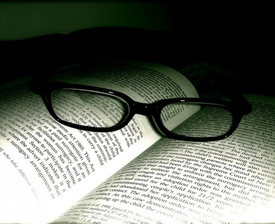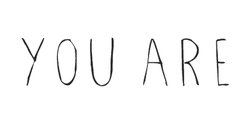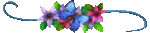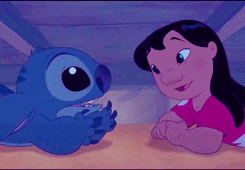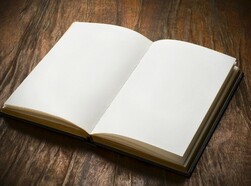-
-
Jean Antoine de Baïf, ce méconnu
Frédéric Fabri

Préface
« Je ne sais plus par quel chemin, voici bien des années, je suis venu à Baïf. C’est, j’imagine, le goût des hommes et des choses de la Renaissance, si vif, dans cette génération, qui m’a conduit vers lui, et aussi peut-être l’attrait de l’inconnu. Ceux à qui j’exposais mon projet me disaient : « Vous ferez oeuvre utile ; mais Baïf est bien ennuyeux »
Je ne serais ni étonné, ni déçu, et je m’estimerai honnêtement payé de ma peine si l’on juge ce livre fait à l’image du poète, hérissé, broussailleux, ennuyeux, - mais utile. »
C’est par ces mots que débute la préface de Mathieu Augé-Chiquet, pour son livre de 1909 intitulé « La vie, les idées et l’œuvre de Jean Antoine de Baïf »
Loin de moi l’envie d’une telle ambition qui consisterait finalement à réécrire ce livre qui n’a pas pris une ride, en corrigeant peut-être quelques petits éléments que de rares personnes contestent. Mais en ouvrant le pdf de ce livre, en format image, j’ai été immédiatement conquis par son humilité, sa sincérité, sa documentation, ses personnages.
Car, si certains chapitres sont techniques, d’autres sont du pur roman historique, dans l’esprit du moins. La vie de Jean Antoine de Baïf mérite un meilleur accueil des lecteurs, même si le poète maudit que je veux ressusciter a été éclipsé dans l’inconscient collectif par ses congénères de l’époque, pour quelques œuvres plus du goût du public, en majorité scolaire. Si cela peut sembler à certains « de l’ordre d’un Dieu qui n’a plus besoin de rien », je suis persuadé quant à moi que traverser cette époque avec un tel compagnon est une opportunité sans pareille.
Le livre étant du domaine public, puisque Mathieu Augé Chiquet est malheureusement décédé fort jeune en 1912 (39 ans), j’emprunterai à celui-ci de nombreux passages, fort bien écrits, mieux en tout cas que je ne saurais le faire moi-même, et j’en résumerai d’autres, tout en rajoutant peut-être parfois quelques éléments historiques afin de bien planter le contexte de l’aventure.
Pour ceux qui n’ont pas peur de six-cent-soixante pages en format image, avec parfois des passages très techniques, mais instructifs, je ne peux que conseiller l’original mis à disposition par l’université de Toronto à l’adresse suivante :
https://archive.org/stream/lavielesideset00auguoft#p...
Pour les autres, j’espère être à la hauteur de leur confiance et de la tâche entreprise.Une enfance studieuse
Jean Antoine de Baïf naît à Venise en février 1532, de mère inconnue, et de père ecclésiastique, peut-être le 19 selon Mersenne dans une de ses œuvres.
Son père, en poste depuis juillet 1529, en qualité d’ambassadeur du Roi de France, alors François 1°, reste discret sur l’origine de l’enfant. Il faut dire qu’en ce même mois de février, l’Abbaye de Grenetière lui est enfin accordée, et qu’il a besoin de cette manne financière.
Piètre diplomate espion, il ne se forme point au contact des maîtres vénitiens aux arcanes de la politiques. Mais il mène grand train, pour représenter dignement son maître, avec table ouverte, pour les seigneurs vénitiens comme les hommes de lettres. Cet humaniste érudit traduit Plutarque, donne des cours de grec, prête libéralement de nombreux ouvrages de sa riche bibliothèque.
« Son obligeance, sa bonté, sa loyauté, sa générosité enfin lui conquièrent la sympathie de tous ceux qui ont l’occasion de l’approcher ».
On ne sait de cette naissance que ce que Jean Antoine en écrira plus tard, dans son « Épitre au Roy », riche en détails auto-biographiques.
Le choix des deux parrains de l’enfant est malheureux. Le cardinal George d’Armagnac, humaniste besogneux, vagabond et hâbleur, vivant de leçons et de dédicaces, ne se préoccupera pas de son neveu. Pas plus que Antonio Rincon, réfugié espagnol, émissaire du roi de passage à Venise, et espionnant le turc Soliman le Magnifique, qui sera assassiné quelques années plus tard par les sbires de Charles Quint. La famille de son père (deux sœurs) l’ignore aussi totalement, sauf quand il s’agit de récupérer une partie de l’héritage.
Son père cependant, dès son retour en France, en février 1534, remplit à son profit un acte officiel de légitimation ce qui à sa mort, évitera à son fils d’être dépossédé.
De bonne heure, l’enfant passe des mains des nourrices et gouvernantes à celles de deux précepteurs, Charles Estienne, pour le latin, et Ange Vergèce pour le grec ancien. Le premier, ami humaniste, érudit et doué, traduisant des œuvres anciennes, imprimant traités élémentaires de grammaire latine… Le second, « écrivain ordinère de François 1, parlant « mauvais françoys et l’écrivant encore plus mal », avait cependant une « gentille main » pour l’écriture grecque, et ce scribe, qui eut de nombreux élèves, fournit les modèles à Garamond pour le gravage de ses caractères d’imprimerie.
Ange Vergèce et Lazare de Baïf se trouvaient à Venise durant la même période. Connaissant l’attrait de Lazare pour les manuscrits grecs, il est fort probable qu’ils se soient connus là-bas. En tous cas, la « patte » du maître se retrouvera dans la main de l’élève par la suite.
Au début de 1540, François 1 le charge d’une mission importante en Allemagne, voyage long et périlleux (la peste y sévit) dont l’enfant est exclu, laissé aux mains de Jacques Toussain. Lazare part le 16 mai 1940, accompagné de Charles Estienne et d’un certain… Pierre de Ronsard, alors âgé de seize ans, au service du Duc d’Orléans, et devant être pour celui-ci ses « yeux et ses oreilles ».
La mission ne dure que quatre mois, mais comme son père est accaparé par de nombreux offices, Jean Antoine restera pensionnaire de Jacques Toussain durant quatre ans.
Celui-ci a étudié grec et latin. Nonchalant et timide, il n’ose écrire, et Bodé, son ami, le pousse à ordonner et imprimer ses nombreuses notes. Si de son portrait, on peut y retrouver les traits d’un savant austère, aux convictions énergiques, il restera à tout jamais pour Jean Antoine ce « Bon Tusan », placide et doux. Ses livres sont considérés comme inférieurs à son enseignement. Qualifié de bibliothèque parlante, il a toujours été exact, net et précis dans ses explications, il était aussi appliqué et modeste. Enfin, il avait l’art d’éclairer les passages obscurs des anciens textes, en s’appuyant sur la grammaire.
De cette période, il semble que Jean Antoine se soit lié durablement d’amitié avec un autre élève, Nicolas Vergece, fils de son premier maître.
Milieu 1544, Son père le confie à Jean Dorat, alors hébergé chez lui. Ronsard, âgé de vingt ans, vient lui aussi profiter de cet enseignement exceptionnel, avec Jean Antoine pour guide, malgré sa jeunesse.
Lazare de Baïf meurt en 1547 et Jean Dorat part enseigner au collège des Coquerets, emmenant ses deux élèves avec lui.
On ne sait exactement aujourd’hui combien de temps ceux-ci restèrent ainsi avec Dorat, ni tout ce qu’il leur enseigna. Néanmoins, la culture « classique » de Jean Antoine à quatorze ans est bien plus étendue que celle de Marot à sa mort : un des effets de la Renaissance, voulus par François 1, du travail acharné des pionniers, et une mission que la Pléiade plus tard voudra prolonger, pour donner à la culture française les connaissances des textes anciens en grec et en latin.
Ainsi, Jean Antoine, comme Dorat, traduira en français de nombreuses œuvres, pour le profit des suivants. Il aura le même goût que son maître pour « l’alexandrinisme, la recherche de l’anecdote historique, des curiosités de l’érudition ».
Si Jean Dorat ne doit pas à ses dons de poète sa place dans la Pléiade, c’est par son érudition et sa qualité de maître « père des poètes » qu’il s’imposa, leur ayant appris leur métier d’écrivains et de versificateurs. Jean le Masle va jusqu’à affirmer qu’il n’est point de poète français « qui ne tienne de lui, et qui n’ait autrefois cueilli les mots dorés de sa bouche sucrée ».
DeVitrac prétend que Dorat savait aussi entrecouper les auteurs anciens avec la lecture de Jean de Meug, Gaston de Foix, Alain Chartier, Villon, Philippe de Commines. C’est imaginé, mais la Pléiade ne méprisera pas indistinctement tous les écrivains qui l’ont précédée.
La disparition prématurée de Lazare, père protecteur aimé, seule famille de son fils non reconnu par les siens laisse le jeune Jean Antoine, orphelin à seize ans aux alentours de début novembre 1547, sous le début de règne d’Henri II.
Si celui-ci s’inscrit dans la lignée de son père François 1 en ce qui concerne les arts et la politique étrangère, il prend dès octobre 1547 des mesures répressives contre les protestants. Il met en place une politique monétaire moins dispendieuse, une administration de cour complètement renouvelée en 1547, de nouveaux impôts et des réformes visant à établir un État puissant au pouvoir centralisé, ce qui ne se fera pas sans heurts intérieurs que les écrivains et poètes ne pourront ignorer.De l’étude à la poésie et aux amours.
On ne sait à quel moment exact Jean Antoine et Ronsard terminèrent leurs humanités au Collège des Coquerets. On les retrouve à Paris, sur les bancs du Collège de Boncourt, écoutant de savantes lectures, comme Jean Passerat débutant, expliquant les commentaires de César. Il passe l’année 1551, moitié à Paris, moitié à Orléans, intéressé par la « Faculté des lois ».
Jean Antoine se lie d’amitié avec Muret en 1551, et il retrouvera chez lui ses amis Ronsard, Jodelle, Nicolas Denisot, Belleau… futurs membres de La Pléiade. A-t-il bien rencontré à Meudon, chez le cardinal de Lorraine, La Boétie auquel est adressé en 1555 un sonnet des « Amours de Francine ».
Comment vit-il ? Le groupe a un mécène, Jean Brinon, qui paie de somptueuses dédicaces. Il participe a une œuvre collective « Le tombeau de Marguerite » pour la sœur de François 1 qui lui donne un peu de notoriété au-delà de son cercle de connaissances. Il a déjà un peu composé : un essai « sur la paix avec les Anglais », un sonnet « Gentil Ronsard » qui sera publié en fin du livre de son ami en 1550. Il ne s’agit pas d’oeuvres très glorieuses, mais Jean Antoine prouve qu’il y maîtrise techniques et clichés de l’époque.
Dans ce contexte poétique foisonnant très à la mode, ami d’un Ronsard populaire pour ses Odes et bientôt pour « Les amours de Cassandre », Jean Antoine publie fin 1552, les « amours de Méline ».
Las. Il n’en retire qu’une polémique qui le fera rager contre un certain « Mastin », un critique peu bienveillant dont nous ne saurons rien. Il quitte Paris, sonne l’hallali, dégorge sa bile en vingt pages de malédictions ininterrompues mais… il n’est pas plus sincère que dans ses vers. Il soutiendra en 1554 que les poètes discourent mieux de l’amour quand ils sont « moins atteints de maladie ». Il n’est pas le seul à ainsi créer de feintes chansons pour « une amour contrefaite » : « chansons », car comme beaucoup de ses amis, il chante ses vers en s’accompagnant de la guitare.
En 1553, à Arcueil, avec ses amis poètes, il se prête à une joyeuse mascarade déguisée en l’honneur de Jodelle, « la fête du bouc », imitation d’un rite païen grec, qui vaudra par la suite quelques tracas à ses auteurs, pour l’avoir chacun racontée dans leurs vers. Ronsard ira jusqu’à effacer les siens pour faire cesser la polémique avec les protestant et le diocèse de Gentilly qui les accuse d’idolâtrie. Jean Antoine la raconte dans son « dithyrambe à la pompe de bouc d’Estienne Jodelle ». Le bouc a t-il bien été égorgé, quoique les participants s’en soient défendus ? Mystère.
En 1554, il est à Poitiers, avec son ami Tahureau, « poète des nuits », gentilhomme du Maine et parent de Ronsard. Il y restera neuf mois.
Poitiers est alors une ville très active, avec nombre de poètes et d’éditeurs hardis et généreux.
Les deux amis fréquenteraient alors deux sœurs, dont l’identité est toujours sujette à caution. Tahureau a souffert avec Marion, chantée dans « l’Admirée », mais point de trace de la rupture. La femme avec laquelle il s’est marié, Marie Grené, n’est pas la sœur de son ami Guillaume de Gennes. (Source : La vie de Tahureau, par Henri Chardon 1885). Jean Antoine sera présent à son mariage dans le Berry.
Malheureusement, Tahureau meurt à Paris quelques semaines plus tard, en 1555, mort « poétiquement » attribuée à Marie qui l’aurait « épuisé ». Il faut dire que ses amis qui avaient perdu un célibataire endurci n’avaient pas vu ce mariage d’un bon œil.
Quant à Jean Antoine, il tombe réellement amoureux de « Francine », qui qu’elle soit vraiment, mais son affection n’est pas réciproque. Il feint un temps d’avoir conquis la belle pour mieux implorer le pardon de son mensonge. En vain. Le livre paraîtra en 1555. Il tentera une nouvelle approche cinq ans plus tard, sans succès.
À noter entre 1554 et 1555 sa brouille avec Ronsard, certainement sur des malentendus et quelques ragots en sus de propos aigre-doux. Mais Jean Antoine en éprouve du chagrin, tend quelques vers à son ami. Des amis se chargent alors d’organiser une réconciliation définitive.
Jean Antoine rentre à Paris, où ses amours de Francine remportent un vif succès. De ses premières années d’écriture subsistent des « baisers », des œuvres un peu licencieuses, dont il s’est vite détourné. Son « pétrarquisme » s’affirme, ainsi qu’une certaine influence « Bembiste ». Il pille aussi (« emprunte sans cesser d’être original ») sans essayer de dissimuler jusqu’aux plus prestigieux. Ainsi, il concourt à la diffusion en français de nombreuses œuvres italiennes, retouchées pour l’occasion. Cependant, on croit parfois qu’il a traduit tel ou tel sonnet, mais l’original n’existe pas.
« Il imite les textes, transpose les thèmes, pétraquise et bembise les yeux fermés » puis il rejette cette défroque lyrique en s’éloignant de la poésie amoureuse… comme une libération. Il en a cependant tiré la quintessence des règles et procédés.Poète à la Cour
Malgré l’accueil flatteur de ses amis pour ses « amours », sa « docte lamentation » sur son insuccès, il faut reconnaître, et Ronsard le fera, que ces œuvres sont indignes du talent de Jean Antoine. Celui-ci admet être un peu « paresseux à se repolir ». Pire, il avoue écrire pour lui : « Mon but est de me plaire aux chansons que je chante ».
Mais ce n’est que feinte. La poésie lyrique n’est pas son domaine de prédilection même s’il en a démonté les mécanismes et compris, voire théorisé les règles.
Il voyage. Début 1556, il est dans la Sarthe, chez Jacques Morin, conseiller au Parlement de Paris. Il ne se rend qu’une seule fois en Italie, histoire de se ressourcer mais, peu observateur, il note que les gens sont les mêmes partout.
Pour vivre, moins favorisé que Dorat et Ronsard, sans famille, il fréquente assidûment la cour d’Henri II et fait payer nombre de dédicaces, épithalames, tombeaux, épitaphes, épigrammes, poèmes officiels et autres œuvres de circonstance tandis que dans le même temps il continue ses traductions, et écrit même trois œuvres de théâtre dont l’une sera jouée : « Le brave » et « l’eunuque », deux comédies, et une « Antigone », où il ne se contente pas de traduire, mais bel et bien d’adapter le théâtre grec au goût français. Il s’autorise ainsi hardiment quelques arrangements et rajouts personnels. Selon ses pairs, il aurait pu être un bon auteur dramatique mais Jean Antoine ne s’y investira pas plus, malgré un réel talent en la matière. Il aurait aussi mis en français en autres la « Médée » d’Euripide et le « Platon » d’Aristophane Malheureusement, ces ouvrages sont perdus.
Pour la « Franciade », œuvre collective de la Pleïade, il écrit « Genevre » et « Fleurdepine », deux poèmes d’aventures. Mais Ronsard n’achève pas le projet et l’édition est un échec en 1562.
Même si tout est prétexte pour se faire remarquer des puissants, il écrit pour de nombreux fonctionnaires voire petites gens (jusqu’au « capitaine d’argoulets et couppejarrets »), loue aussi les autres poètes, versifie des faits historiques comme la prise de Calais…
Il charge aussi des amis de transmettre aux puissants à l’étranger ses recueils de poèmes qu’il dédicace en vers, espérant des « commandes » pour se faire « immortaliser, moyennant un honnête salaire ».
Malgré tout, si ses vers sont pesamment assenés, c’est parce qu’il est au fond malhabile à flatter, qu’il souffre d’une gaucherie naturelle et qu’il doit lui rester encore un peu de fierté dont il n’a su se défaire, malgré les flatteries distribuées « à pleins sacs ».
Il n’en obtient que de modestes charges, parfois fictives parce que non-payées, comme « secrétaire de la chambre du Roy », et de petites cures catholiques. Plus ou moins payé pour ses nombreuses œuvres, copiées, apprises par cœur et colportées par d’autres à la cour, il ne récolte que des succès éphémères sur des œuvres « illisibles » aujourd’hui, et pourtant écrites en vers grecs, ou latins, ou français rimé et mesuré, voire les trois à la fois.
Grâce à une de ces « petites cures », on apprend qu’en 1564 Jean Antoine habite sur les fossés près de la porte Saint Marcel et de la porte Saint Victor au pied de l’ancienne enceinte de Philippe Auguste édifiée vers 1200 dans l’actuel cinquième arrondissement de Paris.
Il parvient quand même à se faire remarquer par Catherine de Médicis, pour laquelle il écrira « Les météores » en 1567 (L’églogue premier est sien, puis il s’inspirera de l’italien Giovanni Pontano, de Virgile et de Bion). Mais comme pour ses églogues, écrites pour la plupart avant 1560, il n’en tire aucun succès.
Il bénéficie aussi, dès le règne de François II, d’une pension de douze cents livres, ce qui est considérable pour l’époque mais ne semble pas le satisfaire surtout qu’il prétend qu’elle ne lui ai pas toujours payée.
Dès 1567, il prépare son idée d’« Académie de musique et de poésie », car les poèmes sont chantés, et les premiers vers mesurés le sont avec la lyre. Le jeune roi lui-même, comme son père, aime s’accompagner d’un lutrin. Jean Antoine pratique aussi la guitare espagnole. Malgré l’opposition du Parlement, L’Académie, créée le 15 novembre 1570 par Charles IX se réunit à la maison du poète. Il veut unir plus étroitement musique et poésie, avec des lois communes, en appliquant les vers mesurés à l’antique, une réforme de l’orthographe et de la prononciation, et de distinguer par des signes les syllabes longues des syllabes brèves. Son expérience et ses études personnelles en matière de poésie sont précieuses et il partage son savoir avec Claude Lejeune, Eustache de Caurroy, Jacques Mauduit…
1570, c’est aussi l’année où Jean Antoine publie « les étrènes de poézie fransoeze en vers mezurés », une tentative de réforme de l’orthographe en écrivant phonétiquement, en éliminant les lettres superflues, en créant des caractères alphabétiques supplémentaires.
Imaginez ce que serait l’orthographe aujourd’hui si Jean Antoine avait réussi à l’époque à persuader tout le monde d’employer « l’egzakte ékriture konform o parlèr an tous les élémans d’iselui ».
En 1573, Charles IX lui donne « moyen et courage » de réunir et publier ses vers. Ce sera « Euvres en rime », travail selon lui de vingt-trois années. Malheureusement, dans cette œuvre considérable, il a aussi intégré nombre de rogatons, ébauches, rognures, épreuves manquées… Il a aussi retouché ses œuvres, en particulier les « amours », malgré ses dires, car sur cette, la langue poétique a évolué, ainsi que la grammaire.
A quarante ans, dépité, il s’estime « pauvre », une pauvreté relative par rapport à Jodelle, mort dans la misère, mais bien en dessous du niveau de vie de ses amis Ronsard et Dorat.
Pourtant, avec eux, il distrait le roi Charles IX quand il ne peut aller à la chasse à cause du mauvais temps ou de chaleur extrème.
S’il faut voir dans l’expression de cette pauvreté une obligation quasi-professionnelle de quémander faite à l’artiste de l’époque, en plus dans une période troublée et de vaches maigres pour beaucoup après la prodigalité des Valois, il y a aussi pour Jean Antoine de la déception, car malgré ses efforts et sa notoriété, il reste dans l’ombre de Ronsard en particulier et quelques autres autour de lui tirent mieux les marrons de feu qu’il ne sait faire. L’argument financier n’est qu’un exutoire et un argument pour l’extérieur pour masquer cette « injustice » qu’il ressent. Nous verrons par la suite qu’il a été souvent spolié, à des niveaux divers.
« Je cuidoy pour avoir salaire
Que ce fust assez de bien faire
Et qu’ainsi l’on gangnoit le pris.
En cette sote fantaisie
Le métier de la Poésie
J’ay mené bien près de vingt ans. »
Sous Henri II, durant les années 1550, le protestantisme se répand malgré les édits répressifs et la situation se tend dès 1557 de manière inquiétante, avec des émeutes de réformés et une tentative d’assassinat du roi. En 1559, l’édit d’Ecouen stipule que tout protestant révolté ou en fuite sera abattu. Le 10 juin, le roi embastille ceux qui critiquent sa politique. Tous se rétractèrent sauf Anne du Bourg qui quelque mois après, malgré la mort du roi due à une blessure en tournoi, sera brûlée vive.
Le traité du Cateau-Cambrésis en 1559, entérine un déclin militaire face à l’Espagne et l’Angleterre et la fin des guerres d’Italie.
Le règne de François II à partir de 1559 est dominé par une importante crise politique, financière et religieuse. Les Guise qui ont la faveur du Roi, sont perçus comme des étrangers et sont les garants en France de la religion catholique. La « conjuration d’Amboise » menée par des protestants pour retirer le jeune roi de la tutelle des Guise échoue. La répression fera entre 1200 et 1500 morts. Mais la province se soulève avec l’appui secret des deux premiers prince de sang, Condé et Navarre. Condé est arrêté le 31 octobre 1560. Le roi meurt en décembre et Catherine de Médicis le fait relâcher. Charles IX est roi à dix ans. Les guerres de religions débutent en 1562 et Jean Antoine ne devait jamais en connaître la fin, même si les périodes de paix alternent avec de nouvelles hostilités, des massacres et de cruelles exécutions. Condé meurt assassiné après sa reddition durant la Bataille de Jarnac en 1569 face à Henri d’Anjou. Nouvelle paix, dite de Saint Germain en 1570.
En 1572, alors que le mariage de la sœur du Roi, Marguerite, avec le prince de Navarre, futur Henri IV semble être un gage de réconciliation durable, (Jean Antoine leur a dédié ses « Devis des Dieux), un attentat quatre jours après contre Gaspard II de Coligny, chef des Huguenots, fait craindre à Charles IX un nouveau soulèvement et il organise l’élimination des chefs protestants, sauf le prince de Condé et Henri de Navarre. Cette décision déclenche le massacre de la Saint-Barthélémy, avec de terribles exactions de la part de l’entourage royal. La guerre reprend dans le royaume (siège de la Rochelle) et le roi, en 1573 est fort faible.
À la cour règne donc une atmosphère de peur et de complot, peu favorable aux poètes et à l’optimisme.Sous le règne d’Henri III
Le 31 mai 1574, Charles IX s’éteint. Ambroise Paré procède à l’autopsie et confirme la mort par pleurésie.
Son frère Henri, alors roi de Pologne, ex-duc d’Anjou, s’enfuit de son palais pour prendre le trône de France. D’emblée, il doit faire face à la guerre et aux complots à la cour, fomentés par le duc d’Alençon, et du roi de Navarre (futur Henri IV)
Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d’Henri III et entame la sixième guerre de religion.
Privée de son parrain, l’activité de l’Académie de musique et de poésie décline.
Et pourtant, Baif qui à cette époque est l’écrivain qui a composé le plus de vers mesurés et de poèmes de toutes sorte. Les vers rimés lui semblent une mode barbare. Mais il doit s’y replonger, et ne publie pas la plupart de ses œuvres en vers mesurés de cette période. Du Verdier, Binet, Boissard, Rapin, Sainte Marthe saluent en lui le rénovateur de cet art, et attribue l’insuccès de Baif aux préjugés du public et au « style ferré » du poète. Il en est aujourd’hui considéré comme l’inventeur, par ceux bien rares qui le connaissent, bien sûr.
A suivre... votre commentaire
votre commentaire
-
Cycle Bêta
Frédéric Fabri

Préface
Je ne connaissais Frédéric que sous un avatar virtuel jusqu'au jour où il m'a demandé de préfacer son premier roman. Ému, j'ai commencé à lire pour me faire une idée. J'avais peur de retomber dans la collection Fleuve Noir que je lisais en cachette durant mon adolescence. Je me disais, « Bon, encore un qui va nous téléporter sur des rayons verts et autres trucs pas possibles. »
Et je me suis trompé. J'ai rapidement été conquis par l'histoire qui, même si elle recèle de profonds termes et descriptions techniques incompréhensibles à un non-scientifique, m'a scotché à plusieurs points de vue.
Je connaissais l'ouverture d'esprit, la franchise et les engagements de Frédéric, j'ignorais son côté conteur de belles histoires. Je n'ai pratiquement pas quitté Alsyen, cette petite bête que vous allez découvrir et qui donne à l'auteur ce détachement indispensable au bon déroulement de l'histoire.
Le caractère humain et parfois bestial de l'histoire ne vous échappera pas. Même si j'ai regretté à quelques moments que Frédéric ne se lâche pas un peu plus, j'ai découvert une aventure qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout et dont je n'ai qu'un mot pour la résumer : à quand la suite ?
Merci Frédéric de tes mots qui m'ont allumé, parfois subjugué, souvent distrait de ce monde que je croyais sans vie. Merci, Frédéric d'avoir pu m'apporter ce rayon de soleil indispensable à la vie, merci Alsyen de m'avoir fait vivre d'heureux moments.
Comment ?Vous n'avez pas encore commencé la lecture ?
Qu'attendez-vous ?
Denis NerincxAvertissement de l'auteur
Premier roman, premier tome d'une trilogie, ce « Cycle Bêta » décrit le parcours et la formation d'une jeune recrue des temps futurs. L'espèce humaine est alors en pleine expansion. La barrière de la vitesse de la lumière n'a pas été franchie. Aucune intelligence extra-terrestre n'a été rencontrée. Enfin presque…
Les robots sont peu nombreux et spécialisés. Les ordinateurs permettent l'entraînement par la simulation. La vie des militaires est rustique, les efforts sont aussi physiques.
Dans ce contexte, on peut dire que les progrès techniques ne sont pas très nombreux. Il n'y a pas de produits miracle. Il n'y a pas une société utopique. L'aventure reste humaine.
Mon passé de militaire m'a servi pour illustrer la vie quotidienne du héros. L'exemple de certains de mes chefs aussi. Certains pourraient estimer que cette organisation militaire « idéale » est propagandiste. Des militaires pourraient nier certaines critiques ou pratiques brutales. Ils ont tous raison. Les défauts mis en avant ont été empruntés à une vieille expérience. L'idéal mis en avant est le modèle qui était vanté à mon départ de l'institution. Et le tout a subi les influences du roman et de l'adaptation à une société futuriste. De plus, la première partie de la formation a été réalisée sur Terre avec des cadres qui ne savent plus ce que c'est que la guerre. Ils appliquent un « manuel » sans en comprendre le fond et avec ennui car ils se répètent à chaque contingent. Dans l'espace, les recrues sont prises en main par des gens d'expérience et quisont du métier. On peut donc voir l'analogie que j'ai faite entre l'armée d'appelés d'avant 1998 en France, (même la formation était assurée par des « intérimaires ») et l'armée professionnelle d'aujourd'hui, où le rôle de chaque individu compte et justifie une permanente recherche de l'excellence.
C'est aussi la description du passage de l'adolescent au stade adulte, comme du civil scolaire au soldat confirmé. Cette aventure profite de différents décors, de circonstances, d'un processus comme d'une évolution intérieure. Ce qui ne rentre pas par les yeux et les oreilles passe par les pieds.
Alsyen n'est pas un simple faire-valoir qui se transforme en « Deus ex machina » dès que le besoin s'en fait sentir. Il est à la fois témoin et acteur. Par son œil étranger, et son histoire personnelle, il démontre que pour notre société humaine, d'autres choix sont possibles et que nous sommes encore nous aussi des enfants dans l'évolution. Par son amitié avec Reno, il franchit les espaces interraciaux alors que nous n'avons pas encore globalement réussi à franchir l'espace entre deux religions ou deux ethnies au sein de notre propre espèce. Et pourtant, heureusement, notre « jeunesse » dans l'évolution a quelque chose à lui offrir, à lui, le jeune d'une société « mâture ». Enfin, mes personnages ne sont pas des philosophes ni des êtres parfaits. Ils sont juste honnêtes, droits et recherchent un but digne de leurs efforts. Mais ils sont aussi de chair et de sang.
Les distances aussi sont « en taille réelle ». En interplanétaire, il faut compter entre l'accélération et la décélération qui sont les phases les plus longues. Au quart de la vitesse lumière, qui est « physiquement » la limite atteinte, il faut vingt ans pour arriver sur Alpha du Centaure, et quand même six ans pour l'atteindre sous forme dématérialisée. Cela symbolisela distance entre la recrue et le monde qu'il a quitté, ainsi que ce que peuvent connaître les expatriés au bout du monde. La distance physique interdit le contact et isole. Il se crée alors une distance temporelle, entre l'endroit où on est qui évolue lentement sans qu'on s'en aperçoive après qu'on l'ait découvert, et l'endroit où on revient qui lui a changé d'un coup. La gestion des distances a de tout temps été le souci des sociétés en expansion.
Néanmoins, l'homme n'évolue pas vite et si les sociétés s'adaptent aux éléments ambiants, elles retombent vite dans les mêmes travers. Le lecteur sera donc dépaysé sans être en territoire inconnu. Mon ambition n'a pas été de concurrencer des films tels la saga « StarWars », mais de faire parfois des clins d'œil aux classiques de Jules Verne, auteur qui expliquait scientifiquement ce qui n'existait pas encore, ou faisait du « journalisme » sur les territoires traversés en racontant l'histoire, les conditions géographiques, le système social… enfin, tout ce qui venait enrichir ou contrarier l'aventure personnelle des héros.
Car, ce roman se veut être plus une aventure qu'une histoire de science-fiction, qu'il s'agisse de défi personnel, d'obstacles à franchir, d'épreuves à surmonter ou d'objectif à atteindre…Frédéric FABRI
P.S : je tiens ici à remercier Denis pour son soutien « technique » ainsi que mes lecteurs « Bêta », en ligne comme sur papier, qui m'ont soutenu moralement lors de l'écriture et de la correction.
Débarquement sur B-112
Le jeune homme qui posait le pied sur Bêta-112 ressentit une intense bouffée d'émotion teintée d'appréhension. C'était la première fois qu'il foulait le sol d'une autre planète que la sienne, Alpha Prime, autant dire La Terre.
Il était le dernier du groupe de soldats s'extrayant d'une navette mi-hélicoptère, mi-hydroglisseur utilisée pour débarquer des troupes en provenance de leur vaisseau amiral, resté en orbite haute.
L'espace était colonisé par « cercles » autour du système planétaire central, codés selon l'alphabet grec, en hommage aux premiers astronomes utilisant des lettres et non des hiéroglyphes. La première expédition avait quitté la terre trois cent ans auparavant, avec dans ses soutes un régénérateur moléculaire. Elle avait atteint Pluton l'orbite servait maintenant de base de départ pour les expéditions.
L'exploration spatiale utilisait deux principes complémentaires pour son expansion. Tout d'abord, un vaisseau classique partait avec à son bord un régénérateur moléculaire. Il pouvait atteindre après une longue accélération la vitesse de 0,21 fois la vitesse de la lumière, soit environ cinq fois moins vite.
Cela équivalait tout de même à six mille kilomètres par seconde ! Mais il fallait aussi songer à la longue décélération.
Une fois arrivé à la destination voulue, le régénérateur moléculaire était installé. Les techniciens établissaient le « pont » avec le premier régénérateur grâce à un rayon lumineux envoyé déjà quelques années plus tôt et qui leur avait servi de fil guide durant le voyage. Une fois opérationnel, le « pont » permettait un voyage dans un état dématérialisébien plus rapide puisque proche de la vitesse de la lumière dès le départ et sans obligation de décélération.
Pour un engin spatial, la vitesse de pointe n'était pas accessible dans le seul périmètre du système solaire.
L'espèce humaine enfin unifiée avait planifié son expansion en commun. Pour commencer, elle avait utilisé un énorme vaisseau construit en orbite terrestre pour atteindre Pluton et durant quarante ans y avait construit une base devant servir de « grand échangeur inter-galactique », point de passage obligé pour tout départ vers les étoiles.
Une fois le régénérateur moléculaire monté sur l'orbite de Pluton , un pont d'énergie avait pu être établi avec la station du Pôle Nord. Ce pont, sorte de tunnel d'informations énergie, permettait physiquement la désintégration et la reconstitution d'organismes vivants, de matières brutes ou de matériels sophistiqués. Le régénérateur pouvait servir, soit de point d'arrivée, soit d'amplificateur pour relayer le flux au régénérateur suivant, bien au-delà. Le système très sophistiqué de redondance de l'information permettait la reconstitution parfaite d'un individu viable et le cerveau n'était pas affecté par des pertes de mémoire.
Le flux, bien que composé de protons, se comportait comme un flux lumineux sauf que sa vitesse n'excédait pas 0,91 fois la vitesse d'une lumière classique. La technologie pour maîtriser le boson restait inaccessible et le proton était plus fiable que l'électron pour transmettre l'information.
Pluton fut aussi colonisée pour servir l'expansion afin de fournir matériaux et grosses pièces d'infrastructures, trop coûteuses en énergie à faire venir de la Terre ou de Mars. L'expansion se plaçait dans la durée. Les solutions retenues devaient être pérennes et non servir une cause éphémère. Une fois la base au sol construite, un autre régénérateur avaitdonc été installé sur Pluton afin de recevoir directement les hommes et du matériel. C'était donc des centaines de milliers d'ouvriers et des millions de tonnes de matériel qui avaient permis de rendre Pluton viable, et d'exploiter ses gisements de minerais
Ce régénérateur pouvait aussi servir de régénérateur de secours, mais dans les faits il fournissait l'orbite de Pluton en pièces locales.
Ce « trio » de régénérateur moléculaire permit de mettre au point le fonctionnement et la doctrine d'emploi d'un régénérateur dans le cadre des missions au long cours.
Un régénérateur moléculaire se composait d'un ensemble fixe composé d'une extrémité émettrice fixée sur un corps servant à la dématérialisation des éléments à expédier, d'un second module servant à la rematérialisation et d'une extrémité réceptrice.
Le flux émis était envoyé sur un miroir distant de plusieurs centaines de kilomètres chargé de le réfléchir dans la bonne direction. Il traversait ensuite l'espace pour rencontrer aux alentours de sa destination un autre miroir qui le dirigeait alors sur la partie arrière d'un autre régénérateur moléculaire. Ce régénérateur pouvait alors, soit réexpédier le flux amplifié vers son miroir situé à l'avant pour être envoyé vers un régénérateur plus distant, soit rematérialiser les éléments transportés par le flux.
Chaque régénérateur pouvait se tester seul grâce à ses deux miroirs. Les miroirs eux se calaient avec un rayon lumineux à travers l'espace et le temps. En effet, la position relative des miroirs placés jusqu'à cinq années lumière de distance évoluait à chaque seconde de plusieurs centaines de kilomètres. Mais de façon régulière et de manière imperceptible au niveau angulaire.
Les principes du voyage, bien compliqués, entre la dématérialisation, le flux lumineux, le guidage et le temps étaient sommairement expliqués auxvoyageurs avec des images de synthèse mais tous préféraient faire confiance et en accepter l'existence plutôt que de rechercher des explications qui les auraient incités à prendre des vaisseaux spatiaux classiques, mais bien moins rapides et qui surtout les laisseraient vieillir durant le voyage.
Les espaces interstellaires sont tellement vastes qu'il avait fallu quarante ans et quelque (un milliard de secondes) pour atteindre trois destinations (deux vaisseaux étaient considérés comme perdus) et bâtir le premier cercle Bêta à seulement 60000 milliards de kilomètres, soit 1,6 parsec ou 4,9 années lumières.
À l'issue de ces quarante années de difficile traversée pour l'équipage cloîtré et vieillissant parti fort heureusement avec des enfants, un régénérateur avait été installé près de Proxima du Centaure. Sous la forme d'un faisceau de protons, il ne fallait plus alors que cinq ans et demi à un voyageur dématérialisé aux environs de Pluton pour être régénéré à l'identique sur ce qui allait devenir une station du second cercle ou Cercle Bêta. Pour communiquer avec la terre, les signaux lumineux ne mettaient que six mois de moins.
Au moment où ce soldat posait le pied sur B-112, il y avait cinq cercles, correspondant à trois-cents années de voyages classiques consécutifs et permettant à un terrien de parcourir les vingt-huit années lumières de distance entre la terre et êta-prime, base la plus éloignée, en trente et un an.
Vingt-neuf stations de régénérateur moléculaire opérationnelles avaient été déployées. Si des planètes avec des formes de vie avaient été découvertes, aucune intelligence, et encore moins de puissance galactique n'avait été rencontrée.
Autour de chaque base la colonisation s'établissait, afin de découvrir etd'exploiter les matières premières permettant la poursuite de l'exploration.
Un corps militaire planétaire avait été créé pour protéger les colons dès le début de leur implantation :la Force de Colonisation Planétaire ou FCP.
Quelques membres partaient avec le vaisseau d'exploration, représentant dix pour cent des contingents coloniaux à la sortie des régénérateurs.
Tous les jeunes engagés passaient par une station Bêta avant de rejoindre les confins de l'univers connu. Le décalage temporel avec la terre n'était que de cinq ans et demi en moyenne quand ils étaient régénérés. L'aller-retour durait donc onze ans. S'ils le désiraient, ou parce qu'ils n'étaient pas certains de leur choix dans leur première année de formation, ils ne pouvaient retrouver leur famille que douze ans plus tard.
À l'issue de cette année de formation (Quatre mois sur terre, huit mois dans la zone Bêta) ils obtenaient une affectation, déterminée par leur choix personnel, mais ensuite en fonction des besoins des FCP et de leur classement, situées dans des systèmes plus ou moins proches. Partir pour le quatrième ou le cercle extérieur signifiait effectuer un voyage sans retour. Quel intérêt de revenir sur Terre soixante-deux ans plus tard au minimum ?
Ce jeune garçon de dix-huit ans s'appelle Reno. Il a suivi quatre mois d'instruction en Sibérie pour apprendre les principes du combat d'infanterie. À bord du vaisseau station caserne il a appris la vie de marsouin de l'espace et son rôle d'adjoint fourrier. Aujourd'hui, il étudie le déplacement en groupe de combat pour la première fois en situation inconnue sur une planète de type terrestre, où l'air est respirable. Bien bâti, il laisse une franche trace de botte taille quarante-deux sur le sol un peu spongieux de Bêta-112 parachevant ainsi le piétinement du reste dugroupe, suivant son chef qui ouvre la marche à travers la savane bleue.
C'est un petit pas pour lui, mais il survient après de nombreuses avancées pour l'Homme.
*
* *
Glyon et Alsyen se baignaient en toute tranquillité sur cette planète de type végétal. Il n'y avait pour eux aucun danger d'agression. L'analyse toxicologique de la mare avait révélé une eau quasi pure filtrée par les roseaux, et aucun composant chimique ne présentait les caractéristiques d'un poison potentiel.
Leur vaisseau spatial de petite taille était camouflé par un écran de force cylindrique qui restituait la lumière au coté opposé de sa réception ce qui rendait l'espace protégé invisible. Il était aussi impossible de traverser cet écran. Il arrêtait même les ondes lumineuses ou radios sauf les fréquences en parfaite opposition de phase. Cette fréquence servait entre autre à la télécommande du champ de force. Mais, matériaux, ondes de chocs, bruits ne pouvaient ébranler cet écran.
Celui-ci servait aussi lors de la navigation spatiale afin d'éviter les collisions avec la poussière d'étoile ou les morceaux plus petits dans les phases de déplacement local. Il n'avait jamais été utilisé durant une guerre, les races de la galaxie Zannienne étant pacifiques, mais nul doute qu'il était indestructible.
Glyon et Alsyen, deux adolescents insouciants, avaient violé les limites de l'espace interdit. La race humaine, détectée dès son arrivée, avait été jugée trop peu évoluée pour pouvoir s'intégrer dans la fédération multiraciale de Zanni. La zone étant déserte, elle avait été laissée aux humains. Les détecteurs du vaisseau de plaisance Zannien avaient sondé seulement la planète à l'arrivée et non l'espace immédiat. Pour ses deux occupants, La planète était donc libre pour le jeu et la recherche de philloxphène, une plante prohibée dont les effets euphorisants agrémentaient les soirées pimentées de l'élite Zannienne.
Ils en avaient consommé quelques extraits et ils riaient à gorge déployée. Glyon lança Alsyen en l'air et alors qu'il allait le rattraper, un bruit de tonnerre lui emporta la moitié du crâne. L'onde de choc du projectile sonique atteint aussi Alsyen qui sombra dans l'inconscience.
*
* *
— Qu'en pensez vous Docteur ?
— Bizarre. Cette planète est considérée comme sans faune. On n'y a même pas trouvé d'insectes terrestres et il n'y a que quelques vers dans l'eau. Aujourd'hui vous me ramenez d'un coup deux espèces évoluées différentes. Il est dommage qu'il y ait un cadavre dans le lot.
— Si je n'avais pas tué celui-ci, vous seriez allé chercher l'autre dans son estomac.
— Certes. Mais ces deux espèces ne semblent pas partager le même biotope. L'une semble amphibie alors que l'autre est manifestement arboricole, ce qui ne colle pas à cette planète seulement colonisée par des herbes géantes.
— Le petit singe a des ventouses aux doigts. C'est peut-être pour monter à la cime de ces herbes comme le long d'un mât. Et s' il est petit, c'est pour ne pas les plier.
— Et il se nourrirait alors des graines aux extrémités ? Oui, pourquoi pas.
— L'autre me semble d'une force phénoménale.
— Effectivement. Des membres inférieurs très courts pour marcher, mais pas pour courir. Un corps massif et six tentacules terminés par des doubles pinces. Une tête couronnée d'yeux dont certains surveillent en l'air. On ne distingue l'avant de l'arrière que par cette gueule impressionnante.
— Le croyez vous herbivore ?
— Plutôt omnivore. Il a des molaires plates, des canines et des incisives. Ses pinces peuvent griffer comme attraper. Au corps à corps, il s'avérerait mortel pour n'importe lequel d'entre nous malgré sa taille d'un mètre cinquante. C'est un danger potentiel qu'il va falloir cataloguer. En tout cas, je vais préconiser au commandement que toutes les sorties se fassent en armure et que personne ne se retrouve isolé.
— Mes camarades n'étaient pas loin. Je m'étais éloigné un peu juste pour une envie pressante avec l'accord de mon chef de groupe. Après mon tir, ils étaient tous là en moins de deux minutes.
— Si cette bestiole avait été tapie dans les herbes et avait surgi à un mètre de vous, il lui aurait fallu trente secondes pour vous estourbir et vous entraîner sous les eaux . En tout cas, soldat, c'est une belle prise.
— Que va devenir le petit singe ?
— Je vais l'observer quelques temps, puis j'en ferai une petite étude plus poussée. Enfin, il rejoindra les autres spécimens dans mes bocaux sur les étagères.
— Alors je ne l'ai pas vraiment sauvé en fin de compte…
— Vous l'avez au moins sauvé de l'oubli…
Alsyen a repris connaissance depuis un moment déjà dans sa petite cage. Même s' il n'a pas compris les paroles des deux humains, il en a saisi le sens émotionnel, surtout dans celles de Reno.
Avec effroi, il a aussi constaté la mort de Glyon, son Zymbreke.
La dépouille de celui-ci qui avait été à la fois son protecteur, son serviteur et son ami lui inspire de la peine, de la souffrance, ainsi qu'un sentiment de solitude de culpabilité et de crainte pour son avenir. Il n'a pas l'intention de finir son existence plongé dans une solution d'alcool.Évasion
Dans le dortoir, il règne une bonne ambiance festive. Les douze jeunes recrues qui dorment sur des couchettes superposées (par trois) fêtent leur sortie sur B-112 autour de la table commune centrale. Tous les écrans sont repliés dans le plateau. L'heure n'est pas à l'instruction. Chacun tient dans sa main une brique de C'fet, une boisson euphorisante, au goût d'alcool, avec des psychotropes non dangereux pour la santé, efficaces très rapidement, mais aussi brièvement, et n'entraînant ni ivresse ni dépendance.
Reno raconte pour la énième fois son tir sur la créature des marais, avec toute l'assurance d'un exterminateur de monstres galactiques, puis le bain qu'il a pris pour aller récupérer le petit singe inanimé (et peut-être même mort de peur), avant qu'il ne se noie.
Il rit un peu moins quand il raconte comment le sergent l'a envoyé chercher le corps de sa victime. Cependant il l'imite tant bien que mal, reprenant tous ses sarcasmes.
« Vous qui êtes déjà mouillé… qui vous êtes jeté pour sauver des eaux un singe au mépris des risques considérables d'attaques de redoutables créatures sous-marines… qui d'ailleurs vous ont déjà épargné une fois… allez donc maintenant nous ramener votre monstre sanguinaire»
Malgré toutes ses moqueries, alors que Reno s'embourbait une deuxième fois, le sergent avait quand même allumé son détecteur afin de s'assurer qu'aucun autre intrus ne surgisse à l'improviste. Cette présence de prédateur était plutôt imprévue.
Cette fois, Reno avait dû toucher le corps hideux, caoutchouteux et sanguinolent. Il l'avait tiré par deux tentacules jusqu'à la rive et ses camarades un peu effrayés l'avait aidé à le sortir de l'eau.
Ensuite, à l'aide de quelques herbes assez rigides, ils avaient confectionné un brancard de fortune pour pouvoir le ramener jusqu'à la barge.
Ils avaient marché trois heures et les autres se moquaient de la boue séchée qui maculait son uniforme. L'adjudant à son arrivée lui jeta un « Alors Reno, le terrain était glissant ? » avant de s'enquérir du mystérieux cadavre auprès du sergent.
Trois briques de C'fet plus tard, Reno épaule toujours son fracasseur, mais se propose en plus de faire sauter au passage la tête du sergent, bien moins sympathique selon lui que celle d'un acarien grossie trois-cent-cinquante-mille fois.
Si ses accents de matamore provoquent une certaine hilarité, c'est parce que Reno n'est pas ce qu'on pourrait appeler un foudre de guerre. Un peu rêveur, assez distrait, plutôt malchanceux, il s'est vite fait remarquer à l'instruction pour son équipement toujours incomplet, sa maladresse et sa poisse, ce qui en a fait très vite le souffre-douleur préféré des cadres et l'attraction de la section. Sa gentillesse et sa camaraderie l'ont tout de même fait accepter par les autres recrues, bien contentes qu'un seul assume ce qui sinon serait distribué plus aléatoirement. Car si Reno est là, c'est que tout le monde est présent, si Reno y arrive, les autres doivent y arriver aussi, etc. etc.
Et ce pauvre Reno sert de cobaye pour n'importe quelle démonstration de close combat, d'obstacle à franchir ou de question de contrôle…
Ce soir malgré tout, il est envié même si son triomphe se change petit à petit en farce tartarine.
*
* *Dans le laboratoire, Alsyen est sorti de sa cage et explore la moindre anfractuosité des murs et du plafond. Il est allé fermer les quatorze yeux restants (sur vingt) de Glyon allongé sur une paillasse et il lui a péniblement arrangé les tentacules autour du corps, avec les extrémités sur sa poitrine. Il ne sera certes pas enterré ainsi, mais au moins, si son âme se retourne un instant, elle verra que son compagnon ne l'a pas oublié.
Il a compté six grilles de ventilation et chose bizarre, sur chacune des ouvertures, il y a des système de fermetures étanches automatiques. Alsyen n'en a pas encore tiré toute la signification. Il veut croire à un abri de campagne protégé d'une éventuelle contagion de l'extérieur, ou à une pièce pouvant abriter des expériences dangereuses qui pourraient s'avérer contagieuses, voire contenir des animaux encore plus petits que lui qui ne doivent à aucun prix s'échapper entre des grilles, comme des serpents par exemple …
Mais il n'a pas de tournevis pour les démonter de leur cadre…
Alsyen, bien qu'il ait enfreint les règlements en franchissant les limites interdites est tenu par le respect des règles de survie pour sa race. Les Humains, trop immatures, ne doivent pas découvrir l'existence d'une autre espèce intelligente. Donc, il ne doit pas tenter de communiquer pour se faire reconnaître et obtenir sa libération. Il va devoir jouer serrer.
Et pour l'instant, il est de retour à sa cage, qu'il a correctement fermée pour réfléchir en toute quiétude.
Primo, il ne doit pas rester sous le coude du scientifique. Sinon, il va y passer très prochainement.
Secundo, il est nu. S'il parvient jusqu'au vaisseau, la puce implantée sous sa peau déverrouillera le champ de protection. Dans le cas contraire,il doit prendre en considération que sa race n'a plus vécu à l'état sauvage depuis trois-cents siècles. Sa vie sur cette planète végétale n'aura de l'intérêt que lorsque il trouvera des plants de philloxphène. Mais avoir étudié trente ans pour n'avoir que pour seule perspective quatre-cents ans de défonce en ermite, est-ce bien un avenir enviable ?
Tertio, le retour sur Myrna l'enverra directement en disgrâce pour une cinquantaine d'années. Au lieu de prospérer dans la société, il deviendra un banni condamné à rester en dehors des murs de la cité, récupérant tous les jours son minimum vital après avoir travaillé une quinzaine d'heures (la période de révolution de Myrna est de trente heures et 54 minutes environ ). Avec la mort de Glyon, il n'y aura aucune commisération pour lui de la part de ses congénères, car en tant que Niumi, il avait la responsabilité de son Zymbreke.
Alsyen choisit de sortir par la porte. Il a déjà touché au cadavre de Glyon. Il lui suffit de dissimuler sa cage dans le labo et de s'échapper dès que la personne présente regardera ailleurs. Alsyen a d'ailleurs la faculté d'inspirer une présence à un cerveau dans une direction précise.
Il lui suffira d'influencer l'humain pour détourner son regard vers la direction opposée à celle de la porte durant quelques secondes…
*
* *
C'est d'ailleurs un humain chargé du nettoyage qui va lui permettre de mettre son plan à exécution quelques heures plus tard. Alsyen pénètre dans un couloir et décide d'aller le plus loin possible dans la même direction. Grâce à ses ventouses, il progresse au plafond et incite les quelques humains qu'il croise à regarder par terre, ce qui est assez simple car ils semblent à peine éveillés.
Certains crient, mais il s'agit plus d'ordres que de cris de bataille ou de détresse. Il y a un sentiment de sécurité et d'habitude dans leurs esprits et ils semblent au dixième de leurs facultés de réflexion. Au bout de trois-cents mètres environ, Alsyen se retrouve à hauteur de la porte du labo.
? ? ?. Alsyen est dérouté. Aucune fois il n'a obliqué à droite ou à gauche. Il est vraiment allé tout droit. Lorsque il atteint à nouveau la porte du labo, il décide de prendre la première à droite et de continuer tout droit.
À une dizaine de mètres de l'intersection, il laisse une marque. Au bout de quarante mètres, il est bloqué et doit tourné à droite ou à gauche. Il choisit la droite après avoir fait une marque. Au bout d'un kilomètre, il trouve son trajet bien familier.
Tout se ressemblerait donc. Il fait une nouvelle marque, marque qu'il retrouve trois-cents mètres plus loin avec dix mètres d'avance. Un humain est en train de la nettoyer. Il comprend tout d'abord qu'il est dans un espace circulaire, et un quart de seconde plus tard prend conscience qu'il est dans l'espace.
La roue tourne sur elle-même afin de générer une force centrifuge qui crée un ersatz de gravitation artificielle. Les escaliers qu'il croise conduisent vers le centre qui doit être exempt de gravité. À cet axe, il peut y avoir un passage pour une autre roue ou pour d'autres éléments d'un vaisseau spatial.
Cette fois, il réalise qu'il ne retournera jamais sur Myrna.Unis
Reno est un peu fatigué de la soirée précédente. Le C'fet n'y est pour rien. Il s'agit du manque de sommeil. La part consacrée au sommeil oscille entre six et huit heures par cycle de vingt-quatre heures, en fonction des activités. Seulement, cette fois-ci, ils n'ont dormi que quatre heures dans la chambrée, et lui-même a tourné et retourné sa journée précédente avant de sombrer dans un sommeil agité.
Pour ne plus y penser et enfin trouver le repos, il a tenté de se souvenir des traits d'Alessandra, et des meilleurs moments qu'il a pu passer en sa compagnie. Ils se sont fâchés, avant qu'il ne s'engage, mais depuis son départ de la Terre, elle en est un peu devenue le symbole. Il y a certes des recrues féminines à bord mais elles sont cantonnées dans d'autres quartiers. Les mises en contact rares donnent lieu à quelques « échanges » de bons procédés pour les plus rapides, échanges n'étant pas du goût de la hiérarchie.
Bien qu'il paraîtrait que certaines auraient un talent d'ubiquité et de partage assez étendu… selon des histoires de « grandes gueules ». La dernière fois, il a bu quelques C'fet , deviné quelques formes sous les combinaisons de travail et juste reniflé quelques effluves de parfum. Sa conversation n'a pas été non plus des plus brillantes, bien qu'elle ne le soit jamais vraiment. Mais là, il avait touché le fond et continué de creuser tout le reste de la soirée.
Il doit, pour s'acquitter de sa corvée du matin, effectuer le nettoyage du couloir de la section C4. Le revêtement sombre, sorte de plastique très dur contenant les barres de métal permettant l’aimantation en cas de coupure de la gravité a en effet tendance à se ternir au passage des bottes de bord.Il s'agit de lui rendre un certain lustre avec la « cireuse ». Il n'y a pas de problème de poussières puisque l'atmosphère est filtrée lors de sa régénération via les conduits de ventilation qui évacuent les gaz nocifs et redistribuent un air plus frais, rechargé en oxygène. Il en est presque à la fin du couloir à lustrer au moment où il croise Alsyen.
Alsyen depuis un moment a reconnu de loin le jeune humain comme étant celui qui était avec le scientifique du labo la veille. À ce moment là, il avait déjà ressenti chez le jeune humain de l'affection pour lui, confondu avec un petit primate sans défense. Cette méprise était tout de même préférable à une curiosité scientifique un peu trop poussée. Il décide donc de capter son attention par une simulation télépathique pour attirer son regard jusqu'alors dirigé sur le sol.
Reno lui parle doucement pour l'amadouer et s'approche précautionneusement pour ne pas l'affoler. « Alors, p'tit tu cherches à te barrer ? T'iras pas loin tu sais. Viens me voir. Là . Attend, j'ai un gâteau ».
Il sort de sa poche un petit sachet de biscuits, reste du précédent petit déjeuner, en déchire l'emballage plastique, et tend le petit beurre en direction d'Alsyen. L'estomac de celui-ci se crispe. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Que risque-t-il à goûter de la nourriture étrangère. De toute façon, il va mourir de faim s'il n'essaie pas. Il prend le biscuit d'une main, puis des deux et pend alors la tête en bas pendant qu'il grignote sans en perdre une miette.
Reno en profite pour le saisir sur les flancs.
Alsyen se laisse faire et se décroche. Chacun a fait le geste envers l'autre. Les deux ont les mains prises. Reno se penche pour observer Alsyen. Celui-ci lève alors les yeux pour regarder Reno tout en continuant de manger en confiance.
Le ciment prend. Dès qu'Alsyen a fini le biscuit, Reno lui en donne unautre puis il approche le jeune Niumi de son épaule gauche. Alsyen se plaque à lui de façon à ne pas le gêner et Reno peut terminer son travail en vitesse.
Il se précipite ensuite vers sa chambre, tentant de dissimuler tant bien que mal Alsyen lorsqu'ils croisent quelqu'un.
Mais son manège ne passerait pas inaperçu si Alsyen ne détournait pas l'attention des humains par suggestion télépathique fugitive les incitant à regarder dans une autre direction.
Une fois dans la chambre, Reno ouvre son placard et sort quelques friandises pour Alsyen. Celui-ci y fait honneur, et puis fait mine de lui en offrir une. Reno sourit et accepte volontiers pour faire plaisir à l'animal. Il le caresse pour le remercier en mimant le plaisir de recevoir. Il se sait parfaitement ridicule mais ne s'en soucie pas. Par contre, les autres ne vont pas tarder à revenir de leurs corvées. Quoi leur dire ? Il décide donc de cacher le singe dans le placard. Il prend Alsyen dans les mains et le pose à l'étage de la nourriture tout en le caressant. Il lui fait une petite place, y met une serviette, l'installe dessus. L'animal semble accepter. Il ferme alors lentement la porte. Celui-ci ne semble pas s'en offusquer. Il rouvre. Alsyen fait mine de vouloir dormir. Rassuré, Reno referme la porte et met le cadenas.
Alsyen a la certitude que l'humain l'accepte et n'ira pas prévenir le scientifique. Lui non plus n'a pas envie d'un Alsyen écorché flottant au sein d'une solution alcoolisée dans un bocal. Ici, il est encore en sécurité quelques heures. Il a senti au moment où Reno fermait la porte qu'il n'allait pas revenir tout de suite et qu'il craignait qu'Alsyen soit bruyant une fois enfermé. Alsyen l'a donc rassuré par persuasion télépathique afin qu'il puisse partir sans inquiétude. Inquiétude qui aurait pu tenter Reno de le ramener au labo.Cet humain pourrait-il être un bon remplaçant pour son Zymbreke ? Alsyen y pense déjà.
La journée de Reno, comme celle de ses camarades, est réglée comme du papier à musique. Deux heures de sport au gymnase, deux heures de cours de spécialité, repas, informations en salle commune, instruction combat théorique, simulation de tir, sports de combat, corvées de bord, repas et ensuite retour en chambre et/ou foyer du soldat. Ainsi pendant deux jours. La troisième journée, c'est loisir, c'est-à-dire compétitions sportives et compétitions de jeux intellectuels. Mais il y a toujours une heure le matin et une heure le soir consacrées aux corvées de bord.
Une journée de loisir sur trois, une manœuvre virtuelle est organisée au profit de l'ensemble du vaisseau. Chacun
est un joueur tenant son propre rôle dans une phase de conflit. Deux équipes s'affrontent, avec des variantes de moyens.
Les gradés jouent la stratégie, mais connaissent aussi les qualités réelles de leurs hommes quand ils les font affronter en corps à corps des créatures chimériques. En effet, chacun gagne ses points de valeur grâce aux contrôles continus dans les vraies matières de l'instruction militaire.
Les chefs qui gagnent aux jeux virtuels gagnent aussi la considération de leurs subordonnés. Il y a deux façons de contrôler son avatar, double virtuel incorporé en 3D dans la simulation par les programmeurs lors des formalités administratives de la recrue sous la base d'un simple scan de l'original. Soit le joueur mime son action, et les nombreuses caméras des locaux transmettent l'information au réseau de serveurs affectés à la simulation et à sa distribution sur le réseau général, soit il pointe sur son écran les actions proposées du type « je tire », "je me mets à l'abri derrière » etc. etc.
Des paroles peuvent être saisies en direct, des ordres notamment...D'autres sont simulées par une pré-programmation et lors d'éléments imprévus dans le cadre d'une action automatisée, comme un déplacement d'un point à un autre, suivi d'une chute malencontreuse dans un piège. Des « Aïe », des « Ouille », des jurons fleuris pour « détendre l'atmosphère », voire des cris d'agonie aux accents dramatiques, dont le réalisme (parfois caricatural) frise le ridicule, font l'objet de sophistications perverses de la part des programmeurs. En conséquence, tout soldat appréhende sa propre fin de partie, qui risque de déchaîner les rires de ses camarades, mais pas le leur.
L'humour des informaticiens a pour consigne de ne pas respecter les gradés non plus. Ainsi, tout le monde se doit d'être aussi prudent, craignant pour son image comme il devrait craindre pour sa propre vie dans un contexte réel.
Ces grands jeux en réseau servent donc à la cohésion de l'Armada du cercle, tout en ayant des vertus pédagogiques.
Un soldat inactif est un soldat qui se relâche. Il devient un mort en sursis. Dans l'espace, l'ennui est aussi le pire ennemi à craindre pour ses conséquences sur le moral. Les activités doivent donc être équilibrées et permanentes.
Bien sûr, dès que la situation l'exige, l'emploi du temps s'adapte aux circonstances. La priorité opérationnelle prend le dessus sur l'instruction. Durant l'attente, les petits gradés vérifient la parfaite connaissance des points-clés de l'action susceptible d'être réalisée.
C'est vers onze heures de l'heure « Quart C » que l'alerte est donnée. Une espèce animale inconnue s'est enfuie d'une enceinte sécurisée. Elle peut être n'importe où, il faut la retrouver avant qu'elle ne provoque des dégâts. D'aspect simiesque, elle semble tout de même inoffensive. Il faut essayer de la capturer vivante, mais aussi se méfier et prendre toutes les précautions, en particulier bactériologiques : des germes mortels peuvent subsister sous ses griffes, sa morsure peut être contaminante...
Grâce aux hauts-parleurs intégrés un peu partout dans les cloisons, les hommes peuvent entendre le détail de la suite des opérations. La recherche va s'organiser secteur par secteur. Ces secteurs seront ensuite condamnés de manière étanche. Chaque compagnie va déployer une trentaine d'hommes par équipe de dix qui se déplaceront dans leur secteur de résidence ou d'entraînement avec des détecteurs de chaleur.
Les autres équipes ont pour ordre de rejoindre dans un premier temps les salles de réunion afin d'y recevoir des consignes de recherche dans les zones communes. Les quatre roues, quartiers des escadres, doivent couper tout accès entre elles, comme avec la roue de l'état-major. Les secteurs périphériques, en apesanteur, réservés au stockage, aux serres et aux postes de combat sont eux aussi cloisonnés.
« Ils vont retrouver le petit singe à tous les coups dans mon casier » s'affole Reno. Il se précipite dans sa chambrée au lieu de filer directement au foyer, car il n'est désigné dans aucune équipe de détection.
Il se saisit d'Alsyen. Un instant, il l'abandonnerait bien dans le couloir, pour lui laisser sa chance. En aucun cas, il ne voudrait le livrer. Alsyen comprend instinctivement le désir de Reno et le rassure par son contact. Moins affolé, Reno prend son sac à dos de sport et y dépose doucement Alsyen à l'intérieur. Celui-ci se tapit au fond et reste immobile. « On dirait qu'il comprend » pense le jeune homme sans vraiment croire à cette réalité.
Reno croise l'équipe de détection.
— J'avais oublié mon kimono pour le quart de l'après-midi, dit-il au sergent.
— Toujours la même tête de piaf, lui répond celui-ci, dégage !Le détecteur n'a pas bronché, la signature thermique de l'humain ayant masqué celle du Niumi.
Deux heures plus tard, des rations sont distribuées. Les recherches continuent… en vain.
À la passerelle de commandement, le scientifique en prend pour son grade. Il n'est pas le seul à devoir redouter les foudres de la hiérarchie. On « découvre » à bord des dizaines de rats, des animaux familiers passés en fraude comme des hamsters et même un furet et deux chats. Avec eux, des puces à foison, vecteurs potentiels de contamination redoutables.
Une seule silhouette reste calme et détendue, silencieuse et énigmatique, au milieu de l'agitation générale. C'est l' « Amiral ». Son grade sert de nom, de prénom, d'épouvantail ou de dieu vivant à bord. Quand on parle de Lui, c'est avec crainte et respect, y compris dans son entourage direct, et surtout quand « ça chauffe ». On ne l'interroge jamais sur la conduite à tenir. On fait ce qu'il dit, on fait ce qu'on pense qu'on doit faire quand il ne dit rien, en lui jetant parfois un regard pour tenter de lire sur son visage une preuve de son assentiment. Un visage dur, de parchemin cuivré, avec un nez crochu, une mâchoire carrée, des lèvres quasi-inexistantes. Des cheveux blancs, très courts et drus. Surtout, comme pour les autres vétérans, ce qui marque le plus, ce sont ses yeux : tout de marbre blanc, veinés à l'or fin, avec un soleil rouge pour iris éclipsé par une pupille gris de cendre.
Entre l'Amiral et son état-major frais émoulu des grandes écoles militaires terrestres, il y a encore toute la distance entre la terre et le dernier cercle. Il n'y a qu'au milieu de ses vétérans qu'on a pu de loin l'entendre rire. Mais pourquoi donc ces vieux débris du siècle dernier ont été rappelés dans le cercle Bêta ?
L'Amiral laisse le soin à son second d'invectiver tous les commandants et capitaines pour leur incompétence crasse et l'inefficacité de leurs troupes, incapables de retrouver un bœuf dans un couloir. Ceux-ci s'en prennent ensuite à leurs lieutenants et leurs sous-officiers par radio, pas même fichus de commander un C'Fet au foyer et de trouver leur ... pour pisser. À tous les niveaux, les fouilles s'intensifient dans la plus grande agitation. Les casiers personnels sont ouverts, fouillés, vidés pour en vérifier le moindre recoin.
La liste des coupables d'infractions aux règlements s'allonge encore. Alcools, cigarettes, drogues, et même armes blanches, argent sale, photos compromettantes… Rien n'échappe aux équipes de recherche. Pas même, dans les zones périphériques, quelques « garçonnières » improvisées au milieu des rangées de stockages ou dans les alvéoles d'armement.
De nouvelles équipes sont constituées, pour aller chercher dans les compartiments périphériques, et dans les quartiers des autres escadres. Ainsi, personne ne peut être protégé dans son propre secteur de responsabilité.
Une nouvelle moisson d'entorses aux règlements s'annonce.
Le représentant des vétérans s'insurge. Il demande à parler à l'Amiral. Celui-ci, le voyant arriver de loin, le reçoit avec le sourire, mais sans lui laisser le temps de prendre la parole.
— Je sais ce que vous allez me dire. Ces ordres ne s'appliquent pas pour vos quartiers, désignez parmi vos hommes ceux qui vont VOUS accompagner pour y chercher le singe.
— Bien Monsieur, à vos ordres.
Quatre heures plus tard, distribution de rations de type « cycle de 24h » à chaque personnel. Les équipes de recherche sont relevées, et le seront à nouveau toutes les deux heures. Reno, intégré dans une équipe pour la prochaine période, ne s'étonne pas de son culot, oubliant même qu'il est porteur de l'objet de toute cette agitation.. Alsyen veille au grain.
Dans tous les foyers, les commentaires vont bon train. Certains boivent plus que de coutume afin de se préparer à leur future sanction. En effet, ils savent que ce qu'ils dissimulaient a dû être découvert ou est en passe de l'être. D'autres commentent. Jean-Louis, de la chambrée de Reno, en profite pour mettre en avant son camarade en lui demandant de raconter à nouveau son histoire. Piégé, Reno reprend son récit, pour un public assez large cette fois.
Dans le sac, Alsyen vit au travers des images ressenties dans le souvenir de Reno l'histoire telle qu'elle a été vécue par celui-ci.
Il entend d'abord ses rires, confondus par l'humain avec des cris de peur. Il aperçoit Glyon, son frère spirituel, au travers des yeux de Reno, l'image terrible un monstre rugissant jouant avec sa pauvre victime avant de la dévorer d'un coup de gueule. Il distingue, au travers du viseur de l'arme, le visage de son ami exploser sous l'impact du projectile sonique. Il se voit, inanimé, flottant sur le ventre à la surface du plan d'eau, risquant se noyer. Il voit Reno, le peureux, se lancer sans réfléchir pour le récupérer. Il voit intimement, agir, vibrer, celui qui est à la fois l'assassin de son Zymbreke, son sauveur et le responsable de tous ses malheurs.
Alsyen est bouleversé. Glyon est mort. Il est seul dans le labo. Il a envie de le rejoindre. Reno finit son histoire. Alsyen le pousse à montrer ce qu'il a dans le sac. Reno lutte. Non, il ne veut pas. Alsyen insiste. Reno a peur aussi des représailles du commandement. Alsyen le rassure, puis l'incite à nouveau. Reno vide sa brique de C'fet et conclut.
« Et ce matin, j'ai retrouvé le singe. C'est mon ami. Il est là. »
Il sort Alsyen du sac. Celui-ci se colle à lui contre l'épaule un instant, puis s'y perche. La salle se tait. Alsyen voit ces trois-cents têtes tournées vers lui et les affronte du regard. Il saute sur le bar, fait mine de boire du C'fet à la paille. L'éclat de rire est général.
Le spectacle est retransmis à la passerelle. Le chef d'escadre responsable de Reno est blanc comme un linge.
L'amiral contre toute attente sourit. Alsyen a goûté à un hamburger, l'a jeté par terre puis se régale avec des cacahuètes, en jette une en l'air, la rattrape dans la bouche. Et ainsi de suite... Il effectue des tours de plus en plus difficiles et cabotins. Il exécute aussi quelques pas de danse improvisés sur le bar, deux trois cabrioles et tout le monde s'esclaffe. Les sous-officiers n'arrivent pas à passer pour les rejoindre. L'amiral se tourne vers le chef d'escadre.
— Mon cher Patrick, j'aimerai beaucoup voir ce jeune homme avec son animal dans mon bureau dans dix minutes.
— Je donne les ordres Monsieur.
— C'est ça. Amenez-les moi.
Il sort ... prestement. L'Amiral s'adresse alors au reste de son staff, avec un petit sourire en coin qu'on ne lui connaissait pas.
— De temps en temps, une petite mise au point est nécessaire non ? J'attends pour demain matin le résultat par escadre de toutes les « découvertes ». Je pense que le bilan est très positif et la leçon bonne à prendre…
Le chef de section et son adjoint encadrent Reno et Alsyen. Ils ont essayé de les séparer, mais Alsyen s'est agrippé à Reno de toutes ses forces en poussant des cris perçants quand ils lui ont tiré sur les membres pour tenter de le faire lâcher sa prise. Reno s'est emporté, contre toute attente de la part d'une jeune recrue. Alsyen les a intérieurement couverts de honte et ils ont préféré capituler.
Le chef d'escadre marmonne sa vengeance entre les dents. Il ne veut rien dire avant la décision de l'amiral, mais Reno comprend qu'il ne perd rien pour attendre. La sanction sera exemplaire. Il finira comme cireur de godasses pour toute l'escadre.
Alsyen a retrouvé un peu le moral. Il en veut moins à Reno qui s'est mis, pour lui, dans une sacrée mauvaise passe. Seulement, c'est aussi sa survie qui se joue.
Dans la salle d'attente, malgré les sièges confortables, personne ne s'assoit. L'amiral est en vidéo-contact permanent, supervisant la fin des inspections en cours dans les derniers secteurs qu'il a décidé de mener à leur terme. Il faut dire, qu'ironie de l'histoire, on a retrouvé sa cantine égarée depuis vingt-sept ans relatifs. Il n'était alors que jeune lieutenant muté sur ce vaisseau-école pour se préparer à la conquête des dernières planètes delta. Avec trois de ses camarades, disparus aujourd'hui, ils avaient été bizutés et ils avaient dû se débrouiller sans leurs affaires personnelles durant deux semaines. Par contre, lui avait dû faire sans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait qu'une roue centrale. Une excellente nouvelle donc.
Qu'ont-ils bien pu retrouver d'autre qu'ils n'ont pas signalé ? Finalement ce vaisseau avait bien besoin d'un peu de remise en ordre. Il n'empêche que s'il tenait le petit malin qui à l'époque avait collé l'étiquette « Jouets d'enfants 0-3ans » sur sa cantine et l'avait planquée dans une salle d'archives... Un pseudo camarade d'alors, sans doute, qui a bien dû se moquer de lui dans son dos...mort certainement depuis, avec son petit secret.
N'a-t-il donc survécu que pour la retrouver ? Il sait qu'à l'intérieur, il y avait laissé les photos de sa vieille Jessie, une chienne de quinze ans morte deux jours avant son embarquement et avec laquelle il avait vécu quasiment toute son enfance.
Alors il a une idée. Une idée pas bien nouvelle puisque elle a juste été perdue à l'occasion des débuts de la conquête spatiale.
Il va restaurer la tradition des mascottes à bord. Les fouilles ont mis à jour un cheptel assez conséquent qui en démontre le besoin. Il sait aussi que les vétérans cachent une créature bizarre qui ne doit jamais être montrée à d'autres. Alors ce petit singe extra-terrestre va devenir la mascotte du vaisseau, et ce jeune homme qui a su gagner sa confiance en sera le responsable.
Le scientifique tripailleur et collectionneur de bocaux quant à lui sera responsable de l'hygiène et de la santé de tous les animaux classifiés « familiers ».
Pour le désordre induit par cette recherche effrénée, ce seront tous les magouilleurs et les tarés qui paieront les pots cassés. L'humanité traîne avec elle une fange que l'espace doit permettre de purifier. Mais la vie, si rare dans l'univers, est sacrée. Même les rats seront adoptables. Cependant leur reproduction va être régulée.
En plus de la charge d'entretien du petit singe, le jeune va tout de même récupérer une corvée moins glorieuse. Le risque sanitaire est un risque à prendre au sérieux.
Une sanction doit donc s'appliquer. Il va devenir durant deux heures par cycle jour de douze heures responsable de l'entretien des latrines jusqu'à la fin de sa formation. Cela dissuadera les amateurs d'adoption en douce d'espèces extra-terrestres à bord. La prochaine planète d'exercice est en effet peuplée par une faune parfois redoutable.Nouvelle vie
À peine sorti de chez l'amiral, Reno est devenu le VIP de l'escadre. Mais les jeunes évitent pour l'instant de lui manifester leur sympathie car la tête sinistre des deux cadres de la section qui l'accompagnent en dit long sur sa popularité dans la hiérarchie.
Pourtant, après que l'amiral l'ait tout de même tancé pour avoir cacher l'animal recherché, Reno a été un peu interrogé sur le déroulement de son instruction. Il n'a pas critiqué ses chefs malgré les brimades plus ou moins légères et au bon goût contestable subies durant sa formation initiale, puis au quotidien durant la formation complémentaire actuelle. Il a parlé de la peur de voir l'animal disséqué par le vétérinaire scientifique alors qu'il pensait lui avoir sauvé la vie pour justifier son acte. Mais Reno n'en menait pas large et ses cadres auraient préféré présenter au « grand chef »un « velu » plus représentatif de la qualité de leur instruction.
L'énoncé de la peine ne les a pas satisfaits. Eux vont devoir subir les avanies de leurs collègues pour les fouilles entreprises et leurs conséquences dérangeantes. Ce Reno porte-poisse est vraiment la pire chose qui leur soit arrivée. Il ne manquait plus qu'il devienne un « chouchou » intouchable à haut niveau.
Alsyen, sentant l'animosité des deux humains vis-à-vis de Reno, prend parti pour celui-ci même sans en comprendre la raison. (il ne connaît pas encore leur langage). Il décide de stimuler un peu plus leur sentiment de frustration, ce qui leur serre bien la gorge. Il prend soin aussi de rassurer Reno, plutôt bouleversé.
Heureusement, l'amiral a donné quartier libre pour le reste de la journée à toutes les recrues non prises par le service, afin de remettre de l'ordre dans leurs affaires. Autre largesse : malgré les rations distribuées, le repas chaud devra être prêt pour le soir. Ce sera le premier signe du « retour à l'ordre ».
Le sergent Coll quant à lui hérite d'une demande de punition pour avoir dissimulé dans son casier un Neurovid avec des contenus pornographiques interdits. Ceux-ci montrent des humaines en pleine action avec des Alcychiens, animaux pacifiques de la planète Alcyde, domestiqués pour protéger les alentours de la base, et dont la tendance aux câlins profonds à l'attention des femmes de colons est légendaire.
Il va aussi subir un examen médical complet, suivi d'une rééducation psychologique de plusieurs semaines. À l'origine, un Neurovid était prévu pour se connecter directement sur le cerveau à travers les tempes. Une émission de rayon photonique à travers le crâne permettait de modifier les perceptions visuelles et donc de montrer en grand des scènes virtuelles. Mais ils furent interdits après des accidents qui rendirent leurs usagers aveugles : les synapses des neurones cognitifs au contact des neurones optiques subissaient de graves dommages dus à une sur-stimulation d'acétylcholine, et divers autres neuro-transmetteurs habituellement sécrétés en quantité infinitésimale. Facteur aggravant : le principe avait évolué avec la distribution de ce produit à grande échelle. Le Neurovid ressemblait à un simple baladeur avec des écouteurs. Le signal visuel cette fois était transmis au cerveau via les nerfs auditifs. Cela permit aux premières victimes de l'ancienne technologie de retrouver la vue grâce à une caméra fixée sur des lunettes reliées au Neurovid. Mais malgré toutes les précautions, à la longue, des troubles auditifs, acouphènes comme hypoacousie apparaissaient, ainsi que des altérations irréversibles de l'oreille interne.
Les Neurovids auraient donc dû rapidement tomber dans l'oubli si un trafiquant minable n'avait pas eu l'idée de les utiliser pour du porno. Afin de s'assurer des clients, il avait fait évoluer le dispositif. Commercialement rebaptisé Porn-Neurovid, l'engin fait parvenir par les nerfs optiques non seulement des scènes obscènes, mais aussi des signaux « fleshy », provoquant une excitation sexuelle artificielle directement au niveau du cerveau, puis par réaction, au reste du corps. Un effet de dépendance survient alors assez vite, surtout chez des hommes privés de relations sexuelles durant de longues périodes, comme ceux contraints à de longs trajets dans l'espace par exemple.
Le corps des FCP ne peut tolérer la moindre dépendance psychologique, surtout lorsque elle s'accompagne de dégénérescence mentale et physique. Le sergent Coll risque se retrouver débarqué au retour sur Bêta prime pour redevenir simple colon durant la durée de son contrat initial de vingt ans. S'il est reconnu inapte, il va être dégradé et affecté à des tâches primaires.
Cela, les jeunes recrues l'ignorent totalement pour l'instant mais le chef de section sait qu'il va regretter ce sergent prometteur, moins « bourrin » que le reste de l'encadrement, physiquement « chat maigre » et dont le commandement impose naturellement le respect sans contrainte aux jeunes.
Un peu ce qu'il aurait souhaité pour lui-même, mais qu'il n'était pas parvenu à réaliser. Trop ambitieux, trop pressé pour prendre le temps d'atteindre les objectifs dans les règles de l'art, il s'était rabattu sur « les bonnes vieilles méthodes » pour tenter d'y parvenir quand même.
Dans la chambre de Reno, les recrues se passent et se repassent Alsyen. Tout le monde veut le toucher, l'amadouer et Reno n'a pas le cœur de refuser ce plaisir à ses camarades. Alsyen n'apprécie pas vraiment mais il sent la sympathie communicative de tous ces jeunes humains et il se laisse faire avec bonne grâce. Néanmoins, il ne recommence pas son numéro au milieu des briques de C'fet. Sinon, la chambre risque devenir un music-hall et il estime que même un « animal » doit avoir droit à sa dignité.
Au réfectoire, Alsyen n'a pu que regarder les humains manger. Son dernier repas est assez loin. Heureusement Jean-Louis y pense.
— Et qu'est ce qu'il mange ton singe ?
— Pour l'instant, je suis sûr qu'il aime les biscuits, les cacahuètes mais pas les hamburgers
— On a eu des rations. On n'a qu'à les ouvrir et voir ce qui lui plaît
— Excellente idée.
— Moi j'ai une numéro 3 avec du porc aux patates.
— Et moi une 7 avec mouton haricots.
— Il préférera peut-être la 11 avec des cannelloni.
— Je suis sûr qu'il aime les corn-flakes au chocolat…
La table commune se couvre de victuailles industrielles et Reno pose Alsyen à côté en lui proposant un biscuit. Alsyen prend le biscuit, le mange puis, oh quelle intelligence, se met à renifler tout ce qui est sur la table.
Il ne mange jamais de viande ou de poisson. Question d'éducation. Néanmoins, il lui arrive assez souvent de manger sur Myrna certains gros insectes et des sortes d'escargots à condition qu'ils soient servis vivants. Les œufs d'oiseaux comme de reptiles sont aussi des mets de choix mais il n'en abuse pas. Les Niumis ne consomment pas de nourriture cuite. Omnivores, ils s'astreignent à un régime carné minimum. Ils lyophilisent quand même la nourriture pour mieux la conserver sous vide ensuite car il s'agit d'une technique dérivée du séchage des fruits. Friands de nombreuses espèces de graines,, ils n'ont jamais ressenti le besoin d'en faire de la farine pour la cuire. Au contraire, le grain entier se conserve mieux dans les filets silos. Déjà, les biscuits plaisent beaucoup à Alsyen. Contraints de goûter pour survivre, Alsyen découvre avec plaisir les corn-flakes au miel. Ceux au chocolat sont un pur délice. Le fromage par contre l'intrigue beaucoup. De peu, il évite de se trahir, tenté un bref moment de prendre le verre de lait à la main, malgré sa grosse taille pour lui. Il se met donc à laper pour la « première » fois. Par la suite, pour en boire d'une manière plus civilisée, il fera quelques simulacres d'imitation, feignant ainsi d' « apprendre » à boire au verre.
Néanmoins, il va lui falloir tout d'abord apprendre à communiquer comme un animal mais surtout à comprendre réellement les humains, c'est à dire leur langue en plus de leurs émotions et de leurs motivations (Alsyen jusqu'à maintenant « sent » le geste de l'humain avant qu'il ne le réalise).
Ensuite, il lui faudra savoir lire. Malgré son extraordinaire mémoire et son intelligence par rapport à un humain, un apprentissage non organisé est toujours pénible. Impossible dans son cas de demander un abécédaire avec des images, des enregistrements sonores et un professeur.
Il y a un mot facile à apprendre. Allez, c'est pour maintenant. Alsyen prend une poignée de raviolis et la lance sur Reno. Tout le monde rit sauf l'intéressé qui part dans une diatribe négative incompréhensible. Donc, Alsyen recommence. « Non, arrête » dit Reno. Alsyen reprend une poignée. Reno retient son bras. « Non » répète t-il. Alsyen relâche son bras puis va pour lancer. Reno le retient à nouveau et lui présente sa main près de la tête, comme pour le frapper. « Non » insiste t-il. Alsyen repose les raviolis dans la boite. « Oui, c'est bien » dit Reno. Alsyen se lèche la main, alors qu'il préférerait se l'essuyer, puis va pour se coller contre Reno. « Oui, c'est bien. Gentil le singe »
Reno le caresse. Alsyen peut sentir l'affection qui lui est destinée. Pas rancunier l'humain.
Jean-Louis alors pose la question fatidique.
— D'abord c'est même pas un singe. Et puis, on va l'appeler comment ?
— Je ne sais pas.
— Moi je sais. Caubard ! »
Tout le monde rit. Donner le nom du chef de section au singe, c'est amusant, mais plutôt déconseillé. L'humour risquerait ne pas être partagé par les cadres.
— Et pourquoi pas Willy ?
— C'est nul comme idée.
— Tarzan.
— Léon.
— Non, moi je sais. Flipper.
— Pff.
— Nikita !
— C'est un mâle ! Arrête de l'appeler comme ça.
— Rex.
— C'est pas un chien.
— Nabudochonossor.
— C'est Nabuchodonosor et c'est trop long.
— Rocky.
— Riton.
— P'tit louis.
— Dicentim.
— Non. Ça va pas. Mais on peut organiser un vote.
— Oui. On sélectionne plusieurs trucs parmi les meilleures idées et on choisit.
— Ça lui irait bien Coco Barge.
— On reconnaîtrait encore le chef et ça fait perroquet.
Jean-Louis s'approche de l'oreille d'Alsyen et doucement l'appelle « Bleno !». Alsyen tourne la tête et Jean-Louis fait « Vous avez vu ? Bleno réagit »
Reno secoue la tête de gauche à droite. Vraiment, ils sont tous nuls. Mais c'est vrai, comment l'appeler ?Alsyen s'implique
Alsyen s'est installé sur les cuisses de Reno et fait mine de jouer avec le hochet lumineux à variation de spectre en le tournant dans tous les sens et en le mordillant. En fait, il observe les doigts de Reno et l'écran. La mémoire d'Alsyen lui permettrait déjà de se connecter car sans comprendre les caractères, il les a déjà tous retenus, comme enregistré la réaction de chacun d'eux à l'écran.
Les Niumis utilisent des ordinateurs depuis une vingtaine de siècles. Néanmoins, leur planète n'est industrialisée qu'à moitié et les Niumis n'ont fait aucune découverte technique. Depuis plus de cent-mille ans, ils ont évolué de concert avec les Zymbrekes. D'abord symbiotique et animale, la relation avec les Zymbrekes a connu les rapports maître-esclave pendant cinquante-mille ans. Puis cette situation est devenue insupportable aux Niumis, qui, ayant acquis une certaine sagesse, commençaient à influencer les cerveaux des Zymbrekes pour les faire accéder à l'intelligence. Trente-mille ans plus tard, des colons xhantiens débarquèrent sur Myrna la Forestière. Ils s'installèrent près des fleuves, dans les plaines et chassèrent les Niumis à coup de désintégrateurs. Mal leur en prit. À chaque violence commise par un groupe de colons, ceux-ci se retrouvaient rapidement décimés par des Zymbrekes, ayant parvenu mystérieusement à s'introduire derrière les barrières de sécurité les plus sophistiquées.
Les Xhantiens avaient installé une station orbitale. Au télescope, ils purent observer Niumis et Zymbrekes découvrant les objets technologiques abandonnés, puis apprenant à s'en servir.
Ils comprirent alors que les massacres à coups de griffes n'étaient donc qu'une mise en scène. Dès le départ, ils auraient pu retourner les armes des envahisseurs contre eux. Il s'agissait d'espèces intelligentes : il fallait agir autrement.
La troisième expédition xhantienne fut donc précédée d'une navette diplomatique sans aucun armement. Un groupe de volontaires se porta à la rencontre des Zymbrekes. Lorsque ceux-ci voulurent lancer l'assaut, les Xhantiens présentèrent des objets en cadeau. Il n'y eut cette fois aucune victime et les trois races sympathisèrent.
Les armes saisies sur les cadavres furent restituées aux Xhantiens spontanément au bout de quelques jours. Alors, les colons xhantiens débarquèrent non armés et purent s'installer là où ils le souhaitaient.
Des couples Niumis-Zymbrekes (Deux Niumis et deux Zymbrekes) se présentèrent au devant des implantations et manifestèrent leur désir de vivre au sein de la communauté xhantienne. En réciprocité, certains Xhantiens durent aller vivre avec les colonies des Niumis.
En moins d'un siècle, il y avait deux types de quartiers dans les villes de Myrna. Celui qui était adapté au mode de vie autochtone, et celui adapté aux Xhantiens. Les Xhantiens sont des créatures humanoïdes à la peau sombre et écailleuse. Leur nez est presque plat, à quatre fentes. Leurs oreilles sont petites et cylindriques de part et d'autre de la tête. Enfin, ils mesurent plus de deux mètres cinquante. L'habitat ne peut donc être commun avec les Niumis, hauts de quarante centimètres maxi sur la pointe des pattes ayant leurs « propres appartements » à l'étage auxquels ils accèdent par un pilier-tronc, tandis que le rez-de-chaussée est réservé aux Zymbrekes, mesurant environ un mètre cinquante, se déplaçant sur des tentacules et souhaitant vivre en permanence sur un sol nu et naturel.
La « villa-immeuble » est d'ailleurs conçue pour protéger une colonie de Niumis à l'étage, avec le nombre équivalent de Zymbrekes au rez-de-chaussée.
Les Niumis permirent aux Xhantiens de régler leurs problèmes ethniques sur leur planète, par leur philosophie et leur pacifisme, rapidement à la mode au sein de l'élite xhantienne. Ils devinrent très vite ambassadeurs adjoints, au service de chaque partie, afin d'arbitrer et régler les problèmes internes des Xhantiens avec pragmatisme. Leur collectivisme permit aussi de rationaliser la production, de mettre en place un partage équitable des ressources et de maintenir la motivation de tous les individus en récompensant le travail accompli par des fournitures inédites, cependant non vitales. Ils firent aussi redécouvrir aux Xhantiens les charmes d'une pharmacopée naturelle grâce à leur excellente connaissance de la flore myrnienne, encore intacte et riche en plantes médicamenteuses. Les chimistes xhantiens parvinrent d'abord à synthétiser les molécules actives, et finalement prirent le parti de la culture des plantes elle-mêmes, avec les quelques manipulations génétiques adéquates pour améliorer leur rendement et en permettre un développement contrôlé sur les sols déserts ou pollués de Xhantios. Diverses techniques d'extraction des principes actifs s'avérèrent bien plus profitables que de jouer industriellement avec des éprouvettes...
En échange, les Xhantiens devinrent partenaires pour la réalisation d'usines de produits manufacturés pour les Niumis et les Zymbrekes, dont la nudité fut déclarée « choquante ». Les Niumis découvrirent donc les heures de travail (seulement la moitié de la journée un jour sur deux) pour pouvoir se procurer ces produits. Le binôme Zymbreke (avec ses bras et tentacules) et Niumi était quand même aussi efficace que six Xhantiens. Myrna exporta très rapidement des produits pour Xhantiens fabriqués grâces aux ressources naturelles de la planète et grâce au travail niumio-zymbreke. Puis, il y eu très rapidement des techniciens, des concepteurs et des créateurs niumis car leur vive intelligence était étayée par une mémoire phénoménale.
Enfin, en dehors de leurs heures de travail, les Niumis élaborèrent des dictionnaires, des méthodes d'apprentissage, des bilans de découvertes... sur leur réseau informatique global. Ils accédèrent ainsi à une culture de l'écrit, une révolution, car jusqu'alors, toute la transmission des savoirs et des traditions était orale et télépathique. Aucunement pervertis par une histoire sanglante et des idéologies hégémoniques, tout à fait innocents face à l’œdipe, incapables de comprendre le besoin de richesses, leur motivation était la recherche de la connaissance et de la sagesse.
La possibilité de voyager loin allait perturber quelques équilibres. Pour pouvoir s'offrir des vaisseaux spatiaux, il fallait quand même gagner beaucoup de crédits. De plus, les plaisirs d'une drogue concentrée (alors que les Niumis en consommaient seulement sous forme naturelle le soir pour se détacher l'esprit), interdite de surcroît encouragèrent quelques comportements déviants comme l'escroquerie et la masturbation en public. Mais il n'y eu jamais violence ou meurtre en effet secondaire.
Alsyen faisait donc partie d'une famille aisée. Ele possédait d'ailleurs deux vaisseaux spatiaux. Celui qu'il avait « emprunté » pour sa petite virée funeste dans l'espoir d'un « détachement » plus jouissif retournerait de lui-même au bercail après une centaine d'alternances jour/nuit …
Tenir compagnie à Reno durant ses cours l'avait déjà amené à apprendre notre alphabet dans l'ordre des touches du clavier. De plus, comme souvent Reno répondait au logiciel en parlant à voix basse mais perceptible par un micro d'oreille interprétant les vibrations des os de la mâchoire, et que le logiciel de synthèse vocale affichait la réponse dans les cadres de saisie, Alsyen connaissait déjà un certain nombre de phonèmes à la fin de la journée.
Il pouvait ainsi reconnaître dans une phrase un objet nommé en sa présence assez rapidement. Il y avait tout de même une difficulté particulière à la langue humaine. Aucune des trois langues (Niumi, Zymbreke, Xhantien) connues d'Alsyen ne comportaient d'articles et il existait quatre genres : masculin, féminin, neutre et associatif (genre réservé au binôme Niumi-Zymbreke). Avec le nombre et la fonction dans la phrase, tout était une question de déclinaison à la fin du mot. Le verbe était donné accordé en début de phrase, puis suivait l'adverbe éventuel, le groupe sujet, (un groupe est composé d'adjectifs invariables car c'est le nom commun qui porte la marque du genre et nombre) toujours sans subordonnée à l'intérieur, et enfin le groupe action, suivis des groupes circonstanciels, toujours sans subordonnées. Voila pour le langage parlé. Dans le langage écrit par contre, après le dernier groupe circonstanciel, on introduisait les subordonnées par un pronom qui indiquait, soit le groupe objet, soit le groupe action, soit enfin le numéro du groupe circonstanciel. Les pronoms personnels sujets n'existaient pas puisque le verbe, accordé par un suffixe à la bonne personne du singulier ou du pluriel, indiquait déjà les renseignements. Cela donnait des phrases du genre « Boije » (je bois). « Boije eau quiobjet coule dans grande forêt qui1 recouvre verte planète ». La négation, quant à elle, se plaçait devant le verbe quand il y avait lieu.
Quelques autres règles avec des conjonctions de coordination régentaient les règles de position, d'appartenance, d'antériorité etc. etc.
Alsyen allait avoir au début un peu de mal à s'y retrouver, malgré son intelligence et sa mémoire. Les langages de la terre avaient fusionné en un franglais extrêmement compliqué à cause de l'exception culturelle d'un petit pays de trente millions d'habitants. Celui-ci, héritier d'une « Grande Histoire de Lui-Même », avait voulu, et obtenu par influence une académie planétaire composée « d'immortels » pour régenter le bon emploi des mots et leur certification, comptant ainsi éviter des termes « locaux » même dans les futures terres conquises.
Le pire vint ensuite des huit cents « immortels », menant de grandes luttes d'influence et d'ego tout en prétendant sauvegarder l'étymologie des mots alors qu'ils devaient être homogénéisés. Quant aux phrases, les grammairiens menaient d'épiques batailles pour défendre telle ou telle exception dans les règles universelles. Sans les correcteurs orthographiques ou les logiciels de synthèse vocale, nul n'écrirait de terrien académiquement correct.
D'où un retour à un langage parlé universel assez fruste qui correspondait très bien à l'action en ces périodes d'émancipation. Mêmes certaines onomatopées pouvaient être lourdes de sens chez quelques taciturnes, significations très accessibles à la télépathie d'Alsyen se basant sur les émotions et les motivations liées au déclenchement de l'usage de la parole. Mieux, Alsyen pouvait sentir le mensonge ou la méchanceté derrière chaque message apparemment sibyllin chez la plupart des créatures intelligentes.
*
* *
À la mi-journée, alors que toute la section finissait son repas, Reno amena Alsyen en chambre dans les locaux de la section. Il croisa le sergent Coll, ou plutôt l'ombre du sergent Coll. Celui-ci revenait de la visite médicale et les résultats d'analyse étaient mauvais. Le docteur avait décidé de temporiser la décision du commandement en prévoyant une contre-visite trente cycles/jour plus tard pour jauger d'une éventuelle amélioration après suppression par le sujet de l'usage de sa Neurovid. Néanmoins, il pensait certains dommages irréversibles.
À sa vue, et sans connaître la cause de sa tristesse, Reno proposa de bon cœur au sergent Coll une C'fet et celui-ci accepta. La conversation resta anodine et tourna autour d'Alsyen tandis que celui-ci mangeait. Alsyen perçut la détresse du sergent et les dégâts occasionnés par le Neurovid sur ses zones temporales.
Entraîné par la sympathie de Reno, il décida donc de stimuler certaines synapses qui allaient relancer la production d'hormones et de neurotransmetteurs qui eux-mêmes déclencheraient les réparations de manière naturelle. Le Neurovid « désamorçait » et déréglait trop de mécanismes pour que la réparation se relance d'elle-même. Il faudrait juste que pendant deux semaines, Alsyen puisse croiser Coll quotidiennement pour re-stimuler l'ensemble et ensuite, les choses se soigneraient d'elles-mêmes progressivement, totalement en quelques mois, mais déjà aux trois-quarts dans les deux premières semaines.
Coll prit congé de Reno avec un « Merci, c'était sympa de ta part, Reno. Mais fait gaffe, Caubard t'a dans le nez et il veut ta peau »Cérémonie de baptême
Alsyen va être baptisé au cours d'une petite fête surprise pour les recrues de l'escadre, mais préparée dans les moindres détails par l'équipe désignée par le chef d'escadre. En effet, l'Amiral a précédemment décidé une visite d'inspection dans toutes les unités élémentaires du vaisseau. À l'issue de celle-ci, la mascotte de chacune de ces unités va connaître son nom. Une manière de vérifier que la leçon a porté et qu'après les sanctions et les mises au point, les escadres sont à nouveau irréprochables et dignes de la confiance de leur chef.
Cela donne aussi l'occasion aux recrues de voir leur chef suprême à des millions de kilomètres à la ronde. Les chambres ont été rangées « au carré », les couloirs ont leurs parois étincelantes, les lourdes portes coulissent au petit poil et toutes les ampoules fonctionnent. Les sanitaires eux aussi ont eu droit à un nettoyage en règle, et durant les deux heures précédant la visite, puis pendant l'heure d'inspection, personne n'a eu le droit de les utiliser, d'où quelques grimaces de la part de certains.
Les deux-cents recrues non prises par le service sont maintenant au garde-à-vous devant leur amiral, section par section, avec leur encadrement, dans le réfectoire réaménagé pour l'occasion…
La corvée de Reno pour cette cérémonie a été de nettoyer Alsyen et de mettre en valeur sa fourrure. Il a fait ça au labo du « tripailleur », dans le bac d'une paillasse.
Si Alsyen ne craint pas l'eau, il n'a pas du tout apprécié le savon au citron mais Reno, malgré les sollicitations télépathiques a été intraitable. Lui aussi a donc été abondamment mouillé malgré le tablier en plastique que lui a prêté le « tripailleur ». Le plus pénible a été le nettoyage de la tête. Même les poissons dans leur aquarium se sont cachés suite à l'émission de détresse télépathique d'Alsyen, le passage de la tête sous l'eau étant équivalent pour sa race à un véritable supplice.
Sorti du bac, Alsyen semblait squelettique et pitoyable. Son air outré fit sourire Reno et Alsyen dut s'incliner et rire de son propre ridicule. Il se laissa donc faire durant la séance de sèche-cheveux, puis Reno le brossa en faisant bouffer les poils très fins. Alsyen reprit ainsi une forme plus présentable. Reno lui coupa au carré les poils qui sortaient des oreilles. Alsyen se trouva beau dans la glace que lui présenta Reno.
Il dut aussi enfiler l'uniforme réalisé par le maître-tailleur d'après les images prises par l'ordinateur spécialisé. Alsyen résista un peu pour la forme. Il était censé être un primate sauvage à peine apprivoisé. Néanmoins, ce cadeau imprévu qui lui redonnait toute sa prestance de Niumi civilisé lui fit énormément plaisir.
Un grand soin spécifique avait été apporté à sa conception. Sa queue avait son propre compartiment interne mais n'était pas visible de l'extérieur afin certainement d'éviter qu'elle puisse rester coincée dans une porte. Le tissu, multicouche, était bien sûr indéchirable. Les agrafes pour y fixer de façon étanche une capuche sous casque scaphandre afin de sortir dans l'espace étaient présentes. En avait-il un prévu pour lui ? (Plus tard, il s'avéra que oui. Reno reçut ainsi un paquetage complet pour son protégé, avec même des vêtements civils et une trousse de toilette adaptée. Ah, les applications du règlement parfois).
Cette combinaison était auto-respirante, anti-allergique, anti-odeur. Équipée d'un convecteur, elle récupérait la chaleur corporelle de l'individu pour recharger ses batteries, partie prenantes de la matière du vêtement elle-même. La polarisation variable des fibres permettait le détachage de toute matière organique interne et externe, ce qui permettait au vêtement de rester toujours propre. Plusieurs couches totalement isolantes pouvaient s'activer d'elles-mêmes en fonction de la température extérieure (sécurité) ou sur commande. D'anti-transpirant, le vêtement devenait alors totalement étanche. La transpiration collectée au niveau de la peau s'accumulait dans la doublure, comme les excréments liquides. Sel et eau était récupérés et utilisables en cas de besoin.
Ainsi, le recyclage des liquides, avec élimination des déchets dangereux permettaient à un naufragé de survivre plus longtemps. La plupart du temps, dès le retour dans une atmosphère sécurisée, il suffisait de vider les poches réservoir situées à l'extérieur des cuisses. Leur contenu était recyclé une deuxième fois à bord du vaisseau, car dans ce cas-là, personne ne pensait plus à l'origine de l'eau.
Les hommes ne portaient pas cette tenue en permanence. Mais elle leur servait aussi d'uniforme d'apparat, en particulier lors des escales. Le tissu infroissable, brillant et coupé sur mesure impressionnait les colons. Dans l'espace, en cas d'alerte, les hommes devaient l'enfiler au plus vite. Un autre modèle de combat au sol, plus résistant, prévu pour emporter armes, munitions, protégeant aussi des rayons laser de faible intensité, des impacts de projectiles de première catégorie et des champs magnéto-soniques, était rangé dans les casiers de chaque recrue. Différents modèles de bottes avaient aussi été conçus pour la compléter efficacement en fonction des circonstances. (température au sol, dans l'espace, résistance à l'eau, à l'incendie, poids et souplesse si long déplacement pédestre...)
Après essayage des gants et des chaussons à doigts pour Alsyen, ceux-ci lui furent retirés et rangés dans une poche dans son dos. Ainsi, en temps normal, il gardait toute son « adhérence naturelle » à Reno.
*
* *
La cérémonie commence.
Après la présentation des troupes par le chef d'escadre, l'amiral ordonne le « repos » puis entame son petit discours traditionnel. Il les félicite pour l'état impeccable de leurs quartiers pourtant vétustes puisqu'ils sont logés dans la roue la plus ancienne du vaisseau. Il félicite en particulier les cadres qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour la formation et les recrues ayant les meilleurs résultats aux tests continus. Il leur annonce un nouveau décor pour la prochaine simulation tactique globale, sans en trahir le secret du thème. « Mais il va y avoir de l'action et chacun devra être au maximum de son potentiel ».
Pour conclure, avant que chacun puisse goûter ce que l'excellente équipe de cuisiniers a préparé comme buffet, il décide de présenter une nouvelle recrue à l'escadre, dans la nouvelle fonction de mascotte.
Reno s'avance donc droit comme un « i » et au pas vers l'Amiral, avec Alsyen tenu sous les aisselles au bout de ses bras. Un haut tabouret est amené près de l'Amiral et Reno y dépose Alsyen. Celui-ci ne fait pas d'histoire, mais joue un peu l'apeuré, sans se forcer vraiment car il a aussi le trac d'avoir tous ces yeux fixés sur lui.
L'amiral sourit, puis se tourna vers les troupes.
— J'ai choisi pour notre ami un nom prestigieux de notre histoire. Un militaire bien sûr, qui s'est battu pour la grandeur de sa cité, pour ses valeurs, pour sa survie, son expansion et son rayonnement sur le monde d'alors. Je vous présente Scipion.
Il y a un blanc. Tout le monde ne connaît pas ce général romain. Puis les cadres de haut rang commencent à applaudir, vite suivis par le reste de l'assemblée.
« Et maintenant, la main dessus » (Vieille expression terrienne dont l'origine s'est perdue signifiant qu'on peut se servir au buffet).
Dans un joyeux brouhaha, tout le monde se rend auprès des tables chargées de boissons et de toasts disposées contre les cloisons.
— Venez avec nous au buffet officiel mon garçon , dit le second à Reno qui vient de récupérer Alsyen. Scipion est parfait. Il ne lui manque plus que la parole.Leçon de dressage
Tout le monde observe de son lit ou d'une chaise le duo Alsyen-Reno. Le spectacle attendu est une pièce comique.
Reno dépose Alsyen à une extrémité de la pièce. Puis il va à l'autre bout, tenant à la main une petite boite de croquettes de chocolat.
— Scipion ici ! ordonne-t-il.
Reno a décidé de dresser Alsyen. Maintenant qu'il a un nom, il va pouvoir le lui apprendre. Alsyen comprend déjà une bonne partie du langage courant et s'est même habitué à son rôle. Mais là, sa fierté en prend un coup. Il a décidé de se jouer de son dresseur dès qu'il le pourra.
Donc, Scipion ne bouge pas. Reno répète en lui tendant les bras. Scipion fait mine de se gratter les fesses.
— Allez, viens ici Scipion ! Insiste Reno en secouant la boite de croquettes.
Cette fois, Alsyen est d'accord. Aucun animal n'est censé refuser un appel direct à l'estomac.
— Bien Scipion bien, dit Reno en lui refilant une croquette.
Il s'éloigne et Alsyen le suit. Alors Reno revient et lui dit « Pas bouger ». Scipion s'assied donc. Reno repart. Alsyen aussi. « Non, Scipion, non ».
Reno le pose à nouveau au sol. « Scipion pas bouger ». Il parcourt un mètre. Scipion le regarde sans bouger. Reno revient, lui donne une croquette en lui disant « Bien, Scipion, bien ».
— Scipion, pas bouger.
Il s'éloigne et Scipion suit. Même jeu une dizaine de fois. Reno ne peut pas s'éloigner de plus de deux mètres après avoir donné une croquette.
Puis Alsyen le laisse traverser la pièce. Reno revient. Le félicite. Lui donne une croquette. Il le laisse sans rien dire. Alsyen le suit donc. Retour sur l'endroit, « pas bouger Scipion » puis Reno se place à l'autre bout de la salle
— Viens, Scipion. Viens, ordonne Reno.
Scipion s'étire. Le regarde, avance un peu. « Allez oui, viens Scipion ». Il décide de ne pas se presser. Reno secoue la boite. Alsyen s'arrête.
— Il n'a plus faim, fait Jean-Louis.
— Il est trop bête, ajoute Paulo.
— Allez viens Scipion, implore Reno.
Sur ce ton-là, Alsyen veut bien. Nouvelle croquette et deux trois caresses. « Pas bouger Scipion » et Reno s'éloigne.
— Viens, Scipion, viens.
Il en a assez Alsyen, et il tient à le faire savoir. À mi-parcours, il s'arrête et défèque.
Toute la chambre écarquille les yeux. Scipion n'a jamais fait cela auparavant. Et d'ailleurs personne ne sait ce qu'il fait d'habitude. Bien sûr que jamais personne n'a pu penser que Scipion pouvait ne rien faire. Mais, on s'imaginait qu'il allait plus loin, durant les périodes nocturnes, qu'une autre section devait nettoyer sans rien dire…
Tout le monde rit, sauf Reno qui sait qu'il va devoir nettoyer.
— Scipion vilain, sermonne Reno.
— Il faut le gronder, dit Jean-Louis,. Il y a un truc qui marche bien, c'est lui mettre le nez dedans.
Alsyen sent tout son poil se hérisser. « Non, Reno, non. Tu ne vas pas faire ça ? » songe t-il effrayé.
Reno se rapproche d'Alsyen. Si, il va le faire ! Alsyen s'enfuit mais la porte est fermée. Il tente en sautant d'atteindre le bouton, mais le manque sous la précipitation.
— Pas bête le singe, dit Jean-Louis, on dirait qu'il a compris. Attrape-le avant qu'il réussisse à se tirer ailleurs.
Reno l'attrape au vol.
Alsyen s'accroche à son bras, lui envoie télépathiquement des ondes de remords de sa part, de honte pour lui s'il lui faisait subir ça… Reno sait que tout le monde le regarde. Il ne peut plus reculer, sinon, il est bon pour nettoyer en permanence. Les corvées du matin et du soir lui suffisent. Alsyen appelle à l'aide toute la chambrée, se crispe, jette sa tête en arrière, fait les gros yeux gémit bruyamment mais rien n'y fait et Reno inflexible lui souille la truffe.
Les griffes rétractiles d'Alsyen, oubliées par Reno habitué aux ventouses qui les dissimulent jaillissent et en un éclair lacèrent Reno aux bras, déchirant combinaison et peau comme un simple film de plastique. Il lâche Alsyen, qui en profite pour se dissimuler sous un lit, en répandant des ondes de honte à la ronde.
Fin de la leçon d'aujourd'hui. Les deux ont appris plus qu'ils n'auraient voulu et chacun d'eux le regrette car chacun a sa part de responsabilité. Alsyen finalement ému par le désarroi de Reno cesse ses stimulations télépathiques. Reno nettoie les dégâts et personne ne rit. Il se promet demain de consulter en ligne les principes d'un bon dressage plutôt que d'improviser. Un animal, ça se respecte. Jean-Louis va chercher dans sa trousse individuelle des pansements hémostatiques et désinfectants à base de cyanoacrylate en tube (Les modèles en bombe sont interdits dans l'espace).
Alsyen remonte alors télépathiquement le moral des troupes et suggère une petite soif de C'fet à tous. Quand les premiers rires fusent à nouveau, il sort de sa cachette et va se blottir contre Reno qui discrètement le serre contre lui avec une effusion qu'il tente de masquer.Progrès et découvertes
Quinze cycles jours se sont écoulés. Aujourd'hui, Alsyen est capable de comprendre l'intégralité des conversations en cours autour de lui. Il sait aussi lire. Ayant mémorisé le code d'accès de Reno, il va pouvoir se connecter sur le réseau interne du vaisseau et étendre sa connaissance de la culture des humains.
Le sergent Coll est enfin sorti d'affaire avec ses problèmes médicaux. Le médecin de bord ne s'explique pas la régénérescence aussi rapide des neurones endommagés et le sevrage sans troubles psychologiques au Neurovid. Sur la feuille de soin, il a présumé d'une détérioration très rapide mais non définitive, donc réversible grâce à un emploi antérieur très peu fréquent. Cette conclusion de « très peu fréquent » permet aussi d'appliquer un bémol à la punition en cours et ne remet plus en cause de manière catégorique la suite de la carrière du jeune gradé.
Coll trouvant Reno très sympathique, il interagit sur le chef de groupe en titre de celui-ci, le sergent Sancruz afin de le convaincre de cesser les petites vexations quotidiennes imposées à Reno. D'ailleurs Alsyen lui aussi encourage le tourmenteur à plus de retenue, surtout verbale en lui simulant des goûts écœurants lors de l'emploi de termes blessants à l'égard de son subordonné. Le sergent Sancruz va finir par devenir poli avec tout le monde à la longue, bien conscient de ce « problème » dont il n'ose parler à qui que ce soit.
Quant à Reno, il prend du poil de la bête. Son assurance s'affirme vis-à-vis de ses camarades et il est moins gaffeur dans la vie quotidienne. Il faut dire qu'il bénéficie de l'aura de « responsable de mascotte ». Il est devenu une célébrité sur le vaisseau. Son singe savant en jette tout de même plus que les cochons d'Inde ou les souris blanches des autres unités.
Alsyen n'est pas étranger à cet état.
Il a de moins en moins besoin d'influer sur le rythme cardiaque ou les nerfs de son protégé/partenaire. En effet, il a corrigé le petit défaut congénital de Reno en stimulant quelques neurones jouant sur les sécrétions de l'hypophyse. Il a aussi un peu modifié les taux de sécrétions hormonales et bidouillé quelques neurones du cervelet pour finir de « câbler » les hémisphères cérébraux. Reno dispose aujourd'hui du double de neurones cognitifs par rapport à la grande majorité de ses congénères. Les performances de sa mémoire et de ses dispositifs mentaux en sont sur-multipliés. Reste à les lui faire utiliser à autre chose que ses maigres cours théoriques et le comptage de chaussettes auxquels il est destiné dans le cadre de son orientation initiale.
Alsyen a aussi corrigé le caractère naturellement indolent de Reno. Rêveur timide et maladroit, Reno ne se donnait que des buts étriqués à atteindre afin de ne pas être dépassé et son manque d'ambition pouvait le cantonner aux échelons subalternes de la hiérarchie. Aujourd'hui, Reno a envie de faire du sport, de progresser dans tous les domaines possibles. Il attribue cette nouvelle boulimie d'intérêts à la relative inactivité après ses classes à bord du vaisseau. Heureusement, il peut accéder à une salle de sport, et il commence à s'y rendre de plus en plus souvent en dehors des heures obligatoires en section. Les premiers progrès sont très encourageants et sa maîtrise de mouvement, qu'il s'agisse de sport de combat ou de geste technique, s'est bien améliorée, surtout qu'auparavant, trop craintif, il tremblait presque d'appréhension à chaque mise à l'épreuve, ce qui l'inhibait totalement. Alsyen, toujours à ses côtés veille au grain.
Comme ce fameux jour de la dernière décade... Reno s'entraînait à la boxe française contre un simple sac rembourré de mousse. Les trois sergents de la section sont arrivés pour s'entraîner entre eux. Surpris par la présence d'une recrue en ces lieux en dehors des heures imposées, Sancruz a décidé de le prendre pour adversaire au « full contact ». Reno monta alors sur le ring la tête basse.
Les trente premières secondes, ce fut un massacre. Reno tentait de parer, mais les coups de poing mêmes amortis par les gants, l'étourdissaient. Son adversaire en profitait pour l'accabler sous une grêle de coups de plus en plus appuyés et précis en toute liberté. Alsyen dissipa alors ses malaises en augmentant son rythme cardiaque, en stimulant quelques glandes pour dilater les veines, puis coupa les récepteurs de la douleur, simula en Reno une sourde colère et lui suggéra quelques enchaînements. Deux minutes après, un uppercut envoyait proprement Sancruz au tapis, alors que les deux autres n'avaient rien remarqué d'étrange en ce subit revirement de situation. Alsyen calma instantanément Reno avant qu'il n'y ait risque de débordement et celui-ci, avec sa gentillesse habituelle proposa alors sa main à son adversaire pour l'aider à se relever. Sancruz préféra refuser l'aide inattendue, prétexta une douleur au poignet et quitta le ring, baignant dans un mélange de surprise et de dépit. Reno n'en ressentit pas immédiatement de la fierté car Alsyen bloqua ce sentiment. Il ne fallait pas que la métamorphose semblât trop rapide.
Mais depuis cette raclée inattendue, Sancruz choisissait un autre cobaye pour ses démonstrations au niveau section et les vexations se raréfièrent pour disparaître totalement.
Reno doit encore intellectuellement beaucoup progresser, pour parvenir au niveau souhaité par Alsyen. Celui-ci stimule les centres de la curiosité, mais l'emploi du temps est chargé et les accès aux informations sont peut-être analysés. Alsyen s'oblige à la prudence et apprend simultanément les mêmes choses que Reno.
Lorsque la « roue » est endormie, Reno en profite pour allumer un des ordinateurs intégrés dans la table de la chambre. Il trouve enfin un descriptif du vaisseau école, avec une représentation visuelle et un descriptif technique, dans les grandes lignes. Derrière lui, Alsyen est horrifié. Les humains ont un tel retard technologique. Mais on ne peut leur dénier un certain sens pratique et un sacré courage pour s'embarquer sur de telles casseroles.
Le vaisseau est composé d'une base propulsive circulaire. À chaque extrémité d'un diamètre, deux grandes colonnes s'élèvent perpendiculairement à cette base. Ces deux colonnes supportent un axe les reliant entre elles. Cet axe est aussi celui de cinq roues internes (Mais on pourrait encore en rajouter deux à l'intérieur des colonnes). Rien n'interdirait d'avoir un jour des roues tournant à l'extérieur des colonnes, mais pour l'instant, il y a deux roues cylindriques stables de part et d'autre de l'ensemble.
Ces deux roues servent d'entrepôts dans les niveaux les plus proches des axes, de réservoirs dans les parties inférieures, de ponts d'envols et de garage pour les différents types de véhicules spatiaux ou terrestres embarqués dans les parties supérieures. On sort par l'avant de l'épaisseur du disque et on y entre par l'arrière. Ainsi, les trajectoires d'entrées-sorties ne se croisent pas et ne sont jamais perpendiculaires aux « roues d'habitation ». Elles sont aussi éloignées des réservoirs et des réacteurs de propulsion du vaisseau école. Enfin, les surfaces extérieures des disques, flancs de l'ensemble, servent de boucliers comme de support pour l'installation de canons pour la défense rapprochée. D'autres canons sont situés aussi sur deux niveaux à l'arrière et à l'avant dans l'axe du vaisseau.
La roue interne est plus large que les autres. Elle peut suspendre sa rotation en phase d'alerte ou de combat. C'est la seule roue à avoir la tranche entièrement armée. En effet, en son centre, jusqu'à mi-rayon, sont implantées la passerelle de commandement et l'état major. Pilotes et commandement peuvent voir dans toutes les directions grâce aux caméras positionnées tout autour du vaisseau, tout en étant au coeur supérieur de la structure du « Sun Tzu ».
Dans la partie supérieure (quand la rotation est bloquée), il y a trois niveaux de pistes d'envol, accessibles par l'arrière. Dans la partie inférieure sont prépositionnés des stocks de survie, toujours vérifiés et jamais entamés dans le service courant prévus pour être consommés durant les attaques, ou en cas de destruction des stocks plus exposés aux coups d'un adversaire. Les meubles sont fixés au sol et le matériel informatique de commandement inclus dans les tables. Les hommes s'arriment à leur siège, et pour se déplacer, disposent de semelles qui s'aimantent par induction en fonction de la position du pied à l'intérieur de la botte. Un talon qui se relève sous l'effet de la marche permet en fonction de sa position relative la dés-aimantation de l'arrière de la semelle tandis l'autre pied bien à plat commande l'aimantation totale. Si deux talons sont « en l'air » simultanément, les semelles restent aimantées.
Ce dispositif est indispensable puisque lorsque la roue ne tourne plus, il n'y a pas d'énergie cinétique créant une attraction artificielle contre les parois dans le sens de la tranche. Mais il n'y a pas de pesanteur non plus pour troubler un homme assis qui serait « tête à tête » avec son symétrique par rapport à l'axe.
En disposition de combat, l'équipe est donc répartie dans la roue centrale et dans les roues boucliers. Les roues d'habitation, trop exposées et suceptibles de subir des décompressions coûteuses en oxygène et destructrices sont exemptes de personnels, dépressurisées (et l'atmosphère récupérée), désactivées (moins de risques d'incendie, en particulier électrique) et protègent le cœur du vaisseau.
La surface extérieure du disque de propulsion ainsi que ses tranches sont hérissées de canons à commande déportée dans le centre de commandement. Il y a trop de radiations au niveau de ce disque pour y envoyer des canonniers. C'est pour cela que le nombre de canons y est très important. Il est redondant à l'extrême, car ils peuvent s'enrayer ou se bloquer dans une mauvaise position de tir, et personne n'ira les remettre en fonction durant la bataille.
En effet, la propulsion du vaisseau est nucléaire. Tout le disque est une superposition d'accélérateurs atomiques. Les gaz propulseurs décrivent une trajectoire en spirale d'accélération électromagnétique, dans un plan en partant du centre, puis dans le second de l'extérieur vers l'intérieur, et enfin selon le même principe au travers de trois autres avant d'être éjectés avec le maximum de vitesse, donc d'énergie pour propulser le vaisseau.
Ces gaz ne sont plus sous une structure moléculaire lors de l'éjection, mais plutôt en bouillie d'atomes car la vitesse a brisé toutes les liaisons et une recombinaison moléculaire n'est plus possible à l'intérieur du circuit.
Mélange de méthane ou d'autres pompés à la surface de certaines planètes, les gaz propulseurs sont conservés sous forme liquide à 100 °K, température régulée dans les réservoirs du vaisseau, mais dans les réservoirs souples en forme de dirigeables, ils sont, soit solidifiés quand il n'y a aucun astre « proche » et que la température passe en dessous de 80 °K. L'espace interstellaire est le plus froid, à 2,3 °K soit – 270 °C. Ceux-ci sont reliés entre eux par des câbles et forment un gigantesque succession de « saucisses » . Elle est disposée en arc de cercle à l'arrière du vaisseau car chaque extrémité est fixée à une colonne. Selon les besoins, le contenu du réservoir est réchauffé si besoin est, puis pompé pour remplir les réservoirs internes tandis que l'enveloppe souple une fois « dégonflée » est stockée dans les entrepôts. En cas d'attaque, les sacs sont largués, car ils peuvent gêner à l'accélération brutale nécessaire, comme risquer d'exploser sous les feux de l'ennemi trop près du vaisseau. Cependant, en vitesse de croisière, accélérés comme le reste de l'ensemble, il n'ont aucun effet parasite important puisque il n'y a pas de frottement dans le vide. En phase de décélération, le vaisseau « descend » par rapport au plan de l'ensemble, pour permettre aux réservoirs de passer au devant sans croiser les flux des réacteurs. En fait, c'est l'arrière qui monte un peu sous l'effet d'une légère éjection gazeuse et la propulsion le fait descendre. Le chapelet de « saucisses » s'aligne dans le nouveau plan. Puis la propulsion arrière est coupée, l'avant remonte sous l'effet d'une éjection de gaz, et la propulsion « avant » servant à la décélération fait passer le vaisseau sous l'arc de « saucisses ».
Cet effet est rendu possible grâce à la conception de l'ensemble « disque propulseur ».
Au premier niveau du disque, ce sont les cinq réacteurs nucléaires. Deux seulement sont simultanément en activité. Les autres sont en attente. Ils seront activés un par un quand un autre s'arrêtera faute de carburant. Car il n'y a pas de « recharge » en combustibles durant les voyages. Celles-ci s'effectuent à quai et seulement dans les stations spatiales spécialisées.
Les réacteurs servent aussi à la production d'électricité pour les accélérateurs atomiques et pour l'ensemble du vaisseau, ainsi que pour les circuits de chauffage qui font vivre celui-ci. Prés du cœur en fusion, après la piscine permettant l'échange calorique entre deux tuyauteries bat une pompe qui fait circuler un fluide visqueux bien chaud « à tous les étages ».
L'électricité alimente des batteries qui desservent les circuits de « prises » comme l'éclairage ou les circuits techniques intégrés dans la coque du vaisseau. Ces systèmes sont très variés et vont des valves pour les systèmes pneumatiques ou hydrauliques servant à l'ouverture-fermetures de « portes », à un réseau multiples ordinateurs-experts rendant compte au système central en temps réel des sous-systèmes dont ils ont la charge. Il y a aussi des radiateurs de secours en cas de « purge » ou fuite des circuits hydrauliques etc. etc.)
Mais surtout, elle alimente les gigantesques bobines d'induction des six accélérateurs.
Chaque accélérateur est doté d'une sortie d'éjection destinée à la propulsion. L'orientation de cette sortie permet de définir la direction de la poussée. Les disques peuvent se déplacer autour de leur axe, à la vitesse d'un degré par minute seulement, alors qu'il suffit de dix secondes pour « démarrer » un réacteur et trente secondes pour qu'il soit au maximum de sa capacité.
Donc, en temps normal, pas plus de deux réacteurs sont activés. Les sorties d'éjection sont pré-positionnées de la manière suivante : une à angle droit par rapport au sens de déplacement à droite, une de même à gauche, deux sorties à l'avant pour la décélération, deux sorties à l'arrière. Ces quatre dernières formeraient un X, avec un angle de trente degrés à l'avant et à l'arrière, si on devait relier par une ligne imaginaire l'arrière droit avec l'avant gauche, puis l'arrière gauche avec l'avant droit.
Ainsi, on peut obtenir très rapidement (dix secondes) une décélération dans l'axe de déplacement par extinction de la propulsion arrière et activation de l'éjection avant ou une déviation latérale puissante. Cette activation à l'avant ne doit jamais se faire à moins de dix degrés de l'axe de déplacement du vaisseau. Autrement, celui-ci pourrait être éclaboussé par ses propres gaz d'éjection qu'il « rattraperait » et il y aurait risque de radioactivité à bord. Pour pour un simple changement de cap, il suffit de faire lentement pivoter l'ensemble.
Enfin, pour les longs voyages où l'accélération initiale est importante en termes de délais de trajets, les six réacteurs, une fois le vaisseau sur le bon cap, peuvent être alignés à l'arrière et utilisés simultanément durant cette phase. Puis deux réacteurs suffisent à conserver la vitesse acquise (la vitesse maximale dépend aussi de la vitesse d'éjection maximale possible de la matière gazeuse).
La maniabilité est donc excellente, car les systèmes-experts d'aide au pilotage s'occupent de tous les choix en matière d'orientation des jets et de la puissance en fonction des mouvements du « manche à balai » entre les mains des pilotes. Mais ceux-ci restent indispensables pour gérer l'inertie de la masse afin dene ne pas percuter les planètes lors de la mise en orbite ou les quais des plates formes spatiales durant les manœuvres d'amarrage, car les ordinateurs ne peuvent pas tout faire, quoique...
Il n'empêche que pour Alsyen, ce système est bien primaire, et surtout, il regrette l'absence rassurante de bouclier anti-collision pour les petits corps célestes. Les hommes ne disposent pas de la technologie du vaisseau d'Alsyen et ont choisi d'autres solutions techniques, sachant tout de même que seule la redondance en matière d'équipements et de précautions peut permettre de lutter contre le hasard des mauvaises rencontres.
Les parois des zones pressurisées comportent des matériaux « auto-réparant » (mousse expansive). Le trou créé par le passage se rebouche par la pression du matériau environnant jusqu'à cinq centimètres. Ensuite, c'est la couche fluide pâteuse emprisonnée entre les deux couches de ce matériau qui s'écoule et coagule au contact de l'air qui s'échappe. Elle peut boucher encore huit centimètres en moins de trente secondes. Cependant, à l'intérieur, un corps vivant peut être traversé de part en part à n'importe quel moment, ce qui n'est guère rassurant.
La probabilité est quasi nulle dans les espaces inter-galactiques, mais est augmentée par la vitesse de déplacement et la proximité de planètes ou de comètes. Le choix fait par les humains du « traversé de part en part comme dans du beurre » permet, grâce à la multiplication et la diversité des systèmes mis en place, comme la sur-compartimentation ses espaces prévue dès la conception d'éviter les explosions ou les larges brèches dans les espaces habités.
Seuls les boucliers latéraux peuvent être endommagés sans « auto-réparation » mais il n'y aurait pas de fuite d'air catastrophique. Leur rôle à eux est d'arrêter des projectiles moins rapides ou des lasers dans le cadre de combats. Les hommes ont confiance en leur vaisseau. Seulement, si comme Alsyen, nous devrions perdre une vie de plusieurs siècles, nous serions aussi craintifs que lui.
Un détail important attire l'attention d'Alsyen. Le système central surveille toutes les sorties vers les ponts d'envol et y exerce un contrôle d'accès draconien.
En effet, ceux-ci sont dans l'espace et les hommes sont en scaphandre. Il faut donc passer par des sas, vidés de leur air (récupéré) à la sortie, et re-pressurisés avant de rentrer. Toute sortie doit être programmée et fait l'objet d'un ordre de mission individuel ou d'une habilitation permanente doublée d'une programmation. Pour des raisons de sécurité, des vérifications sont faites pour que jamais un travailleur de pont ne soit encore dehors une demi-heure avant la fin de son autonomie en oxygène. Un éventuel fuyard qui n'aurait pas programmé une sortie à l'extérieur, et sensé être encore sur le pont, serait donc repéré au bout d'une heure trente.
S'enfuir en volant une navette serait extrêmement compliqué pour lui, même en influençant un humain… il faut tous les sacrements de l'état-major pour pouvoir décoller...Drill intensif
Alsyen (tranquillement installé sur les genoux de Reno) poursuit en même temps que lui mais avec le regard en biais et l'esprit un peu léger l'instruction technique et militaire du jeune soldat.
Tous les gestes, toutes les situations, toutes les missions qu'il doit réaliser dans le cadre de son emploi existent en simulation. Pour lui, comme pour ses camarades.
Dans le cadre de son travail d'adjoint fourrier, Reno peut réaliser des distributions pour sa section, commander des véhicules de manutention de caisses dans les entrepôts sans gravité ou gérer des stocks de vivres en campagne au niveau d'une section isolée.
Pour apprendre les bons comportements au combat, il joue son rôle de soldat devant suivre les ordres de son chef en cours de mission tout en prenant garde à son environnement. Il apprend ainsi à toujours essayer de progresser discrètement, en évitant les éventuels pièges dissimulés le long d'une lisière, à traverser un découvert en liaison avec d'autres éléments du groupe, mais aussi à utiliser son arme (visée, suivi des indications de distance, identification de la menace…et autres données sont fournies dans la visière de son casque). L'ordinateur associé à sa combinaison, relié au réseau du vaisseau, analyse en permanence, par l'intermédiaire de sa mini-caméra à trois-cent-soixante degrés ventousée sur son casque et le dispositif de visée de son fusil d'assaut, l'ensemble de son environnement. Il peut ainsi renseigner d'une présence ennemie en temps réel (type, volume, position, intention, dangerosité), non seulement le soldat pour sa protection individuelle et celle de ses camarades, mais aussi le commandement pour la prise de décision stratégique.
Cette représentation virtuelle en 3D permet d'instrumenter les équipements comme les cadres d'ordres, les savoir-faire, les méthodes et les conventions au combat, ainsi que l'application de nombreuses consignes dans des phases particulièrement délicates comme le respect des procédures de sécurité à l'embarquement ou au débarquement d'une barge…
Ces programmes sont adaptés à chaque échelon hiérarchique et tout le monde suit un entraînement journalier afin que chacun, au combat comme en simulation générale, soit déjà drillé et réagisse avec un maximum d'efficacité. Si la simulation ne remplace pas la véritable expérience sur le terrain, elle reste la seule possible réalisable dans l'espace en ce qui concerne les opérations terrestres. D'autres exercices liés au vaisseau dans l'espace sont aussi réalisés physiquement aux abords des planètes ou à l'arrêt.
Reno s'étonne de ses excellents résultats. La stimulation effectuée par Alsyen porte ses fruits. Il ne sait pas que le programme d'instruction réagit en fonction de son niveau et que les exercices deviennent de plus en plus compliqués. Dans la vie réelle, Reno se révélerait comme une redoutable « bête de guerre » sur un champ de bataille.
Son corps progresse en souplesse, force et efficacité. Après l'épisode avec le sergent Sancruz, il a encore amélioré le contrôle de ses capacités combatives tout en commençant à profiter de la rapidité et de la force. Le programme sportif qu'il s'impose selon les indications soufflées par Alsyen lui apporte élasticité des muscles et des tendons, augmentation de la masse musculaire et optimisation physico-chimique du système nerveux. Le nombre de synapses a encore été doublé. Les neurones eux-mêmes à chaque régénération cellulaire font progresser leur infrastructure de canaux sodiques et améliorent leur conductivité. Les gaines de myéline ont été renforcées, la composition des neurotransmetteurs a été épurée. Enfin, le système physiologique a ralenti la mort des neurones, développé leur système dendritique, multiplié les connexions chimiques. Le système immunitaire fabrique des anticorps supérieurs aux modèles classiques, à large spectre et s'attaquant même à certains virus et aux cellules pré-cancéreuse.
Le sang est mieux filtré, l'hémoglobine est plus efficiente et les organes eux-aussi ont été optimisés.
Le phénomène de vieillissement naturel est retardé grâce à une mitose sécurisée principalement aux stades de l'interphase et de l'anaphase, lors du renouvellement cellulaire. Reno est donc en pleine forme et en proie à un appétit féroce.
Le système expert de détection des meilleurs éléments l'a inscrit en tête. Néanmoins, personne encore ne le consulte à ce sujet, car Reno n'est pas dans une phase d'orientation.
Le niveau de simulation se porte donc pour Reno dans le cadre de simple combattant comme de sa progression en trinôme au sein de son groupe commandé par un sergent. Dans le cadre d'une manœuvre, il a aussi un rôle au niveau section, qui dispose de quatre groupes, et une interaction avec le niveau escadre. Dans l'espace, où les effectifs sont réduits, les grandes armées n'existent pas.
Pour la défense d'une planète peuplée de colons, on ne prévoit qu'un vaisseau amiral, que l'ennemi soit situé dans l'espace ou sur la planète. Il peut y avoir quatre ou six escadres sous le commandement d'un état-major partagé entre plusieurs missions : « Le vaisseau », l'escadron spatio-aérien, les troupes au sol, et les liaisons avec l'état-major allié (les colons). Il y a obligatoirement une escadre attachée au vaisseau, et une escadre qui est en fait l'escadron aérien.
Le vaisseau-école ne forme donc que deux escadres de « troupes au sol » à la fois.
C'est plus un choix technique et logistique adapté au format actuelle des troupes du FCP.
Néanmoins, l'amiral et les vétérans, dont la section est une section d'état-major, autant qu'une garde rapprochée, s'appliquent à faire évoluer ses schémas en testant d'autres combinaisons avec le pool des programmeurs-concepteurs du vaisseau. Ce sont eux, avec un des trois adjoints de l'amiral, qui mettent au point les « simulations globales », ou font évoluer les programmes d'instruction virtuelle.
Il existe aussi une salle par escadre avec des armes quasi-réelles et des caméras percevant mouvements et position, reliées au système informatique et une cinématique grandeur nature projetée sur un large écran. Cette salle permet de s'entraîner au tir et au déplacement avec une représentation 3D conforme aux gestes et attitudes réelles des participants, (un groupe de quinze hommes : deux trinômes assaut, deux trinômes soutien, un trinôme de commandement et de liaison (un élément liaison sol, un élément liaison aérien, et le sergent).
Ces trinômes peuvent s'appeler différemment selon les missions. Par exemple, dans le cadre d'une embuscade visant à l'attaque d'un convoi ennemi, le premier trinôme est l'élément d'arrêt qui bloque la progression du convoi en prenant sous ses feux le véhicule de tête puis tout véhicule qui tenterait de la dépasser. Le second trinôme constitue l'élément de destruction. Le troisième trinôme sert d'« élément de couverture ». Il empêche les véhicules du convoi ou les troupes qui en descendraient de déborder par l'arrière les éléments précédents en sortant de la voie de circulation du côté du flanc d'où proviennent les tirs. Enfin, le quatrième trinôme guette l'arrivée éventuelle de renforts qui viendraient dégager le convoi des feux qui le paralysent et le détruisent.
Toutes ces techniques sont le fruit de réflexions de milliers d'années de guerre, constate Alsyen. Néanmoins, elles ne sont pas spécialement valables dans tous les types de conflits modernes. L'unité de combat de base zannien regroupe une intelligence zannienne, un système expert, et une centaine de droïdes très spécialisés de toutes tailles mais aptes à l'autonomie dès lors qu'une mission individuelle leur est confiée.
La pointe du combat au sol d'infanterie a une composante aérienne équipée de droïdes qui se propulsent en trois secondes à cent mètres de haut et arrosent de grenades dans les dix secondes une zone de un kilomètre de long sur cinquante de large. L'ensemble du dispositif d'attaque humain niveau escadre serait anéanti avant la première velléité de repli.
Les scénarios les plus loufoques parfois permettent aussi d'utiliser ce matériel en détente, mais la plupart du temps, le verdict tombe durement (« trop en arrière, tu n'as pas couvert ton camarade, il est mort par ta faute », « trop en avant, tu t'es exposé à la vue de l'ennemi trop tôt faisant perdre l'effet de surprise », « trop distrait, tu as marché sur une mine… »).
Être soldat, ce n'est pas simple et les erreurs se paient au prix fort, alors que la ressource est rare et coûteuse pour faire face à des besoins...astronomiques. Le champ de bataille n'est pas un terrain de jeu et la réalité de leur formation leur fait oublier la fiction des films de propagande pour inciter à l'engagement de toute l'humanité dans la conquête spatiale, effort soutenu depuis plus de trois siècles…
Les mises en situation tactique des échelons supérieurs, grâce aux résultats individuels permanents des troupes, permettent aux chefs de prendre des décisions avec les moyens virtuels correspondant aux moyens réels. Un individu mauvais pénalisera donc son chef sur le terrain. Ainsi, le commandement, à tous les niveaux est obligé de s'investir dans le suivi et la motivation de ses subordonnés dans le réel. C'est pour cela aussi que les exercices sont soit individuels, soit en réseau, par groupe, section ou escadre avant les exercices de « restitution » au niveau global. La simulation permet en outre un vrai gain de temps dans l'instruction, grâce à une préparation minutieuse déjà réalisée pour les exercices basiques, avec des objectifs pédagogiques clairement identifiés, comme une véritable mise à l'épreuve lors des simulations globales où « tout peut arriver ».
Dans le premier cas, on peut faire l'analyse critique et « rejouer l'exercice » jusqu'à l'obtention du résultat escompté, autant individuel que collectif (Et dans l'espace, le temps ne manque pas pour la simulation). Mais, lors des simulations globales, la sanction du « terrain » tombe et l'amiral se charge d'être le « juge suprême » de la qualité des actions menées.
En prévision de l'arrivée prochaine pour une restitution physique d'envergure sur B006, l'exercice de simulation globale de mi-parcours sera déterminant pour l'instruction complémentaire à réaliser avant cette nouvelle mise à l'épreuve.
L'Amiral place l'homme au cœur du dispositif. Selon lui, sans la détermination et la compétence du soldat, les moyens employés seraient sans effet face à un ennemi plus motivé. De plus, la meilleure des mécaniques des systèmes d'armes comme des systèmes de transmission et de commandement peut s'enrayer pour un grain de sable dans l'œil du chef mal secondé par des subordonnés sans imagination ni initiative. Avec ses chers vétérans, il a préparé une sacrée surprise pour ses cadres qui ne connaissent pas encore la dure réalité des niveaux extérieurs.
Car si l'homme n'a toujours pas rencontré d'espèces intelligentes, il s'est quand même implanté sur des planètes dont l'évolution des espèces en est encore au niveau de la griffe et de la dent, mais où parfois existent des groupes sociaux primaires, plus évolués que les termitières ou les bandes de loups… avec lesquels l'affrontement direct peut être pire qu'essayer d'endiguer une marabunta de fourmis de deux mètres de long équipées d'une queue de scorpion. Ces planètes-là, à risque, ne sont bien sûr pas ouvertes à la colonisation de masse.Visite des entrepôts
Après le déjeuner, Reno retourne à sa chambre avec Alsyen . Il vient récupérer son équipement spatial, et celui de la « mascotte » qui est tout à fait opérationnel. Aujourd'hui, il se rend réellement dans les entrepôts pour apprendre, lors d'une véritable opération de déstockage, à manipuler les lourds containers en apesanteur.
Il passe alors ses bottes « de cale ». À la différence des bottes normales, celle-ci s'enfilent dans la double épaisseur des jambes de pantalon qui ainsi les recouvrent et se fixent de manière étanche sur la botte au niveau de la cheville. Enfin, elles sont elles-aussi à aimantation progressive (seule est aimantée la partie en contact, en respectant le mouvement du pied. Cette aimantation est réalisée grâce à un maillage de mini-bobines inductives ultra-conductrices (qui en plus chauffent la botte) alimentées ou pas situé dans la semelle. Les gants fonctionnent sur le même principe, que ce soit pour l'étanchéité, qui cette fois se fait au niveau du poignet, que pour le chauffage (sur le dos de la main) mais ont une aimantation facultative et réglable en intensité. L'énergie électrique est stockée dans les multi-couches de la combinaison, qui a aussi des qualités de protection aux chocs et d'isolement aux différences extrêmes de température.
Au niveau du casque, la combinaison dispose d'une capuche habituellement rangée en col fermé par des bandes auto adhésives électrostatiques. Un simple changement de polarité et la capuche peut se dérouler. Le casque est composé d'une partie rigide protégeant le crâne, et d'une visière prolongée par une mentonnière pouvant basculer d'avant en arrière et dont chaque coté vient s'emboîter hermétiquement à la base arrière du casque, emprisonnant ainsi la mâchoire. La mentonnière et la base du casque sont elles-mêmes prolongées par une « jupe » qui vient électrostatiquement se fixer dans le dos, sur les épaules et sur le torse. L'air entre les deux couches de « tissu spatial » est chassé par l'injection d'un gel qui aura tendance à se rétracter et à coller dès qu'il sera soumis à basse température, ce qui est rapidement le cas dans les entrepôts (il y fait moins soixante degré Celsius).
Alsyen est encore une fois étonné par cette rusticité. Là où l'homme emploie un système multi-couches de fibres tissées alterné avec des couches isolantes métalliques et d'autres plastiques, sa technologie utilise un champ ondo-magnétique généré à fleur de combinaison très seyante, à la fois isolant et protecteur grâce aussi à des micro-paillettes réfléchissantes polarisées emprisonnées en son sein. Il n'y a pas de contact de la combinaison avec le vide donc il n'y a pas de déperdition de chaleur. L'énergie lumineuse quant à elle est dispersée par les micro-paillettes avant de l'atteindre et n'entraîne pas de surchauffe.
Ensuite, juste avant de sortir, il faut, par-dessus la combinaison de bord, enfiler un scaphandre bien plus épais que celle-ci, rigide sauf au niveau des articulations du poignet, du coude, et du genou. Le scaphandre se clipse lui aussi au casque, aux gants et aux bottes.
Sécurité maximum. La zone des entrepôts jouxte celle des hangars aux navettes. Ceux-ci, durant le déplacement intra-planétaire sont fermés. Cela leur permet de ne pas être exposés au froid extrême de l'espace de l'ordre de moins trois cent cinquante degrés Celsius quand il n'y a pas d'étoile dans les environs. Actuellement, l'espace extérieur est à 150°K grâce à Alpha du Centaure. C'est quand même un froid à ne pas mettre une navette dehors. Il ne fait que moins cent degrés Celsius dans le hangar des navettes, quasi désert en période de voyage.
Le sergent Coll se charge de la formation de Reno. Celui-ci se réjouit de recroiser Alsyen et il a insisté pour que Reno l'emmène. De plus, Reno doit se sentir en confiance. Les manœuvres à effectuer sont délicates. Ils faut responsabiliser sans mettre une pression trop forte qui pourrait avoir des conséquences dramatiques.
Ils enfilent leurs scaphandres. Puis ils effectuent mutuellement les vérifications d'usage des systèmes de sécurité, de l'étanchéité et de l'intégrité de ceux-ci. (pas de trou, ni d'entaille, ni de pli collé ou de bande électrostatique désactivée, discontinue, mal positionnée...). Ils sont alors autorisés à entrer dans le sas après identification auprès du poste de sécurité de l'état-major qui, à distance, leur ouvre la lourde porte. Quand celle-ci s'est refermée, l'atmosphère du sas est saturée d'un gaz irritant sous pression. Cinq minutes plus tard, si aucune plainte n'émane des trois reclus, c'est que leur équipement est opérationnel. Le vide est fait et la deuxième porte s'ouvre sur l'entrepôt Charlie.
Après ces deux mois de confinement, Alsyen et Reno se sentent écrasés par l'immensité de celui-ci. La porte est située prés du plafond, alors que le sol est à trente cinq mètres plus bas. De là où ils sont, ils peuvent tout voir. Les containers, de trois mètres sur quinze, pour trois mètres cinquante de large, sont rangés empilés par dix, opposés par l'arrière. Ainsi, ils présentent en permanence leurs portes à la vue. Pour en contrôler le contenu, rien ne serait plus facile que de les ouvrir. Seulement, les containers sont chauffés par circulation de fluide. Leur disposition empilable permet à leur circuit de chauffage de communiquer avec leur voisin du dessus, du dessous et des cotés. Ouvrir signifie faire descendre la température de moins dix à moins soixante degrés Celsius et de risquer endommager les tuyaux de fluides internes. Alors, il vaut mieux s'abstenir. Pour les ouvrir dans de bonnes conditions, il faut les manipuler pour les installer à l'entrée de sas spéciaux qui en permettent le vidage ou le remplissage en atmosphère normale. À l'autre bout, des hommes peuvent donc les ouvrir et remplir les monte-charges permettant la répartition ultime dans les escadres ou dans les ateliers.
Trois ponts télécommandés pouvant se déplacer sur des rails d'acier en hauteur, et équipés de palans avec des chaînes au bout desquelles s'agitent des mousquetons de quarante centimètres de long permettent cette manipulation. Les containers sont numérotés et leurs contenus sont recensés dans les mémoires des ordinateurs du vaisseau, sauf pour quelques-uns encore, datant d'une semaine avant l'arrivée de l'amiral, il y a vingt sept ans, qui ont été perdus dans les strates du cargo. Non équipés de la balise d'identification, et suite à un gros clash, ils ont totalement disparu des archives. Pour un potentiel d'embarquement par entrepôt de six mille containers, il reste une douzaine de « fantômes » auxquels on n'accède jamais. Il suffirait de retrouver les identifications en double alors qu'une seule est présente dans le fichier en « lisant » toutes les portes des containers mais on préfère compter sur le hasard pour les retrouver. Ainsi, s'il existe deux containers 1695, on « charge » le premier 1695 que l'on trouve sur le chariot. Si le contenu correspond à l'état de chargement, tant mieux, sinon, c'est qu'on a retrouvé un container perdu…mais alors, où est l'autre ? Par jeu, personne ne recense les numéros des containers ouverts pour lesquels le contenu ne correspondait pas...
Lorsque un container a été vidé, il est placé au bout de l'entrepôt. Afin d'équilibrer vide et plein, les entrepôts C et D qui sont accolés sont vidés « en opposition ». Parfois un container vide est aménagé en lupanar ou en popote. Les « fêtards » embarquent avec un système de chauffage et un système d'oxygénation dans le container par le sas de chargement-déchargement et se font enfermer. Avec un complice dans l'entrepôt, le container quitte le sas et ses occupants ne risquent pas d'être dérangés durant leurs excès. C'est strictement interdit, mais c'est inévitable.
Cette façon de fuir un instant le vaisseau et la promiscuité est très prisée. Une histoire de container « fantôme » ainsi occupé circule afin de dissuader les fêtards mais l'Amiral sait qu'il n'en est rien, ou alors son amiral de l'époque a su cacher la disparition de quelques membres de l'équipage. Ce qui est sûr, c'est que l'internement disciplinaire sans lumière avec un chauffage minimum et quelques rations est aussi strictement interdit par la hiérarchie militaire de haut niveau. Quelques amiraux y ont tout de même recouru pour des cas extrêmes.
Reno est assez ému de manipuler les commandes du pont central. Il apprend à ne pas donner d'accélérations brusques et à poser doucement le container à la place exacte pour permettre l'emboîtement des circuits de chauffage. L'effet du poids n'existe pas en apesanteur, mais celui l'énergie cinétique, produit de la masse par la vitesse au carré existe bien. En cas de choc, il peut donc y avoir sous son action détérioration irrémédiable d'une jonction, ou plus grave, celle d'un sas, d'un pont, d'un autre container, d'une cloison... ou l'écrasement d'un collègue situé sur la trajectoire alors qu'il est en train de guider le conteneur pour réaliser un emboîtement parfait. Car au ralenti, on peut « pousser », quand les pieds aimantés touchent bien le sommet d'un container ou le sol, un autre container non emboîté.
Le sergent Coll constate les manœuvres parfaites de Reno. Il en est heureusement surpris car former un jeune à cet exercice est une sacrée responsabilité. Néanmoins, le protocole exige un nombre minimum de mêmes manœuvres à effectuer à la suite, alors il suit le protocole même si c'est une perte de temps, question de responsabilité en cas de problème éventuel ultérieur.
Le cerveau d'Alsyen est assailli par des ondes suspectes. Cela provient de l'autre extrémité de l'entrepôt. L'exercice étant terminé, il « suggère » au sergent Coll de décider un petit tour avec le pont pour l'atteindre. Chacun s'accroche à un palan et sur ordre, Reno lance le pont « à fond », histoire de tester la sécurité du freinage d'urgence. À cinq mètres du mur, le pont stoppe brutalement. Les deux compères continuent leur course au bout de leur chaîne, la lâchent au bon moment et vont se coller contre la cloison avec leurs quatre membres. Le jeu déplaît à Alsyen qui ne dispose pas de gants aimantés car il ne serait pas capable, selon leur fabricant, d'actionner le coté facultatif. Il rebondit donc sur la paroi et se retrouve à l'horizontale, avec la vue dirigée vers le haut, tenu par les pieds. Les deux hommes rient. Mais lui ne pense qu'à ces ondes psychiques. Malheur, elles émanent de mantas. Ces créatures de l'espace semblent immatérielles. Elles ne sont pas perceptibles à l'œil nu et passent au travers de la matière. Elles se nourrissent de matière fissile, de chaleur et de rayonnement lumineux. Il n'y en a que deux mais elles sont collées aux réacteurs nucléaires. La consommation du vaisseau doit en être augmentée. Les réserves en uranium pourraient ne pas être suffisantes. Et ce serait la mort pour tout l'équipage. La solution pour s'en débarrasser est de se rapprocher d'un soleil, source de nourriture, puis d'émettre des ondes d'une certaine longueur qui leur sont, pour des raisons inconnues extrêmement désagréables. Elles choisissent alors de changer de fournisseur. Mais comment prévenir les humains sans se compromettre ?
Il n'y a pas encore urgence mais ce vaisseau est condamné s'il ne fait rien.
Au retour des entrepôts, un vétéran aborde Reno.
— Petit, suis-moi avec Scipion. On va le numériser.
Reno est ravi. Ainsi Scipion sera dans les programmes de simulation avec lui. Reno bafouille un peu .
— Oui Monsieur (*). Avec plaisir.
Le vétéran le regarde de ses yeux glacés. Les traits burinés de son visage sec sont durs et figés. Les rides sont profondes alors que l'homme n'a pas l'air si vieux. Son crâne rasé est parcouru de veines proéminentes. Il est aussi efflanqué qu'un épouvantail. Reno n'ose plus bouger, attend d'interminables secondes que l'homme brise cette glace qui l'emprisonne.
— Gamin, ne m'appelle jamais Monsieur. Moi, c'est « chef », compris ?
— Oui M…Chef.(*) Monsieur est la traduction de "Sir" réservé aux officiers dans les armées du vingtième siècle. Le vétéran doit être un non-officier ancien avec une certaine aversion pour le « corps » supérieur.
Simulation globale
Les programmeurs de l'état-major ont monté l'exercice « Bêta 112 : retour à la normale » de main de maître. Ils ont simulé la colonisation de la planète végétale avec quelques villes, des secteurs industriels et des mines d'uranium, de fer et autres métaux précieux.
Ils ont aussi défini la cartographie des villages autochtones. Une race guerrière, peu évoluée au niveau technique, mais redoutable au corps à corps et à la guérilla. Certaines tribus disposeraient aussi d'un arsenal d'armes de poing volées aux colons.
Il ne s'agit pas de tous les massacrer, mais de leur faire entendre raison quant à la suprématie technologique et militaire des humains. Afin de rétablir la paix, il faut dissuader et effectivement, en échange, on peut leur fournir quelques produits inédits manufacturés : les petits cadeaux entretiennent l'amitié.
La mission de l'Armada est donc de venir en aide aux colons, avec leurs moyens militaires aériens et terrestres. Aucune opération amphibie n'est prévue. Ce type de mise en place ne se justifie pas, les barges aériennes à atterissages et décollages verticaux permettant d'investir les plages avec de nombreux personnels sans se mouiller et bien plus rapidement.
Il faut savoir aussi qu'aucune évacuation totale des colons n'est possible. L'expansion coloniale a atteint le point de non-retour, en matière d'investissements comme en volume de population. Seuls 25% de la population pourraient être évacués, et elle ne le sera que si 75% ont été massacrés au préalable. Par contre, après définition des points sensibles à tenir coûte que coûte, et celle des lieux de regroupement sans risque, des missions d'extraction de colons de zones sensibles seront organisées, avec le risque d'être « accroché ».
Après la « bande annonce » du contexte , les chefs peuvent consulter les cartes de la planète et prendre contact avec des entités virtuelles figurant les colons afin de préparer les états-majors terrestres. Certains officiers sont des officiers de liaison (O.L) professionnels prévus pour travailler en équipe avec les colons et ils transmettront les demandes de moyens militaires à l'Armada, ainsi que tout renseignement à propos des colons susceptible d'être « utile » à la décision. Le commandement des opérations est dévolu à l'Amiral, mais la décision d'action est conjointe entre celui-ci et le « représentant planétaire ». C'est cependant l'Amiral qui, le cas échéant, prend le dessus en matière de diplomatie avec les races locales évoluées.
La simulation commence. Reno a été affecté comme aide de camp de l'état-major de l'escadre, après la distribution (fictive) aux hommes de sa section de tous leurs équipements de combat terrestre. Cela va de leur équipement de vie en campagne (tentes individuelles, petits outils, trousses de premiers soins, produits d'hygiène spécifiques – par exemple le savon parfumé autorisé à bord est prohibé en opération, on ne peut se raser qu'à la crème dépilatoire afin d'éviter les risques d'infections par des germes locaux inconnus– à des compléments de paquetage indispensables non conservés dans leurs armoires et parfois spécifiques au type de mission comme l'armure-gilet et le casque intégral de combat entre autres). Reno est « virtuellement » aux côtés de son chef d'escadre même s'il est physiquement dans sa chambre avec ses camarades.
Ils ont tous des casques audio qui les isolent physiquement des uns en les rapprochant virtuellement des autres. Alsyen suit l'évolution de la situation par les yeux de Reno et fait mine de dormir sur le lit. Son double numérique a beaucoup amusé la galerie, avec une petite cinématique reprenant ses « acrobaties » du premier jour. C'était la « private joke » du briefing initial. Maintenant, il se tient tranquillement aux cotés de Reno virtuellement en salle état-major. De temps en temps, son avatar fait une bêtise qui provoque un désagrément à un officier en pleine action et l'hilarité de ses camarades. Ces humains sont de grands enfants.
Le réalisme est extrême. Le rôle de Reno en ce moment est de préparer la salle de détente des officiers, avec restauration légère et rafraîchissements. Les officiers qui s'y rendront guideront leur avatar puis irons réellement à la salle d'à coté, dans la pièce de l'état major. Déjà la mission pour transporter des officiers de liaison (O.L) dans la capitale virtuelle de Bêta 112 a quitté le bord. Une navette équipée de huit barges se prépare à disperser celles-ci sur toute la surface de la planète en les larguant au plus près de leur point d'atterrissage. Elles transportent les équipes de recherche en profondeur (renseignement) plus deux sections aguerries pour déjà tenir une position stratégique.
Les navettes peuvent éventuellement atterrir sur les planètes à condition qu'il y ait de grandes pistes d'atterrissage, nécessaires aussi au décollage. Mais la dépense énergétique est très importante, même si elles se posent ou décollent comme un avion.
Les barges sont des sortes d'ailes volantes circulaires, avec un cockpit à l'avant pour les deux pilotes. Une petite queue à l'arrière stabilise l'engin et peut l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière afin de permettre à la grande hélice du centre d'élever l'ensemble, de le faire avancer ou de le freiner, comme pour un hélicoptère.
Elles disposent aussi de petites ailes escamotables qui peuvent les diriger tout en planant, avec l'hélice en auto-rotation. Un habitacle en fait le tour, tel une couronne et est occupé par les troupes d'assaut et leur matériel. Il existe un réservoir de carburant destiné au groupe électrogène fournissant l'énergie électrique pour le moteur, secondé néanmoins par de nombreuses batteries intégrées dans la coque qui se chargent en électricité quand la barge se laisse « tomber » en silence au dessus de son point d'arrivée. Elles font partie du bouclier inférieur qui protège aussi le dessous de la barge de tirs de projectiles. Au dessus et au dessous de l'hélice, un filet serré en câbles de polymères cent fois plus résistant et dix fois plus léger que l'acier, évite à celle-ci de cogner avec des oiseaux en vol, et avec des bouts de bois, ou des pierres à l'atterrissage. Sur le bord extérieur de l'habitacle, une sorte de store automatique déplie ou replie une « jupe », et à l'avant, une grosse hélice dans un cadre peut quitter l'intérieur de l'habitacle pour se positionner au dessus du poste de pilotage. La barge se transforme ainsi au sol en hydroglisseur. Le déplacement nécessite alors moins d'énergie qu'en vol.
La position du jour sur la planète détermine quelle demi-escadre part au combat. Le rythme des demi-escadres est décalé de six heures, une même escadre couvrant ainsi dix-huit heures potentielles consécutives. Ainsi tous les personnels d'une demi-roue s'endorment totalement.
Il y a aussi quatre quarts pour les équipes d'état-major mais leur roue a des quartiers spécifiques pour qu'ils ne se gênent pas dans leur cycle de vie quotidienne.
Pour les attaques, autant que possible, le rythme des escadres est respecté au moins pour le départ. Ensuite, il s'agira d'aléas « au sol », mais les personnels seront fatigués au moment de la nuit, quoique que le rythme de la rotation de Bêta 112 soit de trente heures. C'est un problème de plus pour les grands décideurs. La durée de l'exercice est prévue aux alentours de quarante-huit heures pour ne pas compromettre l'instruction des personnels, mais une attaque manquée au départ ou une résistance acharnée due à une erreur de programmation initiale peut prolonger l'exercice. Car il est hors de question de se contenter de résultats partiels. La partie doit être gagnée.
Le chef de Reno connaît ses objectifs. Face à sa webcam, il s'adresse à ses hommes pour leur donner les informations et les ordres nécessaires à la mission de l'escadre. Il sera bref car les chefs de section vont ensuite préparer les ordres avec les sergents avant de s'adresser à l'ensemble de leur section. Les sergents vérifieront que tous leurs hommes ont bien compris les ordres et ont bien préparé leur paquetage avant le départ. Enfin, ils pourront dormir réellement, pour être réveillés trente minutes avant le départ virtuel. L'escadre devra installer son PC dans une petite ville. Ce PC sera protégé par la Section Une renforcée par trois sections de colons, civils formés sur le tas, et équipés avec du matériel local.
La section Deux, celle de Reno, devra assurer la sécurité de l'évacuation de petits villages, couverte ensuite sur ses arrières par la section Trois.
La section Quatre quant à elle reste en réserve dès l'atterrissage. Elle peut être engagée à la demande en renfort, ou relever une section éprouvée après un dur combat. Sinon, elle remplacera, dix heures plus tard, la Section Une dans sa mission de surveillance… qui se substituera à la section Deux qui prendra la mission de la section Trois qui elle-même sera placée en repos.
Toutes les escadres s'organisent ainsi, afin que les recrues puissent être jaugées sur trois types de mission différents. Enfin, un groupe comprend l'adjoint de section, tandis que le chef de section se place au sein d'un autre. Ainsi, avec le « décalage » permettant un groupe en situation de repos, il y a permanence du commandement de la section.
Alsyen ne peut que constater l'ingéniosité de cette organisation, auxquels les moyens techniques ont été adaptés via un cahier des charges initial.
Chaque section de combat débarquée compte soixante hommes. Chaque navette de huit barges peut débarquer deux sections. Chaque barge compte vingt-deux places pour permettre un éventuel sur-effectif accompagnant les groupes (chef d'escadres, officiers de liaison, spécialistes…)
Le vaisseau école « Sun Tzu » dispose donc d'une force de frappe terrestre de quatre-cent-quatre-vingt fantassins, auxquels il faut ajouter les deux pilotes et le mécanicien de bord de chaque barge. Vingt navettes au total sont servies par six hommes (deux pilotes, deux mécaniciens et deux canonniers, les canonniers ayant des compétences de mécanicien, et les mécaniciens des compétences de pilote adjoint.) Deux équipages, en alternance sont prévus pour chaque navette.
Avec le personnel de bord du « Sun Tzu », cela représente un effectif total de mille hommes. Mille hommes pour sauver une colonie de terriens face à plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'autochtones. Il faut impérativement une supériorité technique et une force de frappe militaire crédible pour s'imposer. Mais surtout, il faut de la diplomatie et du bluff. Une race non équipée de télescopes ne doit pas pouvoir connaître les vrais effectifs auxquels elle est opposée. Car le nombre est en sa faveur.
Pour l'instant, la race humaine n'a pas été confrontée à une race avec, entre autres, une armée organisée. Pas même une race qualifiée d' intelligente. Les simulations ne prennent donc en compte que des peuplades très primitives qui ne peuvent s'opposer à l'exploitation de leurs ressources minières.
Néanmoins, un « droit sidéral» de l'indigénat les protège de sévices esclavagistes ou de génocides. Sur une planète déclarée « habitée », les colons ne peuvent prétendre à occuper plus de dix pour cent des terres émergées.
En cas de société sédentarisée agricole, ce pourcentage passe à cinq, en partie en zone désertique qu'il faudra « aménager » pour être supportable et il est nécessaire de développer une diplomatie afin d'aider la race à atteindre le niveau de race industrialisée en échange. En cas de société industrielle, il ne peut y avoir que négociation : il ne s'agit alors plus de colonisation mais de comptoir d'échange marchand en préambule à des liens progressivements plus nombreux et ressérrés dans l'intérêt des deux espèces.
Dans le cas de Bêta 112, pour plus de suspense, la forme de vie locale, qualifiée d'intelligente, mais ayant atteint seulement l'équivalent de l'âge de fer par elle-même n'a pas été dévoilée. Elle n'a malgré tout pas atteint le stade de la sédentarisation agraire. On imagine quand même un armement composé de lances, d'épées, de couteaux. Les programmeurs ont aussi rajouté en supposition des casse-têtes, des haches, des bolas, des boomerangs, des frondes, des arcs, des fourches et des filets, conçus à partir des hautes herbes qui recouvrent la planète, dont la tige est parfois aussi robuste, souple et dure que des bambous terrestres. On suppose qu'il s'agit d'une race ancienne, intelligente, naufragée de l'espace dont les descendants des rescapés initiaux sont en pleine décadence. En effet, aucune autre vie animale n'existant sur cette planète avant l'arrivée des colons, cette espèce évoluée ne peut pas être un effet de l'évolution locale… Autre détail croustillant : sa barbarie au combat est effrayante selon les colons. Quant aux effectifs, ils sont estimés entre quinze et cent-cinquante assaillants pour les plus grandes communautés.
Seulement, un recensement plus précis à l'échelle de la planète n'a jamais été réalisé et la densité de communautés est totalement inconnue, car, celles-ci disparaissant sous les herbes, elles restent invisibles sur les photos aériennes.
En cas d'attaque, l'avatar de chacun est « touché » de façon très réaliste. La mort semble moins évidente qu'avec des balles soniques ou des rayons, mais infiniment plus douloureuse. Se voir meurtri ou découpé peut faire réfléchir pour le cas où « ce serait vrai ». Il convient donc d'éviter le contact au corps à corps ou à courte distance…
Ce qui est étonnant, c'est que les colons ont des problèmes sur l'ensemble de la planète. Ils occupent trois des quatre continents ( le quatrième est marécageux sur la totalité de sa superficie) pour un total de cinq villes (aïe, une de plus que quatre, chiffre « magique » de l'organisation du « Sun Tzu »), et treize implantations minières (gaz naturel et pétrole).
Ceux-ci ont leur propre armée, environ mille cinq cents hommes répartis sur les cinq villes. Chaque ville pouvant fournir un contingent de cent hommes (cinq barges), pour défendre un centre minier attaqué. Seulement ça, c'était il y a trois mois. Leurs effectifs ont chuté de moitié « brutalement » suite à quelques accrochages meurtriers, sans survivant. Des civils ont été massacrés autour des villes. Les ouvriers des implantations minières sont retranchés et demandent leur évacuation.
Doit-on imaginer une réaction au niveau de la planète ? Sur la base de quel système de communications existant entre ces primitifs ?
Dans la salle d'état-major, les chefs d'escadre réels, avec l'amiral et les vice-amiraux peuvent suivre l'évolution de la simulation sur un écran géant splitté sur plusieurs scènes, avec des cartes des opérations en cours, un « espace de type planche contact » et une vue principale de cinq mètres sur trois. L'officier chef de l'équipe de programmation est celui qui choisit quel sous-espace a droit au premier plan. Mais chacun à son poste sélectionne ses sous-écrans et son espace principal en fonction de sa place dans le dispositif et de sa mission. Deux barges d'action de reconnaissance se sont posées à quelques centaines de mètres d'un village autochtone. Il ne s'agit pas d'attaquer mais de les observer.
Dans le même temps, une barge de combat et une navette coloniale se sont posées prés d'un centre minier à évacuer. Cent soldats coloniaux devront protéger l'usine et ses ouvriers, car dans un premier temps, seuls les femmes et les enfants seront emmenés à la ville la plus proche.
Les soldats coloniaux se déploient rapidement le long des barricades édifiées par les ouvriers. Ceux-ci quittent alors leur poste pour aller embrasser leurs famille avant qu'elles ne les quittent. Les deux aéronefs décollent. Au sol, les ouvriers montrent aux soldats non postés et à leurs chefs les quartiers qu'ils vont pouvoir occuper durant leur séjour.
Quand soudain, c'est l'attaque. Partie des hautes herbes, une pluie de projectiles divers s'abat sur les hommes. La plupart sont de gros galets qui explosent les crânes découverts et les visières de casque, ébranlent les corps sous les gilets pare-éclats et blessent les membres. Mais il y a aussi des étoiles de métal qui se plantent dans les chairs. En deux minutes, quelques morts jonchent le sol et une cinquantaine de blessés geignent dans leur coin, sans que personne n'ait tiré une fois, tout occupé à se protéger contre l'averse.
Ensuite, rien ne bouge malgré quelques rafales lâchées au hasard dans la végétation. Une deuxième bordée aussi drue que la première ne fait cette fois aucune victime. Le chef de bataillon colonial demande des renforts face à la « direction dangereuse ». Des grenades explosent à intervalles réguliers et enflamment la savane bleue.
Des cris sur leurs arrières leur parviennent. Lorsqu'ils se retournent, ils peuvent voir une horde de cauchemar franchir les défenses. Alsyen en a un haut-le-cœur.
Des Zymbrekes, une centaine environ, courant sur leurs jambes tentaculaires et courtaudes, avec leurs quatre bras armés déboulent en massacrant très vite tout ce qu'ils croisent. Les armes automatiques crépitent, quelques grenades explosent, des rayons vrombissent, mais en trois minutes, tous les humains périssent, affreusement mutilés. La vitesse et la résistance aux balles durant quelques secondes des assaillants leur permettent de s'approcher au plus près. Certains parviennent à tuer leur vis-à-vis avant de mourir sous les balles reçues presque une minute plus tôt. Sinon, ce sont les suivants protégés par les premières lignes qui s'en chargent. Seuls les projectiles soniques faisant exploser les torses et les têtes pourraient les arrêter en plein élan, mais les colons n'étaient pas équipés. Enfin, chaque soldat ne disposait que de huit chargeurs de vingt-cinq cartouches. Ceux qui étaient en hauteur n'ont pu tuer qu'un ou deux adversaires (car il est impossible de viser correctement sous une grêle de cailloux) avant d'être sauvagement tailladés par les haches, serpes, couteaux et griffes de leurs ennemis.
Un à zéro, avantage aux « lanceurs de cailloux ». Leur victoire est totale, y compris pour le nombre de victimes. L'effroi se lit sur les visages des hommes. Le corps à corps est à leur désavantage. La portée utile de leur arme est inférieure à celle de leurs adversaires qui peuvent lancer leurs cailloux en étant à l'abri des vues. Pour commencer, iIl va falloir désherber tout autour des périmètres de défense. Mettre des détecteurs de mouvement assez loin pour ne pas se faire surprendre...et surtout monter en batterie des mitrailleuses soniques et des canons.
Le « Sun Tzu » n'a pour l'instant aucune perte à déplorer mais l'usine tombée aux griffes des autochtones explose avec une cinquantaine de ceux-ci après qu'ils l'aient incendiée. C'est l'approvisionnement des villes et des vaisseaux spatiaux qui est menacé, c'est une défaite pour l'humanité.
C'était à prévoir : le président de la planète s'en prend à l'Amiral qui n'a pas correctement protégé sa colonie. L'Amiral l'assure que dorénavant, tout détachement colonial sera appuyé par le « Sun Tzu ». Voilà les chefs d'escadre condamnés à organiser la défense de chaque exploitation minière.
La solution retenue pour être efficace s'organise autour de deux groupes. Un groupe armé en traditionnel. Un autre à moitié en barge, et à moitié avec deux trinômes appuis, un trinôme servant un canon de 20 mm explosif et l'autre une mitrailleuse à munitions soniques.
Mais il manque deux groupes pour couvrir l'ensemble du dispositif : il n'y a pas de forces de réserve sur lesquelles compter... Cela fait partie des problèmes « calculés » pour donner des maux de tête aux stratèges en exercice.
En ne mettant qu'un groupe dans les villes, qui disposeraient de civils bien décidés à vendre chèrement leur peau, il devient possible d'en mettre deux dans les lieux isolés.
Deux sections « éveillées » partent avec une navette et renforcent ainsi quatre usines. Afin de calmer la population, cinq des huit groupes présents au sol seront livrés en canons, mitrailleuses et munitions soniques pour fusil d'assaut afin de défendre les villes.
Deux barges partent aussi raser un village autochtone proche de l'usine détruite en représailles.
Huit heures plus tard, une nouvelle usine est attaquée.
L'attaque a lieu de nuit. Chaque fantassin est bien équipé d'intensificateur de lumière individuel, mais les armes pour l'appui n'ont pas pu avoir le résultat escompté car le système intensificateur n'est utilisable qu'à cent mètres. Les troupes vendent chèrement leur peau mais finissent taillées littéralement en pièces. Seuls les deux trinômes à bord de la barge ont encore une chance de survie. Le chef de section est avec eux. La barge doit arrêter son feu meurtrier et retourner en ville lorsque l'usine est perdue et les troupes au sol anéanties. Le massacre aérien des autochtones est inutile et peu efficace puisque ils se dispersent vite et disparaissent dans les herbes après avoir tué le dernier humain.
Faut-il abandonner les usines ? Chaque ville compte entre deux mille et cinq mille habitants mais seulement le tiers est apte au combat et a besoin d'être encadré par des personnels bien formés.
À titre d'expérience, on décide d'évacuer une usine, en la piégeant à ses abords. Ainsi, les autochtones seraient dissuadés de s'y aventurer alors qu'il n'y a personne.
Deux heures après son abandon, un groupe d'autochtones s'approche des baraquements. Une mine fait deux morts parmi eux. Loin de s'enfuir, au mépris de quatre autres morts, ils l'incendient.
Dans l'intervalle, une ville est sévèrement attaquée. Grâce à l'arrivée de deux barges heureusement positionnées aux alentours, l'ennemi est contraint à la fuite, non sans avoir massacré quatre-cent-quatre-vingt-sept colons en vingt minutes.
L'escadre de Reno doit rejoindre ses diverses affectations. Reno sera en ville avec un groupe appui, deux barges et le chef d'escadre, tandis que sa section sera répartie sur deux usines.
Il se fait traiter de planqué par toute sa chambrée. Chacun se jure de bousiller le maximum de « toctones » avant d'y passer. Ce n'est pas la stratégie qui les étouffe, mais surtout aucun ne sait comment éviter le massacre. Si les grands chefs ne trouvent pas un moyen de défendre les positions contre des bestioles qui foncent comme une horde d'éléphants équipés de griffes et de dents, ils n'ont plus qu'à faire la prière de ne jamais tomber réellement dans cette situation-là. Car la reconstitution est riche en jurons spontanés réels mêlés ensuite aux horribles cris d'agonie émis par les avatars déchiquetés ou écrasés sous le nombre.
On propose la construction de chicanes, de plots, de trous, de pièges contondants, de murets, de tranchées plus où moins profondes pour faire un no man‘s land autour des villes et des installations pour stopper le flux des attaquants. Certains ressortent les plans des camps retranchés romains avec le plus grand sérieux. Mais le temps manque. Il suffit de l'arrivée des troupes pour déclencher des attaques spontanées. Abandonner les lieux, c'est les livrer aux flammes.
Un chef d'escadre reçoit un regard noir de l'Amiral quand il suggère que le scénario n'est pas crédible. La réalisation de ces usines ou des villes n'aurait jamais pu avoir lieu dans de telles conditions d'agressivité de cette espèce.
— Le scénario est crédible, lâche l'Amiral, mais certains d'entre vous ne le sont pas . Vous n'allez pas assez au bout de vos observations. »
Les avatars s'équipent en combinaison de combat, en matériel, en armes et en munitions. Un dernier repas est pris avant de quitter le vaisseau, puis c'est l'embarquement dans les barges pour les uns, directement dans la navette pour Reno et Alsyen. Cet embarquement se fait par des sas spéciaux qui évitent de passer par les lourdes portes et qui mènent directement à l'intérieur des barges ou des navettes. Ainsi, pas besoin de s'équiper en scaphandre. Mais la température est quand même encore fraîche dans les habitacles. Un petit plus quatre les change de leurs dix-huit degrés habituels.
Chaque décollage sur le « Sun Tzu » est reconstitué sur le grand écran. Les hommes qui sont à l'intérieur des navettes et des barges eux conservent la vue intérieure, avec sur leur visage leur propre angoisse reconstituée par leurs avatars. Mais ceux qui restent dans le vaisseau où qui participent maintenant en spectateur puisque ils sont virtuellement morts ressentent à la fois ce sentiment de n'être rien par rapport à la masse du vaisseau, mais aussi celle d'être une parcelle de sa grandeur. La beauté de ses lignes, l'intensité des couleurs, la planète en arrière-plan, c'est un spectacle magnifique qui un instant leur fait oublier toute la dureté de cette simulation, au sol.
Les hommes qui fixent les vis-à-vis de leur avatar sur leur écran restituants les vibrations de leur aéronef en seraient presque pris de nausées entraînées par cette suggestion. Il faut dire que leur chambre est aussi équipée d'un dispositif sensurround qui par l'émission de sons « inaudibles » consciemment, mais perçus par leur oreille interne, provoque des crampes au niveau de l'estomac. Personne n'ose parler dans la reconstitution comme dans la réalité durant le trajet d'une petite demi-heure.
Puis c'est le débarquement sur B-112. Dans les usines, la section est accueillie avec des cris de joie et les ouvriers leur proposent quelques boissons alcoolisées, boissons qu'il faut savoir accepter mais ne pas consommer.
Pour Reno, et le contingent accompagnant le chef d'escadre, c'est tout le contraire. La population maugrée de la modicité des renforts fournis. Elle pensait certainement voir débarquer de nombreuses troupes, mais seulement une quarantaine de militaires débarquent de la navette qui s'est posée sur une des grandes places de la ville.
Des femmes et des enfants ont été conduits dans l'enceinte de l'astroport. Leur nombre correspond à la capacité d'emport des navettes présentes si on doit évacuer rapidement ce qu'on pourra de la population. Les hommes de plus de seize ans ont tous vocation à se battre, ainsi que les femmes jeunes sans enfant. Les personnes de plus de cinquante ans sont aux portes de l'astroport et serviront de dernier rempart pour couvrir la fuite des navettes. La mission des groupes de la FCP est d'interdire coûte que coûte l'accès à l'astroport, aux civils en fuite comme aux autochtones meurtriers.
La ville est bouclée et se considère comme assiégée alors qu'aucun ennemi n'est encore en vue. Les abords à deux kilomètres à la ronde ont été « désherbés » au lance-flamme. Les sols sont affreusement noircis. Les zones marécageuses sont d'un noir parfois brillant, trahissant ainsi la présence d'eau, d'une profondeur aléatoire.
Le chef d'escadre peste intérieurement. Il est sûr que l'Amiral triche avec la simulation. Les premiers assauts étaient l'œuvre d'une centaine de créatures. La dernière usine attaquée l'a été par plus d'un millier. Le potentiel du dispositif de défense a beau devenir plus efficace, les assaillants sont à chaque fois plus nombreux et il ne peut que céder sous le nombre.
Mais il préfère ne pas en rediscuter.
Reno, qui a aidé au montage des abris de combat en mousse expansée protégeant les défenseurs des jets de pierre durant leurs tirs par les meurtrières du-dit abri constate lui aussi l'inutilité d'une telle défense, orientée seulement vers les terres. Qui dit que l'ennemi ne va pas surgir du lac voisin qui borde la ville à peine à trois cent mètres de la place à défendre ? Il en parlerait bien à son chef, mais il n'ose pas.
Le hasard faisant bien les choses, l'avatar de celui-ci le rejoint. En tant que chef, il est de bon ton avant la bataille d'avoir un petit mot avec les subordonnés, histoire de connaître leur mental et de leur remonter le moral. Sa note globale dépend de l'ardeur de ses combattants. Alsyen dans le cas de Reno est un bon moyen d'approche.
— Alors Scipion, pas trop effrayé par le voyage ?
Pour toute réponse, l'avatar lui bondit dans les bras pour jouer avec les boutons dorés de ses poches pectorales.
— Faites attention à vos bonbons si vous en avez, monsieur, dit l'avatar de Reno sans intervention de celui-ci.
Les spectateurs sensibles à l'humour au deuxième degré bien qu'en dessous de la ceinture rient de bon cœur à bord du « Sun Tzu », comme le vrai chef d'escadre interloqué juste quelques secondes.
Mais il est encore plus stupéfait cette fois par la question du vrai Reno.
— Monsieur, c'est bien sûr qu'ils ne savent pas nager sous l'eau, les monstres ? fait-il en montrant le lac.
L'évidence même qui avait pourtant échappé à tout le monde... De son poste de commandement, l'Amiral sourit. L'effet de l'attaque surprise va tomber littéralement à l'eau mais, enfin, ses troupes commencent à réagir...
— En fait, je n'en sais rien, avoue honnêtement le chef d'escadre. Je vais me renseigner auprès des colons.
Plus personne ne rit, surtout quand il s'avère que les colons n'en savent rien non plus. L'étude de l'espèce la plus évoluée de la planète n'a pas été faite. Ils ont été classés comme « sauvages » ne pouvant s'opposer à l'exploitation des ressources indispensables au déploiement de l'humanité et sources de profit pour les colons sans plus de considération.
Alors que l'état-major assiste en premier plan au massacre de la moitié de la section de Reno commandée par le chef de section, le chef d'escadre consulte les archives des colons au sujet des autochtones. Il visionne ainsi quelques scènes filmées au tout début par le module d'exploration, puis par les premiers humains débarqués sur la planète.
Les colons ont menti par omission. Cette espèce ne cultive pas la terre soit, mais elle est évoluée. Il semble qu'il y ait un système hiérarchique dans les villages. Les femelles élèvent les petits et les mâles ploient les herbes de moins de trois mètres dont ils ne consomment seulement que les extrémités pour faire la cueillette. La ressource étant inépuisable naturellement, la culture propement dite est bien entendu inutile. Et la définition de la limite pour la définition de leurs droits est inadéquate.
Plus rien n'a été filmé après la mort d'un anthropologue et de son guide. Nul ne savait ce qui s'était passé. On ne voulait pas le savoir non plus. On donnait quelques verroteries à ceux qui approchaient des premières habitations et tout se passait bien. Sauf quand on retrouva toute une famille massacrée.
Les colons s'armèrent donc. Les incidents, cachés dans un premier temps, devinrent de plus en plus nombreux. Certains abandonnèrent leurs fermes et leurs animaux. Ceux-ci laissés en liberté, afin de pouvoir les retrouver en cas de retour se reproduisirent anarchiquement dans un premier temps, détruisant les jeunes herbes. Puis disparurent. On soupçonna bien sûr les autochtones d'en être responsables.
La situation empira petit à petit. On créa donc une milice pour défendre la population. Les accrochages s'intensifièrent. C'est alors qu'un appel à l'aide fut lancé.
Le chef d'escadre se repasse les vidéos et autres bilans des attaques. Les cailloux peuvent se trouver dans les lacs et rivières et être communs. Les haches, serpes et couteaux doivent servir à la fabrication des cabanes et à la consommation de l'herbe.
Seules les étoiles l'intriguent un moment. Mais dans un passage filmé, on peut voir une créature évider avec une branche d'étoile l'intérieur d'une herbe. Et voilà pourquoi les étoiles ont des branches de tailles différentes. En fonction de l'herbe à évider, la créature utilise la branche appropriée. Toutes les « armes » utilisées sont des outils d'utilisation courante détournés de leur emploi. Malgré l'usage commun du métal, les autochtones ne fabriquent pas d'armes.
D'ici qu'il y ait un tabou sur les armes, il n'y a qu'un pas à franchir. Et en le franchissant, l'escalade de la violence devient logique. Les créatures sont pacifiques mais ne tolèrent pas une espèce guerrière sur leur sol qui par la possession ou par l'exposition d'armes violent leurs principes.
Encore deux usines viennent d'être attaquées et dévastées. Il n'y a que quelques survivants qui ont pu atteindre les barges. Il est temps d'arrêter les frais. Cette fois, le chef d'escadre décide de faire regrouper tous les colons sur l'astroport, ayant déjà fait embarquer les candidats autorisés à l'évacuation.
Il ordonne ensuite la destruction de toutes les fortifications qui bloquent les routes, et la dissimulation de toutes les armes. Personne ne doit arborer une seule arme, puisque cela ne les dissuade pas, mais au contraire les oblige à passer à l'attaque.
En face du lac, il fait mettre de nombreuses caisses ouvertes de « cadeaux ». En première ligne, il y installe Reno et Alsyen avec une conduite à tenir.
Le conseil des colons hurle à la folie furieuse. Mais cette fois l'Amiral se déclare intéressé par la suggestion de son chef d'escadre. Et pourquoi pas une tentative de négociation pour un retour à la paix ?
Il donne lui-même des ordres à l'autre chef d'escadre d'infanterie pour adopter la même conduite dans les usines encore intactes.
C'est alors que des créatures sortent du lac et se dirigent vers Reno. Elles ne sont qu'une vingtaine. Reno lutte contre la sensation de peur et de dégoût qu'il avait eue en découvrant Glyon.
Alsyen à ses côtés n'intervient pas, mais peut constater ce qui se passe dans la tête de son nouvel ami protecteur. Son chef a t-il raison ou son avatar va t-il être déchiqueté ? A t-il eu raison de tirer, réellement cette fois, sur cette créature qui allait avaler Alsyen tout cru ? Puis il se dit qu'il est victime du scénario de la simulation, que bien sûr, la créature des marais aurait dévoré Alsyen. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une société extra-terrestre, cette créature à l'apparence monstrueuse peut effectivement être intelligente et pacifique. Seulement, cette simulation n'est qu'une fiction à but pédagogique et applicatif. Alsyen le conforte dans cette idée qui peut lui éviter une culpabilisation traumatisante, bien inutile puisque Glyon est mort, et qu'il n'aurait pas voulu d'une vengeance inutile. Après tout, Reno n'est pas responsable des préjugés qu'une race inférieure comme la sienne peut encore colporter. Déjà, si cette race se montre compréhensive envers les races qui lui sont inférieures, alors elle mérite la même compréhension à son égard de la part des races supérieures.
Alsyen s'interroge sur cet amiral et sur cette société humaine, capable du meilleur comme du pire.
Arrivées à deux mètres de Reno, les créatures s'arrêtent. Avec des gestes amples, de ses deux bras, Reno montre les caisses, désigne les créatures et essaie de mimer le fait que ces caisses sont pour eux et qu'ils peuvent les prendre. Une créature y plonge un tentacule et Reno opine du chef. Et puis, non prévu, il s'avance, bras largement ouverts, à portée immédiate des tentacules meurtriers. Il présente en avant sa main. L'être accepte alors de le toucher, d'abord la main, puis le dos, les bras… et Reno bien que crispé garde le sourire.
Les créatures voisines emportent les caisses avec eux. La bataille n'aura pas lieu. Des scènes semblables se répètent à chaque implantation.
La guerre est finie. Et gagnée. Non pas militairement, bien au contraire. Les colons sont désarmés de force par les FCP. L'Amiral donne des avertissements clairs aux colons, en matière d'expansion et de respect des espèces déjà en place. En fait, il rappelle ces notions essentielles dans les F.C.P. à l'ensemble de ses troupes.
Son état-major est soulagé, bien que surpris d'une telle conclusion. Dans un sens, elle est logique. De l'autre, ils ne sont pas encore prêts à accepter ce genre de réalité. L'Amiral a de l'expérience, mais ne se ferait-il pas un peu vieux ?Revue de chambrée
Bien que la partie soit gagnée, l'exercice n'est considéré comme terminé qu'une fois le dernier homme rembarqué sur le « Sun Tzu », le matériel reconditionné et réintégré, les différents états et comptes-rendus remplis. Mais l'ennemi a emporté de l'armement, l'a détruit ou jeté dans des endroits inaccessibles. Il a pris aussi la plupart du petit matériel des sections massacrées, par curiosité, comme « prise de guerre » ou pour améliorer l'ordinaire. Reno a dû faire de nombreux rapports de perte virtuels et rééquilibrer ses stocks.
La section n'a pas eu un résultat honorable car, au combat, les hommes ont eu des réactions irraisonnées. Pour ceux qui se sont laissés dépasser comme le chef de section, et ceux qui ont voulu faire du zèle et qui se sont trop exposés, comme le chef de groupe Sancruz, le bilan est sévère. Alors, la note exceptionnelle de Reno réveille des rancœurs même si elle permet de ne pas être la section la plus mal notée du « Sun Tzu ».
Dès le dernier bouton de guêtre nettoyé, rangé ou recousu, Caubard organise une revue de chambre pour la section. Le but évident est de « punir » si possible les coupables de mauvaises notes.
Mais il a décidé de s'en prendre aussi à Reno.
Dans la première chambre, C'est l'ensemble des recrues qui écopent de sévères remontrances disgracieuses pour des traces de doigts encore visibles sur les surfaces sensibles des postes informatiques. Sa voix résonne dans les couloirs. Il y a parmi les recrues des autres chambres des petits rires moqueurs et nerveux, mais tous s'agitent afin de traquer la moindre trace ou la moindre poussière.
Pour un reste de nourriture pourtant emballé et récent dans une armoire, Caubard gueule à l'infamie, au manque d'hygiène, à l'irresponsabilité et vide entièrement l'armoire dont les habits, serviettes et effets étaient pourtant bien rangés, pliés au carré. Seul le petit casier réservé aux affaires personnelles est épargné. Il n'a théoriquement même pas le droit de voir ce qu'il contient.
La malheureuse recrue abattue par les paroles blessantes de son chef contemple tristement au sol ses affaires, en vrac alors qu'elle avait mis tant d'effort à les plier et à les aligner. Sa sanction est exemplaire : trois jours d'interdiction de foyer pour lui et cinq pour le responsable de piaule.
Dans la seconde chambre, c'est une bannette avec un sac de couchage déclaré froissé qui vaut à son possesseur un savon en règle. Il faut dire qu'en matière de qualificatifs exotiques, l'armée stellaire a su conserver des classiques du genre. « Pine de coucou » dispute avec « couille de loup », « testicule de chien sauvage » et « résidu de fond de capote » la première place au hit-parade de l'insulte gratuite. Encore deux jours pour la malheureuse victime habillée pour tout le reste de son service à bord du « Sun Tzu ».
Sancruz met la chambre de Reno au « Garde à vous ». Alsyen saute sur la bannette de Reno et fait mine de grignoter un stylo.
Caubard répond au salut de Sancruz, fait mettre au repos la chambrée et se plante devant Reno.
— C'est quoi ce binz, soldat ?
Reno ne comprend pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va passer un sale quart d'heure.
— Votre saloperie de singe n'a rien à faire ici durant une revue. Surtout avec son habitude de faire des saletés partout.— Désolé, Monsieur, je ne le savais pas. C'est la première depuis que...
Caubard se colle presque à lui et à deux centimètres du nez, il lui crache une flopée d'invectives. Il en est rouge de rage.
— Désolé…désolé. Vous ne savez dire que çà. Vous êtes une bite de porc, une pine d'huître, une grosse couille, une plaque d'égout, une balayette à chiottes, un …
On n'en saura pas plus. Alsyen vient de perturber les neurones contrôlant les centres moteurs de la parole, et Caubard n'émet plus qu'un borborygme suivi d'un gargouillis. Il n'apprécie pas trop qu'on lui rappelle un incident récent qui l'a en fait mis dans l'embarras, même si ce n'était pas le but du chef de section.
Caubard s'interrompt, surpris. Puis réessaie. Il n'articule qu'un « vous » très aigu et ridicule. Tous les regards se portent sur lui. Silence pesant et son teint devient livide. Il choisit de sortir sans un mot et Sancruz « pète » un garde- à-vous quand il franchit la porte. La revue est terminée. La quatrième chambre souffle, tandis que celle de Reno retient un fou-rire qui leur tord les tripes et les fait grimacer alors qu'ils tentent de rester impassibles.
Sancruz sort lui aussi. Le regard de son chef ne présageait rien de bon. Et manifestement, ses sphincters ont dû lâcher en même temps que ses nerfs.Le vétéran
Le vétéran Erick Dombass est assez intrigué par le duo Scipion-Reno. Il observe les deux acolytes consommant l'un un C'fet, l'autre un petit paquet de biscuits à une table du foyer. Il lui semble que ces deux-là communiquent vraiment. Il est vrai que Reno parle à Alsyen, mais sans se douter que celui-ci comprend. Assez réservé, malgré une certaine popularité parmi les recrues grâce à son petit compagnon, Reno reste souvent seul. Il ne se doute pas qu''Alsyen éloigne insidieusement les gêneurs, ceux-ci pouvant faire perdre du temps à la formation de Reno.
Celui-ci étudie « par curiosité » le pilotage d'une navette sur l'écran souple au bras gauche de sa combinaison tout en sirotant à la paille sa cannette souple. Il retient sans vraiment se rendre compte toutes les consignes qui devront lui servir le moment venu. Dans son idée, il les lit « comme un roman » même s'il ne comprend pas tout. En même temps, il parle à Alsyen de son ancienne vie sur Terre, comme si Alsyen était un confident. Il agit en fait sous l'impulsion de celui-ci. Ainsi, Alsyen en apprend beaucoup sur les mœurs terriennes et leur niveau de développement. Il en apprend aussi beaucoup sur Reno, ses joies, ses peines, ses ambitions…
Reno s'est engagé suite à une rupture sentimentale et parce qu'il avait l'âge de travailler. Un secret désir d'aventure chez le garçon l'avait détourné du fonctionnariat ou de l'emploi à vie dans une société ou une usine. Une condition physique moyenne, mais potentiellement améliorable lui avait permis de passer les tests de sélection pour les FCP (Force de Colonisation Planétaire, souvent mises à tort au pluriel, car la volonté terrestre est bien d'avoir un organisme unifié de défense). Mais son faible entrain pour les études ne lui avait permis d'obtenir qu'un maigre diplôme de gestionnaire de stock, ce qui avait conditionné son emploi actuel.
Blanc originaire de « La Dominique », dans les Antilles, Reno avait cette nonchalance trompeuse des îliens. À l'étroit sur son île, dans son idée, la Terre elle-même était aussi étroite. En fait, il s'adaptait très bien à vivre dans un microcosme comme le vaisseau ou le camp d'entraînement dans lequel il avait séjourné trois mois.
Il n'avait que peu visité les extérieurs puisque celui-ci était implanté dans un ancien goulag soviétique, afin de préparer les recrues à toujours se méfier du froid de l'espace, bien sûr hors de proportion avec ce qu'on pouvait subir sur terre.
Néanmoins, il n'avait pas eu à affronter directement le terrible hiver russe. Il avait commencé en été à supporter chaleur, moiteur et moustiques dans les marais, puis un rafraîchissement notable automnal pour quelques températures glaciales mi-novembre. Ensuite, l'instruction avait porté surtout sur le confinement, et non sur la résistance au froid. Il n'avait donc pas été exposé à des températures extrêmes. À quoi bon ? Dans l'espace, elles pouvaient survenir en quelques secondes en cas d'accident ou en quelques heures par manque d'énergie. Quand il n'y avait aucun secours extérieur possible, une mort rapide était peut-être même parfois préférable à une survie inutilement prolongée grâce aux différents dispositifs de survie et l'aptitude à les mettre instantanément en œuvre.
Puis il avait effectué un petit trajet vers le cercle Arctique à la station dite du Pôle Nord, mais en fait située sur l'île d' Ellesm. Les glaces avaient finalement fondu deux siècles auparavant et malgré le contrôle de l'atmosphère, la calotte glaciaire ne se reformait pas.
À peine arrivé dans le cercle Bêta, il avait intégré le « Sun Tzu » et entrepris le voyage initiatique dans le système d'Alpha du Centaure. Si seulement ses cadres ne l'avaient pas bousculé, pour lui, plutôt placide, malgré sa timidité, les classes dans l'espace auraient été supportables. Mais son côté « provincial » et sa gentillesse en avaient fait la tête de turc idéale pour des cadres qui devaient rapidement s'affirmer, derrière ceux qui sur terre avaient « préparé le boulot ».
De Bêta prime à Bêta 112, Reno avait appris la vie à bord et son travail de soldat lors des simulations, mais sans étincelles. Pour Erick Dombass, à ce moment-là, Reno n'était qu'un bleu, sans intérêt de surcroît.
Erick Dombass a physiologiquement trente ans. Mais il a quitté la terre plus de cinquante ans avant Reno. Il a exploré pendant dix ans un système à dix années-lumière de là. Cinq ans de voyage initial, un an dans le cercle Bêta, encore douze ans de « voyage », dix ans d'explorations et d'aventures durant lesquelles les trois-quarts de ses camarades ont perdu la vie.
Puis douze ans pour « revenir en arrière » avec quelques rares privilégiés afin de participer à la formation d'un équipage et repartir ensuite avec pour les cercles extérieurs à dix-sept années-lumière du cercle Bêta. Il a encore dix ans à faire de l'exploration. S'il en réchappe, il aura gagné le droit à une retraite et à une « terre » à exploiter sur une planète habitable des systèmes extérieurs.
Bref, même petit gradé, ce vétéran compte plus qu'un jeune sergent ou un jeune officier, surtout aux yeux de l'Amiral, qui lui, va accomplir sa troisième campagne…
Alors, quand le vieux soldat aborde Reno, celui-ci tombe des nues et en écrase sa canette de C'Fet posée sur la tablette devant lui.
— Bonjour mon garçon. Désolé de te déranger. Tu permets qu'on discute un peu ?
— Euh! Oui Mon…, chef, avec plaisir.
— Tu en reprends un ?
— Oui merci. (En fait, refuser une invitation de vétéran est impensable pour une jeune recrue, déconseillé pour un jeune gradé, y compris officier).
Celui-ci fait un signe de la main, avec deux doigts tendus. Le responsable du comptoir se déplace avec deux « spécial vétéran » car il est hors de question qu'un vétéran boive du C'Fet. Cet ersatz de boisson alcoolisée, à base d'eau recyclée, légèrement gazéifiée et additionnée de sucre, de colorant jaune/noir et d'un mystérieux extrait de plantes apéritives ne serait pas bénéfique pour un vieux foie habitué à dégrader de bien plus intéressants liquides.
La boisson « spécial vétéran » est un peu forte et certainement alcoolisée. De curieuses histoires de distillation clandestine sur le vaisseau circulent.
Il s'agit là en fait d'un pur malt terrestre que l'administration militaire ne saurait refuser à ses troupes d'élite qui sont sans espoir de revoir un jour la terre, cela malgré le coût énergétique élevé du kilo de matière expédié à cinq année-lumières par le régénérateur.
Reno est plus accoutumé au rhum. Mais c'est devenu un produit introuvable pour lui, et à son grade actuel, tout alcool lui est interdit. Sous la « protection » du vétéran, il peut apprécier le breuvage à sa juste valeur.
— Je te regardais et j'ai vu que ton petit ami est bien apprivoisé.
— Oui, Monsieur, il est assez intelligent même.
— À quel point ?
— Il sait ouvrir une poche proprement pour manger la nourriture à l'intérieur. Il répond à son nom. Il sait rester sage bien qu'en fait, il n'est pas très actif. Il serait même du genre nocturne, car je l'entends bouger la nuit. Mais il ne fait aucun dégât dans la chambrée et je lui dépose sa nourriture à portée. Il mange quand il veut et ne semble pas grossir.
— Et que mange- t-il ?
— Des cacahuètes, des biscuits, des fruits secs ou seulement séchés…Ses dents sont vérifiées toutes les semaines, à cause du sel et du sucre. Il a aussi droit à des analyses d'urine pour détecter un éventuel déséquilibre. De temps en temps, je lui donne des fruits au sirop mais il n'aime ni les compotes, ni les yaourts, ni les crèmes dessert. Il faut dire qu'à bord, nous n'avons aucune nourriture pour animaux.
— C'est peut-être une chance pour lui. Nous avons une « bestiole » nous aussi. Mais elle est infiniment plus insaisissable. Plus intelligente je pense, mais très sournoise. Nous la gardons en cage. Tu as le seul toutou extra-terrestre du bord.
— C'est vrai qu'il est affectueux. Mais parfois, je me dis que c'est lui qui m'a adopté.
— Certains animaux sentent qu'ils ne risquent rien avec certaines personnes. C'est d'autant plus vrai avec les primates habitués à la vie en collectivité sous la domination d'un chef. Il t'accepte et obéit. Les échanges ensuite tissent les liens. Mais il faut aussi respecter leur « personnalité » et ne pas céder à leurs caprices.
— Le jeu ne l'intéresse pas trop. Par contre, il veut toujours être avec moi.
Alsyen rirait bien intérieurement de cette conversation, s'il n'avait « scanné » l'esprit du vétéran durant cette conversation. Un brave gars un peu bourru qui en a vu des vertes et des pas mûres, mais surtout condamné à brève échéance si Alsyen ne fait rien. Une tumeur sous le lobe gauche est déjà bien développée. Son foie est déréglé ainsi que son système physiologique. Certainement des altérations dues à des rayonnements cosmiques ou des radiations. Pour la tumeur, Alsyen l'étouffe en organisant le boycott des mini vaisseaux sanguins qui la nourrissent. Quelques milliers de neurones vont en pâtir. Mais d'autres prendront leur place, car Alsyen le « stimule » un peu pour cela, comme il l'a déjà fait pour Reno. Il corrige aussi les taux de réaction de certaines glandes afin d'accélérer la production d'hormones réparatrices. Enfin, que l'homme profite bien de son whisky, car les prochains lui seront désagréables au goût.
C'est du « vite fait », mais la médication par stimulation neuronale a aussi des limites et demande du temps pour agir sur certaines parties du corps. La prostate elle-aussi est à changer rapidement. Il vaut mieux assez tôt que trop tard. Ce soir, il dormira à l'infirmerie, car Alsyen en bloque l'influx nerveux qui la ferait réagir. Les humains ont d'ailleurs une solution efficace de remplacement aujourd'hui pour vider une vessie à la demande. Pour soigner les intestins, Alsyen sollicite la vésicule biliaire. Elle va produire pour l'estomac une variante d'un antibiotique naturel qui va les assainir. L'homme en général n'est pas adapté à tous les micro-organismes extra-terrestres qu'il croise et certains lui sont néfastes à long terme.
Comme si l'homme lui en était déjà reconnaissant, celui-ci le caresse doucement sur le sommet du crâne et à la base du cou. Alsyen se rapproche un peu de Reno, jouant à l'apeuré, alors qu'il peut provoquer une douleur de tous les diables en moins d'un dixième de seconde à tout ennemi, avant même que celui-ci n'attaque. Puis c'est la paralysie temporaire ou la mort, selon l'inspiration. En général, c'est la paralysie. Alsyen et les siens respectent toute vie dans la mesure du possible. Un apanage du vrai pouvoir. Celui de pouvoir faire et de savoir se contrôler.
— Monsieur, demande Reno timidement, vous avez déjà fait des guerres ?
Dombass s'interroge. A-t-il le droit de répondre que les seules guerres qu'il a connues ont dû être menées contre des colons qui s'en prenaient à d'autres colons ?
— Non mon garçon. Nous sommes une force de dissuasion et d'urgence, ainsi qu'une aide à l'exploration, un symbole du gouvernement légal et une protection dont on espère ne pas avoir besoin. Mais nous devons nous entraîner pour être prêts à toute éventualité. Seulement tu verras. Certaines planètes sont hostiles. Et le service est fatigant à la longue.
— Alors, il y a beaucoup de routine ?
— L'entraînement permanent permet de s'en affranchir en partie. De plus, chaque escale est exceptionnelle et enrichissante. Le danger est permanent, car l'espace dehors est glacial. Mais il faut savoir dominer sa peur, gérer son stress et rester opérationnel. Pour cela, il faut un moral en acier inoxydable. Enfin, nous balisons le chemin de l'homme dans cette immensité. Nous écrivons l'histoire, à notre petit niveau. Pas de gloire et de conquêtes sanguinaires. Mais je te promets des jours difficiles où le héros sera toujours celui qui sait en toute occasion résister à la tentation de baisser les bras. Enfin, dans ce contexte, les risques d'accidents sont nombreux. Tu dois être vigilant pour toi, mais aussi pour tes camarades. Nous sommes dans le ventre du même tas de ferraille, et crois-moi, des actes importants pour tous, tu auras à en faire souvent. Déjà en étant un bon camarade.
— Vous avez visité beaucoup de planètes ?
— J'en ai survolé quelques-unes. Je me suis posé sur d'autres. Mais on ne peut en visiter une en entier. Il y a tant à voir sur chacune. Des paysages, de la flore et de la faune parfois… et puis les colons, leurs filles. Il y a des bons coups dans de plus en plus d'endroits. Et à chaque fois qu'on se repointe près d'un régénérateur, la station a doublé de volume, il y a de nouvelles villes sur la planète support, de nouveaux bars, de nouvelles filles… ».
Les filles. Mais quelles filles disponibles pour des soldats de la FCP, par définition de passage ? Des prostituées, l'amour tarifé. Sur terre, cela n'existe plus.
— Des p... ?
— Mais non, ce sont des hôtesses et elles ont choisi de s'occuper de nous. Bon, elles te poussent à la consommation, mais le passage à l'acte n'est pas automatique. Et surtout, il est gratuit.
Là, le vétéran ment effrontément. Il est interdit aux filles d'encaisser quoi que ce soit de la part des troupes de la FCP. Mais elles ont leur commission sur leurs consommations, comme sur les prix des chambres. Enfin, les petits cadeaux offerts aux plus gentilles ne sont pas interdits, à condition qu'il ne s'agisse pas d'argent. Elles sont très habiles pour se faire offrir des produits que les commerçants reprendront ensuite comme les bijoux et les bouteilles de parfums encore sous emballage. Ils appliquent cependant une petite décote aux dépens de la fille, histoire de mieux profiter du filon que représente un vaisseau des FCP plein de jeunes gens sans occasion réelle de pouvoir dépenser leur solde durant de longues périodes.
En tout cas, Reno est peu prolixe sur le sujet. Quant au vétéran, il n'a pas envie de s'étendre sur son passé. Un passé chargé de camarades morts par accident ou maladie.
Il ne peut pas parler aujourd'hui de toutes les affections qui touchent l'humanité durant sa conquête de l'espace à un jeune : les radiations, le « scorbut de l'espace », la stérilité à trente ans, les « coups de folie » meurtriers…
Néanmoins, il tente de prendre la température du moral de Reno, histoire de rendre cette discussion « utile » au bon fonctionnement des FCP.
— Et tes chefs, ils sont sympas ?
Petite moue de Reno.
— Je vois. Je ne te demande pas de balancer. Ça ne se fait pas en plus. Mais tu sais, c'est normal qu'au début, ils soient un peu rudes avec vous. Ce ne sont pas des copains et vous n'êtes plus des gosses. Ensuite ça s'arrange. Ils doivent pouvoir compter sur vous et savent vous féliciter pour vos résultats aux manœuvres …
— Je n'ai pas dû être brillant dans mon travail, et moi je n'ai pas combattu comme le reste de la section.
— Tu es pourtant le premier qui se soit interrogé sur la connaissance des espèces locales, alors que les autres ne se contentaient que de réagir à un déferlement d'assaillants. Or on ne peut bien combattre un adversaire qu'avec la connaissance complète de celui-ci, et pas seulement de son armement et de ses effectifs. De plus, le meilleur combat est celui qui coûte le moins cher en vies. C'était le but de cet exercice. Les effectifs sont encore réduits et les moyens sont coûteux. Enfin, nous ne pouvons pas laisser une trace de sang sur notre passage dans l'espace.
Alsyen apprécie ces réflexions de la part d'un simple soldat. Cette préoccupation, même motivée par des raisons économiques et pratiques est oubliée par les espèces belliqueuses finissant alors dans un cul-de-sac de l'évolution. Parfois trop tard, après avoir causé des dégâts irrémédiables pour d'autres mondes. Qu'une espèce sache raisonner ainsi en chacun de ses membres est un bon signe. Malheureusement, l'homme a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir bénéficier des échanges avec les Zanniens.
— Tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, c'est le travail des diplomates, pas des militaires.
— Où vois-tu des diplomates ici ? Dans l'espace, nous nous devons d'être autonomes. Dans les cercles extérieurs, ce seront des militaires qui seront en premier au contact avec une autre civilisation. Imagine que nous ouvrions le feu à mauvais escient. Nous condamnerions tout le reste de notre espèce à cause de cette « mauvaise impression » initiale.
— Il n'y a pas de cours pour ça.
— L'Amiral a l'intention maintenant de faire travailler les officiers à les concevoir. D'où le côté un peu manichéen de la dernière simulation pour les convaincre après un échec cuisant.
— Oui, c'est une histoire de « grands chefs ».
— Pas du tout. La rencontre avec une espèce intelligente peut avoir lieu n'importe où, et avec celui qui sera en première ligne : un simple soldat en général.
— Et si l'autre est armé ?
— Espérons que de son côté, il aura eu la même instruction que nous. Sinon c'est la peur de l'autre qui entraînera les deux parties dans un conflit meurtrier.
— Mais comment savoir ?
— Si tu croises une espèce avec des objets manufacturés, même une simple hache en pierre, tu évites de tirer. Et même de menacer. Ta vie est en jeu, mais dans ce cas-là, celle de tes camarades l'est encore plus, et tu dois être prêt à mourir pour ne pas t'être défendu à temps.
— Facile à dire.
— C'est pour cela qu'il faut une instruction, pour aller au-delà du réflexe primaire d'auto-défense, et que nous sélectionnons les « éclaireurs ».
— Vous voudriez que je sois éclaireur ?
— Du calme petit. Finis d'abord tes classes. Cette fonction n'existe pas encore… officiellement, et puis, tu as déjà tiré sur une espèce inconnue. Cela peut être interprété comme un constat d'échec ou comme une expérience unique qui peut t'éviter de recommencer.
— C'était pour…
— Oui mais, le casse-croûte est en général moins important que le prédateur dans l‘échelle de l'évolution. Dans ton choix, tu as fait preuve d'anthrocen... d'anthropocentrisme comme dit l'Amiral. Et quand l'intelligence survient, alors, il y a produits manufacturés.
— C'est un point de vue aussi.
— C'est un point de départ. Je ne suis pas une grosse tête. Allez, ne t'en fais pas. Après Bêta 006, le régime de « bleu » passera de mode. Ça va être votre baptême du feu là-bas.
— Qu'est ce qu'il y a là-bas ?
— De nombreuses surprises. Mais ne compte pas sur moi pour les éventer. Sinon, où serait l'intérêt ? Je te laisse. Deux whisky, c'est tout ce que le règlement permet. Même pour nous. Et je suis de quart tout à l'heure. À la prochaine petit.
— À la pro…oui Chef »
Deux heures plus tard, le vétéran s'endort alors que le chirurgien de bord étudie son dossier médical. Pour lui, si la prostate est touchée, le vétéran n'en a plus pour longtemps. La suite va lui donner tort.B-006 : Accident dans la jungle
Tout allait bien jusqu'alors. Ce n'était plus de la simulation cette fois. Comme pour Bêta 112, il fallait débarquer. Il ne s'agissait pas d'une promenade de santé. À peine sorti des barges, il faudrait progresser dans la jungle durant un kilomètre, se cacher en lisière, observer l'ennemi de jour. Enfin, passer à l'attaque de nuit.
Dans le scénario, l'ennemi était clairement humain et évolué en matière technologique : des colons séparatistes, supérieurs en nombre, mais pas très bien formés militairement. Ils avaient recruté des mercenaires et des aventuriers, plus dangereux mais moins motivés dès que les forces coloniales seraient clairement supérieures en puissance de feu. Enfin, une résistance aux séparatistes, légaliste, existait et il fallait agir de concert avec elle. Chaque compagnie avait sa mission. Une section prendrait contact avec la résistance, les autres se prépareraient à l'assaut en lisière. Mais toutes commenceraient leur exercice par une phase d'infiltration pédestre.
Voilà pour les conditions initiales de la mission qui avaient été relayées à tous les échelons. Il fallait le prendre pour un simple petit jeu en grandeur réelle avant de rejoindre les quartiers des camps d'entraînement de Bêta 006.
Une formalité à laquelle chacun avait dû être préparé grâce aux exercices de simulation. Hélas, l'impondérable survient. La barge du groupe de combat de Reno donne des signes de dysfonctionnement. Elle se pose sur la canopée de la jungle luxuriante qui borde l'objectif.
Des branches craquent, elle s'enfonce de moitié dans l'océan vert, des antennes extérieures se brisent. Le contact avec le « Sun Tzu » et les autres barges est coupé. Les pilotes déclenchent la balise de secours.
C'est la nuit. Il y a deux heures avant que ne se lève l'aube. Tout le monde reste en sécurité à l'intérieur et tente de dormir un peu. La situation semble stable, une autre barge ne devrait pas tarder à arriver.
Alsyen en doute un peu. L'encadrement, que ce soit le chef de section ou les sergents ne semble pas croire à l'arrivée d'éventuels secours. Seulement, aucun d'entre eux ne manifeste de signe d'inquiétude pour autant. Qu'est ce que cela cache ?
Aux premières lueurs du jour, les sergents réveillent la troupe. Caubard prend alors la parole.
— Les gars, l'exercice continue, même si nous ne sont plus dans le cadre des conditions de départ. Mais au lieu d'un kilomètre de jungle à parcourir, c'est dix qu'il va falloir se coltiner, en vingt-quatre heures seulement. L'attaque a été reportée pour nous attendre. Il n'y a pas de barges disponibles pour venir nous chercher. Elles ont leurs propres exercices à effectuer une fois les troupes déposées au sol au profit des pilotes.
Dans l'esprit des recrues, il y a un peu de colère et d'appréhension. Faire dix bornes en vingt-quatre heures dans cette jungle si inhospitalière, alors que dans l'espace, leurs organismes se sont affaiblis... Ils rêvent tout éveillé les chefs !. Mais pour elles, le cauchemar commence.
Alors que la plupart de ses camarades sont descendus, Reno, d'autorité, arrête quatre de ses camarades.
— Faut prendre du matos les gars sinon on va se retrouver rapidement à court dans cette jungle.
Joignant le geste à la parole, il leur tend coupe-coupe, hachettes, trousses de survie, cordes, sacs plastiques, gants de manutention...ainsi qu'un brancard, une pompe filtrante…
— On répartira tout ça en bas, ordonne Reno.
C'est chargés comme des baudets, avec armes, munitions et sacs de campagne bourrés de grenades et d'explosifs que Reno et ses camarades descendent le long des cordes jusqu'au sol à travers les branchages.
Avant de partir, chacun s'occupe de vider son sac pour n'emporter que le strict nécessaire.
Alsyen les trouve bien inconséquents. Certains abandonnent leur tente individuelle, d'autres les affaires de rechange sous prétexte que leur combinaison de combat est étanche. Des sur-vestes chauffantes (par mise en contact de deux liquides réactifs) et des duvet-hamac jonchent le sol, jetés par leur propriétaire désireux de transporter un petit kilo de moins. Il est question de combattre de nuit, donc la nuit prochaine, il n'y en a pas besoin. Les organismes sont amoindris par le manque d'exercice physique dans l'espace, tout poids inutile peut leur rendre l'épreuve insoutenable ou les mettre dans une situation dramatique.
Heureusement Reno lui est en pleine forme et Alsyen le conforte dans sa décision de tout garder, et même de porter en plus une trousse de survie supplémentaire, de la corde, des sacs plastiques, la pompe filtrante et la toile du brancard. En cas de besoin, des branches peuvent remplacer les armatures. Les sergents regardent leurs hommes mais ne disent rien. Alsyen remarque qu'eux n'ont rien laissé de leur paquetage individuel.
Tout le monde est muni, soit d'un coupe-coupe, soit d'une hache, outils indispensables dans la jungle pour ouvrir une trace. Reno emporte une petite pelle pliable à son ceinturon. C'est encore le seul.
— Alors Reno, plaisante l'un, c'est toi qui va te charger des feuillées ?
(Les feuillées : nom donné aux WC de campagne utilisés collectivement. Sommairement, il s'agit d'un trou creusé à l'écart du reste du camp, protégé des regards, mais dans la zone sécurisée. Si le détachement est important, et le stationnement prévu pour durer un peu, toute l'ingéniosité des bâtisseurs est sollicitée : trous plus importants, planchers, murs de branches, protection contre la pluie, camouflage y compris aérien avec de la végétation fraîche (herbes, feuilles...) .)
Les deux sergents rassemblent leurs groupes face à eux. Il faut expliquer à la troupe la méthode de progression dans une jungle. Chacun tient à son groupe ce langage.
— Cette planète dispose d'un magnétisme comme sur la terre, situé au pôle nord avec une déviation de quatre degrés entre le nord magnétique et le nord géographique. À bord de la barge, nous disposions d'un GPS relié au « Sun Tzu » qui nous renseignait en permanence. Dans certains cas, le relais était assuré par une navette qui nous « orientait » durant l'opération. Mais ce dispositif, assez lourd, n'est pas prévu pour rester en place deux jours pour seulement une section isolée. Au sol, nous disposons donc d'une carte et d'une boussole. La carte nous servira quand nous rejoindrons une route. Mais nous devrons éviter celles-ci lorsque nous nous rapprocherons de l'objectif.
Nous allons donc passer par la jungle sur dix kilomètres en suivant un azimut, c'est à dire une direction dont je connais l'écart angulaire avec le nord magnétique. Mais il va falloir aller tout droit et connaître à chaque instant la distance que nous aurons parcouru.
Pour cela, nous allons définir des fonctions et tout le monde les échangera au fur et à mesure.
Il va y avoir un « ouvreur » qui marchera en tête avec un sac à dos rouge, bien visible dans cette végétation, mais très léger car il va lui falloir se faufiler entre les branches. Plus loin il sera, tout en restant à vue, mieux je peux prendre un point de repère situé entre moi et l'objectif dans la direction indiquée par ma boussole. Si je n'ai pas de point de repère, l'ouvreur en fera un, avant de faire lui aussi encore un peu de trajet. Derrière moi, il y aura deux compteurs de pas. On vous a fait calculer combien de pas vous faisiez « naturellement » en cent mètres. Ils vont compter leurs pas pour les transcrire ensuite en distance. Quand un « compteur » arrive à cent mètres, il fait un nœud sur une petite corde accrochée à son poignet droit. Au bout de dix, il fait un nœud sur la cordelette de gauche. Au bout de neuf nœuds de chaque coté, nous serons pas loin de la sortie..
Mais avant de faire compter, j'envoie les layonneurs vers le repère que j'ai pris, qu'il soit naturel, ou posé par l'ouvreur. Avec les coupe-coupe et les haches, ils devront tracer un chemin « carrossable » pour le reste de leurs camarades jusqu'au repère. Car ceux-ci vont porter leur équipement, plus l'équipement « collectif », plus le sac de leurs camarades de devant qui ne bénéficient pas d'un passage aisé. Bref, les bêtes de somme avec plus de trente kilos sans compter arme et munitions. Avec cette chaleur moite, ce ne sera pas une partie de plaisir.
Fin de l'explication. Tout le monde n'a pas encore bien compris, sauf que ça va être pénible. Mais une fois que chacun sera à sa place, il va pouvoir constater le fonctionnement de l'ensemble.
Jamais les recrues n'auraient pu penser se retrouver dans de pareilles conditions. À l'époque des régénérateurs translateurs inter-sidéraux, des vaisseaux spatiaux et des scooters anti-gravité (en ville seulement car il faut un rail à effet d'induction enterré pour pouvoir léviter), il va leur falloir marcher, et dans une forêt dense en plus.
Rien à voir avec leurs marches dans les déserts glacés sur terre lors de leurs classes, où il suffisait de baisser la tête et de suivre le rythme…
Caubard marche juste devant Reno. Il constate la qualité du layon ouvert et s'assure de ne perdre personne. Par précaution, tout le monde est relié par talkie-walkie. Seuls les cadres les gardent en permanence allumés, ainsi que l'ouvreur. Une recrue qui s'éloignerait de la trace à l'insu de son binôme doit l'allumer pour appeler à l'aide. En dix mètres hors du layon, on peut perdre le sens de l'orientation, partir dans une mauvaise direction et être perdu, c'est-à-dire dans ces conditions, être condamné à mort à brève échéance. Bien que la progression se fasse en file indienne, que chacun voit son camarade de devant, et que logiquement il n'y a pas à quitter la « trace », on ne sait jamais ce qui peut arriver si une créature agressive surprenait les hommes et que ceux-ci se dispersent un peu trop vite.
Un sergent ferme la marche, tandis que l'autre guide la colonne.
Les arbres vont du simple tronc très fin qui tente de trouver de la lumière aux gros troncs centenaires assombrissant le ciel. Les racines sont triangulaires, à haut sommet et s'élève parfois jusqu'à cinquante centimètres au dessus du sol puis rejoignent le tronc et semblent vouloir y grimper. On dirait des lettres J. Elles sont assez pénibles à enjamber, et extrêmement glissantes, comme le bois mort dissimulé par les mousses et les hautes fougères, semblables à celles que Reno a pu voir dans les restes de forêt primaire sur son île d'origine. Elles ont aussi la fâcheuse manie de se disputer l'espace et de s'enchevêtrer. Le sol est constitué en dessous d'argile rouge, elle aussi glissante en surface et dure en dessous. En suivant les troncs, Reno peut constater la présence de nombreuses plantes parasites nichant dans les trous et méandres des géants. Des lianes retombent des sommets et finissent par se replanter dans le sol. Parfois, il faut passer entre les branches d'arbres morts tombés en travers. Les tronçonneuses entrent alors en action car les coupe-coupe sont insuffisants pour permettre de se frayer un passage.
L'œil acéré de Reno repère aussi quelques orchidées accrochées aux arbres, mais il n'est pas sur un circuit touristique et il vaut mieux pour lui surveiller ses pieds. Les serpents doivent fuir au devant des hommes mais les scolopendres n'hésitent pas à leur couper le passage. Leur piqûre douloureuse peut faire gonfler un bras en quelques minutes et mettre au supplice sa victime pour plusieurs jours. Vu la taille de certains ici, approchant les trente centimètres, ils pourraient peut-être même faire mourir un homme de douleur. Chaque souche de bois pourrissante peut abriter un nid de dizaines d'individus... Reno n'ose penser qu'on ait pu importer aussi des mygales et des fourmis géantes
Au bout de deux heures, première halte. Ils ont parcouru un kilomètre environ. Tout le monde est regroupé pour un repos et une collation obligatoire. À l'issue, les rôles seront inter-changés.
À part les cadres, non astreints au layonnage, et qui de plus ne portent que leurs affaires personnelles au maximum, tout le monde est déjà exténué.
Alsyen constate que Reno supporte mieux les conditions difficiles que ses camarades. L'entraînement physique à bord porte déjà ses fruits. Au cours de la progression, il a déjà soulagé la fatigue des deux porteurs de part et d'autre de Reno, et à la pause, il s'occupe de Jean-Louis qui s'est pas mal entaillé les avants-bras en layonnant. Les griffures, bien que superficielles, sont vilaines et sales mais Jean-Louis ne semble pas vouloir les montrer à l'infirmier. Il incite donc Reno à les voir et spontanément le jeune homme se propose de soigner son camarade.
Celui-ci accepte volontiers. Reno nettoie les avant-bras avec un peu d'eau prise de sa gourde, puis passe un antiseptique léger avant d'appliquer un pansement vaporisable. Jean-Louis est soulagé de la sensation de brûlure à fleur de peau qui le taraudait. Plus loin, l'infirmier de la section ne chôme pas non plus.
Alsyen s'étonne de la fragilité des combinaisons de combat qui se sont parfois déchirées au niveau des jambes et des bras. Les porteurs et les cadres ont encore les leurs en bon état, mais celle de l'ouvreur qui se faufile comme il peut en liaison avec le sergent de tête risque fort de bientôt ressembler à une loque s'il conserve cette fonction. Branches et ronces devraient glisser sur elles… En observant les épines des lianes, Alsyen constate qu'elles sont dentelées et coupantes comme des rasoirs. Ces plantes sont fortement composées de minerai de fer, dont le sous-sol doit être saturé, et elles l'intègrent dans leur organisme en évitant en plus son oxydation. Voilà pourquoi aussi elles sont si difficiles à trancher. Les coupe-coupe eux-aussi sont déjà passablement émoussés et Sancruz montre aux jeunes comment les réaffûter.
Le sergent Coll lui aussi aborde individuellement chaque membre de son groupe pour une brève discussion qui lui permet de savoir où en est mentalement et physiquement son interlocuteur du moment, comme de pouvoir juger l'état général de l'ensemble de son groupe. Caubard enregistre des commentaires sur son dictaphone en chuchotant. L'attitude des cadres est totalement différente que sur le « Sun Tzu ». Attentifs et prévenants, ils passent de l'un à l'autre de leurs hommes avec les bons conseils pour gérer les petits bobos.
La colonne se remet en marche. Environ une heure plus tard, elle tombe face à un marigot. Des sortes de palétuviers ont colonisé la cuvette. Il faut traverser.
Caubard ordonne la pause déjeuner. Les hommes ont droit à une petite demi-heure. Certains mangent complètement leur ration journalière de combat, d'autres chipotent. Reno s'applique à ne manger que le nécessaire, mais à en garder pour le cas où, ce soir. Chacun en effet n'a qu'une ration. Celle qu'ils devaient manger pour juste après le combat. La conserve auto-réchauffée est excellente, et Reno fait chauffer de l'eau pour que chacun puisse profiter de son café individuel en sachet.
Cette initiative est saluée par Caubard lorsque il vient d'autorité se servir et Reno en rougit. Pour une fois que son chef de section a un mot sympathique pour lui, il en tombe des nues. Ce petit moment de détente pour chacun retarde la fin de la pause, mais ensuite, le moral un peu remonté, personne n'hésite à entrer dans l'eau à la suite de l'ouvreur.
Celle-ci se trouble de la vase remuée dans le fond. Des odeurs méphitiques remontent aussi en grosses bulles. Pour ceux dont les combinaisons sont griffées, le contact avec l'eau est gluant. Chacun porte son sac en hauteur bien qu'il soit logiquement parfaitement étanche, et seuls quatre guetteurs conservent leur arme hors de la housse, prête à servir.
En effet, Caubard a parlé de la présence éventuelle de crocodiliens et ils ont la mission de surveiller la moindre ombre suspecte. Tout le monde pense aussi à des poissons carnivores, des serpents d'eau géants … En tout cas, il y a des sangsues dans l'eau et des insectes tout aussi suceurs de sang au dessus.
La peur et le dégoût au ventre, chacun avance, vigilant, afin de ne pas glisser sur les racines sous marines, de ne pas s'enfoncer dans des sables mouvants… L'ouvreur n'est plus seul. Il s'agit d'un trinôme dont chaque élément est relié à la même corde. Le premier surveille au devant, les deux autres ont chacun leur côté et la section suit plus loin le même trajet. Pour l'instant, la profondeur est inférieure à un mètre et il n'y a pas de courant, d'où la vase et les poches de méthane issues de la putréfaction et piégées sous la couche de végétation tombée ultérieurement au fond de l'eau …
Au-dessus, la canopée vibre de mille cris, craquements et autres bruissements. Parfois, une branche tombe dans l'eau, on entend une envolée subite… et la vie si bruyante du haut, bien qu'étouffée par le feuillage dense, contraste avec le silence d'en bas, dans une semi pénombre permanente, où les hommes, sauf pour quelques flocs parfois inquiétants, sont les plus bruyants malgré leur mutisme. La jungle d'en bas retient son souffle sur leur passage, ou s'est enfuie avant leur arrivée.
À part le sergent Coll qui communique avec le trinôme de tête, plus personne ne discute et chacun avance à la queue leu-leu, perdu dans ses pensées, tout en regardant anxieusement autour de lui. Pour certains, la combinaison de combat retient plus l'eau qu'autre chose. On entend râler sourdement pour des piqûres. De temps en temps, l'un glisse, parfois dans un juron éteint par l'eau et se terminant par un « plouf », mais plus personne ne rit. Certains commencent même à aider les plus faibles à se relever, écrasés par le poids du sac et du reste de l'équipement.
D'autres prétendent être tombés à cause du « sol » qui a glissé, ou d'un serpent qui les a entravés. Personne n'est rassuré par ces anguilles invisibles et tomber pourrait entraîner les morsures d'un adversaire invisible, ou pire…
Les remugles gazeux qui éclatent à la surface ne parviennent plus à écœurer les nez blasés mais commencent à donner de sérieux maux de tête. Caubard harangue les hommes exténués leur promettant la pause dès la sortie du bourbier. Ceux-ci maugréent maintenant.
C'est alors qu'un crocodilien sème la panique. Ses quatre mètres de queue et d'estomac derrière ses deux mètres de mâchoires immergés sont surmontés des deux centimètres d'yeux et des dix centimètres de cerveau qui ont repéré les hommes et décidé l'ensemble à plonger. L'eau est tellement trouble qu'il est devenu invisible dès son immersion complète. Alsyen détecte sa présence froide tapie dans les profondeurs. L'animal n'a pas faim mais chasse systématiquement, histoire de mettre dans son garde manger sous-marin un peu de viande à y faire pourrir pour mieux l'attendrir et la bonifier . Il est impossible de faire un tir de barrage pour l'effrayer. Alsyen comprend que soit le crocodilien est tué, soit il va tuer un homme. Alors, il stimule Reno pour qu'il se saisisse de son arme et persuade le crocodilien de remonter en surface. À moins de dix mètres du sergent Coll, la masse sombre apparaît, gueule ouverte. Reno l'atteint immédiatement à l'articulation de la mâchoire, puis dans la masse du torse. L'animal se tord de douleur et une fusillade l'achève, le perforant de toutes parts.
Les hommes respirent. Le sergent Coll fait un petit signe de remerciement à Reno puis les hommes s'éloignent rapidement du corps qui déjà attire de nombreux poissons et anguilles carnivores. De plus gros prédateurs risquent bientôt eux aussi se joindre à la curée…
Bien leur en prend. Quelques dizaines de mètres plus tard, Reno se retourne et aperçoit d'inquiétants soubresauts qui agitent la surface voisine du cadavre déjà à moitié dévoré.
Un quart d'heure plus tard, ils atteignent enfin la terre ferme. Caubard accorde dix minutes de pause. Il faut s'éloigner ensuite du marais pour établir un camp pour la nuit. Car celle-ci tombe dans moins de trois heures.
Les hommes passent ces dix minutes à brûler les sangsues qui se sont fixées sur les jambes avec la pointe incandescente de briquets à pile. Certaines ont même mordu au travers de la combinaison. Reno fait circuler entre les recrues les bombes de sparadrap hémostatique en aérosol. Il pense quand même à s'en garder une pour lui. Après tout, les autres n'avaient qu'à se charger eux aussi. Il pense à mettre sur le crâne d'Alsyen un baume pour calmer les piqûres et celui-ci lui manifeste sa reconnaissance par de petits cris.
La colonne repart. « Dans une demi-heure, si on trouve une clairière, on s'arrête » ordonne Caubard au sergent Sancruz qui prend la responsabilité de l'orientation à la place de Coll.
Une heure et demi plus tard, enfin, l'endroit idéal est trouvé. Tout le monde avec son coupe-coupe ou sa hache dégage la zone afin de la rendre plus confortable. Une équipe va chercher du bois mort avec haches et tronçonneuses. Chaque groupe à sa zone de « résidence » . Certains tendent les hamacs (dits étanches car le dormeur est intégralement protégé par une toile laissant passer l'air mais pas l'eau, et encore moins les insectes) entre deux arbres. D'autres préfèrent la tente … Mais surtout, la moitié des effectifs se retrouve sans protection ni couchage pour la nuit.
Les cadres sermonnent les inconscients qui peuvent se préparer à la plus mauvaise nuit de leur vie, entre les moustiques, araignées, serpents, scolopendres, rats, chenilles urticantes et autres vermines grouillantes qui vont sortir de terre ou descendre des arbres dès le crépuscule. Ils n'ont plus qu'à dormir, à même une bâche plastique ou une couverture de survie près du feu.
Caubard relève d'ailleurs leurs noms, l'air de rien et Alsyen comprend que les circonstances actuelles n'ont rien d'accidentel, ni même d'improvisé.
Le stage d'aguerrissement a commencé à l'insu des recrues.
Longue nuit prévisible : quatorze heures.
Alors que les tentes sont à peine montées, des trombes d'eau s'abattent sur la jungle en quelques minutes. Des sacs oubliés ouverts, en particulier ceux des « sans-abris », se remplissent et leur contenu se mouille. Adieu linge sec et papier toilette.
Le sergent Coll montre comment allumer du feu avec du bois mouillé. Il prend une hache et choisit un gros rondin. Il le fend et en conserve le cœur. « Voyez,fait-il, au centre, le bois est dur et sec ». Il en extrait alors de fines baguettes qu'il empile puis allume avec un superbe briquet tempête à essence gravé à son nom que tous les jeunes à ce moment-là admirent et désirent le même dès qu'ils auront l'occasion d'en acheter un. Enfin, il rajoute progressivement des bouts de bois de plus en plus gros.
Trois autres foyers sont donc allumés selon la même recette et tout le monde s'y réchauffe et s'y sèche tant bien que mal. Personne ne pense que l'ennemi pourrait repérer ces fumées et qu'un aéronef pourrait surgir et les régaler d'un feu nourri plus lourd à digérer en plein repas. Dans un petit abri de branches et de bâche, confectionné à la hâte, Reno et l'infirmier passent en revue avec leur lampe électrique les corps fatigués et meurtris de leurs camarades afin de soigner toutes les coupures, piqûres, ampoules...
Caubard surprend tout le monde après s'être absenté aux feuillées nouvellement creusées grâce à la pelle de Reno (Le sergent Coll a désigné deux responsables. Il a félicité Reno pour sa prévoyance de « fourrier », et remercié pour son tir rapide et efficace qui lui a peut-être sauvé la vie). Il revient traînant une lourde masse derrière lui. En fait, il a abattu une sorte de phacochère qui a eu le malheur d'être trop curieux alors que l'humain tenait à son intimité et à sa sécurité à ce moment-là. Pas question d'espérer que l'animal ne charge pas quand la situation n'est pas à son avantage. Personne ne demande s'il a tiré en position accroupie ou debout. Les recrues les moins « impressionnables » dépècent, vident et mettent à la broche le cochon sauvage en un minimum de temps.
Les odeurs de viande grillée réveillent des instincts de chasseur chez plusieurs recrues et Sancruz en place deux sur un côté du campement, interdisant aux autres de s'y promener.
Une lampe et les viscères du tourne-broché servent d'appâts. Bientôt chaque feu s'orne d'une broche sur laquelle un gibier de taille « frétillant » de graisse fondue va permettre à des ventres affamés de se remplir.
Alsyen est effaré de cette barbarie. Il a suffit d'une journée à ces jeunes humains civilisés tiraillés par leur estomac pour redescendre au niveau de l'homme des cavernes.
*
* *
Les affamés oublieront d'ailleurs Reno et l'infirmier, occupés jusqu'à fort tard aux soins de leurs camarades. Finalement, ils n'en verront même pas les os, jetés dans le feu après qu'on y ait arraché avec les dents le dernier lambeau de viande et croqué les cartilages les plus fragiles.
Heureusement le prévoyant Reno avait encore quelques bribes de ration dans son sac qu'il partagea avec l'infirmier. Celui-ci avait aussi quelques bonbons revigorants et des vitamines dont il décréta qu'ils en avaient tout deux bien besoin avec un petit sourire. Afin d'achever en beauté ce maigre repas en solitaires, ils prirent ensemble un petit café soluble chaud grâce au réchaud de Reno et ils se couchèrent relativement rassasiés.
Pour leur travail précédent, ils avaient été dispensés de tour de garde. Ils purent donc s'endormir pour une nuit sans interruption tandis qu'autour du camp, les ombres des sentinelles fantomatiques, par leurs courtes et incessantes rondes repoussaient tout de même un peu les silhouettes plus sinistres de la faune locale.
Alsyen ne put dormir mais plongea Reno dans un sommeil profond et réparateur. Lui ressentait la pression des esprits animaux prédateurs ou peureux du voisinage. Certains cris et rugissements inquiétants jaillissant durant de brefs moments furent sans équivoque sur la triste destinée de certains.
Auprès du feu, les recrues trop peu prévoyantes vécurent une nuit de cauchemar entre les moustiques, araignées, tiques et vers sangsues qui ne leur laissèrent aucun répit. Les bruits et les cris sinistres les empêchèrent aussi de s'endormir.
Un peu avant le lever du jour, de nouvelles trombes d'eau faillirent éteindre les maigres cendres rescapées de la nuit. Seuls deux feux purent reprendre après l'averse pour tenter de sécher ce qui n'avait pas été mis à l'abri.
*
* *
Ce matin humide et encore froid, les cadres constatent les dégâts. Les trois quarts de leurs troupes sont amorphes, les yeux bouffis, la tête basse, les bras ballants.
Afin de les réveiller, Caubard ordonne un rassemblement, bien alignés, dans les trois minutes. C'est la pagaille. Il houspille les recrues et ordonne un nouveau rassemblement, prêts à partir, dans le quart d'heure, camp propre. Cette fois, tout le monde s'active un peu plus, mais Reno a du retard, car personne ne l'aide pour le matériel commun.
Il en fait un tas, près du lieu de rassemblement, et rejoint l'arrière des rangs, son sac à peine bouclé et gonflé au maximum.
Caubard l'appelle. Ça va être sa fête.
— Soldat, c'est quoi ce tas ?
— La tronçonneuse, une pelle, le reste du matériel médical, une pompe épuratrice d'eau, un réchaud collectif…
— Vous aviez donc de quoi chauffer de l'eau pure pour toute la section ce matin.
— Oui adjudant.
— Et vous ne l'avez pas fait.
— Je n'ai pas eu d'ordres et tout seul, pour trouver de l'eau dans cette jungle…
— Voilà ce que je reproche à la section. Tout le monde s'est occupé de ses petits bobos et est resté au chaud dans sa propre bouse en attendant que les choses se fassent. Sortez tous quarts et couverts de vos sacs et laissez les sacs ici. À quatre, allez cherchez de l'eau. Vous, dit-il en regardant Reno, soyez prêt à faire fonctionner l'épurateur et à faire chauffer l'eau. Et faites vous aider si nécessaire. Les autres, trouvez-moi dix branches droites de deux mètres cinquante de long pouvant supporter plus de cent kilos. Je veux tout dans vingt minutes, personne ne reste seul. Tout le monde a son arme avec lui. Il y en a toujours un pour couvrir le groupe. Exécution. »
Cette fois tout le monde s'agite dans le bons sens. Caubard arrête deux boiteux dans leur élan et demande à l'infirmier de les examiner.
Tout le monde est bien réveillé maintenant et le café a aussi redonné un peu de moral. Certains se sont proposés pour aider Reno à transporter le matériel commun. Caubard réclame à nouveau l'attention de la section.
— Les gars, il ne reste qu'une heure d'efforts pour rejoindre l'objectif. La manip de l'assaut est annulée. (« Tiens donc - pense Alsyen – Comme si on pouvait encore y croire ... »). Dans un kilomètre, nous sortirons de cette jungle. Mais nous avons un problème. Deux de vos camarades ne peuvent plus marcher. Il va falloir les brancarder. Toi l'infirmier, tu as combien de brancards ?
— La toile d'un seul, adjudant.
— Alors trouve-moi deux sur-vestes chauffantes.
Reno donne la sienne à l'infirmier qui en avait déjà une. Ce sera encore ça de moins à porter pour lui.
Le sergent Coll prend les deux vestes, les boutonne, puis les oppose par le bas. Ensuite, il fait passer un bâton dans la manche de la première, le long de la veste fermée, le long de l'autre veste pour enfin faire ressortir le bâton par la manche de la seconde veste. Même opération avec le deuxième bâton et voilà un brancard de fortune prêt à accueillir un blessé.
Reno récupère deux bâtons pour la toile de brancard classique et le sergent Coll demande au reste de la section de confectionner trois brancards de plus sur lesquels seront mis les sacs des blessés et de leurs porteurs.
La difficile progression reprend, encore plus compliquée par l'exercice de brancardage à réaliser. Caubard a été optimiste en parlant de « seulement une heure » et au bout de deux heures, la lisière apparaît enfin. Une autre section est sortie de la jungle elle aussi, depuis peu et progresse cent mètres plus loin. Elle se traîne, désemparée, avec le dernier marcheur abandonné, des petits groupes dispersés, la tête basse, de taille variable... elle ressemble aux tristes lambeaux d'une armée défaite.
— Rassemblement au pied du mât au drapeau. Immédiatement, lance Caubard.
Effectivement, sur ce qui ressemble à une énorme base aérienne flotte au loin un drapeau qui doit être au moins à deux kilomètres. Mais cette fois, c'est l'euphorie et chacun rassemble ses dernières forces pour ne pas ralentir la section.
Les cadres derrière adoptent un rythme de croisière en riant, regardant leurs jeunes poulains dopés par l'odeur de l'écurie. Ils courent presque, le souffle court, oubliant les ampoules aux pieds, les muscles douloureux, le poids de la charge, la fatigue et la faim. Ils ne voient que ce drapeau qui finalement se rapproche et ils sont hypnotisés par le roulement de leur cadence sur le bitume. À hauteur de l'autre section, les quolibets fusent entre les dépassés et ceux qui les doublent. Les cadres tous en tête se font surprendre par la section de Reno qui leur passe devant, tous groupés en quelques secondes. Le temps de rameuter les traînards et de lancer leurs propres hommes à leur trousses, il est trop tard.
La section Caubard arrive avec cent mètres d'avance sur leur section qui vient de se faire griller la première place pour toute l'unité. Spontanément, Reno et ses camarades déposent leurs sacs, le matériel proprement derrière et s'alignent, par groupe, au pied du mât.
— lls comprennent vite, glisse Caubard à ses deux sergents. Après tout, elle n'est pas si mauvaise cette section.
Mais le stage vient seulement de commencer.B-006 : Planète tout risque
Les recrues en ont plein les bottes. Et pourtant, cela ne fait que quinze jours que le stage d'aguerrissement a commencé. Il reste encore un mois et demi à tirer avant de repartir avec le « Sun Tzu » vers d'autres horizons.
Bêta 006 est une planète grosse comme une fois et demi la Terre. La gravité s'en ressent. Comparée à la gravité artificielle du « Sun Tzu », elle est encore plus pénible à supporter. Voilà pourquoi les efforts dans la jungle étaient si pénibles à leur arrivée malgré leur entraînement physique dans l'espace.
D'un autre côté, cette gravité élevée leur permet de se remuscler plus rapidement car leur organisme est sollicité en permanence. Rationnés à bord, et contraints de manger des denrées lyophilisées, congelées, irradiées, conditionnées sous vide, pleines de conservateurs etc …, le plaisir de remanger de la viande rouge, de vrais œufs, et surtout des fruits et des légumes frais est immense.
Cette planète a été terra-formée il y a deux cents ans. Précédemment, les êtres vivants, malgré la présence d'eau, de volcans, d'une atmosphère…, n'avaient pas encore atteint le stade des amibes.
Par contre, de nombreuses plantes se sont adaptées à l'atmosphère riche en gaz carbonique et certaines ont été plantées dans le but de dégrader ou de capter les gaz soufrés qui encombraient l'atmosphère à l'origine et la rendait impropre à la vie humaine.
Puis des semences d'espèces terriennes ont proliféré. Des organismes animaux ont été manipulés génétiquement. Les crocodiles de la jungle sont indispensables pour nettoyer les grosses charognes. Les insectes servent de nourriture aux oiseaux, mais aussi d'aide à la reproduction de la flore. Il n'y a que quelques centaines d'espèces animales et il est question d'essayer d'en adapter des milliers d'autres au fur et à mesure afin de gérer l'écologie des parcs forestiers. L'introduction des espèces est planifiée et suivie par des centres spécifiques au niveau de la planète. Les embryons d'espèces menacées sur terre, congelés parfois depuis deux cents ans, sont implantés dans des couveuses-placentas (produits à la chaîne grâce à des cellules souches) puis élevés en cage jusqu'à ce que quelques individus au patrimoine génétique varié puissent se reproduire.
Des couples sont alors lâchés et suivis sur des espaces propices à leur essor. L'équilibre entre nouveau prédateur et le reste de la « chaîne alimentaire » doit se créer harmonieusement, sinon les scientifiques interviennent pour corriger les effets néfastes induits par l'introduction malheureuse.
Des mutations surviennent après seulement deux à trois générations à cause de la gravité, en plus des résultats de la sélection naturelle. En fonction des espèces, certaines deviennent plus petites alors que d'autres grossissent. Ces mutations interviennent souvent par l'expression des « gênes endormis » qui permettent aux espèces de s'acclimater à leurs nouvelles conditions d'existence. Quelques unes ne s'expliquent pas pour autant.
L'agriculture est elle aussi encadrée, car sa production doit être supérieure à la simple quantité nécessaire pour l'autarcie de la planète. Bêta 006 possède une industrie agroalimentaire qui permet de reconstituer les réserves du « Sun Tzu » même s'il n'en a apparemment pas besoin, et surtout de nourrir une dizaine de stations spatiales ou de stations minières sur des astéroïdes stériles, mais riches en métaux rares. Enfin, l'argent des FCP, provenant de la métropole terrestre, imposant les grosses sociétés sur vingt années-lumière de rayon est toujours bon à prendre pour les petites économies locales.
D'ailleurs, pendant que la troupe s'échine et en bave à l'instruction, l'Amiral et ses vétérans sont partis en safari éliminer un excédent de fauves dans une réserve à quelques milliers de kilomètres de là durant quatre jours. Ce ne sont pas les mêmes émotions fortes que les parcours du risque divers auxquels les recrues sont confrontées…
Alsyen est aussi du voyage, car dès le lendemain de l'arrivée sur le camp, il a été confié à Erick Dombass, bien remis de ses problèmes de santé. En effet, Reno et ses camarades sont soumis à de nombreuses activités et le temps libre est rare. Ils se voient quand même tous les deux ou trois jours durant une ou deux heures. Alsyen profite de ces moments pour le sonder, le libérer de toutes les tensions nerveuses et entretenir son besoin de le voir, car il n'a pas l'intention de se laisser prendre de mains en mains indéfiniment.
Par contre, les contacts entre les recrues et la population sont inexistants et prohibés. La religion locale, dérivée de celle des Mormons, est encore plus intransigeante envers les interdits, sauf qu'ils ont enfin accepté un certain modernisme. Si la polygamie subsiste et se révèle bien utile pour une colonisation dangereuse surtout pour les mâles, la population aujourd'hui est quand même équilibrée en nombre d'hommes et de femmes, d'où certaines tensions si des « concurrents » venus de l'espace faussaient le jeu de l'offre et de la demande en local. Malgré certains souhaits exprimés de sélection scientifique du sexe des bébés pour augmenter le nombre de filles, les vieux tabous religieux s'y opposent. Souvent, avoir une deuxième femme consiste à épouser une veuve déjà propriétaire pour augmenter son exploitation, en taille comme en production.
Comme de plus, il est interdit de frayer aussi avec ses collègues féminines car un soldat enceinte ne peut monter à bord d'un vaisseau spatial, et se bat moins bien, les jeunes se dépensent sans compter dans les exercices physiques. Le pugilat met aussi souvent un terme à l'interprétation sexuelle d'un geste ambigu entre deux soldats de même sexe. L'homosexualité n'est pas prisée dans les rangs des FCP. Il n'y a pas d'homophobie encouragée pour autant. Mais la notion de camarade de combat n'atteint pas les niveaux du soldat grec de l'antiquité. L'amitié est une valeur qui ne saurait être galvaudée.
Dans l'espace, malgré la pression atmosphérique moindre qui facilite les érections, la promiscuité permanente décourage les relations par définition intimes.
À terre, le soleil, le sport, la bonne chère (l'alimentation est souvent la base du moral) éveillent des sens enfouis depuis trop longtemps, et même l'épuisement ne peut suffire seul à les calmer. Pour éviter des incidents regrettables dus à des frustrations trop fortes, les jeunes qui le désirent peuvent se projeter des films dans des cabines isolantes. Le médecin a d'ailleurs distribué à tous des pilules stimulantes à prendre une heure avant la projection privée. Ainsi, l'orgasme ressenti est plus fort que celui d'une simple masturbation et répond mieux aux attentes du cerveau. Cela évite le recours au traditionnel « tonneau du marin » si présent dans la légende des troupes spatiales et sujet de quelques bizutages (« simples bahutages » diraient les cadres car la pratique du bizutage est rigoureusement interdite suite à des excès antérieurs). En effet, il existe toujours un cadre dans chaque section pour afficher un tour de présence au sein du-dit tonneau pour le soir même suivant l'arrivée des nouveaux.
La recrue désignée en premier passe une bien mauvaise journée entre les quolibets de ses camarades pas très rassurés par leur nom présent tout de même pour les jours suivants, et les sourires entendus des cadres le plus souvent mal interprétés. Comme les menaces de prendre la place du premier désigné pleuvent rapidement dans les oreilles des traînards, les consignes d'installations à bord sont rapidement exécutées. Le soir, dans la salle commune de la section, le malheureux de la terrible première journée se retrouve au milieu d'un tonneau constitué de canettes de C'fet à distribuer à ses camarades au milieu de quelques rires libérateurs et c'est le début de la cohésion entre les jeunes qui se connaissent souvent déjà de leur centre de sélection terrestre, et les cadres, qui sont plus âgés de trois ans en moyenne puisque ils ont une année de formation sur le « Sun Tzu », deux ans de patrouille dans l'aire Bêta et encore six mois de formation sur Bêta 006.
Le bataillon des pilotes du « Sun Tzu » ont eux aussi trois ans d'expérience en doublure, d'abord en élèves puis en instructeurs, avant de pouvoir prétendre partir pour les cercles les plus éloignés. Seuls les meilleurs des techniciens pilotes et des cadres partent avec l'amiral en fonction, et le contingent de fantassins pour constituer à tous un nouvel équipage de vaisseau des colonies extérieures. Les autres continuent leur formation avec la promotion suivante. Ils peuvent progresser en grade et en responsabilité avant de partir l'année suivante. Mais il est bien rare que les départs pour les cadres et techniciens pointus se fassent en moins de trois ans et en plus de cinq.
Reno s'inquiète un peu de son manque de motivation pour le sexe et l'usage des cabines. Sur terre, il était un peu timide, mais avait quand même eu quelques petites amies, même si les histoires d'amour s'étaient mal terminées. Il ne peut savoir qu'Alsyen a rendu pour lui inutile le recours à ce procédé. Il est donc parfaitement équilibré coté hormonal et mental. Ses rêves érotiques dont il se souvient parfois, loin de le tourmenter, ont la faculté de le réguler. Comme après tout cela arrange bien ses affaires, il ne s'en préoccupe pas outre-mesure pour autant.
Il ne pense pas non plus à mieux réussir pour devenir cadre ou technicien. Lui, il est simple fourrier et combattant. Il partira en première ligne au plus loin de l'espace connu. Son but, c'est de ne pas être éliminé de la sélection, comme le sera une recrue sur deux.
Pour les recalés, ce sera alors un statut de colon et ils seront envoyés sur une planète à terraformer, où ils pourront avoir tout de même un avenir civil intéressant. Mais certains se retrouveront comme souvent dans des milices planétaires et formeront alors un petit noyau de fonctionnaires de sécurité ou de mercenaires selon la chance, la motivation et les compétences. Ce seront surtout des éternels rampants… Très peu en fait font valoir leur droit immédiat à retourner sur Terre.
Son manque d'ambition hiérarchique et son incapacité à penser positivement sur sa personne d'une part, sa motivation et ses capacités sportives et intellectuelles développées récemment de d'autre part, l'entraînent à se démarquer des autres sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Bien qu'il décroche au sport comme au tir les meilleures notes, ses résultats en équipe dopent celle-ci tout en masquant son rôle primordial. En effet, les cadres restent sur les a-priori du centre de sélection terrestre et ses premiers résultats à bord du « Sun Tzu » avant l'embarquement d'Alsyen. Caubard voit aussi dans certaines notes une magouille du commandement due à son rôle de chaperon de mascotte, et pour des notes d' « appréciation » saque Reno dans un but de rééquilibrage. Enfin, certains tests effectués à bord par Reno ne sont pas prévus dans son orientation initiale et sont tout simplement ignorés par l'ordinateur qui ne retient que les matières liées à son emploi futur.
Pour ses camarades, Reno est devenu un ami de choix. Il a toujours la solution à un problème, il donne de sacrés coups de main et il n'a pas la grosse tête. Malgré tout, la plupart de ses amis ont de médiocres résultats par ailleurs et sont condamnés à être éliminés. De plus, comme Caubard souhaite l'élimination de Reno, il le met toujours en équipe avec le « rebut ».
Le sergent Coll quant à lui finit tout de même par être intrigué. Ayant observé Reno à l'épreuve nautique du groupe de l'après-midi, où son leadership et son endurance ont permis un résultat inespéré pour son équipe de canards boiteux, il décide de filmer l'épreuve de sabotage de nuit en infra-rouge et en son intégral afin de bien cerner le rôle de Reno. Avec un cadre du centre commando, il décide aussi que Reno sera une des victimes « privilégiées » de l'exercice d'interrogatoire.
Alsyen est bien loin de toutes ses préoccupations militaires. Pourtant, il a eu une semaine chargée lui aussi avec le vétéran Erick Dombass.
Celui-ci l'a emmené au centre de zoologie de Bêta 006. Là, une charmante scientifique l'a étudié sous toutes les coutures avant d'avouer son ignorance quant à son origine. Elle étudiait aussi le moyen de séduire le vétéran. Elle a donc extrapolé mille et une hypothèses à chacune de ses observations, qu'il s'agisse de ses doigts ventouses, de ses griffes rétractiles venimeuses à volonté et de son intelligence troublante, malgré tous les efforts d'Alsyen pour saboter certains tests.
Le vétéran a ensuite tout fait pour qu'Alsyen ne soit pas classé comme animal dangereux, à cause de la toxicité de son venin recueilli durant son sommeil (il a été gazé par surprise) et de cette intelligence trouble qui pouvait s'avérer dangereuse en cas d'agressivité soudaine.
Alors qu'Alsyen pensait effacer quelques pans de la mémoire de la scientifique pour mieux influencer ensuite son jugement, le vétéran sortit sa botte secrète et la proposa à la zoologiste tout à fait à même d'apprécier la qualité de l'offre.
Alsyen trouva ce marchandage répugnant, et effaça par précaution quelques informations quand même chez la jeune femme qui, vue maintenant sous son coté animal par un Alsyen anthropologiste, semblait en manque permanent malgré une forte demande masculine locale. Il faut dire que cette malheureuse ne parvenait pas à rompre le machisme ambiant malgré son intelligence et ses armes naturelles. La bêtise de certaines certitudes était si forte qu'elle était le vrai pilier de la pseudo supériorité masculine sur cette planète. Le vétéran quant à lui attentionné rendit le vrai lustre qui convenait selon lui à un homme digne de ce nom en donnant à cette femme toutes les considérations nécessaires et optionnelles qu'elle était en droit d'attendre. Puis il commença à étendre le cercle de ses connaissances en la gratifiant de spécialités lointaines dont cette planète semblait avoir été tenue à l'écart. Enhardie et conquise, elle l'encouragea à repousser plus loin les limites de sa pudeur qui la privait de plaisirs inconnus mais désirés.
Le temps manquant, ils reprirent rendez-vous, au prétexte d'examens complémentaires à effectuer sur Alsyen pour le lendemain. La soirée était impossible car réservée à son mari. Ensuite, Dombass ne pouvait plus revenir.
Alsyen avait pris le parti d'en rire et faillit provoquer un grave lumbago en suggérant aux deux amants une position impossible pour ceux qui n'avaient pas la souplesse d'un Niumi. Pour se faire pardonner, il participa un peu en soutenant l'élan de chacun des partenaires. L'alerte sismique fut à deux doigts de se déclencher dans le bâtiment. Cependant le lourd vitrage comme les murs épais ne laissèrent rien passer du remue-ménage à l'extérieur du laboratoire.
Un porte-éprouvettes fut tout de même renversé et le contenu de celles-ci se mélangea parmi les bouts de verres sur le sol. Deux bactéries dont le hasard, jusqu'alors n'avait pas permis la rencontre se trouvèrent quelques similitudes et beaucoup de complémentarités. Si le sol quelques heures plus tard fut nettoyé et stérilisé avec soin, les morceaux de verre furent jetés tels quels dans la poubelle, qui fut vidée dans une décharge en plein air, car la planète peu peuplée n'était pas encore équipée d'incinérateurs.
Mais il faudrait attendre trente ans pour que les effets de la bactérie issue du croisement d'un prélèvement de la flore intestinale d'un coléoptère commun et de la culture d'un virus bovin anodin se fassent sentir.
Enfin repus de l'autre, chacun des amants occasionnels remit de l'ordre dans sa tenue et son attitude, si ce n'est quelques sourires échangés dans les propos tout à faits professionnels qu'ils purent encore avoir et le regard complice en se disant « Au revoir. À demain »
Un effet plus court dans le temps fut aussi la conséquence de cette rencontre. Alsyen gazé n'avait pu se rendre compte qu'il avait subi une extraction de gamètes. Après le départ du « Sun Tzu », des ovules de macaque eurent leurs chromosomes substitués par ceux d'Alsyen.
Puis les spermatozoïdes d'Alsyen servirent à la fécondation. Dix femelles furent ensuite fécondées au moyen de ses œufs et toute prudence quant à la dangerosité de l'espèce d'Alsyen ne fut pris en compte car Alsyen avait éliminé de la mémoire de la scientifique les faits qui auraient pu conduire à sa détention en cage. Elle, par nostalgie pour son militaire, allait reporter son affection sur son animal mystérieux. Seulement les rejetons des jeunes macaques, doués de raison génétiquement, mais élevés par des animaux se conduisirent comme des bêtes sauvages et surtout réussirent à s'évader du centre à leur maturité après avoir tué le personnel responsable de leur entretien. Puis leur intelligence et leurs facultés télépathiques leur permirent d'échapper aux pièges des humains et de proliférer dans les jungles avant de…
Ils allaient devenir, vingt ans plus tard, une menace pour tout le système Bêta …
La seule menace qui à ce moment-là planait sur l'humanité était l'espèce à laquelle appartenait la « mascotte » des vétérans. Quand Alsyen avait pu la voir, par hasard, puisque il logeait avec Dombass dans leurs quartiers, son sang s'était glacé. Mais il ne pouvait rien faire pour prévenir les hommes sans se trahir.
*
* *
Pour l'heure, Alsyen s'éloigne un peu des véhicules tout terrain ayant transporté les chasseurs qu'il n'a pas accompagné dans leur ultime déplacement, obligatoirement pédestre. Son responsable joue aux cartes avec les autres chauffeurs. Les chasseurs se sont déployés et progressent en silence contre le vent pour approcher un gigantesque troupeau de rhinocéros laineux. Alsyen a envie de se rapprocher de la lisière arborée dont l'ombre lui procurerait un peu de fraîcheur. Il règne, au sein de cette savane-prairie, une chaleur torride sous le soleil intense. Assez verte et dense, constituée en majorité d'une herbe de plus de deux mètres de haut, elle fournit une nourriture abondante aux grands herbivores, un abri pour les plus petits, mais vraiment pas de réconfort pour les espèces non adaptées aux fortes températures. Curieusement, les rhinocéros laineux ne souffrent pas de cette chaleur. Les poils protègent leur épiderme fragile et leur sudation suffit à éliminer l'excès de chaleur.
*
* *
À quelques milliers de kilomètres de là, le groupe de Reno commence son raid. Ils sont largués depuis des barges à huit-cents mètres d'altitude en deux passages humains, après le largage de quelques robots qui sécurisent la zone. Une fois arrivés au sol, les huit robots en s'éloignant forment un carré dont les côtés s'allongent jusqu'à couvrir un carré de trois-cents mètres de côté. Pour un parachutiste qui saute de la barge, c'est la chute libre puis à deux-cents mètres d'altitude, une bouteille d'air comprimé se déclenche et gonfle en quelques secondes une voile rigide qui stoppe une éventuelle vrille du parachutiste qui n'aurait su se maintenir à plat. Ensuite, dans un pschitt, la voile se détache du corps du parachutiste et sert d'extracteur pour un parachute-delta qui gonfle aussi des armatures et doit permettre d'atterrir en un minimum de temps face au vent. Encore cinq secondes et les pieds touchent le sol. Le parachutiste se laisse choir et libère avec son couteau la voile à usage unique qui doit, une fois dépliée, s’autodétruire par dé-polymérisation dans les dix minutes. Les suspentes sont quasi invisibles tellement le fil est fin et le couteau les tranche comme des cheveux alors que leur résistance à la traction est de plusieurs centaines de kilos. Les paras ne conservent avec eux que les poignées qui leur ont permis de se diriger dans les quelques dizaines de mètres avant l'impact au sol, histoire d'éviter une flaque, un arbre, un rocher ou tout autre obstacle dangereux. Elles peuvent être réutilisées, mais pour leur premier saut, les recrues sont autorisées à les conserver comme trophées.
Pour son premier saut, le cœur de Reno bat à tout rompre. Il s'est vu mourir durant les six-cents premiers mètres de chute libre, puis les soixante derniers sous voile lui ont semblé être une éternité alors que dès le choc à l'ouverture, il s'attendait déjà au choc suivant avec le sol semblant remonter vers lui à grande vitesse.
Déjà, il faut se relever, se rassembler et aller à couvert, avant de dégager illico la zone. Pour le largage suivant, ce sont des véhicules électriques de soutien qui vont les rejoindre et il vaut mieux ne pas être dessous en cas de mauvais fonctionnement des parachutes automatiques.
Ces véhicules permettent le transport de munitions et d'explosifs sur cent kilomètres. Le soldat a son équipement individuel sur lui. Deux véhicules servent aussi à la reconnaissance tandis que les fantassins se déplacent à pied derrière. Ils peuvent faire des aller-retours, mais en règle générale, ils progressent rapidement d'une centaine de mètres, se postent, puis, en cas de détection de robots ennemis, déposent leur propre robot pour couvrir leur fuite. Ils donnent aussi l'alerte. En fonction de l'ennemi rencontré , les fantassins doivent fuir ou combattre et ils ont ainsi le temps de se mettre en position pour accueillir le premier rang ennemi.
Les robots n'ont qu'une puissance de feu limitée, car trop de munitions à transporter les handicaperait. Par contre, une fois déployés, leur caméras classiques et thermiques donnent de précieux renseignements sur les effectifs et les moyens de l'ennemi en face, présent dans les huit-cent derniers mètres, distance de combat idéale pour les armes légères.
La zone est sécurisée. Le second largage se passe bien.
La manœuvre se poursuit, conformément aux exercices de simulation. Sinon que cette fois, le poids de l'équipement, de l'arme et des vivres se fait cruellement sentir dans les épaules, le dos, les genoux, les pieds…
*
* *
La terre se met à trembler autour d'Alsyen. L'air se charge d'un bourdonnement sourd qui commence à se rapprocher, comme le rugissement d'une vague chargée de milliers de tambours. Un nuage ocre s'élève à deux-cents mètres de là. Des ondes de terreur parviennent à Alsyen. La panique vient de réveiller le troupeau nonchalant et sa fuite le mène vers les véhicules. Alsyen n'a pas le temps de les rejoindre. Il préfère fuir vers les arbres. Les hommes embarquent en vitesse. Déjà les rhinocéros laineux sont à moins de cinquante mètres et leur vitesse atteint les quarante kilomètres heures. Leur front massif est impressionnant car il couvre plus de huit-cents mètres.
Un véhicule ne démarre pas. Mais l'autre ne l'a pas attendu et tente d'atteindre une vitesse supérieure à celle de la mort qui le talonne. Quelques secondes après, le premier véhicule et ses malheureux occupants disparaissent sous la masse. Alsyen a perçu la détresse des hommes face à leur mort inéluctable. Une terreur sans nom pour l'un, un renoncement fataliste pour l'autre. Le courage ne sert à rien dans ces cas-là car il n'y a rien à combattre ou à gérer.
Ils sont morts instantanément les os broyés, en particulier ceux du crâne mais par réflexe, Alsyen avait coupé les ponts télépathiques avant leur trépas pour se préserver mentalement.
Le passage des rhinocéros laineux se prolonge durant de longues minutes. La ruée qui s'éloigne laisse la place à un silence de mort assourdissant. Alsyen contemple avec effroi le sol écorché et écrasé par le passage des pachydermes. Nulle trace des corps humains, certainement mêlés aux quatre ou cinq cadavres de rhinocéros qui ont perdu l'équilibre en butant sur le véhicule. Leurs corps éclatés laissent une tache sombre d'une vingtaine de mètres de long sur cinq à sept mètres de large tandis que des mouches par milliers viennent se poser sur les restes sanguinolents aplatis et dispersés comme sur les herbes souillées de sang poussiéreux. Le véhicule quant à lui a été déplacé de plus de cent mètres tandis que les paquetages ont été éjectés, broyés, aplatis, dispersés et semi-enterrés avec les hautes herbes. Sur les huit-cents mètres de large du front du troupeau affolé règnent la désolation et la mort. Ces troupeaux n'ont pas pour habitude de ravager ainsi la végétation. Leurs déplacements se font lentement à la queue leu-leu sur de longues files qui ouvrent de nombreuses voies, assez étroites finalement, ce qui permet une repousse rapide sur celles-ci grâce à la proximité de larges bandes de végétation intactes.
Alsyen ne sait pas si quelqu'un va venir le chercher. Le second véhicule a t-il échappé à la fureur de la vague meurtrière ? Et que sont devenus les chasseurs à pied ?B-006 : Expériences douloureuses
La nuit est tombée sur Bêta 006. Elle va être longue.
Alsyen s'est réfugié dans les frondaisons d'une sorte d'acacia géant. Les branches sont assez épineuses et devraient le protéger des gros prédateurs. Il en a d'ailleurs cassé quelques unes pour s'en faire une grille de protection efficace, enfin l'espère t-il car elle n'est pas solide. Mais il l'espère assez dissuasive si un gros félin arboricole s'y frotte. Il a dû mener un dur combat cet après-midi avec l'un d'entre eux et c'est son poison plus que l'attaque mentale qui a eu raison du prédateur. Celui-ci avait une vitesse de pensée bien supérieure à lui. Impossible d'anticiper et de bloquer mentalement son adversaire. Le félin par contre avait dédaigné le danger de ses petites mains. Griffé sur la truffe, surpris, il a reculé au lieu de tuer Alsyen, puis ressentant les effets foudroyants du poison neurotoxique s'est enfui ivre de douleur. Il devrait s'en sortir néanmoins après des maux de crâne durant quelques jours car la dose injectée par Alsyen a été volontairement réduite.
Alsyen a faim et soif. Il préfère attendre le plus tard possible pour s'abreuver. Afin de ne pas être trop affaibli, il devra boire quand même, mais il préfère éviter d'attraper des amibes, ou autres parasites intestinaux pour rien et ne le fera qu'en dernière extrémité.. Alors, il joue la carte des secours intervenant rapidement. Pareil pour la nourriture. Les fruits et racines peuvent être toxiques. Quant à la viande, elle risque de le rendre malade, à cause des microbes locaux (pour lesquels il ne dispose d'aucun anticorps) ou de parasites.
Il sait que les secours arriveront pour récupérer les restes des humains. Inutile donc de prendre des risques pour combler une simple sensation de faim.
*
* *
Reno et son groupe progressent selon les ordres d'un chef de section qui les suit par GPS. Chacun dispose d'un dispositif personnel de vision nocturne, de moyens radios sophistiqués, et d'un équipement individuel complet et léger par dessus la combinaison de combat terrestre. La mission de ce soir est délicate. Ils doivent investir une cité lacustre. Elle flotte sur un bloc de béton alvéolé plus léger que l'eau, produit d'une émulsion chimique entre un béton avec des fibres polymérisées et un gaz libéré au dernier moment par l'ajout du catalyseur en fin de cycle mélangeur. Entre la surface habitable bien au-dessus du niveau du lac et le matériau de flottaison, il y a des « sous-sols » parfois inondés qui permettent un système d'égouts, de voies de communication invisibles de la surface, et en ceinture, un dispositif de défense retranchée.
L'attaque se déroulera sur plusieurs fronts et en phases successives. Après infiltration d'un commando par les « voies d'eau », une attaque amphibie aura lieu pour permettre à l'élément de sabotage de faire sauter l'usine hydro-biochimique qui fournit l'énergie électrique.
Reno fera partie des quatre hommes de la section chargés d'ouvrir la voie au reste du commando. Pour l'heure, ils viennent d'atteindre le bord du lac. L'ombre de la cité au loin plane sur l'horizon à quelques kilomètres. Il va falloir s'équiper. Les groupes sortent alors les masques, en vérifient les pastilles d'oxygène qui au contact de l'eau extérieure vont libérer un air consommable à la base du nez. Au niveau de la bouche, un conduit entraîne l'air expiré vers un filtre spongieux. À son contact, les gaz réagissent chimiquement avec un élément solide et génèrent un liquide, évacué discrètement au fur et mesure dans le cas présent.
Bien sûr, dans l'espace, ce résidu chargé de CO2 est récupéré pour recyclage dans le « poumon » du scaphandre, (un « organe » plat de cinq centimètres d'épaisseur pour vingt de long et dix de large, situé à la ceinture à gauche, un peu en arrière), qui par électrolyse, libère à nouveau l'oxygène et l'azote dans les bonnes proportions.
Les pastilles fournissent à l'utilisateur deux heures d'autonomie en air respirable, au bout desquelles il faut changer filtre et pastilles. Plus qu'il n'en faut pour investir la position. Reno a quand même appris à changer « calmement » pastilles et filtre sous l'eau en moins de trente secondes sans paniquer. En plus du masque, les hommes disposent d'un harnais sustentateur muni de compartiments gonflables et de compartiments étanches. Dans les compartiments étanches, les commandos disposent leurs explosifs, leurs grenades, leurs petits équipements … Leur armement (fusil d'assaut) est toujours en bandoulière dans une housse étanche individuelle. Les éléments gonflables se remplissent grâce à la réaction d'une poudre de catalyseur qui au contact de l'eau prise alentours libère l'oxygène de celle-ci. Ainsi, ce harnais reste-t-il très léger et sert de sac à dos spécifique aux commandos aquatiques. Les palmes servent à terre à rigidifier les flancs du sac du harnais, fonction assurée par le gonflage lors de l'action sous marine.
Reno sait qu'il va falloir franchir des filets sous-marins, pénétrer des conduits étroits et surtout ne pouvoir compter que sur son équipier. En effet, sous l'eau, en opération, le contact se fait à vue avec son binôme tandis que la liaison avec le reste de la section est rompue. Pourquoi est-il là, alors qu'en fait, en tant que fourrier, il n'est pas censé être un combattant d'élite ? Le sergent Coll bien sûr, en est le responsable. Après avoir vu ses résultats physiques et ses notes de simulateur, il a remarqué que le nouveau Reno ne correspond pas aux données fournies à l'origine par la Terre à l'issue de ses classes. Le sergent a préféré n'en parler à personne, mais compte lui donner toutes ses chances, même s'il n'est pas de son groupe. Le sergent Sancruz lui, y voit peut-être l'occasion de faire chuter Reno de son piédestal et ne se préoccupe pas de savoir pourquoi son subordonné qu'il déteste participe à cet exercice pénible et périlleux.
*
* *
Alsyen tremble. Il n'a pas de raison d'avoir froid, car sa combinaison le protège, mais c'est la fatigue qui le fait frissonner. Il ne veut pas s'endormir car autour de lui, la vie grouille et la mort rôde. Souvent, un froissement subi de feuilles, des grognements, un cri de plainte puis d'agonie se succèdent, témoignage sonore d'un drame banal. Des branches craquent. Des oiseaux s'envolent soudainement. Des bruits de chute aussi. La veille mentale est saturée de peur paralysante, de faim intense et du confort d'un couple de phacochères au fond de son terrier improvisé entre les racines d'un arbre à moitié couché. Mais ce qu'Alsyen ne peut détecter pour cause d'incompatibilité mentale, c'est l'arrivée lascive d'un boa dans les branches voisines…
*
* *
Reno se raidit un instant au contact de l'eau dans son cou. Il ne peut la ressentir ailleurs, car il est bien protégé. De plus, elle n'est pas vraiment froide. Il nage avec des gants et exceptionnellement porte un vrai couteau à son mollet. Une fois les filets passés, il est censé ne plus en avoir besoin et y mettre à la place un couteau en bois pour « égorger » d'éventuelles sentinelles. En nageant près du fond, la vase se soulève en d'inquiétants nuages troubles… Le temps nécessaire pour effectuer les deux kilomètres lui semble une éternité. Puis les premiers filets anti-plongeurs étendent leurs ombres fantomatiques dans l'onde calme. On les voit bien. Trop bien. Les filets sont efficaces dans les lieux sombres car ils réussissent à emprisonner le plongeur. Là, ils sont trop facilement repérables comme s'ils voulaient être coupés. Reno fait donc un signe de négation à son binôme. Il vaut mieux inspecter les lieux avant de toucher. Bien leur en prend. Les filets sont fixés au sol par des plots en béton, et ils ont des flotteurs immergés à peine en dessous de la surface. Au niveau des flotteurs, il y a de l'électronique testant la continuité des circuits. Une maille déchirée et l'alarme se déclenche.
Reno constate que la taille des mailles pourrait permettre le passage d'un homme non équipé sans la rupture de celles-ci. Bien sûr, c'est un exercice. En temps de guerre, il y aurait plus de surveillance en surface, les mailles seraient plus petites et il y aurait plus de maintenance pour réparer des filets abîmés par la faune sous-marine parfois non dissuadée par les influx d'ondes censées l'effaroucher. Dans le cas présent, il ne fallait pas se précipiter et faire l'exercice de se déharnacher, se faire aider par son camarade, passer les harnais au travers, puis se ré-équiper de l'autre côté. Ce savoir-faire est vital quand on est réellement coincé. Les filets servent donc de prétexte.
Au moins un binôme d'une autre section (ils font le même exercice, mais doivent prendre un autre passage) n'a pas réfléchi et une vedette rapide avec quatre plongeurs les interceptent. Reno connaît la sanction. Les recrues mal inspirées vont être ramenées sur la rive et se re-taper deux kilomètres de trajet. Reno arrive à la cité. Bien que ce soit déjà la quasi-obscurité à vingt mètres de profondeur, l'ombre de cette masse les écrase. Ils vont devoir passer dessous. Après, et seulement après, ils pourront utiliser leurs lampes pour trouver les orifices de sortie des égouts de la ville, pas si écœurants que le mot le laisse supposer puisqu'ils ne charrient que de l'eau de pluie ou de l'eau purifiée. Cette ville rappelle une forme de bateau classique au niveau de sa « coque », mais il s'agit en fait d'une pointe de flèche, avec à l'arrière deux renfoncements latéraux de trois quarts de cercle qui sont des ports protégés, et une « poupe » en demi cercle abritant des accès à des plages artificielles. Ainsi, l'île-ville s'oriente toujours face au vent et son étrave renforcée lui permet de résister à la houle qui peut parfois atteindre deux mètres. C'est aussi à l'avant que l'on trouve les stations de pompage pour l'usine hydro-biochimique. Deux récupérateurs de l'énergie marémotrice sont situés sur les flancs antérieurs.
Les égouts sont les accès les moins surveillés car leur franchissement est le plus dangereux et le plus improbable de par leur conception. Ils sont fermés par de lourdes portes qui ne s'écartent que sous l'action de la pression de l'eau au-dessus. Ouvertes, ces portes sont infranchissables à cause de l'eau qui s'échappe des flancs de la cité. Il est hors de question de les ouvrir à l'explosif pour passer dans le cadre d'un exercice. Il va donc s'agir de les ouvrir grâce à un treuil fixé contre la paroi et sur l'un des battants . En temps normal, il faudrait creuser le béton et le métal grâce à des outils spéciaux. Mais pour ne pas détériorer les portes à chaque exercice, il y a des poignées sur la porte et sur la paroi qui permettent d'installer le treuil et de passer les câbles.
Le but en fait est de faire travailler les recrues sur un parcours aquatique plus compliqué qu'un simple débarquement sur la plage plutôt que de réellement trouver le point faible d'une cité lacustre.
Dans le plus grand silence et l'obscurité quasi totale, Reno et son camarade s'engouffrent dans le collecteur, allument les lampes, mettent en place les fausses charges, installent le treuil... Reno pense à éteindre les lampes avant d'écarter la porte. Les sentinelles font donc mine de ne pas les voir, puisque il n'y a pas de lumière visible. Ils parviennent ainsi jusqu'aux bassins de décantation. Les plafonds sont faiblement éclairés. Prudence.
Ce qui n'est pas juste, c'est qu'il est prévu dans l'exercice (mais ils ne le savent pas) qu'ils soient capturés et interrogés individuellement. Ils seront jugés sur leurs réactions. Deux salles plus loin, ils tombent sur un guet-apens, simulant une patrouille de quatre hommes. Le camarade de Reno s'enfuit et il est « abattu » dans le dos. Reno se poste et fait usage de son arme de type flashball. Malgré deux adversaires éliminés, il est censé se rendre quand six nouveaux adversaires arrivent. À deux, ils auraient peut-être pu éliminer les quatre premiers avant l'intervention des six autres et ainsi s'échapper.
Mais là, le combat est « désespéré ». Les deux commandos en herbe sont menottés et séparés. Reno se retrouve dans une pièce avec deux hommes à la mine patibulaire.
— Où sont les autres ?
Pas de réponse. Il n'est pas censé en donner.
Celui qui n'a rien dit se porte à sa hauteur et le frappe violemment au visage, main ouverte. La claque étourdit Reno et lui brûle la joue. Il ouvre la bouche pour insulter son agresseur mais se ravise in extremis et aucun son n'en sort.
S'il a reçu la claque, c'est qu'il devait la recevoir. « On me teste. Et ça va être très dur »
Il réalise que même si la sécurité sera respectée, le prochain quart d'heure ne va pas être une partie de plaisir.
— Où sont les autres ?
Mutisme de Reno. Aller-retour de la part de la brute.
— Où sont les autres ?
Reno s'en sort haut la main, c'est le cas de dire. L'inefficacité des gifles est établie.
— Vérifions si nous ne sommes pas tombés sur un muet.
La brute se met derrière Reno et lui appuie avec le pouce et un certain savoir-faire dans le creux de l'épaule.
Reno pousse un long râle qui en fait vibrer le béton de la pièce et articule un « arrêtez » pour que cesse le supplice. La brute attend quelques secondes avant de relâcher la pression.
— Allez accouche. Où sont les autres ?
Reno se reprend, vexé. Alors la brute recommence et Reno prend le parti de hurler. Au moins, de la sorte, il ne pense plus à la douleur. Ses yeux se remplissent de larmes de souffrance.
Mais quand la pression cesse, au bout d'un temps de plus en plus long, Reno résiste à la tentation de « lâcher le morceau ».
— Manifestement, notre ami désire le grand jeu.
La brute déchire la combinaison de Reno et lui pince les tétons. Reno en un réflexe fou lui mord violemment le bras, ce qui lui vaut un coup de poing pour le faire lâcher prise.
La brute regarde son acolyte, interrogateur, puis gifle violemment plusieurs fois de suite Reno. Sa tête explose, mais Reno ne plie pas.
Alors, son tourmenteur lui donne un coup de pied dans la cuisse. Cette fois, la douleur persiste. Il va avoir un bleu durant plusieurs jours après ce coup-là.
— Nous allons voir si votre camarade a été plus loquace. Vous n'aurez ainsi pas de scrupule à parler ensuite.
Ils abandonnent Reno. Les deux hommes sont assez admiratifs même si le « mordu » lâche un qualificatif disgracieux. Ils doivent parler. Ils finissent tous par parler. Après tout, ce n'est qu'un exercice pour leur montrer que même en étant gentil, on parvient à être persuasif, et que donc, il vaut mieux éviter de tomber vivants dans les mains de l'ennemi. Pour Reno, il va falloir être un peu plus créatif. Il a franchit le cap du quart d'heure avec succès. Ils ne sont que trois sur dix en moyenne dans ce cas.
À leur retour, ils commencent à injecter à Reno un pseudo « sérum de vérité » qui en fait doit l'étourdir et lui donner des nausées. « Tu parleras de toute manière. » insistent-ils. Puis l'interrogatoire recommence, et il vaut deux brûlures légères à Reno sur les avant-bras. Reno serre les dents, sauf quand il doit recevoir une claque qu'il apprend à dominer.
Le jeu devient plus cruel, avec des chocs électriques. Reno s'abandonne dans la douleur au lieu de parler. Il subit comme si rien ne devait arrêter ce supplice, même pas lui. Un quart d'heure plus tard, Reno dans les statistiques fait partie du un pour cent qui résiste. Mais il est trop épuisé pour pouvoir seul parvenir à réussir l'exercice d'évasion.
Ses bourreaux s'absentent donc et c'est le camarade de Reno qui reçoit pour « instruction » de s'évader en allant chercher son camarade.
Reno reprend espoir quand il est libéré. Il pense à récupérer son matériel dans la pièce voisine, et tout naturellement, au lieu de s'enfuir, comme font la moitié des recrues, il décide de tenter de poursuivre la mission de sabotage.
Dans les coulisses, le sergent Coll se réjouit de cette bonne réaction. S'ensuit alors une partie de cache-cache (infiltration), l'élimination d'une sentinelle par égorgement (mimé avec le couteau en bois), l'acte de sabotage lui-même (dépôt des charges), et enfin, l'exfiltration.
Les premières lueurs de l'aube le trouvent à plus de quatre kilomètres du lac. Il lui en reste encore quinze à parcourir avant d'être de retour à la base.
*
* *
Alsyen déjeune de la chair du boa. Celui-ci a été victime du poison des griffes d'Alsyen, qui ne s'est pas laissé surprendre grâce à un craquement de sa cage en bois. Au fond de lui, après avoir lutté contre le dégoût et tenaillé par la faim, Alsyen se réjouit de se repaître d'une viande crue. Assis sur la branche, tenant le serpent à deux mains, il plonge son museau dans l'entaille à travers la peau du ventre pour dévorer la chair des muscles latéraux. À la fin du repas proprement dit, il savoure les dernières gouttes de sang en faisant sa toilette « à l'ancienne » et sans eau. Son visage ainsi débarbouillé du rouge sanglant redevient celui d'un petit animal inoffensif.B-006 : Recueillement
Dure journée en perspective. Moralement.
Après le raid, il y a eu encore quelques épreuves sportives, du tir, des tests d'utilisation de matériel militaire et des épreuves sur simulateurs, avec des questions comme des mises en situation tendues à débrouiller.
Mais il y a eu aussi un mort parmi les recrues durant le raid. Alsyen a été « miraculeusement » retrouvé par l'équipe venue récupérer les restes des deux vétérans écrasés par le troupeau de rhinocéros laineux. On avait pas spécialement craint pour sa vie, ce n'est qu'un animal, mais personne n'aurait parié qu'on le retrouverait aussi proche du lieu du drame. Reno n'avait par contre pas été prévenu de la disparition d'Alsyen.
Cet après-midi, il y aura un hommage rendu aux trois défunts. Alors, la matinée est consacrée au sport et à la préparation de la cérémonie. Ce dernier jour de la formation avant quelques jours de vacances à prendre sur la planète aurait dû être joyeux, mais les recrues pourtant soulagées restent inquiètes quant à leurs résultats individuels. Chacun a été poussé à bout. Quels sont ceux qui ne prendront pas le chemin des extrêmes confins de l'univers connu ? La déception risque d'être grande pour certains.
La veille, Alsyen a été de nouveau confié à Reno. Les deux acolytes ont été contents de se retrouver. Alsyen s'est blotti contre Reno et a tout de suite senti le traumatisme mental que Reno a subi l'avant-veille. Mais plutôt que de commencer un traitement télépathique, il a préféré laisser à la joie sincère de leurs retrouvailles le soin d'opérer une « cicatrisation » naturelle. Reno a beaucoup changé durant ces deux mois sur Bêta 006. Alsyen se félicite des progrès qu'il a acquis naturellement à partir des bases qu'il lui avait dispensées à bord du « Sun Tzu ». Il regrette cependant l'acceptation d'une certaine violence froide que la discipline peut lui faire mettre en œuvre dans le cadre d'un combat, même avec un de ses congénères.
L'homme pourrait être plus évolué, mais l'éducation qu'il donne à ses jeunes adultes, teintée de peur et de violence, le précipite quelques niveaux plus bas dans l'échelle de l'évolution. Dans le reste de la société humaine, la recherche du profit plus que les impératifs économiques l'asservit aussi à un égoïsme qui le condamne à rester au ban des civilisations évoluées. Au moins, dans son système militaire, l'homme conserve d'intéressantes valeurs d'honneur, de justice et d'altruisme qui lui donnent la motivation pour, éventuellement, se sacrifier dans l'intérêt de sa race.
L'adjudant Caubard a été convoqué à l'état-major du centre de formation. L'Amiral, au côté du commandant en chef du centre se tenait debout en le fixant fermement du regard. Caubard, encore essoufflé par sa promptitude à obéir s'attendait au pire. Mais celui-ci ne fut pas à l'image qu'il en attendait.
En effet, il fut félicité pour Reno, élément exceptionnel qui avait donné le meilleur de lui-même, dans la terrible épreuve de l'interrogatoire comme dans le reste de la mission. Sa rage se mêla quand même à un peu d'admiration. Lui-même avait tenu vingt-cinq minutes, mais quand ses « bourreaux » avaient approché les électrodes de ses parties intimes, il avait craqué.
Bien sûr, il est interdit d'électro-choquer à cet endroit-là, mais il n'est pas interdit de le suggérer. Reno avait ensuite été « stimulé » un peu plus loin, comme l'aurait été Caubard. Celui-ci l'aurait supporté, c'est sûr, mais il n'avait alors pas été prêt à sacrifier sa virilité, ou à bluffer. À partir de ce moment-là, Caubard en son for intérieur se jura de respecter un peu plus ce garçon qui lui avait semblé si timoré au départ, causé quelques soucis par ses maladresses... et d'oublier cette antipathie qu'il lui avait tout de suite inspiré avec ses deux pieds gauches, sa droite molle et son sourire niais.
Après lui avoir valu quelques remontrances à bord du « Sun Tzu », Reno cette fois lui apportait de la considération de la part de ses supérieurs, considération à laquelle Caubard était assez sensible, s'étant toujours démené en vain pour en obtenir autant qu'il pensait en mériter.
L'Amiral lui expliqua donc qu'il lui était cependant impossible aujourd'hui de mettre Reno à l'honneur, à cause des tragiques circonstances, mais qu'il passerait les jours prochains la revue de sa section et qu'il en parlerait. Caubard finalement trouva ce compromis préférable à des honneurs trop larges, qui suscitent souvent des jalousies, et quitta la pièce plus heureux qu'à son arrivée.
Alsyen avait repéré depuis longtemps un atelier d'électronique qui servait pour de multiples réparations de matériel. Tout le personnel avait déserté son poste de travail pour préparer la prise d'armes de l'après-midi ce qui laissait enfin à Alsyen le champ libre. Il échappa à la surveillance de Reno, trop occupé lui aussi pour se soucier de « la mascotte », se rendit à l'atelier et y réalisa un mystérieux montage. Cela lui prit une bonne heure. Par chance, il y avait tout ce qui fallait pour son projet.
Quand il sortit enfin, dissimulant sous sa combinaison les divers éléments, il ressemblait à un petit chapardeur satisfait.
*
* *
Vers seize heures, tous les personnels de la base sont alignés sur la grande place d'armes, en tenue d'apparat. Les combinaisons argent et noir des spatiaux étincellent au soleil. Ils portent un casque de cérémonie blanc, en résine ultra-légère, avec un profilé sur le sommet, une casquette moulée très courte et équipé d'une visière noire relevable, qui baissée leur cache les yeux et s'appuie sur le nez. En effet, souvent, au sol, les spatiaux ne supportent pas le soleil trop intense. Le personnel permanent de la base quant à lui porte des combinaisons kaki bariolé, par dessus lesquelles ils ont passé des ceinturons blancs et de larges épaulettes dorées.
Leur casque, blanc lui aussi, n'est pas équipé de visière relevable, mais d'une casquette moulée plus longue et d'une large mentonnière en plastique. Enfin, tout le monde est en gants blancs et personne n'est armé. Le commandement des mouvements de pied ferme se fait à la voix et « au bâton », celui-ci symbolisant l'ancien sabre jugé trop agressif dans certaines communautés.
Le salut au passage d'une autorité, lors de la revue des troupes, se fait coude au corps, bras rabattu sur la poitrine, le poing droit fermé avec le pouce au dessus posé sur le cœur, juste en dessous des pectoraux, tandis que le bras gauche reste tendu le long du corps, la main dans l'axe et les doigts joints, le pouce avec les autres doigts.
La musique que l'Amiral a choisie pour la revue est un vieux morceau traditionnel du folklore écossais. Les accents de la cornemuse lors de l'interprétation de Hightland Cathedral déchirent le voile noir de la tristesse des cœurs pour redonner courage et enthousiasme, avec un zeste de nostalgie.
Ils sont ainsi plus de quatre-mille à vibrer à l'unisson, tandis que l'Amiral et le commandant de la base passent devant les bataillons de permanents et les unités du « Sun Tzu ». Le dernier carré est celui des vétérans. Ils saluent tous, aussi droits qu'ils puissent l'être malgré leurs os qui les font souffrir, avec le menton levé, la visière escamotée, et le regard dirigé droit dans les yeux des deux autorités. Leur froide fierté est impressionnante. Pendant un instant, pour ces hommes éprouvés par de dures campagnes, les tremblements cessent, les strabismes sont corrigés, les corps sont figés tout entiers dans ce respectueux salut que l'Amiral leur rend ensuite avec la même solennité. Puis les deux hommes se rendent au centre de la place d'arme, face aux trois cercueils.
De part et d'autre, deux hommes brandissent, l'un la torche de la base, et l'autre la torche du « Sun Tzu » . Les torches ont remplacé drapeaux et étendards dans les cérémonies. Il s'agit, ni plus, ni moins, que d'une lourde hampe avec au bout de larges insignes laissant passer au travers de perforations une intense lumière aux reflets polychromes. Dans les insignes, obligatoirement, il y a une représentation du globe terrestre, symbole d'unité dans tout l'espace. Le « Sun Tzu » dispose en plus de celui-ci d'une chimère enroulée autour d'une ancre et d'un diadème de cinq étoiles bleues clair, chaque étoile est censée représenter un cercle d'expansion humaine, auquel le « Sun Tzu », comme les vaisseaux écoles prédécesseurs aujourd'hui démantelés, fournit des recrues formées.
L'Amiral se saisit du bâton de commandement et dirige la cérémonie. Les notes de la sonnerie aux morts résonnent encore un instant aux oreilles avant de se perdre dans les premières secondes de la minute de silence, moment de recueillement qui, pour les recrues comme pour Alsyen, est une première. Reno est touché par ce silence soudain qui alourdit l'atmosphère de Bêta 006. Il ne connaissait aucun des trois décédés, mais il sent toute l'émotion que ce moment implique. Depuis des siècles, les sociétés du monde entier ont ainsi rendu hommage à leurs morts et il a l'impression qu'aujourd'hui, à des millions de kilomètres de la planète d'origine, les morts de toutes les conquêtes ont suivi les vivants et partagent cet instant à leurs côtés. Pour signifier la fin de la minute de silence, les haut-parleurs diffusent l'hymne mondial, le « Boléro » de Ravel, choisi il y a plus de trois cent ans pour sa neutralité politique ou religieuse, son rythme bien particulier, sa magnificence et sa notoriété dans une version tout de même moins obsédante que l'original.
Certains auraient préféré du Beethoven, mais il avait déjà été sollicité en d'autres temps pour des hymnes locaux de sinistre mémoire.
« Officiers, sous-officiers, hommes de troupe, nous sommes ici pour un dernier hommage à nos trois camarades. Ils sont morts loin de notre planète, l'ayant quittée pour servir l'expansion de l'humanité. Bien qu'il s'agisse pour eux trois d'accidents tragiques, ils avaient fait le choix de servir leurs semblables au lieu de rechercher des richesses dans l'espace colonisé. Ils avaient choisi de sacrifier amour, famille et ambitions égoïstes pour se consacrer au dur métier de soldat. Souvenons-nous de ce qui nous rassemble encore. Ils avaient comme nous choisi ce métier. Car si certains viennent chercher la gloire, l'aventure ou l'évasion, que nous soyons chefs ou exécutants, que nous appartenions au soutien logistique ou que nous soyons en première ligne, nous avons tous choisi de quitter notre monde connu pour nous consacrer au service des autres. Ce métier de soldat qui ne pardonne pas la médiocrité, vous avez pu en éprouver toute la difficulté pour l'apprendre. Vous allez découvrir aussi qu'il ne vous épargnera pas. Nous paierons tous notre fierté de l'exercer au prix fort. C'est à ce prix, que nous acceptons alors que les autres le trouvent trop élevé, et à ce prix seulement que nous pouvons prétendre avoir le droit de porter fièrement les armes de notre civilisation. C'est à ce prix que nous avons l'honneur d'être les premiers à pouvoir explorer l'immensité de notre univers. C'est au prix du sang versé, du courage sans cesse renouvelé, du risque calculé, de la force maîtrisée, des efforts perpétuels, de l'entraînement régulier, du respect et de l'abnégation permanents que nous pouvons à chaque réveil être fier d'être un soldat. »
L'Amiral laisse alors passer un ange.
« Votre jeune camarade sans nul doute comme vous l'avait compris. Comme nos deux vieux amis que l'espace avait épargnés jusqu'à ce jour. Un soldat des FCP ne meurt pas toujours dans l'espace, mais il y reposera à jamais. Leur poussière se mêlera à celle des étoiles et nous leur rendront dans quelques jours un dernier hommage à bord du « Sun Tzu » avant de les laisser aller librement dans les courants de l'espace. »
Chaque recrue, comme Reno, se sent touchée par le sort de leur compagnon malchanceux. Ils ont l'impression de déjà faire partie des FCP, puisque le défunt est honoré comme les anciens le sont aussi. S'ils ne résilient pas leur engagement, s'ils ne renient pas leur foi, eux aussi auront droit à ces honneurs. Leurs noms seront gravés dans les archives de l'histoire et d'autres voudront leur ressembler, faire comme eux… L'empathie de groupe joue à plein. Et tous, même dans la tristesse, ressentent la chaleur de leur nouvelle famille d'élection.B-006 : Sortie nocturne
Ils ont été lâchés pour une soirée plus nuit de fête sur Bêta 006. Toute la matinée, ils ont fait leurs bagages, chargé les barges de paquetages personnels et de matériel à destination du « Sun Tzu ». Puis ils ont réparé et récuré les bâtiments qu'ils ont occupés durant ces deux mois intenses. Les revues ont été draconiennes. Certaines chambrées ont même été repeintes du sol au plafond. Alsyen a réussi à faire charger dans le paquetage de Reno son bricolage « ultrasonique », ressemblant en tout points au poste radio émetteur individuel qui a fourni la carcasse.
Aéro-transportés jusqu'à la capitale avec les barges du « Sun Tzu » qui les ramèneront ensuite à bord de leur vaisseau-école qu'ils n'ont pas vu depuis deux mois, ils ont été débarqués avec de la monnaie locale. La mauvaise surprise, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose pour faire la fiesta. À peine un petit repas, quelques verres dans un bar ou une entrée en dancing. Manger, boire ou s'amuser, il faut choisir.
Les jeunes recrues partent donc à pied et en bande sillonner les rues de la petite capitale. Reno quant à lui, outre Alsyen, est accompagné de Jean-Louis. Lui, il a un « bon plan » avec une fille du « Sun Tzu ». Et elle est avec une copine puisque nul n'a le droit de se promener seul ou en couple hétéro. Néanmoins, une petite rencontre dans un endroit discret doit pouvoir être possible. Reno n'est pas rassuré de devoir faire un manquement à la discipline. Il n'est pas non plus enchanté de faire la conversation tandis que son camarade s'éclate dans l'auberge même (Les deux éléments de chaque binôme ne doivent pas être éloignés de plus de vingt mètres).
Bref, la soirée, au nom de la camaraderie, va se passer dans un resto qui fait aussi hôtellerie. Malheureusement, les finances ne permettent pas cette fameuse chambre d'hôtel.
Ils parviennent à retrouver les filles dans le centre-ville, près de la « Pierre de la Cité ». La Pierre de la Cité est une tradition des colons. C'est un monument sur lequel sont gravés les noms des fondateurs de la ville, puis des dirigeants successifs. Elle est très souvent en plein air. Aux alentours, on peut y trouver une mairie, un organe du gouvernement, un musée racontant l'histoire de la ville ou de la planète. Ne connaissant pas la ville, c'était un lieu sûr de retrouvailles possibles.
Les deux filles ne sont pas des top modèles loin s'en faut. Elles ont tout de même l'air sympa. Reno reconnaît la victime à son air un peu renfrogné. Elle aussi a dû se faire harceler pour être là. Surtout qu'en tant que féminine, elle n'aurait eu aucun mal à se trouver un garçon par elle-même. Jenifer croise les yeux de Jean-Louis mais les deux tourtereaux n'ont pas le droit de s'embrasser en tenue et en public, pour la réputation des FCP comme du fait de l'extrême pudibonderie des habitants de Bêta 006. Ils se serrent donc la main, un peu longuement. Reno attend qu’Élisa tende la sienne, ce qu'elle se résout à faire. Mais l'échange est rapide. Par contre, d'emblée, elle veut prendre la main d'Alsyen mais celui-ci s'y refuse, par jeu, faisant le timide. Cela l'amuse et elle caresse Alsyen qui se retient de la griffer. Non mais, pour qui se prend-elle ?
Reno sent son petit camarade se raidir contre lui.
— Laisse-le pour l'instant. Il n'aime pas être traité comme un jouet. Tout à l'heure peut-être, s'il vient à toi.
— T'es sûr ? Il a l'air si chou ?
— Tu ne l'as pas vu en colère. Un vrai fauve.
— Et c'est toi qui l'a dressé ?
— Euh oui, en quelque sorte.
« En aucune sorte, pense Alsyen, je vais te faire payer ça ».
Néanmoins, Alsyen n'en fait rien immédiatement. Il a compris la situation et pour les trois laissés pour compte, la situation n'est pas très agréable. Selon Alsyen, Reno est encore trop gentil, et Élisa, de la même trempe molle qui les font plier au desiderata de leurs camarades.
Enfin, dans leurs rapports avec les autres, car leur opiniâtreté face à l'adversité est proportionnelle à leur « gentillesse ». Ils savent que la vie ne fait pas de cadeaux. Tout compte fait, Alsyen estime Élisa de bonne compagnie tandis que Reno la trouve plutôt quelconque. Même après dix mois d'abstinence, il n'est pas tenté par elle.
Élisa par contre, si elle ne trouve pas Reno très mignon, remarque tout de même son corps vif et vigoureux. Les parties moulantes de la combinaison sont en effet à l'avantage de Reno. Mais pour l'instant, celui-ci ne semble disposer que d'un vocabulaire réduit à quelques acquiescements de mauvaise grâce.
Que vont-ils bien pouvoir faire ? Leurs pas les amènent devant un attroupement de quelques recrues. Là, une d'entre elle est en train d'essayer de regagner ce qu'elle a déjà perdu. En vain.
Un homme assis propose de retrouver la carte de l'étoile parmi deux cartes de lunes. Un vulgaire bonneteau en fin de compte. Il est assez doué, et parvient souvent à tromper la vigilance des jeunes. Alsyen lui-même se laisserait embrouiller s'il n'avait pas la possibilité de savoir grâce à ses dons télépathiques où l'homme a mis l'étoile.
Jean-Louis se propose de gagner facilement quelques crédits. Il tente et commence à perdre. Alsyen se décide à l'aider par suggestion. Petit à petit, il efface ses pertes et gagne un peu. Une autre recrue prend le relais, pensant que c'était facile. Il perd vite les deux tiers de son avoir et préfère aller boire le reste pour oublier. Jenifer essaie. Même méthode. Les amoureux seraient-ils chanceux ? L'homme arrête de jouer avec Jenifer, car « elle est trop forte ». Une autre recrue se présente. Les deux gagnants voudraient partir mais Élisa veut jouer elle aussi. Ils attendent donc le plumage d'un puis de deux jeunes. Élisa joue et perd elle aussi plus de la moitié de son avoir. Alsyen n'a rien fait pour elle. Elle regarde Reno qui lui n'a pas l'intention de jouer à ce truc trop facile. En fait, il ne veut pas jouer du tout. L'homme renifle un autre pigeon. Il insiste.
— Puisque c'est si facile, essaie !
— Pff ! Ça ne m'intéresse pas de gagner des clopinettes.
— Tu as peur. La demoiselle a eu plus de courage.
— Mais ça n'a rien à voir.
— Je joue contre toi à trois contre un. Trois fois. Il suffit que tu gagnes une fois pour être gagnant. Statistiquement, c'est plausible. Tu n'as qu'à jouer le tiers de ton argent disponible à chaque fois.
— Et pourquoi je jouerais ce que j'ai déjà ?
— Pour regagner ce qu'elle a perdu, et pour prouver que c'est facile.
— Je n'ai rien à prouver.
Alsyen réfléchit. Cet homme ne va pas lâcher Reno. Il a même l'intention de le rétamer. Pourquoi ? Il n'en sait rien. Mais un non-joueur, c'est comme quelqu'un qui ne veut rien lui lâcher. Alors, il veut lui donner une leçon.
— Dommage. Voilà une demoiselle qui va s'ennuyer ce soir.
Alsyen donne le coup de pouce qu'il faut à Reno pour se décider.
— Allons-y, puisque vous insistez.
L'homme manipule ses cartes. « Ouyettelle ? »
— Là !
Reno a parlé, vite, trop vite pour Alsyen qui n'a rien pu suggérer. Et bien sûr, ce n'est pas la bonne. L'homme saisit les billets aussi vite qu'il trompe la vue des gogos.
— Il te reste deux chances.
Reno est coincé. Il est pris dans l'engrenage. Mais cette fois, pendant le « oukellé oukellé ouyettelle », Alsyen bloque le gosier de Reno. Celui-ci pense à de la peur et le temps que la gorge se desserre, il « sait » où est la bonne carte.
L'homme fait grise mine. Cette fois, c'est lui qui est en perte. Et qui le sera, sauf si Reno joue plus et perd sur le dernier coup... une idée que lui a mise Alsyen dans la tête.
— Quitte ou double ? propose l'homme à Reno.
— Au troisième coup, je peux donc miser ce que je veux, dit Reno, et vous avez parlé de trois fois la mise.
— C'est exact. confirment les autres.
Cette fois, l'homme est coincé. Il reste deux de ses victimes dans le public. Il y a bien une trentaine de spectateurs au total.
— OK.
— Donc je rejoue ce que je viens de gagner, à un contre trois.
Cette fois le « oukellé » dure plus longtemps. La gorge de Reno se noue à nouveau. Il se résigne déjà à perdre. Mais néanmoins, il n'aura perdu qu'un tiers. Il aurait du ne rejouer que ses gains, c'est à dire deux tiers, mais il ne sait pas pourquoi il a remis un tiers en jeu.
— « Ouyettelle ? »
Tout le monde se tait. Attend Reno. Celui-ci ne parvient pas à ouvrir la bouche. Pas à bouger. Alsyen veut être bien sûr qu'il fasse selon son indication. Il veut aussi faire durer un peu le suspense.
— Celle du milieu, articule maladroitement Reno enfin libéré de l'étreinte mentale d'Alsyen.
L'homme la retourne. Dépité. Mais pas trop. Il n'a pas perdu grand chose finalement. Il arnaque les jeunes sur une partie des loisirs de la soirée et y gagne un bénéfice intéressant sur le nombre. Finalement, il est à la fois un espoir, statistiquement déçu, et une attraction. Ce gros gagnant va, si ça se trouve, lui rapporter des clients toute la soirée. Dans une heure ou deux, il se sera refait sur l'écornage d'une trentaine d'autres.
Reno a le triomphe modeste. Finalement, il a dû se baser sur son intuition car la carte n'était pas là où il croyait avoir vu.
— J'arrête avant que la chance tourne, dit-il plus posément.
Les mises à nouveau réduites, l'homme perd encore un coup sur deux, histoire de dire que la chance ce soir n'est pas de son côté. Il disparaît presque sous la foule impatiente de se faire plumer.
Les trois camarades de Reno le regardent comme le Messie.
— On y va ,dit-il, maintenant, il ne reste qu'à trouver le bon endroit.
— C'est toi qui paye ? lance Jean-Louis.
— C'est nous qui payons. Tout doit être dépensé avant l'embarquement. Cette monnaie n'a court qu'ici. Il n'y a qu'à mettre tout l'argent en commun.
— T'es vraiment sympa toi ! balbutie la malchanceuse Élisa.
Elle tente gentiment de se rapprocher de Reno. Mais celui-ci ne lui porte guère l'attention qu'elle souhaiterait, même s'ils n'ont pas le droit de se prendre la main en public. À la première borne électronique, ils font le choix du complexe restauration - dancing - chambre en tenant compte de sa distance avec l'astroport et de ses prix abordables pour leur bourse.
Le Santa-Fe leur tend les bras, et ils décident de prendre un taxi vert à bande blanche pour s'y rendre. Les tarifs sont libres et négociables car la concurrence est rude et certains sont plutôt vétustes. Les chauffeurs les plus pauvres ne mettent du carburant (huile végétale) qu'au dernier moment. Sinon, ils sont là, à retaper leur vieux véhicule pour qu'il fasse encore quelques kilomètres de plus.
Les autorités ferment les yeux sur ces taxis illégaux. Comme pour les récupérateurs de métaux, de plastiques, de bois, de papier, de vieux textiles, ces activités de récupération pour le recyclage permettent à une frange pauvre de la population de subsister tout en ne grevant pas le budget social, en travaillant et en étant utile au reste de la population.
Cette main d'œuvre bon marché sert aussi pour du travail minute : balayer un trottoir, nettoyer une vitrine … À côté de cela, qui n'est pas contrôlé, existe une tolérance zéro pour les trafics de drogue ou de Neurovids, les vols et les agressions, la prostitution, le trafic d'organes en matière de justice pénale. Enfin un service de soupe populaire est assuré pour ceux qui n'ont pas pu gagner les quelques crédits nécessaires à leur subsistance immédiate. La soupe est infâme, produite synthétiquement, mais contient le nécessaire pour la survie et un développement harmonieux. Avec quelques additifs gustatifs, cette « recette » sert même de repas de substitution pour ceux qui ont besoin de perdre quelques kilos naturellement. Il existe aussi une médecine minimale gratuite dans des établissements spéciaux. La pauvreté doit être plus rebutante que le monde du travail pour que celui-ci trouve la main d'œuvre dont il a besoin. Mais elle peut aussi être un état passager pour tous et personne ne manque de respect à ces exclus.
Les colons assez durs sur Bêta 006 ont un bagne prison totalement isolé qui a mauvaise réputation. Ceux qui ont débarqué ici sans un sou, peuvent soit réussir par leurs compétences personnelles, soit survivre en attendant une chance de repartir gratuitement en soute de vaisseau-cargo pour une planète qui embauche quand Bêta 006 ne le permet pas.
Néanmoins, ces pauvres peuvent passer quotidiennement dans les bureaux de recrutement pour rappeler qu'ils n'ont pas quitté la planète et qu'ils recherchent toujours un emploi.
Ce système n'est pas le plus juste qui soit et les colons sont âpres au gain. Ils acceptent cette règle dans la ville, sachant qu'en dehors, la nature ne fait pas de cadeau à l'homme. Celui qui quitte la capitale doit en avoir les moyens ou être embauché par une entreprise ou un fermier, parfois pour des missions temporaires. Ils sont ensuite ramenés à la capitale, qui seule dispose d'un astroport et de logements pour eux, assez sordides, communs et à sa périphérie.
C'est donc pour le fun que le quatuor embarque dans un tas de ferraille brinquebalant roulant certainement avec un mélange non homogène d'huiles de friteuse d'origines diverses. La rouille tient grâce à la peinture et le siège défoncé permet à Jean-Louis, au centre et à l'arrière, de se retenir aux filles pour stabiliser tout le monde. Reno et ses grandes jambes se sentent à l'étroit devant, avec Alsyen sur les genoux. La nuit commence à tomber et la température devient progressivement plus supportable. Alors que ses camarades rient de bon cœur à l'arrière, il reste un peu songeur, voire mélancolique. Alsyen lui transmet un peu de réconfort. Il n'est pas bon pour Reno d'être un solitaire.
Afin de rester corrects au restaurant, les garçons font face aux filles. Bien leur en a pris. Un quart d'heure après, Erick Dombass et son amie la scientifique pénètrent à leur tour dans la salle. Avec manifestement les mêmes intentions que Jean-Louis et Jenifer pour leur dernière soirée ensemble.
Les quatre recrues rougissent en l'apercevant, mais le vétéran leur adresse un sourire complice. Toute l'hypocrisie du monde n'empêchera pas celui-ci de tourner.
Après l'apéritif le moins cher, les jeunes ont choisi un menu. Le personnel sympathiquement charge un peu les assiettes. C'est si rare d'avoir des recrues ici (trop cher) et la base des FCP a bonne presse sur Bêta 006. Tout le monde reconnaît les efforts que les jeunes ont dû fournir pour devenir des soldats au service de l'humanité et sait que leur destin est tragique, à plus court terme que pour le reste de la population de colons.
L'espace favorise les cancers multiples et les accidents sont nombreux.
Par contre, c'est la scientifique qui, elle, va manger un de ses pires repas. D'ailleurs, elle sait qu'elle ne remettra jamais les pieds ici pour s'être montrée avec un homme qui ne peut être son conjoint. Ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi une salade, et la viande additionnelle fraîche qui essaie de fuir l'assiette est censée achever de lui couper l'appétit. Erick veut se plaindre mais elle en dissuade. « On leur laissera une chambre honteusement marquée par les stigmates de nos ébats » plaisante-t-elle en posant ostensiblement sur son verre une empreinte glosseuse bien rouge et bien dessinée de surcroît sans que ses lèvres pulpeuses ne perdent pour autant de leur éclat. Erick la ressert donc de cet excellent simili Bordeaux sur la base de plants importés d'Australie, puisque manifestement la bouteille sera la seule origine sûre de ce que pourra consommer son invitée.
À la table des quatre jeunes, la tension tombe un peu. Élisa raconte avec brio ses mésaventures durant sa formation. Ils en rient de bon cœur maintenant que c'est terminé, mais manifestement pour elle aussi, la formation n'a pas été rose tous les jours.
Ce n'est vraiment pas une question de manque de chance, mais d'une poisse permanente. Jean-Louis et Jenifer se dévorent des yeux et il faut que Dombass passe un petit moment leur dire qu'il ne verra rien pour qu'ils décident de s'éclipser. D'ailleurs, pour permettre au couple de s'éloigner à plus de vingt mètres des deux autres, il déverrouille les bracelets de Jean-Louis et Élisa. Ils les intervertissent, les glissant dans leur poche, et doivent se les échanger à nouveau le lendemain avant l'embarquement. Il leur faut conserver les bracelets sur eux, par sécurité. Comme pour toutes les recrues, en cas de problème, c'est le bracelet qui permettra de les retrouver. Toute personne disparue loin de son bracelet risque d'être sanctionnée pour désertion.
Reno se retrouve donc seul avec Élisa, dont il ne peut plus s'éloigner maintenant puisque elle a le bracelet de Jean-Louis. Tous les quatre se sont donnés rendez-vous devant l'établissement pour demain six heures. Pour faire plaisir à Élisa, il commence à lui narrer ses propres déboires. Elle sourit, pose les coudes sur la table, sa tête sur les mains et se dandine un peu en hochant la tête.
Alsyen est écœuré. La femelle serait intéressée par une petite partie de jambes en l'air avec Reno. Mais celui-ci ne se rend compte de rien. Il continue, fort correctement, à animer cette conversation que la miss voudrait bien voir déraper vers un peu de séduction de principe à son égard avant de céder diplomatiquement à une proposition à laquelle elle aspire vraiment.
Mais au fur et à mesure, elle est quand même conquise par le personnage qui s'avère, en plus d'un solide gaillard, être assez intéressant. Alsyen tente de la calmer hormonalement histoire qu'elle cesse d'envoyer les regards langoureux que l'autre nigaud ignore, tout absorbé à raconter sa découverte d'Alsyen en vidant son assiette.
Bien au contraire, Élisa sent qu'elle commence à , oui, c'est ça, tomber amoureuse. Ce n'est plus l'excitation sexuelle d'une fille en parfaite santé enfin en présence d'un garçon qu'elle ressent, mais une attirance pour lui. Elle a envie de le soulager, le protéger, le réconforter, s'en occuper, s'offrir…
Reno, lui, rassasié, ne voit en elle qu'une fille sympa, et pas si moche après tout. D'un revers mental souverain , il écarte avec honte pour lui, respect pour elle, la brève tentation bestiale de la soumettre à un traitement de choc contre la virginité chronique. Il décide d'ailleurs de ne rien lui proposer de tel, afin de pouvoir la garder comme copine.
Élisa n'a pour l'instant pas un physique facile. Ce petit bout de fille de un mètre soixante-deux est encore suivi, malgré tout le sport pratiqué depuis deux mois, par un derrière apparemment généreux. C'est aussi un effet grossissant de la combinaison des FCP qui n'est pas prévue non plus pour mettre en valeur les seins des recrues féminines (effet aplatissant dans ce cas). Les cheveux sont obligatoirement portés courts (Ils ne doivent pas toucher les épaules ou être en chignon ou couette enroulée). La rouquine Élisa a choisi une coupe en brosse sur les cotés avec une frange assez sympa qui met en valeur ses yeux verts. Son visage est un champ de bataille entre les taches de rousseurs qui se disputent l'espace avec des boutons d'acné juvénile non traités, car les crèmes ne sont pas monnaie courante sur le « Sun Tzu » comme sur une base militaire. Un petit nez taquin surmonte des lèvres assez fines. Déjà des rides d'expression marquées, dues aux efforts, à un visage qui a maigri, s'est un peu durci durant ces derniers mois, lui donnent une petite maturité en contradiction avec la flamme joueuse brillant dans ses yeux. Sa dentition est un peu irrégulière, mais son sourire reste délicat, éclairant son visage de douceur tout en lui conservant un petit air naïf. Ses narines palpitent d'excitation et elle garde en permanence un demi-sourire involontaire. Ses lèvres sont un peu plus gonflées qu'à l'accoutumée et quelques micro-muscles font parfois trembler légèrement sa lèvre supérieure. Elle boit les paroles de son compagnon, et se surprend pour une fois à ne pas toujours se présenter comme une gourde.
Mais Reno ne remarque rien de rien. Il reste même insensible à sa voix, marquée d'un accent assez chaud pourtant, qui lui vante le boulot d'infirmière de « contact ». Elle n'est pas protégée par un statut médical. (D'ailleurs, comment des extra-terrestres pourraient-ils avoir développé des notions pareilles). Elle est combattante à part entière, mais s'occupe des premiers gestes sur les blessés (les mettre à l'abri en tenant compte pour les déplacer de leurs blessures apparentes, les dégager de leur harnachement, les positionner correctement). Pour les secourir, elle active leurs balises de détresse s'ils ne peuvent pas le faire, pose des garrots, enfin, des bracelets de contrôle de la combinaison qui permettent de gérer des zones de pression spécifique, ainsi que des atèles et des pansements hémostatiques. Elle a aussi dans sa trousse des doses injectables supplémentaires de méta-morphine, seringues qui ne peuvent être en trop grande quantité à disposition du combattant lui-même.
La méta-morphine est plus puissante que la morphine classique, et n'est utilisable que dans un temps très court (entre dix-huit et vingt-quatre heures selon les dosages). Ensuite, elle provoque des nausées qui découragent une accoutumance grâce à un complément qui à une demi-vie de quelques jours dans l'organisme. Donner cette spécialité en sus à toutes les filles leur permet de ne pas faire partie du premier binôme de choc lors d'une progression en zone hostile, comme d'être respectées au sein du groupe de combat. Si la formation n'est pas mixte, les équipes de combat opérationnel le seront dans la plupart des cas lors de leur mise en place effective. Avec l'expérience et la fin des tabous précédant le vingt et unième siècle, on s'est aperçu que la présence d'une femme ou deux rendait le groupe plus solide et plus efficace dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, à condition que la « Madelon » refuse d'appartenir à un membre du groupe. Par contre, elle est encore mieux acceptée quand elle a un compagnon hors du groupe. Allez donc comprendre…
Alsyen non plus ne comprend pas. Malgré ses suggestions télépathiques pour décourager Élisa, celle-ci est à un cheveu de passer à l'acte en public. Elle n'est plus retenue par sa timidité de maladroite congénitale. Il passe même à la limite de la catastrophe, quand il la trouble au point de lui faire renverser son verre. Reno prévenant saisit sa serviette pour l'essuyer et au dernier moment se ravise, se contentant de la lui tendre. De toute façon, la combinaison est traitée anti-tâches. Alsyen parfois fait balbutier Reno pour qu'elle pense avoir un nigaud en face, ce qu'il est déjà assez tout seul d'ailleurs, car même non intéressé, il se montre assez timide. Mais justement, elle interprète sa maladresse comme justement un effet du trouble qu'elle lui provoquerait.
Finalement, ils décident d'aller aux salles de dancing. Malheureusement, ils sont restés tard à table et celles-ci se sont vidées. La population est du genre couche-tôt dans le coin. Un petit verre d'alcool local, pour s'encanailler, a fait pleurer la tendre marguerite en vain. Ils décident donc de prendre une chambre pour se reposer et attendre l'heure.
Il y a une salle de bain avec baignoire. Un luxe qu'ils avaient oublié. Galant, Reno lui laisse la première place. Pas question de laisser passer une occasion pareille, qui ne se reproduira peut-être jamais, en tout cas peut-être pas avant quelques années.
Élisa s'y éternise. Elle a l'impression de décoller une crasse de plusieurs mois tellement elle a l'impression que sa peau respire. La direction de l'hôtel fournit aussi le bain moussant parfumé et réparateur. Elle n'ose appeler Reno sous un prétexte fallacieux qui pourrait lui permettre de voir son corps, ou au moins sa tête et ses épaules émergeant de la mousse blanche. Et puis, elle n'est pas trop sûre d'elle. Un échec après une telle audace serait un affront qu'elle ne pourrait pas supporter. Reno lui ne cogite pas. Il dort tandis qu'elle rêve tout haut. À elle le bain, à lui le lit. Alsyen rit intérieurement. Finalement, ils sont bien bêtes tous les deux avec leurs scrupules alors qu'ils auraient pu tout partager.
Élisa sort du bain, observe son corps nu dans le grand miroir. Elle a l'impression d'être plus fine qu'avant alors qu'elle a perdu peu de poids. Et même d'être plus grande. Elle a raison mais elle reste elle persuadée qu'il ne s'agit que d'une impression. Elle est plus grande car elle a passé déjà plus de six mois dans l'espace. Dans quelques mois, quand elle devra changer son paquetage, elle pourra constater qu'elle aura pris dix centimètres en taille sans prendre un kilo de plus. Avec l'effet dû aux faibles pressions dans l'espace qui réussissent bien aux organes érectiles, sa silhouette finalement sera bien plus agréable à regarder que celles des femmes restant à la surface des planètes.
Elle se couche à côté de Reno, nue, sans le réveiller. Elle décide d'activer l'alarme vibratoire de sa montre une heure avant de partir. Ainsi, elle s'habillera et réveillera Reno afin qu'il puisse prendre un bain lui aussi. Avant de sombrer dans le sommeil, elle espère un instant être réveillée au matin par un prince charmant entreprenant.Déparasitage
Le « Sun Tzu » en route pour Bêta Prime va croiser la route d'une exoplanète gazeuse de gros calibre. C'est l'occasion rêvée de se débarrasser des « mantas ».
Pour cela Alsyen doit dispatcher trois réémetteurs d'ondes miniatures de part et d'autre du « Sun Tzu ». Impossible pour lui de se promener seul. Il va avoir besoin de Reno pour traverser les différents quartiers et atteindre les entrepôts.
Reno, depuis son retour sur le « Sun Tzu », a du vague à l'âme. Il a l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important. En fait, il est obsédé par Élisa Quand elle l'a réveillé au petit matin sur Bêta 006, il a été frappé par ce visage féminin qui lui souriait au dessus de lui. Comme suggéré, il est allé prendre un bain et finalement, il se sont quittés bons amis à la sortie de l'établissement de loisirs. Jean-Louis n'a cessé de lui raconter ses exploits de la nuit tandis que lui avait dormi. Au début, il n'y avait accordé aucune importance, mais à chaque fin de cycle de sommeil, Reno revoit le visage d’Élisa au dessus de lui.
La cérémonie de dispersion des cendres de leurs camarades a été diffusée sur le réseau informatique du vaisseau en direct pour les quartiers éveillés et en différé pour les autres. Pendant le recueillement, cela a permis à Reno de se remémorer les moments forts vécus sur Bêta 006.
Chaque minute le rapproche de Bêta prime qu'ils atteindront dans deux semaines. Là, les recrues devront choisir en fonction de leurs résultats aux épreuves entre partir en unité constituée pour l'exploration dans le dernier cercle atteint Thêta, partir en individuel dans les places proposées dans les autres niveaux pour combler les trous des effectifs ou devenir colon, en répondant aux nombreuses offres d'emplois interstellaires.
En effet, les sous-officiers surtout sont sollicités pour « entraîner » les troupes planétaires quand elles existent. Les hommes de troupe sont recherchés par les gouvernements pour servir dans leurs forces de protection, qu'il s'agisse de police, milice, entreprise de gardes du corps ou même de d'employeurs de mercenaires. Les officiers peuvent se voir proposer des postes de généraux au lieu de rester simple lieutenant. Mais aucune place ne peut avoir le prestige d'être un soldat des FCP, protecteurs de l'humanité à travers l'espace. Ce sont donc le plus souvent les recalés qui trouvent ainsi des places de consolation. Mais ils resteront des rampants loin de leur terre d'origine…
Reno se souvient de ce vieux fermier à quelques kilomètres de la base sur Bêta 006. À son époque, la formation devait être bien plus pénible. À l'issue de celle-ci, il avait choisi de rester dans le cercle Bêta. Reno et son groupe étaient planqués dans le hangar des couveuses. Ils avaient coupé au plus court entre deux points de contrôle durant un raid de survie et avaient un peu dévié pour demander à la ferme un peu d'eau et acheter éventuellement un peu de nourriture. À ce moment-là, ils ne savaient pas que la monnaie utilisée sur la base n'avait pas court en dehors de ses limites.
Mais le fermier les avait bien reçus. Lorsque le vrombissement d'un glisseur les avait alertés, ils avaient dû se cacher pour ne pas se faire prendre en flagrant délit de tricherie. De là où il était, Reno pouvait entendre le sergent Coll, accompagné de Erick Dombass. Alsyen avait repéré l'aura de Reno mais lui aussi avait compris qu'il ne devait pas réagir à sa présence.
Coll avait questionné le fermier pour savoir s'il avait vu du monde. « Personne » avait répondu le vieux, goguenard. Manifestement, sa ferme était souvent visitée.
Dombass avait alors discuté avec le fermier du bon vieux temps. Horrifié, Reno avait compris que le fermier et Dombass avaient été recrues ensembles sur la base, quarante ans plus tôt. Le fermier n'était pas parti, et avait vécu sa vie. Dombass lui, totalisait presque trente ans de voyages inter-cercles sous forme dématérialisée et n'avait relativement vécu qu'une dizaine d'années. Trente ans auparavant, le fermier s'était installé près de la base, par nostalgie de ce qu'il n'avait pas vécu.
Il était donc un producteur vendeur privilégié pour la base, et on savait qu'il recevait parfois des visites durant les exercices de survie. Il était donc défendu de passer à sa ferme, en théorie. Signaler cette interdiction, c'était déjà indiquer l'existence de cette ferme, voire insister sur son importance stratégique. Que penser de commandos sans audace qui ne de braveraient pas les interdits, surtout que le risque était proportionné. Vingt kilomètres en arrière si on se faisait prendre, une bonne omelette d'œufs d'autruche et une lampée de gnôle si on gagnait, et parfois les deux si le timing était trop juste.
D'ailleurs, Dombass en avait une bien bonne à raconter à son vieil ami qu'il n'avait revu que quelques jours auparavant, au hasard d'une livraison de produits frais à la base. C'était le vieux qui l'avait reconnu. Dombass avait bien sûr moins changé que son camarade.
— Hier, tu nous as menti. Je le sais parce qu'un blaireau n'a rien trouvé de mieux que de déposer une gerbe à l'arrivée du parcours d'obstacles qu'on leur fait franchir comme dernière épreuve du raid. Il n'a bien sûr pas craché le morceau même devant l'évidence. Et à l'odeur, j'ai reconnu plus ta « pomme » que les sucs gastriques habituels.
— Y en a, avait reconnu le vieux, mais pas seulement. Ne t'inquiète pas, personne n'est devenu aveugle avec ce que je donne à boire ici.
Reno plaignait ce vieux fermier et ne voulait pas passer à côté de ce que Dombass avait déjà vécu. Si ses résultats le permettaient, il choisirait lui aussi de partir pour l'inconnu le plus lointain.
*
* *
Alsyen trouve Reno seul à ce seuil de réflexion. Il décide de lui envoyer un message télépathique en clair.
— Reno, il faut que tu m'aides.
Celui-ci se retourne, et ne voit qu'Alsyen. Il pense avoir rêvé.
— Reno, c'est bien moi qui te parle.
Il se retourne. Alsyen lui fait face, debout.
— Scipion ?
— Oui, Reno.
Reno doute encore de ses sens. Puis il décide de déclencher l'alarme car il doit y avoir une fuite de monoxyde de carbone, un excès d'oxygène, ou un gaztruc quelconque qui donne des hallucinations. Il a au moins besoin d'un examen médical.
Alsyen l'arrête en plein mouvement.
— Non, Reno, cela doit rester entre nous. Mais c'est grave. Calme-toi. Je te bloque, mais je peux lire tes pensées maintenant. Je peux aussi me faire comprendre de toi au niveau conscient. Je ne suis pas un simple animal, mais un être intelligent, comme toi. Mon vrai nom est Alsyen. Je dois te faire confiance pour garder ce secret. De toute façon, si tu me dénonces, je fais le singe et tu passes pour fou. Alors, fini les rêves étoilés pour toi. Réponds mentalement que tu as bien compris et répète le en toi, que je mesure bien la qualité de la liaison télépathique entre nous.
— Tu t'appelles « Le sien ». C'est grave. Tu peux me contrôler. Tu es intelligent. Ça doit rester secret sinon je passerai pour fou.
— Excellent résumé. Je suis aussi un ami. Ton vaisseau est infesté par deux mantas qui vous volent votre énergie nucléaire. Le vaisseau va tomber bientôt en panne de carburant si nous laissons faire car leur consommation double tous les vingt-quatre jours. Nous pouvons les chasser en les encourageant à quitter le bord pour se nourrir de l'énergie de cette planète, moins intense, mais en quantité bien plus importante.
— Comment faire ?
— Il faut faire passer durant quelques minutes un train d'ondes désagréables pour elles à travers la structure afin qu'elles quittent le navire et dérivent en orbite. Le temps qu'un vaisseau repasse, elles seront devenues tellement grosses que voler l'énergie du vaisseau ne les intéressera plus.
— Et alors ?
— Regarde.
Alsyen va chercher dans les affaires de Reno le simili poste de radio. Il sort de la carcasse deux mini-émetteurs.
— Il faut mettre ces émetteurs aux extrémités du « Sun Tzu ». Chacun diffuse un train d'ondes particulier, et leur conjonction dans les entrepôts sera intolérable pour elles.
— Donc, il faut aller dans chaque roue externe et sur la plate-forme supérieure ?
— C'est à peu près ça.
— Pour la roue de droite, c'est facile.
— C'est déjà fait.
— Pour les deux autres endroits, il faut des laissez-passer électroniques.
— Je les ai aussi…à ton nom. Mais il faut que tu sois avec moi pour que la garde actionne les sas de sortie en extérieur.
— Ils ne vont pas me laisser passer chez les filles. En plus, elles sont en période de sommeil.
— Oh que si. Officiellement, tu dois traverser la zone pour changer le lot de cartouches de gaz servant au déclenchement automatique de la fermeture des portes incendie qui sera périmé dans six heures.
— Tu sais trafiquer l'ordinateur central ?
— Je te promets que c'est pour la bonne cause. Les cartouches sont stockées dans les entrepôts. C'est aussi simple que ça.
— Scipion, c'est incroyable. Mais comment est tu arrivé sur Bêta-112 ?
— Appelle moi Alsyen tu veux bien ? Sinon comme toi. En vaisseau spatial.
— Et le monstre ?
— On en reparlera au retour. D'accord ?
— Oui, allons-y.
Mille questions s'entrechoquent dans l'esprit de Reno tandis que sous la direction d'Alsyen, il se rend aux entrepôts, récupère les cartouches et place le mini émetteur. Alsyen y répond un peu, histoire de le motiver. Il se garde la possibilité de le paralyser à tout moment et de le faire baver, s'il a le malheur de tenter d'informer ses congénères.
Reno a des projets ensuite avec Alsyen. Il n'a pas encore compris que celui-ci y était pour beaucoup dans les changements récents. Pour lui, ce sont les FCP et la formation militaire qui l'ont ainsi révélé à lui-même. Alsyen ne le détrompe pas.
Le passage dans le quartier féminin est moins aisé que prévu. Il a fallu un peu discuter. Incroyable. Elles sont mieux gardées que tout le matériel sensible, hors armement tout de même.
Alsyen en reste stupéfait. Il ne manquait plus que ça. Une malchance sur dix mille. Il faut que Reno croise Élisa qui revient des toilettes.
— Reno ?
— Chut !
— Mais …que fais tu là ?
— Je …euh…
— Tu voulais me voir ?
— Non euh oui (Alsyen lui a soufflé de mentir. Elle ne doit pas savoir).
— Oui ou non ? insiste-t-elle espiègle.
Elle est ravie de la présence de Reno et ne pense pas à de possibles sanctions. Il est peut-être un peu lent, mais déterminé en fin de compte. Comment a-t-il fait pour franchir les contrôles ? Il doit être malin en fait, et audacieux. C'est pour elle qu'il fait tout ça.. Elle est flattée, voire plus.
— Oui, répond-il.
C'est presque vrai. S'il avait pu par lui-même, il serait venu. Il est content d'être là. La chance est avec lui.
— Suis-moi. Ici on peut nous voir.
Retour donc aux toilettes. Alsyen laisse faire. Il vaut mieux ne pas être louche aux yeux d’Élisa
— Viens avec moi, insiste Élisa
Ils entrent dans une cabine. C'est exigu. Ce n'est pas prévu pour deux qui plus est. Il a posé son matériel ainsi qu'Alsyen dans la cabine d'à-côté. Élisa est contre lui. Elle le serre entre ses petits bras.
— Embrasse-moi, lui susurre-t-elle dans l'oreille, rougissante. Embrasse-moi ou je crie.
Alsyen les laisse s'expliquer durant un petit quart d'heure. Puis il s'immisce dans la conversation en envoyant des messages d'urgence à Reno afin qu'il abrège l'entretien. Les deux tourtereaux ont été en fait bien sages, même si les mains se sont parfois un peu égarées.
Reno promet de revenir bientôt. Mais là, il lui faut rejoindre rapidement sa section s'il ne veut pas être repéré. Il a un petit boulot à effectuer qu'il devra terminer plus tard afin de pouvoir revenir. « Demain, même heure, d'accord.»
Une dizaine de minutes plus tard, la palpitante Élisa le laisse enfin partir.
Reno se hâte d'effectuer les changements de cartouches tandis que Alsyen met en place le dernier émetteur. Puis il met en route son générateur d'ondes. D'ici quelques dizaines de minutes, les mantas se décrocheront…
De retour à la section, Reno se trouve pris d'une soudaine fatigue alors qu'il est censé se rendre en sport. Personne ne s'en aperçoit.
Alsyen lui envoie dans son premier sommeil quelques mots d'excuses, avant de lui effacer la mémoire des deux dernières heures, c'est à dire juste avant lui avoir demandé son aide et révélé sa vraie nature. Il efface donc aussi le souvenir de ses quelques moments d'intimité avec Élisa, des promesses qu'il lui a faites, des sentiments qu'il a éprouvés pour elle. Demain soir, il ne sera pas au rendez-vous.B-069 : Bordée dans l'espace
À l'issue d'une approche parfaite, le « Sun Tzu » s'arrima à la station spatiale de Bêta 69 surnommée l'Oasis.
Effectivement, elle était entre un tiers et mi-parcours de Bêta-112 et Bêta prime dans ce sens de déplacement (En fonction des positions relatives durant l'année centaurienne).
En orbite éloignée de Bêta 69, l'Oasis disposait de quais gigantesques où s'amarraient les gros vaisseaux interstellaires, les petits courriers interplanétaires et les remorqueurs.
Ceux-ci établissaient une noria dans tout le système pour alimenter les autres stations planétaires en gaz naturel bon marché de Bêta 69 et ramener à la station et aux quartiers miniers en orbite basse les métaux et les produits manufacturés nécessaires à leur expansion.
L'espace environnant la géante gazeuse grouillait donc de chapelets de réservoirs saucisses vides ou pleins, dérivant sur des orbites définies guidés par des pilotes automatiques, en attendant d'être tractés par les remorqueurs, puis arrimés sur les vaisseaux à distance de la station avant leur départ pour leurs lointaines destinations. Les convois ainsi formés étaient tous identifiés afin que les convoyeurs sachent quels réservoirs monter sur le vaisseau demandeur.
Ce système était censé éviter la piraterie. À ce jour, la gestion et la surveillance avait dissuadé toute tentative de vol d'énergie.
De toute façon, en cas de problèmes (attaque ennemie), les remorqueurs avaient l'autorisation de charger les vaisseaux avec n'importe quel convoi à condition qu'ils ne soient pas sous un feu direct.
Par tradition, les pilotes furent applaudis pour leur manœuvre savamment exécutée sans accroc. Néanmoins, ce quai n'était pas physiquement arrimé à la station. Il était en contact permanent avec elle, et ses générateurs de poussée à gaz conservaient une distance stable.
Il permettait aussi aux hommes du « Sun Tzu » de quitter le bord et de prendre place sur des petites navettes qui elles allaient rejoindre la station proprement dite. D'autres petites navettes assuraient le transbordement de marchandises plus précieuses que les simples métaux et le carburant.
La station elle-même était composée de cylindres de cent-vingt mètres de diamètre et de quatre-vingt mètres de large, reliés par des cordons ombilicaux par leur axe. Ces cordons avaient des sas amortisseurs en leur centre pour maintenir les cylindres entre eux avec une certaine souplesse. Les cylindres tournaient sur eux-mêmes comme le faisaient les roues plus petites du « Sun Tzu » pour générer une gravité artificielle.
En fait, il s'agissait de deux demi-cylindres séparés par un sas de changement de sens. La station était occupée en majorité par des permanents. La gravité devait donc être bien plus forte que dans le « Sun Tzu » pour se rapprocher des normes terrestres indispensables sur le long terme. La vitesse de rotation était donc dix fois plus rapide.
Le système fonctionnait par éjection de gaz neutre. À l'axe de rotation, en plus des sas de transition, il y avait donc des bobines à induction qui fournissaient une partie de l'électricité des modules et des passages de fluides, certains caloporteurs qui par contact avec les éléments amortisseurs et lubrificateurs se réchauffaient et circulaient partout pour chauffer l'atmosphère des cylindres ou d'autres réseaux caloporteurs.
La même technologie d’auto-réparation des parois que sur le le « Sun Tzu » et des cloisons étanches protégeaient les humains contre les dépressurisations dues à l'impact de petites météorites, ou, dans cette zone assez occupée, de déchets négligemment semés dans l'espace qui bénéficiaient des accélérations orbitales et s'avéraient assez dangereux. Des navettes de récupération avaient d'ailleurs pour mission de les repêcher avec des « filets » magnétiques. En fait de filet, c'était une soucoupe alvéolée que la navette déployait autour d'elle. Une fois l'objet à capturer repéré avec des radars spécifiques, elle arrivait derrière lui avec une vitesse relative légèrement plus élevée. Celui-ci se plantait alors dans la coupelle entre les différentes parois et y restait coincé. Pour ceux qui étaient trop gros, il y avait une méthode de capture plus manuelle. Les récupérateurs se positionnaient auprès d'eux pour les intercepter sans risque, chacun ayant la même vitesse. L'exercice restait toutefois périlleux quand l'objet avait en plus un mouvement de rotation sur lui-même...
L'ensemble des cylindres décrivait une spirale sphérique d'une centaine d'éléments. Cet ensemble aurait pu être étiré, mais ainsi en spirale, en cas de problème, chaque cylindre était assez proche des autres pour permettre l'évacuation d'un cylindre endommagé en catastrophe par des cabines individuelles non motorisées. On pouvait ainsi récupérer ces cabines dans le délai de trois heures de survie au maximum qu'elles permettaient à leur occupant (Ou une heure et demi pour deux plutôt l'un sur l'autre, mais comme il n'y avait alors plus de gravité…).
Les gaz expulsés par de courts tuyaux orientables sortant à l'extérieur des cylindres (dont l'ensemble semblait former une crête inclinable) pour entretenir la rotation étaient bien sûr inertes, et retombaient finalement lentement sur la naine gazeuse qui maintenait elle-même encore une très légère attraction à cette distance. Leur compression était donc une sorte de conservation de leur énergie. Les usines qui devaient brûler des gaz étaient bien à l'écart des lieux habités et avec des effectifs humains réduits. Des robots non humanoïdes assistaient très efficacement ceux-ci, bien qu'on ne pouvait pas parler d'intelligence concernant leur cerveau « micro-processeurisé » pourtant à l'extrême.
Tous les travailleurs de l'espace étaient bien payés. Mais ils ne pouvaient pas exercer leur métier plus de quinze ans, toujours à cause des cancers dus aux rayons solaires, aux ondes diverses et à la nourriture souvent en conserve.
Enfin, les travailleurs spatiaux souffraient de déformations corporelles (les corps continuaient de grandir alors que les muscles s'atrophiaient) qui pouvaient les tuer prématurément ou même leur interdire de retourner sur des planètes à gravité normale. De plus, au bout de quinze ans, ils étaient stériles dans quarante pour cent des cas. Mieux valait n'y rester que dix ans, y gagner un pécule conséquent, puis s'installer sur une bonne planète.
Mais cette épargne en intéressait d'autres. Sur l'Oasis, en plus de quelques commerces de base, et des grandes sociétés d'énergie, banques et assureurs en surnombre cohabitaient avec espaces de loisirs et casinos. Comme tout bon port, il y avait des femmes disponibles pour les marins de passage.
Cette fois, les recrues avaient accès à une plus grosse part de leur épargne forcée. Mais ils ne disposaient que de deux jours pour profiter de la vie en toute insouciance. Ils seraient sur Bêta prime dans une semaine pour rendre le « Sun Tzu » à un autre équipage et en ce qui les concernait, prendre un nouveau départ. La précaution des bracelets pour chaque binôme n'avait pas été prise. Si un jeune se perdait ici, c'est qu'il ne désirait plus faire partie des FCP ou appréhendait trop la suite. Cette liberté était un moyen déguisé de pratiquer une sélection. En leur laissant plus de chances que s'ils désertaient sur Bêta 006.
Les sections furent débarquées sur les cylindres en fonction de leur rythme circadien. Il fut impossible à Jean-Louis de contacter son amie Jenifer pour se mettre d'accord sur un lieu de rendez-vous. Mais ce n'était pas grave. Avec le reste de la section, c'était une bande de copains qui allait s'éclater sans retenue.
Les filles auraient été des poids morts, pire, des freins, des rabat-joie. Reno partageait cette impression, le visage d’Élisa ayant cessé de lui apparaître au réveil après l'amnésie provoquée par Alsyen. Une petite étincelle humide essaya bien de lui étreindre la conscience mais son inflexible mentor la souffla sans remord quand il s'en aperçut.
De leur côté, les deux copines étaient plus réservées quant à leurs excès. Les hôtes de charme masculins étaient bien moins nombreux que leurs équivalents féminins, et le genre musclé, huilé et épilé ne leur plaisait pas vraiment. Les gars sportifs des FCP suffisaient à leur bonheur, mais seule Élisa voulait se garder pour le sien, malgré qu'il ne soit pas venu au rendez-vous, ni à l'heure, ni aux jours suivants. Enfin, aucun point de rendez-vous n'était possible à « deviner » sur l'Oasis. Elle espérait que le hasard ferait bien les choses.
Si les types de distraction étaient rares, les établissements qui les proposaient étaient assez nombreux. Il y en avait au moins un par demi-cylindre. D'autres vaisseaux étaient présents. En particulier des vaisseaux en provenance de Bêta prime, avec des produits terrestres, qu'il s'agisse de biens d'équipements, culturels ou des colons fraîchement régénérés. On leur posait de multiples questions sur la planète mère, et c'était pour les recrues déjà une source de nouvelles sur ce qu'ils avaient laissé derrière eux, subjectivement il y a quelques mois, mais depuis presque six ans en réalité.
Les colons quant à eux découvraient l'espace, bien qu'ils étaient pressés pour la plupart de retrouver une terre ferme. Certains savaient sur quelle planète du système ils allaient aller. D'autres étaient des aventuriers. Ils avaient toutes leurs richesses sur eux, et pour certains, ce n'était pas grand chose.
En théorie aussi, ils ne voulaient rien dépenser pour garder de quoi s'établir. Mais les entraîneuses étaient là pour les convaincre de voyager plus léger par la suite. Bref, alors qu'ils dérivaient un peu dans les brumes de l'alcool entre deux recherches d'emploi (ou d'opportunité) sur InterplaNet, elles leur vantaient leurs futures richesses pour les inciter à profiter de l'instant présent. Les plus anciennes, dont le crédit spatial s'amenuisait, recherchaient aussi celui qui pourrait leur assurer un avenir planétaire grâce à ses diplômes, ses amis déjà installés, une richesse personnelle…
Même s'ils étaient en minorité, la station étaient aux mains de ses permanents. Ceux qui y travaillaient quinze ans. Les métiers de maintenance, de sécurité, d'informatique pour le personnel spécifique d'entretien et de gestion des cylindres, des quais et des entrepôts. Il fallait compter aussi tous les employés d'entreprises, de loisirs, de commerce et le personnel d'état-major des sociétés minières. Ce ne pouvait être que des salariés. Les propriétaires des lieux avaient acheté ceux-ci dès la construction du cylindre. C'était le plus souvent des intersidérales, ces grandes sociétés qui avaient les capitaux pour investir dans l'espace plutôt que sur les planètes, où les petites entreprises étaient leurs clients. Quelques aventuriers se faisaient embaucher pour être serveur, cuistot, manœuvre en échange du gîte, du couvert et d'une paie modique, parce qu'ils espéraient mieux avec les rotations de personnels permanents. Mais la plupart se décidaient au bout d'un an ou deux à retrouver une terre ferme, ou à s'engager dans le dur travail de méthanier ou de mineur. Quelques uns trouvaient aussi des places dans les vaisseaux qui faisaient relâche au port et qui n'avaient qu'une vocation interplanétaire.
Quoiqu'il en soit, comme pour le « Sun Tzu », les cycles de vie étaient décalés afin qu'il y ait toujours un lieu où les gens ne dormaient pas et travaillaient pour recevoir les touristes.
*
* *
Le premier réflexe d'un soldat en bordée est de trouver un endroit sympa pour boire un coup.
Le quartier des loisirs n'offre que des endroits de ce type. Jean-Louis, Reno et leurs deux camarades de chambrée dépassent les premiers établissements bondés pour profiter d'un peu de calme plus loin. La Caverne de l'espace, copie modeste d'une taverne quasi homonymique, leur tend les bras. Les filles sont moins jolies mais plus disponibles. Ils s'installent donc à une table de huit, car les filles boivent avec eux mais à leurs frais. Elles n'ont pas droit à l'alcool, mais leur jus d'orange vaut aussi cher que le rhum. Comme elles touchent une commission sur chaque verre bu, et pas seulement sur leur verre. Autant dire qu'elles fixent les clients et leur font tenir un rythme assez soutenu.
Pour cela, elles ont une vie à rallonge à raconter, un panel de blagues stupides, plein de conseils utiles à donner, mais surtout des yeux langoureux, des mains caressantes, des cuisses alléchantes et des hanches accueillantes.
Elles n‘hésitent pas non plus à réchauffer les genoux de celui qui serait tenté de se lever pour quitter l'établissement. Leurs parfums capiteux et le rhum font tourner rapidement les têtes, tandis que leur poitrine semi-apparente attirent de plus en plus les regards de ceux qui cherchent un sein comme oreiller.
Deux heures qu'ils sont coincés. Alsyen s'impatiente. Il préférerait visiter plutôt que de voir ces niais boire comme des trous et se faire soutirer leur argent. Les attouchements sont de plus en plus précis même s'ils demeurent discrets. Le niveau de la discussion vole au ras de la ceinture des pâquerettes. La relève des filles arrive. Celles-ci ne sont plus censées rester dans l'établissement. Chacune essaie de se faire emmener par son client. Le groupe de huit devient trop important tandis que deux sont vraiment pressés de conclure. Jean-Louis et Reno préfèrent emmener leurs amies dîner. En échange, sympathiquement, elles leur proposent des cachets anti-ébriété afin qu'ils puissent profiter de cette soirée. L'avantage, c'est qu'ils seront dessaoulés avant la partie de jambes en l'air, alors que les deux autres vont connaître une rapide déroute. Elles sont comme ça les filles. Même les prostituées veulent être respectées. L'inconvénient, c'est que ces cachets sont interdits à la vente. En effet, ils suppriment l'ivresse mais n'empêchent pas la nocivité de l'alcool ingéré. En supprimant l'ivresse, ils permettent donc une surconsommation supérieure pour ceux qui ne savent pas s'arrêter. Reno apprécie de retrouver certaines sensations un petit quart d'heure plus tard. Alsyen sent bien d'ailleurs que les cachets n'ont pas entamé sa détermination pour des relations sexuelles prolongées multiples et variées en fin de soirée.
Élisa et Jenifer ont utilisé leur après-midi différemment. D'abord, elles sont entrées dans un institut de beauté pour profiter de masques anti-acné sur le visage, une coupe de cheveux bleue avec une mèche rose et des soins d'épilation, de manucure, de maquillage. Elles se font aussi masser et poser quelques tatouages affriolants temporaires.
Puis elles sont entrées dans quelques boutiques pour acheter bijoux et sous-vêtements. Leur combinaison spatiale devient ainsi l'écrin de voluptueuses créatures. Élisa joue avec sa nouvelle montre scarabée. L'insecte mécanique n'a que des diamants et autres pierres précieuses d'origine artificielle et les chaînes sont en plaqué or, mais de toute façon, elle ne pourra pas l'utiliser souvent sur le « Sun Tzu ». L'effet sur la population masculine dès qu'elles sortent ainsi dans les coursives est probant. Les deux coquettes ont le choix de leurs cavaliers si elles le désirent. Ce succès tourne un peu la tête d’Élisa. Tant pis pour Reno si elle ne le croise pas. Elles s'installent dans un établissement de loisirs et ne restent pas seules longtemps. Elles n'ont même pas eu à commander car deux mineurs ont décidé de tenter leur chance. Elles n'ont rien à débourser pour l'instant. Pas de chance pour Élisa Rapidement, le plus mignon des deux a trouvé l'ouverture avec Jenifer et l'autre ne la tente pas du tout. En plus, ils sont déjà légèrement saouls et particulièrement lourds dans leurs plaisanteries. Si Jenifer peut répondre à leur pitoyable humour par un rire ridicule et bien peu spontané. Élisa n'y parvient pas. On commence à se forcer à rire à table, on finit par faire semblant au lit. Tout ça pour quoi ?
Avec Reno, ce ne serait pas la même chose. Ce garçon a de fantastiques élans du cœur, et s'il est plutôt passif côté drague, c'est certainement à cause de sa timidité et de son respect pour le sexe féminin. Pas comme ce butor, qui lorsque elle fait signe à un employé pour lui demander un nouveau jus de fruits s'entend dire qu'une femme ne devrait jamais commander, même pas dans un bar.
Son doux visage s'assombrit un instant puis elle rétorque qu'on ne devrait pas laisser sortir les mineurs sans surveillance car ils ont tendance à vouloir amuser la galerie avec des blagues de niveau moins dix.
Les voilà dégrisés d'un coup. Jenifer essaie de décoincer un peu la situation avec son rire qu'une otarie reconnaîtrait pour sien, mais finalement, les deux compères les lâchent assez rapidement une fois leur verre vidé.
— Tu as raison, dit Jenifer. Il doit y en avoir de moins idiots.
Elles sortent de l'établissement car elles s'estiment grillées sur place. Mieux vaut qu'elle aillent tenter leur chance ailleurs. Elles croisent quelques gars mais aucun de l'unité de Reno et Jean-Louis qui pourrait les renseigner. Elles prennent un C'fet avec eux quand même. Il est toujours bon de se connaître avant que le futur équipage soit constitué. Pendant une bonne heure, la conversation tourne beaucoup autour de leurs aventures personnelles depuis qu'ils se sont engagés. Ils ne parlent pas de leur enfance ou de la Terre.
C'est comme s'ils étaient nés, il y a quelques mois. Encore une fois, Élisa se renfrogne car sa chère copine raconte une de ses mésaventures qu'elle aurait préféré oublier. Une histoire qui maintenant risque la suivre à travers les millions de kilomètres de l'espace. Les garçons ne risquent pas d'oublier cette histoire de la culotte impossible à changer durant une semaine de terrain parce qu'elle avait oublié au départ de mettre le linge de rechange dans son sac. De nuit, elle avait voulu la laver discrètement avec l'eau de sa gourde et du savon aux abords du bivouac. Mais c'était la nuit de l'attaque du bivouac. Elle avait donc été capturée la première et avait perdu la culotte durant la bataille. Elle n'en avait parlé à personne sur le moment et était restée fesses nues sous la combinaison durant le reste de la manœuvre, soit encore trois jours. Deux semaines plus tard, confidence à la mauvaise copine, et patatras toute la section était au courant avant la fin du cycle.
Même les gradées de la section, elle en était sûre, mais elle n'allait pas leur demander.
Cette fois, au retour sur le « Sun Tzu », l'Amiral lui-même sera au courant qu'elle est la recrue de son vaisseau école capable de perdre sa seule culotte sur le terrain.
Sa gêne lui donne de belles couleurs mais cette fois, les regards sont plus égrillards que moqueurs. En voulant se mettre en avant, Jenifer en fait n'a réussi qu'à donner une mauvaise impression d'elle-même et apporter de l'intérêt à sa copine.
Élisa en rajoute donc en disant qu'il était pour elle hors de question qu'une culotte, aussi sexy soit-elle, reste soudée sur sa propriétaire et ils prennent cela pour une invite. Certains en viennent ainsi à douter de la véracité de l'histoire qui en devient un mythe inventé par les filles pour les émoustiller.
Au final, elles repartent avec trois copains pour une petite séance de laser-game en apesanteur au centre du cylindre. Dans un espace de vingt mètres de diamètre sur quarante mètres de long avec de multiples cloisons qui protègent dans une direction mais qui laissent vulnérable dans l'autre, trois équipes de huit doivent marquer des points en blastant les équipes adverses, dans une semi-obscurité obtenue avec des lumières tamisées, traversée par des flashs violents et irréguliers. L'ambiance est survoltée par une musique obsédante, inquiétante, et rapide. Pour se déplacer, il faut utiliser son sac à dos qui permet, grâce à six jets de gaz, de progresser dans toutes les directions pour surprendre un adversaire ou échapper à des tirs.
Le corps à corps est interdit pour blaster un adversaire, mais certains binômes s'organisent. Un joueur prend un de ses camarades par la taille et s'occupe des déplacements . L'autre tire sur les autres joueurs. Ce n'est pas vraiment plus efficace pour l'équipe, mais beaucoup de binômes sont en réalité des couples, plus où moins temporaires.
Élisa se laisse faire. Le garçon est sympa et elle pense à Reno. Lui est aux anges, enfin, jusqu'au moment où il abuse de la situation pour l'embrasser dans le cou. Il reçoit un bon coup dans les côtes qui lui coupe le souffle et elle lui rappelle son rôle tout en indiquant qu'elle n'est pas rancunière en serrant son bras contre elle pour qu'il ne lâche pas sa prise (L'autre bras lui permet de les diriger par rotation du poignet dans lequel il serre le joystick de commande des gaz). À la fin du jeu, elle se retourne et l'embrasse gentiment sur la joue par surprise avec un sourire. L'honneur est sauf et ils ressortent comme les deux camarades qu'ils étaient en entrant.
*
* *
Reno et Jean-louis entrent avec leurs accompagnatrices dans le hall du casino. Il ne s'agit en fait que d'un bar, avec un dancing et des machines à sous. On y achète des jetons en nickel afin que les jack-pots soient aussi bruyants que traditionnellement. Il n'est pas besoin de jouer beaucoup pour s'amuser. En fait, la dépense maximale possible au jeu en une soirée est peu élevée. Donc, les probabilités pour perdre ne sont que légèrement supérieures à celles de gagner. Il s'agit d'un divertissement. Il est aussi possible de jouer au poker entre clients, mais seulement avec des jetons. Il y a surtout un petit numéro de music-hall d'une durée de trois quarts d'heure qui se répète toutes les trois heures. C'est ce numéro qu'ils viennent voir. Le one-man-show désopilant raconte l'histoire d'un colon un peu simplet, en manque de femme, tenté par tous les animaux de sa ferme et qui réinvente avec chaque espèce une espèce de Kamasutra improbable plutôt grivois. Il ne fait pas dans la dentelle et sert d'exutoire à tous les célibataires de la station.
Autant dire qu'à la fin, quand autour d'un verre les accompagnatrices proposent leurs prestations, leurs clients sont tentés par le forfait tout compris et plus si affinités. La fille un peu lourdaude et limite vulgaire de l'après-midi s'est transformée en ange de la nuit aux yeux de Reno et au grand désespoir d'Alsyen. C'est la vieille poule qui va plumer le pigeon.
La chambre d'hôtel n'est qu'une cabine de dix mètres carrés. Un grand lit, une apesanteur très réduite, des miroirs et des poignées pour s'accrocher partout. Avec des petits dessins aux murs pour donner des idées d'utilisation. La fille a en plus une robe très aérienne, soyeuse et quand elle se met dans le courant d'air, des petits pans se soulèvent et laissent apparaître sa peau. Des jeux de lumière envoûtants sont aussi prévus et la fille manie la télécommande des effets spéciaux avec art.
Reno entre dans la danse et Alsyen décide d'aller faire un tour. Depuis une petite demi-heure, il a un vague pressentiment.
Il décide d'en avoir le cœur net et se dirige vers les parois extérieures du cylindre.
La population du cylindre est dans son cycle nocturne tardif. Il y règne un silence relatif. C'est dans ce silence qu'Alsyen sent une présence télépathique connue. Un de ses nombreux frères est dans les parages. La liaison se cale en quelques nanosecondes.
— Alsyen ? C'est Thornott ! Comment vas tu ?
— Vous m'avez retrouvé. C'est incroyable. Je vais bien.
— Nous étions si inquiets pour toi et Glyon .
— Glyon est mort.
— Quelle tristesse !
— Une erreur de jugement regrettable. Comment avez vous fait pour me retrouver ?
— Le vaisseau est rentré sans vous, et le pilote automatique avait conservé votre lieu d'atterrissage. Il avait en plus détecté le vaisseau spatial en orbite. Grâce à la signature de sa trace radioactive, nous avons pu le suivre jusqu'ici. Nous venons te chercher.
— Non.
— Pourquoi ?
— Primo, avec les lois que j'ai enfreintes, je vais avoir de sérieux ennuis.
— Notre père arrangera ça.
— Glyon est mort. J'en suis responsable.
— Fuir n'amènera rien.
— Je sais. Mais je veux aussi rester.
— Une fois que tu seras à bord du vaisseau de guerre, nous ne pourrons plus rien pour toi.
— Il faut quand même que vous me fassiez parvenir une balise pour que vous puissiez me suivre.
— Pourquoi ?
— Nous allons partir pour un secteur de l'espace que j'ignore. Le trajet va se faire par un système de désintégration-régénération. Ils n'ont trouvé que ça pour voyager presque à la vitesse de la lumière. Là où ils vont, il y a des struves. Ils en ont capturé une. Actuellement, s'ils rencontrent cette espèce, ils sont condamnés.
— Les guerres entres espèces inférieures ne nous intéressent pas.
— Les hommes ont du potentiel. Ils ont aussi des choses à nous apprendre.
— Ce sont surtout des sauvages. Ils se font la guerre entre eux.
— Pas tous. Ils ne sont pas les enfants d'une même tribu.
— Nous n'avons pas le droit d'aider des espèces inférieures qui ont des logiques de guerre expansionnistes.
— Les hommes ne sont pas des struves. Ils ont la conscience du bien et du mal.
— Leur contact t'a perverti.
— Lis en moi. Tu verras qu'il n'en est rien.
— Tu as mangé une proie que tu as tuée.
— Pour survivre et j'ai été attaqué. Je ne pourrai mentir à mon retour. Si notre race me condamne, je le comprendrai.
— Que vas-tu faire ?
— Faire la guerre contre les struves à leur côté, mais discrètement. D'ailleurs, que l'une ou l'autre espèce gagne vous indiffère.
— Nous sommes invisibles à leur vue et à leurs radars grâce à notre écran. Combien de temps seras-tu sur cette base ?
— Je pars dans douze heures.
— Ta décision ?
— Est irrévocable. J'ai un nouveau Zymbreke et ami même s'il ne le sait pas vraiment.
— Comment t'envoyer la balise ? As-tu besoin d'autre chose ?
— Mettez la balise et un petit kit de survie d'un demi-litre au maximum dans un sac magnétique caché sous le flanc de la barge immatriculée IMZTNX248. Arrivé sur le vaisseau de guerre, j'échapperai un instant à mon Zymbreke et j'irai le récupérer.
— Bien. Bonne route mon frère.
— Nous nous reverrons peut-être. Je croyais déjà t'avoir perdu.
— Si tu changes d'avis, envoie un signal mental de détresse. Nous allons rester dans les parages jusqu'à ton embarquement.
— Merci Thornott.
— Prend soin de toi.
— Toi aussi. Et rassure nos parents. Je vais vivre autre chose que ce que la tradition avait prévu pour moi.
— Peut-être. Mais à quel prix ?
— Celui d'une vie.
Alsyen coupe la conversation. Cette échange lui a été si fort. Mais il doit renoncer à toute idée de retourner chez lui. Il ne l'a jamais exprimé jusqu'alors. Son idée de s'échapper était non seulement irréaliste, mais surtout vaine. Rien ne l'attend en dehors de Reno. Il se lie corps et âme à la cause des hommes. Par un engagement personnel, mais aussi pour le choix d'une autre vie, plus rude, plus aventureuse, plus stimulante que la vie de n'importe quel Niumi, né dans la sécurité au sein d'une espèce dominante au sommet de sa maturité intellectuelle, alliée à d'autres espèces ayant des connaissances technologiques supérieures.
« Scipion, soldat d'élite des FCP » Alsyen sourit intérieurement à cette idée. Il y a quelques temps, il l'aurait trouvée ridicule.
*
* *
Jenifer a loué une alvéole pour deux et s'y est réfugiée avec un pilote de navette, rencontré au bar après qu'elles aient pris congé de leurs camarades des FCP. Élisa a préféré finir la soirée dans son coin. Elle en veut un peu à Reno de l'avoir laissée seule. Dans son alvéole individuelle, elle est vite lassée des vidéos proposées aux clients. Il y a un Neurovid dans un compartiment mural. Tentée car frustrée, elle se résout à l'utiliser malgré les interdits. Au bout de quelques minutes, son rythme cardiaque s'est accéléré, elle respire à pleins poumons et son corps est parcouru d'agréables frissons qui petit à petit l'entraînent vers un tourbillon de délices.
*
* *
Reno a largement été à la hauteur, bien qu'il ait raison de douter de la sincérité de la fille dont le travail du soir n'a pas été désagréable mais qui a depuis longtemps oublié que le plaisir avait été créé pour deux au moins. Consciencieuse, elle a initié Reno a quelques pratiques qui pourront lui servir plus tard, et lui a fait profiter de sensations inédites pour un jeunot. C'est un type bien sur tout rapport, pourrait plaisanter une amante conquise devant ses parents.
Reno se réveille et constate l'absence de la fille. Il allume sa lampe de chevet, se lève, vérifie ses quelques affaires. Tout est là. Rassuré, il se recouche, non sans avoir eu un regard affectueux pour Alsyen, revenu depuis peu, et qu'il a réveillé à s'agiter ainsi. Il éteint la lampe mais cette fois Morphée l'ignore. Reno cogite dans l'obscurité. Il comprend vite ce que d'autres essaieront d'ignorer toute leur vie. En s'engageant, il a aussi laissé l'amour vrai derrière lui. L'amour a besoin de stabilité pour s'épanouir. Il n'a aucun avenir à proposer à ses rencontres. C'est la solitude au pied de son lit maintenant froid qui s'offre à lui. Son cœur se glace. L'amour, jamais, mais cela ne nuira pas au sexe. Néanmoins, Reno ne peut s'empêcher de penser à sa famille. Avec les décalages dus aux transferts, ce sont peut-être les arrière-arrière-petits enfants de son frère qui recevront la nouvelle de sa mort. Il ne les reverra pas. Aucun. Sur Bêta prime, il y aura environ six mois de courrier, de courrier déjà vieux de plus de cinq ans.
Il se promet ces jours prochains de leur demander d'envoyer régulièrement des photos, des petits films. Il se promet de leur écrire à tous qu'il les aime. Il ne va leur donner que des bonnes nouvelles, comme quoi il a bien réussi, qu'il a une belle vie, et qu'il ne les oublie pas pour autant. Lui aussi va prendre quelques photos. Il regrette de ne pas y avoir pensé sur Bêta 006. Il va leur présenter Scipion…
Alsyen sentant qu'on pense à lui se connecte sur Reno et peut suivre l'évolution de ses états d'âmes. Lui ne fait pas tout à fait les mêmes sacrifices car sa race possède une très longue longévité.
De plus, ses parents sont encore très jeunes, et un long transfert par les méthodes des humains ne lui fera pas perdre la même chose. Néanmoins, lui aussi vient de choisir de s'éloigner de son foyer et il apprécie que Reno voit en lui une présence agréable, même si c'est un amour pour un camarade de jeu du niveau animal de compagnie.
Reno repense à ce qu'il attend. Solitaire, il sent bien que sans ami, il risque devenir fou. De l'autre, il est vrai que les divertissements d'un soldat en bordée sont plutôt limités. Il se remémore toutes ses expériences qu'il a déjà vécues. Depuis Bêta 112, ce n'est plus aussi subi qu'au départ. Il commence à aimer l'aventure et le dépassement de soi. Jamais sur terre, il n'aurait pu faire tout ce qu'il a fait : plongée, parachutisme, raids…dans des conditions extrêmes. Et puis, l'espace est assez envoûtant, il rencontre des gens hors du commun terrestre. De toute façon, hors période de crise, rien ne l'empêche de terminer un contrat et de devenir colon pour fonder une famille tant qu'il en est encore temps.
Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le temps passe si vite et qu'un jour, on peut rester prisonnier du choix de ses vingts ans.
*
* *
Reno et Jean-Louis se racontent leur nuit d'enfer dans un bar sans accompagnatrice. Entre garçons, ils rient de jour de ce qu'ils faisaient le plus sérieusement du monde la nuit. Ils sont fatigués et ont pris quelques cachets autorisés pour soulager leur foie. Ils boivent du thé froid, meilleur pour leur santé.
Jenifer et Élisa sont entre filles. Elles sont plutôt nature ce matin et ont les traits tirés. Élisa n'ose pas parler de sa nuit alors que Jenifer est plus diserte. Elle vont retourner se faire refaire une beauté, puis elles mangeront un peu plus gastronomique qu'à l'ordinaire. Ça les changera des menus du « Sun Tzu ».
Les cadres du « Sun Tzu » ont organisé un repas commun dans un établissement de loisirs spécialement loué pour l'occasion. Pas d'accompagnatrices au menu. L'Amiral à l'issue de la formation veut féliciter et remotiver ses troupes. Il a aussi des infos à partager. Erick Dombass et quelques vétérans sont arrivés en avance pour s'occuper de la sécurité et s'assurer que l'intendance suit pour que tout soit prêt à l'heure.
Sur Bêta 069, à part quelques volontaires qui en ont bien profité la veille et qui sont de quart sur le « Sun Tzu », l'ensemble de l'équipage compte bien profiter de ce dernier cycle de détente avant le départ pour le cercle extérieur.
À l'heure de l'apéritif, sacré en vacances, Reno et Jean-Louis ont fini leurs emplettes. Pour se dérouiller, Reno propose à Jean-Louis un petit jeu vidéo. Une cabine pour devenir « Chasseur de l'espace » est libre. Reno s'y introduit avec Alsyen, ajuste son siège, son tableau de bord, sa configuration et attaque le niveau un.
*
* *
Jenifer et Élisa rient de leur crédulité. Elles ont commandé des mets savoureux à des prix tout à fait corrects. Le serveur vient de leur ramener de la nourriture synthétique. Elles vont donc manger du poisson, du crabe, des fruits de mer, de la grenouille, du rhinocéros laineux, des champignons, du caviar, du foie gras, mais aussi des légumes sous forme de petits carrés ou de boulettes arrosés de sauces colorées aux arômes artificiels.
La présentation est très artistique et la consistance agréable à mâcher. Certains cubes sont fourrés avec des goûts nouveaux qui éclatent sous le palais. Finalement, c'est excellent. Chaque bouchée est raffinée et la gastronomie spatiale est concurrentielle des méthodes plus traditionnelles qu'elles ont connues sur terre. C'est quand même bien meilleur que les beignets frits synthétiques, les sandwichs, les biscuits et les ersatz douteux qu'elles ont testé la veille entre deux verres.
*
* *
Les cadres du « Sun Tzu » ont aussi ce genre de plats au menu, arrosés néanmoins de vins naturels. L'ambiance est bonne mais la mine de l'Amiral est grave et personne n'ose lui demander pourquoi. Il n'a rien dit dans son discours de bienvenue, sinon « Amusez-vous ». Tant qu'il sera là, personne ne se permettra de s'absenter et d'aller se divertir ailleurs. Les vétérans chantent quelques chansons, tantôt paillardes, tantôt traditionnelles. Il y est question de filles qu'on a quittées, de Madelons, comme de mères maquerelles. Il y a aussi des chansons sur les vaisseaux qui ont mystérieusement disparus, les planètes qui ont coûté la vie à bien des camarades, l'enthousiasme des jeunes qui partent droit devant sans espoir de retour mais le plus loin possible… Il y a de la gaîté, mais aussi de l'émotion, de la nostalgie, du mystère. Les cadres se mêlent à leurs chants quand ils en connaissent les paroles. Il y a aussi des chansons du folklore colon. L'histoire de cette femme qui part cinq ans après en espérant retrouver son mari riche. Mais c'est un estropié des mines et il mendie à la sortie des établissement de loisir. Elle devient accompagnatrice et le rejoint chaque nuit, après son dernier client.
L'Amiral reçoit un appel du « Sun Tzu ». Il demande à ce qu'on active l'écran géant de la salle.
Le sergent Coll reconnaît Reno dans une petite incrustation en bas à droite.
Le reste de l'écran est occupé par un spectacle dantesque. En bas, on peut lire que ce joueur depuis quatre heures, repousse les hordes ennemies avec brio et qu'il est détenteur du meilleur score de B-069 depuis un quart d'heure.
Reno joue sur un simulateur de chasseur conforme avec une future réalité. Il n'est en effet pas encore construit et les ingénieurs s'inspirent des modifications que les joueurs font subir à l'ergonomie de l'habitacle et à des paramètres tels que l'écartement des réacteurs, les commandes du chasseur, le placement des canons sur les ailes latérales. Reno, fortement inspiré par Alsyen, a choisi une configuration très efficace. En cours de jeu, en fonction de la mission, il a réalisé trois type de chasseurs basés sur le même réacteur et un noyau dur de la carcasse. Les ingénieurs en sont assez estomaqués. Ce type doit avoir la chasse dans le sang.
La maniabilité du petit chasseur semble parfaite à l'écran, mais le pilote d'essai sur le « Sun Tzu » qui le teste sur le même logiciel ne parvient pas à le maîtriser. Sauf en durcissant les commandes, ce qui en limite l'efficacité. Mais c'est une piste. Chaque pilote devra pouvoir régler ses paramètres et enregistrer sa config sur chaque chasseur ou avoir une sauvegarde sur lui à l'embarquement.
En cours de jeu, le niveau de force des adversaires augmente. Au départ égal au tiers des performances d'un chasseur classique, il en est actuellement à cinq fois plus et ils ont adopté une logique de groupe pour traquer un chasseur isolé.
Reno est obligé de tirer sur ses ennemis tout en ayant lui-même une trajectoire désordonnée. Il lui faut en même temps supprimer les missiles fire and forget qui sont attirés par la chaleur de ses réacteurs. Enfin, il doit envoyer le maximum de coups au but sur un vaisseau spatial ennemi gigantesque avec des zones sensibles en évitant le tir de ses canons de proximité. Chaque seconde de survie semble un miracle, car il compose avec une trentaine de départ de coup toutes les cinq secondes sous des angles et des distances différentes. Il a un aileron noirci à son extrémité, et des traces de brûlure sur la carrosserie, vestiges d'une explosion un peu trop proche. Dans la salle, chaque ennemi abattu suscite des applaudissements et des cris de joie, d'encouragement et d'admiration. Soudain, une vague de nouveaux chasseurs apparaît. Ils sont plus d'une centaine. Les gens sifflent. C'est de la triche. À l'écran, les chasseurs qui harcelaient Reno se sont enfuis.
La réaction de Reno ne se fait pas attendre. Il se dirige vers le vaisseau géant, objet de la mission et le bombarde au maximum. Le jeu s'arrête alors. Il a eu la bonne réaction en ne se précipitant pas au devant des chasseurs contre lesquels il n'avait aucune chance et a choisi ce qui pouvait être le plus efficace contre l'ennemi.
Au restaurant, Élisa a pu voir Reno elle aussi. D'abord surprise, elle a ensuite éprouvé une vive sensation de désir pour le retrouver. Elle a suivi la retransmission jusqu'au bout. Il y avait en incrustation le nom de l'établissement propriétaire de la cabine de jeu publique. Il n'est qu'à cinq cylindres. Jenifer ne veut pas y aller. Elle ne comprend pas l'obstination de sa copine et a rendez-vous avec sa connaissance de la veille.
Élisa part donc seule. Elle ne remarque pas deux hommes qui se lèvent pour la suivre.
Reno ressort après quatre heures et demi de jeu, complètement épuisé. Il ne comprend qu'il a fait le spectacle qu'au nombre de clients qui entourent la cabine et l'acclament. Après avoir serré quelques mains, bu quelques verres, le nombre d'inconnus qui veulent le féliciter diminue et il peut enfin manger tranquille avec Jean-Louis. Le patron lui sert ce qu'il a de meilleur. Dans la cabine, d'autres joueurs se succèdent en testant les configurations qu'il a enregistrées. Alsyen sourit intérieurement. Ce premier coup de pouce à la technologie humaine peut être décisif.
*
* *
La fin du repas cohésion approche. L'Amiral demande la parole. Il a appris une nouvelle importante qui concerne tout le monde sur le « Sun Tzu ». Il n'y aura pas de choix d'orientation à Bêta prime. À part les « échecs physiques », tout le monde partira pour le cercle extérieur. Les cadres pourront envoyer des messages aux membres de leurs familles encore vivants sur terre avant le départ. Les recrues ne doivent pas être au courant avant le rembarquement sur le « Sun Tzu » pour éviter les désertions en plus grand nombre que la simple évaporation classique.
Les supputations vont bon train mais l'Amiral ne donne pas plus de détails. Les cadres comprennent que la situation est exceptionnelle et qu'ils n'en sauront pas plus. L'Amiral a déjà eu beaucoup de confiance en eux pour les prévenir afin qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps. Ils en sont reconnaissants bien qu'inquiets.
*
* *
Quand Élisa arrive au restaurant, elle peut voir Reno bien entouré. Il embrasse une brune ténébreuse et ne s'interrompt pas en l'apercevant.
Elle s'approche et il reste totalement de marbre à son dépit qu'elle masque au maximum. Alsyen est intrigué. Élisa est parcourue à la fois de rage, de colère mais aussi de désirs sexuels qui ne lui ressemblent pas. Surtout, il reconnaît la brûlure psychique d'un Neurovid sur son hémisphère gauche. Il est aussi alerté par les deux hommes qui viennent d'entrer et qui observent Élisa. Ils la suivent comme une proie. Ils ont de sales intentions envers elle. Quand Élisa décide de fuir en courant un Reno qui la dégoûte, ils s'écartent puis lui emboîtent le pas. Reno regarde Jean-Louis, interrogateur. Aucun des deux n'y a rien compris. Reno se consacre à nouveau à l'accompagnatrice. Alsyen décide d'agir. Il se sent coupable de ce qui se passe à cinquante mètres de là. Ils l'ont rattrapée. L'un d'eux vient de lui coller un disque sur la tempe qui à le même effet qu'un Neurovid. Elle ne résiste pas. Alsyen rend en vitesse à Reno les sentiments qu'il a éprouvés pour elle quelques jours auparavant, et active tous ses indicateurs de danger. Le jeune homme se précipite alors à son tour vers la sortie et Alsyen lui suggère la bonne direction. Jean-Louis ne suit pas immédiatement. Il passe d'abord à la caisse.
Reno s'engouffre dans une travée sombre d'entretien, perpendiculaire aux larges couloirs de promenade. Il aperçoit les deux ombres qui enserrent une troisième plus petite. Ils sont en train de lui ôter sa combinaison de soldat. Ils ont pour elle une combinaison d'agent de service. Alsyen charge Reno de rage afin qu'il attaque sans poser de question. Les séances d'entraînement font merveille. Reno se débarrasse en moins de vingt secondes de son premier adversaire par un fort coup de pied au plexus, heureusement amorti par les bras de celui-ci qui s'était mis en garde.
Il en reste choqué et évanoui, mais il s'en réveillera. L'autre sort une lame, abandonnant sa victime pantelante qui choit sur le sol comme un sac vide. Reno esquive une fois, deux fois puis parvient à saisir le poignet du truand, le brise sans pitié, tord le bras, lui déboîte l'épaule. L'homme crie. Reno le fait taire d'un coup à la tête, porté avec le pied mais mesuré cette fois.
Puis il s'occupe d’Élisa. Elle pleure doucement, tandis qu'Alsyen lui administre les premiers soins psychiques. Ses lèvres tremblent mais ne parviennent pas à articuler. Reno rajuste sa combinaison alors qu'elle est encore à terre. Puis il la lève, passe son bras au dessus de son cou en maintenant sa main et la soutient avec son autre bras passé derrière son dos et sous son aisselle. Elle s'abandonne contre lui, à moitié évanouie, marchant comme un zombie. Une fois retournés au couloir central, ils retrouvent Jean-Louis.
— Nous allons nous coucher. Elle a besoin de repos, dit Reno.
— Et bien bonne nuit. T'inquiète pas pour moi. Ta brune là-bas m'a dit de revenir si je ne te retrouvais pas.
— Amuse-toi bien !
— J'y compte.
— Ne t'inquiète pas pour Élisa Elle a l'air d'aller mieux.
— Je ne m'inquiétais pas. Prends en soin. Je la trouve quand même un peu pâlichonne.
— Je n'y manquerai pas.
Une enseigne lumineuse accueille Reno, qui doit négocier avec le patron qui ne veut pas d'un animal comme Alsyen dans ses chambres-alvéoles. Cela lui vaut une rallonge mais il peut enfin poser Élisa qui s'endort comme une masse. Alsyen décide qu'il en a assez fait et de ne pas remodifier les psychés des deux jeunes tourtereaux.
De toute façon, ce n'est pas encore ce soir qu'ils vont pouvoir consommer. Reno sait qu’Élisa ne lui en voudra pas et ose alors la déshabiller pour la glisser dans le lit. Mais il la contemple un instant, dans ses magnifiques sous-vêtements, avec ses tatouages dont un petit cœur, au dessus du sein gauche. Il la recouvre ensuite tendrement avec le drap et embrasse sa joue avant de se préparer lui même pour dormir à son côté.
— Mince,pense t-il amusé, elle est sur mon côté habituel.Déchirements
Le « Sun Tzu » est amarré à la station Bêta Prime. Reno effectue avec le sergent Coll toutes les dernières réintégrations de la section. Les recrues ne peuvent conserver que quatre kilos d'effets personnels et une seule tenue, celle qu'ils portent, avant le départ pour le transmetteur.
Les quatre kilos iront dans la « soute à bagage » tandis qu'eux se présenteront quasi nus pour le voyage. Alsyen a eu un mal fou à dispatcher ses propres bagages que lui a procuré son frère entre les affaires de Reno et celles de quelques uns de ses camarades.
Durant le voyage entre B-069 et Bêta Prime, ils n'ont cessé de récurer et remettre en état le vaisseau. La tension était parfois à son comble et quelques bagarres ont éclaté ici ou là. Certains se voyaient déjà recalés. D'autres réglaient des comptes avant de perdre de vue certains mauvais camarades. Et puis surtout, il y avait cette incertitude et personne ne devait rester inactif pour y penser.
Autre moment important. Ils ont tous écrit du courrier qu'ils vont pouvoir physiquement envoyer à leurs familles. Ils vont surtout en recevoir. Le lien avec la Terre commence à peser sur leur moral alors qu'ils vont encore plus le distendre avec le prochain départ.
Une nuit, Reno a pu revoir Élisa. Alsyen a utilisé le même stratagème que la fois dernière. Une petite demi-heure seulement mais ils ont pu se dire au revoir. Ils espèrent tout deux être sélectionnés, mais il est vrai que les résultats d’Élisa, si on en croit ce qu'elle en pense, ne doivent guère être brillants. Reno lui pense toujours que Caubard lui en veut. Il n'est donc pas sûr de ne pas avoir quelque part une mauvaise note éliminatoire. Ils regrettent de s'être ainsi manqués sur B-069. Reno ne comprend pas cette amnésie, tandis qu’Élisa fait mine de le croire.
Néanmoins, elle doit à Reno de ne pas être prisonnière de sadiques ou d'un rade clandestin sur B-069. Alsyen a d'ailleurs profité de cette entrevue pour soigner encore quelques pulsions latentes dues au Neurovid, mais il n'a pas osé trop y toucher non plus car l'amoureuse était en proie à de fortes émotions même si elle en laissait peu paraître à son compagnon plus fataliste. Les deux jeunes gens se sont quand même un peu découverts sur B-069 au réveil, contrairement à celui de B-006. Mais aucun n'a osé exprimer de sentiments durables à l'autre.
Puis c'est le débarquement, par une porte étanche donnant sur un tunnel souple vers la base qui surplombe les aires de transit vers les transmetteurs. Un autre équipage, d'autres recrues vont bientôt embarquer et faire le même voyage.
Ils rejoignent en silence de grands hangars où ils sont réunis à plus de cent. C'est dur pour eux de quitter ce vaisseau qui était quasiment leur nouvelle maison. Reno est appelé, avec quelques autres. Tous en sont dépités. Ils vont rater la remise du courrier. Ils sont même assez abattus. Reno glisse un « au revoir » à Jean-Louis. Il pense faire partie des exclus. C'est évident. Les deux camarades se séparent avec émotion. Si c'est le cas, ils ne se reverront sans doute jamais.
Ils sont conduits dans une grande salle, où les attendent les vétérans. Il y règne une bonne ambiance. L'Amiral doit les recevoir. Dombass se dirige vers Reno et Alsyen. Reno se met à rêver d'une promotion finalement. Un peu de C'Fet, quelques biscuits et son moral remonte. Il remarque cependant que les recrues qui passent chez l'Amiral ne réapparaissent pas…
Lorsque son tour vient, Dombass conserve Alsyen avec lui en souriant. « Je te le rends tout à l'heure ». Alsyen sent de la tristesse chez Dombass, mais il ne ment pas.
Il en est intrigué. Reno s'éloigne, se remémorant in petto la manière de se présenter dans le bureau d'un amiral. Pas de mouvement brusque surtout, car l'apesanteur peut jouer des tours. Reno aperçoit le voyant au-dessus de la porte passer du rouge au vert, il peut entrer, referme la porte, fait face à l'Amiral qui ne le laisse pas parler.
— Asseyez-vous mon garçon, nous avons des choses à nous dire.
— À vos ordres Monsieur.
— Je suis très satisfait de vos résultats. Je pense que vous êtes une excellente recrue. J'espère que vous êtes toujours volontaire pour partir avec nous vers le cercle extérieur.
— Oui Monsieur.
— Vous vous êtes engagé il y a aujourd'hui presque sept ans. Vous avez passés trois mois de formation en Sibérie.
— Oui Monsieur.
— Un bon souvenir ?
— Pas tout à fait Monsieur.
— C'est un peu fait exprès. Nous décourageons ainsi tout ceux qui n'auraient pas l'étoffe pour entreprendre le grand voyage. Et puis, si on pense à la Terre, en se rappelant ce passage, c'est quelque chose qui vous rend heureux d'être là où vous êtes. Néanmoins, avec le temps, même la Sibérie finira par vous manquer.
— Je ne pense pas Monsieur.
— Vous verrez bien. Ensuite, vous avez intégré la section Caubard. Des débuts laborieux.
— J'ai changé Monsieur.
— Oui, énormément en fait. Il semble que la présence d'un compagnon vous a aidé à vous réaliser, puis à vous aider à aller vers les autres. De là, une amélioration de votre mental et …un désir d'apprendre. Très fort.
— C'est venu tout seul Monsieur. Je n'ai jamais réussi à apprendre ainsi avant.
— Votre environnement d'alors ne s'y prêtait peut-être pas. Quoi qu'il en soit les résultats sont là, et je vous promets un bel avenir. Malheureusement, ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir mon garçon.
— ... ?
— Durant ces six ans, les choses ont changé sur Terre, et il y a un mois, nous avons appris que votre mère était morte quelques mois après votre départ pour le Cercle Bêta. J'en suis fortement peiné pour vous.
La vue de Reno se trouble. Il ferme ses yeux humides et garde la gorge serrée. Il ne veut pas montrer sa douleur à l'amiral.
— Vous pouvez sortir mon garçon. Un de vos camarades vous attend avec votre courrier. Je suis désolé d'avoir eu à vous apprendre cette nouvelle. Mais nous n'avons pas voulu que vous l'appreniez par un courrier vieux de six ans. Reno sort. L'amiral appuie sur un bouton, pour prévenir d'aller chercher le suivant. Il en profite pour sortir une bouteille du tiroir de son bureau et boit une gorgée d'alcool. Bon sang, qu'il déteste ce boulot aujourd'hui. Il parcourt la fiche du suivant…
Dombass est là, avec le courrier et Alsyen. D'emblée, celui-ci peut lire toute sa peine. Dans un premier réflexe, il va pour atténuer celle-ci mais se ravise. Il est des expériences indispensables dans la vie d'un homme. Nul n'a le droit de les lui confisquer. Dombass prend Reno par l'épaule.
— Voilà ton courrier. Tu as peu de temps pour le lire même si tu vas le retrouver à notre « gare » d'arrivée. Courage camarade. Si tu veux parler, je lis mon courrier à tes côtés.
— Ça va aller, articule tant bien que mal Reno.
Dans cette grande salle, ils sont bien peu nombreux à s'isoler de part et d'autre, seuls avec leur chagrin. Parfois, un courrier plus gai leur arrache un vilain sourire, vite effacé. Quelques soupirs, peu de pleurs déchirent parfois un froid silence.
Quand Reno a fini de lire et relire son courrier, de revivre sous la plume de son père, son frère et ses deux sœurs de douloureux moments, comme quelques bons, il a encore une bonne heure avant de rejoindre les salles de départ. Il lit alors une des lettres qu'il a mises à l'écart. Une seule. Des lettres de sa mère, il ne lit que la dernière. Il se sent coupable de tout cet amour qu'une dernière fois elle lui prodigue, lui cachant ses douleurs dues à la maladie, taisant sa souffrance de le savoir si loin pour mieux l'encourager à aller de l'avant.
Il ferme les yeux, pense à la Terre. La vie y continue, mais le temps qu'il y retourne si finalement il rentre, plus de douze ans se seront écoulés entre son arrivée et la mort de sa mère. Si cela se trouve, il y aura encore de mauvaises nouvelles, mais sinon, ils ne seront plus en deuil depuis longtemps.
Quand il arrivera sur le cercle extérieur, il recevra des lettres qui dateront de un an et quelques mois après son départ terrestre, mais en fait, elle dateront de trente-quatre ans pour ceux qui les ont envoyées. Quand il les recevra, d'autres seront morts mais il lui faudra encore quelques années avant de l'apprendre. Le courrier qu'il vient d'envoyer pour la terre arrivera dans six ans, et il n'en recevra une réponse éventuelle que dans douze ans de son temps à lui, sauf s'il voyage sous forme dématérialisée dans cet intervalle. Un vrai casse-tête.
Il écrit donc quelques lignes pour rassurer sur son sort, pour les assurer de son amour familial et pour leur souhaiter une vie heureuse, en espérant toujours recevoir des nouvelles même si elles dateront un peu, car pour lui, ils sont à jamais dans son cœur.
Alsyen soupire un peu lui aussi. Il doit manquer aux siens. A-t-il pris la bonne décision ?
Dombass les tire de leur réflexion. « Il faut y aller ». Reno ose poser une question qui lui brûle les lèvres. Reverra t-il Jean-Louis, et puis une fille appelée Eli…
— Tu vas revoir tout le monde. Nous avons besoin de vous tous dans les FCP.
Faire la queue, puis se déshabiller dans une des multiples cabines, enfiler une sorte de sac plastique noir pour se couvrir. Reno sent l'aiguille de l'infirmière s'enfoncer dans son bras. Il pense à Élisa, caresse le poil d'Alsyen. Puis on l'allonge sur une civière. Il est amené dans la salle de transit occupée par des centaines de lits. Il ne reconnaît personne. À côté, Alsyen plus petit s'est déjà endormi. Reno rêve déjà d'aventures plus extraordinaires encore. Et les ténèbres froides se referment sur lui.À suivre...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Histoire de la puissance américaine
Cilou

Introduction
Au XX e s la première puissance mondiale n’est plus l’Angleterre mais devient les Etats-Unis. Les deux guerres mondiales puis la guerre froide ont renforcé l’économie américaine au point d’être qualifiée de superpuissance voire d’hyper puissance à la fin du XX e siècle. La notion de puissance était liée au territoire, aux domaines militaires et économiques, le« Hard power ». Pour être une puissance complète, un Etat doit avoir également une influence culturelle et idéologique, un « Soft power », pouvoir d’attractivité sans usage de la force. Comment la notion de puissance est née aux Etats-Unis au début du XX e siècle puis s’est affirmée tout au long du XXe siècle ?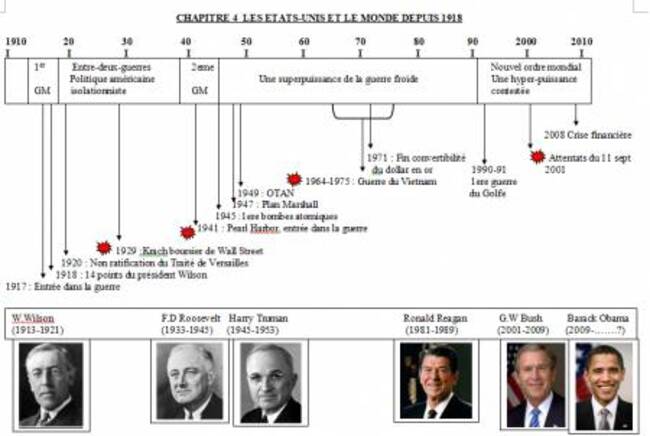
I – Un rôle mondial mal assumé dans la 1ere moitié du XXe siècle
1) Une politique théoriquement isolationniste
Les Etats-Unis deviennent la première puissance économique au début du XX e siècle. Contexte : 2e révolution industrielle (pétrole, électricité, chimie), nouvelles méthodes de travail : le fordisme. Les américains sont convaincus d’avoir une « Destinée Manifeste » = la mission de diffuser le progrès et les valeurs démocratiques jugées supérieures.
Pourtant depuis le XIX e siècle, la Doctrine Monroe (1823) partageait le monde en deux puissances : européenne et américaine. Chaque puissance avait sa sphère d’influence sans que l’autre n’y intervienne : les empires coloniaux pour l’Europe et le continent américain pour les Etats-Unis.
Caricature américaine de F.Victor Gillam, 1896
Les monarques européens se heurtent au panneau américain « défense d’entrer. L’Amérique aux américains. Signé l’Oncle Sam »
La doctrine Monroe explique pourquoi la politique étrangère américaine avait une tradition isolationniste ne se sentant pas concernés pas les affaires européennes. Toutefois l’isolationnisme américain fut théorique. Lorsque qu’il considère que ses intérêts sont en jeu, le pays intervient militairement ou économiquement.
Par exemple les Etats-Unis interviennent sur le reste du continent américain, en Amérique centrale et latine « leur chasse gardée. ». C’est la politique du « big stick » ou gros baton du président Théodore Roosevelt au début du XX e siècle lorsque le pays intervient par exemple dans les Caraïbes et dans le Pacifique. (pour contrôler d’anciennes colonies espagnoles, contrôler le Panama…). Les Etats-Unis y installent des bases navales et se forgent l’image « de gendarme international ».
Caricature de W.A Rogers, 1904
Autre exemple, les Etats-Unis interviennent tardivement dans la première guerre mondiale en 1917 pour défendre leurs intérêts commerciaux touchés par les sous-marins allemands en Atlantique. C’est le président américain Wilson qui convainc le Congrès d’intervenir. La puissance économique américaine fut déterminante pour remporter la guerre.

Wilson prépare la paix en présentant ses « 14 points » au Congrès, points qualifiés d’idéalisme wilsonien. Il s’agit de transposer à l’échelle mondiale les fondements de la démocratie américaine en les énonçant comme des valeurs universelles : libéralisme commercial, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sécurité collective…. Les principes de Wilson inspirent la signature de paix du traité de Versailles en 1919 et la fondation de la SDN Société des Nations (ancêtre de l’ONU).
Pourtant c’est un échec pour le démocrate Wilson car le Sénat américain composé d’une majorité de Républicains, refuse de ratifier la SDN ainsi que le Traité de Versailles. L’opinion publique américaine pacifiste n’est pas prête à assumer un rôle international, le pays reste de tradition isolationniste.
2) America First dans les années 20 et 30
Après les pertes et le coût de la première guerre mondiale les Etats-Unis mènent de nouveau une politique isolationniste : lois de neutralité, quotas à l’immigration, protectionnisme…Le slogan « Ameria first » ou Amérique d’abord résume ce repli. Mais de nouveau cet isolationnisme est plus théorique que réel. En réalité le pays intervient indirectement par le commerce et la finance.
La première guerre mondiale a renforcé la puissance des Etats-Unis qui est la première puissance financière, en 1919. Les Etats-Unis possédaient 45 % du stock d’or mondial. New-York devient la première place boursière du monde et le dollar était la seule monnaie convertible en or. Ils interviennent en Europe par la « diplomatie du dollar » : créanciers des pays à reconstruire particulièrement de l’Allemagne afin qu’elle puisse rembourser les réparations à la France et l’Angleterre et qu’à leur tour ces derniers remboursent leurs dettes de guerre aux Etats-Unis.
Le krach boursier de Wall Street d’octobre 1929 qui entraine la première crise mondiale du capitalisme prouve combien l’économie américaine est déjà puissante et influente. En conséquence les américains se replient dans l’isolationnisme :
- isolationnisme économique : protectionnisme de l’économie américaine en taxant les produits étrangers, rapatriement des capitaux d’Europe notamment ceux prêtés à l’Allemagne.
- Isolationnisme politique : Les EU ne veulent pas intervenir face à la montée de l’extrême en Europe. Ils votent des « lois de neutralité » qui interdit la vente d’armes ou des prêts aux pays en guerre.
En réalité la crise des années 30 n’empêche pas l’essor du modèle américain. C’est le pays de la modernité dont l’Europe imite le mode de vie ou « American Way of Life ». L’attractivité et la diffusion du modèle culturel est qualifié de « Soft Power » :
- le cinéma hollywoodien
- les automobiles fabriquées dans les usines Ford
- le premier pôle d’immigration au monde
En Europe déjà on craint le déclin du vieux continent face à la modernité américaine.
II – Une puissance assumée depuis la seconde guerre mondiale
1) De l’isolationnisme à l’interventionnisme en 1941
Sous la présidence de F. D Roosevelt, les Etats-Unis poursuivent leur tradition isolationniste au début de la seconde guerre mondiale. L’opinion publique ne veut pas d’une nouvelle guerre, le pays reste neutre. Mais à partir de 1941 le pays intervient indirectement par la loi Prêt Bail qui autorise le Président à prêter des armements aux pays dont la défense est nécessaire à la sécurité des Etats-Unis. Aide ainsi à l’Angleterre et l’URSS afin de continuer la guerre contre Hitler.
Les Etats-Unis entrent directement en guerre à partir du 7 décembre 1941 suite à l’attaque surprise des japonais contre leurs bases militaires de Pearl Harbor à Hawaï. La guerre est une menace pour le modèle libéral et pour le libre échange commercial notamment en Asie Pacifique.
L’engagement devient alors total, en 1942 le président Roosevelt fait adopter le «Victory Program », selon son expression le pays devient « l’Arsenal des démocraties ». Les affiches de propagande « More production » montrent que la productivité industrielle américaine est au service du V, la victoire des démocraties sur les dictatures. Cette aide assure aux Alliés une supériorité militaire écrasante et décisive : reconquête du Pacifique, débarquement puis Libération en Europe.

La guerre totale nécessite une aide dans tous les domaines :
- mobilisation financière : prêts financiers
- mobilisation humaine : 16 millions de soldats américains engagés
- mobilisation économique : Victory Program
- mobilisation des esprits : films, musique, propagande…
- mobilisation scientifique : ex Projet Manhattan de la bombe A largués sur le Japon le 6 et 9 août 1945.
2) 1945 : le triomphe des Etats-Unis
Au sortir de la guerre, la puissance des Etats-Unis est sans précédent. C’est une puissance dans tous les domaines ou « superpuissance ». D’autant que leur territoire est intact alors que l’Europe doit se reconstruire. Pour la première fois l’influence politique des Etats-Unis est à l’image de leur puissance économique : une puissance d’influence mondiale.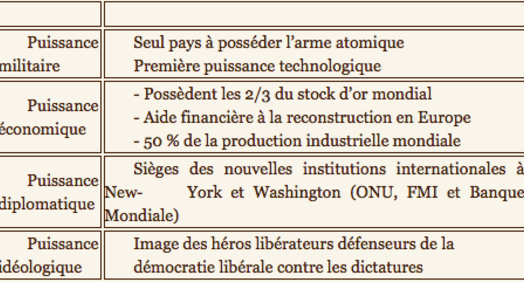
Durant la guerre, Roosevelt préparait déjà l’après guerre en signant avec Churchill la Charte de l’Atlantique le 14 août 1941. Cette Charte reprenait les principes énoncés par le président Wilson 20 ans plus tôt : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, liberté de navigation sur les mers…Ce sont ces mêmes principes qui dictent ceux de la paix et de l’ONU de 1945, un nouvel ordre mondial organisé autour des EU, une gouvernance mondiale.
Accords de Bretton Woods organisés aux Etats-Unis en 1944 tentent de recréer un SMI ou système monétaire international stable.
- le dollar est la seule monnaie convertible en or car seule économie solide
- création du FMI et de la Banque Mondiale. Le FMI contrôle la parité fixe des monnaies par rapport au dollar et aide les pays en crise financière. Le FMI siège à Washington et était financé à 31 % par les Etats-Unis.
La conférence de Yalta qui règle la fin du conflit en 1945 prouve cette puissance Américaine incontournable. Sur les photographies, Roosevelt tient une place centrale entre Staline et Churchill. Ce sont les puissances qui décident du sort de l’après guerre. Le droit des peuples à disposer d’eux même annonce la prévision d’élections libres en Europe.
Conférence de San Francisco le 26 juin 1945 fonde l’ONU qui siège depuis à New-York. Signés en 1945 par 51 Etats.
1947 Signature des Accords du GATT accords sur le commerce mondial (actuel OMC) afin de libéraliser les échanges mondiaux en baissant les taxes douanières.
3) Une superpuissance durant la guerre froide
Les Etats-Unis triomphants en 1945 deviennent l’une des deux superpuissances du monde bipolaire durant la guerre froide. (1947-1989).
La Grande Alliance se rompt entre les Alliés, l’URSS considérant que les Accords de Bretton Woods servent l’impérialisme américain. La guerre froide débute officiellement en 1947 par deux doctrines idéologiques : Doctrine Truman anticommuniste contre Doctrine Jdanov anti impérialiste. La doctrine Truman est une politique du « containment » ou d’endiguement c’est-à-dire une politique extérieure visant à contenir la propagation du communisme dans le monde.Le monde s’organise en blocs par le jeu des alliances. Les EU signent des alliances militaires ainsi que des aides financières avec les pays pro américains. Ils installent des bases militaires sur toutes les mers et tous les continents afin de défendre le monde libre. Ils signent des alliances militaires avec tous les continents c’est la pactomania. Ex L’OTAN de 1949 avec l’Europe occidentale et le Canada, le Pacte de Bagdad au Moyen Orient pour s’assurer l’approvisionnement en pétrole, la lutte contre les régimes communistes en Amérique latine, la démocratisation libérale au Japon…
En Europe occidentale l’alliance militaire s’accompagne de l’aide financière du Plan Marshall de1947.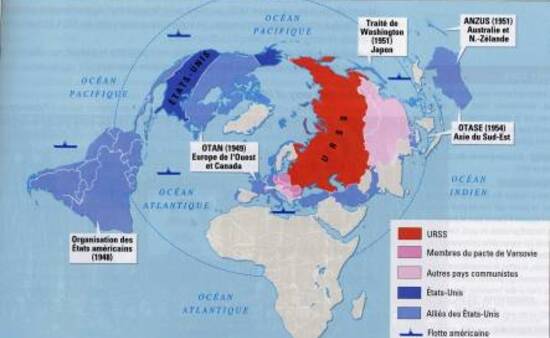
En France, le PCF dénonce l’impérialisme américain du dollar sur l’Europe.
Affiche du parti communiste français en 1952
Pourtant dans les années 50, le modèle américain et son mode de vie sont à leur apogée, un modèle qui fait rêver les européens qui ont connu les privations de la guerre : société de consommation, automobile, électroménager, cinéma d’Hollywood, la musique, la publicité, la grande distribution. C’est l’influence du soft power durant la prospérité économique des 30 glorieuses.
Les Etats-Unis interviennent dans les crises de la guerre froide et appliquent le containment :
- Dès 1948 le blocus de Berlin est première crise de la guerre froide. Les Etats-Unis organisent un formidable pont aérien pour ravitailler les berlinois.
- De 1950 à 1953 dans la guerre de Corée, toujours partagée par les deux idéologies.
- En 1962 la Crise de Cuba met le monde « au bord du gouffre ». La terreur du nucléaire aboutit à la Détente entre les deux grands.
Caricature opposant « les deux K » durant la guerre froide
- De 1960 à 1975 l’enlisement dans la guerre du Vietnam est un traumatisme profond : un échec dans la lutte anti communiste en Asie, une humiliation contre un pays du Tiers-Monde, une image désastreuse du fait de l’utilisation des armes chimiques.
Photographie ayant diffusé une mauvaise image des Etats-Unis dans le monde
La course à l’armement et la conquête spatiale entre les EU et l’URSS expliquent la part du budget fédéral consacré au Pentagone. En 1969 ce sont les Etats-Unis qui envoient le premier homme sur la lune Neil Armstrong.« Un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité ». Le pays sort vainqueur de la course à l’armement et de la course technologique des années 60 et 70.
Pourtant les années 70 fragilisent les Etats-Unis :
- diffusion du communisme dans des pays asiatiques et africains décolonisés.
- Guérillas communistes depuis Cuba sous l’influence du Che Guevara.
- crise économique des années 70 : chocs pétroliers, fin convertibilité du dollar en or et du SMI.
- Scandale du Watergate en 1974 fait démissionner le président Nixon
Dans les années 80 « América is back » sous la présidence de Ronald Reagan :
- reprise du containment ex : aide à l’Afghanistan envahi par les russes depuis 1979.
- relance de la course à l’armement : Projet IDS initiative de défense stratégique (Star Wars), des satellites armés antimissiles, bouclier autour des Etats-Unis.
- avancée technologique : essor d’Apple et Microsoft
Finalement la fin de la guerre froide précipite la victoire américaine suite à la chute du mur de Berlin en 1989 puis à l’implosion de l’URSS en 1991. De fait les Etats-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale à la fin de la guerre froide.III – De l’hyper puissance des années 90 à un relatif déclin au XXI e siècle
1) Une hyper puissance dans les années 90 dans un monde instable
Dans les années 90 les Etats-Unis bénéficient d’une suprématie dans tous les domaines qualifiée « d’hyper puissance » :
- Première puissance économique mondiale, la moitié des 100 premières firmes du monde sont américaines.
- Première puissance technologique : innovations dans les NTIC nouvelles technologies de l’information et de la communication, domination d’Internet, le NASDAQ….
- Première puissance financière : Wall Street représente 40 % de la capitalisation boursière au cœur de la globalisation financière, le dollar reste la monnaie du commerce mondial.
- Hollywood 1er marché cinématographique mondial.
Comme après les deux guerres mondiales, en 1919 et en 1945, 1991 semble mettre en place un nouvel ordre mondial organisé par les démocraties libérales dont les leaders sont les Etats-Unis. Georges Bush renoue avec l’idéalisme wilsonien du début du siècle en diffusant le libéralisme. Il s’agit de diffuser la démocratie afin d’élargir l’économie de marché.Ils multiplient les Accords de libre échange. Ex : création de l’ALENA en 1992 Accord de libre échange nord américain (Etats-Unis, Canada et Mexique).
Ils interviennent au nom des valeurs démocratique et de la liberté en accord avec l’ONU : le multilatéralisme. Ex : en 1991 la première guerre du Golfe est une intervention multilatérale de l’ONU contre l’invasion du Koweït par l’Irakien Saddam Hussein. L’Enjeu est pétrolier au Moyen Orient. En réalité ils n’interviennent pas dans les pays non démocratiques lorsque cela ne menace pas leurs intérêts (ex : Russie, Chine)
Ils ont un rôle d’arbitre international dans les conflits, "les gendarmes du monde". Ex : Accords de paix dans l’ex Yougoslavie en 1995 ou accords d’Oslo en Palestine.
Le nouvel ordre mondial de l’après guerre froide ressemble plutôt à un désordre international : un monde multipolaire, plus instable et conflictuel où grandissent les oppositions à la domination américaine. De nouvelles menaces liées à :- de nouveaux types de conflits : guerres ethniques, armes non conventionnelles, prolifération nucléaire…
- l’instabilité de la mondialisation économique ex : crise financière de 2008
- la montée des critiques à l’impérialisme américain, l’antiaméricanisme
- l’islamisme et le terrorisme en sont les formes les plus violentes.
2) La menace du terrorisme islamiste
Le terrorisme = Action politique violente afin de créer un climat de terreur pour faire pression sur l’opinion publique et sur les Etats.
L’origine du terrorisme est née lors de la guerre d’Afghanistan lorsque les Etats-Unis arment les moudjahidins afin de lutter contre l’invasion russe de 1979. Après 10 ans de guerre, les russes se retirent en 1989 mais le pays sombre dans la dictature islamiste des Talibans. Afghanistan et Pakistan deviennent des pays d’entraînement pour le réseau Al Qaïda. (la base en arabe), en réalité une nébuleuse. Son idéologue Oussama Ben Laden prône le jihad contre l’Occident.Les attentats du 11 septembre 2001 sont un choc car :
- ce sont les attentats les plus meurtriers jamais commis (près de 3000 morts)
- premiers attentats commis sur le sol américain
- ciblés sur les symboles du pouvoir commercial (world Trade center), pouvoir militaire (menace sur le Pentagone) et pouvoir politique (la Maison Blanche)
- Enfin ces attentats prouvent que les services secrets et le FBI ne sont pas invincibles et dysfonctionnent.
Sous la présidence du néo libéral George W. Bush, les EU assument une politique unilatérale dans les années 2000 en menant des guerres seuls sans l’accord de l’ONU. C’est un tournant dans les relations internationales. Dès 2001 les Etats-Unis interviennent en Afghanistan ce qui met fin au régime des Talibans mais la guérilla s’étend au Pakistan voisin.
G.W Bush fait entrer les EU en guerre préventive en 2003 contre les Etats terroristes qu’il appelle « Etats voyous » et « Axe du Mal » (Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan..).
En 2003 c’est la deuxième guerre du Golfe contre l’Irak, une intervention unilatérale où les Etats-Unis interviennent seuls sans l’accord de l’ONU. Pour détruire les armes de destruction massive (mensonge d’Etat américain), les Etats-Unis font chuter le régime irakien de Saddam Hussein.
Destruction de la statue de Saddam Hussein à Bagdad en 2003
Malgré des victoires apparentes, l’occupation américaine est très longue afin de tenter en vain de pacifier ces pays.
2003-2013 Occupation en Irak
2001-2013 Occupation en Afghanistan
L’antiaméricanisme grandit dans des pays où l’occupation américaine est vécue comme une agression impérialiste. Les relations se détériorent avec le monde musulman.3) Un déclin relatif au début du XXI e s
Une nouvelle ère semble naître avec la présidence de Barack Obama élu en 2008. Homme de dialogue, il restaure le multilatéralisme, reçoit le prix Nobel de la paix et incarne une image plus positive des Etats-Unis :
- Charisme du premier président noir
- Le soft power : attractivité et rayonnement sans usage de la force
- Homme de paix sans être pacifiste : « real politique » usage de la force seulement quand elle est jugée nécessaire
ex : Discours du Caire où il noue le dialogue avec le monde musulman.
ex : Oussama Ben Laden traqué puis tué en 2011 au Pakistan
On assiste à un certain retrait militaire américain. Les Etats-Unis veulent « partager le fardeau » trop coûteux de la sécurité mondiale. L’armée américaine retire ses troupes d’Irak en 2011 et d’Afghanistan prévu en 2014.
Ce retrait militaire s’explique par une opinion publique qui s’oppose désormais aux interventions militaires. Par exemple, des manifestations éclatent contre le camp de Guantanamo, un camp militaire américain situé sur une base américaine à Cuba. Echappant ainsi à la législation américaine, le camp inflige des mauvais traitements, la torture aux prisonniers de guerre terroristes. Actuellement, les drones américains sont également dénoncés : ces avions téléguidés frappant à distance des civils au Moyen Orient.Le retrait de l’armée américaine s’explique aussi par son recul économique l’obligeant à limiter le budget militaire. Les américains ont peur du déclin de leur pays du fait de l’émergence des nouvelles puissances (les BRICS) particulièrement la Chine deuxième puissance mondiale depuis 2011. Les Etats-Unis vivent au dessus de leurs moyens, ils ont le premier endettement mondial, le pays emprunte à la Chine et aux pétromonarchies.
La crise financière de 2008 révèle la fragilité des Etats-Unis et leur dépendance vis-à-vis des emprunts chinois. La crise renforce aussi les inégalités sociales précarisant un peu plus les classes défavorisées et moyennes.
Cependant le déclin américain est à relativiser :
Par exemple les EU restent la première puissance militaire du monde. Même si sa part baisse elle représente encore 30 % des exportations d’armes dans le monde et le premier budget militaire (661 milliards de dollars c’est 4 fois plus que la Chine mais la part de ce dernier augmente).
Contrairement à la Chine, les Etats-Unis restent la seule puissance globale dans tous les domaines : premier PIB, avance technologique, brevets, réseau mondial de communication, influence culturelle…..
Conclusion
Les Etats-Unis furent la première puissance mondiale au XX e siècle particulièrement depuis 1945. Leur superpuissance durant la guerre froide puis leur hyper puissance depuis les années 90 peuvent être considérés comme de l’impérialisme. L’antiaméricanisme menace dans les pays islamistes.
Aujourd’hui Les Etats-Unis sont toujours la première puissance mais perdent des positions par rapport au reste du monde. Un monde multipolaire qui voit émerger de nouvelles puissances particulièrement celle de la Chine devenue la deuxième puissance mondiale. votre commentaire
votre commentaire
-
Apologie de Socrate
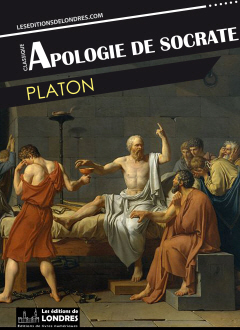
JE ne sais, Athéniens, quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous. Pour moi, en les entendant, peu s’en est fallu que je ne me méconnusse moi-même, tant ils ont parlé d’une manière persuasive ; et cependant, à parler franchement, ils n’ont pas dit un mot qui soit véritable.
Mais, parmi tous les mensonges qu’ils ont débités, ce qui m’a le plus surpris, c’est lorsqu’ils vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence ; car, de n’avoir pas craint la honte du démenti que je vais leur donner tout-à-l’heure, en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent, voilà ce qui m’a paru le comble de l’impudence, à moins qu’ils n’appellent éloquent celui qui dit la vérité. Si c’est là ce qu’ils veulent dire, j’avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière ; car, encore une fois, ils n’ont pas dit un mot qui soit véritable ; et de ma bouche vous entendrez la vérité toute entière, non pas, il est vrai, Athéniens, dans les discours étudiés, comme ceux de mes adversaires, et brillants de tous les artifices du langage, mais au contraire dans les termes qui se présenteront à moi les premiers ; en effet, j’ai la confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste. Ainsi que personne n’attende de moi autre chose. Vous sentez bien qu’il ne me siérait guère, à mon âge, de paraître devant vous comme un jeune homme qui s’exerce à bien parler. C’est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c’est que, si vous m’entendez employer pour ma défense le même langage dont j’ai coutume de me servir dans la place publique, aux comptoirs des banquiers, où vous m’avez souvent entendu, ou partout ailleurs, vous n’en soyez pas surpris, et ne vous emportiez pas contre moi ; car c’est aujourd’hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, à l’âge de plus de soixante-dix ans ; véritablement donc je suis étranger au langage qu’on parle ici. Eh bien ! de même que, si j’étais réellement un étranger, vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays, je vous conjure, et je ne crois pas vous faire une demande injuste, de me laisser maître de la forme de mon discours, bonne ou mauvaise, et de considérer seulement, mais avec attention, si ce que je dis est juste ou non : c’est en cela que consiste toute la vertu du juge ; celle de l’orateur est de dire la vérité.
D’abord, Athéniens, il faut que je réfute les premières accusations dont j’ai été l’objet, et mes premiers accusateurs ; ensuite les accusations récentes et les accusateurs qui viennent de s’élever contre moi. Car, Athéniens, j’ai beaucoup d’accusateurs auprès de vous, et depuis bien des années, qui n’avancent rien qui ne soit faux, et que pourtant je crains plus qu’Anytus[1] et ceux, qui se joignent à lui[2], bien que ceux-ci soient très redoutables ; mais les autres le sont encore beaucoup plus. Ce sont eux, Athéniens, qui, s’emparant de la plupart d’entre vous dès votre enfance, vous ont répété, et vous ont fait accroire qu’il y a un certain Socrate, homme savant, qui s’occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, et qui d’une mauvaise cause en sait faire une bonne. Ceux qui répandent ces bruits, voilà mes vrais accusateurs ; car, en les entendant, on se persuade que les hommes, livrés à de pareilles recherches, ne croient pas qu’il y ait des dieux. D’ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand nombre, et il y a déjà longtemps qu’ils travaillent à ce complot ; et puis, ils vous ont prévenus de cette opinion dans l’âge de la crédulité ; car alors vous étiez enfants pour la plupart, ou dans la première jeunesse : ils m’accusaient donc auprès de vous tout à leur aise, plaidant contre un homme qui ne se défend pas ; et ce qu’il y a de plus bizarre, c’est qu’il ne m’est pas permis de connaître, ni de nommer mes accusateurs, à l’exception d’un certain faiseur de comédies. Tous ceux qui, par envie et pour me décrier, vous ont persuadé ces faussetés, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, ont persuadé les autres, échappent à toute poursuite, et je ne puis ni les appeler devant vous, ni les réfuter ; de sorte que je me vois réduit à combattre des fantômes, et à me défendre sans que personne m’attaque. Ainsi mettez-vous dans l’esprit que j’ai affaire à deux sortes d’accusateurs, comme je viens de le dire ; les uns qui m’ont accusé depuis long-temps, les autres qui m’ont cité en dernier lieu ; et croyez, je vous prie, qu’il est nécessaire que je commence par répondre aux premiers ; car ce sont eux que vous avez d’abord écoutés, et ils ont fait plus d’impression sur vous que les autres.
Eh bien donc ! Athéniens, il faut se défendre, et tâcher d’arracher de vos esprits une calomnie qui y est déjà depuis long-temps, et cela en aussi peu d’instants. Je souhaite y réussir, s’il en peut résulter quelque bien pour vous et pour moi ; je souhaite que cette défense me serve ; mais je regarde la chose comme très difficile, et je ne m’abuse point à cet égard. Cependant qu’il arrive tout ce qu’il plaira aux dieux, il faut obéir à la loi, et se défendre.
Reprenons donc dans son principe l’accusation sur laquelle s’appuient mes calomniateurs, et qui a donné à Mélitus la confiance de me traduire devant le tribunal. Voyons ; que disent mes calomniateurs ? Car il faut mettre leur accusation dans les formes, et la lire comme si, elle était écrite, et le serment prêté[3] : Socrate est un homme dangereux qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, fait une bonne cause d’une mauvaise, et enseigne aux autres ces secrets pernicieux. Voilà l’accusation ; c’est ce que vous avez vu dans la comédie d’Aristophane, où l’on représente un certain Socrate, qui dit qu’il se promène dans les airs et autres semblables extravagances[4] sur des choses où je n’entends absolument rien ; et je ne dis pas cela pour déprécier ce genre de connaissances, s’il y a quelqu’un qui y soit habile (et que Mélitus n’aille pas me faire ici de nouvelles affaires) ; mais c’est qu’en effet, je ne me suis jamais mêlé de ces matières, et je puis en prendre à témoin la plupart d’entre vous. Je vous conjure donc tous tant que vous êtes avec qui j’ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre, je vous conjure de déclarer si vous m’avez jamais entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près ni de loin ; par là, vous jugerez des autres parties de l’accusation, où il n’y a pas un mot de vrai. Et si l’on vous dit que je me mêle d’enseigner, et que j’exige un salaire, c’est encore une fausseté. Ce n’est pas que je ne trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes, comme font Gorgias de Léontium[5], Prodicus de Céos[6], et Hippias d’Élis[7]. Ces illustres personnages parcourent toute la Grèce, attirant les jeunes gens qui pourraient, sans aucune dépense, s’attacher à tel de leurs concitoyens qu’il leur plairait de choisir ; ils savent leur persuader de laisser là leurs concitoyens, et de venir à eux : ceux-ci les paient bien, et leur ont encore beaucoup d’obligation. J’ai ouï dire aussi qu’il était arrivé ici un homme de Paros, qui est fort habile ; car m’étant trouvé l’autre jour chez un homme qui dépense plus en sophistes que tous nos autres, citoyens ensemble, Callias, fils d’Hipponicus[8], je m’avisai de lui dire, en parlant de ses deux fils : Callias, si, pour enfans, tu avais deux jeunes chevaux ou deux jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre entre les mains d’un habile homme, que nous paierions bien, afin qu’il les rendît aussi beaux et aussi bons qu’ils peuvent être, et qu’il leur donnât toutes les perfections de leur nature ? Et cet homme, ce serait probablement un cavalier ou un laboureur. Mais, puisque pour enfants tu as des hommes, à qui as-tu résolu de les confier ? Quel maître avons-nous en ce genre, pour les vertus de l’homme et du citoyen ? Je m’imagine qu’ayant des enfants, tu as dû penser à cela ? As-tu quelqu’un ? lui dis-je. Sans doute, me répondit-il. Et qui donc ? repris-je ; d’où est-il ? Combien prend-il ? C’est Évène[9], Socrate, me répondit Callias ; il est de Paros, et prend cinq mines[10]. Alors je félicitai Évène, s’il était vrai qu’il eût ce talent, et qu’il l’enseignât à si bon marché. Pour moi, j’avoue que je serais bien fier et bien glorieux, si j’avais cette habileté ; mais malheureusement je ne l’ai point, Athéniens.
Et ici quelqu’un de vous me dira sans doute : Mais, Socrate, que fais-tu donc ? Et d’où viennent ces calomnies que l’on a répandues contre toi ? Car si tu ne faisais rien de plus ou autrement que les autres, on n’aurait jamais tant parlé de toi. Dis-nous donc ce que c’est, afin que nous ne portions pas un jugement téméraire. Rien de plus juste assurément qu’un pareil langage ; et je vais tâcher de vous expliquer ce qui m’a fait tant de réputation et tant d’ennemis. Écoutez-moi ; quelques-uns de vous croiront peut-être que je ne parle pas sérieusement ; mais soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la vérité. En effet, Athéniens, la réputation que j’ai acquise vient d’une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse ? C’est peut-être une sagesse purement humaine ; et je cours grand risque de n’être sage que de celle-là, tandis que les hommes dont je viens de vous parler sont sages d’une sagesse bien plus qu’humaine. Je n’ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l’ai point ; et qui le prétend en impose et veut me calomnier. Mais je vous conjure, Athéniens, de ne pas vous émouvoir, si ce que je vais vous dire vous paraît d’une arrogance extrême ; car je ne vous dirai rien qui vienne de moi, et je ferai parler devant vous une autorité digne de votre confiance ; je vous donnerai de ma sagesse un témoin qui vous dira si elle est, et quelle elle est ; et ce témoin c’est le dieu de Delphes. Vous connaissez tous Chérephon, c’était mon ami d’enfance ; il l’était aussi de la plupart d’entre vous ; il fut exilé avec vous, et revint avec vous. Vous savez donc quel homme c’était que Chérephon[11], et quelle ardeur il mettait dans tout ce qu’il entreprenait. Un jour, étant allé à Delphes, il eut la hardiesse de demander à l’oracle (et je vous prie encore une fois de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire) ; il lui demanda s’il y avait au monde un homme plus sage que moi : la Pythie lui répondit qu’il n’y en avait aucun[12]. À défaut de Chérephon, qui est mort, son frère, qui est ici, pourra vous le certifier. Considérez bien, Athéniens, pourquoi je vous dis toutes ces choses, c’est uniquement pour vous faire voir d’où viennent les bruits qu’on a fait courir contre moi. Quand je sus la réponse de l’oracle, je me dis en moi-même : que veut dire le dieu ? Quel sens cachent ses paroles ? Car je sais bien qu’il n’y a en moi aucune sagesse, ni petite ni grande ; que veut-il donc dire, en me déclarant le plus sage des hommes ? Car enfin il ne ment point ; un dieu ne saurait mentir. Je fus long-temps dans une extrême perplexité sur le sens de l’oracle, jusqu’à ce qu’enfin, après bien des incertitudes, je pris le parti que vous allez entendre pour connaître l’intention du dieu. J’allai chez un de nos concitoyens, qui passe pour un des plus sages de la ville ; et j’espérais que là, mieux qu’ailleurs, je pourrais confondre l’oracle, et lui dire : tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi. Examinant donc cet homme, dont je n’ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c’était un de nos plus grands politiques, et m’entretenant avec lui, je trouvai qu’il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu’il ne l’était point. Après cette découverte, je m’efforçai de lui faire voir qu’il n’était nullement ce qu’il croyait être ; et voilà déjà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient à notre conversation. Quand je l’eus quitté, je raisonnai ainsi en moi-même : je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux ; mais il y a cette différence que lui, il croit savoir, quoiqu’il ne sache rien ; et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela du moins je suis un peu plus sage, que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. De là, j’allai chez un autre, qui passait encore pour plus sage que le premier ; je trouvai la même chose, et je me fis là de nouveaux ennemis. Cependant je ne me rebutai point ; je sentais bien quelles haines j’assemblais sur moi ; j’en étais affligé, effrayé même. Malgré cela, je crus que je devais préférer à toutes choses la voix du dieu, et, pour en trouver le véritable sens, aller de porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de réputation ; et je vous jure[13], Athéniens, car il faut vous dire la vérité, que voici le résultat que me laissèrent mes recherches : Ceux qu’on vantait le plus me satisfirent le moins, et ceux dont on n’avait aucune opinion, je les trouvai beaucoup plus près de la sagesse. Mais il faut achever de vous raconter mes courses et les travaux que j’entrepris. Pour m’assurer de la vérité de l’oracle. Après les politiques, je m’adressai aux poètes tant à ceux qui font des tragédies, qu’aux poètes dithyrambiques et autres, ne doutant point que je ne prisse là sur le fait mon ignorance et leur supériorité. Prenant ceux de leurs ouvrages qui me paraissaient travaillés avec le plus de soin, je leur demandai ce qu’ils avaient voulu dire, désirant m’instruire dans leur entretien. J’ai honte, Athéniens, de vous dire la vérité ; mais il faut pourtant vous la dire. De tous ceux qui étaient là présents, il n’y en avait presque pas un qui ne fut capable de rendre compte de ces poèmes mieux que ceux qui les avaient faits. Je reconnus donc bientôt que ce n’est pas la raison qui, dirige le poète, mais une sorte d’inspiration naturelle, un enthousiasme semblable à celui qui transporte le prophète et le devin, qui disent tous de fort belles choses, mais sans rien comprendre, à ce qu’ils disent. Les poètes me parurent dans le même cas, et je m’aperçus en même temps qu’à cause de leur talent pour la poésie, ils se croyaient sur tout le reste les plus sages des hommes ; ce qu’ils n’étaient en aucune manière. Je les quittai donc, persuadé que j’étais au-dessus d’eux, par le même endroit qui m’avait mis au-dessus des politiques. Des poètes, je passai aux artistes. J’avais la conscience de n’entendre rien aux arts, et j’étais bien persuadé que les artistes possédaient mille secrets admirables, en quoi je ne me trompais point. Ils savaient bien des choses que j’ignorais, et en cela ils étaient beaucoup plus habiles que moi. Mais, Athéniens, les plus habiles me parurent tomber dans les mêmes défauts que les poètes ; il n’y en avait pas un qui, parce qu’il excellait dans son art, ne crut très-bien savoir les choses les plus importantes, et cette folle présomption gâtait leur habileté, de sorte que, me mettant à la place de l’oracle, et me demandant à moi-même lequel j’aimerais mieux ou d’être tel que je suis, sans leur habileté et aussi sans leur ignorance, ou d’avoir leurs avantages avec leurs défauts, je me répondis à moi-même et à l’oracle : J’aime mieux être comme je suis. Ce sont ces recherches, Athéniens, qui ont excité contre moi tant d’inimitiés dangereuses ; de là toutes les calomnies répandues sur mon compte, et ma réputation de sage ; car tous ceux qui m’entendent croient que je sais toutes les choses sur lesquelles je démasque l’ignorance des autres. Mais, Athéniens, la vérité est qu’Apollon seul est sage, et qu’il a voulu dire seulement, par son oracle, que toute la sagesse humaine n’est pas grand’chose, ou même qu’elle n’est rien ; et il est évident que l’oracle ne parle pas ici de moi, mais qu’il s’est servi de mon nom comme d’un exemple, et comme s’il eût dit à tous les hommes : Le plus sage d’entre vous, c’est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n’est rien. Convaincu de cette vérité, pour m’en assurer encore davantage, et pour obéir au dieu, je continue ces recherches, et vais examinant tous ceux de nos concitoyens et des étrangers, en qui j’espère trouver la vraie sagesse ; et quand je ne l’y trouve point, je sers d’interprète à l’oracle ; en leur faisant voir qu’ils ne sont point sages. Cela m’occupe si fort, que je n’ai pas eu le temps d’être un peu utile à la république, ni à ma famille, et mon dévouement au service du dieu m’a mis dans une gêne extrême. D’ailleurs beaucoup de jeunes gens, qui ont du loisir, et qui appartiennent à de riches familles, s’attachent à moi, et prennent un grand plaisir à voir de quelle manière j’éprouve les hommes ; eux-mêmes ensuite tâchent de m’imiter, et se mettent à éprouver ceux qu’ils rencontrent ; et je ne doute pas qu’ils ne trouvent une abondante moisson ; car il ne manque pas de gens qui croient tout savoir, quoiqu’ils ne sachent rien, ou très-peu de chose. Tous ceux qu’ils convainquent ainsi d’ignorance s’en prennent à moi, et non pas à eux, et vont disant qu’il y a un certain Socrate, qui est une vraie peste pour les jeunes gens ; et quand on leur demande ce que fait ce Socrate, ou ce qu’il enseigne, ils n’en savent rien ; mais, pour ne pas demeurer court, ils mettent en avant ces accusations banales qu’on fait ordinairement aux philosophes ; qu’il recherche ce qui se passe dans le ciel et sous la terre ; qu’il ne croit point aux dieux, et qu’il rend bonnes les plus mauvaises causes ; car ils n’osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le fait, et montre qu’ils font semblant de savoir, quoiqu’ils ne sachent rien. Intrigants, actifs et nombreux, parlant de moi d’après un plan concerté et avec une éloquence fort capable de séduire, ils vous ont depuis long-temps rempli les oreilles des bruits les plus perfides, et poursuivent sans relâche leur système de calomnie. Aujourd’hui ils me détachent Mélitus, Anytus et Lycon. Mélitus représente les poètes ; Anytus, les politiques et les artistes ; Lycon, les orateurs. C’est pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais comme un miracle, si, en aussi peu de temps, je pouvais détruire une calomnie qui a déjà de vieilles racines dans vos esprits.
Vous avez entendu, Athéniens, la vérité toute pure ; je ne vous cache et ne vous déguise rien, quoique je n’ignore pas que tout ce que je dis ne fait qu’envenimer la plaie ; et c’est cela même qui prouve que je dis la vérité, et que je ne me suis pas trompé sur la source de ces calomnies : et vous vous en convaincrez aisément, si vous voulez vous donner la peine d’approfondir cette affaire, ou maintenant ou plus tard.
Voilà contre mes premiers accusateurs une apologie suffisante ; venons présentement aux derniers, et tâchons de répondre à Mélitus, cet homme de bien, si attaché à sa patrie, à ce qu’il assure. Reprenons cette dernière accusation comme nous avons fait la première ; voici à-peu-près comme elle est conçue : Socrate est coupable, en ce qu’il corrompt les jeunes gens, ne reconnaît pas la religion de l’état, et met à la place des extravagances démoniaques[14]. Voilà l’accusation ; examinons-en tous les chefs l’un après l’autre.
Il dit que je suis coupable, en ce que je corromps les jeunes gens. Et moi, Athéniens, je dis que c’est Mélitus qui est coupable, en ce qu’il se fait un jeu des choses sérieuses, et, de gaité de cœur, appelle les gens en justice pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses dont il ne s’est jamais mis en peine ; et je m’en vais vous le prouver. Viens ici, Mélitus ; dis-moi : Y a-t-il rien que tu aies tant à cœur que de rendre les jeunes gens aussi vertueux qu’ils peuvent l’être ?
MÉLITUS.
Non, sans doute.
SOCRATE.
Eh bien donc, dis à nos juges qui est-ce qui est capable de rendre les jeunes gens meilleurs ; car il ne faut pas douter que tu ne le saches, puisque cela t’occupe si fort. En effet, puisque tu as découvert celui qui les corrompt, et que tu l’as dénoncé devant ce tribunal, il faut que tu dises qui est celui qui peut les rendre meilleurs. Parle, Mélitus… tu vois que tu es interdit, et ne sais que répondre : cela ne te semble-t-il pas honteux, et n’est-ce pas une preuve certaine que tu ne t’es jamais soucié de l’éducation de la jeunesse ? Mais, encore une fois, digne Mélitus, dis-nous qui peut rendre les jeunes gens meilleurs.
MÉLITUS.
Les lois.
SOCRATE.
Ce n’est pas là, excellent Mélitus, ce que je te demande. Je te demande qui est-ce ? Quel est l’homme ? Il est bien sûr que la première chose qu’il faut que cet homme sache, ce sont les lois.
MÉLITUS.
Ceux que tu vois ici, Socrate ; les juges.
SOCRATE.
Comment dis-tu, Mélitus ? Ces juges sont capables d’instruire les jeunes gens et de les rendre meilleurs ?
MÉLITUS.
Certainement.
SOCRATE.
Sont-ce tous ces juges, ou y en a-t-il parmi eux qui le puissent, et d’autres qui ne le puissent pas ?
MÉLITUS.
Tous.
SOCRATE.
À merveille, par Junon ; tu nous as trouvé un grand nombre de bons précepteurs. Mais poursuivons ; et tous ces citoyens qui nous écoutent peuvent-ils aussi rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas ?
MÉLITUS.
Ils le peuvent aussi.
SOCRATE.
Et les sénateurs ?
MÉLITUS.
Les sénateurs aussi.
SOCRATE.
Mais, mon cher Mélitus, tous ceux qui assistent aux assemblées du peuple ne pourraient-ils donc pas corrompre la jeunesse, ou sont-ils aussi tous capables de la rendre vertueuse ?
MÉLITUS.
Ils en sont tous capables.
SOCRATE.
Ainsi, selon toi, tous les Athéniens peuvent être utiles à la jeunesse, hors moi ; il n’y a que moi qui la corrompe : n’est-ce pas là ce que tu dis ?
MÉLITUS.
C’est cela même.
SOCRATE.
En vérité, il faut que j’aie bien du malheur ; mais continue de me répondre. Te paraît-il qu’il en soit de même des chevaux ? Tous les hommes peuvent-ils les rendre meilleurs, et n’y en a-t-il qu’un seul qui ait le secret de les gâter ? Ou est-ce tout le contraire ? N’y a-t-il qu’un seul homme, ou un bien petit nombre, savoir les écuyers, qui soient capables de les dresser ? Et les autres hommes, s’ils veulent les monter et s’en servir, ne les gâtent-ils pas ? N’en est-il pas de-même de tous les animaux ? Oui, sans doute, soit qu’Anytus et toi vous en conveniez ou que vous n’en conveniez point ; et, en vérité, ce serait un grand bonheur pour la jeunesse, qu’il n’y eût qu’un seul homme qui pût la corrompre, et que tous les autres pussent la rendre vertueuse. Mais tu as suffisamment prouvé, Mélitus, que l’éducation de la jeunesse ne t’a jamais fort inquiété ; et tes discours viennent de faire paraître clairement que tu ne t’es jamais occupé de la chose même pour laquelle tu me poursuis.
D’ailleurs, je t’en prie au nom de Jupiter, Mélitus, réponds à ceci : Lequel est le plus avantageux d’habiter avec des gens de bien, ou d’habiter avec des méchants ? Réponds-moi, mon ami, car je ne te demande rien de difficile. N’est-il pas vrai que les méchants font toujours quelque mal à ceux qui les fréquentent, et que les bons font toujours quelque bien à ceux qui vivent avec eux ?
MÉLITUS.
Sans doute.
SOCRATE.
Y a-t-il donc quelqu’un qui aime mieux recevoir du préjudice de la part de ceux qu’il fréquente, que d’en recevoir de l’utilité ? Réponds-moi, Mélitus ; car la loi ordonne de répondre. Y a-t-il quelqu’un qui aime mieux recevoir du mal que du bien ?
MÉLITUS.
Non, il n’y a personne.
SOCRATE.
Mais voyons, quand tu m’accuses de corrompre la jeunesse, et de la rendre plus méchante, dis-tu que je la corromps à dessein, ou sans le vouloir ?
MÉLITUS.
À dessein.
SOCRATE.
Quoi donc ! Mélitus, à ton âge, ta sagesse surpasse-t-elle de si loin la mienne à l’âge ou je suis parvenu, que tu saches fort bien que les méchants fassent toujours du mal à ceux qui les fréquentent et que les bons leur font du bien, et que moi je sois assez ignorant pour ne savoir pas qu’en rendant méchant quelqu’un de ceux qui ont avec moi un commerce habituel, je m’expose à en recevoir du mal, et pour ne pas laisser malgré cela de m’attirer ce mal, le voulant et le sachant ? En cela, Mélitus, je ne te crois point, et je ne pense pas qu’il y ait un homme au monde qui puisse te croire. Il faut de deux choses l’une, ou que je ne corrompe pas les jeunes gens, ou, si je les corromps, que ce soit malgré moi et sans le savoir : et, dans tous les cas, tu es un imposteur. Si c’est malgré moi que je corromps la jeunesse, la loi ne veut pas qu’on appelle en justice pour des fautes involontaires ; mais elle veut qu’on prenne en particulier ceux qui les commettent, et qu’on les instruise ; car il est bien sûr qu’étant instruit, je cesserai de faire ce que je fais malgré moi : mais tu t’en es bien gardé ; tu n’as pas voulu me voir et m’instruire, et tu me traduis devant ce tribunal, où la loi veut qu’on cite ceux qui ont mérité des punitions, et non pas ceux qui n’ont besoin que de remontrances. Ainsi, Athéniens, voilà une preuve bien évidente de ce que je vous disais, que Mélitus ne s’est jamais mis en peine de toutes ces choses-là, et qu’il n’y a jamais pensé. Cependant, voyons ; dis-nous comment je corromps les jeunes gens : n’est-ce pas, selon ta dénonciation écrite, en leur apprenant à ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la patrie, et en leur enseignant des extravagances sur les démons ? N’est-ce pas là ce que tu dis ?
MÉLITUS.
Précisément.
SOCRATE.
Mélitus, au nom de ces mêmes dieux dont il s’agit maintenant, explique-toi d’une manière un peu plus claire, et pour moi et pour ces juges ; car je ne comprends pas si tu m’accuses d’enseigner qu’il y a bien des dieux (et dans ce cas, si je crois qu’il y a des dieux, je ne suis donc pas entièrement athée, et ce n’est pas là en quoi je suis coupable), mais des dieux qui ne sont pas ceux de l’état : est-ce là de quoi tu m’accuses ? ou bien m’accuses-tu de n’admettre aucun dieu, et d’enseigner aux autres à n’en reconnaître aucun ?
MÉLITUS.
Je t’accuse de ne reconnaître aucun dieu.
SOCRATE.
O merveilleux Mélitus ! pourquoi dis-tu cela ? Quoi ! je ne crois pas, comme les autres hommes, que le soleil et la lune sont des dieux ?
MÉLITUS.
Non, par Jupiter, Athéniens, il ne le croit pas ; car il dit que le soleil est une pierre, et la lune une terre.
SOCRATE.
Tu crois accuser Anaxagore[15], mon cher Mélitus, et tu méprises assez nos juges, tu les crois assez ignorants, pour penser qu’ils ne savent pas que les livres d’Anaxagore de Clazomènes sont pleins de pareilles assertions. D’ailleurs, les jeunes gens viendraient-ils chercher auprès de moi avec tant d’empressement une doctrine qu’ils pourraient aller à tout moment entendre débiter à l’orchestre, pour une dragme tout au plus, et qui leur donnerait une belle occasion de se moquer de Socrate, s’il s’attribuait ainsi des opinions qui ne sont pas à lui, et qui sont si étranges et si absurdes ? Mais dis-moi, au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais aucun dieu.
MÉLITUS.
Oui, par Jupiter, tu n’en reconnais aucun.
SOCRATE.
En vérité, Mélitus, tu dis là des choses incroyables, et auxquelles toi-même, à ce qu’il me semble, tu ne crois pas. Pour moi, Athéniens, il me paraît que Mélitus est un impertinent, qui n’a intenté cette accusation que pour m’insulter, et par une audace de jeune homme ; il est venu ici pour me tenter, en proposant une énigme, et disant en lui-même : Voyons si Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra que je me moque, et que je dis des choses qui se contredisent, ou si je le tromperai, lui et tous les auditeurs. En effet, il paraît entièrement se contredire dans son accusation ; c’est comme s’il disait : Socrate est coupable en ce qu’il ne reconnaît pas de dieux, et en ce qu’il reconnaît des dieux ; vraiment c’est là se moquer. Suivez-moi, je vous en prie, Athéniens, et examinez avec moi en quoi je pense qu’il se contredit. Réponds, Mélitus ; et vous, juges, comme je vous en ai conjurés au commencement, souffrez que je parle ici à ma manière ordinaire. Dis, Mélitus ; y a-t-il quelqu’un dans le monde qui croie qu’il y ait des choses humaines, et qui ne croie pas qu’il y ait des hommes ?… Juges, ordonnez qu’il réponde et qu’il ne fasse pas tant de bruit. Y a-t-il quelqu’un qui croie qu’il y a des règles pour dresser les chevaux, et qu’il n’y a pas de chevaux ? des airs de flûte, et point de joueurs de flûte ?… Il n’y a personne, excellent Mélitus. C’est moi qui te le dis, puisque tu ne veux pas répondre, et qui le dis à toute l’assemblée. Mais réponds à ceci : Y a-t-il quelqu’un qui admette quelque chose relatif aux démons, et qui croie pourtant qu’il n’y a point de démons ?
MÉLITUS.
Non, sans doute.
SOCRATE.
Que tu m’obliges de répondre enfin, et à grand’peine, quand les juges t’y forcent ! Ainsi tu conviens que j’admets et que j’enseigne quelque chose sur les démons : que mon opinion, soit nouvelle, ou soit ancienne, toujours est-il, d’après toi-même, que j’admets quelque chose sur les démons ; et tu l’as juré dans ton accusation. Mais si j’admets quelque chose sur les démons, il faut nécessairement que j’admette des démons ; n’est-ce pas ?… Oui, sans doute ; car je prends ton silence pour un consentement. Or, ne regardons-nous pas les démons comme des dieux, ou des enfants des dieux ? En conviens-tu, oui ou non ?
MÉLITUS.
J’en conviens.
SOCRATE.
Et par conséquent, puisque j’admets des démons de ton propre aveu, et que les démons sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je disais, que tu viens nous proposer des énigmes, et te divertir à mes dépens, en disant que je n’admets point de dieux, et que pourtant j’admets des dieux, puisque j’admets des démons. Et si les démons sont enfants des dieux, enfants bâtards, à la vérité, puisqu’ils les ont eus de nymphes ou, dit-on aussi, de simples mortelles, qui pourrait croire qu’il y a des enfants des dieux, et qu’il n’y ait pas des dieux ? Cela serait aussi absurde que de croire qu’il y a des mulets nés de chevaux ou d’ânes, et qu’il n’y a ni ânes ni chevaux. Ainsi, Mélitus, il est impossible que tu ne m’aies intenté cette accusation pour m’éprouver, ou faute de prétexte légitime pour me citer devant ce tribunal ; car que tu persuades jamais à quelqu’un d’un peu de sens, que le même homme puisse croire qu’il y a des choses relatives aux démons et aux dieux, et pourtant qu’il n’y a ni démons, ni dieux, ni héros, c’est ce qui est entièrement impossible.
Mais je n’ai pas besoin d’une plus longue défense, Athéniens ; et ce que je viens de dire suffit, il me semble, pour faire voir que je ne suis point coupable, et que l’accusation de Mélitus est sans fondement. Et quant à ce que je vous disais au commencement, que j’ai contre moi de vives et nombreuses inimitiés, soyez bien persuadés qu’il en est ainsi ; et ce qui me perdra si je succombe, ce ne sera ni Mélitus ni Anytus, mais l’envie et la calomnie, qui ont déjà fait périr tant de gens de bien, et qui en feront encore périr tant d’autres ; car il ne faut pas espérer que ce fléau s’arrête à moi.
Mais quelqu’un me dira peut-être : N’as-tu pas honte, Socrate, de t’être attaché à une étude qui te met présentement en danger de mourir ? Je puis répondre avec raison à qui me ferait cette objection : Vous êtes dans l’erreur, si vous croyez qu’un homme, qui vaut quelque chose, doit considérer les chances de la mort ou de la vie, au lieu de chercher seulement, dans toutes ses démarches, si ce qu’il fait est juste ou injuste, et si c’est l’action d’un homme de bien ou d’un méchant. Ce seraient donc, suivant vous, des insensés que tous ces demi-dieux qui moururent au siège de Troie, et particulièrement le fils de Thétis, qui comptait le danger pour si peu de chose, en comparaison de la honte, que la déesse sa mère, qui le voyait dans l’impatience d’aller tuer Hector, lui ayant parlé à-peu-près en ces termes, si je m’en souviens : Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle, ton ami, en tuant Hector, tu mourras ; car
Ton trépas doit suivre celui d’Hector ;
lui, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche, sans venger ses amis :
Que je meure à l’instant,
s’écrie-t-il, pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle, et que je ne reste pas ici exposé au mépris,
Assis sur mes vaisseaux, fardeau inutile de la terre[16].
Est-ce là s’inquiéter du danger et de la mort ? Et en effet, Athéniens, c’est ainsi qu’il en doit être. Tout homme qui a choisi un poste, parce qu’il le jugeait le plus honorable, ou qui y a été placé par son chef, doit, à mon avis, y demeurer ferme, et ne considérer ni la mort, ni le péril, ni rien autre chose que l’honneur. Ce serait donc de ma part une étrange conduite, Athéniens, si, après avoir gardé fidèlement, comme un brave soldat, tous les postes où j’ai été mis par vos généraux, à Potidée, à Amphipolis et à Délium[17], et, après avoir souvent exposé ma vie, aujourd’hui que le dieu de Delphes m’ordonne, à ce que je crois, et comme je l’interprète moi-même, de passer mes jours dans l’étude de la philosophie, en m’examinant moi-même, et en examinant les autres, la peur de la mort, ou quelque autre danger, me faisait abandonner ce poste. Ce serait là une conduite bien étrange, et c’est alors vraiment qu’il faudrait me citer devant ce tribunal comme un impie qui ne reconnaît point de dieux, qui désobéit à l’oracle, qui craint la mort, qui se croit sage, et qui ne l’est pas ; car craindre la mort, Athéniens, ce n’est autre chose que se croire sage sans l’être ; car c’est croire connaître ce que l’on ne connaît point. En effet, personne ne connaît ce que c’est que la mort, et si elle n’est pas le plus grand de tous les biens pour l’homme. Cependant on la craint, comme si l’on savait certainement que c’est le plus grand de tous les maux. Or, n’est-ce pas l’ignorance la plus honteuse que de croire connaître ce que l’on ne connaît point ? Pour moi, c’est peut-être en cela que je suis différent de la plupart des hommes ; et si j’osais me dire plus sage qu’un autre en quelque chose, c’est en ce que, ne sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je ne crois pas non plus le savoir ; mais ce que je sais bien, c’est qu’être injuste, et désobéir à ce qui est meilleur que soi, dieu ou homme, est contraire au devoir et à l’honneur. Voilà le mal que je redoute et que je veux fuir, parce que je sais que c’est un mal, et non pas de prétendus maux qui peut-être sont des biens véritables : tellement que si vous me disiez présentement, malgré les instances d’Anytus qui vous a représentés ou qu’il ne fallait pas m’appeler devant ce tribunal, ou qu’après m’y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me faire mourir, par la raison, dit-il, que si j’échappais, vos fils, qui sont déjà si attachés à la doctrine de Socrate, seront bientôt corrompus sans ressource ; si vous me disiez : Socrate, nous rejetons l’avis d’Anytus, et nous te renvoyons absous ; mais c’est à condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées ; et si tu y retombes, et que tu sois découvert, tu mourras ; oui, si vous me renvoyiez à ces conditions, je vous répondrais sans balancer : Athéniens, je vous honore et je vous aime, mais j’obéirai plutôt au dieu qu’à vous ; et tant que je respirerai et que j’aurai un peu de force, je ne cesserai de m’appliquer à la philosophie, de vous donner des avertissements et des conseils, et de tenir à tous ceux que je rencontrerai mon langage ordinaire : ô mon ami ! comment, étant Athénien, de la plus grande ville et la plus renommée pour les lumières et la puissance, ne rougis-tu pas de ne penser qu’à amasser des richesses, à acquérir du crédit et des honneurs, sans t’occuper de la vérité et de la sagesse, de ton âme et de son perfectionnement ? Et si quelqu’un de vous prétend le contraire, et me soutient qu’il s’en occupe, je ne l’en croirai point sur sa parole, je ne le quitterai point ; mais je l’interrogerai, je l’examinerai, je le confondrai, et si je trouve qu’il ne soit pas vertueux, mais qu’il fasse semblant de l’être, je lui ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les plus précieuses, et d’en mettre tant à celles qui n’en ont aucun. Voilà de quelle manière je parlerai à tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près, et sachez que c’est là ce que le dieu m’ordonne, et je suis persuadé qu’il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la république que mon zèle à remplir l’ordre du dieu : car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu’avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l’âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n’est pas la richesse qui fait la vertu ; mais, au contraire, que c’est la vertu qui fait la richesse, et que c’est de là que naissent tous les autres biens publics et particuliers. Si, en parlant ainsi, je corromps la jeunesse, il faut que ces maximes soient un poison, car si on prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l’on vous en impose. Ainsi donc, je n’ai qu’à vous dire : Faites ce que demande Anytus, ou ne le faites pas ; renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas ; je ne ferai jamais autre chose, quand je devrais mourir mille fois… Ne murmurez pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je vous ai demandée, de m’écouter patiemment : cette patience, à mon avis, ne vous sera pas infructueuse. J’ai à vous dire beaucoup d’autres choses qui, peut-être, exciteront vos clameurs ; mais ne vous livrez pas à ces mouvements de colère. Soyez persuadés que, si vous me faites mourir, étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez plus de mal qu’à moi. En effet, ni Anytus ni Mélitus ne me feront aucun mal ; ils ne le peuvent, car je ne crois pas qu’il soit au pouvoir du méchant de nuire à l’homme de bien. Peut-être me feront-ils condamner à la mort ou à l’exil ou à la perte de mes droits de citoyen, et Anytus et les autres prennent sans doute cela pour de très grands maux ; mais moi je ne suis pas de leur avis ; à mon sens, le plus grand de tous les maux, c’est ce qu’Anytus fait aujourd’hui, d’entreprendre de faire périr un innocent.
Maintenant, Athéniens, ne croyez pas que ce soit pour l’amour de moi que je me défends, comme on pourrait le croire ; c’est pour l’amour de vous, de peur qu’en me condamnant, vous n’offensiez le dieu dans le présent qu’il vous a fait ; car si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville, la comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, comme à un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d’un éperon qui l’excite et l’aiguillonne. C’est ainsi que le dieu semble m’avoir choisi pour vous exciter et vous aiguillonner, pour gourmander chacun de vous, partout et toujours sans vous laisser aucune relâche. Un tel homme, Athéniens, sera difficile à retrouver, et, si vous voulez m’en croire, vous me laisserez la vie. Mais peut-être que, fâchés comme des gens qu’on éveille quand ils ont envie de s’endormir, vous me frapperez, et, obéissant aux insinuations d’Anytus, vous me ferez mourir sans scrupule ; et après vous retomberez pour toujours dans un sommeil léthargique, à moins que la divinité, prenant pitié de vous, ne vous envoie encore un homme qui me ressemble. Or, que ce soit elle-même qui m’ait donné à cette ville, c’est ce que vous pouvez aisément reconnaître à cette marque ; qu’il y a quelque chose de plus qu’humain à avoir négligé pendant tant d’années mes propres affaires, pour m’attacher aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier, comme un père ou un frère aîné pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu. Et si j’avais tiré quelque salaire de mes exhortations, ma conduite pourrait s’expliquer ; mais vous voyez que mes accusateurs mêmes, qui m’ont calomnié avec tant d’impudence, n’ont pourtant pas eu le front de me reprocher et d’essayer de prouver par témoins, que j’aie jamais exigé ni demandé le moindre salaire ; et je puis offrir de la vérité de ce que j’avance un assez bon témoin, à ce qu’il me semble : ma pauvreté.
Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n’aie jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple, pour donner mes conseils à la république. Ce qui m’en a empêché, Athéniens, c’est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque, dont vous m’avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus, pour plaisanter, a fait un chef d’accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s’est manifesté en moi dès mon enfance ; c’est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j’ai résolu ; car jamais elle ne m’exhorte à rien entreprendre : c’est elle qui s’est toujours opposée à moi, quand j’ai voulu me mêler des affaires de la république, et elle s’y est opposée fort à propos ; car sachez bien qu’il y a long-temps que je ne serais plus en vie, si je m’étais mêlé des affaires publiques, et je n’aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité. Non, quiconque voudra lutter franchement contre les passions d’un peuple, celui d’Athènes, ou tout autre peuple ; quiconque voudra empêcher qu’il ne se commette rien d’injuste ou d’illégal dans un état, ne le fera jamais impunément. Il faut de toute nécessité que celui qui veut combattre pour la justice, s’il veut vivre quelque temps, demeure simple particulier, et ne prenne aucune part au gouvernement. Je puis vous en donner des preuves incontestables, et ce ne seront pas des raisonnements, mais ce qui a bien plus d’autorité auprès de vous, des faits. Écoutez donc ce qui m’est arrivé, afin que vous sachiez bien que je sois incapable de céder à qui que ce soit contre le devoir, par crainte de la mort ; et que, ne voulant pas le faire, il est impossible que je ne périsse pas. Je vais vous dire des choses qui vous déplairont, et où vous trouverez peut-être la jactance des plaidoyers ordinaires : cependant je ne vous dirai rien qui ne soit vrai.
Vous savez, Athéniens, que je n’ai jamais exercé aucune magistrature, et que j’ai été seulement sénateur[18]. La tribu Antiochide, à laquelle j’appartiens[19], était justement de tour au Prytanée, lorsque, contre toutes les lois, vous vous opiniâtrâtes à faire simultanément[20] le procès aux dix généraux qui avaient négligé d’ensevelir les corps de ceux qui avaient péri au combat naval des Arginuses[21] ; injustice que vous reconnûtes, et dont vous vous repentîtes dans la suite. En cette occasion, je fus le seul des prytanes qui osai m’opposer à la violation des lois, et voter contre vous. Malgré les orateurs qui se préparaient à me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris, j’aimai mieux courir ce danger avec la loi et la justice, que de consentir avec vous à une si grande iniquité, par la crainte des chaînes ou de la mort[22]. Ce fait eut lieu pendant que le gouvernement démocratique subsistait encore. Quand vint l’oligarchie, les Trente me mandèrent moi cinquième au Tholos[23] et me donnèrent l’ordre d’amener de Salamine Léon le Salaminien, afin qu’on le fit mourir ; car ils donnaient de pareils ordres à beaucoup de personnes, pour compromettre le plus de monde qu’ils pourraient ; et alors je prouvai, non pas en paroles, mais par des effets, que je me souciais de la mort comme de rien, si vous me passez cette expression triviale, et que mon unique soin était de ne rien faire d’impie et d’injuste. Toute la puissance des Trente, si terrible alors, n’obtint rien de moi contre la justice. En sortant du Tholos, les quatre autres s’en allèrent à Salamine, et amenèrent Léon, et moi je me retirai dans ma maison ; et il ne faut pas douter que ma mort n’eût suivi ma désobéissance, si ce gouvernement n’eût été aboli bientôt après[24]. C’est ce que peuvent attester un grand nombre de témoins.
Pensez-vous donc que j’eusse vécu tant d’années, si je me fusse mêlé des affaires de la république, et qu’en homme de bien, j’eusse tout foulé aux pieds pour ne penser qu’à défendre la justice ? Il s’en faut bien, Athéniens ; ni moi ni aucun autre homme, ne l’aurions pu faire. Pendant tout le cours de ma vie, toutes les fois qu’il m’est arrivé de prendre part aux affaires publiques, vous me trouverez le même ; le même encore dans mes relations privées, ne cédant jamais rien à qui que ce soit contre la justice, non pas même à aucun de ces tyrans, que mes calomniateurs veulent faire passer pour mes disciples[25]. Je n’ai jamais été le maître de personne ; mais si quelqu’un, jeune ou vieux, a désiré s’entretenir avec moi, et voir comment je m’acquitte de ma mission, je n’ai refusé à personne cette satisfaction. Loin de parler quand on me paie, et de me taire quand on ne me donne rien, je laisse également le riche et le pauvre m’interroger ; ou, si on l’aime mieux, on répond à mes questions, et l’on entend ce que j’ai à dire. Si donc, parmi ceux qui me fréquentent, il s’en trouve qui deviennent honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni m’en louer ni m’en blâmer ; ce n’est pas moi qui en suis la cause, je n’ai jamais promis aucun enseignement, et je n’ai jamais rien enseigné ; et si quelqu’un prétend avoir appris ou entendu de moi en particulier autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, soyez persuadés que c’est une imposture. Vous savez maintenant pourquoi on aime à converser si long-temps avec moi : je vous ai dit la vérité toute pure ; c’est qu’on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages, et qui ne le sont point ; et, en effet, cela n’est pas désagréable. Et je n’agis ainsi, je vous le répète, que pour accomplir l’ordre que le dieu m’a donné par la voix des oracles, par celle des songes et par tous les moyens qu’aucune autre puissance céleste a jamais employés pour communiquer sa volonté à un mortel. Si ce que je vous dis n’était pas vrai, il vous serait aisé de me convaincre de mensonge ; car si je corrompais les jeunes gens, et que j’en eusse déjà corrompu, il faudrait que ceux qui, en avançant en âge, ont reconnu que je leur ai donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse, vinssent s’élever contre moi, et me faire punir ; et s’ils ne voulaient pas se charger eux-mêmes de ce rôle, ce serait le devoir des personnes de leur famille, comme leurs pères ou leurs frères ou leurs autres parents, de venir demander vengeance contre moi, si j’ai nui à ceux qui leur appartiennent ; et j’en vois plusieurs qui sont ici présents, comme Criton, qui est du même bourg que moi, et de mon âge, père de Critobule, que voici : Lysanias de Sphettios[26], avec son fils Eschine[27] ; Antiphon de Céphise[28] père d’Epigenès[29], et beaucoup d’autres dont les frères me fréquentaient, comme Nicostrate, fils de Zotide, et frère de Théodote. Il est vrai que Théodote est mort, et qu’ainsi il n’a plus besoin du secours de son frère. Je vois encore Parale, fils de Demodocus, et dont le frère était Théagès[30] ; Adimante, fils d’Ariston, avec son frère Platon ; Acéantodore, frère d’Apollodore, que je reconnais aussi[31], et beaucoup d’autres dont Mélitus aurait bien dû faire comparaître au moins un comme témoin dans sa cause. S’il n’y a pas pensé, il est encore temps ; je lui permets de le faire ; qu’il dise donc s’il le peut. Mais vous trouverez tout le contraire, Athéniens ; vous verrez qu’ils sont tout prêts à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu leurs enfants et leurs frères, s’il faut en croire Mélitus et Anytus ; car je ne veux pas faire valoir ici le témoignage de ceux que j’ai corrompus, ils pourraient avoir leur raison pour me défendre ; mais leurs parents, que je n’ai pas séduits, qui sont déjà avancés en âge, quelle autre raison peuvent-ils avoir de se déclarer pour moi, que mon bon droit et mon innocence, et leur persuasion que Mélitus est un imposteur, et que je dis la vérité ? Mais en voilà assez, Athéniens ; telles sont à-peu-près les raisons que je puis employer pour me défendre ; les autres seraient du même genre.
Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu’un parmi vous qui s’irritera contre moi, en se souvenant que, dans un péril beaucoup moins grand, il a conjuré et supplié les juges avec larmes, et que, pour exciter une plus grande compassion, il a fait paraître ses enfants, tous ses parents et tous ses amis ; au lieu que je ne fais rien de tout cela, quoique, selon toute apparence, je coure le plus grand danger. Peut-être que cette différence, se présentant à son esprit, l’aigrira contre moi, et que, dans le dépit que lui causera ma conduite, il donnera son suffrage avec colère. S’il y a ici quelqu’un qui soit dans ces sentiments, ce que je ne saurais croire, mais j’en fais la supposition, je pourrais lui dire avec raison : Mon ami, j’ai aussi des parents ; car pour me servir de l’expression d’Homère :
Je ne suis point né d’un chêne ou d’un rocher,[32]
mais d’un homme. Ainsi, Athéniens, j’ai des parents ; et pour des enfants, j’en ai trois, l’un déjà dans l’adolescence, les deux autres encore en bas âge ; et cependant je ne les ferai pas paraître ici pour vous engager à m’absoudre. Pourquoi ne le ferai-je pas ? Ce n’est ni par une opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris pour vous ; d’ailleurs, il ne s’agit pas ici de savoir si je regarde la mort avec intrépidité ou avec faiblesse ; mais pour mon honneur, pour le vôtre et celui de la république, il ne me paraît pas convenable d’employer ces sortes de moyens, à l’âge que j’ai, et avec ma réputation, vraie ou fausse, puisque enfin c’est une opinion généralement reçue que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire des hommes. En vérité, il serait honteux que ceux qui parmi vous se distinguent par la sagesse, le courage ou quelque autre vertu, ressemblassent à beaucoup de gens que j’ai vus, quoiqu’ils eussent toujours passé pour de grands personnages, faire pourtant des choses d’une bassesse étonnante quand on les jugeait, comme s’ils eussent cru qu’il leur arriverait un bien grand mal si vous les faisiez mourir, et qu’ils deviendraient immortels si vous daigniez-leur laisser la vie. De tels hommes déshonorent la patrie ; car ils donneraient lieu aux étrangers de penser que parmi les Athéniens, ceux qui ont le plus de vertu, et que tous les autres choisissent préférablement à eux-mêmes pour les élever aux emplois publics et aux dignités, ne diffèrent en rien des femmes ; et c’est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens, vous qui aimez la gloire ; et si nous voulions nous conduire ainsi, vous devriez ne pas le souffrir, et déclarer que celui qui a recours à ces scènes tragiques pour exciter la compassion, et qui par là vous couvre de ridicule, vous le condamnerez plutôt que celui qui attend tranquillement votre sentence. Mais sans parler de l’opinion, il me semble que la justice veut qu’on ne doive pas son salut à ses prières, qu’on ne supplie pas le juge, mais qu’on l’éclaire et qu’on le convainque ; car le juge ne siège pas ici pour sacrifier la justice au désir de plaire, mais pour la suivre religieusement : il a juré, non de faire grâce à qui bon lui semble, mais de juger suivant les lois. Il ne faut donc pas que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas vous y laisser accoutumer ; car les uns et les autres nous nous rendrions coupables envers les dieux. N’attendez donc point de moi, Athéniens, que j’aie recours auprès de vous à des choses que je ne crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j’y aie recours dans une occasion où je suis accusé d’impiété par Mélitus ; si je vous fléchissais par mes prières, et que je vous forçasse à violer votre serment, c’est alors que je vous enseignerais l’impiété, et en voulant me justifier, je prouverais contre moi-même que je ne crois point aux dieux. Mais il s’en faut bien, Athéniens, qu’il en soit ainsi. Je crois plus aux dieux qu’aucun de mes accusateurs ; et je vous abandonne avec confiance à vous et au dieu de Delphes le soin de prendre à mon égard le parti le meilleur et pour moi et pour vous.
[Ici les juges avant été aux voix, la majorité déclare que Socrate est coupable. Il reprend la parole :]
Le jugement que vous venez de prononcer, Athéniens, m’a peu ému, et par bien des raisons ; d’ailleurs je m’attendais à ce qui est arrivé. Ce qui me surprend bien plus, c’est le nombre des voix pour ou contre ; j’étais bien loin de m’attendre à être condamné à une si faible majorité ; car, à ce qu’il paraît, il n’aurait fallu que trois voix[33] de plus pour que je fusse absous. Je puis donc me flatter d’avoir échappé à Mélitus, et non-seulement je lui ai échappé, mais il est évident que si Anytus et Lycon ne se fussent levés pour m’accuser, il aurait été condamné à payer mille drachmes[34], comme n’ayant pas obtenu la cinquième partie des suffrages.
C’est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi, à la bonne heure ; et moi, de mon côté, Athéniens, à quelle peine me condamnerai-je[35] ? Je dois choisir ce qui m’est dû ; Et que m’est-il dû ? Quelle peine afflictive, ou quelle amende mérité-je, moi, qui me suis fait un principe de ne connaître aucun repos pendant toute ma vie, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d’empressement, les richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois militaires, les fonctions d’orateur et toutes les autres dignités ; moi, qui ne suis jamais entré dans aucune des conjurations et des cabales si fréquentes dans la république, me trouvant réellement trop honnête homme pour ne pas me perdre en prenant part à tout cela ; moi qui, laissant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous ni à moi, n’ai voulu d’autre occupation que celle de vous rendre à chacun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous individuellement à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement plutôt qu’à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sages ; à ne pas songer aux intérêts passagers de la patrie plutôt qu’à la patrie elle-même, et ainsi de tout le reste ? Athéniens, telle a été ma conduite ; que mérite-t-elle ? Une récompense, si vous voulez être justes, et même une récompense qui puisse me convenir. Or, qu’est-ce qui peut convenir à un homme pauvre, votre bienfaiteur, qui a besoin de loisir pour ne s’occuper qu’à vous donner des conseils utiles ? Il n’y a rien qui lui convienne plus, Athéniens, que d’être nourri dans le Prytanée ; et il le mérite bien plus que celui qui, aux jeux Olympiques, a remporté le prix de la course à cheval, ou de la course des chars à deux ou à quatre chevaux[36] ; car celui-ci ne vous rend heureux qu’en apparence : moi, je vous enseigne à l’être véritablement : celui-ci a de quoi vivre, et moi je n’ai rien. Si donc il me faut déclarer ce que je mérite, en bonne justice, je le déclare, c’est d’être nourri au Prytanée.
Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m’accuserez peut-être de la même arrogance qui me faisait condamner tout-à-l’heure les prières et les lamentations. Mais ce n’est nullement cela ; mon véritable motif est que j’ai la conscience de n’avoir jamais commis envers personne d’injustice volontaire ; mais je ne puis vous le persuader, car il n’y a que quelques instants que nous nous entretenons ensemble, tandis que vous auriez fini par me croire peut-être, si vous aviez, comme d’autres peuples, une loi qui, pour une condamnation à mort, exigeât un procès de plusieurs jours[37], au lieu qu’en si peu de temps, il est impossible de détruire des calomnies invétérées. Ayant donc la conscience que je n’ai jamais été injuste envers personne, je suis bien éloigné de vouloir l’être envers moi-même ; d’avouer que je mérite une punition, et de me condamner à quelque chose de semblable ; et cela dans quelle crainte ? Quoi ! pour éviter la peine que réclame contre moi Mélitus, et de laquelle j’ai déjà dit que je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j’irai choisir une peine que je sais très certainement être un mal, et je m’y condamnerai moi-même ! Choisirai-je les fers ? Mais pourquoi me faudrait-il passer ma vie en prison, esclave du pouvoir des Onze, qui se renouvelle toujours[38]? Une amende, et la prison jusqu’à ce que je l’aie payée ? Mais cela revient au même, car je n’ai pas de quoi la payer. Me condamnerai-je à l’exil ? Peut-être y consentiriez-vous. Mais il faudrait que l’amour de la vie m’eût bien aveuglé, Athéniens, pour que je pusse m’imaginer que, si vous, mes concitoyens, vous n’avez pu supporter ma manière d’être et mes discours, s’ils vous sont devenus tellement importuns et odieux qu’aujourd’hui vous voulez enfin vous en délivrer, d’autres n’auront pas de peine à les supporter. Il s’en faut de beaucoup, Athéniens. En vérité, ce serait une belle vie pour moi, vieux comme je suis, de quitter mon pays, d’aller errant de ville en ville, et de vivre comme un proscrit ! Car je sais que partout où j’irai, les jeunes gens viendront m’écouter comme ici ; si je les rebute, eux-mêmes me feront bannir par les hommes plus âgés ; et si je ne les rebute pas, leurs pères et leurs parents me banniront, à cause d’eux.
Mais me dira-t-on peut-être : Socrate, quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu pas te tenir en repos, et garder le silence ? Voilà ce qu’il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d’entre vous ; car si je dis que ce serait désobéir au dieu, et que par cette raison, il m’est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point, et prendrez cette réponse pour une plaisanterie ; et, d’un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de l’homme, c’est de s’entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m’avez entendu discourir, m’examinant et moi-même et les autres : car une vie sans examen n’est pas une vie ; si je vous dis cela, vous me croirez encore moins. Voilà pourtant la vérité, Athéniens ; mais il n’est pas aisé de vous en convaincre. Au reste, je ne suis point accoutumé à me juger digne de souffrir aucun mal. Si j’étais riche, je me condamnerais volontiers à une amende telle que je pourrais la payer, car cela ne me ferait aucun tort ; mais, dans la circonstance présente… car enfin je n’ai rien… à moins que vous ne consentiez à m’imposer seulement à ce que je suis en état de payer ; et je pourrais aller peut-être jusqu’à une mine d’argent ; c’est donc à cette somme que je me condamne. Mais Platon, que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne à trente mines, dont ils répondent. En conséquence, je m’y condamne ; et assurément je vous présente des cautions qui sont très solvables.
[Ici les juges vont aux voix pour l’application de la peine, et Socrate est condamné à mort. Il poursuit :]
POUR n’avoir pas eu la patience d’attendre un peu de temps, Athéniens, vous allez fournir un prétexte à ceux qui voudront diffamer la république ; ils diront que vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage ; car, pour aggraver votre honte, ils m’appelleront sage, quoique je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu de temps, la chose serait venue d’elle-même ; car voyez mon âge ; je suis déjà bien avancé dans la vie, et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m’ont condamné à mort ; c’est à ceux-là que je veux m’adresser encore. Peut-être pensez-vous que si j’avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver, je n’y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader ? Non, ce ne sont pas les paroles qui m’ont manqué, Athéniens, mais l’impudence : je succombe pour n’avoir pas voulu vous dire les choses que vous aimez tant à entendre ; pour n’avoir pas voulu me lamenter, pleurer et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumés. Mais le péril où j’étais ne m’a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d’un homme libre, et maintenant encore je ne me repens pas de m’être ainsi défendu ; j’aime beaucoup mieux mourir après m’être défendu comme je l’ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni dans les combats, il n’est permis ni à moi ni à aucun autre d’employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu’à la guerre il serait très facile de sauver sa vie, en jetant ses armes, et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent ; de même dans tous les dangers, on trouve mille expédients pour éviter la mort, quand on est décidé à tout dire et à tout faire. Eh ! ce n’est pas là ce qui est difficile, Athéniens, que d’éviter la mort ; mais il l’est beaucoup d’éviter le crime ; il court plus vite que la mort. C’est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux, tandis que le plus agile, le crime, s’est attaché à mes accusateurs, qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m’en vais donc subir la mort à laquelle vous m’avez condamné, et eux l’iniquité et l’infamie à laquelle la vérité les condamne. Pour moi, je m’en tiens à ma peine, et eux à la leur. En effet, peut-être est-ce ainsi que les choses devaient se passer, et, selon moi, tout est pour le mieux.
Après cela, ô vous qui m’avez condamné voici ce que j’ose vous prédire ; car je suis précisément dans les circonstances où les hommes lisent dans l’avenir, au moment de quitter la vie. Je vous dis donc que si vous me faites périr, vous en serez punis aussitôt après ma mort par une peine bien plus cruelle que celle à laquelle vous me condamnez ; en effet, vous ne me faites mourir que pour vous délivrer de l’importun fardeau de rendre compte de votre vie ; mais il vous arrivera tout le contraire, je vous le prédis. Il va s’élever contre vous un bien plus grand nombre de censeurs que je retenais sans que vous vous en aperçussiez ; censeurs d’autant plus difficiles, qu’ils sont plus jeunes, et vous n’en serez que plus irrités ; car si vous pensez qu’en tuant les gens, vous empêcherez qu’on vous reproche de mal vivre, vous vous trompez. Cette manière de se délivrer de ses censeurs n’est ni honnête ni possible : celle qui est en même temps et la plus honnête et la plus facile, c’est, au lieu de fermer la bouche aux autres, de se rendre meilleur soi-même. Voilà ce que j’avais à prédire à ceux qui m’ont condamné : il ne me reste qu’à prendre congé d’eux.
Mais pour vous, qui m’avez absous par vos suffrages, Athéniens, je m’entretiendrai volontiers avec vous sur ce qui vient de se passer, pendant que les magistrats[39] sont occupés, et qu’on ne me mène pas encore où je dois mourir. Arrêtez-vous donc quelques instants, et employons à converser ensemble le temps qu’on me laisse. Je veux vous raconter, comme à mes amis, une chose qui m’est arrivée aujourd’hui, et vous apprendre ce qu’elle signifie. Oui, juges (et en vous appelant ainsi, je vous donne le nom que vous méritez), il m’est arrivé aujourd’hui quelque chose d’extraordinaire. Cette inspiration prophétique qui n’a cessé de se faire entendre à moi dans tout le cours de ma vie, qui dans les moindres occasions n’a jamais manqué de me détourner de tout ce que j’allais faire de mal, aujourd’hui qu’il m’arrive ce que vous voyez, ce qu’on pourrait prendre, et ce qu’on prend en effet pour le plus grand de tous les maux, cette voix divine a gardé le silence ; elle ne m’a arrêté ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni quand je suis venu devant ce tribunal, ni tandis que je parlais, quand j’allais dire quelque chose. Cependant, dans beaucoup d’autres circonstances, elle vint m’interrompre au milieu de mon discours ; mais aujourd’hui elle ne s’est opposée à aucune de mes actions, à aucune de mes paroles : quelle en peut être la cause ? Je vais vous le dire ; c’est que ce qui m’arrive est, selon toute vraisemblance, un bien ; et nous nous trompons sans aucun doute, si nous pensons que la mort soit un mal. Une preuve évidente pour moi, c’est qu’infailliblement, si j’eusse dû mal faire aujourd’hui, le signe ordinaire m’en eût averti.
Voici encore quelques raisons d’espérer que la mort est un bien. Il faut qu’elle soit de deux choses l’une, ou l’anéantissement absolu, et la destruction de toute conscience, ou, comme on le dit, un simple changement, le passage de l’âme d’un lieu dans un autre. Si la mort est la privation de tout sentiment, un sommeil sans aucun songe, quel merveilleux avantage n’est-ce pas que de mourir ? Car, que quelqu’un choisisse une nuit ainsi passée dans un sommeil profond que n’aurait troublé aucun songe, et qu’il compare cette nuit avec toutes les nuits et avec tous les jours qui ont rempli le cours entier de sa vie ; qu’il réfléchisse, et qu’il dise en conscience combien dans sa vie il a eu de jours et de nuits plus heureuses et plus douces que celle-là ; je suis persuadé que non-seulement un simple particulier, mais que le grand roi lui-même en trouverait un bien petit nombre, et qu’il serait aisé de les compter. Si la mort est quelque chose de semblable ; je dis qu’elle n’est pas un mal ; car la durée tout entière ne paraît plus ainsi qu’une seule nuit. Mais si la mort est un passage de ce séjour dans un autre, et si ce qu’on dit est véritable, que là est le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus grand bien peut-on imaginer, mes juges ? Car enfin, si en arrivant aux enfers, échappés à ceux qui se prétendent ici-bas des juges, l’on y trouve les vrais juges, ceux qui passent pour y rendre la justice, Minos, Rhadamanthe, Éaque, Triptolème et tous ces autres demi-dieux qui ont été justes pendant leur vie, le voyage serait-il donc si malheureux ? Combien ne donnerait-on pas pour s’entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode, Homère ? Quant à moi, si cela est véritable, je veux mourir plusieurs fois. Oh ! pour moi surtout l’admirable passe-temps, de me trouver là avec Palamède[40], Ajax fils de Télamon, et tous ceux des temps anciens, qui sont morts victimes de condamnations injustes ! Quel agrément de comparer mes aventures avec les leurs ! Mais mon plus grand plaisir serait d’employer ma vie, là comme ici, à interroger et à examiner tous ces personnages pour distinguer ceux qui sont véritablement sages, et ceux qui croient l’être et ne le sont point. À quel prix ne voudrait-on pas, mes juges, examiner un peu celui qui mena contre Troie une si nombreuse armée[41], ou Ulysse[42] ou Sisyphe, et tant d’autres, hommes et femmes, avec lesquels ce serait une félicité inexprimable de converser et de vivre, en les observant et les examinant ? Là du moins on n’est pas condamné à mort pour cela ; car les habitants de cet heureux séjour, entre mille avantages qui mettent leur condition bien au-dessus de la nôtre, jouissent d’une vie immortelle, si du moins ce qu’on en dit est véritable.
C’est pourquoi, mes juges, soyez pleins d’espérance dans la mort, et ne pensez qu’à cette vérité, qu’il n’y a aucun mal pour l’homme de bien, ni pendant sa vie ni après sa mort, et que les dieux ne l’abandonnent jamais ; car ce qui m’arrive n’est point l’effet du hasard, et il est clair pour moi que mourir dès à présent, et être délivré des soucis de la vie, était ce qui me convenait le mieux ; aussi la voix céleste s’est tue aujourd’hui, et je n’ai aucun ressentiment contre mes accusateurs, ni contre ceux qui m’ont condamné, quoique leur intention n’ait pas été de me faire du bien, et qu’ils n’aient cherché qu’à me nuire ; en quoi j’aurais bien quelque raison de me plaindre d’eux. Je ne leur ferai qu’une seule prière. Lorsque mes enfants seront grands, si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose plus que la vertu, punissez-les, en les tourmentant comme je vous ai tourmentés ; et, s’ils se croient quelque chose, quoiqu’ils ne soient rien, faites-les rougir de leur insouciance et de leur présomption : c’est ainsi que je me suis conduit avec vous. Si vous faites cela, moi et mes enfants nous n’aurons qu’à nous louer de votre justice. Mais il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage ? Personne ne le sait, excepté Dieu.
 votre commentaire
votre commentaire
-
" J'Accuse "
Émile Zola

J’Accuse…!
LETTRE
A M. FÉLIX FAURE
Président de la République–––
Monsieur le Président,
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ?
Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette fête patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre Exposition Universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom — j’allais dire sur votre règne — que cette abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis.
Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis.
Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l’ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ?
⁂
La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus.
Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c’est le lieutenant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l’affaire Dreyfus tout entière ; on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l’esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d’intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C’est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus ; c’est lui qui rêva de l’étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c’est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d’une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l’accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l’émoi du réveil. Et je n’ai pas à tout dire, qu’on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a été commise.
Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des « fuites » avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd’hui encore ; et l’auteur du bordereau était recherché, lorsqu’un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu’un officier de l’état-major, et un officier d’artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu’il ne pouvait s’agir que d’un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c’était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l’en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès qu’un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c’est lui qui a inventé Dreyfus, l’affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de l’amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la Guerre, le général Mercier, dont l’intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l’état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l’état-major, le général Gonse, dont la conscience a pu s’accommoder de beaucoup de choses. Mais, au fond, il n’y a d’abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s’occupe aussi de spiritisme, d’occultisme, il converse avec les esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante.
Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s’arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l’instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d’expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n’était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j’insiste, c’est que l’œuf est ici, d’où va sortir plus tard le vrai crime, l’épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l’erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu s’y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu’ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n’y a donc, de leur part, que de l’incurie et de l’inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l’esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise.
Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l’ennemi pour conduire l’empereur allemand jusqu’à Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l’Histoire ; et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n’a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer, d’étudier attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.
Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœurs bondisse d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation démesurée, là-bas, à l’île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau ; et nous apprenons même que les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu’il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé, et il vient de le juger une seconde fois.
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce qu’on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable ! Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où il est parlé d’un certain D… qui devient trop exigeant : quelque mari sans doute trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non ! C’est un mensonge ! et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent impunément sans qu’on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique.
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux « sales juifs », qui déshonore notre époque.
⁂
Et nous arrivons à l’affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondément, s’inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l’innocence de Dreyfus.
Je ne ferai pas l’historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu’il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l’état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c’est à ce titre, dans l’exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre-télégramme, adressée au commandant Esterhazy, par un agent d’une puissance étrangère. Son devoir strict était d’ouvrir une enquête. La certitude est qu’il n’a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la Guerre. Le fameux dossier Picquart, dont il a été tant parlé, n’a jamais été que le dossier Billot, j’entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la Guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu’il faut affirmer bien haut, c’est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d’Esterhazy, c’est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le bordereau ne fût de l’écriture d’Esterhazy. L’enquête du lieutenant-colonel Picquart avait abouti à cette constatation certaine. Mais l’émoi était grand, car la condamnation d’Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus ; et c’était ce que l’état-major ne voulait à aucun prix.
Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d’angoisse. Remarquez que le général Billot n’était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n’osa pas, dans la terreur sans doute de l’opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l’état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis, ce ne fut là qu’une minute de combat entre sa conscience et ce qu’il croyait être l’intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s’était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa responsabilité n’a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable qu’eux, car il a été le maître de faire justice, et il n’a rien fait. Comprenez-vous cela ! Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose ! Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu’ils aiment !
Le colonel Picquart avait rempli son devoir d’honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même, il leur disait combien leurs délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s’amoncelait, qui devait éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scheurer-Kestner tint également au général Billot, l’adjurant par patriotisme de prendre en main l’affaire, de ne pas la laisser s’aggraver, au point de devenir un désastre public. Non ! Le crime était commis, l’état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picquart fut envoyé en mission, on l’éloigna de plus en plus loin, jusqu’en Tunisie, où l’on voulut même un jour honorer sa bravoure, en le chargeant d’une mission qui l’aurait sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n’était pas en disgrâce, le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu’il ne fait pas bon d’avoir surpris.
À Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l’on sait de quelle façon l’orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des Sceaux, une demande en révision du procès. Et c’est ici que le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d’abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis, tout d’un coup, il paye d’audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. C’est que du secours lui était venu, il avait reçu une lettre anonyme l’avertissant des menées de ses ennemis, une dame mystérieuse s’était même dérangée de nuit pour lui remettre une pièce volée à l’état-major, qui devait le sauver. Et je ne puis m’empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du Paty de Clam, en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Dreyfus, était en péril, et il a voulu sûrement défendre son œuvre. La révision du procès, mais c’était l’écroulement du roman- feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l’île du Diable ! C’est ce qu’il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, l’un le visage découvert, l’autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c’est toujours l’état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l’abomination grandit d’heure en heure.
On s’est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy. C’est d’abord, dans l’ombre, le lieutenant-colonel du Paty de Clam qui a tout machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. Puis, c’est le général de Boisdeffre, c’est le général Gonse, c’est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu’ils ne peuvent laisser reconnaître l’innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l’honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu’on bafouera et qu’on punira. Ô justice, quelle affreuse désespérance serre le cœur ! On va jusqu’à dire que c’est lui le faussaire, qu’il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi ? dans quel but ? donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les juifs ? Le joli de l’histoire est qu’il était justement antisémite. Oui ! nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l’innocence, tandis qu’on frappe l’honneur même, un homme à la vie sans tache ! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.
Voilà donc, monsieur le Président, l’affaire Esterhazy : un coupable qu’il s’agissait d’innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J’abrège, car ce n’est ici, en gros, que le résumé de l’histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate d’où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué le conseil de guerre.
⁂
Comment a-t-on pu espérer qu’un conseil de guerre déferait ce qu’un conseil de guerre avait fait ?
Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L’idée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir d’équité ? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministre de la Guerre, le grand chef, a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l’autorité de la chose jugée, vous voulez qu’un conseil de guerre lui donne un formel démenti ? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L’opinion préconçue qu’ils ont apportée sur leur siège, est évidemment celle-ci : « Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre, il est donc coupable ; et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent ; or nous savons que reconnaître la culpabilité d’Esterhazy, ce serait proclamer l’innocence de Dreyfus. » Rien ne pouvait les faire sortir de là.
Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l’honneur de l’armée, on veut que nous l’aimions, la respections. Ah ! certes, oui, l’armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple, et nous n’avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s’agit pas d’elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s’agit du sabre, le maître qu’on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le dieu, non !
Je l’ai démontré d’autre part : l’affaire Dreyfus était l’affaire des bureaux de la guerre, un officier de l’état-major, dénoncé par ses camarades de l’état-major, condamné sous la pression des chefs de l’état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent sans que tout l’état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des influences, n’ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-même ! Où est-il, le ministère vraiment fort et d’un patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renouveler ? Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d’angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense nationale ! Et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, est devenu cet asile sacré, où se décide le sort de la patrie ! On s’épouvante devant le jour terrible que vient d’y jeter l’affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d’un malheureux, d’un « sale juif » ! Ah ! tout ce qui s’est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d’inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d’État !
Et c’est un crime encore que de s’être appuyé sur la presse immonde, que de s’être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C’est un crime d’avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu’on ourdit soi-même l’impudent complot d’imposer l’erreur, devant le monde entier. C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire délirer. C’est un crime d’empoisonner les petits et les humbles, d’exaspérer les passions de réaction et d’intolérance, en s’abritant derrière l’odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l’homme mourra, si elle n’en est pas guérie. C’est un crime que d’exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c’est un crime, enfin, que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l’œuvre prochaine de vérité et de justice.
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies ! Je me doute de l’écroulement qui doit avoir lieu dans l’âme de M. Scheurer-Kestner, et je crois bien qu’il finira par éprouver un remords, celui de n’avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l’interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand honnête homme, l’homme de sa vie loyale, il a cru que la vérité se suffisait à elle- même, surtout lorsqu’elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire ? Et c’est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picquart, qui, par un sentiment de haute dignité, n’a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ces scrupules l’honorent d’autant plus que, pendant qu’il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l’on a même vu, pour le lieutenant-colonel Picquart, cette chose ignoble : un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l’accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos, lorsque ce témoin a été introduit pour s’expliquer et se défendre. Je dis que ceci est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice.
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n’en avez pas moins un devoir d’homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. Ce n’est pas, d’ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. C’est d’aujourd’hui seulement que l’affaire commence, puisque aujourd’hui seulement les positions sont nettes : d’une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse ; de l’autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu’elle soit faite. Je l’ai dit ailleurs, et je le répète ici : quand on enferme la vérité sous terre, elle s’y amasse, elle y prend une force telle d’explosion, que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l’on ne vient pas de préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres.
⁂
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure.
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle.
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major compromis.
J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable.
J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.
J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.
J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.
J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable.
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !
J’attends.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.Émile Zola
 votre commentaire
votre commentaire
-
Histoire d'un merle blanc
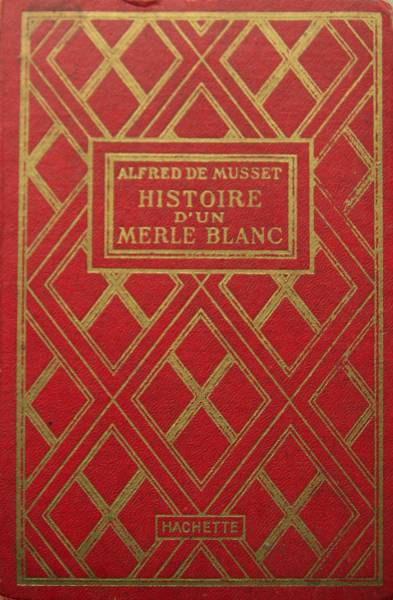
I
Qu’il est glorieux, mais qu’il est pénible d’être en ce monde un merle exceptionnel ! Je ne suis point un oiseau fabuleux, et M. de Buffon m’a décrit. Mais, hélas ! je suis extrêmement rare et très difficile à trouver. Plût au ciel que je fusse tout à fait impossible !
Mon père et ma mère étaient deux bonnes gens qui vivaient, depuis nombre d’années, au fond d’un vieux jardin retiré du Marais. C’était un ménage exemplaire. Pendant que ma mère, assise dans un buisson fourré, pondait régulièrement trois fois par an, et couvait, tout en sommeillant, avec une religion patriarcale, mon père, encore fort propre et fort pétulant, malgré son grand âge, picorait autour d’elle toute la journée, lui apportant de beaux insectes qu’il saisissait délicatement par le bout de la queue pour ne pas dégoûter sa femme, et, la nuit venue, il ne manquait jamais, quand il faisait beau, de la régaler d’une chanson qui réjouissait tout le voisinage. Jamais une querelle, jamais le moindre nuage n’avait troublé cette douce union.
À peine fus-je venu au monde, que, pour là première fois de sa vie, mon père commença à montrer de la mauvaise humeur. Bien que je ne fusse encore que d’un gris douteux, il ne reconnaissait en moi ni la couleur, ni la tournure de sa nombreuse postérité.
— Voilà un sale enfant, disait-il quelquefois en me regardant de travers ; il faut que ce gamin-là aille apparemment se fourrer dans tous les plâtras et tous les tas de boue qu’il rencontre, pour être toujours si laid et si crotté.
— Eh, mon Dieu ! mon ami, répondait ma mère, toujours roulée en boule dans une vieille écuelle dont elle avait fait son nid, ne voyez-vous pas que c’est de son âge ? Et vous-même, dans votre jeune temps, n’avez-vous pas été un charmant vaurien ? Laissez grandir notre merlichon, et vous verrez comme il sera beau ; il est des mieux que j’aie pondus. Tout en prenant ainsi ma défense, ma mère ne s’y trompait pas ; elle voyait pousser mon fatal plumage, qui lui semblait une monstruosité ; mais elle faisait comme toutes les mères qui s’attachent souvent à leurs enfants par cela même qu’ils sont maltraités de la nature, comme si la faute en était à elles, ou comme si elles repoussaient d’avance l’injustice du sort qui doit les frapper.
Quand vint le temps de ma première mue, mon père devint tout à fait pensif et me considéra attentivement. Tant que mes plumes tombèrent, il me traita encore avec assez de bonté et me donna même la pâtée, me voyant grelotter presque nu dans un coin ; mais dès que mes pauvres ailerons transis commencèrent à se recouvrir de duvet, à chaque plume blanche qu’il vit paraître, il entra dans une telle colère, que je craignis qu’il ne me plumât pour le reste de mes jours ! Hélas ! je n’avais pas de miroir ; j’ignorais le sujet de cette fureur, et je me demandais pourquoi le meilleur des pères se montrait pour moi si barbare.
Un jour qu’un rayon de soleil et ma fourrure naissante m’avaient mis, malgré moi, le cœur en joie, comme je voltigeais dans une allée, je me mis, pour mon malheur, à chanter. À la première note qu’il entendit, mon père sauta en l’air comme une fusée.
— Qu’est-ce que j’entends-là ? s’écria-t-il ; est-ce ainsi qu’un merle siffle ? est-ce ainsi que je siffle ? est-ce là siffler ?
Et, s’abattant près de ma mère avec la contenance la plus terrible :
— Malheureuse ! dit-il, qui est-ce qui a pondu dans ton nid ?
À ces mots, ma mère indignée s’élança de son écuelle, non sans se faire du mal à une patte ; elle voulut parler, mais ses sanglots la suffoquaient, elle tomba à terre à demi pâmée. Je la vis près d’expirer ; épouvanté et tremblant de peur, je me jetai aux genoux de mon père.
— Ô mon père ! lui dis-je, si je siffle de travers, et si je suis mal vêtu, que ma mère n’en soit point punie ! Est-ce sa faute si la nature m’a refusé une voix comme la vôtre ? Est-ce sa faute si je n’ai pas votre beau bec jaune et votre bel habit noir à la française, qui vous donnent l’air d’un marguillier en train d’avaler une omelette ? Si le Ciel a fait de moi un monstre, et si quelqu’un doit en porter la peine, que je sois du moins le seul malheureux !
— Il ne s’agit pas de cela, dit mon père ; que signifie la manière absurde dont tu viens de te permettre de siffler ? qui t’a appris à siffler ainsi contre tous les usages et toutes les règles ?
— Hélas ! monsieur, répondis-je humblement, j’ai sifflé comme je pouvais, me sentant gai parce qu’il fait beau, et ayant peut-être mangé trop de mouches.
— On ne siffle pas ainsi dans ma famille, reprit mon père hors de lui. Il y a des siècles que nous sifflons de père en fils, et, lorsque je fais entendre ma voix la nuit, apprends qu’il y a ici, au premier étage, un vieux monsieur, et au grenier une jeune grisette, qui ouvrent leurs fenêtres pour m’entendre. N’est-ce pas assez que j’aie devant les yeux l’affreuse couleur de tes sottes plumes qui te donnent l’air enfariné comme un paillasse de la foire ? Si je n’étais le plus pacifique des merles, je t’aurais déjà cent fois mis à nu, ni plus ni moins qu’un poulet de basse-cour prêt à être embroché.
— Eh bien ! m’écriai-je, révolté de l’injustice de mon père, s’il en est ainsi, monsieur, qu’à cela ne tienne ! je me déroberai à votre présence, je délivrerai vos regards de cette malheureuse queue blanche, par laquelle vous me tirez toute la journée. Je partirai, monsieur, je fuirai ; assez d’autres enfants consoleront votre vieillesse, puisque ma mère pond trois fois par an ; j’irai loin de vous cacher ma misère, et peut-être, ajoutai-je en sanglotant, peut-être trouverai-je, dans le potager du voisin ou sur les gouttières, quelques vers de terre ou quelques araignées pour soutenir ma triste existence.
— Comme tu voudras, répliqua mon père, loin de s’attendrir à ce discours ; que je ne te voie plus ! Tu n’es pas mon fils ; tu n’es pas un merle.
— Et que suis-je donc, monsieur, s’il vous plaît ?
— Je n’en sais rien, mais tu n’es pas un merle. Après ces paroles foudroyantes, mon père s’éloigna à pas lents. Ma mère se releva tristement, et alla, en boitant, achever de pleurer dans son écuelle. Pour moi, confus et désolé, je pris mon vol du mieux que je pus, et j’allai, comme je l’avais annoncé, me percher sur la gouttière d’une maison voisine.II
Mon père eut l’inhumanité de me laisser pendant plusieurs jours dans cette situation mortifiante. Malgré sa violence, il avait bon cœur, et, aux regards détournés qu’il me lançait, je voyais bien qu’il aurait voulu me pardonner et me rappeler ; ma mère, surtout, levait sans cesse vers moi des yeux pleins de tendresse, et se risquait même parfois à m’appeler d’un petit cri plaintif ; mais mon horrible plumage blanc leur inspirait, malgré eux, une répugnance et un effroi auxquels je vis bien qu’il n’y avait point de remède.
— Je ne suis point un merle ! me répétais-je ; et, en effet, en m’épluchant le matin et en me mirant dans l’eau de la gouttière, je ne reconnaissais que trop clairement combien je ressemblais peu à ma famille. — Ô ciel ! répétais-je encore, apprends-moi donc ce que je suis !
Une certaine nuit qu’il pleuvait averse, j’allais m’endormir exténué de faim et de chagrin, lorsque je vis se poser près de moi un oiseau plus mouillé, plus pâle et plus maigre que je ne le croyais possible. Il était à peu près de ma couleur, autant que j’en pus juger à travers la pluie qui nous inondait ; à peine avait-il sur le corps assez de plumes pour habiller un moineau, et il était plus gros que moi. Il me sembla, au premier abord, un oiseau tout à fait pauvre et nécessiteux ; mais il gardait, en dépit de l’orage qui maltraitait son front presque tondu, un air déserté qui me charma. Je lui fis modestement une grande révérence, à laquelle il répondit par un coup de bec qui faillit me jeter à bas de la gouttière. Voyant que je me grattais l’oreille et que je me retirais avec componction sans essayer de lui répondre en sa langue :
— Qui es-tu ? me demanda-t-il d’une voix aussi enrouée que son crâne était chauve.
— Hélas ! monseigneur, répondis-je (craignant une seconde estocade), je n’en sais rien. Je croyais être un merle, mais l’on m’a convaincu que je n’en suis pas un.
La singularité de ma réponse et mon air de sincérité l’intéressèrent. Il s’approcha de moi et me fit conter mon histoire, ce dont je m’acquittai avec toute la tristesse et toute l’humilité qui convenaient à ma position et au temps affreux qu’il faisait.
— Si tu étais un ramier comme moi, me dit-il après m’avoir écouté, les niaiseries dont tu t’affliges ne t’inquiéteraient pas un moment. Nous voyageons, c’est là notre vie, et nous avons bien nos amours, mais je ne sais qui est mon père. Fendre l’air, traverser l’espace, voir à nos pieds les monts et les plaines, respirer l’azur même des cieux, et non les exhalaisons de la terre, courir comme la flèche à un but marqué qui ne nous échappe jamais, voilà notre plaisir et notre existence. Je fais plus de chemin en un jour qu’un homme n’en peut faire en dix.
— Sur ma parole, monsieur, dis-je un peu enhardi, vous êtes un oiseau bohémien.
— C’est encore une chose dont je ne me soucie guère, reprit-il. Je n’ai point de pays ; je ne connais que trois choses : les voyages, ma femme et mes petits. Où est ma femme, là est ma patrie.
— Mais qu’avez-vous là qui vous pend au cou ? C’est comme une vieille papillotte chiffonnée.
— Ce sont des papiers d’importance, répondit-il en se rengorgeant ; je vais à Bruxelles de ce pas, et je porte au célèbre banquier *** une nouvelle qui va faire baisser la rente d’un franc soixante-dix-huit centimes.
— Juste Dieu ! m’écriai-je, c’est une belle existence que la vôtre, et Bruxelles, j’en suis sûr, doit être une ville bien curieuse à voir. Ne pourriez-vous pas m’emmener avec vous ? Puisque je ne suis pas un merle, je suis peut-être un pigeon ramier.
— Si tu en étais un, répliqua-t-il, tu m’aurais rendu le coup de bec que je t’ai donné tout à l’heure.
— Eh bien ! monsieur, je vous le rendrai ; ne nous brouillons pas pour si peu de chose. Voilà le matin qui paraît et l’orage qui s’apaise. De grâce, laissez-moi vous suivre ! Je suis perdu, je n’ai plus rien au monde ; — si vous me refusez, il ne me reste plus qu’à me noyer dans cette gouttière.
— Eh bien, en route ! suis-moi si tu peux.
Je jetai un dernier regard sur le jardin où dormait ma mère. Une larme coula de mes yeux ; le vent et la pluie l’emportèrent. J’ouvris mes ailes et je partis.III
Mes ailes, je l’ai dit, n’étaient pas encore bien robustes. Tandis que mon conducteur allait comme le vent, je m’essoufflais à ses côtés ; je tins bon pendant quelque temps, mais bientôt il me prit un éblouissement si violent, que je me sentis près de défaillir.
— Y en a-t-il encore pour longtemps ? demandai-je d’une voix faible.
— Non, me répondit-il, nous sommes au Bourget ; nous n’avons plus que soixante lieues à faire.
J’essayai de reprendre courage, ne voulant pas avoir l’air d’une poule mouillée, et je volai encore un quart d’heure ; mais, pour le coup, j’étais rendu.
— Monsieur, bégayai-je de nouveau, ne pourrait-on pas s’arrêter un instant ? J’ai une soif horrible qui me tourmente, et, en nous perchant sur un arbre…
— Va-t’en au diable ! tu n’es qu’un merle ! me répondit le ramier en colère.
Et, sans daigner tourner la tête, il continua son voyage enragé. Quant à moi, abasourdi et n’y voyant plus, je tombai dans un champ de blé.
J’ignore combien de temps dura mon évanouissement. Lorsque je repris connaissance, ce qui me revint d’abord en mémoire fut la dernière parole du ramier : Tu n’es qu’un merle, m’avait-il dit.
— Ô mes chers parents ! pensai-je, vous vous êtes donc trompés ! Je vais retourner près de vous ; vous me reconnaîtrez pour votre vrai et légitime enfant, et vous me rendrez ma place dans ce bon petit tas de feuilles qui est sous l’écuelle de ma mère.
Je fis un effort pour me lever ; mais la fatigue du voyage et la douleur que je ressentais de ma chute me paralysaient tous les membres. À peine me fus-je dressé sur mes pattes, que la défaillance me reprit, et je retombai sur le flanc.
L’affreuse pensée de la mort se présentait déjà à mon esprit, lorsque, à travers les bluets et les coquelicots, je vis venir à moi, sur la pointe du pied, deux charmantes personnes. L’une était une petite pie fort bien mouchetée et extrêmement coquette, et l’autre une tourterelle couleur de rose. La tourterelle s’arrêta à quelques pas de distance, avec un grand air de pudeur et de compassion pour mon infortune ; mais la pie s’approcha en sautillant de la manière la plus agréable du monde.
— Eh, bon Dieu ! pauvre enfant, que faites-vous là ? me demanda-t-elle d’une voix folâtre et argentine.
— Hélas ! madame la marquise, répondis-je (car c’en devait être une pour le moins), je suis un pauvre diable de voyageur que son postillon a laissé en route, et je suis en train de mourir de faim.
— Sainte Vierge ! que me dites-vous ? répondit-elle.
Et aussitôt elle se mit à voltiger çà et là sur les buissons qui nous entouraient, allant et venant de côté et d’autre, m’apportant quantité de baies et de fruits, dont elle fit un petit tas près de moi, tout en continuant ses questions.
— Mais qui êtes-vous ? mais d’où venez-vous ? C’est une chose incroyable que votre aventure ! Et où alliez-vous ? Voyager seul, si jeune, car vous sortez de votre première mue ! Que font vos parents ? d’où sont-ils ? comment vous laissent-ils aller dans cet état-là ? Mais c’est à faire dresser les plumes sur la tête !
Pendant qu’elle parlait, je m’étais soulevé un peu de côté, et je mangeais de grand appétit. La tourterelle restait immobile, me regardant toujours d’un œil de pitié. Cependant elle remarqua que je retournais la tête d’un air languissant, et elle comprit que j’avais soif. De la pluie tombée dans la nuit une goutte restait sur un brin de mouron ; elle recueillit timidement cette goutte dans son bec, et me l’apporta toute fraîche. Certainement, si je n’eusse pas été si malade, une personne si réservée ne se serait jamais permis une pareille démarche.
Je ne savais pas encore ce que c’est que l’amour, mais mon cœur battait violemment. Partagé entre deux émotions diverses, j’étais pénétré d’un charme inexplicable. Ma panetière était si gaie, mon échanson si expansif et si doux, que j’aurais voulu déjeuner ainsi pendant toute l’éternité. Malheureusement, tout a un terme, même l’appétit d’un convalescent. Le repas fini et mes forces revenues, je satisfis la curiosité de la petite pie, et lui racontai mes malheurs avec autant de sincérité que je l’avais fait la veille devant le pigeon. La pie m’écouta avec plus d’attention qu’il ne semblait devoir lui appartenir, et la tourterelle me donna des marques charmantes de sa profonde sensibilité. Mais, lorsque j’en fus à toucher le point capital qui causait ma peine, c’est-à-dire l’ignorance où j’étais de moi-même :
— Plaisantez-vous ? s’écria la pie ; vous, un merle ! vous, un pigeon ! Fi donc ! vous êtes une pie, mon cher enfant, pie s’il en fut, et très gentille pie, ajouta-t-elle en me donnant un petit coup d’aile, comme qui dirait un coup d’éventail.
— Mais, madame la marquise, répondis-je, il me semble que, pour une pie, je suis d’une couleur, ne vous en déplaise…
— Une pie russe, mon cher, vous êtes une pie russe ! Vous ne savez pas qu’elles sont blanches ? Pauvre garçon, quelle innocence !
— Mais, madame, repris-je, comment serais-je une pie russe, étant né au fond du Marais, dans une vieille écuelle cassée ?
— Ah ! le bon enfant ! Vous êtes de l’invasion, mon cher ; croyez-vous qu’il n’y ait que vous ? Fiez-vous à moi, et laissez-vous faire ; je veux vous emmener tout à l’heure et vous montrer les plus belles choses de la terre.
— Où cela, madame, s’il vous plaît ?
— Dans mon palais vert, mon mignon ; vous verrez quelle vie on y mène. Vous n’aurez pas plus tôt été pie un quart d’heure, que vous ne voudrez plus entendre parler d’autre chose. Nous sommes là une centaine, non pas de ces grosses pies de village qui demandent l’aumône sur les grands chemins, mais toutes nobles et de bonne compagnie, effilées, lestes, et pas plus grosses que le poing. Pas une de nous n’a ni plus ni moins de sept marques noires et de cinq marques blanches ; c’est une chose invariable, et nous méprisons le reste du monde. Les marques noires vous manquent, il est vrai, mais votre qualité de Russe suffira pour vous faire admettre. Notre vie se compose de deux choses : caqueter et nous attifer. Depuis le matin jusqu’à midi, nous nous attifons, et, depuis midi jusqu’au soir, nous caquetons. Chacune de nous perche sur un arbre, le plus haut et le plus vieux possible. Au milieu de la forêt s’élève un chêne immense, inhabité, hélas ! C’était la demeure du feu roi Pie X, où nous allons en pèlerinage en poussant de bien gros soupirs ; mais, à part ce léger chagrin, nous passons le temps à merveille. Nos femmes, ne sont pas plus bégueules que nos maris ne sont jaloux, mais nos plaisirs sont purs et honnêtes, parce que notre cœur est aussi noble que notre langage est libre et joyeux. Notre fierté n’a pas de bornes, et, si un geai ou toute autre canaille vient par hasard à s’introduire chez nous, nous le plumons impitoyablement. Mais nous n’en sommes pas moins les meilleures gens du monde, et les passereaux, les mésanges, les chardonnerets qui vivent dans nos taillis, nous trouvent toujours prêtes à les aider, à les nourrir et à les défendre. Nulle part il n’y a plus de caquetage que chez nous, et nulle part moins de médisance. Nous ne manquons pas de vieilles pies dévotes qui disent leurs patenôtres toute la journée, mais la plus éventée de nos jeunes commères peut passer, sans crainte d’un coup de bec, près de la plus sévère douairière. En un mot, nous vivons de plaisir, d’honneur, de bavardage, de gloire et de chiffons.
— Voilà qui est fort beau, madame, répliquai-je, et je serais certainement mal appris de ne point obéir aux ordres d’une personne comme vous. Mais avant d’avoir l’honneur de vous suivre, permettez-moi, de grâce, de dire un mot à cette bonne demoiselle qui est ici. — Mademoiselle, continuai-je en m’adressant à la tourterelle, parlez-moi franchement, je vous en supplie ; pensez-vous que je sois véritablement une pie russe ?
À cette question, la tourterelle baissa la tête, et devint rouge pâle, comme les rubans de Lolotte.
— Mais, monsieur, dit-elle, je ne sais si je puis…
— Au nom du ciel, parlez, mademoiselle ! Mon dessein n’a rien qui puisse vous offenser, bien au contraire. Vous me paraissez toutes deux si charmantes, que je fais ici le serment d’offrir mon cœur et ma patte à celle de vous qui en voudra, dès l’instant que je saurai si je suis pie ou autre chose ; car, en vous regardant, ajoutai-je, parlant un peu plus bas à la jeune personne, je me sens je ne sais quoi de tourtereau qui me tourmente singulièrement.
— Mais, en effet, dit la tourterelle en rougissant encore davantage, je ne sais si c’est le reflet du soleil qui tombe sur vous à travers ces coquelicots, mais votre plumage me semble avoir une légère teinte…
Elle n’osa en dire plus long.
— Ô perplexité ! m’écriai-je, comment savoir à quoi m’en tenir ? comment donner mon cœur à l’une de vous, lorsqu’il est si cruellement déchiré ? Ô Socrate ! quel précepte admirable, mais difficile à suivre, tu nous as donné, quand tu as dit : « Connais-toi toi-même ! »
Depuis le jour où une malheureuse chanson avait si fort contrarié mon père, je n’avais pas fait usage de ma voix. En ce moment, il me vint à l’esprit de m’en servir comme d’un moyen pour discerner la vérité. « Parbleu ! pensai-je, puisque monsieur mon père m’a mis à la porte dès le premier couplet, c’est bien le moins que le second produise quelque effet sur ces dames. » Ayant donc commencé par m’incliner poliment, comme pour réclamer l’indulgence, à cause de la pluie que j’avais reçue, je me mis d’abord à siffler, puis à gazouiller, puis à faire des roulades, puis enfin à chanter à tue-tête, comme un muletier espagnol en plein vent.
À mesure que je chantais, la petite pie s’éloignait de moi d’un air de surprise qui devint bientôt de la stupéfaction, puis qui passa à un sentiment d’effroi accompagné d’un profond ennui. Elle décrivait des cercles autour de moi, comme un chat autour d’un morceau de lard trop chaud qui vient de le brûler, mais auquel il voudrait pourtant goûter encore. Voyant l’effet de mon épreuve, et voulant la pousser jusqu’au bout, plus la pauvre marquise montrait d’impatience, plus je m’égosillais à chanter. Elle résista pendant vingt-cinq minutes à mes mélodieux efforts ; enfin, n’y pouvant plus tenir, elle s’envola à grand bruit, et regagna son palais de verdure. Quant à la tourterelle, elle s’était, presque dès le commencement, profondément endormie.
— Admirable effet de l’harmonie ! pensai-je. Ô Marais ! ô écuelle maternelle ! plus que jamais je reviens à vous !
Au moment où je m’élançais pour partir, la tourterelle rouvrit les yeux.
— Adieu, dit-elle, étranger si gentil et si ennuyeux ! Mon nom est Gourouli ; souviens-toi de moi !
— Belle Gourouli, lui répondis-je, vous êtes bonne, douce et charmante ; je voudrais vivre et mourir pour vous. Mais vous êtes couleur de rose ; tant de bonheur n’est pas fait pour moi !IV
Le triste effet produit par mon chant ne laissait pas que de m’attrister.
— Hélas ! musique, hélas ! poésie, me répétais-je en regagnant Paris, qu’il y a peu de cœurs qui vous comprennent !
En faisant ces réflexions, je me cognai la tête contre celle d’un oiseau qui volait dans le sens opposé au mien. Le choc fut si rude et si imprévu, que nous tombâmes tous deux sur la cime d’un arbre qui, par bonheur, se trouva là. Après que nous nous fûmes un peu secoués, je regardai le nouveau venu, m’attendant à une querelle. Je vis avec surprise qu’il était blanc. À la vérité, il avait la tête un peu plus grosse que moi, et, sur le front, une espèce de panache qui lui donnait un air héroï-comique ; de plus, il portait sa queue fort en l’air, avec une grande magnanimité : du reste, il ne me parut nullement disposé à la bataille. Nous nous abordâmes fort civilement, et nous nous fîmes de mutuelles excuses, après quoi nous entrâmes en conversation. Je pris la liberté de lui demander son nom et de quel pays il était.
— Je suis étonné, me dit-il, que vous ne me connaissiez pas. Est-ce que vous n’êtes pas des nôtres ?
— En vérité, monsieur, répondis-je, je ne sais pas desquels je suis. Tout le monde me demande et me dit la même chose ; il faut que ce soit une gageure qu’on ait faite.
— Vous voulez rire, répliqua-t-il ; votre plumage vous sied trop bien pour que je méconnaisse un confrère. Vous appartenez infailliblement à cette race illustre et vénérable qu’on nomme en latin cacuata, en langue savante kakatoès, et en jargon vulgaire catacois.
— Ma foi, monsieur, cela est possible, et ce serait bien de l’honneur pour moi. Mais ne laissez pas de faire comme si je n’en étais pas, et daignez m’apprendre à qui j’ai la gloire de parler.
— Je suis, répondit l’inconnu, le grand poète Kacatogan. J’ai fait de puissants voyages, monsieur, des traversées arides et de cruelles pérégrinations. Ce n’est pas d’hier que je rime, et ma muse a eu des malheurs. J’ai fredonné sous Louis XVI, monsieur, j’ai braillé pour la République, j’ai noblement chanté l’Empire, j’ai discrètement loué la Restauration, j’ai même fait un effort dans ces derniers temps, et je me suis soumis, non sans peine, aux exigences de ce siècle sans goût. J’ai lancé dans le monde des distiques piquants, des hymnes sublimes, de gracieux dithyrambes, de pieuses élégies, des drames chevelus, des romans crépus, des vaudevilles poudrés et des tragédies chauves. En un mot, je puis me flatter d’avoir ajouté au temple des Muses quelques festons galants, quelques sombres créneaux et quelques ingénieuses arabesques. Que voulez-vous ! je me suis fait vieux. Mais je rime encore vertement, monsieur, et, tel que vous me voyez, je rêvais à un poème en un chant, qui n’aura pas moins de six cents pages, quand vous m’avez fait une bosse au front. Du reste, si je puis vous être bon à quelque chose, je suis tout à votre service.
— Vraiment, monsieur, vous le pouvez, répliquai-je, car vous me voyez en ce moment dans un grand embarras poétique. Je n’ose dire que je sois un poète, ni surtout un aussi grand poète que vous, ajoutai-je en le saluant, mais j’ai reçu de la nature un gosier qui me démange quand je me sens bien aise ou que j’ai du chagrin. À vous dire la vérité, j’ignore absolument les règles.
— Je les ai oubliées, dit Kacatogan, ne vous inquiétez pas de cela.
— Mais il m’arrive, repris-je, une chose fâcheuse : c’est que ma voix produit sur ceux qui l’entendent à peu près le même effet que celle d’un certain Jean de Nivelle sur… Vous savez ce que je veux dire ?
— Je le sais, dit Kacatogan ; je connais par moi-même cet effet bizarre. La cause ne m’en est pas connue, mais l’effet est incontestable.
— Eh bien ! monsieur, vous qui me semblez être le Nestor de la poésie, sauriez-vous, je vous prie, un remède à ce pénible inconvénient ?
— Non, dit Kacatogan, pour ma part, je n’en ai jamais pu trouver. Je m’en suis fort tourmenté étant jeune, à cause qu’on me sifflait toujours ; mais, à l’heure qu’il est, je n’y songe plus. Je crois que cette répugnance vient de ce que le public en lit d’autres que nous : cela le distrait..
— Je le pense comme vous ; mais vous conviendrez, monsieur, qu’il est dur, pour une créature bien intentionnée, de mettre les gens en fuite dès qu’il lui prend un bon mouvement. Voudriez-vous me rendre le service de m’écouter, et me dire sincèrement votre avis ?
— Très volontiers, dit Kacatogan ; je suis tout oreilles.
Je me mis à chanter aussitôt, et j’eus la satisfaction de voir que Kacatogan ne s’enfuyait ni ne s’endormait. Il me regardait fixement, et, de temps en temps, il inclinait la tête d’un air d’approbation, avec une espèce de murmure flatteur. Mais je m’aperçus bientôt qu’il ne m’écoutait pas, et qu’il rêvait à son poème. Profitant d’un moment où je reprenais haleine, il m’interrompit tout à coup.
— Je l’ai pourtant trouvée, cette rime ! dit-il en souriant et en branlant la tête ; c’est la soixante mille sept cent quatorzième qui sort de cette cervelle-là ! Et l’on ose dire que je vieillis ! Je vais lire cela aux bons amis, je vais le leur lire, et nous verrons ce qu’on en dira !
Parlant ainsi, il prit son vol et disparut, ne semblant plus se souvenir de m’avoir rencontré.V
Resté seul et désappointé, je n’avais rien de mieux à faire que de profiter du reste du jour et de voler à tire-d’aile vers Paris. Malheureusement, je ne savais pas ma route. Mon voyage avec le pigeon avait été trop peu agréable pour me laisser un souvenir exact ; en sorte que, au lieu d’aller tout droit, je tournai à gauche au Bourget, et, surpris par la nuit, je fus obligé de chercher un gîte dans les bois de Mortefontaine.
Tout le monde se couchait lorsque j’arrivai. Les pies et les geais, qui, comme on le sait, sont les plus mauvais coucheurs de la terre, se chamaillaient de tous les côtés. Dans les buissons piaillaient les moineaux, en piétinant les uns sur les autres. Au bord de l’eau marchaient gravement deux hérons, perchés sur leurs longues échasses ; dans l’attitude de la méditation, Georges Dandins du lieu, attendant patiemment leurs femmes. D’énormes corbeaux, à moitié endormis, se posaient lourdement sur la pointe des arbres les plus élevés, et nasillaient leurs prières du soir. Plus bas, les mésanges amoureuses se pourchassaient encore dans les taillis, tandis qu’un pivert ébouriffé poussait son ménage par-derrière, pour le faire entrer dans le creux d’un arbre. Des phalanges de friquets arrivaient des champs en dansant en l’air comme des bouffées de fumée, et se précipitaient sur un arbrisseau qu’elles couvraient tout entier ; des pinsons, des fauvettes, des rouges-gorges, se groupaient légèrement sur des branches découpées, comme des cristaux sur une girandole. De toute part résonnaient des voix qui disaient bien distinctement :
— Allons, ma femme !
— Allons, ma fille !
— Venez, ma belle !
— Par ici, ma mie !
— Me voilà, mon cher !
— Bonsoir, ma maîtresse !
— Adieu, mes amis !
— Dormez bien, mes enfants !
Quelle position pour un célibataire que de coucher dans une pareille auberge ! J’eus la tentation de me joindre à quelques oiseaux de ma taille, et de leur demander l’hospitalité.
— La nuit, pensais-je, tous les oiseaux sont gris ; et, d’ailleurs, est-ce faire tort aux gens que de dormir poliment près d’eux ?Je me dirigeai d’abord vers un fossé où se rassemblaient des étourneaux. Ils faisaient leur toilette de nuit avec un soin tout particulier, et je remarquai que la plupart d’entre eux avaient les ailes dorées et les pattes vernies : c’étaient les dandies de la forêt : Ils étaient assez bons enfants, et ne m’honorèrent d’aucune attention. Mais leurs propos étaient si creux, ils se racontaient avec tant de fatuité leurs tracasseries et leurs bonnes fortunes, ils se frottaient si lourdement l’un à l’autre, qu’il me fut impossible d’y tenir.
J’allai ensuite me percher sur une branche où s’alignaient une demi-douzaine d’oiseaux de différentes espèces. Je pris modestement la dernière place, à l’extrémité de la branche, espérant qu’on m’y souffrirait. Par malheur, ma voisine était une vieille colombe, aussi sèche qu’une girouette rouillée. Au moment où je m’approchai d’elle, le peu de plumes qui couvraient ses os étaient l’objet de sa sollicitude ; elle feignait de les éplucher, mais elle eût trop craint d’en arracher une : elle les passait seulement en revue pour voir si elle avait son compte. À peine l’eus-je touchée du bout de l’aile, qu’elle se redressa majestueusement.
— Qu’est-ce que vous faites donc, monsieur ? me dit-elle en pinçant le bec avec une pudeur britannique.
Et, m’allongeant un grand coup de coude, elle me jeta à bas avec une vigueur qui eût fait honneur à un portefaix.
Je tombai dans une bruyère où dormait une grosse gelinotte. Ma mère elle-même, dans son écuelle, n’avait pas un tel air de béatitude. Elle était si rebondie, si épanouie, si bien assise sur son triple ventre, qu’on l’eût prise pour un pâté dont on avait mangé la croûte. Je me glissai furtivement près d’elle.
— Elle ne s’éveillera pas, me disais-je, et, en tout cas, une si bonne grosse maman ne peut pas être bien méchante. Elle ne le fut pas en effet. Elle ouvrit les yeux à demi, et me dit en poussant un léger soupir :
— Tu me gênes, mon petit, va-t’en de là.
Au même instant, je m’entendis appeler : c’étaient des grives qui, du haut d’un sorbier, me faisaient signe de venir à elles.
— Voilà enfin de bonnes âmes, pensai-je. Elles me firent place en riant comme des folles, et je me fourrai aussi lestement dans leur groupe emplumé qu’un billet doux dans un manchon. Mais je ne tardai pas à juger que ces dames avaient mangé plus de raisin qu’il n’est raisonnable de le faire ; elles se soutenaient à peine sur les branches, et leurs plaisanteries de mauvaise compagnie, leurs éclats de rire et leurs chansons grivoises me forcèrent de m’éloigner.
Je commençais à désespérer, et j’allais m’endormir dans un coin solitaire, lorsqu’un rossignol se mit à chanter. Tout le monde aussitôt fit silence. Hélas ! que sa voix était pure ! que sa mélancolie même paraissait douce ! Loin de troubler le sommeil d’autrui, ses accords semblaient le bercer. Personne ne songeait à le faire taire, personne ne trouvait mauvais qu’il chantât sa chanson à pareille heure ; son père ne le battait pas, ses amis ne prenaient pas la fuite.
— Il n’y a donc que moi, m’écriai-je, à qui il soit défendu d’être heureux ! Partons, fuyons ce monde cruel ! Mieux vaut chercher ma route dans les ténèbres, au risque d’être avalé par quelque hibou, que de me laisser déchirer ainsi par le spectacle du bonheur des autres !
Sur cette pensée, je me remis en chemin et j’errai longtemps au hasard. Aux premières clartés du jour, j’aperçus les tours de Notre-Dame. En un clin d’œil j’y atteignis, et je ne promenai pas longtemps mes regards avant de reconnaître notre jardin. J’y volai plus vite que l’éclair… Hélas ! il était vide… J’appelai en vain mes parents : personne ne me répondit. L’arbre où se tenait mon père, le buisson maternel, l’écuelle chérie, tout avait disparu. La cognée avait tout détruit ; au lieu de l’allée verte où j’étais né, il ne restait qu’un cent de fagots.VI
Je cherchai d’abord mes parents dans tous les jardins d’alentour, mais ce fut peine perdue ; ils s’étaient sans doute réfugiés dans quelque quartier éloigné, et je ne pus jamais savoir de leurs nouvelles.
Pénétré d’une tristesse affreuse, j’allai me percher sur la gouttière où la colère de mon père m’avait d’abord exilé. J’y passais les jours et les nuits à déplorer ma triste existence. Je ne dormais plus, je mangeais à peine : j’étais près de mourir de douleur.
Un jour que je me lamentais comme à l’ordinaire :
— Ainsi donc, me disais-je tout haut, je ne suis ni un merle, puisque mon père me plumait ; ni un pigeon, puisque je suis tombé en route quand j’ai voulu aller en Belgique ; ni une pie russe, puisque la petite marquise s’est bouché les oreilles dès que j’ai ouvert le bec ; ni une tourterelle, puisque Gourouli, la bonne Gourouli elle-même, ronflait comme un moine quand je chantais ; ni un perroquet, puisque Kacatogan n’a pas daigné m’écouter ; ni un oiseau quelconque, enfin, puisque, à Mortefontaine, on m’a laissé coucher tout seul. Et cependant j’ai des plumes sur le corps ; voilà des pattes et voilà des ailes. Je ne suis point un monstre, témoin Gourouli, et cette petite marquise elle-même, qui me trouvaient assez à leur gré. Par quel mystère inexplicable ces plumes, ces ailes et ces pattes ne sauraient-elles former un ensemble auquel on puisse donner un nom ? Ne serais-je pas par hasard ?…
J’allais poursuivre mes doléances, lorsque je fus interrompu par deux portières qui se disputaient dans la rue.
— Ah, parbleu ! dit l’une d’elles à l’autre, si tu en viens jamais à bout, je te fais cadeau d’un merle blanc !— Dieu juste ! m’écriai-je, voilà mon affaire. Ô Providence ! je suis fils d’un merle, et je suis blanc : je suis un merle blanc !
Cette découverte, il faut l’avouer, modifia beaucoup mes idées. Au lieu de continuer à me plaindre, je commençai à me rengorger et à marcher fièrement le long de la gouttière, en regardant l’espace d’un air victorieux.
— C’est quelque chose, me dis-je, que d’être un merle blanc : cela ne se trouve point dans le pas d’un âne. J’étais bien bon de m’affliger de ne pas rencontrer mon semblable : c’est le sort du génie, c’est le mien ! Je voulais fuir le monde, je veux l’étonner ! Puisque je suis cet oiseau sans pareil dont le vulgaire nie l’existence, je dois et prétends me comporter comme tel, ni plus ni moins que le phénix, et mépriser le reste des volatiles. Il faut que j’achète les Mémoires d’Alfieri et les poèmes de lord Byron ; cette nourriture substantielle m’inspirera un noble orgueil, sans compter celui que Dieu m’a donné. Oui, je veux ajouter, s’il se peut, au prestige de ma naissance. La nature m’a fait rare, je me ferai mystérieux. Ce sera une faveur, une gloire de me voir. — Et, au fait, ajoutai-je plus bas, si je me montrais tout bonnement pour de l’argent ?
— Fi donc ! quelle indigne pensée ! Je veux faire un poème comme Kacatogan, non pas en un chant, mais en vingt-quatre, comme tous les grands hommes ; ce n’est pas assez, il y en aura quarante-huit, avec des notes et un appendice ! Il faut que l’univers apprenne que j’existe. Je ne manquerai pas, dans mes vers, de déplorer mon isolement ; mais ce sera de telle sorte, que les plus heureux me porteront envie. Puisque le ciel m’a refusé une femelle, je dirai un mal affreux de celles des autres. Je prouverai que tout est trop vert, hormis les raisins que je mange. Les rossignols n’ont qu’à se bien tenir ; je démontrerai, comme deux et deux font quatre, que leurs complaintes font mal au cœur, et que leur marchandise ne vaut rien. Il faut que j’aille trouver Charpentier. Je veuxme créer tout d’abord une puissante position littéraire. J’entends avoir autour de moi une cour composée, non pas seulement de journalistes, mais d’auteurs véritables et même de femmes de lettres. J’écrirai un rôle pour mademoiselle Rachel, et, si elle refuse de le jouer, je publierai à son de trompe que son talent est bien inférieur à celui d’une vieille actrice de province. J’irai à Venise, et je louerai, sur les bords du grand canal, au milieu de cette cité féerique, le beau palais Mocenigo, qui coûte quatre livres dix sous par jour ; là, je m’inspirerai de tous les souvenirs que l’auteur de Lara doit y avoir laissés. Du fond de ma solitude, j’inonderai le monde d’un déluge de rimes croisées, calquées sur la strophe de Spencer, où je soulagerai ma grande âme ; je ferai soupirer toutes les mésanges, roucouler toutes les tourterelles, fondre en larmes toutes les bécasses, et hurler toutes les vieilles chouettes. Mais, pour ce qui regarde ma personne, je me montrerai inexorable et inaccessible à l’amour. En vain me pressera-t-on, me suppliera-t-on d’avoir pitié des infortunées qu’auront séduites mes chants sublimes ; à tout cela, je répondrai : Foin ! Ô excès de gloire ! mes manuscrits se vendront au poids de l’or, mes livres traverseront les mers ; la renommée, la fortune, me suivront partout ; seul, je semblera ! indifférent aux murmures de la foule qui m’environnera. En un mot, je serai un parfait merle blanc, un véritable écrivain excentrique, fêté, choyé, admiré, envié, mais complètement grognon et insupportable.VII
Il ne me fallut pas plus de six semaines pour mettre au jour mon premier ouvrage. C’était, comme je me l’étais promis, un poème en quarante-huit chants. Il s’y trouvait bien quelques négligences, à cause de la prodigieuse fécondité avec laquelle je l’avais écrit ; mais je pensai que le public d’aujourd’hui, accoutumé à la belle littérature qui s’imprime au bas des journaux, ne m’en ferait pas un reproche.
J’eus un succès digne de moi, c’est-à-dire sans pareil. Le sujet de mon ouvrage n’était autre que moi-même : je me conformai en cela à la grande mode de notre temps. Je racontais mes souffrances passées avec une fatuité charmante ; je mettais le lecteur au fait de mille détails domestiques du plus piquant intérêt ; la description de l’écuelle de ma mère ne remplissait pas moins de quatorze chants : j’en avais compté les rainures, les trous, les bosses, les éclats, les échardes, les clous, les taches, les teintes diverses, les reflets ; j’en montrais le dedans, le dehors, les bords, le fond, les côtés, les plans inclinés, les plans droits ; passant au contenu, j’avais étudié les brins d’herbe, les pailles, les feuilles sèches, les petits morceaux de bois, les graviers, les gouttes d’eau, les débris de mouches, les pattes de hannetons cassées qui s’y trouvaient : c’était une description ravissante. Mais ne pensez pas que je l’eusse imprimée tout d’une venue ; il y a des lecteurs impertinents qui l’auraient sautée. Je l’avais habilement coupée par morceaux, et entremêlée au récit, afin que rien n’en fût perdu ; en sorte qu’au moment le plus intéressant et le plus dramatique arrivaient tout à coup quinze pages d’écuelle. Voilà, je crois, un des grands secrets de l’art, et, comme je n’ai point d’avarice, en profitera qui voudra.
L’Europe entière fut émue à l’apparition de mon livre ; elle dévora les révélations intimes que je daignais lui communiquer. Comment en eût-il été autrement ? Non seulement j’énumérais tous les faits qui se rattachaient à ma personne, mais je donnais encore au public un tableau complet de toutes les rêvasseries qui m’avaient passé par la tête depuis l’âge de deux mois ; j’avais même intercalé au plus bel endroit une ode composée dans mon œuf. Bien entendu d’ailleurs que je ne négligeais pas de traiter en passant le grand sujet qui préoccupe maintenant tant de monde : à savoir, l’avenir de l’humanité. Ce problème m’avait paru intéressant ; j’en ébauchai, dans un moment de loisir, une solution qui passa généralement pour satisfaisante.
On m’envoyait tous les jours des compliments en vers, des lettres de félicitation et des déclarations d’amour anonymes. Quant aux visites, je suivais rigoureusement le plan que je m’étais tracé ; ma porte était fermée à tout le monde. Je ne pus cependant me dispenser de recevoir deux étrangers qui s’étaient annoncés comme étant de mes parents. L’un était un merle du Sénégal, et l’autre un merle de la Chine.
— Ah ! monsieur, me dirent-ils en m’embrassant à m’étouffer, que vous êtes un grand merle ! que vous avez bien peint, dans votre poème immortel, la profonde souffrance du génie méconu ! Si nous n’étions pas déjà aussi incompris que possible, nous le deviendrions après vous avoir lu. Combien nous sympathisons avec vos douleurs, avec votre sublime mépris du vulgaire ! Nous aussi, monsieur, nous les connaissons par nous-mêmes, les peines secrètes que vous avez chantées ! Voici deux sonnets que nous avons faits, l’un portant l’autre, et que nous vous prions d’agréer.
— Voici, en outre, ajouta le Chinois, de la musique que mon épouse a composée sur un passage de votre préface. Elle rend merveilleusement l’intention de l’auteur.
— Messieurs, leur dis-je, autant que j’en puis juger, vous me semblez doués d’un grand cœur et d’un esprit plein de lumières. Mais pardonnez-moi de vous faire une question. D’où vient votre mélancolie ?
— Eh ! monsieur, répondit l’habitant du Sénégal, regardez comme je suis bâti. Mon plumage, il est vrai, est agréable à voir, et je suis revêtu de cette belle couleur verte qu’on voit briller sur les canards ; mais mon bec est trop court et mon pied trop grand ; et voyez de quelle queue je suis affublé ! la longueur de mon corps n’en fait pas les deux tiers. N’y a-t-il pas là de quoi se donner au diable ?
— Et moi, monsieur, dit le Chinois, mon infortune est encore plus pénible. La queue de mon confrère balaye les rues ; mais les polissons me montrent au doigt, à cause que je n’en ai point.
— Messieurs, repris-je, je vous plains de toute mon âme ; il est toujours fâcheux d’avoir trop ou trop peu n’importe de quoi. Mais permettez-moi de vous dire qu’il y a au Jardin des Plantes plusieurs personnes qui vous ressemblent, et qui demeurent là depuis longtemps, fort paisiblement empaillées. De même qu’il ne suffit pas à une femme de lettres d’être dévergondée pour faire un bon livre, ce n’est pas non plus assez pour un merle d’être mécontent pour avoir du génie. Je suis seul de mon espèce, et je m’en afflige ; j’ai peut-être tort, mais c’est mon droit. Je suis blanc, messieurs ; devenez-le, et nous verrons ce que vous saurez dire.VIII
Malgré la résolution que j’avais prise et le calme que j’affectais, je n’étais pas heureux. Mon isolement, pour être glorieux, ne m’en semblait pas moins pénible, et je ne pouvais songer sans effroi à la nécessité où je me trouvais de passer ma vie entière dans le célibat. Le retour du printemps, en particulier, me causait une gêne mortelle, et je commençais à tomber de nouveau dans la tristesse, lorsqu’une circonstance imprévue décida de ma vie entière.
Il va sans dire que mes écrits avaient traversé la Manche, et que les Anglais se les arrachaient. Les Anglais s’arrachent tout, hormis ce qu’ils comprennent. Je reçus un jour, de Londres, une lettre signée d’une jeune merlette :
« J’ai lu votre poème, me disait-elle, et l’admiration que j’ai éprouvée m’a fait prendre la résolution de vous offrir ma main et ma personne. Dieu nous a créés l’un pour l’autre ! Je suis semblable à vous, je suis une merlette blanche !… »
On suppose aisément ma surprise et ma joie.
— Une merlette blanche ! me dis-je, est-il bien possible ? Je ne suis donc plus seul sur la terre !
Je me hâtai de répondre à la belle inconnue, et je le fis d’une manière qui témoignait assez combien sa proposition m’agréait. Je la pressais de venir à Paris ou de me permettre de voler près d’elle. Elle me répondit qu’elle aimait mieux venir, parce que ses parents l’ennuyaient, qu’elle mettait ordre à ses affaires et que je la verrais bientôt.
Elle vint, en effet, quelques jours après. Ô bonheur ! c’était la plus jolie merlette du monde, et elle était encore plus blanche que moi.
— Ah ! mademoiselle, m’écriai-je, ou plutôt madame, car je vous considère des à présent comme mon épouse légitime, est-il croyable qu’une créature si charmante se trouvât sur la terre sans que la renommée m’apprît son existence ? Bénis soient les malheurs que j’ai éprouvés et les coups de bec que m’a donnés mon père, puisque le ciel me réservait une consolation si inespérée ! Jusqu’à ce jour, je me croyais condamné à une solitude éternelle, et, à vous parler franchement, c’était un rude fardeau à porter ; mais je me sens, en vous regardant, toutes les qualités d’un père de famille. Acceptez ma main sans délai ; marions-nous à l’anglaise, sans cérémonie, et partons ensemble pour la Suisse.
— Je ne l’entends pas ainsi, me répondit la jeune merlette ; je veux que nos noces soient magnifiques, et que tout ce qu’il y a en France de merles un peu bien nés y soient solennellement rassemblés. Des gens comme nous doivent à leur propre gloire de ne pas se marier comme des chats de gouttière. J’ai apporté une provision de bank-notes. Faites vos invitations, allez chez vos marchands, et ne lésinez pas sur les rafraîchissements.
Je me conformai aveuglément aux ordres de la blanche merlette. Nos noces furent d’un luxe écrasant ; on y mangea dix mille mouches. Nous reçûmes la bénédiction nuptiale d’un révérend père Cormoran, qui était archevêque in partibus. Un bal superbe termina la journée ; enfin, rien ne manqua à mon bonheur.
Plus j’approfondissais le caractère de ma charmante femme, plus mon amour augmentait. Elle réunissait, dans sa petite personne, tous les agréments de l’âme et du corps. Elle était seulement un peu bégueule ; mais j’attribuai cela à l’influence du brouillard anglais dans lequel elle avait vécu jusqu’alors, et je ne doutai pas que le climat de la France ne dissipât bientôt ce léger nuage.
Une chose qui m’inquiétait plus sérieusement, c’était une sorte de mystère dont elle s’entourait quelquefois avec une rigueur singulière, s’enfermant à clef avec ses caméristes, et passant ainsi des heures entières pour faire sa toilette, à ce qu’elle prétendait. Les maris n’aiment pas beaucoup ces fantaisies dans leur ménage. Il m’était arrivé vingt fois de frapper à l’appartement de ma femme sans pouvoir obtenir qu’on m’ouvrît la porte. Cela m’impatientait cruellement. Un jour, entre autres, j’insistai avec tant de mauvaise humeur, qu’elle se vit obligée de céder et de m’ouvrir un peu à la hâte, non sans se plaindre fort de mon importunité. Je remarquai, en entrant, une grosse bouteille pleine d’une espèce de colle faite avec de la farine et du blanc d’Espagne. Je demandai à ma femme ce qu’elle faisait de cette drogue ; elle me répondit que c’était un opiat pour des engelures qu’elle avait.
Cet opiat me sembla tant soit peu louche ; mais quelle défiance pouvait m’inspirer une personne si douce et si sage, qui s’était donnée à moi avec tant d’enthousiasme et une sincérité si parfaite ? J’ignorais d’abord que ma bien-aimée fût une femme de plume ; elle me l’avoua au bout de quelque temps, et elle alla même jusqu’à me montrer le manuscrit d’un roman où elle avait imité à la fois Walter Scott et Scarron. Je laisse à penser le plaisir que me causa une si aimable surprise. Non seulement je me voyais possesseur d’une beauté incomparable, mais j’acquérais encore la certitude que l’intelligence de ma compagne était digne en tout point de mon génie. Dès cet instant, nous travaillâmes ensemble. Tandis que je composais mes poèmes, elle barbouillait des rames de papier. Je lui récitais mes vers à haute voix, et cela ne la gênait nullement pour écrire pendant ce temps-là. Elle pondait ses romans avec une facilité presque égale à la mienne, choisissant toujours les sujets les plus dramatiques, des parricides, des rapts, des meurtres, et même jusqu’à des filouteries, ayant toujours soin, en passant, d’attaquer le gouvernement et de prêcher l’émancipation des merlettes. En un mot, aucun effort ne coûtait à son esprit, aucun tour de force à sa pudeur ; il ne lui arrivait jamais de rayer une ligne, ni de faire un plan avant de se mettre à l’œuvre. C’était le type de la merlette lettrée.
Un jour qu’elle se livrait au travail avec une ardeur inaccoutumée, je m’aperçus qu’elle suait à grosses gouttes, et je fus étonné devoir en même temps qu’elle avait une grande tache noire dans le dos.
— Eh, bon Dieu ! lui dis-je, qu’est-ce donc ? est-ce que vous êtes malade ?
Elle parut d’abord un peu effrayée et même penaude ; mais la grande habitude qu’elle avait du monde l’aida bientôt à reprendre l’empire admirable qu’elle gardait toujours sur elle-même. Elle me dit que c’était une tache d’encre, et qu’elle y était fort sujette dans ses moments d’inspiration.
— Est-ce que ma femme déteint ? me dis-je tout bas. Cette pensée m’empêcha de dormir. La bouteille de colle me revint en mémoire. — Ô ciel ! m’écriai-je, quel soupçon ! Cette créature céleste ne serait-elle qu’une peinture, un léger badigeon ? se serait-elle vernie pour abuser de moi ?… Quand je croyais presser sur mon cœur la sœur de mon âme, l’être privilégié créé pour moi seul, n’aurais-je donc épousé que de la farine ?
Poursuivi par ce doute horrible, je formai le dessein de m’en affranchir. Je fis l’achat d’un baromètre, et j’attendis avidement qu’il vint à faire un jour de pluie. Je voulais emmener ma femme à la campagne, choisir un dimanche douteux, et tenter l’épreuve d’une lessive. Mais nous étions en plein juillet ; il faisait un beau temps effroyable.
L’apparence du bonheur et l’habitude d’écrire avaient fort excité ma sensibilité. Naïf comme j’étais, il m’arrivait parfois, en travaillant, que le sentiment fût plus fort que l’idée, et de me mettre à pleurer en attendant la rime. Ma femme aimait beaucoup ces rares occasions : toute faiblesse masculine enchante l’orgueil féminin. Une certaine nuit que je limais une rature, selon le précepte de Boileau, il advint à mon cœur de s’ouvrir.
— Ô Loi ! dis-je à ma chère merlette, toi, la seule et la plus aimée ! toi, sans qui ma vie est un songe ! toi, dont un regard, un sourire, métamorphosent pour moi l’univers, vie de mon cœur, sais-tu combien je t’aime ? Pour mettre en vers une idée banale déjà usée par d’autres poètes, un peu d’étude et d’attention me font aisément trouver des paroles ; mais où en prendrai-je jamais pour t’exprimer ce que ta beauté m’inspire ? Le souvenir même de mes peines passées pourrait-il me fournir un mot pour te parler de mon bonheur présent ? Avant que tu fusses venue à moi, mon isolement était celui d’un orphelin exilé ; aujourd’hui, c’est celui d’un roi. Dans ce faible corps, dont j’ai le simulacre jusqu’à ce que la mort en fasse un débris, dans cette petite cervelle enfiévrée, où fermente une inutile pensée, sais-tu, mon ange, comprends-tu, ma belle, que rien ne peut être qui ne soit à toi ? Écoute ce que mon cerveau peut dire, et sens combien mon amour est plus grand ! Oh ! que mon génie fût une perle, et que tu fusses Cléopâtre !
En radotant ainsi, je pleurais sur ma femme, et elle déteignait visiblement. À chaque larme qui tombait de mes yeux, apparaissait une plume, non pas même noire, mais du plus vieux roux (je crois qu’elle avait déjà déteint autre part). Après quelques minutes d’attendrissement, je me trouvai vis-à-vis d’un oiseau décollé et désenfariné, identiquement semblable aux merles les plus plats et les plus ordinaires.
Que faire ? que dire ? quel parti prendre ? Tout reproche était inutile. J’aurais bien pu, à la vérité, considérer le cas comme rédhibitoire, et faire casser mon mariage ; mais comment oser publier ma honte ? N’était-ce pas assez de mon malheur ? Je pris mon courage à deux pattes, je résolus de quitter le monde, d’abandonner la carrière des lettres, de fuir dans un désert, s’il était possible, d’éviter à jamais l’aspect d’une créature vivante, et de chercher, comme Alceste,
Un endroit écarté,
Où d’être un merle blanc on eût la liberté !IX
Je m’envolai là-dessus, toujours pleurant ; et le vent, qui est le hasard des oiseaux, me rapporta sur une branche de Mortefontaine. Pour cette fois, on était couché.
— Quel mariage ! me disais-je, quelle équipée ! C’est certainement à bonne intention que cette pauvre enfant s’est mis du blanc ; mais je n’en suis pas moins à plaindre, ni elle moins rousse.
Le rossignol chantait encore. Seul, au fond de la nuit, il jouissait à plein cœur du bienfait de Dieu qui le rend si supérieur aux poètes, et donnait librement sa pensée au silence qui l’entourait. Je ne pus résister à la tentation d’aller à lui et de lui parler.
— Que vous êtes heureux ! lui dis-je : non seulement vous chantez tant que vous voulez, et très bien, et tout le monde écoute ; mais vous avez une femme et des enfants, votre nid, vos amis, un bon oreiller de mousse, la pleine lune et pas de journaux. Rubini et Rossini ne sont rien auprès de vous : vous valez l’un, et vous devinez l’autre. J’ai chanté aussi, monsieur, et c’est pitoyable. J’ai rangé des mots en bataille comme des soldats prussiens, et j’ai coordonné des fadaises pendant que vous étiez dans les bois. Votre secret peut-il s’apprendre ?
— Oui, me répondit le rossignol, mais ce n’est pas ce que vous croyez. Ma femme m’ennuie, je ne l’aime point ; je suis amoureux de la rose : Sadi, le Persan, en a parlé. Je m’égosille toute la nuit pour elle, mais elle dort et ne m’entend pas. Son calice est fermé à l’heure qu’il est : elle y berce un vieux scarabée, — et demain matin, quand je regagnerai mon lit, épuisé de souffrance et de fatigue, c’est alors qu’elle s’épanouira, pour qu’une abeille lui mange le cœur !
FIN DE L’HISTOIRE D’UN MERLE BLANC votre commentaire
votre commentaire
-
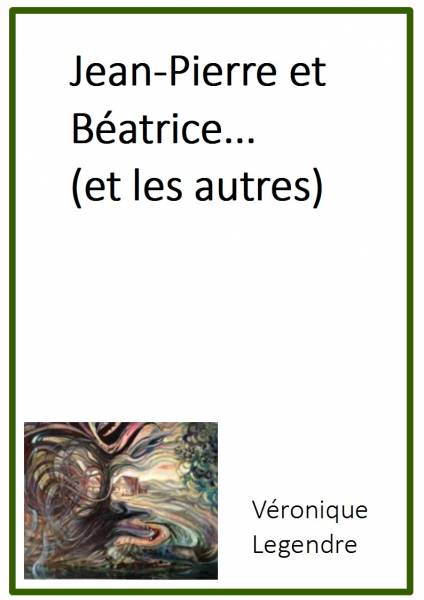
Pensées entre animaux de compagnie
Ce matin, Jean-Pierre et Béatrice sont partis se ravitailler après une nuit pleine de câlins.
Leurs animaux de compagnie sont restés à la maison. Ceux-ci s’entendent généralement bien, mais parfois ils ressentent un besoin irrémédiable de communiquer entre eux et de faire le point sur leur existence. Sur leur raison de vivre. Tel est le cas aujourd’hui.
— Eh bien, voilà encore un peu de solitude qui nous fait du bien, remarque Félix, le joli chat noir aux yeux verts. N’es-tu pas d’accord Jasper ?
— Non Félix ! Moi, ils me manquent déjà. Lorsqu’ils vont rentrer à la maison, je vais leur faire la fête et ils vont s’attendrir. Je vais même rapporter les chaussons à Jean-Pierre.
— Eh bien moi, dit Félix, je me lèche déjà les babines en pensant au foie que Béatrice va m’acheter. Ah, quel plaisir, manger et faire sa petite toilette !
— Oh toi, avec ta toilette ! se moque le chien de chasse.
— Et alors ? On ne peut pas en dire autant de toi ! Même pour faire tes besoins, tu ne prends pas de précautions ; moi, je creuse un trou discrètement et je le rebouche après avoir fait mes besoins naturels. Toi, tu donnes un coup de patte vite fait bien fait, pardon, vite fait mal fait, si bien que la pauvre Béatrice marche dans tes crottes tous les jours. C’est plutôt la honte, non ?
— Toujours le mot gentil pour tes semblables, n’est-ce-pas ? réplique Jasper un peu vexé. Je suis fier d’être un gentil chien, et de surcroît, un chien de chasse pour rapporter les proies à mes maîtres. T’en fais pas autant que je sache, Félix ?
— Tu rigoles ou quoi ? Tu oublies donc les souris que je rapporte toutes les semaines à la maison ? Je les rapporte à Béatrice en croyant lui faire plaisir, car elle mange peu. Je pensais lui procurer une grande joie, mais à chaque fois, j’entends des cris de terreur ! C’est dingue, on dirait qu’elle a peur d’une toute petite créature alors que moi, elle m’adore puisque j’ai le droit de m’installer sur ses genoux tout le temps !
— Félix, les êtres humains ont leurs secrets et nous devons les respecter. Ils sont gentils avec nous, c’est ce qui me semble être important !
— Secrets, gentils, secrets, gentils… répète à qui veut l’entendre Jacquot, le perroquet dans sa grande cage. Oui, mes amis, cela reste à voir, Jean-Pierre et Béatrice sont gentils, mais pas tout le monde !
— Oui Jacquot ! répond Félix avec sympathie. Il est vrai que tu as de la chance avec eux. Ce sont les meilleurs maîtres du monde. Ils t’ont ramené d’Espagne. Tu servais de modèle pour un gitan andalou qui cherchait à se faire du fric avec toi, debout sur les épaules des touristes, en te photographiant avec eux. Sous le soleil ardent et sans eau fraîche !
— Soleil oui ! Eau fraîche ! C’est vrai, tu as raison. J’avais la liberté, mais le gitan m’exploitait… Maintenant, je suis en cage, mais Jean-Pierre et Béatrice me donnent tout l’amour dont j’ai besoin et jouent avec moi tous les jours. Ce sont des gens respectables. Ils m’ont sauvé la vie !
— Moi aussi ! répliquent Jasper et Félix ensemble.
— J’étais en cage à la SPA lorsqu’ils sont venus me chercher, raconte Jasper. Jean-Pierre voulait un chien de chasse et Béatrice a eu la bonne idée de me choisir parmi plusieurs chiens qui sont peut-être encore à la SPA ! Alors, tu vois Jacquot, moi je préfère la maison de mes maîtres même si je dois la garder et qu’elle est parfois symbole de cage ; dans la vie il y a des choix. Il faut parfois choisir : liberté ou sécurité. Chacun a ses choix mais aussi sa raison d’être.
— Oui, raconte Félix devenu songeur. Moi, j’étais bien maigrichon sur les plages d’Alcudia lorsque Béatrice m’a découvert en allant faire son jogging sur la plage. Elle m’a vu, tout chétif et pitoyable que j’étais. Elle m’a entendu gémir et miauler. Moi, en la voyant, j’ai compris qu’elle me donnerait à manger. J’avais la liberté en Espagne, tout comme toi, Jacquot, mais je crevais de faim et parfois certaines gens me lançaient des pierres ! Je n’en menais pas large. J’étais encore presque un bébé. J’avais perdu ma mère, empoisonnée par les hôteliers du coin. Et mon père avait fait la malle… heureusement Béatrice m’a ramené en France !
— Je suis désolé, mon vieux, répond Jasper avec tendresse. Tu en as bavé en Espagne malgré la mer, le beau temps et la plage attrayante ! Et toi, Jacquot, le gitan t’as bel et bien exploité. Ce gars ne te considérait que comme un objet. Moi, je dois bien l’avouer, j’ai eu beaucoup plus de chance que vous deux. Mais j’ai quand même connu l’épisode de la SPA et du confinement.
— Pourquoi as-tu connu la SPA ? demande Jacquot.
— Eh bien, autrefois mon maître était un homme semblable à Jean-Pierre. Sportif, beau garçon et intelligent. Il m’emmenait à la chasse tous les ans et puis, un jour, c’est lui qui a été tué et non le gibier, tu vois ? Une erreur humaine… incroyable, non ? Un autre chasseur l’a confondu avec un gibier. Je n’arrive toujours pas à y croire !
— Et que s’est-il passé par la suite ? demande Félix.
— C’est tout simple. Un des chasseurs du groupe m’a apporté à la SPA. J’avais peur et j’étais malheureux, mais tous les humains m’ont traité avec respect. Tous les jours des jeunes volontaires du centre s’occupaient de moi et me comblaient de caresses, mais je passais toutes les nuits en cage… jusqu’au jour où Béatrice est venue me chercher ! J’étais le chien le plus joyeux au monde. Alors, vous voyez Félix et Jacquot, la liberté et la joie de cette liberté est une notion bien relative.
— C’est vrai, tu as raison, réplique Félix aussitôt. Viens, Jasper, allons voir si Ernest est de notre avis ? Jacquot, à tout à l’heure !
— Coucou Ernest, c’est nous, lancent en cœur Félix et Jasper, tout heureux de se dégourdir les pattes près de l’écurie.
— Bonjour les amis, dit Ernest tranquillement. Comment allez-vous ?
— Bien Ernest ! Nous faisons le point sur notre vie, réplique Jasper. Justement, je parlais à Félix et à Jacquot et je leur demandais s’ils étaient contents de leur sort. Cage, liberté ou sécurité, les choses fondamentales de la vie, tu vois ?
— Oui, mes amis, je vois, répond le vieux cheval philosophe. Demain, je fête mon anniversaire, non pas dans l’écurie, mais dehors, dans les prés voisins avec Jean-Pierre et Béatrice. Quels gens extraordinaires !
— Je pense qu’ils t’ont sauvé toi aussi, n’est-ce-pas ? demande Jasper.
— Oui, demain je fête une nouvelle naissance. Normalement, je devrais être mort et non dans cette écurie. J’étais destiné à la boucherie à cause de mes terribles rhumatismes. J’étais autrefois un cheval de courses. J’y trouvais mon plaisir pendant les premières années et j’aimais courir. Je rapportais de l’argent et puis, au fil des années, j’ai commencé à ressentir des douleurs. Tout a dégénéré bien vite. Je ne pouvais plus courir aussi vite et en guise de retraite, on m’a fait comprendre que je n’étais même pas bon pour la reproduction chevaline.
— Oh, mon Dieu, gémit Jasper. Toi, exploité comme Jacquot ! Incroyable, non ? N’est-ce-pas, Félix ?
— Heureusement, renchérit Ernest, Béatrice est intervenue. Son amour pour nous, les animaux, est grandiose et son âme est d’une grande pureté ! Par hasard, en lisant une petite annonce sur Internet, du genre « SOS chevaux.fr », elle a lu qu’il était question de me donner à la boucherie du coin ; alors elle a préféré contacter l’association et voilà, je suis maintenant ici. Demain, cela fera deux ans.
— La vie est bien curieuse, pense Félix tout haut. Il est toujours question de liberté, de sécurité, d’argent et de mort. Parfois, je me demande quelle est notre raison d’être sur Terre !
— Chacun a un rôle sur cette planète ! La vie n’étant pas facile tous les jours, nous en oublions parfois les joies, les motifs qui nous poussent à nous projeter dans l’avenir, mais croyez-moi, mes amis, il n’y a jamais raison de désespérer, lance Ernest d’un air placide. Nous autres ici, dans cette maison, nous vivons de l’amour de Jean-Pierre et Béatrice !
Sur ce, les trois amis regardent justement les jeunes gens s’approcher de leur maison, bras remplis de victuailles, tout souriants et heureux de retrouver leurs animaux, source de grande joie et d’amour.
Jasper ne peut s’empêcher de japper de joie et de s’élancer sur Jean-Pierre en faisant des grands bonds, tandis que Félix miaule coquettement en se faufilant entre les jambes de Béatrice.
Resté seul, Ernest pense qu’il a eu de la chance. Il a deux ans demain, deux années de vie et d’amour. Son amour pour ses nouveaux maîtres est tout simplement sa raison de vivre.Pensées entre plantes et animaux
C’est l’anniversaire d’ Ernest !
Il fait beau. Tout le monde est heureux. Jasper, Félix et Jacquot, attendris par les mots de leur ami Ernest, et surtout horrifiés par le fait qu’un cheval puisse être considéré comme un repas pour des êtres humains, demandent gentiment à leurs maîtres de s’occuper de lui pour célébrer les deux ans de la nouvelle vie de leur compagnon.
Jean-Pierre et Béatrice sourient. Oui, en effet c’est une bonne idée : faire une belle promenade avec Ernest. Comme la journée est belle, ils souhaitent aller dans les prés, emporter leur repas et pique-niquer. Ernest adore galoper même si ses rhumatismes le gênent dans ses mouvements.
Quelques heures plus tard, assis joyeusement sur leur couverture, Jean-Pierre et Béatrice savourent leur repas. Un repas plutôt frugal : salade de pissenlits accompagnée d’une tranche d’agneau, fromage de chèvre, eau Evian et café pour la fin. En faisant l’impasse sur le dessert.
Non loin du couple, un mouton et une chèvre se régalent de cette belle herbe verte dans leur enclos, tandis qu’ Ernest se prélasse à leur côté. Il admire le paysage et la verdure. Machinalement, la tête baissée dans le pré, il se met à chercher l’herbe la plus tendre, lorsque ses narines frôlent un pissenlit et un akène. La fleur champêtre, ravie de ce premier contact, choisit le moment propice pour saluer Ernest.
— Bonjour le cheval ! Comment vas-tu ? demande la jolie fleur de pissenlit.
— Bien, merci, tendre fleur ! Je m’appelle Ernest. Excuse-moi pour avoir soufflé sur tes petits parachutes ! Je ne tenais pas à te manquer de respect, tu sais !
— Pas grave, joli cheval, répond le pissenlit. J’ai l’habitude des visiteurs et je me suis habitué à ce genre de choses, surtout pendant les beaux jours. Je suis très souvent présent dans les prés, aimé des êtres humains et des animaux. J’ai plusieurs missions sur Terre. On me cultive, et ce depuis plus de cinquante ans. Mes vertus sont puissantes. Ma tige est duveteuse et une fois cassée, le liquide blanc qui s’échappe est utilisé pour fabriquer le caoutchouc. On m’utilise pour les bienfaits du corps mais aussi dans la cuisine.
— C’est vrai, tu as raison, réplique Ernest, soudain pensif. Jean-Pierre et Béatrice viennent de te déguster en salade.
— Eh oui, je le disais ! Eh bien en fait, c’est un peu ma raison d’exister, et je m’en fais l’éloge. De plus, je suis hermaphrodite, je peux m’autoféconder grâce à mes multiples fleurs et aux insectes dans mon réceptacle. Et toi, mon ami ? Quel est le sens de ta vie ?
— Moi, c’est l’amour que je cultive tout simplement. Aujourd’hui, j’ai deux ans. C’est une nouvelle vie. Tu vois, Jean-Pierre et Béatrice, qui viennent de te déguster, m’apprécient beaucoup. Ils m’ont sauvé de la boucherie…
— Quoi ? Tu veux dire, que toi aussi, tu représentes un mets succulent pour les humains ? Ça, je ne l’aurais vraiment pas cru.
Et Ernest raconte son histoire, ses périples et ses courses, en évoquant sa destinée auprès de ses maîtres. La fleur est toute pensive et finit par reconnaître que, l’amour porté à des êtres humains tel que celui qu’éprouve Ernest pour ses maîtres, est une noblesse d’âme du cheval.
Pendant la discussion du pissenlit et du cheval, le mouton et la chèvre s’étaient rapprochés du couple. La chèvre, curieuse de nature, trouve le moment propice pour se joindre à la conversation du pissenlit et du cheval.
— Bonjour vous deux ! Quelle belle journée, n’est-ce-pas ?
— Oui, répondit Ernest. C’est magnifique de se reposer dans un pré, car cela change de mon écurie. J’adore profiter de ces moments agréables pour admirer tout ce que je vois autour de moi : l’herbe si belle, les arbres et les plantes… la joie de mes maîtres !
— Tes maîtres ? Assis tous les deux sur la couverture ? demande la chèvre.
— Oui, jeune chèvre curieuse, mes maîtres font un pique-nique aujourd’hui. N’est-ce-pas, joli pissenlit ?
— Oui, mon ami ! répond celui-ci. Justement, nous parlions de notre vie et de notre rôle sur Terre ! Je parlais de mes vertus et de mes utilisations diverses. Oh, regarde la chèvre ! Les maîtres d’Ernest se reposent et somnolent après leur repas.
— Ah oui, je les ai vus, réplique la chèvre. Ils dégustaient un magnifique fromage fait avec mon lait. Eh bien moi, je n’ai pas chômé depuis que j’existe sur Terre !
— Ah oui ? Que peux-tu nous conter de beau ? demandent le pissenlit et Ernest en même temps, heureux d’avoir un nouveau compagnon.
— Eh bien en fait, je ne suis pas jeune, comme vous le pensiez en me saluant. Notre histoire remonte à la fin de la deuxième glaciation, c’est-à-dire environ dix mille ans. Attention, je ne parle que de la période de domestication qui se situerait à cette époque, sur les plateaux d’Iran et de l’Anatolie. Les êtres humains, conscients de notre utilité, nous ont protégées autrefois en tuant nos prédateurs. Ensuite, certaines tribus ont commencé à nous élever…
— Et qu’ont-ils fait avec vous, les chèvres ? demande Ernest très intrigué.
— Nous sommes devenues domestiquées et étions généralement gardées dans des troupeaux qui se déplaçaient sur les collines et sur les domaines de pâturage. En fait, ce sont les enfants ou des adolescents qui se consacraient à la tâche. Le lait, notre peau, nos poils et même notre viande, sont appréciés. C’est reconnu dans le monde entier ! Un fait divers remonte en 1931, lorsque deux de mes ancêtres ont nourri Gandhi en lui fournissant sa ration quotidienne de lait, vous le saviez ?
— Non, pas du tout ! répliquent le pissenlit et le cheval étonnés.
— Mais ce n’est pas tout… non seulement notre peau est toujours utilisée pour le transport de l’eau, du lait caillé ou du vin, mais elle était utilisée autrefois comme parchemin, jusqu’à ce que l’imprimerie soit inventée.
— Ernest, mon joli, où es-tu ? demande soudain Béatrice qui vient de se réveiller après une petite sieste.
— Je suis là, je discute avec des amis, Béatrice ! répond Ernest.
— Très bien ! Tiens, je te donne un peu d’eau, tu dois avoir soif. Moi aussi, je boirais bien un bon café… Jean-Pierre, mon amour, tu me passes la thermos ?
— Bonté divine, intervient alors la chèvre excitée ! Pour un peu, j’aurais oublié de mentionner qu’une de mes ancêtres est à l’origine de l’invention du café !
— C’est vrai ça ? demande Jean-Pierre, en servant une tasse de café à Béatrice. Dis donc, la chèvre, tu ne te moques pas un peu de nous ?
— Oh, que non, répond celle-ci d’un air amusé ! Une de mes ancêtres vivait autrefois en troupeaux en Afrique, plus exactement en Éthiopie, vers l’an 850, et se nourrissait de choses et d’autres. En fait, elle mangeait ce qu’elle pouvait bien trouver, et par hasard elle trouva les grains rouges particulièrement délicieux qui se trouvaient en baies tout près d’elle. Le berger remarqua, peu de temps après, que mon ancêtre était devenue vivace et excitée bien plus que ses congénères. Il en chercha les raisons et découvrit la graine…
— Ah, oui ? On peut deviner la fin de l’histoire, réplique Ernest. Je parie que le berger a goûté la graine, mais comment est véritablement né le café ?
— Il a un goût amer, il a fallu procéder à la torréfaction, répond la chèvre savante. On dit que les moines ont jeté le fruit dans le feu pour lui donner du goût. En guise de goût, c’est une bonne odeur qui s’est répandue et alors, ils ont fait une infusion de cette chose devenue une boisson que personne ne conteste aujourd’hui pour ses vertus excitantes. D’ailleurs, en langue arabe, le mot café est « qahwah « et signifie « excitant ».
— Bon sang ! Je suis enseignant et je parle plusieurs langues, intervient Jean-Pierre, mais je n’étais pas au courant de ce fait. Je bois du café tous les jours comme des milliards d’individus, mais je ne me suis jamais posé de questions sur l’histoire du café. Bien dit, la chèvre !
— Tatata, réplique le pissenlit, excité et un peu jaloux. Si tu veux du café ou un bon substitut, tu peux toujours griller mes racines ! Ça marche aussi.
— Oui, c’est vrai, renchérit Béatrice en enlevant son petit gilet. Oh, quel bon café. Il me réchauffe un peu.
— Bingo, réplique la chèvre, qu’est-ce que je vois ? Alors on enlève la petite laine : la mohair, n’est-ce-pas, Béatrice ? Voilà, encore une de nos utilisations ! Sans parler de notre chair et de notre utilité pour certaines populations africaines qui survivent grâce à nous, en buvant un peu de notre sang lorsque la population en a le besoin.
La chèvre, toute excitée et ravie de vanter ses mérites, ne voit pas s’approcher le mouton, qui partage son enclos. Celui-ci est timide et modeste : il plaît davantage à Ernest pour ces raisons, car la chèvre lui fait penser un peu à Félix, qui parfois, est tout aussi arrogant que cette dernière. Mais peu importe, il reconnaît que chacun a son histoire et sa raison d’être. D’une voix aimable, il s’adresse maintenant au mouton, qui a déjà salué le pissenlit.
— Bonjour mon ami ! Et toi, comment vas-tu ? Que fais-tu sur Terre ?
— Je vais bien, merci, murmure le mouton, un peu intimidé. Moi, je suis encore jeune et je n’ai pas encore l’expérience ni la maturité de Joséphine, dit-il, en désignant la chèvre. Néanmoins, nous avons beaucoup de points communs pour l’économie agricole mondiale. Nous fournissons également une vaste gamme de matières premières. Nos laines, nos peaux sont utiles pour la fabrication des vêtements de même que les sous-produits de notre abatage tels que le suif, utilisé dans la fabrication des bougies et du savon. Nos os ainsi que les cartilages servent à fabriquer la colle et la gélatine ainsi que des osselets. D’autre part, nos intestins sont souvent utilisés comme boyau de saucisses, pour les sutures chirurgicales ou pour des instruments de musique.
— C’est ce que je raconte souvent à mes élèves, c’est vrai gentil mouton, dit Béatrice. Je suis institutrice et je travaille dans la même ville que Jean-Pierre, mon mari.
Sur ce, Ernest qui digère sa belle herbe en écoutant la conversation, sent subitement une envie pressante l’envahir, et par pudeur, s’éloigne du petit groupe pour faire un besoin naturel. La chèvre regarde Ernest d’un air un peu narquois, écarquille davantage ses grands yeux. Le gentil mouton, qui apprécie le cheval, s’approche de lui, et contemple le crotin tout frais pour reprendre son discours interrompu par Béatrice. Le jeune mouton a pris de l’assurance :
— Les crottes de mes semblables servent aussi à la fabrication de pâte à papier, une fois stérilisées et mélangées aux matériaux traditionnels. Et parfois, nos testicules sont appréciées dans certains pays comme l’Iran. C’est dire notre importance et puis Béatrice et Jean-Pierre ont eux-mêmes mangé une belle tranche de mouton, n’est-ce-pas ? Je vous ai vus tous les deux, vous vous êtes bien régalés, notre chair est succulente. Le monde musulman nous consomme, notamment les pays du Golfe Persique ! Quant à la France, l’élevage de moutons a fourni au début des années 2000 plus de 141 000 tonnes de viande par an, plus de 235 millions de litres de lait, pour la fabrication de 46 700 tonnes de fromage et environ 12 000 tonnes de laine.
— Oh, que tu es bien instruit, petit mouton, répond Béatrice. Je te remercie pour ces précisions. Mais tu sais, beaucoup de tes semblables vivent surtout en Chine, en Australie de même qu’en Inde et en Iran.
— Oui, c’est vrai ! Merci, mon amie.
— Nous sommes très présentes en Iran aussi, intervient alors Joséphine, toujours soucieuse de sa propre valeur. Nous sommes très appréciées et parfois, les gens nous considèrent comme des animaux domestiques. Ils jouent avec nous. Nous les suivons partout, nous savons nous adapter et même faire de la moto ! Ça vous épate, non ? Et dans des pays africains, comme au Sénégal, certaines de nos cousines sont présentes en bordure de mer, dans certains villages, et mangent du papier pour survivre. Je veux dire que nous, les chèvres, nous sommes particulièrement douées pour survivre et nous habituer à n’importe quel destin.
— Oui, c’est exact, reconnaît Béatrice. J’aurais aimé que mes élèves soient présents aujourd’hui pour vous entendre parler de votre rôle sur Terre !
— Eh oui, Béatrice a raison, commente maintenant Jean-Pierre, alors, moi, je vais vous dire quel est notre rôle ! Béatrice et moi, nous sommes enseignants et notre raison de vivre est d’inculquer notre savoir aux futures générations humaines, du moins les bases essentielles de ce que nous considérons être notre savoir, limité, il faut bien le dire. Et notre raison d’exister est aussi celui de procréer. Béatrice souhaite un enfant et nous y travaillons assidûment, si l’on peut considérer cela comme une tâche, sourit Jean-Pierre en regardant Béatrice d’un air coquin !
— Jean-Pierre, tu as raison, rougit sa femme. Mais dis-moi, il se fait tard. Jasper, Félix et Jacquot nous attendent.
Sur ce, tout le monde se sépare et se confond en remerciements. Avant de partir, Béatrice ramasse quelques pissenlits pour les faire cuire afin de remplacer les épinards qu’elle a oubliés d’acheter.
Ernest, ravi d’avoir eu une belle compagnie le jour de son anniversaire, rentre joyeusement au bercail.
Déjà les attendent Jasper et Félix dans la cour du jardin. Le chien lape un peu d’eau dans sa gamelle devant le pérron, tandis que Félix rebouche un trou délicatement après avoir fait son petit pipi. Jacquot, lui, grignone quelques graines dans sa cage.Pensées sur les fourmis et abeilles
Il reste quelques tranches de gigot de mouton. Béatrice fait cuire les pissenlits et prépare le repas. Tous les animaux, eux, ont mangé et sont repus. C’est au tour des êtres humains maintenant.
Pendant le repas, le temps a changé. Le beau soleil a fait place à un ciel gris, maintenant si maussade, que les nuages, omniprésents, deviennent de plus en plus noirs et menaçants.
— Bon ! Pour un petit tour dans le village afin de faciliter notre digestion, c’est raté, annonce Jean-Pierre après la dernière bouchée. Je crois, ma chérie, qu’il vaut mieux rester sagement à la maison.
— Oui, tu as raison. De toute façon, nous avons passé une belle journée dehors. Je me sens détendue ! Pas toi ?
— Si. Viens, nous allons regarder la télé, à moins que tu préfères une partie de cartes ou lire un peu !
— Non, réplique sa femme. On peut regarder la télé ce soir.
Sitôt dit, sitôt fait. La télé est allumée. Notre jeune couple est installé avec leur chien et leur chat. Sur le sofa un bocal contenant des roupettes à queues est à la porté de Jean-Pierre. Il en prend une et croque dedans.
Au programme un reportage de la BBC sur les animaux. Ils sont d’emblée envoûtés par les belles images que présente la chaîne britannique sur la vie des insectes. L’émission a commencé, mais ils sont, tous les deux, fascinés par les fourmilières et par leur classification sociale ainsi que leur mode de communication.
— Regarde, chérie ! Qu’en penses-tu ? Un monde fascinant, n’est-ce-pas ?
— Oui, Jean-Pierre ! Tu sais, l’innovation des fourmis ainsi que des termites, de certaines abeilles et même de guêpes, a été de produire deux catégories d’adultes femelles qui sont les reines et les ouvrières. Et elles ont des morphologies différentes qui ont abouti à une spécialisation pour l’accomplissement de tâches distinctes.
— Tu as raison, regarde ! Ici, on voit les ouvrières qui protègent leur nid et rapportent la nourriture !
— Oui, et les reines, dont la longévité de vie peut être de l’ordre de vingt ans pour certaines espèces, est fertile et pond les œufs : les mâles les fécondent au cours du vol nuptial et meurent aussitôt !
— Mon Dieu, réplique Jean-Pierre, imagine la mort de tous ces mâles, quelle horreur… mais après tout, c’est la vie et leur raison d’être sur Terre ! Oh, regarde bien ces deux fourmis qui se croisent ! On dirait qu’elles se caressent !
— Eh bien en fait non, réplique sagement Béatrice. Tu vois deux fourmis qui se rencontrent pour la première fois ! Elle se tapotent avec leurs pattes et leurs antennes et peuvent ainsi reconnaître leur forme et leur odeur. Donc, cela leur permet de savoir si elles sont de la même fourmilière ! Et lorsqu’une fourmi revient à la fourmilière, les fourmis affamées lui caressent la tête.
La BBC offre de splendides images. Jean-Pierre voit justement une fourmi qui ouvre sa mandibule pour régurgiter une goutte de nourriture qui sort de son estomac. Cette nourriture est constituée d’aliments absorbés hors du nid, du liquide régurgité par d’autres fourmis et des arômes qui viennent de la fourmi elle-même. D’autres images suivent ainsi que les commentaires. Jean-Pierre apprend que le monde compte environ 10 millions de milliard de fourmis. La plus petite taille est 1 millimètre et la plus grande est de l’ordre de 5 centimètres.
Jean-Pierre reprend une roupette, tandis que la BBC passe à la fourmi indienne, capable de nids complexes sous-terrains pour échapper aux inondations qui sévissent dans le pays. Plusieurs étages montrent des chambres habitées et protégées par une coupole imperméable, le tout étant isolé par un vide sanitaire débouchant sur un puits perdu. Il est fasciné par cette architecture et cette intelligence animale.
— Chérie, regarde bien ces petites créatures qui sont si brillantes ! Elles sont capables de se protéger de l’eau et des inondations ! Quand je pense que demain, je serai au collège à enseigner dans une classe avec un trou au toit et la flotte en prime sur notre tête !
— Quoi, tu n’as toujours pas de réparation en cours, intervint Béatrice, outrée ?
— La semaine dernière des ouvriers sont venus pour effectuer des travaux d’étanchéité, mais quelques gouttes tombent toujours sur ma tête, répond Jean-Pierre non sans sourire en pensant au travail brillant des fourmis.
— Eh bien, à la bonne heure ! dit Béatrice en visionnant les fourmis australiennes que les reporters de la BBC ont filmées sur le haut d’un arbre ! Regarde, celles-ci font leur abri en repliant des feuilles, en les tirant pour rapprocher les bords.
Avec émerveillement le couple contemple ces fourmis intelligentes qui s’activent à coudre les feuilles grâce aux fils de soie produits par leurs larves. Un gros plan sur la mandibule de la fourmi permet de voir son travail efficace. Puis s’ensuit un reportage sur la seule fourmi capable de sauter pour attraper une proie vivante : Le Harpegnathos saltator. Un vrai phénomène !
Soudain, Jasper, sagement couché près de son maître se lève, le regarde et lui fait comprendre que lui, il a des « fourmis » dans les pattes et qu’il aimerait bien sortir un peu. Félix s’étire, baîlle un peu, il a un petit creux. Il miaule et Béatrice se lève pour lui donner quelques croquettes de poulet. Heureusement, c’est le moment de la publicité !
Il fait noir, lorsque Jean-Pierre sort dehors, parapluie en mains, avec Jasper, qui n’a pas peur de quelques gouttes d’eau et qui s’excite. Il jappe de plaisir… Béatrice en profite pour caresser Félix et jouer un peu avec Jacquot. Celui-ci est ravi des attentions prodiguées et offre à la vue de sa maîtresse un plumage époustouflant de couleurs magnifiques. Oui, il se sent bien ici chez elle et apprécie sa sérénité.
Lorsque Jean-Pierre revient, il enlève ses chaussures humides, les dépose soigneusement dans la petite véranda, ainsi que son parapluie, devant la maison, et prend une grande serviette de bain pour frictionner Jasper.
— C’est toujours la pub ? demande t-il. Au fait, une fourmilière est grande. Combien de fourmis vivent dans une colonie et comment font-elles pour s’orienter ? demande le professeur de langues vivantes.
— Eh bien, tout dépend de la colonie et des espèces, répond Béatrice. On compte plusieurs centaines de milliers, voire de millions de fourmis par colonie; en Afrique, chez certaines espèces, les colonies se comptent le plus souvent en centaines de milliers, voire en millions d’individus tandis qu’au Japon on a recensé des méga-fourmilières enregistrant plusieurs centaines de millions d’individus ! Tu te rends comptes, une fourmilière qui pourrait être aussi peuplée que notre Europe en parlant de l’échelle humaine, incroyable, non ? En ce qui concerne le sens de l’orientation, elles se servent de compas solaire pour compléter les odeurs déposées le long du dédale de leur chemin. Les messages olfactifs jouent aussi un grand rôle.
— Effectivement, cela me laisse pantois, répond Jean-Pierre. Mais dis-moi, de quoi se nourrissent les fourmis en général ?
— Mon chéri, leur choix peut être varié. Selon les milieux fréquentés et les espèces considérées, on va trouver des fourmis herbivores. Parmi celles-ci, il y a les fourmis moissonneuses qui récoltent des graines de nombreuses plantes pour les trier, les emmagasiner. Il y a aussi les fourmis champignonnistes qui accumulent des feuilles dans des chambres prévues à cet effet. Ces feuilles vont se décomposer en un substrat qu’elles ensemencent pour obtenir des champignons dont elles vont se nourrir. On compte aussi les fourmis carnivores qui chassent des proies vivantes dont la fourmi appelée Harpegnathos saltator et les fourmis éleveuses de… pucerons ! Elles se nourrissent de miellat, excès de sève rejeté par les pucerons ou les cochenilles. Les fourmis ouvrières obtiennent le liquide sucré en caressant et en tapotant l’abdomen du puceron. Certaines espèces, plus évoluées, vont même jusqu’à élever ces pucerons comme du bétail et les protéger des prédateurs, Jean-Pierre !
— Oh, comme tout est bien organisé ! remarque Jean-Pierre. Nous, les hommes, sommes souvent convaincus de notre supériorité, quelle erreur de notre part ! Chaque espèce, chaque plante a sa fonction et son intelligence, n’est-ce-pas, Jasper ?
En guise de réponse, le chien, encore humide, s’approche de son maître et lui lèche la joue. Tous les deux sont maintenant dans la cuisine. Félix, le chat, en profite pour les rejoindre afin de quémander un peu de lait. Jean-Pierre le caresse et s’apprête à se faire un lait chaud pour lui et Béatrice. En ajoutant un peu de miel. Du miel de la ruche d’un gentil collègue !
Entre-temps, la publicité est terminée et la nouvelle émission concerne les abeilles. La BBC diffuse quelques clichés spectaculaires et souhaite présenter aux spectateurs un petit sommaire des ressemblances entre ces abeilles et les fourmis que la chaîne britannique vient de présenter. En effet, l’organisation sociale est fort intéressante et similaire par certains aspects.
— Voici ton lait chaud, fait Jean-Pierre, en déposant la tasse près de Béatrice. On regarde la fin de l’émission et on va dormir.
— Oui, demain la journée sera rude. Je dois faire encore une autre exposition, raconte Béatrice. Le mois dernier, c’était les fourmis, mais cette fois-ci, ce sera les mésanges. Un jour, peut-être, ce sera les abeilles. Les élèves et certains parents d’élèves viennent aux expositions et sont enchantés. Je prends soin de présenter les thèmes d’une façon plutôt ludique, pour que les gens assimilent mieux les informations sans trop de chiffres à retenir. En fait, tout dépend du thème choisi. Cela demande une grande préparation : les informations à apporter et la manière de les présenter dans la salle.
— Eh, oui, chérie, dit Jean-Pierre, un jour tu pourras raconter tout ce que tu sais à notre rejeton ! Ah, au fait, quand comptes-tu passer les vacances à Majorque ?
— Je pense que juillet est moins chaud que le mois d’août, répond Béatrice, d’une voix enjouée. Une semaine au soleil et au bord de la mer, ça va nous faire du bien. Je dois faire les réservations et prendre les billets d’avion.
— D’accord, et moi, de mon côté, je vais prévenir Nadine qui s’occupera de la maison et des animaux. Que ferions-nous sans elle ?
Le présentateur de la BBC annonce la diffusion du programme concernant les abeilles, pendant que le couple boit le lait encore chaud. L’émission porte, tout d’abord, sur la vie d’une reine des abeilles.
— Eh bien, fait Jean-Pierre attentif. Les mâles sont encore une fois de plus les perdants. La reine va s’accoupler avec plusieurs mâles qui vont ensuite mourir ! Pas juste, vraiment, non !
— Eh oui, que veux-tu, Jean-Pierre ? C’est la vie. Regarde plutôt cette abeille ! C’est une reine. Tu sais, elle passe sa vie à pondre des œufs, et des œufs femelles pour assurer la relève de l’espèce. Elle peut pondre environ 2500 œufs en 24 heures, ajoute Béatrice. Mais à partir de la quatrième année, elle ne pondra plus beaucoup et la ponte consistera à déposer que des œufs sans spermatozoïdes qui donneront naissance à des mâles.
Le couple apprend qu’une reine des abeilles peut vivre jusqu’à 5 ans grâce à la fameuse gelée royale, produit blanchâtre et gélatineux fabriqué grâce aux glandes cervicales des nourrices. Les images les montrant, nourries de cette gelée, sont magnifiques. Comme pour les fourmis, les abeilles ont une organisation sociale comme l’indique le reportage. Les abeilles ouvrières dont le but est de nourrir la reine et de prendre soin d’elle, sont organisées. Chacune assume son rôle.
Jean-Pierre et Béatrice ont bu leur lait et posent la tasse vide près du bocal à roupettes. Le reportage porte sur les étapes des tâches variées des abeilles ouvrières. Le couple assiste à la naissance de l’abeille qui naît au bout de 21 jours après avoir été une petite larve auparavant. Les premiers jours passés consistent à nettoyer les débris de la ruche et des cellules tout comme les couvains. Vient la phase de la nourriture pendant laquelle les abeilles ouvrières agissent comme nourrices pour nourrir les larves ouvrières avec de la bouillie de miel et de pollen. Une fois les glandes pharyngiennes développées, elles nourrissent la reine avec la gelée royale produite par leurs glandes. Ensuite suivra la période de magasinière : recevoir les pollens apportés par les butineuses pour les déposer dans les alvéoles et operculer le miel. Peu de temps après, elles produiront des écailles pour édifier des rayons ou en réparer grâce à la maturité des glandes cirières.
Soudain, Jean-Pierre se lève. Il a chaud. Il ouvre la fenêtre pour avoir un peu d’air. C’est le moment ou le reporter parle du rôle de ventileuse consistant à battre des ailes pour aérer la ruche à l’entrée. L’homme est fasciné par les images. Il saisit l’importance de l’information et du rôle de ces merveilleux insectes. Il admire ces ventileuses qui laissent passer les abeilles butineuses en interdisant l’accès aux abeilles d’autres ruches. Il constate que tout est admirablement bien organisé et pense involontairement que l’organisation de son lycée bat de « l’aile » et laisse à désirer. Il a presque honte d’être un « humain » , et de surcroît de profiter de ces animaux pour s’accaparer du miel qu’il déguste tous les soirs dans son lait avant de se coucher.
Béatrice admire aussi ces formidables créatures. Elle vient de voir une abeille gardienne surveiller l’entrée de la ruche et demander du renfort contre une invasion d’abeilles appartenant à d’autres ruches. Elle apprécie les butineuses qui transmettent le butin aux abeilles magasinières.
Soudain, c’est un coup de tonnerre qui couvre le son du poste de télévision ! Un éclair illumine la pièce et un second coup de tonnerre encore plus fort se fait entendre. Jasper est nerveux. Jean-Pierre referme la fenêtre. La pluie tombe maintenant encore plus soutenue que tout à l’heure.
Béatrice préfère éteindre le poste de télévision : les orages la rendent aussi nerveuse.
C’est l’heure d’aller dormir. Béatrice pense à ses mésanges pendant que Jean-Pierre aux gouttes d’eau qui tomberont du toit de sa classe demain pendant les cours.
Ernest dort dans son écurie, pendant que Jasper et Félix sont couchés au bord de la cheminée. Jacquot est là, lui aussi. L’orage a fini de faire trembler la maison et les êtres.
Tout est paisible.Pensées sur le soleil et la lune
Nadine, la nièce de Jean-Pierre, débarque le jour du départ du couple.
Jasper et Félix ont remarqué les allez-et-venues dans la maison et des valises ouvertes. Ils sont un peu nerveux, ils pressentent l’inévitable : le départ de leurs chers maîtres. Jacquot a parlé en prononçant quelques mots tels que « vacances », « voyages », « seul » ; par contre, Ernest, reste serein. Il sait que ses maîtres ont besoin de repos au bord de la mer.
En effet, Jean-Pierre a eu une année stressante dans son lycée, où les conditions de travail se détériorent d’année en année. Le toit de son établissement n’a toujours pas été réparé et il tremble à chaque fois qu’il pleut. Alors, système « D« oblige, il a pris soin de poser un petit seau à l’endroit précis où les gouttes tombent. En arrivant un jour à l’improviste dans sa classe, c’est le proviseur qui a pâli en constatant l’absurdité de la situation. Les élèves, eux, ont rigolé et ont posté sur internet les photos de leur classe… avec le seau !
Béatrice, quant à elle, a eu beaucoup à faire avec ses expositions sur les fourmis et les mésanges pour ses petits élèves. De plus, son bénévolat, pour sauver les âmes en peine à quatre pattes, lui a demandé beaucoup d’énergie. Elle a sauvé d’autres chats et chevaux tels que Félix et Ernest.
Alors, forcément, Félix est un peu nerveux. Il a l’impression que ses maîtres ne reviendront pas et a peur de les perdre. Pire, encore, il a peur de voir débarquer un autre chat affamé et orphelin dans les bras de Béatrice à son retour. Félix est un peu jaloux.
Nadine fait le tour de la maison et après avoir embrassé le couple et salué les animaux, elle range ses affaires dans la chambre d’amis. Elle aime la maison de son oncle et une semaine à la campagne en compagnie des animaux la comble de bonheur.
Pendant ce temps Jean-Pierre et Béatrice rassurent les bêtes et leur parlent en leur promettant de revenir bientôt. Nadine reste seule avec Jasper, Félix, Jacquot et Ernest.
Après deux heures de vol, les voici arrivés à destination en début de soirée. Leur petite finca à Alcudia va leur permettre de se reposer. Piscine, mer et plage, chaleur estivale vont procurer la détente nécessaire pour que le couple décompresse un peu et prenne le temps de vivre.
Après une nuit pleine de sommeil, le couple se lève, réveillé par les premiers rayons du soleil qui filtrent les volets verts de la finca.
Comme le frigidaire est vide, il faut faire les courses, mais Béatrice a décidé de prendre un petit déjeuner – café con leche y magdalenas (café au lait et madeleines) – au petit bistrot du coin comme chaque année. Pedro, le propriétaire du bistrot, y travaille depuis plus de 20 ans, c’est dire qu’il il fait partie du décor d’Alcudia ! Pedro, cœur sous la main, est en fait andalou. Il est venu à Majorque pour une vie meilleure, et surtout à cause d’Inès, sa femme, qui préférait cette île située près de sa ville natale, Valencia.
Avec un sourire au coin des lèvres, Béatrice repense au jour où elle a ramené le petit chaton affamé chez Pedro, qui aussitôt, lui avait donné de l’eau et quelques tranches de jambon. Eh oui, sacré Pedro, ça va lui faire plaisir de nous revoir, pense la jeune femme.
Déjà, le bistrot est plein de monde : gens du coin et les nombreux touristes. Tous prennent le café sur la petite terrasse ensoleillée. Béatrice et Jean-Pierre cherchent une table parmi les autres clients. Ils n’ont pas encore vu Pedro. Sans doute est-il occupé dans la cuisine à tartiner les tranches de pain de « sobrasada ».
Jean-Pierre songe qu’il est ravi de pouvoir parler toutes les langues qu’il enseigne à des élèves plus ou moins motivés. En plus de l’espagnol, il parle l’anglais, l’allemand et l’italien. Béatrice se débrouille en anglais, mais ne parle que quelques mots d’espagnol.
— Holà ! Amigos mios ! s’écrie brusquement Pedro en les apercevant près du couple anglais qu’il s’apprête à servir.
Après avoir échangé deux mots aimables avec le couple britannique, il se dirige maintenant vers Béatrice et Jean-Pierre, qu’il appelle « mes amis français » à qui veut l’entendre. Il les embrasse très chaleureusement.
— Holà Pedro ! Quel plaisir de te voir ! s’exclame Jean-Pierre d’une voix émue.
Accolades et embrassades. Quelques larmes de bonheur. Pour eux, cette retrouvaille est une source de joie profonde. Cette chaleur humaine les énivre de bonheur tout autant que le soleil en Espagne et ses tapas. Il s’ensuit une petite discussion amicale sur la santé de la famille de Pedro, les affaires du bistrot et sur les nouvelles du pays. Le couple français raconte la vie stressante qu’il vient d’endurer en France, puis Pedro prend leur commande. Peu de temps après, il revient tout souriant avec le café au lait et les madeleines.
— Dis-moi, comment va le chat ? s’enquiert Pedro.
— Félix ? Très bien. Nadine s’occupe de lui pendant nos vacances.
— Nadine, tu nièce ? Comment va t-elle ?
Jean-Pierre sait que Félix est toujours présent dans les pensées de son ami andalou qui aime bien Nadine aussi. Celle-ci aime les animaux et la langue espagnole qu’elle étudie. Béatrice, elle aussi, ressent de l’affection pour Pedro, qui l’avait autrefois aidée à trouver un bon vétérinaire pour examiner Félix avant de le vacciner.
Après le petit déjeuner Jean-Pierre et Béatrice vont louer une voiture pour leurs déplacements pendant la semaine. Ainsi, ils pourront visiter d’autres régions de cette belle île. Puis, ils filent se ravitailler.
Il fait chaud et le couple transpire. Jean-Pierre et Béatrice reviennent les bras chargés de victuailles et commencent à préparer leur déjeuner pour le déguster sur la terrasse. Le soleil est ardent et une sieste s’impose. Près de leur piscine ils se reposent, repus de leurs tapas, sous le grand parasol. Demain, ils iront à la mer avec de quoi passer toute la journée : boissons, fruits et petits pains, crème solaire, chapeaux, livre ou magazines.
Après une grasse matinée prolongée jusqu’à dix heures, Jean-Pierre et Béatrice se lèvent et déjeunent copieusement avant de rejoindre la plage pour y passer la journée. Ils utilisent la voiture louée pour accéder à la grande baie d’Alcudia déjà bondée de vacanciers.
— Quelle belle journée, souffle Béatrice à son mari, une fois installée confortablement sur sa chaise longue. Le soleil cogne. Il faut bien se protéger !
— Eh, oui tu as raison. Mais dis-moi, ne serions-nous pas mieux dans l’eau ? N’as-tu pas envie de nager un peu ? La mer est si belle !
Et comment ? Bien sûr que si, cette baignade leur plaît. Elle est parfois entrecoupée d’une petite séance de bronzage, mais l’eau limpide et rafraîchissante les attire indubitablement. Les heures passent vite. Ils bronzent, se reposent et retournent se baigner. Ils se prélassent en s’efforçant d’oublier les soucis quotidiens.
Peu à peu, les gens quittent la plage. Mais Jean-Pierre et Béatrice sont trop heureux de profiter de ces moments de bonheur ! Parfois, ils se désaltèrent et croquent dans une pomme.
Il est presque vingt heures trente et ils sont toujours dans l’eau ! Le soleil va bientôt se coucher et la lune fait son apparition discrète sous forme de croissant d’une couleur jaune pâle. Le ciel est légèrement orangé, des mouettes volent en tournant autour du couple ou en direction de la plage un peu sombre par endroits. La mer est calme et claire. Les bruits s’estompent ; on n’entend plus que les cris des mouettes…
— Jean-Pierre ! Regarde cette lune, et le soleil couchant ! C’est poétique, tu ne trouves pas ? s’exclame Béatrice.
— Oui, c’est même très romantique ! réplique son mari. Ah, que je suis heureux d’être ici. Avec toi !
Pensif, le couple admire le ciel devenu orange vif à l’horizon, la lune plus lumineuse et toute la mer immense autour d’eux. Devant ce magnifique spectacle, les mots manquent pour décrire tout ce que les jeunes gens ressentent à la minute présente. La beauté est si saisissante, que le couple reste silencieux. Jean-Pierre échange un regard ému à Béatrice, qui est aussi tout aussi bouleversée que lui. Soudain, une larme coule le long de la joue de Béatrice, une larme de bonheur face aux éléments de la nature. Jean-Pierre s’approche de sa femme, l’entoure de ses bras puis l’embrasse tendrement, en lui disant que, elle aussi, elle est tout aussi belle que ce paysage magnifique.
Le soleil s’est couché maintenant. Le ciel embrasé et pourpre, devient plus sombre, de même que la mer et la plage. Il est temps de regagner la plage et de se sécher.
— Mais dis-moi, chérie, comment sont nés le soleil et la lune ? Sont-ils vraiment si loin de nous ? s’enquiert soudain Jean-Pierre, après s’être essuyé et avoir enfilé des vêtements secs.
— Les scientifiques pensent que la cause la plus probable de la naissance du Soleil serait l’explosion d’une étoile – supernova – à proximité du nuage de poussière ou bien le passage de ce dernier dans un des bras de la galaxie qui aurait provoqué sa contraction, il y a plus de 4,5 milliards d’années. En fait, le soleil a déjà vécu la moitié de son temps et peut être considéré comme une petite étoile à environ 150 millions de kilomètres de nous. Quant à la Lune, dont la distance est 384 400 kilomètres, on spécule sur son origine. Certains scientifiques parlent d’un astéroïde capturé, ou bien de la fission d’une partie de la terre par l’énergie centrifuge. Mais d’autres corroborent l’hypothèse d’un impact géant tel qu’une collision entre la jeune Terre et un objet gros comme Mars, appelé Theia, qui aurait éjecté de la matière autour de la Terre pour former ce que nous considérons comme la Lune aujourd’hui. Il y a bien longtemps, environ 4,5 milliards d’années.
— Impressionnant Béatrice, tu ne trouves pas ? En tout cas, la lune est belle et est certainement l’astre le plus visible dans le ciel. On y voit à l’œil nu ses contours et avec des jumelles les sombres plaines basaltiques et les cratères.
Soudain, une petite ombre s’approche de Jean-Pierre qui effrayé, a arrêté de parler. Béatrice, elle, rit de sa frayeur ! Oh, mon Dieu, cette ombre n’est que la silhouette d’un chat errant, qui cherche un peu de nourriture et des caresses. Le chat est encore jeune et ressemble un peu à Félix. Béatrice prend ses victuailles et sort du panier un petit mets pour chat… Partout où elle va, elle prend soin de prendre de la nourriture pour chats pour tous ses déplacements… Ainsi, elle peut nourrir les âmes affamées qu’elle rencontre. La bête se jette sur le mets délicat au poulet. Le couple ne peut s’empêcher de repenser au jour où ils ont connu Félix ; c’était il y a 3 ans. Cette pensée les émeut, car ce chat aimerait sûrement aussi avoir un maître. Par chance, l’animal, qui vient de terminer son repas, s’éloigne de quelques mètres, puis s’arrête pour entreprendre une petite toilette. Jean-Pierre et Béatrice en profitent pour quitter silencieusement la plage. Non, ils n’emporteront pas d’autres chats avec eux en France. Félix serait trop jaloux et mécontent !
Avant de se coucher, le couple déguste une paella sur la terrasse de leur finca. La lune éclaire leur table. Jean-Pierre trinque avec Béatrice : une petite sangria pour terminer la journée en beauté. Ils contemplent encore une fois la lune et les étoiles, en silence, pour profiter de cet instant merveilleux…
Vers minuit, ils vont se coucher. Avant de dormir, écouter de la musique : Stan Getz accompagnée de la belle voix d’Astrid Gilberto. Un ravissement pour les oreilles, pensent-ils avec bonne humeur. Cela les rend tout câlins et amoureux… Bientôt, la Bossa Nova fait place aux soupirs langoureux de Béatrice, qui sous l’étreinte de Jean-Pierre, se sent amoureuse et comblée de bonheur !
Le lendemain matin, Béatrice admire la vue qui donne sur leur piscine et la terrasse en ouvrant les volets verts. Les jeunes gens se lèvent et prennent le petit déjeuner sur la terrasse.
Aujourd’hui, ils aimeraient faire une petite excursion jusqu’au cap Formentor qui marque le point le plus septentrional de Majorque avec un phare tout au bout. On y accède en traversant une pinède tranquille pour arriver dans un méli-mélo de falaises et de roches. Rien de tel pour faire un peu d’exercice et de voir un petit bout de l’île sans rester inactifs toute la journée sur une plage, pensent-ils d’un air enjoué.
— Chérie, il faudrait emporter des boissons et des sandwiches, déclare Jean-Pierre. Nous ferons une pause casse-croûte quelque part. Surtout, n’oublions pas notre caméra digitale. Qui sait, tu feras peut-être un jour une expo sur l’île de Majorque !
— Tout est prêt, déclare Béatrice très organisée. Heureusement, les animaux sont restés en France. Au fait, comment va Nadine ? As-tu pu lui parler ?
— Oui, elle a dit que tout allait bien, mais que le temps n’était pas terrible. De la pluie comme toujours…
Déjà, ils se sont éloignés et atteignent rapidement la forêt qui les protège du soleil ardent. Pendant un certain temps ils marchent en silence pour mieux profiter de ce moment de bonheur : sentir les odeurs de la pinède et s’en imprégner. Surtout pour Jean-Pierre qui a vécu dans les Landes, cette petite excursion lui rappelle bien des souvenirs ! Ils marchent toujours. Le soleil est devenu encore plus audacieux et les jeunes gens transpirent. Il est maintenant presque midi et un petit creux se manifeste ainsi que le besoin de boire. Il fait plus de 35ºC !
— Ouf, dit Béatrice en posant son sac à dos sur le sol près d’une petite roche, faisons une pause ici. Mon Dieu, quelle chaleur !
— Oui, ici, ça cogne dur alors que chez nous il pleut ! remarque son mari. Allons, mangeons et buvons un peu !
— Oui, répond Béatrice en s’essuyant le front avec un mouchoir en papier. Tiens, prends ton petit pain avec le saucisson sec.
— Merci. Tu vois, après avoir admiré hier soir la lune et les étoiles, c’est le soleil que j’admire vraiment, nous avons pris des couleurs à la plage et c’est à cause de LUI que nous sommes ici en vacances.
— Eh oui, sacré soleil, sans LUI, que serions-nous ? rétorque Béatrice volubile. Parmi les 200 milliards d’étoiles dans notre galaxie, c’est celle ci qui compte le plus pour nous les humains. Tu sais que le soleil à lui seul représente plus de 99,8% du système solaire, ce qui vaut dire que l’ensemble de toutes les planètes et comètes ne représentent que 1/100 du soleil.
— Vraiment ? demande Jean-Pierre.
— Oui, imagine en fait par analogie un dé à coudre par rapport à un litre d’eau. Quant à l’ordre de grandeur du soleil par rapport à la terre, imagine une petite bille de 12 mm placée à 150 mètres d’un objet dont le diamètre de 1,4 mètre représenterait le soleil. Tu vois, que le soleil est véritablement grand. Un tiers de son diamètre équivaut à la distance de la Terre-Lune.
— Impressionnant ! clame Jean-Pierre.
— Oui, le soleil pourrait contenir 1.300.000 fois la Terre. De par son diamètre on pourrait y placer 190 Terre côte à côte au niveau de l’équateur, poursuit Béatrice entre deux bouchées. Cela reste rêveur, n’est-ce-pas ?
— Oui chérie. J’imagine que tes petits élèves sont fascinés par tes récits et tes leçons. Moi, pour impressionner mes lycéens ayant atteint l’âge de la puberté, c’est plus dur.
— Tu as raison. J’ai de la chance, admet Béatrice. Les petits choux sont très jeunes. Ils s’intéressent encore aux choses qui les entourent et aiment découvrir un nouvel environnement. Je pense qu’ils seront fascinés par le cap Formentor. Alors, après la pause casse-croûte, il vaut mieux y aller. Nous sommes presque arrivés, poursuit la jeune femme.
Sur ce, victuailles remballées, le couple reprend la marche. Vingt minutes plus tard les pinèdes font place à un espace ensoleillé de rochers. Et puis, une petite brise annonce que la mer est tout près, enfin les falaises…
Voilà, le cap Formentor est maintenant devant eux. La grandeur des falaises, la profondeur de la mer les impressionnent si bien que la jeune femme prend la caméra pour immortaliser ces paysages dans sa mémoire. Le vent balayant les mèches de leurs cheveux, ils admirent le paysage avec ravissement. Ils restent debout, les bras ballants, en contemplant cette nature grandiose. Soudain, ils se sentent tout petits. Un sentiment d’humilité et de respect vis à vis de la Nature les envahit. Béatrice prend une fois de plus conscience que sa place dans le monde est éphémère, presque insignifiante. Que le savoir qu’elle transmet aux élèves et aux futures générations est très limité. La gorge nouée par l’émotion, elle se détourne de Jean-Pierre, pour qu’il ne s’aperçoive pas de son trouble et de ses larmes. Des larmes suite à une prise de conscience, quelque chose d’ineffable qu ’elle vient de ressentir au plus profond de son être…
Après une journée de marche, les jeunes gens fatigués, éprouvent le besoin de se retrouver seuls chez eux. L’air marin et le soleil ardent les ont épuisés. Pour se détendre, ils profitent de la piscine en buvant un cocktail sans alcool.
Ils n’ont plus la force de beaucoup parler . Ils ne souhaitent qu’une chose : dormir, passer une bonne nuit pour reprendre des forces.
Le lendemain matin Pedro les attend à la bodéga.
— Hola amigos ! s’exclame Pedro à la vue de ses deux amis français. Comment ça va ?
— Très bien, Pedro. Merci et toi ? Comment vas-tu ? fait Jean-Pierre tout souriant.
— Bien aussi, répond Pedro en tapotant amicalement l’épaule de son ami. Beaucoup de travail comme d’habitude. Alors, qu’est-ce que je vous sers ?
— On va prendre un café au lait avec des churros, n’est-ce-pas, Béatrice ? Cela va changer du pain.
— Oui, répond Béatrice d’un air enjoué. Mais mettons nous à l’ombre pour profiter du petit déjeuner. Car il fait déjà très chaud.
Le jeune couple s’assied à une table ombragée grâce au parasol que Pedro a installé sur la terrasse. En attendant leur commande le couple observe leurs voisins de table, un autre jeune couple, probablement en voyages de noce à Alcudia, étant donné les nombreux baisers et doux regards échangés toutes les minutes. Un peu plus loin, Jean-Pierre remarque une famille allemande, qui semble parler de leurs projets pour la journée. Jean-Pierre saisit quelques bribes de la conversation et sourit. À côté des têtes blondes un berger allemand boit l’eau fraîche que Pedro, ami des animaux, a versée dans un grand bol. Le chien semble appartenir à la famille allemande.
— Eh bien, remarque Béatrice, ce chien a soif. Il fait chaud pour lui, n’est-ce-pas ?
— Tu as raison. Il me fait penser à Jasper.
Pedro arrive maintenant avec un plateau sur lequel figurent la commande du couple français et celles d’autres clients. Par inadvertance, Pedro fait tomber un churro par terre en déposant une tasse de café sur la table du couple. Le berger allemand s’empresse de le renifler avant de le saisir entre ses crocs. Puis des paroles en allemand sont échangées.
— Qu’est-ce-qu’ils disent ? demande Béatrice, tasse à la main pour la porter à ses lèvres délicates.
— Ils ont grondé leur chien. Son nom est Rudi. Une superbe bête !
Les Français déjeunent tranquillement en admirant le petit coin de rue dynamique avec ses petits commerces où se ravitaillent les touristes tous les jours. Comme ils ne sont pas pressés et n’ont rien planifié pour la matinée, ils reprennent un café au lait que leur sert Pedro dans un verre. Eh oui, « en el vaso », comme on dit ici. Les jeunes gens observent d’autres clients qui viennent d’arriver. Deux grands gaillards dynamiques et souriants, entre 40 et 50 ans, s’approchent et prennent place tout près d’eux. Jean-Pierre pense que les deux hommes sont Anglo-Saxons. En écoutant discrètement leurs paroles, il en a la certitude.
Le plus petit des deux hommes passe la commande en langue anglaise, d’une manière si courtoise, que Jean-Pierre en déduit qu’il doit être Anglais. Cette politesse exacerbée n’est pas sans lui rappeler ses quelques séjours en Angleterre avec ses élèves. Il sourit en repensant à ses visites dans la capitale anglaise et à la nourriture anglaise.
Il observe un instant les deux hommes. Il fait part de ses pensées à Béatrice qui discrètement porte son regard sur les deux messieurs. Sans aucun doute, ils sont Anglo-saxons, pense t-elle.
— Chéri, je pense qu’ils sont anglais ou américains, je ne saurais trop le dire, dit elle en faisant un peu la moue. Et les autres là-bas, les têtes blondes avec le chien, hein, ce sont des Allemands, n’est-ce-pas ?
— Oui, c’est un bistrot plein de touristes ici et Majorque est la destination rêvée des Allemands. Ici, ils reprennent des forces pour le travail, car en Allemagne on ne rigole pas trop ! répond Jean-Pierre avec un large sourire.
Un grand éclat de rire venant du grand gaillard fait sourire Béatrice qui le trouve plutôt sympathique. Son ami vient sans doute de raconter quelque chose de drôle, peut être une blague. Pedro ne laisse pas le temps à Roger de répondre ou de raconter une autre blague. Le breakfast commandé par Roger vient d’être servi sur la nappe jaune des deux compères. Un vrai repas : un brunch. Thé, café, jus d’orange, saucisses, bacon, œufs, pain de mie toasté, beurre, haricots en grain Heinz et tomates… Que cela sent bon ! Rudi, qui n’a pas perdu une seconde des allez-et-venues de Pedro, profite d’un moment d’inattention de ses maîtres pour se ruer vers la table voisine.
Les deux hommes deviennent hilares pendant que Rudi pose son museau sur le genou de Roger pour quémander la saucisse que celui-ci s’apprête à déguster. Le gentleman anglais - amour des animaux oblige - n’a pas le cœur à repousser ce chien magnifique, qui se jette sur la viande. L’autre homme rit davantage et devant la scène le couple français finit pas rire également en pensant à leur propre chien Jasper qui aurait certainement été heureux de profiter des vacances et d’être à la place du berger allemand.
— Ah, Roger, my friend, que serait le monde sans nos compagnons à quatre pattes ? remarque gaiement l’homme le plus grand en portant machinalement son regard sur les jeunes Français à la table voisine.
— Tu as raison, Jimmy ! dit l’autre amusé avec un accent britannique.
De ce fait, Jean-Pierre se joint à la conversation en anglais et échange quelques mots sur la compagnie animale avant même que la famille allemande intervienne pour appeler leur chien devenant de plus en plus envahissant. Flegmatique, Roger reste calme et conserve son humour. Il se dit qu’il mangera mieux plus tard et se met à parler en français pour répondre à Jean-Pierre. Il en profite pour se présenter ainsi que son ami américain Jimmy. Son accent britannique est charmant ! Béatrice est sous le charme…
— Mon nom est Roger, je suis Anglais. Je viens de Nottingham. Jimmy, mon ami, est Américain et vit à Rochester près de New York. Nous passons une semaine de vacances à Majorque. Une belle région d’Espagne, n’est-ce-pas ?
— Oh oui, répond Jean-Pierre qui se présente ainsi que Béatrice. Nous aussi, nous adorons cette île et nous y passons nos vacances chaque été. Ma femme et moi, sommes enseignants en France. Mais dites-moi, vous parlez très bien le français !
— J’aime beaucoup le français, répond Roger enthousiaste. Et puis, ma femme est Française comme celle de Jimmy d’ailleurs ! Mais, vous aussi, vous parlez l’anglais couramment !
— Je suis professeur de langues dans un collège. J’enseigne l’anglais et l’allemand, répond Jean-Pierre flatté . Ma femme est institutrice dans le même village.
— Rudi, crie une voix enfantine. Que fais-tu, vilain chien ?
Rudi qui n’a pas cessé de renifler Roger et l’odeur du bacon, redresse brusquement la tête et retourne vers la table de ses maîtres qui viennent de régler l’addition.
— Auf Wiedersehen ! lance Pedro avec un grand sourire, car ces Allemands sont aussi des clients assidus et généreux.
— C’est international ici, n’est-ce-pas ? intervient Jimmy dans un français impeccable laissant le couple français béat d’admiration.
— Oui, en été beaucoup de touristes viennent passer les vacances sur l’île, réplique Jean-Pierre.
Le couple raconte ses premiers jours passés à Alcudia et les joies vécues au cap Formantor ainsi qu’à la plage immense de sable d’Alcudia. Jimmy et Roger leur parlent de leurs projets. Ils vont rester encore une journée dans la belle île avant de se rendre dans le Morvan. Roger a une résidence secondaire dans cette merveilleuse région française et ils souhaitent y passer une autre semaine de vacances. Leurs femmes respectives sont déjà là-bas. Jimmy évoque les bons souvenirs de la région qu’il connaît déjà puisque son ami Roger l’a invité plusieurs fois à y séjourner.
En compagnie des deux hommes, le temps passe bien vite et c’est avec plaisir que les jeunes Français évoquent leurs voyages à travers le monde. Ils connaissent l’Espagne, l’Europe, les États-Unis ainsi que certains pays du Maghreb.
Il est maintenant plus de midi. Malgré les parasols placés au dessus des tables, les rayons du soleil devenus plus chauds, s’infiltrent à travers le tissu. Béatrice s’ humidifie la nuque et le front. Elle commande une « agua mineral sin gas » à Pedro qui apporte sur-le-champ un pichet et quatre verres.
— Il fait chaud, n’est-ce-pas, intervient Jimmy. Un bel été ! Tout le monde fait des kilomètres pour trouver le soleil et profiter de la lumière et de sa chaleur.
— C’est véridique, n’est-ce-pas Jean-Pierre ? fait Béatrice. Nous profitons de nos vacances en Espagne grâce au soleil. Nous venons de passer une belle journée avant-hier sur la plage d’Alcudia. Nous avons bronzé et nous nous sommes baignés jusqu’à vingt heures trente. On apercevait un petit croissant de lune, c’était magnifique !
— Ma femme et moi, adorons la nature ! Nous nous posons aussi beaucoup de questions sur les éléments de l’univers et ce sur qui nous entoure.
— Ah, bon ! Très bien, réplique Jimmy. Roger et moi, aussi. Nous sommes tous les deux ingénieurs dans l’aéronautique et passionnés d’astronomie. Les astres, les planètes, les étoiles, les comètes et notre voie lactée. Pour moi, c’est le soleil, qui me fascine le plus. C’est incroyable, n’est-ce-pas, que malgré la distance de plus de 150 millions de kilomètres qui le sépare de la Terre, sa chaleur arrive à brunir et parfois même brûler notre peau ! Incroyable, non ? Étoile, boule de gaz, le soleil est déjà arrivé à la moitié de sa vie active et termina de vivre en augmentant de volume jusqu’à engloutir la Terre. En fait, il deviendra une géante rouge pendant 500 millions d’années. Incroyable, non ?
— En effet, fait Jean-Pierre, soudain très intéressé par le sujet. Et alors, qu’est-ce qu’il se passera par la suite ?
— Eh bien, la gravitation jouera un rôle important car le noyau s’effondrera, vu que la pression interne ne pourra plus compenser la force de gravitation. Le soleil épuisera tout son combustible et deviendra aussi petit que la Terre, après quoi, il se refroidira très lentement en quelques milliers de milliards d’années.
— Vous parlez de combustion, très bien, soit, mais quelle est cette énergie qui caractérise le soleil ?
— Il faut savoir que le soleil est composé de 70% d’hydrogène et de 28% d’hélium. Les 2% restants représentent la plupart des autres atomes présents dans l’univers. Les étoiles créent tous les matériaux existants dans l’univers, à partir de l’hydrogène. L’énergie du soleil est une bombe gigantesque thermosnucléaire dont la puissance, émise sous forme de photons, est le résultat de la combustion de 596 millions de tonnes par seconde d’hydrogène convertis en 592 millions de tonnes par seconde d’hélium. La perte, 4 millions de tonnes/seconde se traduit sous forme de rayonnement gamma. Chaque cm² émet une énergie de 6 kilowatts. Cette pile thermosnucléaire fonctionne grâce à la transformation de 4 noyaux d’hydrogène qui fusionnent pour fournir 1 noyau d’atome d’hélium avec la libération d’une énergie de 25 000 mégawatts par gramme et par seconde. Incroyable, non ? répète encore Jimmy.
— Mon Dieu, s’exclame Béatrice, vous semblez être calé sur le sujet, Jimmy. Tous ces chiffres nous donnent un peu le vertige.
— Oui, je comprends, fait Jimmy. En fait, rappelez-vous d’une chose : c’est que chaque seconde le soleil dégage autant d’énergie que 10 milliards de bombes nucléaires.
— Impressionnant, remarque Béatrice. Mais dites-moi, ce qui m’intéresserait le plus de savoir, c’est pourquoi le soleil est devenu jaune et non rouge, par exemple ?
— Eh bien, poursuit Jimmy d’une voix enjouée. Le soleil n’a pas de surface, mais la température entre les couches internes et l’atmosphère est de 5 700 ºK (0 degré Kelvin = - 273,15°C); c’est donc le zéro absolu. Il en résulte que l’agitation moléculaire est stoppée, ce qui lui donne sa couleur jaune. On en conclut que la couleur est en relation directe avec la longueur d’onde, laquelle est liée à la température.
— On parle ici de température thermodynamique selon le physicien irlandais Lord Kelvin, ajoute Roger. Il a introduit cette unité de mesure pour cette notion thermodynamique !
— Oui, je le savais, déclare Béatrice. Mais dites-moi, comment peut-on évaluer l’énergie du soleil et d’où vient-elle ?
— L’énergie dont Jimmy vient de parler comme pile thermonucléaire vient du centre, répond Roger, pendant que Jimmy boit une gorgée de jus d’orange. La pression comprime les noyaux d’hydrogène et permet ainsi la fusion. Le transfert de cette énergie s’effectue par rayonnement et par convection. La zone de convection est limitée par la photosphère, épaisse de 200 km, et appelée ainsi, car presque la totalité du rayonnement visible vient d’elle. Il s’agit d’une apparence un peu granuleuse. La taille d’une granule peut dépasser celle de la France pour une durée de vie de 10 minutes à 10 heures.
— Et cette pression empêche les photons d’atteindre la surface dès leur création, repart Jimmy de plus belle. Ils peuvent mettre 2 millions d’années pour sortir des profondeurs du soleil, tandis qu’il leur faut 8 minutes pour arriver sur Terre. Extraordinaire, n’est-ce-pas, mes amis ?
— Oui, répond Jean-Pierre ébahi et pensif. J’essaie de m’imaginer tout ce que cela représente.
— En effet, continue Béatrice, je suis perplexe et je vous admire tous les deux. Votre savoir et vos connaissances parfaites du Français !
Les deux hommes répondent par un grand sourire amical et par le fait que leur passion de la langue française et de l’astronomie les ont amenés à s’instruire et à explorer de nouvelles voies pour satisfaire leurs besoins insatiables dans le domaine de la science.
— Oui, mes amis, continue Jimmy, dans toute cette énergie nous avons beaucoup d’atomes, dont une particule insaisissable, créée au centre du soleil, et nommée le neutrino. Il y règnent des températures de plus de 15 millions de degrés au centre. Chaque seconde, 65 milliards de neutrinos bombardent chaque cm² de notre Terre. Pour 1 proton, il y a 10 milliards de neutrinos. Les scientifiques recherchent le neutrino afin de déterminer le fonctionnement interne du soleil et de vérifier certaines théories de physique élémentaire par la même occasion.
— Passionnant, s’exclame Jean-Pierre ! Et surtout, il est assez curieux de considérer que tout le monde connaît et admire ce soleil, mais qui est en fait peu connu de nous, sauf pour les scientifiques ou les gens comme vous, Jimmy et Roger !
— C’est exact, répond Roger, avec son accent britannique délicieux qui ravit Béatrice. Jimmy et moi, nous avons eu la chance d’avoir étudié dans différents pays et de nous être rencontrés afin de nous entretenir de nos connaissances et de notre métier. Nous adorons aussi les avions et les engins de l’espace.
Soudain, le téléphone portable de Jean-Pierre sonne. C’est Nadine, qui donne des nouvelles. Elle parle des rhumatismes d’Ernest et de ses souffrances. Si le soleil cogne en Espagne, il n’est pas brillant en France, surtout pas en Picardie, où vit le couple français.
En écoutant la conversation, Roger et Jimmy sourient. Ils ont de la peine pour Ernest. Jean-Pierre et Béatrice leur racontent comment ils ont sauvé leurs animaux domestiques de destins incertains et surtout sauvé Ernest de la mort aux abattoirs.
Roger admire le couple pour cette belle action. Il ne se voit pas manger de la viande de cheval et encore moins Jimmy. Parfois, ils trouvent les Français un peu dingues !
Il fait maintenant très chaud et les jeunes Français désirent retourner à leur finca pour s’allonger un peu sur leur terrasse. Roger et Jimmy, souhaiteraient revoir le couple pour dîner ensemble et peut-être pour aborder un autre sujet tel que le vent solaire. Ils doivent faire quelques emplettes et acheter quelques souvenirs pour leurs épouses françaises.
Arrivé à la finca, le couple mange une petite salade et s’étend sur une chaise longue près de la piscine. Béatrice a choisi une place ombragée et ne peut pas s’empêcher de penser aux mots de Jimmy sur le soleil. À partir d’aujourd’hui, celui-ci aura un nouveau nom. Il s’appellera désormais JIMMY. Béatrice pense que l’Américain serait honoré de cette pensée chaleureuse.
Et puis, fatigués par la chaleur persistance, les jeunes gens finissent par dormir un peu sur leur terrasse. Deux heures plus tard, le couple réveillé, se prélasse dans leur piscine. L’eau fraîche leur procure une sensation de bien-être. Mais malgré tout, Béatrice ne se sent pas très bien. Elle a quelques nausées et des maux de tête.
Jean-Pierre et Béatrice décident de rester à la maison ce soir, car Béatrice n’a pas la force de manger. Elle ne souhaite qu’une chose : boire et rester au calme dans un endroit frais. Jean-Pierre compose le numéro de Jimmy pour s’excuser : ils ne pourront pas dîner ensemble… Ils avaient prévu de se retrouver dans un bar-grill de la région.
Qu’à cela ne tienne, ils se reverront un jour prochain. Certainement en France ! Ils ont échangé leur adresse et leur numéro de téléphone.Pensées sur les femmes et les hommes
À défaut d’avoir revu Roger et Jimmy, ils ont revu Pedro le lendemain.
Celui-ci, toujours amical et souriant, les salue avec empressement, mais il trouve Béatrice un peu pâle ce matin. Le couple prolonge une conversation dynamique avec le tenancier.
Deux jours plus tard les voici dans l’avion… retour au bercail. Mais avant de quitter Majorque, ils ont emporté avec eux quelques spécialités locales, comme la crème « sobrasada » que Jean-Pierre adore déguster sur une tranche de pain, et un paquet de « ensaïmada » pour Nadine. De même, ils ont acheté de l’huile d’olive pour la famille entière.
Et ils ont fait un petit repas d’adieux avec Pedro et Inès : une « paella » a la valencia, plat favori des époux de l’île. Ils ont passé une belle soirée avec leurs amis espagnols et se réjouissent de les revoir l’été prochain.
Ā l’aéroport Nadine les attend. Elle est venue les chercher comme d’habitude. Le ciel est grisâtre et il fait frais pour un mois de juillet tirant à sa fin. Nadine enfile un chandail, celui fait avec la laine Mohair, dont parlait Joséphine, la chèvre, pour vanter ses mérites le jour du pique-nique avec Ernest.
Elle a soudain une pensée triste pour Ernest qui souffre lorsque le temps est humide. Le pauvre, ces sacrés rhumatismes lui donnent du fil à retordre.
Enfin, ils prennent leurs valises et aperçoivent Nadine à la sortie. Celle-ci, toute souriante, vêtue d’un jean, petit pull et baskets, vient à leur rencontre et les embrasse. Les accolades typiques des retours de vacances près de la famille ! Après les premiers mots échangés sur le temps et la santé de chacun, Nadine les ramène à la maison. Il est presque midi. Nadine a préparé un cassoulet.
— Merci Nadine, s’exclame Béatrice. C’est gentil à toi te t’occuper de nous et des animaux.
— Oh, cela me fait bien plaisir. Cela fait un peu de repos et cela change des études et du stress de la ville. Et vous deux, comment allez-vous ? Avez-vous passé des vacances d’enfer ?
— Oui, répond Jean-Pierre avec enthousiasme. Il a fait très chaud. Du soleil tous les jours ! La mer était belle et la nourriture merveilleuse. Comme d’habitude, Pedro nous a bien reçus. Tu sais, Nadine, il nous demande toujours de tes nouvelles. Il faudrait que tu viennes un jour à Alcudia. Tu peux y aller quand tu veux. La finca reste à notre disposition.
Ils viennent de franchir le portail de leur demeure. Jasper est le premier à venir les saluer. Il aboie, il est fou de joie. Il saute sur Jean-Pierre, pose ses pattes sur sa chemise blanche et le lèche. Puis, c’est au tour de Béatrice qui le caresse et lui parle d’une voix tendre. Félix, qui vient de terminer une petite toilette, s’approche de sa maîtresse en miaulant d’un air joyeux. Jean-Pierre lui dit qu’ils ont bien pensé à lui à Alcudia et que même Pedro se souvient toujours de lui.
— Allez, rentrons, dit Nadine. Il fait frisquet. Allons manger le cassoulet. En entrée, crudités, ensuite cassoulet, puis plateau de fromage et en dessert crème caramel.
— Merci, ma belle, fait Jean-Pierre en embrassant sa nièce sur la joue. Sans toi, que ferions-nous, hein ?
Ils déposent leurs valises près de la porte d’entrée et se dirigent vers Jacquot qui est en train de boire dans sa cage. Ils se mettent à lui parler un peu avant de se mettre à table. Le repas a été très bon et le couple reprend des forces. Quelle joie d’être de nouveau parmi les siens ! Avant d’ouvrir les valises, Jean-Pierre et Béatrice se rendent à l’écurie et saluent Ernest. Celui-ci a l’air de souffrir, mais est ravi de la présence de ses maîtres… Il se sent moins seul maintenant qu’ils sont de retour !
Nadine a récupéré ses affaires avec les biscuits de Majorque, quelques bouteilles d’huile d’olive… et bien sûr quelques jolies perles de Majorque : collier, bracelet et boucles d’oreilles !
Le reste de la journée passe vite. Nadine est repartie chez elle, Béatrice s’est occupée d’Ernest et de l’écurie pendant que Jean-Pierre, de son côté, a pris soin de cuisiner un peu pour Félix et Jasper : un peu de poulet, quelques croquettes et des légumes verts. Ils adorent ça !
Il est presque minuit ! Bien au chaud dans leur couette moelleuse, ils écoutent un peu de jazz : John Coltrane et Benny Goodman. Félix et Jasper sont sagement couchés près de la cheminée et non loin de Jacquot qui, de son bec, casse quelques graines.
Quelques jours passent et Béatrice, sujette à des nausées de plus en plus fréquentes, décide de consulter son médecin, car elle s’inquiète un peu sur les causes de ses petits vomissements. S’agirait-il d’ une éventuelle grossesse ? Une maternité qu’elle a planifiée depuis plus de 2 ans ! Jean-Pierre est tout aussi excité qu’elle. Un bébé serait le fruit de leurs amours et une seconde réussite après leur carrière dans la fonction publique française !
Béatrice a bien fait un test de grossesse après avoir acheté le kit en pharmacie et Blue Clear a affirmé qu’elle était enceinte. Elle a fait ce test juste avant de quitter Alcudia, mais n’en n’a pas parlé à Jean-Pierre. À quoi bon en parler ? Elle n’est pas du genre à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Et puis une erreur peut arriver…
Rien ne vaut la consultation du médecin gynécologue, une femme de Buenos Aires, qui est intelligente et chaleureuse. Cette femme sait mettre ses patientes à l’aise, et même les jeunes filles timides et apeurées, savent qu’elles peuvent lui parler de femme à femme en toute confiance.
La gynécologue confirme la grossesse de Béatrice et la félicite. Le jeune couple est aux anges. Sans perdre de temps, Jean-Pierre annonce l’heureux événement à toute la famille. Les animaux ont remarqué la bonne humeur du couple. Il se dégage une atmosphère de bien-être au foyer. Une humeur frôlant le délire. Oui, on croirait que le couple a atteint les portes du paradis. Les jeunes gens s’embrassent souvent en chantant et en racontant des blagues. Ils commencent même à faire des projets concrets concernant l’organisation de leur maison. Oui, ils doivent trouver une chambre pour le bébé. Au fait, quel sera son prénom ? Garçon ou fille ? Arnaud ou Amandine ? On ne sait pas encore le sexe de l’enfant ! Peu importe, l’essentiel est un bébé bien portant…
Pour fêter la bonne nouvelle, les jeunes gens souhaitent organiser un barbecue pour un dimanche. Leurs parents seront présents. Nadine aussi. Et puis, ce sera l’occasion de se retrouver ensemble avant la rentrée scolaire. Quant aux sœurs et frères du couple, ils viendront le mois prochain, car la place manquerait pour recevoir tout le monde. Certains sont en vacances d’ailleurs !
Une semaine passe. Les préparatifs sont terminés : voilà que tout est prêt pour le fameux barbecue. Heureusement, il fait très beau en cette fin du mois d’août. La table, les chaises ainsi que le grand parasol trônent au milieu du jardin. Le barbecue aussi. De temps en temps, Félix et Jasper tournent autour de la table, attirés par la viande et les premières odeurs alléchantes dégagées par la cuisson des aliments.
On sonne à la porte. Ce sont les parents de Béatrice qui arrivent les premiers. Il s’agit d’un couple charmant, éduqué et au caractère agréable : Jean est médecin et Janine est responsable du département des achats dans une PME. Après les accolades habituelles, ils caressent les animaux qui leur font la fête. Jasper et Félix sont ravis. L’amour des animaux les réunit tous. Béatrice a sans doute hérité de cet amour qu’elle continue de partager à droite à gauche en s’occupant d’organisations animales. Ses parents ont eux même un chat, un berger allemand et deux chevaux chez uns, une belle résidence, avec terrasse, jardin et écurie. Les parents de Béatrice ont les moyens d’embaucher du personnel pour s’occuper des chevaux dans l’écurie adjacente à leur demeure, ainsi qu’une femme de ménage qui est la perle rare, car elle cuisine aussi.
Ernest, aussi, apprécie beaucoup Janine, Jean, de même que Nadine, qui vient d’arriver en petit débardeur avec son jean délavé. Ernest les regarde derrière la porte d’entrée de l’écurie. Il aime ces retrouvailles…
Jean-Pierre commence à déboucher les premières bouteilles pour l’apéritif, lorsqu’il entend une voiture freiner tout près de sa maison. Ses parents sûrement !
— Laisse moi faire, dit Nadine à son oncle, en prenant le relais.
— Bonjour Jean-Pierre ! s’exclame sa mère ravie et attendrie par la bonne mine de son fils. Comment vas-tu ? Et Béa ? Nadine ?
— Béa va bien. Nadine aussi. Elle est en train de servir l’apéro. Viens, allons nous asseoir. Jean, Janine et Nadine sont là aussi.
— Bonjour mon grand, dit à son tour le père de Jean-Pierre pour le saluer en l’embrassant.
— Bonjour Pierrette et Jacques! Belle journée, n’est-ce-pas ? s’exclame Janine après avoir embrassé les parents de Jean-Pierre.
Nadine les rejoint et embrasse ses grands-parents. Ils trinquent à la santé de la jeune femme et celle du futur bébé. Les premières gouttes d’alcool et les rayons du soleil mettent la famille à l’aise. Jean et Jacques plaisantent en évoquant quelques souvenirs cocasses concernant leurs patients et leurs élèves. Jacques est enseignant comme son fils. Un instituteur. Entre elles, les femmes parlent de leur vie quotidienne…
— Alors Béa, comment se sont passées tes vacances ? demande sa mère après avoir dégusté une petite gorgée de porto.
— Nos vacances étaient géniales maman, répond Béatrice. Tu sais, chaque année, c’est la même chose à Majorque. Nous avons profité du soleil et avons récupéré du stress. Notre finca nous procure des moments de détente agréable avec sa piscine et la vue magnifique sur les citronniers. Nous avons fait quelques excursions, cette fois-ci, nous sommes allés jusqu’au cap Formentor. Et rencontré des gens de toutes les nationalités imaginables.
— Et Pedro et Inès ? demande Pierrette. Jean-Pierre me dit que Pedro travaille toujours à la bodega. Qu’il travaille toujours sans relâche et avec le sourire !
— Oui, intervient Jean-Pierre. Pedro est toujours à Alcudia. De temps en temps, il passe quelques vacances à Ronda, sa terre natale.
— Ronda ? Chérie, n’est-ce-pas la ville dans les montagnes où se trouve l’une des plus fameuses arènes de l’Andalousie ? demande Jacques à sa femme.
— Oui, répond Pierrette. Tu as raison. Il y a au moins dix ans que nous sommes allés en Andalousie. Nous y sommes retournés depuis et avons visité Jerez de la Frontera. Cette année, nous avons préféré nous reposer en Dordogne. Dix jours de repos avec une nature superbe. Nous avons été hébergés chez un couple londonien, qui tient une petite auberge sympathique et qui aime la Dordogne.
Pendant ce temps Nadine fait le service. Apéritif, eau, jus de fruits et les crudités en entrée. Jean-Pierre laisse les hommes blaguer entre eux et les femmes parler de leurs vacances respectives. Il est chargé de surveiller les grillades : merguez, saucisses, quelques entrecôtes aussi. Béatrice, elle, revient de la maison avec un grand saladier dans la main : une laitue assaisonnée avec petits oignons rouges. Elle a prévu un plateau de fromages et un vacherin en dessert.
Les convives se régalent. La viande grillée a bon goût. Jasper récupère quelques bouts de saucisses tandis que Félix, un peu fatigué par toutes ces voix, s’est éloigné pour se coucher sur le palier. De temps en temps, on entend Jacquot qui prononce les mots « Alcudia » et « soleil » à plusieurs reprises. Il est calme…
Soudain, la conversation reprend pour aborder l’heureux évènement. Janine s’adresse à sa fille.
— Dis moi, chérie, quand vas-tu emménager la pièce du fond pour le bébé ?
— On pense le faire pendant les prochaines vacances de la Toussaint ! Il va falloir faire quelques travaux. Après on verra. Pour les derniers achats, il faudra attendre pour connaître le sexe de l’enfant, répond Béatrice.
— Oui, nous avons encore du temps, n’est-ce-pas, chérie ? demande Jean-Pierre en posant délicatement un baiser sur le front de sa femme.
— As-tu un prénom ? Comment vas-tu l’appeler ? demande Jacques.
— Eh bien Papa, on a pensé à Arnaud pour un garçon et Amandine pour une fille, répond son fils en souriant. On verra bien, ce n’est pas très important.
— Ah oui, de toute manière on se moque du sexe de l’enfant. Du moment qu’il sera en bonne santé, c’est tout ce que nous souhaitons. Garçon ou fille, homme ou femme, on s’en fout… renchérit Béatrice.
— Pourtant les différences sont grandes entre femmes et hommes ! fait Jean.
— Ah oui, les hommes gagnent toujours plus que les femmes. Entre entre 20 et 25 pour 100 ! ricane Nadine, moqueuse.
— Non, répond Jean d’un air sérieux. Je parle des différences entre les hommes et les femmes sur le plan cérébral.
— Et alors ? fait Pierrette.
— C’est vrai. Jean a raison, renchérit Jean-Pierre. Je vois bien que Béatrice agit et voit parfois les choses d’une autre façon que moi.
— Bien sûr les enfants, s’exclame Jean ! Les recherches des neurosciences font état des différences entre le cerveau de la femme et celui de l’homme. Des études montrent que le cerveau humain s’est développé en fonction de l’environnement culturel. Ces chercheurs expliquent que les nombreuses différences biologiques fondamentales entre les hommes et les femmes sont le résultat d’une longue évolution de plus d’un million d’année. Cette évolution aurait modelé nos cerveaux à travers l’action conjuguée des hormones et des neurotransmetteurs.
— Soit, réplique sa femme. Et alors, toutes ces différences dont tu nous parles, chéri, quelles sont-elles concrètement parlant ?
— Eh bien, en fait, poursuit Jean, tu vois, je te parle, mais mes paroles ne seront pas perçues de la même manière selon le sexe de l’individu.
— Ah bon ? Comment cela ?
— Eh bien, au moment où je parle, tu m’entends, toi et les autres femmes, avec les deux hémisphères du cerveau, tandis que les hommes m’entendent essentiellement avec l’hémisphère gauche, logique et critique… Les femmes, elles, mobilisent, en même temps, leur hémisphère droit, ce qui rend mon discours à leurs oreilles plus coloré d’émotions. Elles entendent ce que je dis, mais surtout comment je le dis. Elles sont en fait plus sensibles aux inflexions de ma voix, au rythme de ma respiration, dirais-je même.
— On dit que les femmes ne savent pas lire une carte correctement ou encore s’orienter. Qu’elles sont plutôt nulles en mathématiques, mais plutôt bonnes en langues. Quelle est la part du vrai et du faux ? demande Jacques à son tour.
— J’y viens, rétorque Jean. Des études ont montré que les filles, dès l’âge de 9 ans, présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les garçons. À l’âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6 min pour les hommes. La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions, tandis que l’homme contrôle et retient les siens : il transmet des informations et cherche des solutions… et la femme ne se sent pas « écoutée » !
— En résumé, la femme est moins émotive, mais elle s’exprime davantage alors que l’homme est, en réalité plus émotif, mais il n’exprime pas ses émotions. Le cerveau gauche est plus développé chez les femmes.
— C’est vrai, intervient sa femme. Même toi, chéri, tu ne m’écoutes pas et pourtant, tu es médecin !
— Eh bien, oui ! continue Jean. Les garçons sont bels et bien meilleurs en mathématiques. Ils possèdent aussi une logique spatiale pour un meilleur sens de l’orientation en fonction du cerveau droit, plus développé chez eux. Les hommes sont orientés dans l’espace tandis que les femmes sont orientées dans le temps. Je veux dire qu’elles se « repèrent » d’après des objets et des signes concrets tandis que nous les hommes, nous pouvons nous orienter dans une direction abstraite. Nous pouvons « couper » par un raccourci en forêt par exemple pour retrouver la voiture.
— Tu as raison Papa, réplique Béatrice. Pour le sens de l’orientation, je l’avais bien remarqué ! Mais il y a aussi d’autres différences dans les organes des sens, vrai ou faux ?
— Oui, fait son père. D’une règle générale, les femmes sont plus sensibles et son ouïe est plus développée d’où l’importance des mots doux, du timbre de la voix et de la musique. Les femmes possèdent jusqu’à 10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact; l’ocytocine et la prolactine (hormones de l’attachement et des câlins) multiplient leur besoin de toucher et d’être touchées. Son olfaction est plus fine: jusqu’à 100 fois, à certaines périodes du cycle. De plus, son OVN (organe voméro-nasal, véritable sixième sens chimique et relationnel) perçoit les phéromones qui traduisent plusieurs formes d’émotions : désir sexuel, colère, crainte, tristesse…Il serait aussi plus sensible chez les femmes. Serait-ce là une forme de l’intuition ?
— Et nous les hommes, intervient Jacques, où sommes nous supérieurs ? À part les mathématiques et le sens de l’orientation ?
— Notre vue est davantage développée - et n’en déplaise aux femmes - plus érotisée d’où notre intérêt et notre excitation par les vêtements, le maquillage, les bijoux, l’érotisation du nu, voire une certaine attirance pour les revues pornos… fait remarquer Jean.
— Bon Dieu, s’exclame Béatrice, amusée. Alors non, je ne veux pas de fils. Je veux une fille… Comme ça, pas de magazines pornographiques qui traîneront à droite à gauche dans la maison !
Tout le monde se met à rire tout en mangeant le dessert. Cette meringue glacée accompagnée d’un dernier verre de vin blanc est agréable pour accompagner cette conversation entre le médecin et les membres de sa famille.
Puis le père de Béatrice reprend le court de sa pensée :
— Les hormones jouent naturellement un rôle essentiel. Les œstrogènes ne sont pas les testostérones des mâles qui ont plutôt le goût de la conquête, de l’aventure tandis que les femmes rechercheront essentiellement la sécurité. D’une règle générale, on comprend pourquoi les femmes sont attirées par un mâle dominant, fort et expérimenté, socialement reconnu, moins jeune, mais susceptible de la protéger. Les hommes, eux, ont un attrait pour les femmes jeunes, qui cherchent la sécurité, mais qui sont susceptibles d’engendrer.
— Dis-donc Papa, comment expliques-tu ces différences ? Quelles en sont les causes ?
— Je dirais que le comportement extérieur de l’être et du vécu intérieur des hommes et des femmes est largement conditionné par des dispositions préexistantes de nature biologique, sur lesquelles viennent se greffer des influences éducatives et culturelles, répond Jean. Un tiers viendrait de l’hérédité, un autre tiers serait congénital.
— Congénital ? Que veux-tu dire, chéri ? demande Janine en reprenant une part de vacherin avec du coulis à la framboise.
— Eh bien, il s’agit d’un acquis pendant les premières semaines de la vie intra-utérine. L’embryon est féminin pendant les premiers jours et la masculinité est une lente conquête hormonale et éducative. Ainsi, la fille n’est pas un garçon qui a perdu son pénis, comme le supposait Freud, mais le garçon est un fait une fille qui a gagné un pénis. Logique, non ?
— Bien sûr, répond Béatrice, ravie de la réponse de son père. Encore une raison de plus pour avoir une fille, ajoute t-elle en plaisantant. Et le dernier tiers ? Ne s’agirait-il pas de la culture ?
— Oui, tout simplement, fait son père. Le bain culturel au fils du temps ; les entraînements ou les circonstances psychologiques jouent un rôle considérable aussi dans l’épigenèse du cerveau humain.
— Mais alors, certains homosexuels, transsexuels de toutes catégories ne sont pas forcément d’accord avec ces études ? intervient Jean-Pierre.
— C’est vrai Jean-Pierre, tu vois juste. Certains chercheurs se sont penchés sur ces questions, car ils pensent que ces deux genres sont simplistes. En France, une sociologue connue et maître de conférence est une fervente du mouvement « queer » né aux États-Unis., pendant qu’une philosophe américaine partage les mêmes opinions. La théorie « queer », poursuit Jean, est une théorie sociologique qui critique principalement l’idée que le genre et l’orientation sexuels seraient déterminés génétiquement. Certains sociologues et philosophes soutiennent l’idée que la sexualité mais aussi le genre social – masculin ou féminin – d’un individu n’est pas déterminé exclusivement pas son sexe biologique, mais principalement par son environnement socio-culturel et son histoire de vie. À dire vrai, je pense qu’ils n’ont pas tout à fait tort…
Jean s’arrête subitement de parler pour prendre une gorgée de vin. Il a tellement parlé qu’il n’a pas vraiment apprécié le vacherin. Les autres en ont repris et Jasper a léché le fond du récipient.
Soudain, le portable de Jean-Pierre sonne. C’est Roger qui prend des nouvelles du couple …
— Jean-Pierre parle 5 langues et c’est un homme, alors on ne peut vraiment pas généraliser, fait son père d’un air critique en écoutant son fils parler la langue de Shakespeare sans le moindre effort d’élocution.
— Roger et Jimmy te saluent, dit Jean-Pierre à sa femme après avoir remis son portable sur la table. Ils vont bien, ils ont repris leur travail. Et ils nous félicitent pour le bébé…
— Sacrés Roger et Jimmy ! sourit Béatrice en expliquant aux parents respectifs leur amitié naissante.
Elle ajoute en souriant qu’elle a un nouveau nom pour le soleil. Dorénavant, le soleil se nomme « JIMMY ». À chaque occasion, elle ne peut s’empêcher de repenser à lui, lorsqu’elle admire sa belle couleur jaune et sent les rayons chauffer les parties de son corps. Elle repense aux chiffres cités par Jimmy concernant le soleil !
Décidément, son père a raison ! Les maths et les hommes, ça fait la paire !
Les heures ont passé vite en compagnie de Nadine et des parents du couple. Ils ont passé un bon moment ensemble. Nadine a fait des photos.
Jean, Janine, Jacques, Pierrette et Nadine quittent les lieux en remerciant le couple… Jasper les salue en remuant la queue, il pense qu’il aimerait bien faire une petite promenade.
Béatrice s’occupe du rangement dans la cuisine. La vaisselle est terminée. Jean-Pierre nettoie le barbecue et le range soigneusement dans le garage.
Il commence à faire sombre et JIMMY a disparu. Peut-être va t-il pleuvoir ?
Béatrice a été ravie de ce dimanche…Pensées sur la vie et la mort
Arnaud se lève ! Il a fini ses devoirs…
Il est satisfait de sa journée. La rentrée des classes s’est bien passée et il s’est bien adapté au nouveau rythme du collège. Arnaud vient de rentrer en 5ème !
C’est un garçon éveillé qui a l’intelligence et la curiosité de ses parents. Il aime l’école, même s’il n’apprend pas assez à son goût. De ce fait, il lit beaucoup et voyage souvent à l’étranger avec ses parents.
Il se souvient que l’été dernier il a passé un mois merveilleux à Alcudia où il s’est perfectionné en espagnol, sa quatrième langue. Comme son père, il a le don pour les langues, mais il est tout aussi doué pour les mathématiques. Il se passionne aussi pour les sciences physiques, l’astronomie et l’astrophysique.
Deux ans auparavant il a fait la connaissance de Jimmy et de Roger, amis toujours inséparables, lors d’un petit week-end à Londres. Roger visitait une tante dans la capitale anglaise et avait invité Jimmy et le couple français par la même occasion. Arnaud ne peut oublier les deux hommes, leur esprit ouvert sur le monde et les sciences ainsi que les conversations des adultes.
Cette rencontre dans la capitale britannique a été inoubliable. Avec curiosité il a écouté tout ce que Roger et Jimmy avait à dire sur les astres, les planètes autour de nous et très éloignées de nous. Il est dorénavant passionné par la Terre, ses étoiles et l’Univers entier. Son rêve est de devenir astrophysicien tout comme Stephen Hawking.
Mais, du haut de ses onze ans, il sait qu’il a encore du chemin à faire. Il sait aussi que rien n ’est joué d’avance. La vie et la mort sont des sujets tout aussi fascinants que l’Univers ; souvent revient la sempiternelle question : qui sommes nous et que faisons nous sur Terre ? Pourquoi vivons-nous et mourons-nous ? Quelle est notre raison d’être ?
La mort de Jasper et d’Ernest ont été perçues comme une fin inéluctable du cycle de la vie, mais aussi comme un événement douloureux pour le cœur et pour son âme sensible.
Après ses devoirs il file au fond du jardin pour se recueillir sur la petite tombe de Jasper. Le chien de chasse est enterré depuis 4 ans dans un endroit discret du jardin. Jean-Pierre tenait à ce que son chien soit près des siens…
Quant à Ernest, ses rhumatismes étaient atroces ! Il ne pouvait plus bouger. Il souffrait beaucoup trop et on a dû l’euthanasier après bien des délibérations dans la maison. Cette mort a eu lieu la même année que celle de Jasper, qui lui, est mort écrasé sur la route. Une mort toute bête… Imprévisible !
À cause de ces premières expériences vécues sur la mort, Arnaud a fini par se poser beaucoup de questions sur la vie. Il s’est rendu compte que la vie est fragile et éphémère.
Arnaud vient de parler au chien enterré. Il lui a dit qu’il l’aimait et qu’il l’aimerait toute sa vie… Il ne sait pas si l’esprit du chien peut capter ce message important, mais on ne sait jamais. Au cas où ?
Parfois, Félix le suit jusqu’à la petite butte de terre sous laquelle repose Jasper. Le chat noir dont les yeux verts le regardent d’un air mystérieux fascine l’enfant. Les chats sont des créatures sublimes, pense Arnaud, qui apprécie le caractère indépendant propre à la race féline.
Il adore Jacquot aussi. Le perroquet a appris beaucoup de mots en langue étrangère que Arnaud s’est appliqué à lui inculquer…Il a été surpris du résultat. Arnaud passe beaucoup de temps avec Jacquot après ses devoirs. Parfois Béatrice pense qu’Arnaud se sent mieux avec le perroquet qu’avec ses petits camarades de classe.
Arnaud est heureux : des gentils parents intelligents, un mode de vie agréable, une belle maison et des animaux, des résultats scolaires fort honorables, des grand-parents adorables et généreux ainsi que des oncles et tantes chaleureuses….
Mais il n’ a pas de petite sœur ! Pourquoi ? La vie a aussi ses caprices, pense t-il à court de réponses.
Souvent l’enfant discute à table avec ses parents. Il ne parle pas de l’école et des petits camarades bruyants et énervants, mais il pose des questions pour satisfaire sa curiosité insatiable sur le cours de l’existence. Il souhaiterait avoir des réponses concrètes sur Dieu, sur ce qui a créé tout l’Univers… mais aussi avoir une ligne de conduite, adopter une certaine philosophie de vie.
Un soir, alors qu’il revenait de la tombe du chien Jasper avec une larme au coin de l’œil, son père Jean-Pierre lui a parlé de Montaigne ; il a encore en tête cette phrase : « philosopher, c’est apprendre à mourir » ! Et puis d’autres phrases… La préméditation de la mort est préméditation de la liberté, a essayé de lui expliquer son père. Un apprentissage à mettre en place pour se préparer à la mort et se libérer de l’angoisse que suscite la mort comme événement inexorable, brutal et imprévisible…
Son père lui cite souvent Michel de Montaigne pour répondre, ou du moins pour tenter de répondre, à ses questions pertinentes…
Pour résumer l’essentiel de Montaigne en quelques mots simples, surtout pour un enfant, Jean-Pierre lui a tenu ces propos la semaine dernière :
— Arnaud, l’homme que nous sommes sur Terre ne peut accéder si facilement au savoir universel. Le monde change tout le temps. Chaque chose est différente des autres. Notre raison est faible et ne peut pas nous permettre d’atteindre la vérité. Il est sage de douter et de se poser des questions. Mais le droit chemin est de suivre la nature, chose devenue, hélas, plus difficile à cause de notre culture et parfois de notre raison, ce qui nous fait perdre notre instinct naturel. Il faut suivre la nature du mieux que tu peux, mais surtout utiliser ton intelligence, c’est-à-dire ta sagesse ainsi que ton jugement, car il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine… Tu apprendras que l’humilité est primordiale, car elle est l’aboutissement de notre conscience concernant la limite de notre savoir. Bref, mon fils, sois modeste, mais ne te méprise pas pour autant. Sois conscient de ta propre valeur, de tes faiblesses mais aussi, ou surtout dirais-je, de ton ignorance pour trouver le juste milieu dans ta conduite afin d’adopter une ligne de philosophie adéquate.
Béatrice a trouvé ces mots assez juste pour orienter leur fils sur une première voie ; au fil du temps Arnaud fera ses expériences et aura lu Montaigne… peut être Descartes et tous les rationalistes qui sauront aussi satisfaire son besoin de savoir et éclairer sa lanterne. Et bien d’autres aussi !
Un appel de Nadine a interrompu la conversation. Nadine voulait simplement inviter Arnaud en Espagne pendant les prochaines vacances. Nadine enseigne l’espagnol à Biarritz et est mariée à un homme catalan de Tarragone. Cet homme est artiste peintre et réussit à vivre de ses peintures.
— Génial ! a dit Arnaud. Je vais pouvoir voir Miguel peindre. Il a même dit qu’il aimerait faire mon portrait. Le vendre à las Ramblas à Barcelone !
— Oui, mon chéri, c’est merveilleux, ton père et moi, sommes fiers de toi. Nous sommes heureux avec toi. Tu es notre raison de vivre, tu sais ! Moi, je dirais simplement que l’AMOUR est, et devrait être, la raison de vivre de tout être !
FIN votre commentaire
votre commentaire
-

Chapitre 1 : Neige de Feu
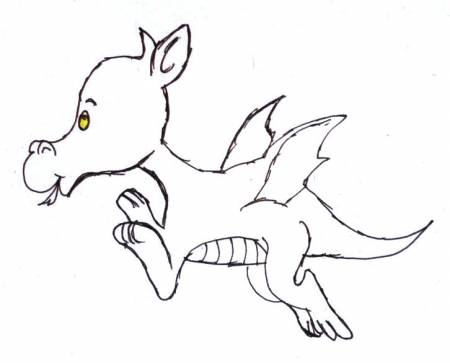
Dans le pays des dragons se trouve un dragonnet malheureux. Il est petit, vraiment petit, blanc aux yeux jaunes, et ne sait pas cracher du feu.
— Aller Neige de feu, fait encore un petit effort. Inspire profondément, bloque l’air dans tes petits poumons, pense aux flammes que tu vas donner et crache ! lui conseille fermement sa mère.
— Mais maman, c’est ce que je fais depuis le coucher du soleil, j’essaie, j’essaie, je ne fais que ça, mais je n’y arrive pas ! pleurniche le dragonnet.
« Et puis quelle idée de m’avoir appelé Neige ! Comme si ce nom allait me donner de la force et du caractère ! Neige ! Pourquoi ne m’ont-ils pas appelé Petit Flocon tant qu’ils étaient dans des noms ridicules ? » pense-t-il.
Ses parents ne savent plus quoi faire avec lui. Sa mère finit par le laisser rentrer dans sa grotte. Elle regarde les minuscules ailes sur le dos de son fils et soupire.
— Courage ma reptile d’amour, l’année prochaine, l’œuf sera meilleur. Je suis sûr que notre second enfant sera grand, beau, et un cracheur de feu exceptionnel ! l’encourage Dragon Impérial, son compagnon.
Mais maman dragon n’y croit pas. Voilà des semaines qu’elle désespère de voir son fils grandir, même ses ailes de chauve-souris n’ont pas pris un centimètre. Quant à sa peau, elle sait qu’avec des écailles de pareilles couleurs, jamais il ne pourra sortir en plein soleil.
Fin de nuit, Neige de feu fait un cauchemar. Il se réveille peu avant l’aube. Il sort de sa grotte et observe le ciel chargé de nuages.
— Avec un peu de chances, la saison des pluies va commencer et je vais enfin pouvoir sortir sans risquer une insolation, dit-il tout bas pour ne pas réveiller ses parents.
Effectivement, le soleil peine à percer les nuages pour annoncer le lever du jour. Neige de feu profite de ce temps maussade pour aller au village chercher des petits pains de pierre pour le petit déjeuner. Peut-être qu’avec cette surprise, son papa lui donnera enfin un sourire.
Hélas, il n’est pas encore arrivé au village qu’il croise la route de Vert Bouteille. Vert Bouteille est aussi un dragonnet, à peine plus âgé que lui. Sauf que lui, il est trois fois plus grand, a des écailles vert crocodile et qu’il sait cracher du feu depuis longtemps. Même la technique du vol, il la maîtrise.
Neige de feu est heureux de rencontrer un autre enfant. Il s’avance vers lui un grand sourire aux lèvres.
— Salut, je m’appelle...
Il n’a pas le temps de se présenter qu’un jet jaune et rouge lui roussit le bout du museau !
— Ouuuais ! J’ai réussi du premier coup et sans trop te brûler. Ah ! maman serait fière de voir que je sais enfin cracher les flammes d’avertissement, dit fièrement Vert Bouteille.
— Oh tu sais déjà faire tout ça, lui répond tristement Neige de feu. Tu en as de la chance. Moi, je suis petit, blanc et je ne sais pas encore crach…
Shhhhh
Vert Bouteille remet ça. Il s’amuse à faire peur à ce petit dragon tout blanc. Il dose sa force et crache ses flammes d’avertissement les unes sur les autres.
Neige de feu volette maladroitement, finalement, il ne veut plus faire la connaissance de ce dragonnet-là. Et son vol un peu gauche lui vaut un éclat de rire de la part de deux autres dragonnets.
Plus il avance dans le village, plus on se moque de lui, on le prend pour un fantôme, on lui jette des bouteilles de peinturagon et on lui crie d’aller voir ailleurs s’il n’existe pas un pays pour dragonnetus, un pays pour les dragons minus.
Neige de feu est triste, il pleure, il vole, il court. Chemin faisant, il s’éloigne du village et dépasse même sa caverne. Il laisse derrière lui ses parents et s’en va en s’imaginant qu’il ne manquerait à personne.Chapitre 2 : Violette et la fée

Le temps s'écoule inexorablement. Alors que le dragonnet continue péniblement sa route, les nuages se dissipent. Tout à coup, un rayon de soleil déchire l’obscurité et stoppe net la progression de Neige de feu. Du regard, le petit dragon cherche un abri. Il doit à tout prix se protéger, il ne veut pas en plus avoir à affronter une douleur physique.
Il n’a plus de force. Les moqueries et les méchancetés qu’il a essuyées à l’occasion de sa toute première sortie en plein jour l’ont complètement vidé de ses maigres forces. Malheureusement, il ne trouve qu’une vieille pierre, taillée comme une délicate fée. Ce travail qui semble être l’œuvre d’un sorcier, intrigue le petit dragon. Lorsque Neige de feu manipule la pierre pour l’observer sous toutes les coutures, le soleil immerge la vallée et le frappe de plein fouet.
— Snif, snif, pourquoi faut-il que je sois comme ça ? Sanglote le petit dragon meurtri par l’astre chauffant.
Timidement, une larme du dragonnet roule sur la pierre de fée, puis une seconde et une troisième aussi. Humidifiée de la sorte, la pierre devient moins solide. Elle semble se craqueler dans la main de Neige de feu. Très vite, une véritable fée émerge dans sa paume.
— Ne pleure plus petit dragon. Je suis là à présent. Tes larmes blanches de dragon m’ont sauvée de mon triste sort. À présent, je te dois un coup de fée. Ensemble, nous allons pouvoir faire quelque chose pour toi, lui dit-elle de sa voix mélodieuse.
— C’est vrai ? Vous pouvez me changer en un vrai dragon, un grand, vert et puissant ? lui demande le petit dragon plein d’espoir.
— Non, je n’ai pas beaucoup de pouvoirs malheureusement. Sinon, je ne me serais pas fait attraper par ce vilain sorcier ! Sais-tu que je suis restée deux années dragonnières entières coincée dans cette pierre ?
— Oh ! soupire Neige de feu. Alors que peux-tu faire pour moi ?
La fée s’étire encore puis fait apparaître une bouteille blanche entre les pattes du dragon.
— Étale cette crème sur tout ton corps, c’est un lait hydratant qui protège des UV. Et mets aussi ça sur ta tête, lui dit-elle en montrant une casquette venue de nulle part.
Neige de feu obtempère sans discuter, il sent déjà une brûlure sur ses épaules.
Et aussitôt la crème étalée, les douleurs disparurent comme par enchantement. Il n’a plus mal à la tête et se sent déjà mieux.
— Merci, merci beaucoup, ça fait du bien, lui dit-il.
— Mais ceci n’est que trois fois rien. Comprends-tu, ma magie à moi, ce sont les objets. Je peux faire apparaître tout ce que tu veux, mais je ne peux rien faire disparaître. Je ne peux pas donner non plus la vie éternelle, pas plus que des couleurs, des sentiments ou toute autre chose qu’on ne peut pas toucher.
— Mais moi j’ai besoin d’écailles vertes, j’ai besoin de grandir et j’ai besoin de force pour pouvoir voler et cracher comme il faut. Petite fée, tu ne peux donc rien me donner de tout ça ?
— Je regrette. Toutefois, je pense que je peux t’aider autrement.
Neige de feu ne comprend pas le sens de sa dernière phrase. Au moment où il va déposer cette fée par terre, celle-ci s’envole dans les airs. Bizarrement, elle n’a pas retrouvé ses couleurs, elle est toujours aussi pâle que lorsque la pierre l’avait libérée. Sans doute les larmes blanches de Neige de feu ont-elles déteint sur elle ? Toujours est-il qu’elle tient à remercier ce petit dragon. Elle veut lui rendre la vie meilleure. Alors, d’un claquement de doigts, elle fait apparaître une étrange petite machine. L’engin se met à grésiller puis des dizaines de voix fusent des haut-parleurs.
— Mais, c’est une radio, dit Neige de feu surpris.
— Oui ! C’est ça, une radio ! dit la petite fée en riant. J’avais oublié son nom, je l’ai rebaptisée « boîte à voix », dit-elle fièrement.
— Et en quoi est-ce qu’elle pourra m’être utile ? lui demanda alors le dragonnet.
— Écoute plutôt, lui répond-elle.
La fée change de fréquence en tournant un petit bouton. Tous deux peuvent alors entendre :
« Mais où est-il ? Où a-t-il pu voler ? Il est si petit, si faible. »
— Maman ! C’est la voix de maman. Elle me cherche donc ? dit Neige de feu en prenant la radio dans ses mains.
— Oui elle te cherche, elle est triste que tu sois parti…
Attends un peu, écoute ceci à présent.
La fée tourne encore le bouton.
« Laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait ! Mais laissez-moi ! Maman ! Maman ! » Peuvent-ils entendre crier un dragonnet ?
— Qui c’est ? Qui l’embête ? On ne peut pas laisser faire, dit Neige de feu.
— C’est Violette, une dragonnette du village plus loin. Tu vois, toi, tu es blanc, elle, elle a le ventre et les ailes mauves. Et comme toi, elle subit les moqueries des autres dragonnets. Vous n’êtes pas les seuls à être différents, vous êtes nombreux, mais vous ne vous connaissez pas encore…
— Peut-on l’aider ? Je ne sais pas encore comment, mais je ne peux pas la laisser seule, on est un peu pareils elle et moi, on doit pouvoir s’entraider, pense-t-il tout haut.
Alors que la fée lui explique comment il peut voyager grâce à la radio, Neige de feu ne pense plus à devenir vert, grand et excellent cracheur de feu, mais à aider cette pauvre Violette que l’on maltraite.
— Tu as bien compris ? Ne te trompe pas de bouton, sinon tu perds la fréquence, lui disait la fée pour la troisième fois.
— Oui, c’est bon, j’ai compris. Je ne touche à aucun des boutons sauf à celui qui est sur le côté, en dessous de l’antenne, répète-t-il impatient.
— Oui, c’est ça ! s’extasie la fée.
Et sitôt dit, sitôt fait. Neige de feu appuie sur le bouton en question et tout à coup, un nuage mauve se forme, l’engloutit puis le fait disparaître.
De l’autre côté de la radio, dans un village plus loin, Violette se fait jeter dans une rivière par deux dragovoyous. Ses grandes et soyeuses ailes mauves se retrouvent soudainement trempées et chiffonnées.
Dans un nuage, Neige de feu apparaît pile à côté d’eux. Profitant de l’effet de surprise, il pousse durement les deux dragovoyous dans l’eau et tend sa main à Violette pour l’aider à se remettre debout.
Les deux dragodolescents ont la peur de leur vie en voyant ce petit dragonnet blanc apparaître comme par magie.
— Un dragofantôme ! Aaaahhh ! s’envolent-ils dans un cri de terreur.
— Merci beaucoup, dit Violette à son sauveur. Je pense qu’ils n’oseront plus m’embêter à présent.
— Je n’ai presque rien fait, répond-il en rougissant jusqu’à ses oreilles pointues.
À l’instant même où Neige de feu explique sa venue en prononçant le mot « fée », il disparaît à nouveau dans un nuage coloré.
De retour devant la « boîte à voix », la fée lui explique les conséquences de son geste de bravoure.
— Grâce à cet engin, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin pour devenir un grand et fort dragon. Constate-le par toi-même, regarde-toi dans ce miroir, lui dit-elle en le faisant apparaître.
— Ouah ! C’est génial ! s’est-il exclamé en voyant son ventre devenu… violet ! mais heu…
Il n’a pas le temps d’en dire davantage, la fée lui coupe la parole :
— Oui, bon, on ne peut pas tout avoir, du violet, c’est déjà mieux que du blanc, non ? Et puis, tu n’as pas encore vu tes ailes, tourne-toi un peu.
Neige de feu laisse sortir un immense cri de joie. Ses ailes ont grandi et sont devenues aussi soyeuses que celles de Violette. C’est en y songeant qu’il angoisse :
— Violette ! J’espère qu’elle n’a pas attrapé mes écailles blanches et que ses ailes n’ont pas rétréci ?
— Ne t’inquiète pas, la rassure la fée. Rien n’a bougé de son côté, si ce n’est qu’elle a gagné à te connaître, elle s’est fait un ami.
Neige de feu se sent plus fort, plus sûr de lui. Il exhibe ses ailes et ne cesse de s’admirer dans le miroir.
Pour la première fois, il passe une bonne nuit.
Chapitre 3 : Capucine

Le lendemain, fier d’avoir pu aider quelqu’un, il veut à nouveau écouter la radio. Avec la compagnie de la fée, Neige de feu se sent… pousser des ailes. Il est enthousiaste à l’idée d’avoir d’autres couleurs sur son corps.
Il tourne le bouton et la machine à voix se met en état de fonctionnement. Il entend rapidement un nouvel appel à l’aide. C’est une autre dragonnette qui a des problèmes avec des dragodolescents de mauvaises fréquentations.
« À l’aide, ils me démantibulent les jambes ! »
D’un signe de tête, la fée approuve son geste. Une fumée plus tard, et voilà notre petit dragon blanc et mauve qui apparaît dans un brouillard rouge.
Une fois encore, Neige de feu garde l’effet de surprise pour lui et attrape la dragonnette en danger par ses bras levés. Les trois dragodolescents qui se disputent le cœur de la belle Capucine n’osent rester accrocher à leur dulcinée. Ils sont tellement impressionnés par la visite de cet étrange dragofantôme à moitié violet qu’ils restent tous trois aussi immobiles que des statues de pierre.
Du cou de Capucine se dégagea un parfum envoûtant. C’est une fragrance si ensorcelante qu’il fait tourner la tête de son sauveteur. Neige de feu s’envole avec la dragonnette tout en lui racontant comment il a pu entendre son appel à l’aide d’aussi loin. Puis, pour la seconde fois, il disparaît aussi soudainement qu’il est apparu dès qu’il parle de sa bonne fée.
À son retour, la fée l’attend. Dès qu’elle l’aperçoit, elle a un sourire aux lèvres. Neige de feu n’a pas besoin de miroir pour admirer la superbe teinte rouge à chacune de ses quatre pattes. Ses ailes ne sont pas plus grandes que la veille, mais pour avoir pu voler avec Capucine dans ses bras, il sait qu’elles sont beaucoup plus musclées. Une toise faite de galets plats et lisses lui montre qu’il a pris quelques centimètres. Ce n’est pas beaucoup, mais Neige de feu ne peut retenir sa joie :
— Ouah ! c’est extraordinaire, et c’est, c’est…
— Oui, vas-y recommence ton cri de joie, je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises pour ce sauvetage.
— Ouah ! Ouah ! Ouah !
De la fumée sort des naseaux de Neige de feu. Au bout du dixième cri de victoire, une flamme rouge et chaude comme la braise jaillit de sa bouche !
— Yahou !
Il ne peut plus se retenir. Le dragonnet vole de bonheur et crache pour le plaisir en faisant des figures dans le ciel.
Après avoir passé tout l’après-midi à travailler son feu et sa puissance, il se couche complètement ivre de joie.
— Demain, j’essaierai de cracher les flammes d’avertissement, dit-il à sa fée en fermant déjà les yeux.Chapitre 4 : Poussin et le Dragocteur

Le troisième jour, il n’attend pas que la petite fée se réveille.
La radio ne grésille même plus, la voix est nette et suppliante :
« Mais où suis-je ? Oh pour l’amour des dragons, je crois que je me suis perdue ! » pleure Poussin, une dragonnette au désespoir.
Une fumée jaune prévient Neige de feu que celle qu’il va aider doit avoir du jaune sur son corps.
Il arrive dans un bois, à une longueur de flamme de Poussin.
— Bonjour mademoiselle. Je me présente Neige de feu et je suis là pour vous aider à retrouver votre chemin.
— Oh ! Vous m’avez fait peur. Mais comment … ?
— C’est une très longue histoire. Si vous me permettez, je vais tâcher de trouver un petit coin de ciel d’où nous puissions nous envoler, vu de là-haut, cela devrait être plus facile de savoir où nous sommes.
Poussin est ravie de faire la connaissance de Neige de feu pour deux raisons. La première bien sûr est qu’il va l’aider à pouvoir rentrer chez elle et la seconde est qu’il est le premier dragonnet à ne pas faire de remarque quant à sa taille un peu démesurée pour une jeune dragon comme elle.
La forêt est dense et Neige de feu ne voit aucun trou vers la cime des arbres qui peu lui permettre de prendre de la hauteur. Il ne perd pas espoir et cherche plutôt à savoir par où est venue Poussin.
— Je ne sais même plus. Je pense que j’ai du faire trois fois le tour de ce buisson, je retombe toujours sur cet arbre effrayant.
— C’est vrai qu’il ne manque plus que la parole à cet arbre pour nous faire peur pour de bon. Son tronc est déformé et on pourrait presque lui donner un visage, brrr frissonne Neige de feu.
Il ne veut pas trop traîner par ici. Il ne connaît pas la forêt et il existe une légende qui parle d’un vieux dragon, cracheur de flammes colériques, et qui…
— Atchoum !
— À tes futurs dragonneaux, souhaite Neige de feu.
— Mais ce n’est pas moi qui ai éternué ! s’étonne Poussin.
Ils n’ont pas le temps de comprendre qui se cache derrière ce rhume qu’un second « atchoum » résonne dans les bois, rapidement suivi d’un chemin de feu impressionnant.
— Vite, allons par là si nous ne voulons pas que nos écailles grillent sur place, suggère Neige de feu en encourageant Poussin à courir plus vite.
Mais comme la dragonnette en a fait l’expérience, ils tournent en rond, sans s’en rendre compte. Ils arrivent ainsi juste derrière celui qui éternue depuis quelques minutes.
Le dragon vert qui est malade les a vus venir, mais ne peut s’arrêter d’éternuer pour autant.
— Attention les enfants, a, a, aaatchoum ! Ne restez pas là, je ne contrôle pas mes flammes.
— Mais vous allez finir par brûler toute la forêt de la sorte, compatit Neige de feu. Vous ne connaissez pas un bon médidragment qui pourrait stopper cette crise d’éternuement aiguë ? lui demanda-t-il.
— Ah si seulement. Figurez-vous que je suis dragocteur, j’ai terminé mes études de médecine voilà bien des années et pourtant le remède que j’administre à mes patients et qui fonctionne chez eux, ne marche pas chez moi.
Poussin a beau être très grande, elle a les pattes qui tremblent de peur. Les écailles de son dos sont couvertes de cendre de bois, on ne distingue presque plus leur couleur jaune.
Neige de feu ne sait pas très bien que faire quand subitement, il se rappelle un remède de grand-dragmère.
— Sapin des bois, avez-vous déjà essayé de vous toucher le front avec votre langue fourchue ?
— Comment ? C’est une blag’ tchoum ?! lui demanda le dragocteur, en crachant une petite flamme de microbes.
— Non, c’est ma grand-dragmère qui a donné ce truc à ma mère. Il paraît que ça marche parfois. Essayez pour voir. Vous ne risquez rien.
Sapin des bois, le dragon vert qui est pourtant docteur, ignore tout de cette astuce. Il essaye une fois. Deux fois. Trois fois. Il essaye, encore et encore. Il ne parvient pas à toucher plus loin que le sommet de son nez. Et, en attendant, il n’éternua plus !
Il essaye encore, car il est presque arrivé. Finalement, il abandonne.
— Je n’y arrive pas. Ma langue n’est plus ce qu’elle était autrefois. Elle se fait vieille, elle n’est plus aussi souple que dans ma jeunesse. Je ne bois pas assez d’eau, elle serait certainement moins rigide si je l’humidifiais plus, non ? Qu’en dites-vous jeunes gens ?
— J’en dis que vous n’avez pas éternué une seule fois pendant toute cette explication ! rigole Poussin.
— Hé ! Mais c’est vrai ! Super, merci petit pour ce conseil. Je le note dans mon carnet de prescription, un médicament gratuit, très efficace et sans aucun effet secondaire.
Et quand Sapin des bois leur demande ce qu’ils font dans ce bois, Poussin lui raconte toute l’histoire.
— Regardez ! dit Neige de feu, vos flammes ont ouvert un passage vers le ciel. Poussin, tu vas pouvoir rentrer chez toi.
Et Poussin n’attend pas plus longtemps pour ouvrir ses ailes et prendre de l’altitude.
Quelques coups d’aile plus tard, elle revient annoncer qu’elle a retrouvé son chemin. Sa grotte n’est plus très loin, juste de l’autre côté de la forêt.
Neige de feu prend congé des deux dragons en lançant un « aure… fée ». Cette fois-ci il disparaît dans un nuage jaune et vert.
La fée est aussi émue que lui peut l’être à se contempler dans le miroir.
— Je n’ai plus une seule écaille blanche. Regarde-moi ce dos jaune et cette tête verte ! Je n’en reviens pas, même mes yeux ont changé de couleur.
— La toise devient trop petite, tu dépasses d’au moins six galets ! Tu es beau comme un prince, la félicite sa fée.
— On devrait me trouver un autre nom. Je pourrais me rebaptiser arc-en-ciel, mais il me manque du bleu, plaisante le dragonnet qui n’est plus du tout malheureux.Chapitre 5 : Saphir
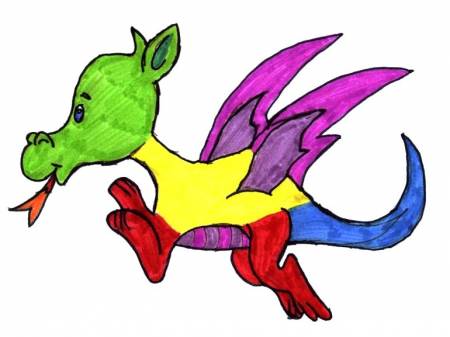
Et alors qu’ils réfléchissent à un nouveau nom, la radio s’éveille d’elle-même.
« Moi, une dragorcière ? Il n’y a que les fous qui peuvent croire que ça existe. Tout le monde sait qu’il n’y a que les fées qui savent faire de la magie. Mais les fées, plus personne n’en a jamais vu depuis des années flammes. Que vais-je devenir ? Serais-je condamnée à rester enfermée dans cette prison jusqu’à la fin de mes jours ? » la plainte de cette dragonnette ne peut laisser personne indifférent, surtout pas Neige de feu.
— En plus, elle dit qu’elle n’a jamais vu de fée, c’est le moment où je peux venir avec toi si tu n’y vois pas d’inconvénient ? lui demande-t-elle de son sourire malicieux.
— Peut-être que de la sorte, je ne disparaîtrai plus en prononçant le mot, puisque tu seras avec moi, c’est toi qui lui raconteras tout, lui répond-il.
Un nuage bleu les entoure doucement.
— On disait justement qu’il te manquait du bleu… lance la fée en riant.
Dans la prison, Saphir, la dragonnette pousse un cri de surprise en voyant le nuage bleu se dissiper.
— N'aie pas peur, nous ne sommes pas là pour te faire du mal, dit Neige de feu.
— Nous ? Mais qui ça nous ? Où est l’autre dragonnet ? demande-t-elle en regardant partout dans sa cellule.
— Je ne suis pas un dragonnet, je suis une fée ! lui répond une petite voix étouffée entre les deux ailes de Neige de feu.
La fée apparaît sur l’épaule de son protégé. Elle semble plus petite que lorsqu’elle est sortie de sa peau de pierre. Sans doute est-ce le fait que Neige de feu est à présent beaucoup plus grand que lorsqu’il a pleuré sur elle.
Saphir a des écailles vertes sur tout le corps excepté sur sa queue.
— Oh ! Je sais ce qui vous intrigue, dit la dragonnette étrange. C’est la couleur de ma queue. Je suis née comme ça, je n’y peux rien. Comme toi, tu es tombé dans un arc-en-ciel pour être multicolore ? lui demanda-t-elle en riant timidement.
— Non, je suis née tout blanc, j’ai gagné ces couleurs en aidant d’autres dragonnets. C’est une longue histoire lui dit-il pour terminer.
— Et elle, demande Saphir, c’est vraiment une fée ? Elle est toute blanche et si…
— Si petite ? Si étrange ? l’interroge la petite fée qui parade dans toute la pièce en faisant des ronds dans les airs et en matérialisant mille et une choses.
— Oui elle en est bien une. Elle a de bien curieux pouvoirs, mais je peux te garantir qu’elle fait bien de la magie dit Neige de feu.
— C’est ce que je vois dit Saphir en ne quittant pas la fée du regard.
— Bon, comment allons-nous pouvoir la faire sortir d’ici ? demande le dragonnet aux multiples couleurs.
La fée est dans tous ses états (imaginez un peu le bazar dans cette cellule. Vous souvenez-vous que cette fée est un peu particulière et qu’elle ne sait faire qu’apparaître des choses matérielles… mais qu’elle ne sait rien faire disparaître ?).
— Je pense à quelque chose, dit la petite fée qui essaie de ranger tous ces objets encombrants. Il me suffit de faire apparaître une porte qui s'ouvre !
— Bonne idée ! lance Saphir, mais où vas-tu la mettre ? Il y a un de ces bazars ici !
En effet, plus un mur ne peut encore servir de porte de sortie. Puis, comme par un tour de magie, un oiseau apparait entre les barreaux de la fenêtre.
— Bien sûr ! crie Neige de feu. Ma bonne fée, peux-tu faire apparaître une petite porte en lieu et place de cette fenêtre ?
— Je n’ai jamais essayé cela. Mettez-vous, heu, derrière cette montagne d’affaires, voulez-vous ? Je ne voudrais pas que vous ayez cette porte sur les orteils ! dit-elle en se frottant les mains.
Un claquement de doigts plus tard et une minuscule porte se matérialise en lieu et place des barreaux du donjon. Un cri de joie suivi aussitôt d’un deuxième et d’un troisième remplit la pièce.
Neige de feu saisit aussitôt la poignée et ouvre la porte.
— Je suis libre, enfin libre crie Saphir en embrassant Neige de feu sur la joue. Merci, merci surtout à toi petite fée bien sympathique que je suis bien heureuse de connaître !
Un peu plus tard, alors qu’ils cherchent une vallée où se reposer, la fée voit un étrange phénomène se produire sous ses yeux.
Elle a toujours cru que c'était la fée des Pigments qui offrait les couleurs aux dragons valeureux. Elle se souvient encore de ce qui lui avait raconté sa mère, alors qu’elle n’était encore qu’une fée en apprentissage.
« La fée des Pigments habite dans les nuages de voyages. Elle seule a le don de colorier un dragonnet en croissance. Et encore il faut que ce petit dragon fasse preuve de courage et de bravoure. » La fée n’a jamais douté de la véracité de cette histoire puisque Neige de feu est à chaque fois parti et revenu de ses aventures dans un nuage coloré. Mais là, sous ses yeux, Neige de feu change encore de couleur !
Près des nuages, son protégé et la dragonnette volent côte à côte, leurs queues enroulées l’une à l’autre. Et ce geste de tendresse donne à Neige de feu, une queue bleu… saphir !
Chemin faisant, ils progressent vite et la vallée où Neige de feu a rendu vie à la fée se profile à présent devant eux.
— Nous voilà de retour chez nous, enfin chez moi, corrige Neige de feu triste à l’idée de devoir se séparer de Saphir pour qui il ressent des sentiments amoureux.
— Tu peux dire chez nous, sauf si tu préfères une autre vallée. Là où j’habite, il y a très peu de grottes et une multitude de falaises rocheuses très glissantes, lui confie-t-elle.
Ivre de bonheur, Neige de feu invite son amoureuse et sa meilleure amie la bonne fée à venir jusque chez lui pour faire connaissance avec ses parents. votre commentaire
votre commentaire
-

Je déteste Noël
Oui, je déteste Noël et toutes les fêtes programmées, parce qu’elles sont accompagnées de réjouissances tout aussi programmées, rendues quasiment obligatoires par les diktats commerçants, les traditions sociétales.
Je n’aime pas cette obligation d’être heureux ou réjouis tous en même temps, dans la mesure où les motivations évoluent dans un sens mercantiliste, j’ai le sentiment dans cette avalanche d’appels à la consommation que tout ce qui donne un sens de rassemblement joyeux, familial, tout ce qui éveillerait des émotions est secondaire. Un bon nombre de « relation à l’autre » passe par l’objet et sa valeur pécuniaire. C’est en même temps une aggravation du sentiment de solitude, une stigmatisation de l’isolement par le rappel incessant de ces moments de rassemblements.
Alors, je déteste Noël, mais pas le Noël de mon enfance.
Celui-là, dans la chaleur de la maison rassurante, avec, au bout des branches du sapin, le scintillement des vraies bougies clipsées que l’on allumait quelques instants, me laisse des souvenirs inoubliables.
J’aimais les guirlandes et les boules brillantes et multicolores, les cheveux d’ange éparpillés sur la ramure pour figurer les flocons de neige.
Pour cacher le pied du sapin, on l’entourait de papier kraft dont la peinture imitait les rochers. Dans un creux aménagé pour simuler une sorte de grotte, on installait les personnages de la crèche. Cela m’enchantait de voir l’âne et le bœuf ainsi réunis pour chauffer de leur souffle le petit berceau et l’enfant. Les rois mages semblaient monter un chemin aménagé dans un sillon du papier.
Nous mangions au réveillon, dans les rires et la gaieté, toute la famille réunie, les mets que l’on ne trouve pas quotidiennement à table.
Le lendemain de la veillée, je trouvais mon cadeau, et une bûche en chocolat creusée pour accueillir un petit Jésus en sucre. J’adorais cette friandise, et si on me la présentait encore aujourd’hui, je la mangerais avec autant de plaisir.
J’aime ces jours-là, ils avaient un éclat et une douceur particuliers, quelque chose d’enchanteur qui permettait la venue du gros bonhomme rouge et de toutes les féeries.
Le Noël était une fête familiale, discrète. Pas de lumières clignotantes au-dehors, hormis les guirlandes électriques de la ville.
Pas de publicités dans les médias de toutes sortes. On finit par nous faire croire que même les chiens attendent avec impatience de recevoir leur os à mâcher emballé de papier doré.
Les autocollants, les décors forcément rouges et blancs des commerces et leurs affichages, les images de Pères-Noël joufflus et réjouis donnent une impression de fête convenue, où l’on est contraint de se réjouir, et l’on nous amène à penser que l’échange de cadeaux originaux est incontournable, que l’on se doit d’organiser des repas exceptionnels en décors et en abondance de nourritures pour démontrer que l’on a su fêter comme il se doit.
Bref, des motifs mercantiles ternissent l’aspect familial ou religieux de cette fête.
Dans les Noëls de mon enfance, on ne trouvait pas de faux Pères-Noël à tous les coins de rues, seulement celui du Prisunic, qui distribuait des bonbons devant le magasin.
Ainsi pour la petite fille que j’étais, pas de doute. Le Père-Noël venait sur terre visiter les enfants, pour savoir s’ils étaient sages et retournait dans son chalet fabriquer tous les jouets commandés.
C’était du moins l’explication qu’on m’en avait donné et elle a suffi à me contenter jusqu’à ce que je sois en âge de comprendre la vérité.
Avec les Pères-Noël commandités par les commerces et les associations diverses, il faut inventer un nouveau mensonge à cette légende du Père-Noël, pour expliquer aux enfants étonnés pourquoi l’on rencontre autant de ces bonshommes rouges.
Une fois la mystification éventée, mes Noëls ont perdu petit à petit leur magie, pour laisser place depuis quelques années à l’irritation face au déballage médiatique, publicitaire qui débute longtemps avant les fêtes.
Alors, je pense à tous ceux qui sont seuls pour passer les fêtes, à tous ceux qui ne peuvent pas se créer un Noël d’abondance, à tous ceux qui passent leur Noël dans une institution, qui auront droit à un repas amélioré et puis au lit ; il faut que le personnel de jour aille réveillonner.
Pour eux, le rappel incessant d’un Noël réussi et chaleureux, dans l’abondance doit exacerber la douleur de la solitude ou de la pauvreté.
Les yeux des enfants perdent leur scintillement quand ils découvrent la duperie des adultes : le Père-Noël n’existe pas.
Malgré les paillettes, l’atmosphère festive artificielle, quand le cercle familial se restreint, la fête prend un goût d’amertume.
Alors, à l’approche de cette fête, je préfère de temps en temps me replonger dans mes souvenirs, un peu flous, un peu usés, le sapin, la lumière tendre, les visages familiers plus jeunes, gais, mes poupées, les chocolats, les…
 votre commentaire
votre commentaire





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 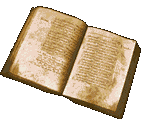
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot