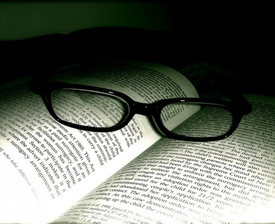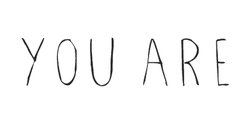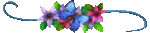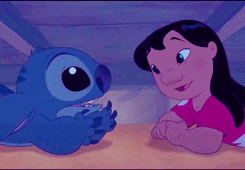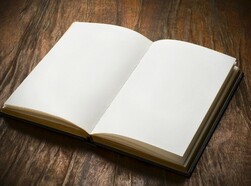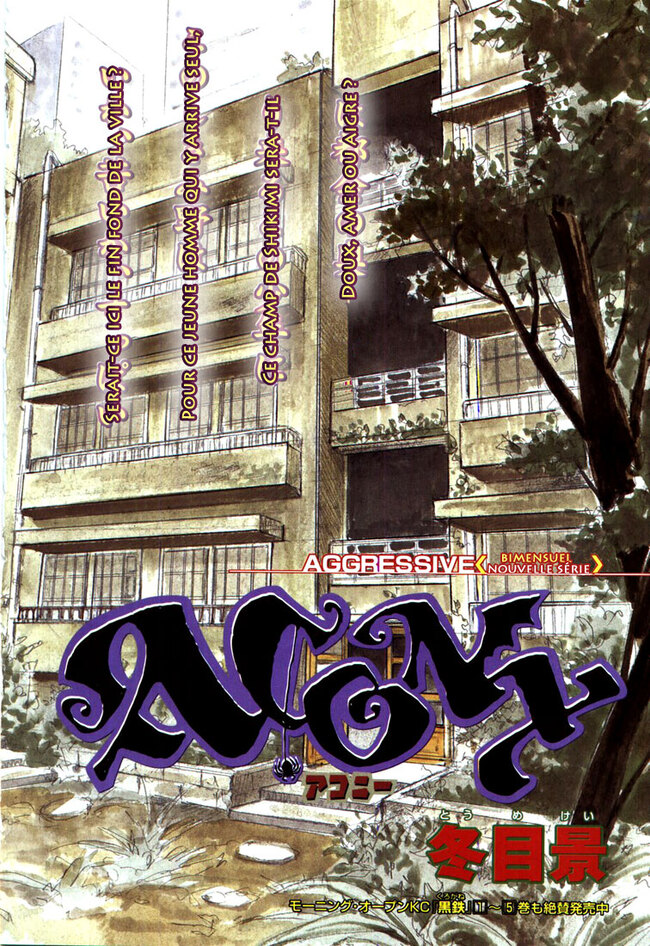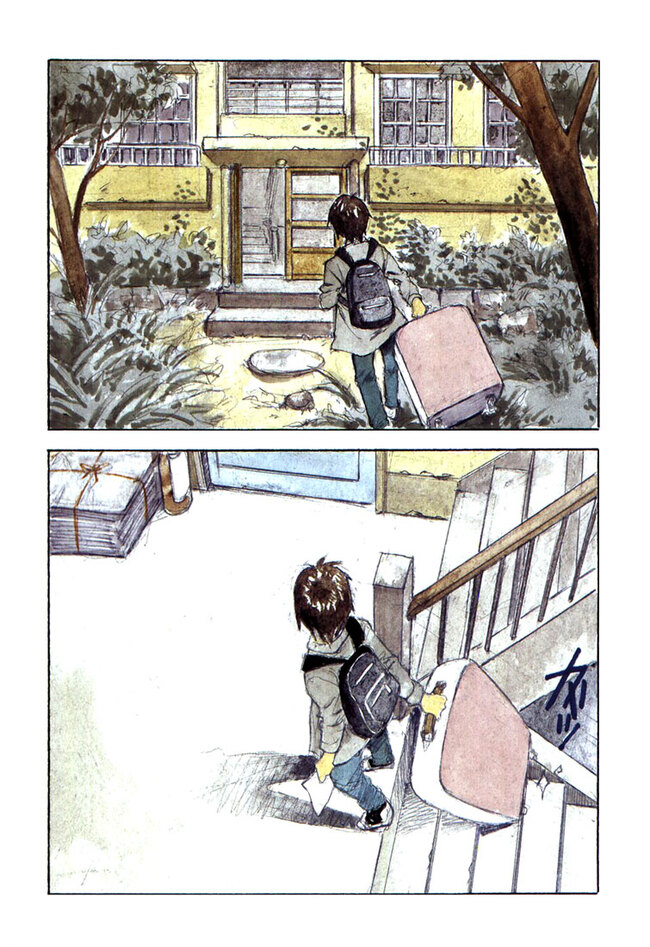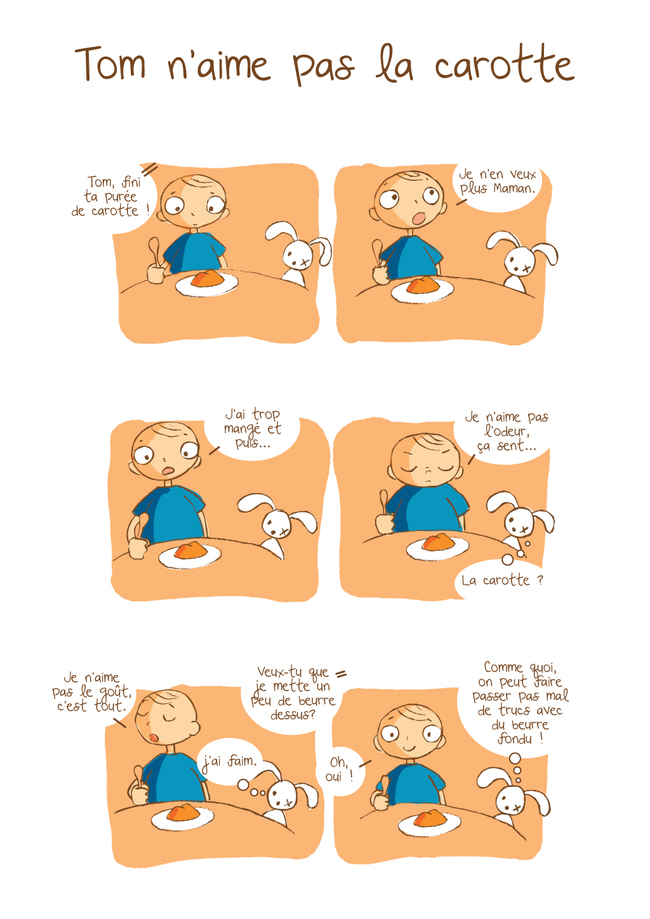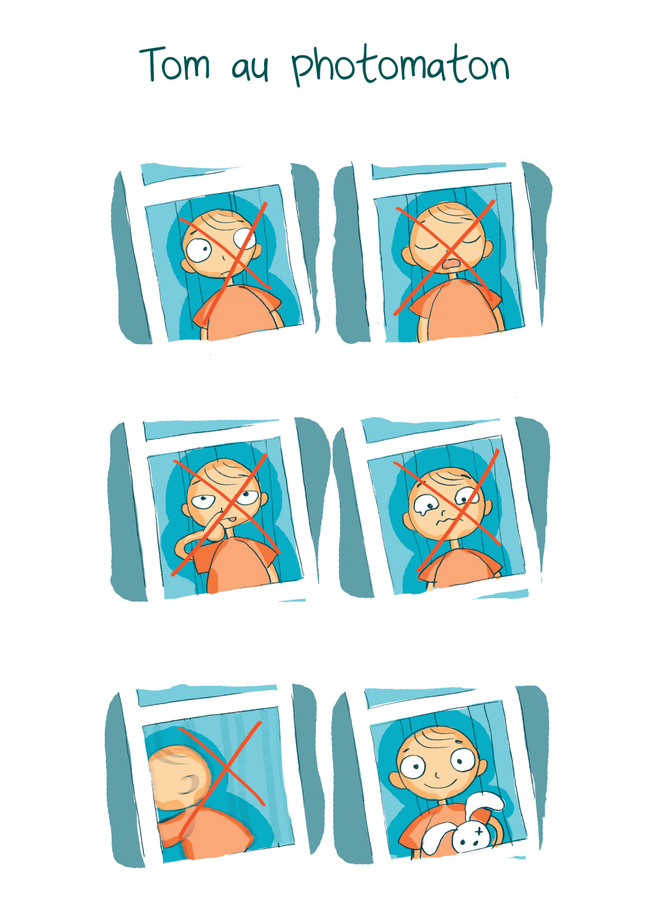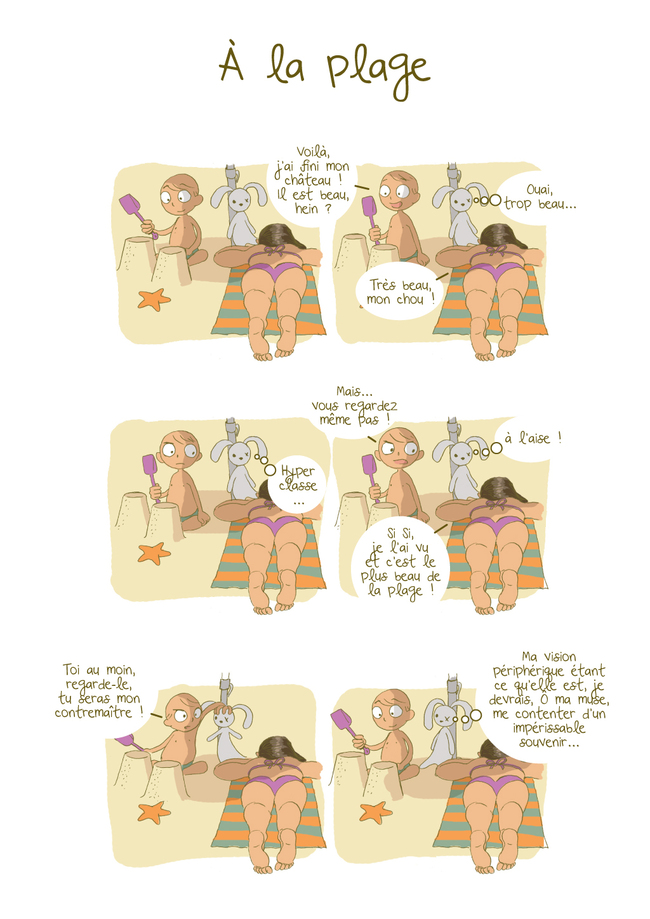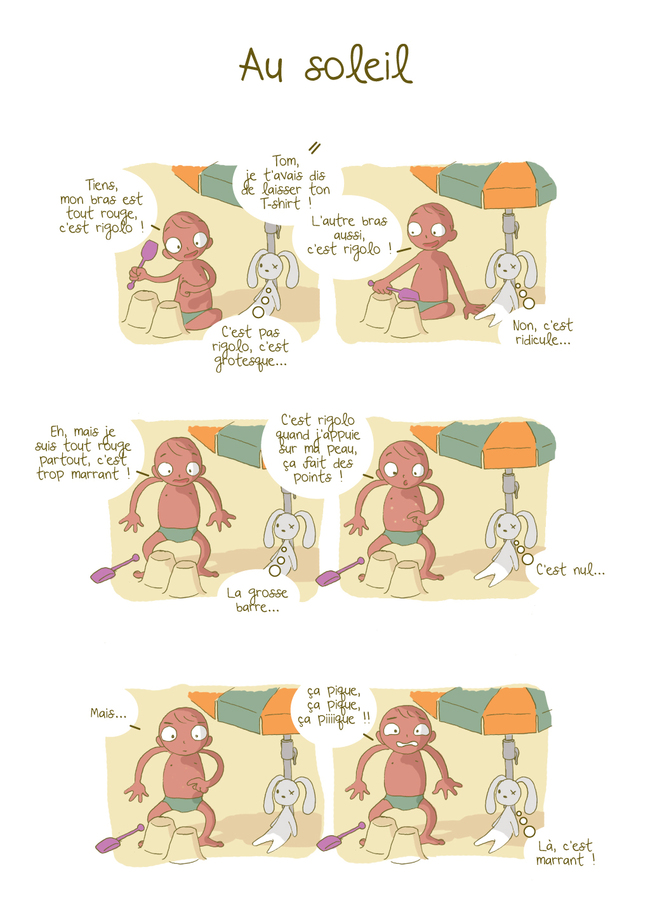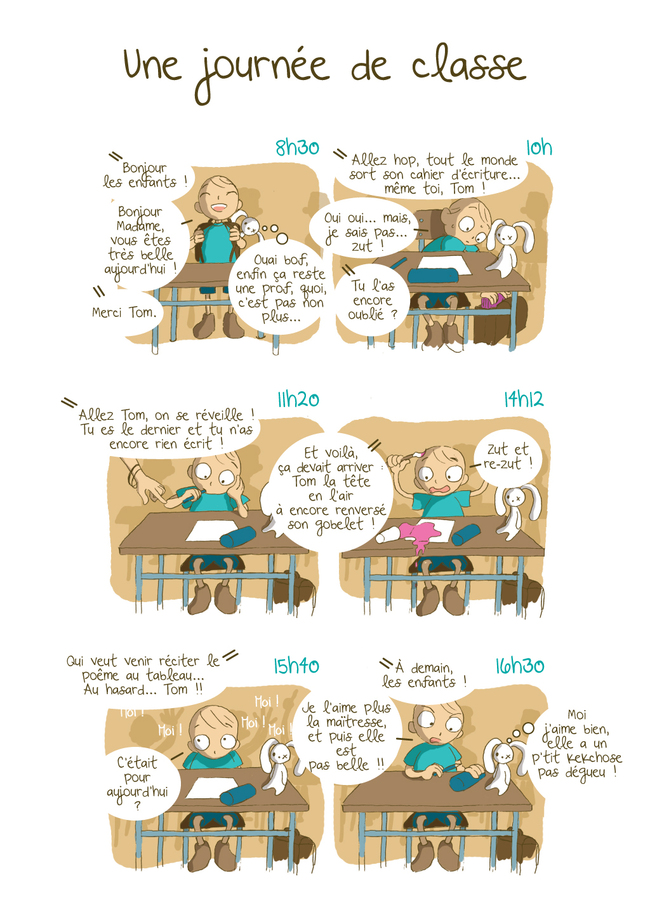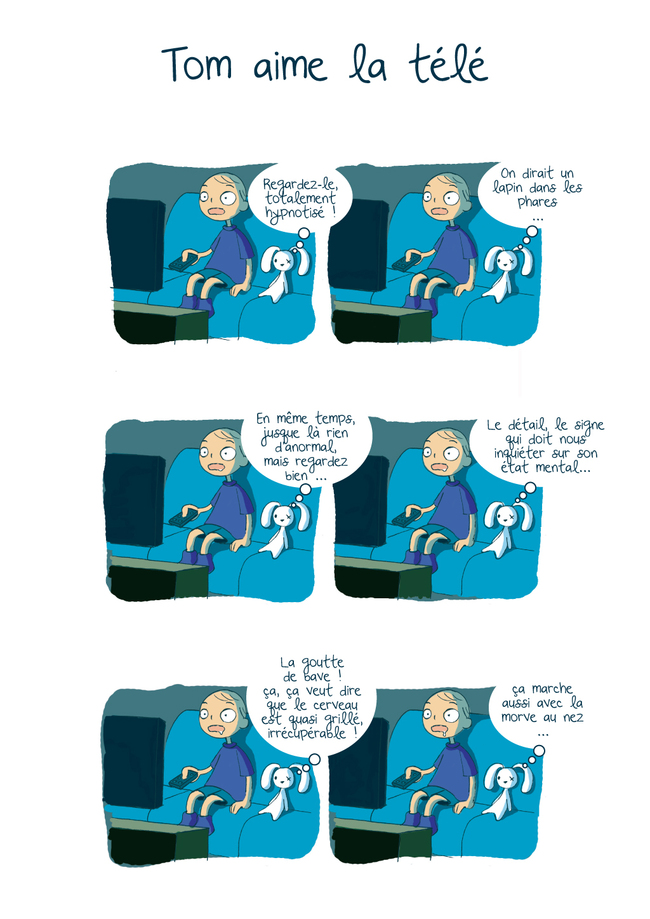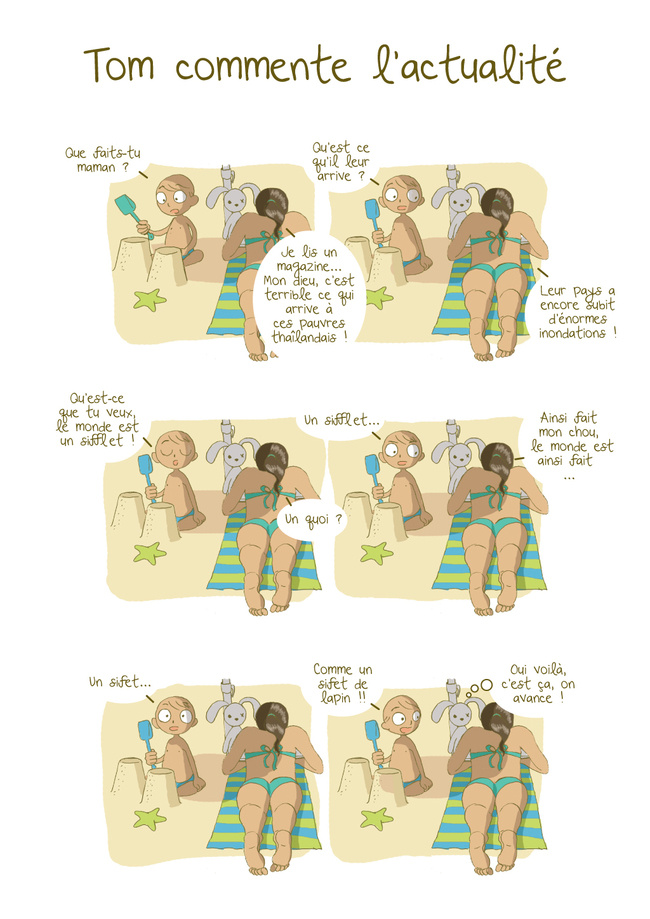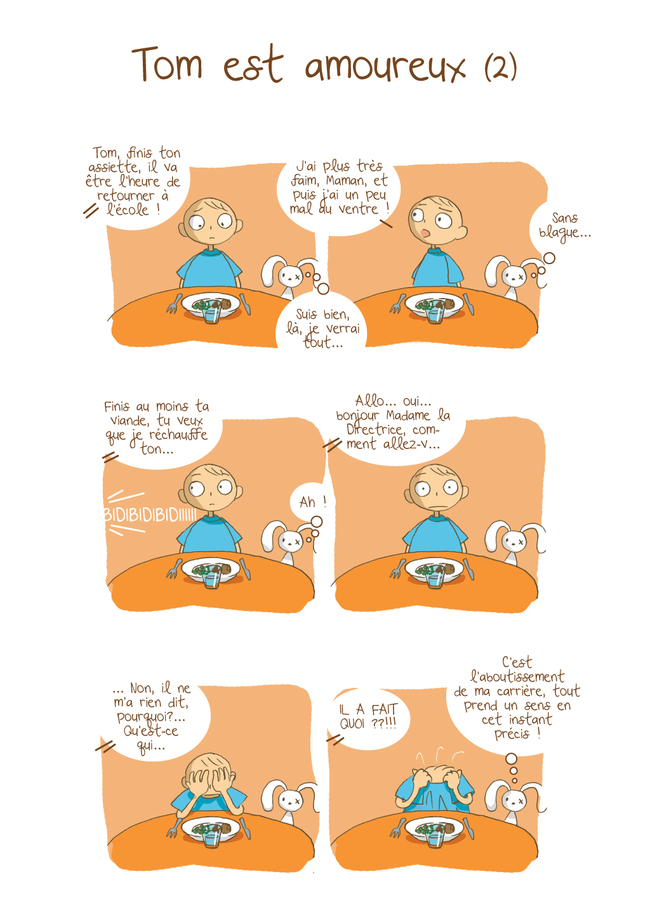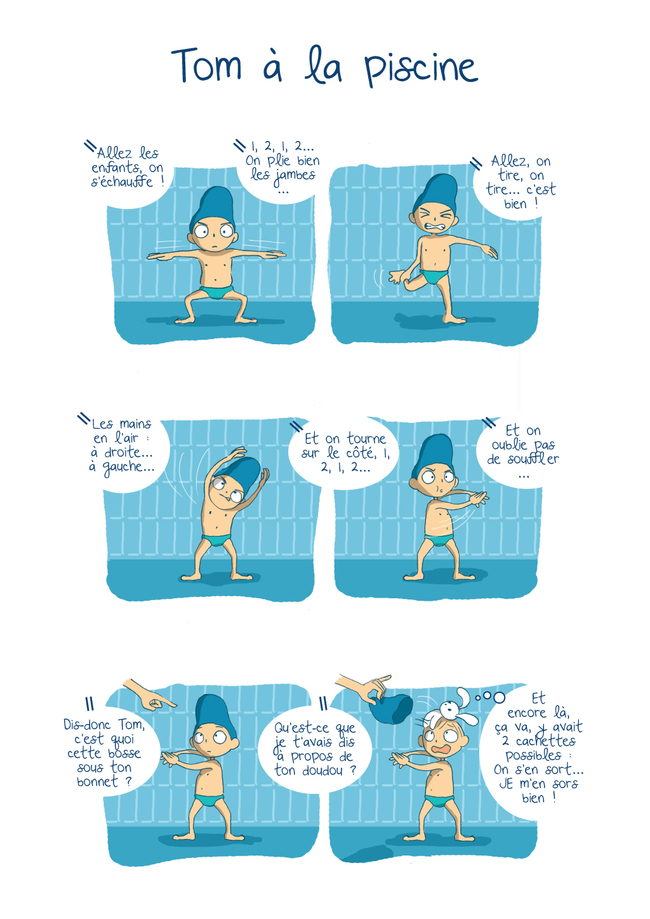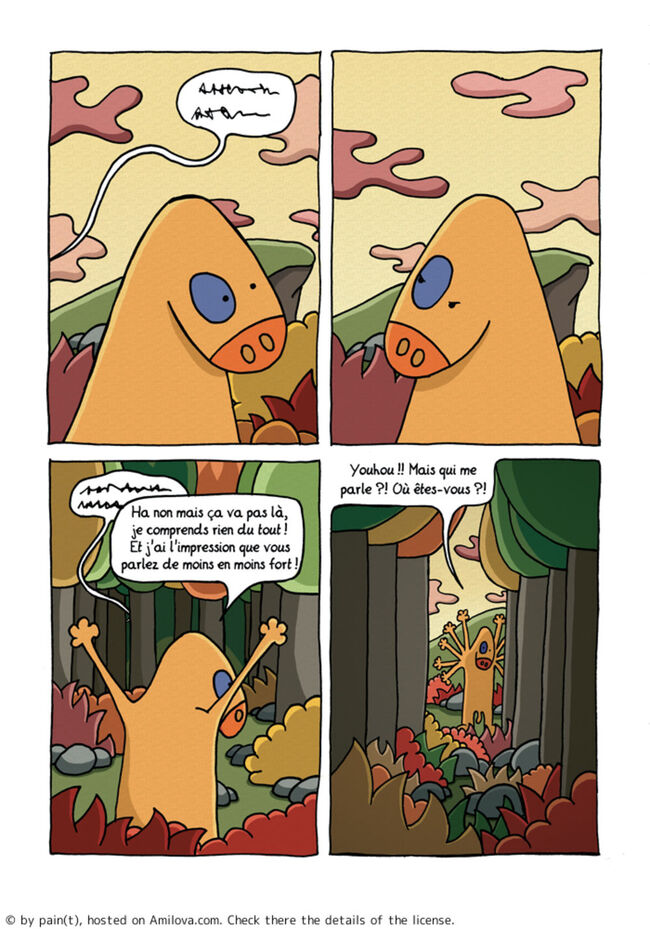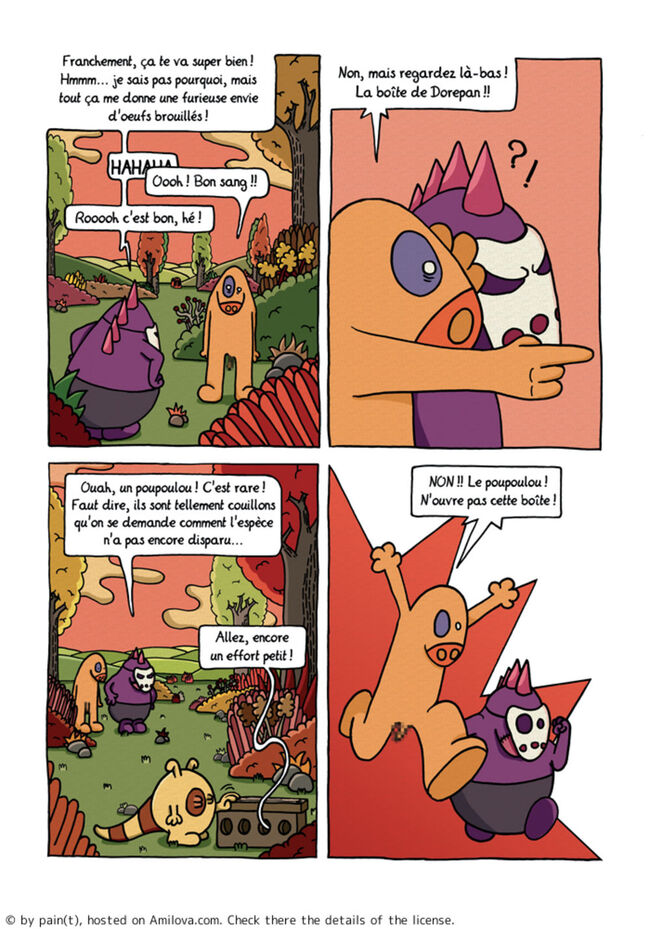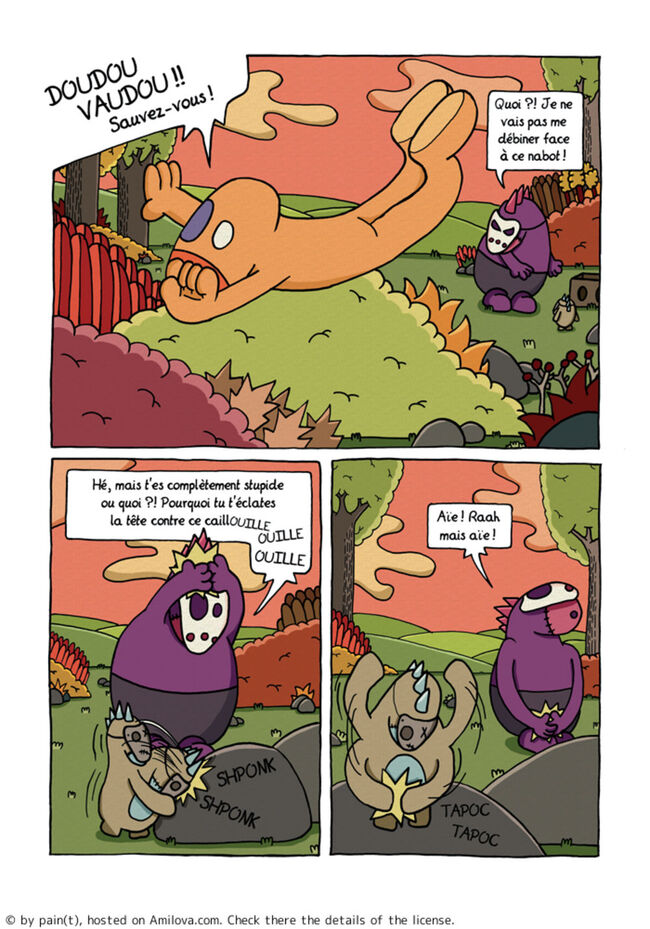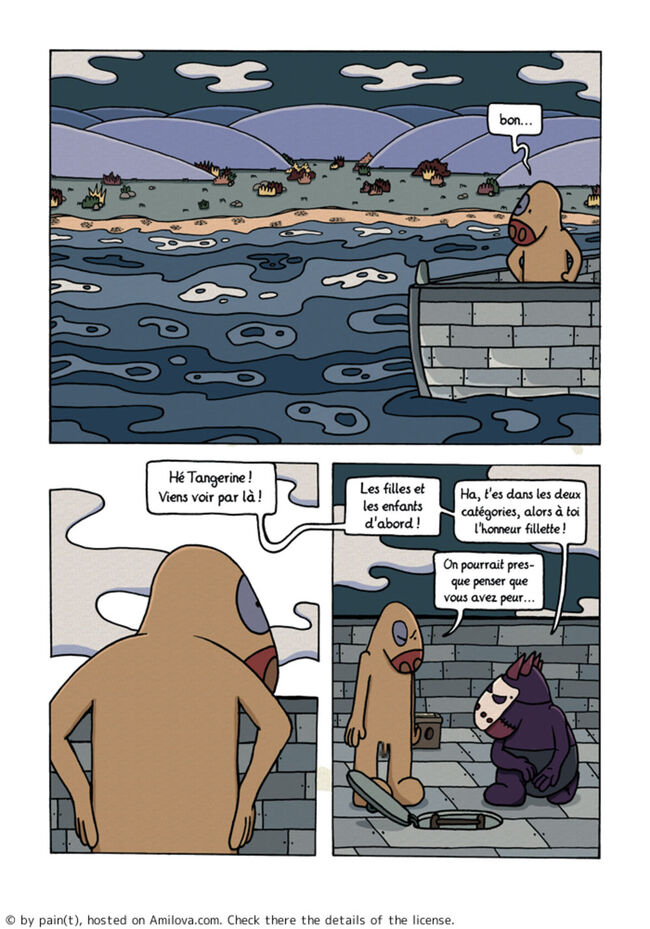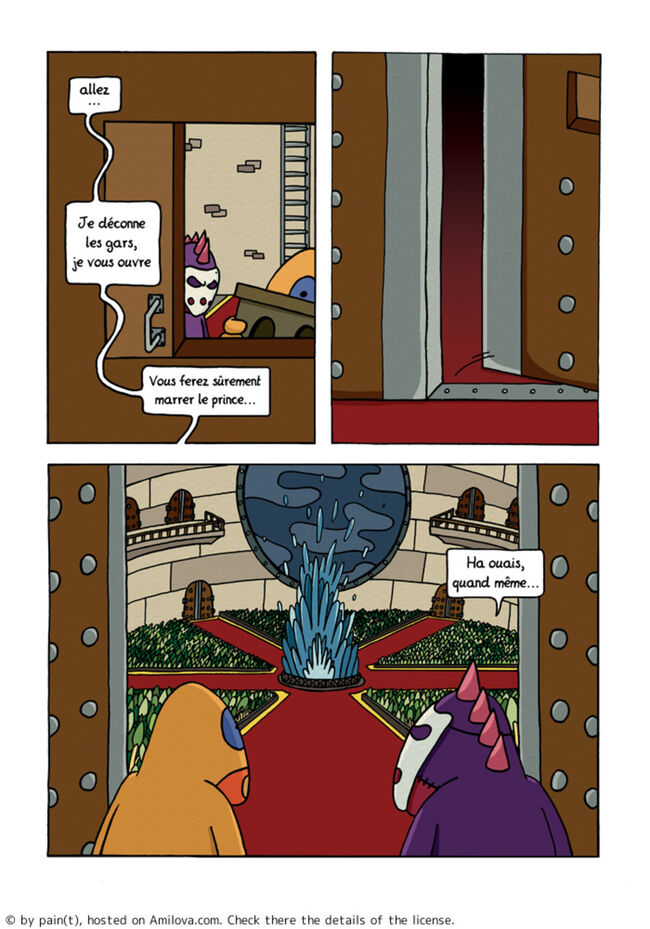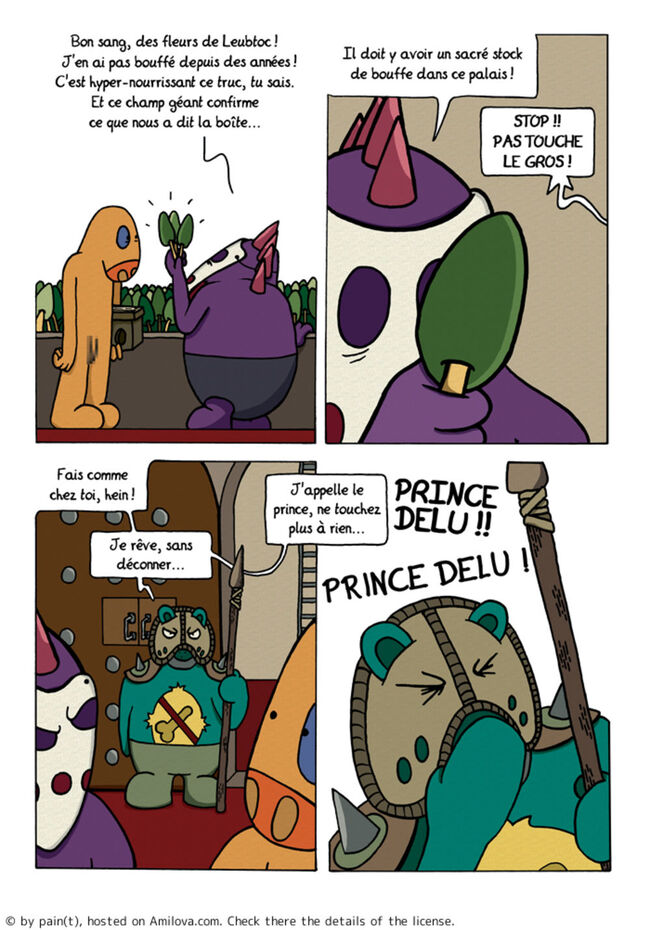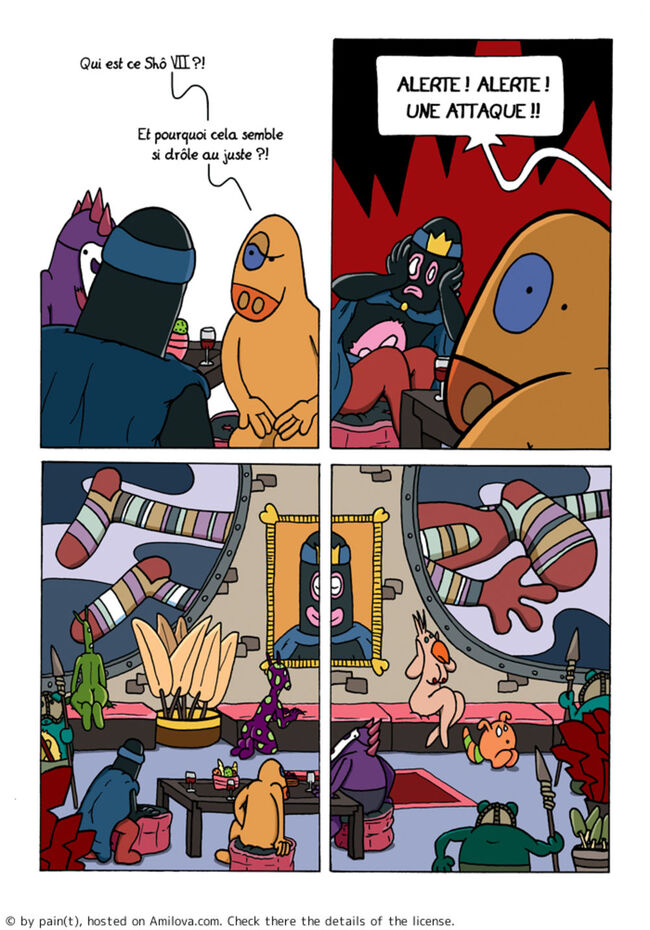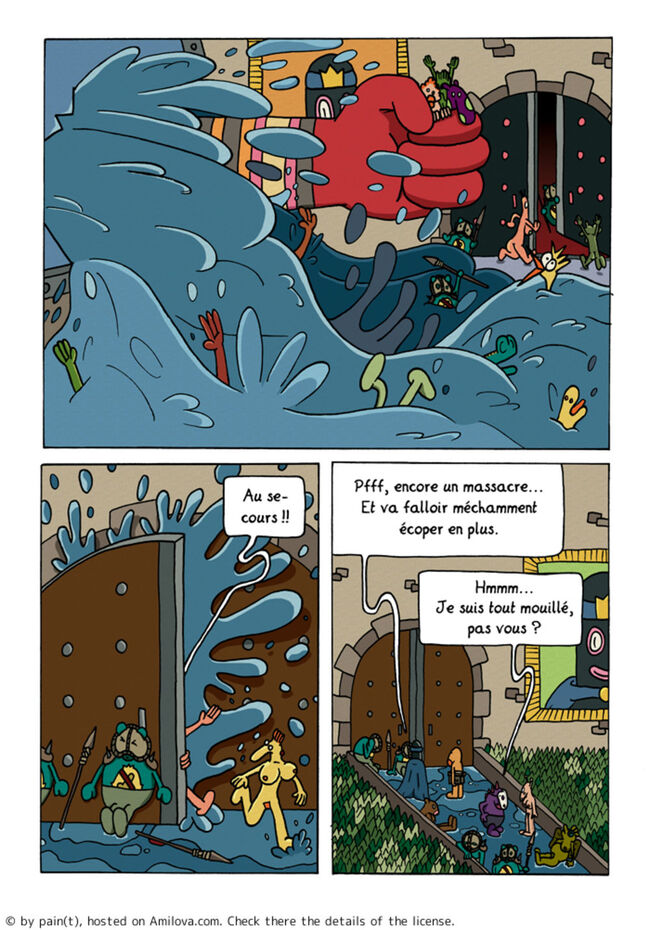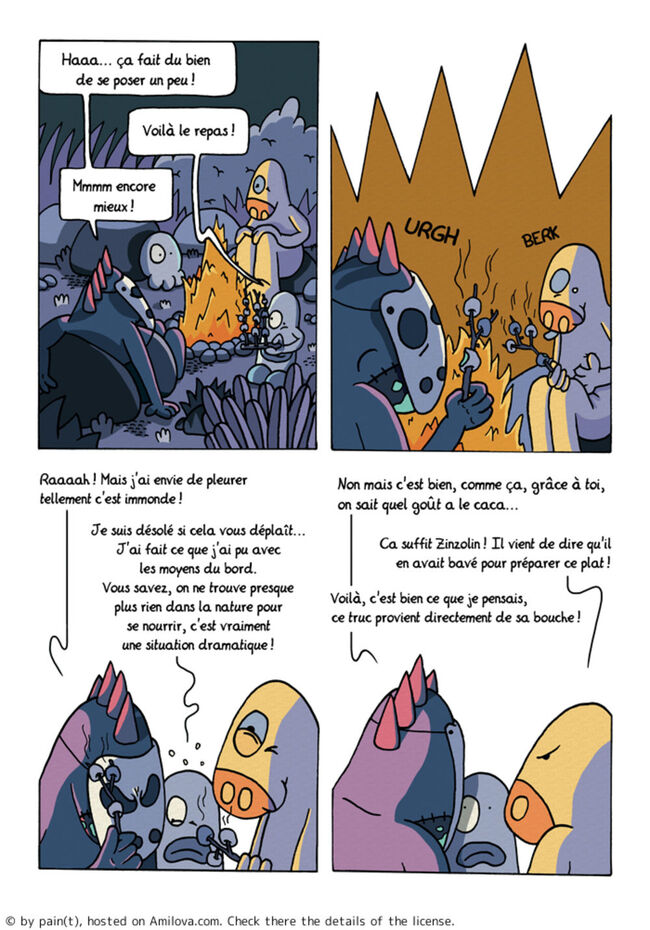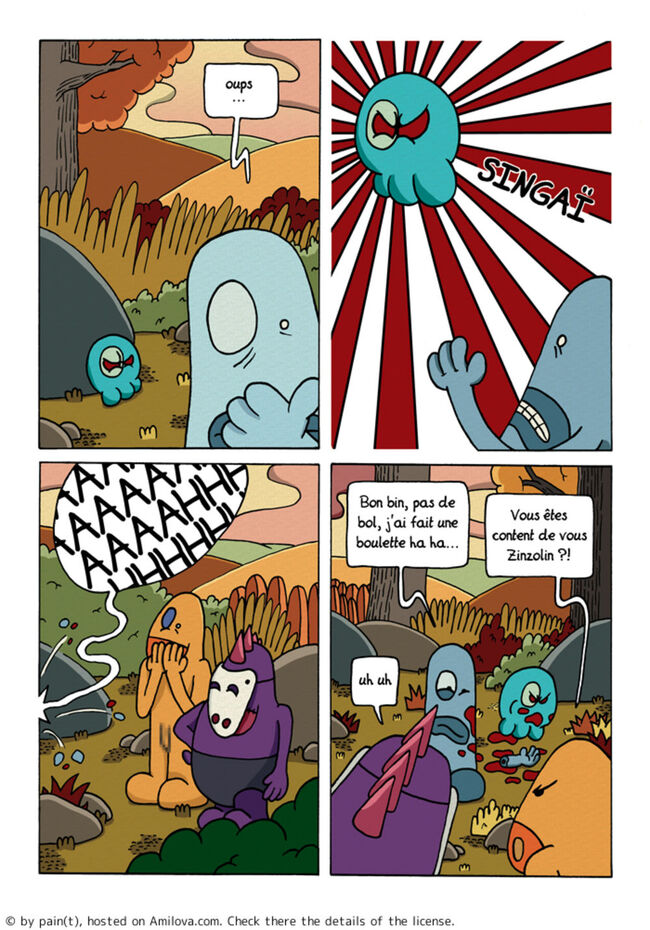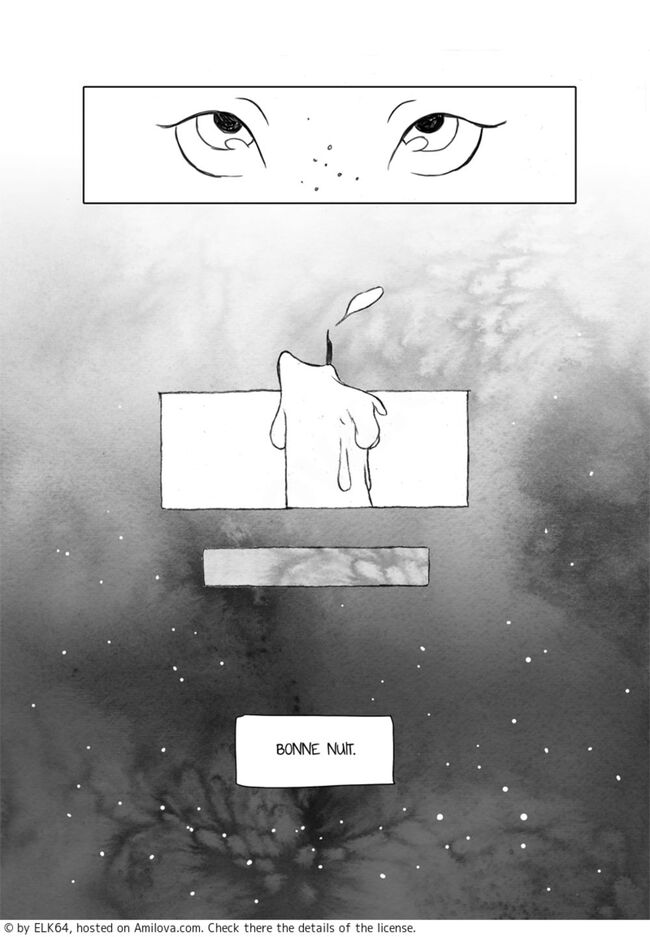-
-
-
Le Vieux de la montagne
Judith Gautier


Dédicace
À
CH. CLERMONT-GANNEAU
Témoignage d’une fraternelle affection.
J. G.
I
On faisait silence autour du roi, qui s’était assoupi. Mais un brouhaha de rires et de cris, de chocs singuliers montait, par intermittences, jusqu’à la terrasse, qu’abritait un velum de soie.
Les dames, appuyées au rebord de pierre, se penchaient pour mieux voir, et, auprès d’elles, avec un sourire un peu dédaigneux, les chevaliers regardaient aussi.
Par-dessus le rempart de Jérusalem, dans un méplat du terrain qui dégringole presque à pic jusqu’à la vallée de Josaphat, on pouvait suivre des yeux les évolutions d’un groupe d’écuyers et de damoiseaux jouant à la quintaine.
À cet endroit, la muraille, dominée par le palais royal et le massif du Temple, formait un angle rentrant et projetait une ombre très allongée, dans laquelle, à l’abri du soleil, on avait établi le jeu. Le mannequin, couvert d’armes sarrasines, était solidement attaché à des pieux et faisait face au jouteur, qui, la lance en arrêt, piquait son cheval et tâchait de pourfendre l’adversaire inanimé. Les rudes chocs bosselaient la cuirasse immobile, ou bien l’arme se brisait, ne laissant qu’un tronçon dans les mains de l’assaillant. Quelquefois un élan maladroit désarçonnait le cavalier, qui s’abattait sur le sol avec un grand bruit de métal froissé. Alors, sur la terrasse royale, les belles curieuses se rejetaient en arrière, étouffaient un rire et disaient à demi-voix :
— En voici un qui, de longtemps, ne sera pas digne de chausser les éperons !
Il y avait là trois très nobles dames : la princesse Sybille, fille du roi, blonde et fière ; Estiennette de Naplouse, veuve d’Homphroy du Toron et remariée à Milon de Plancy, cousin du souverain ; rieuse, très jeune encore : trente-deux ans à peine, elle a, de son premier mariage cependant, un fils déjà chevalier ; Eschive de Galilée, orgueilleusement belle, riche et fastueuse, mère honorée d’une lignée nombreuse. Auprès d’elle, son nouveau mari, le comte Raymond de Tripoli, lui chuchote à l’oreille des aveux d’une tendresse un peu brutale, dont elle se défend par de brusques mouvements d’épaules, tout en riant en dessous.
Raymond III, comte de Tripoli, est d’assez petite taille, maigre, avec des épaules carrées ; il a la face basanée, le regard aigu, la lippe pendante, les cheveux plats et châtains. C’est un homme terrible au combat, tellement que les infidèles l’ont surnommé le « Satan des Francs » ; mais il ne sait pas grand’chose, hors du métier des armes, malgré les efforts qu’il a faits pour s’instruire, pendant une captivité de huit années chez les Sarrasins.
C’est en apparence seulement que la princesse Sybille s’intéresse au tournoi des écuyers. Ses regards glissent de côté et s’arrêtent avec insistance sur un chevalier qui se tient à l’écart, absorbé dans une rêverie, l’air grave et le front baissé. Il est très jeune, mais d’aspect austère, large d’épaules, mince de taille, de haute stature, avec des yeux clairs et des cheveux blonds ; le type parfait de la mâle beauté, à ce que proclament toutes les femmes de la cour. Mais pourquoi est-il si froid et si réservé, si peu semblable aux autres chevaliers, dont les folies et les désordres vont souvent jusqu’au scandale ?
Sybille a, tout à coup, l’idée, qu’il nourrit peut-être le projet de prononcer des vœux, et cette supposition l’encolère à tel point qu’un flot de sang empourpre ses joues et que, résolument, elle marche vers le jeune homme pour le questionner. Arrivée près de lui, cependant, elle se calme, et ne dit pas ce qu’elle voulait dire.
— Que regardez-vous donc avec tant d’intérêt, messire Hugues de Césarée ? Ce n’est certes pas la quintaine que l’on joue au pied des murs.
Dans un sursaut, il se retourne, puis sourit à la princesse et lui répond respectueusement. Ce qu’il regarde, c’est un convoi de pèlerins, qui arrivent d’Europe, et entrent à Jérusalem par la porte de Josaphat. Ils vont en procession, avec croix et bannières, les uns nu-pieds, les cheveux couverts de cendres, d’autres se traînant sur les genoux, quelques-uns enveloppés d’un linceul qui, après avoir touché le Saint-Tombeau, sera conservé comme une relique et, lors de leur mort, les ensevelira. On voit la longue file s’engager, une fois la porte franchie, dans une petite rue montueuse, puis disparaître sous des voûtes, dans la direction du Saint-Sépulcre.
— Des pèlerins !
Sybille fronce le sourcil. L’appréhension du monastère lui revient, et elle demande d’une voix altérée :
— Est-il vrai que vous voulez prendre les ordres ?
— Qui dit cela ?
— Personne ne le dit, si ce n’est la pureté de vos mœurs et votre grande vertu.
Hugues répond en riant :
— Je n’ai pas plus de vertu que beaucoup d’autres ; mais, si je voulais me consacrer au Seigneur, je chercherais le désert, plutôt que de me retirer dans un de ces monastères, fondés par des saints, et qui sont devenus, aujourd’hui, de véritables lieux de perdition.
— Il est vrai qu’il y a de grands pécheurs !…
La princesse se tait, trouvant la causerie mal engagée, un peu trop grave. Hugues, cependant, promène un regard irrité sur la cité sacrée ; il désigne, de son bras tendu, un groupe d’édifices, dominé par une coupole qui flamboie au soleil.
— Voyez, dit-il, avec quel insolent orgueil les Frères Hospitaliers ont élevé ces somptueux monuments, cette basilique, dont le dôme si haut se dresse aux portes mêmes du Sépulcre, qui en est tout écrasé. Et quelle vie mènent-ils derrière ces murs, qui abritent des prostituées ? C’est honte d’en parler seulement ! Ils sont en révolte contre le clergé, auquel ils refusent de payer la dîme, et, d’ailleurs, il n’y a plus rien sous le ciel qui leur inspire du respect, pas même le vénérable sang du Sauveur.
Sybille se récria.
— Ne savez-vous pas, reprit Hugues, ce qu’ils viennent d’imaginer pour troubler le Patriarche de Jérusalem quand il officie au Saint-Sépulcre ?
— Quoi donc ? messire.
— Aussitôt que le bon prêtre commence à prêcher aux fidèles, les chevaliers de l’Hôpital se mettent à sonner leurs grosses cloches à toute volée et sans relâche. Le Patriarche a beau hausser le ton, crier, hurler même : il ne parvient pas à se faire entendre.
— C’est grand’pitié, vraiment, dit Sybille, qui ne put s’empêcher de rire. Mais elle se mordit les lèvres et reprit :
— Le Patriarche s’est plaint, j’imagine ?
— Il s’est plaint, oui ; les Hospitaliers ont répondu qu’ils feraient pire encore. Ils l’ont fait. Ce matin, pendant la messe, ivres de fureur, ils sont entrés, en armes, dans le très saint sanctuaire, comme si c’était une caverne de larrons, et ont osé lancer des flèches.
— Un autre que vous me rapporterait cela que je ne le voudrais croire, s’écria la princesse.
— Vous pouvez voir ces flèches, comme je les ai vues moi-même. On les a réunies en faisceau, et suspendues devant le calvaire, pour témoigner de cette offense.
— Lancer des flèches dans le sépulcre du Sauveur ! dit Sybille en baissant la tête. Et ce sont les soldats du Christ qui font de telles choses ! Ah ! le désordre est grand dans la cité sainte !… Et notre sexe non plus n’est pas exempt de blâme. Ne voit-on pas, chaque jour, les nonnes du couvent de Sainte-Anne se rendre aux bains publics, où leurs amants les attendent ?… Mais il faut avouer aussi que ce climat est bien terrible. Il exalte l’esprit, brûle le sang, obscurcit l’âme : on n’est coupable qu’à moitié. Et puis toutes ces richesses qui, affluent, toutes ces tentations… Comment résister ?… Il y a des âmes fortes cependant : la vôtre, chevalier, car vous êtes insensible aux plus grandes séductions.
Hugues se détourna, le cœur oppressé, les yeux troubles, et il dit, d’une voix à peine distincte :
— Qui peut savoir ce qui se cache dans une âme ?
— Attention ! dit Sybille, en se retournant, le roi s’éveille.
En effet, sur son lit de repos, repoussant les carreaux soyeux, qui roulèrent jusqu’à la mosaïque du sol, Amaury s’étirait les bras et bâillait.
À cause de la chaleur extrême, il n’était vêtu que d’une robe blanche, bordée de pourpre, à larges manches et négligemment nouée à la taille. Ses cheveux, blond clair, longs et ondulés, s’étaient mis en désordre, froissés par l’oreiller, et le roi, un peu essoufflé et hagard, cherchait nonchalamment de sa main, à les rajuster.
La princesse s’élança vers lui :
— Eh bien, père, cette petite fièvre ?
— C’est passé ! Cette courte sieste m’a guéri, bien que mon sommeil ait été peuplé de rêves.
— De mauvais rêves, sire ? demanda Guillaume, archidiacre de Tyr, grand-chancelier du royaume, qui, assis auprès du roi, avait replié le manuscrit qu’il lisait, en voyant le souverain s’éveiller.
— Voudrais-tu expliquer les songes, comme le fit Joseph dans sa prison, au pays d’Égypte ? demanda Amaury, qui zézayait un peu en parlant. En ce cas, je t’avertis qu’il en est, parmi les miens, de fort aimables que je n’oserai guère exposer à un saint homme tel que toi.
Et le roi se laissa aller à un rire désordonné, qui secoua du haut en bas ses chairs opulentes et molles.
Amaury avait alors trente-six ans et régnait depuis dix années sur le royaume chrétien de Jérusalem. Il était beau et agile, en dépit de l’ampleur de son corps. Sa vaste poitrine, aux mamelles charnues, ses bras ronds, ses puissantes épaules, lui donnaient un aspect herculéen, et, malgré la carnation rose et blanche de son visage, où frisait une abondante barbe blonde, son expression était énergique et majestueuse, grâce à la forme aquiline du nez et à l’éclat du regard.
Tous s’étaient réunis et groupés autour du roi. Tiennette de Naplouse l’éventait avec une feuille de palmier, et la belle Eschive lui offrait à boire.
— Non, non, comtesse, dit-il, en repoussant le gobelet, mon médecin me recommande la sobriété à cause que je suis trop gros.
— Un peu de neige parfumée de roses ! Voilà quelque chose de substantiel ! s’écria Sybille.
— Cela ne romprait même pas le jeûne, dit Eschive.
— Vous croyez ?… Qu’en pense Guillaume ?
— Je viens d’en boire, sire, répondit l’évêque ; hâtez-vous, car la neige mollit déjà.
Le roi but le sorbet lentement.
— La chaleur, la fièvre, l’attente, cela altère, dit-il, en rendant le gobelet.
Et il ajouta, en voyant que le soleil était encore haut dans le ciel :
— Cette journée ne finira pas !
Sybille s’agenouilla sur les coussins, près de son père.
— Qu’attend donc le roi ? demanda-t-elle.
— Un ambassadeur, ma fille.
En même temps, Amaury échangea un regard avec l’évêque et, par la gravité de son visage, fit comprendre qu’il n’en voulait pas dire davantage.
Il interpella Hugues de Césarée.
— Assieds-toi sur ces carrés, Hugues, et, pour plus promptement égrener les heures, conte-nous quelque histoire.
Tiennette fit là moue et dit tout bas à Raymond de Tripoli :
— Hélas ! voilà le roi qui cède encore à sa manie ! Nous allons entendre une histoire déjà vingt fois contée.
— Il est trop avare pour payer un jongleur qui nous dirait du nouveau.
Mais Eschive le poussait du coude pour le faire taire. Le roi insistait :
— Allons ! Hugues, toi qui parles un si beau langage.
— C’est par trop grande indulgence que vous dites ainsi.
— Ah ! je t’envie ce don du ciel, mon beau chevalier, moi qui bredouille si maladroitement. Mon frère, le roi Baudouin — que Dieu ait son âme ! — était cependant plus éloquent qu’aucun ; mais je n’ai pas hérité de cette qualité en lui succédant.
— Vos pensées, sire, dit Guillaume, sont hautes, et sages, mais si abondantes en votre esprit qu’elles se pressent en tumulte quand elles veulent passer par vos lèvres.
— Admettons que c’est pour cela, dit Amaury en souriant. Allons, Hugues, j’attends. Si je parle mal, en revanche, j’excelle à écouter et j’aime par-dessus tout les histoires.
— Mais, seigneur, je ne sais laquelle dire.
— Eh bien, redis-nous ton entrevue avec le calife d’Égypte, quand tu fus envoyé par nous en ambassade pour confirmer le traité de paix.
— J’obéis, sire, dit le jeune homme en saluant le roi.
Il se recueillit un instant, tandis que tous s’installaient à l’aise pour l’écouter, ou penser à autre chose.
Il commença, avec un peu d’emphase, sans élever la voix :
— « Nous étions au Caire, dans la salle du trône, tout emplie de gens d’armes et de princes païens, lesquels murmuraient, sourdement, scandalisés qu’ils étaient de notre présence et de la volonté que nous avions de voir le calife en personne. Cela à peine est permis aux plus nobles d’entre eux. Mais nous étions très fermes dans notre vouloir, et le calife allait céder. En face de nous, un rideau magnifique, tout couvert d’or et de perles, cachait le fond de la salle. Il se replia tout à coup, et, assis sur un trône d’or, le souverain parut devant nos yeux. Tous se prosternèrent comme au pied du trône de Dieu ; seuls, nous, les Francs, après un salut courtois, nous restâmes debout, regardant en face le calife El-Adhed-ledin-Illah. C’était un adolescent, beau de visage, brun de peau, aux cheveux noirs, à la barbe naissante. Il semblait très curieux de nous voir et ne put retenir un sourire de sympathie en s’apercevant, peut-être, que j’étais d’âge à peu près égal au sien. Avec grande humilité, son vizir, Schaour, vint lui baiser les pieds, puis lui expliqua, en peu de mots, le but de notre ambassade, et le contenu des pactes et alliances accordés en son nom et qu’il devait confirmer. À cela le calife répondit, très gracieusement et avec beaucoup de calme, qu’il était prêt à accomplir de point en point ce qui avait été convenu par ses ambassadeurs entre lui et son cher ami le roi de Jérusalem. Mais nous, nous exigions qu’il répétât lui-même le serment de foi inviolable, en me donnant sa main en signe de fidélité. Cette prétention souleva un grand tumulte, parmi les Égyptiens, car elle était contre leurs usages et offensait la majesté royale. Après de longues délibérations, le vizir déclara que son maître consentait à nous donner sa main, mais couverte d’un voile. Alors, au grand ébahissement de l’assistance, qui ne pouvait comprendre tant d’audace, devant la majesté royale, je dis, d’une voix haute et tranquille : « Seigneur, la foi vraiment loyale ne cherche pas les cachotteries. Celle par laquelle les princes ont coutume de s’engager ne peut s’affirmer que par des choses nues et ouvertes. Tout ce qui, par l’entremise de la foi, est inséré dans les pactes doit être lié et délié avec sincérité, sans qu’il y ait ni fard ni déguisement d’aucune sorte. C’est pourquoi ou vous donnerez la main nue ou nous serons contraints de penser que, de votre part, il y a quelque feinte et que votre foi n’est pas aussi pure et entière qu’il convient qu’elle soit. » En entendant cela, le calife, vivement, rejeta le voile et mit sa main droite, nue, dans la mienne, en souriant encore, ce qui sembla mécontenter les Égyptiens, et, serrant ma main d’une étreinte loyale, il répéta le serment après moi, me suivant de mot en mot et de syllabe on syllabe. Cela fait, nous nous retirâmes, et, presque aussitôt, le calife nous envoya des présents nombreux et magnifiques. » Voilà, seigneur le récit que vous désiriez entendre.
— Oui, dit Amaury en soupirant, et cette alliance n’a pas donné tout le bien que nous espérions. Que de rudes combats ! Que de luttes à l’issue incertaine ! Que de fatigues ! Que de tourments ! Et, aujourd’hui, le jeune calife n’est plus ; la race des Fathimites s’est éteinte en lui, et Saladin a usurpé le pouvoir au nom du calife Abasside résidant à Bagdad. Cependant l’on pourrait encore conquérir l’Égypte ; mais je n’ai pas les forces qu’il faudrait, et mon oncle, l’empereur Manuel Comnène, tarde bien à m’envoyer le secours qu’il m’a promis.
— J’ai reçu son serment, sire, dit Guillaume ; il le tiendra ; la flotte qu’il vous destine appareille peut-être.
— Le ciel t’entende ! s’écria le roi. L’Égypte, c’est là mon souci, mon cuisant désir !
La princesse Sybille, assise sur des coussins, ses belles nattes dorées pendantes sur sa poitrine et jusqu’à terre, avait écouté Hugues avec un extrême plaisir et semblait l’écouter encore après qu’il s’était tu.
— Vous ne m’avez jamais conté, seigneur, dit-elle, pour le faire parler de nouveau, vos aventures quand vous fûtes fait prisonnier.
— Il ne le peut, dit le roi, car il serait forcé de se louer lui-même. Il lui faudrait rapporter avec quelle furie magnifique, il se rua, suivi seulement de quelques-uns, sur la compagnie que commandait Saladin et comment, resté seul vivant, accablé par la multitude, il fut désarmé et pris, après une lutte terrible.
Sybille joignit les mains et leva les yeux au ciel, tandis que le jeune homme, modestement, courbait la tête.
— Est-il vrai, seigneur de Césarée, demanda Eschive, que, tandis qu’il vous tenait captif, Saladin vous ait contraint à l’armer chevalier ?
— Il ne m’y a pas contraint, dame, mais il m’en a très courtoisement prié.
— Et vous le fîtes ?
— Certes. Je lui ai chaussé l’éperon d’or et enseigné toutes les règles de notre chevalerie, dont il fut fort émerveillé.
— Un infidèle !
— S’il n’eût pas été vide de baptême, c’eût été là un vaillant chevalier et bien digne de l’être.
— Et que vous arriva-t-il après cela, messire ? demanda Sybille.
— Saladin me tint quitte de ma rançon et me donna la liberté. Je revins au camp de Sa Majesté notre roi…
Hugues se tut. Invinciblement, il s’enfonça dans une songerie, oublieux de ceux qui l’entouraient. Il revit les contrées charmantes, que l’armée avait traversées, alors, pour regagner les terres chrétiennes, ces peuples singuliers, avides de voir les soldats du Christ, ces troupes de femmes voilées, dont les longs yeux noirs les dévisageaient, et qui, à la moindre alerte, s’enfuyaient en poussant des cris aigus. Il se souvint de l’ardente curiosité qui le tenait, lui aussi, et de la promesse qu’il s’était faite de ne pas quitter le pays musulman sans avoir aperçu, de gré ou de force, le visage d’une païenne. Et cette résidence d’été, d’un prince dont il ne savait pas le nom, auprès de laquelle on campa à la dernière étape, avant les frontières chrétiennes ! C’est là que sans cesse sa pensée retourne. Les murailles étaient hautes, infranchissables, et pourtant elles l’attiraient, et, sans relâche, il rôdait autour d’elles. Un jour, une voix délicieuse s’envola d’entre les arbres, franchit la muraille, vint caresser l’oreille de l’indiscret chevalier. Elle chantait, cette voix, un chant fier et ardent que le rebab accompagnait, et Hugues crut entendre un appel impérieux, irrésistible. Sans se rendre compte de ce qu’il osait faire, s’aidant des lierres et des lichens, risquant, sa vie de plusieurs façons, il avait escaladé le mur, il était descendu dans ce jardin mystérieux. Mais la voix avait cessé de chanter. Au hasard, alors, il avait erré sous les épaisses frondaisons, tapi dans les buissons, se retenant de respirer, Puis, tout à coup, de l’autre côté d’un ruisseau, qui courait sur des fleurs, dans un kiosque de marbre et d’or, dont l’eau caressait les marches, il avait vu la chanteuse, pour son malheur éternel !
Certes, c’était Satan qui l’avait incité à cette action perverse, pour le détourner de Dieu et perdre son âme. Maintenant, elle le hantait nuit et jour cette vision, le torturait sans relâche, et ce n’était pas naturel, une pareille frénésie d’amour, brûlant son sang brusquement, comme le venin d’une flèche empoisonnée. Il reconnaissait bien là l’œuvre du diable et s’était imposé de rudes pénitences pour échapper à la damnation ; mais c’était en vain, et il se mourait lentement à l’idée qu’Elle ne saurait même pas qu’il existait, qu’il ignorait tout d’Elle, jusqu’à son nom, et qu’il ne la reverrait jamais.
Comme malgré lui, il murmura :
— Jamais ! jamais !
Et cette certitude lui causa une telle douleur que des larmes roulèrent dans ses yeux.
— Doux Sauveur ! Qu’avez-vous ? s’écria Sybille, qui vit ces larmes. Quelles désolantes pensées navrent votre esprit ?
Hugues se mordit les lèvres pour retenir un sanglot. Il chercha une réponse évasive.
— Je songeais, dit-il, à mes compagnons d’armes, morts auprès de moi, dans ce combat dont nous parlions, et que je ne reverrai plus.
— Ils combattaient pour le Christ et sont dans le paradis, tout environnés de gloire. Vous les reverrez un jour.
— Si l’on était bien sûr de cela, il serait plus aisé de se consoler, dit le roi ; mais qui peut savoir ?…
— Sire ! sire ! s’écria Guillaume, voici une pensée impie et sacrilège.
— Que veux-tu, Guillaume ? les pensées vous viennent on ne sait comment et sans demander permission.
Une fanfare joyeuse qui éclata au sommet de la tour de David arrêta la réponse sur les lèvres du chancelier.
Le roi se leva vivement, marcha jusqu’au rebord de la terrasse, les regards tournés vers le sommet de la forteresse qui dominait toute la ville. Une seconde fanfare retentit et, à un angle du donjon, un étendard se déploya.
— Mon ambassadeur est signalé, s’écria Amaury avec une expression de contentement. Il vient, c’est certain maintenant, et, vraiment, j’en suis aise.
— Réjouissons-nous donc avec le roi, dit Sybille d’un air boudeur, tout en ignorant la cause de sa joie.
— La curiosité est un péché, ma fille, dit Amaury en riant ; mais je te pardonne à cause de ta grande jeunesse.
— Le vrai pardon, ce serait de satisfaire la curiosité, ce qui, du même coup, supprimerait le péché.
— Vraiment ?… Eh bien, j’y consens. Je peux parlera présent ; tout à l’heure je n’étais sûr de rien… Ah ! voici le connétable Homphroy du Toron qui, selon mon ordre, va recevoir le nouveau venu, hors des murs, ajouta-t-il, en voyant un petit groupe de cavaliers courir vers les remparts et franchir la poterne des Tanneurs.
— Oh ! mon fils ! combien gracieusement vous chevauchez ! s’écria Tiennette de Naplouse, en envoyant dos baisers au jeune Homphroy, que l’on distinguait mal, cependant, au milieu de la poussière soulevée par les chevaux.
— Père ! père ! tu as promis, dit Sybille, qui saisit la main du roi pour le tirer vers le lit de repos.
— Encore ! gémit Tiennette. La princesse est bien fille de son père !
— L’histoire est neuve au moins, cette fois, dit Raymond.
Amaury alla se rasseoir, et les trois femmes, auprès de lui, reprirent leurs places.
— Il me faut vous prévenir, mes belles écouteuses, que mon histoire ressemble beaucoup à un conte d’enchanteur. Si je la dis mal, pardonnez-le-moi.
— Un conte d’enchanteur ! s’écria Eschive, qui, lorsque son mari tournait la tête, échangeait d’ardents regards avec le roi.
— Écoutez donc : C’était la semaine passée ; je me promenais dans le jardin du palais pour goûter la fraîcheur du matin et je lisais, tout en marchant, un curieux manuscrit qui traitait de la navigation chez les Vénitiens. Tout à coup, voici quelque chose, tombant d’en haut, qui heurte ma tête et rebondit à mes pieds. C’était moins lourd qu’un fruit, moins léger qu’une fleur. D’ailleurs, je passais, à ce moment, dans un endroit découvert et il n’y avait que le ciel au-dessus de moi. Je ramassai cet objet qui me venait de façon si merveilleuse, pensant que, peut-être, quelque saint du paradis faisait un miracle en ma faveur. Je vis un morceau de parchemin roulé et qui semblait imbibé d’un parfum étrangement suave. J’étais si surpris que j’hésitai à le dérouler. M’y décidant à la fin, je vis, en caractères d’or, cette phrase écrite en notre langue : « Le prochain lundi, au coucher du soleil, un ambassadeur du Prince des Montagnes entrera à Jérusalem. »
— C’est le diable ! s’écria Eschive en se signant.
— N’est-ce pas celui-là que nous appelons le Vieux de la Montagne ? demanda Sybille.
— C’est celui-là.
— Le prédécesseur de cet homme exécrable est cause que je suis orphelin, dit le comte Raymond ; j’avais douze ans quand il fit poignarder mon père dans sa ville même de Tripoli, sur les marches de l’église.
— Nul n’échappe à la vengeance du grand-maître des Assassins, dit le roi ; mieux vaut-il aussi être son ami que son adversaire.
— Ah ! père, dis-nous ce que tu sais de lui. J’en ai entendu parler quelquefois ; mais ceux qui le nommaient tremblaient de peur, jetant des regards furtifs autour d’eux, et ils se taisaient dès qu’on les interrogeait, comme s’ils avaient craint d’être entendus de lui.
— C’est qu’en effet il passe pour tout voir et tout entendre. Ce qu’est ce personnage, c’est assez difficile de l’expliquer. Il est très puissant et très terrible et, bien qu’il ne règne que sur une soixantaine de mille âmes, il semble l’égal des plus grands souverains, qui même tremblent devant lui. Pour qui l’offense ou lui déplaît la mort est inévitable. C’est un prophète, un roi, un dieu pour ses sectaires ; un magicien certainement.
— Il fait des miracles ?
— Saladin en a vu quelque chose lorsqu’il voulut faire la guerre au Vieux de la Montagne. Il avait mis le siège devant le château de Macyâf, la résidence habituelle de ce puissant homme, et, un jour, il crut surprendre son ennemi. Saladin le vit, avec deux écuyers pour toute escorte, au sommet d’une montagne isolée. Se croyant bien certain de le tenir, il fit cerner la montagne et envoya soixante nobles cavaliers pour se saisir de l’adversaire et l’amener prisonnier. Le prophète s’était assis sur un rocher et les regardait venir.
« Il est pris ! Il est pris ! » criaient les soldats de Saladin. En effet, les cavaliers n’étaient plus séparés du rocher que de la longueur d’une lance. Mais alors ils s’arrêtèrent comme devant un obstacle infranchissable ; ils avaient beau éperonner furieusement leurs montures : ils n’obtenaient pas d’elles un pas de plus. Quelques-uns mirent pied à terre et voulurent s’élancer ; mais, comme frappés de paralysie, ils tombèrent à genoux, sans pouvoir se relever. En les narguant, le Vieux de la Montagne leur disait : « — Eh bien ! pourquoi ne venez-vous pas nous saisir, comme vous l’a ordonné celui qui vous envoie ?
— C’est que Dieu te protège contre nous », répondirent les émirs tout tremblants. Très penauds, ils s’en retournèrent vers leur maître. Saladin dut lever le siège et, poursuivi par l’ennemi, abandonner, tout son équipage de guerre. Maintenant, il recherche l’alliance du Prince des Montagnes ; mais il ne l’a pas obtenue jusqu’à présent. Et qui sait ce que me veut cet ambassadeur ?
— Comment, sire, il songerait à devenir votre allié ? dit Hugues de Césarée.
Et Sybille s’écria, toute scandalisée :
— Un magicien !
— Dieu l’éclairera peut-être d’un rayon de la vraie foi, dit l’archidiacre : on m’a rapporté qu’il s’est fait instruire dans notre sainte religion.
— Il se ferait chrétien ?
— Je n’en crois rien, dit le roi. Le Prince des Montagnes est sans doute, comme toi Guillaume, empressé de s’instruire sur toutes choses : il a voulu connaître notre doctrine. Songe donc qu’il est, lui-même, dieu et que c’est là un état qu’on ne doit pas vouloir changer.
— Ce n’est donc pas un sectateur de Mahom ? demanda Tiennette,
— Ah ! sur cela, interrogez le chancelier. C’est tellement confus et embrouillé que je ne suis pas capable de l’expliquer clairement. Dis ce que tu sais, Guillaume.
— Sire, tout cela est fort mystérieux, et je n’affirmerai rien. Ceux que les Sarrasins, aussi bien que les nôtres, sans que nous sachions d’où ils ont tiré ce nom, appellent les « Assassins », forment une secte qui fut d’abord réputée la plus dévote aux lois de Mahomet, et, pendant quatre cents ans, ils passèrent pour les seuls vrais observateurs de ladite loi.
En ces derniers temps, la bonne fortune voulut qu’un homme savant, éloquent et d’un esprit merveilleusement vif et subtil, fût élu pour leur grand-maître et seigneur. Celui-ci eut l’idée de s’adonner à la lecture des saints et sacrés évangiles et des épîtres de saint Paul et autres apôtres. Il apprit si bien les commandements de Jésus-Christ et la doctrine apostolique que, comparant cette douce et honnête loi de Jésus avec celle que le misérable séducteur Mahomet avait donnée à ses complices, il commença à prendre en mépris et à détester l’immondice et la vilenie du susdit séducteur. Alors, il jeta à terre les oratoires desquels il avait usé jusque-là, dispensa son peuple de l’observance des superstitions mahométanes, défendit le jeûne et permit à tous de boire du vin et de manger de la chair de porc.
— Et tu crois, Guillaume, qu’il a fait tout cela par amour pour Jésus-Christ ? dit le roi en haussant les épaules.
— Je l’espère, sire.
— Lorsque j’étais dans la ville du Caire, dit Hugues de Césarée, j’ai entendu dire que les califes Fathimites avaient été longtemps les chefs de cette secte et qu’ils la pratiquaient encore secrètement. On appelle aussi les Assassins « Ismailiens », et j’ai cru comprendre que le véritable Grand Maître de l’ordre ne résidait pas en Syrie, mais en Perse, dans un lieu nommé, je crois, Alamout. Les maîtres de Syrie ne seraient que des lieutenants de celui-là ; mais le dernier élu a rompu le joug, s’est fait indépendant et passe pour le plus puissant de tous.
— Ce que tu nous contes là est fort curieux, dit le roi, et j’imagine que c’est aussi nouveau pour le savant chancelier que pour moi-même.
— En effet, dit Guillaume, je n’avais rien entendu de pareil.
— Je connais le grand secret des Assassins, qui est cause qu’on les appelle ainsi, dit Raymond de Tripoli : un philtre magique que le chef sait composer et qui donne d’enivrantes extases.
— Ah ! j’aimerais à en goûter, dit Eschive, ne pourrait-on s’en procurer ?
— Vraiment, êtes-vous folle, ma femme ? Voulez-vous donc vous damner ?
— Le sortilège de votre beauté ne met déjà que trop les âmes en péril, dit le roi. Vous n’avez que faire d’un philtre.
— Mais ce serait pour le boire moi-même, répliqua Eschive, qui riait de tout son cœur.
De nouvelles fanfares, annonçant l’entrée dans la ville de l’ambassadeur du Prince des Montagnes, ramenèrent la noble compagnie au bord des créneaux.
— L’envoyé n’a qu’une très petite escorte, fit remarquer Amaury : il se confie à notre loyauté.
Bientôt Homphroy du Toron parut sur la terrasse. Il venait rendre compte au roi de sa mission. Mais, en voyant la princesse Sybille tout auprès d’Hugues de Césarée, il s’arrêta, le visage altéré, et les enveloppa d’un regard noir.
Le connétable avait dix-huit ans à peine, et il était un peu grêle encore, mais plein d’une grâce très singulière qui semblait tenir plus à l’Orient qu’à l’Europe. De très discrètes rumeurs donnaient à entendre, il est vrai, que le jeune chevalier ressemblait beaucoup à un émir de Noured-din ; mais on chuchotait cela tout bas, et Tiennette, qui seule savait le vrai, adorait son fils, sans laisser voir aucun remords.
Homphroy fit son rapport au souverain d’une voix maussade. On avait conduit l’ambassadeur et sa suite dans l’hôtel préparé pour lui, et, selon les ordres, on le traiterait royalement.
— Demain, après la messe, nous le recevrons, dit Amaury.
Et il ajouta, en humant une brise fraîche qui se levait :
— La chaleur est tombée un peu ; allons travailler, messire chancelier.
II
Avant la fin de cette nuit-là, Hugues de Césarée brusquement s’éveilla comme si quelqu’un l’eût appelé par son nom. Effaré, le cœur battant, il écouta le silence, regarda de tous ses yeux la demi-obscurité. Une lampe de mosquée à verres multicolores, qui pendait d’une poutre, était allumée, car depuis qu’il se croyait hanté du démon, le chevalier redoutait de dormir dans l’ombre ; mais la mèche agonisait, et, sous ses palpitations, des lueurs jaunes, rouges et vertes dansaient sur les dalles du sol et dans les caissons du plafond, où les chimères d’or semblaient s’animer. Elles avaient des ailes dentelées, de gros yeux saillants, de longues langues fourchues sortant de leurs gueules ouvertes, et elles s’allongeaient, se ramassaient, comme pour bondir hors de l’azur qui les tenait prisonnières. Mais, dans un dernier crépitement, la lampe s’éteignit, et, subitement aveuglé, Hugues sentit redoubler son angoisse.
Bientôt, sur le noir opaque, il vit apparaître, dans un flamboiement confus, la forme adorable que le diable prenait pour le tenter, l’image de cette femme inaccessible dont le souvenir le hantait si douloureusement. Il essaya de faire le signe de la croix ; mais son bras retomba inerte, tant la langueur qui coulait dans son sang brisait sa force, et il poursuivit avidement du regard la vision qu’il avait voulu chasser.
Comme elle est gracieusement étendue, cette femme, le coude dans un coussin, le front sur sa main ! Comme elle est belle, sérieuse et profondément pensive !… C’est cela surtout, cette gravité, ce regard paraissant voir si loin dans le mystère de l’inconnu, qui donne à cette tête quelque chose de vraiment divin ; c’est cela qui bouleverse le jeune chevalier, l’emplit d’une terreur sacrée, d’une piété tremblante, plus encore que la pâleur tout unie du visage, où la pourpre n’éclate qu’aux lèvres, la splendeur des yeux, sombres et brillants comme une nuit d’été, les fauves lueurs des cheveux, ni blonds ni noirs, mais d’une étrange couleur de cuivre rouge, plus que toute cette séduction souveraine qui le brûle de si torturants désirs. Et, à voir ce fantôme, l’émotion le fait haleter :
— Ah ! si le diable peut être ainsi, que je sois damné !
Mais, aussitôt, il se dresse, épouvanté du blasphème. Il n’a rien dit. Ses lèvres n’ont rien formulé : il n’est coupable qu’en pensée.
Tout s’est dissipé. L’ogive de la fenêtre se découpe, à présent, d’un gris de perle : c’est le jour.
Hugues retombe sur son lit ; la raison lui revient, un peu de calme. Il comprend qu’il n’y a rien de diabolique dans tout cela, qu’un exorcisme ne le délivrerait pas, mais qu’il est follement épris, sans rémission et sans espoir, d’un être inconnu et insaisissable, que la mort est son seul salut.
Ce jour-là surtout, la vie, il lui semble, est impossible à supporter : c’est comme un poids trop lourd qui pèse sur sa poitrine, gène sa respiration.
Eh bien, oui, il mourra. Au prochain combat, il se fera tuer ; mais, auparavant, il tentera quelque chose : il fera un vœu.
Tout s’éclaire maintenant dans la chambre : le chevet doré du lit, les murs fleuris de peintures, les carreaux émaillés du sol, le tapis sarrasinois, sur lequel gît la belle couverture brodée. Le drap de fine soie est tombé, de l’autre côté. Hugues, dans sa fièvre, a tout bouleversé ; il est nu sur son lit, cherche en vain à se couvrir, ne trouve aucun vêtement. Du drap, qu’il ramasse, il s’enveloppe, comme un Romain dans sa toge, et court à la fenêtre qu’il ouvre.
La ville est silencieuse et déserte encore, toute sombre sous le ciel délicatement rose.
Les terrasses des maisons s’étagent, et l’on voit des Arabes qui dorment là, enveloppés dans des couvertures rayées. Quelques-uns s’étirent et bâillent, clignant des yeux, devant la lueur du ciel et se grattant la tête.
Une cloche commence à sonner matines au très prochain couvent de Sainte-Anne, et, de tous côtés, des sons plus graves lui répondent. À ces voix pieuses, le chevalier s’agenouille pour faire sa prière. Mais il la récite distraitement, des lèvres seulement, tandis qu’il pense que ce n’est pas l’heure encore où son écuyer a coutume de venir lui secouer l’oreiller pour l’éveiller. Impatient, il se relève, déverrouille les portes, fait un grand tapage. Bientôt des valets se précipitent, effarés, à peine vêtus, du regard interrogeant le maître.
— Qu’on appelle Urbain.
L’écuyer ne tarde pas à paraître, mal ajusté, les yeux troubles de sommeil. Urbain est un très jeune homme aux bonnes joues fraîches, à l’air à la fois naïf et malin.
— Mon seigneur serait-il malade ? demande-t-il.
— Non, j’ai hâte de sortir : habillez-moi.
— En armes ? interroge Urbain, s’imaginant qu’il s’agit de quelque querelle à vider.
— Une robe à la mode syrienne, très simple, et une kéfié blanche, répond Hugues.
Les valets ont apporté une vasque de faïence émaillée, ornée d’inscriptions et d’arabesques couleur de lait sur un fond vert turquoise, des aiguières d’eau fraîche, des savons d’Antioche, des essences rares. Mais le chevalier repousse les parfums.
— Je vais en pèlerinage, dit-il.
Sa toilette terminée, le voici dans les rues de Jérusalem, suivi de son écuyer, portant, à pleins bras, une provision de cierges.
L’hôtel où logeait le comte de Césarée, quand il résidait dans la ville sainte, était situé vers le centre de la cité, sur la colline d’Acra, à l’angle d’une place assez vaste. Le chevalier traversa cette place et, tout de suite, s’engagea dans d’étroites ruelles, enchevêtrées, dont les pentes raides et ravinées s’entrecoupaient d’escaliers, de pierre ou de terre battue, passaient sous des voûtes sombres, sous les saillies des maisons. Il descendit rapidement vers la basse ville, du côté de la porte de Josaphat et atteignit le grand réservoir qu’on appelait aux temps bibliques la Piscine Probatique. Il avait devant lui la façade très, simple de l’église Sainte-Anne, avec sa porte à ogives, dans le tympan de laquelle, encadrée d’oves et de billettes disposées en damier, apparaissait, sculptée en bas-relief, la mère de la Vierge Marie.
Hugues entra dans l’église, suivi d’Urbain, qui alluma un cierge à la lampe du parvis et le donna à son maître. Les trois nefs étaient désertes ; les pas y sonnaient longuement. Le jeune homme s’agenouilla un instant devant le maître-autel ; mais ce n’était pas là qu’il voulait formuler son vœu. Il revint sur ses pas, vers un escalier bordé d’une balustrade de pierre, qui, d’un des bas-côtés de l’église, s’enfonçait dans le sol, et il descendit les vingt-deux marches qui aboutissaient à un souterrain creusé dans le rocher.
Quatre lampes éclairaient ce lieu voûté, où persistait un parfum d’encens, mêlé à une odeur de moisissure. Il était de forme irrégulière, et le roc vif apparaissait par places, entre des peintures à fresques. Un autel en pierre grise s’adossait, au fond, à la paroi de la grotte, et, au-dessus, un groupe en bois, sculpté et peint de couleurs naturelles, représentait saint Joachim, sainte Anne et, entre eux, tout enfant, Marie, essayant ses premiers pas.
Hugues s’agenouilla au pied de l’autel et, à haute voix, improvisa sa prière :
— « Ô Marie ! glorieuse Vierge qui êtes née en ce lieu même où mon humble voix résonne, vous que le roi du ciel a bénie entre toutes les créatures, que l’ange Gabriel a visitée, qui avez donné le jour au sauveur du monde, à Bethléem, tandis qu’une étoile belle et claire luisait au ciel et que les pastoureaux sonnaient des chants de joie dans leurs cors, vous qui avez eu le cœur percé de sept glaives et, pour cela, êtes si compatissante à nos douleurs ; ô vous qui savez tout ! vous savez que la peine que je porte est trop lourde pour ma faiblesse, et, comme votre divin fils, quand sa croix trop pesante meurtrissait son épaule, obtint l’aide de Siméon, j’espère en votre secours pour être allégé de mon fardeau. Ô reine du ciel ! recevez mon vœu, faites-le bien accueillir de Celui qui peut tous les miracles, qui a ressuscité Lazare, changé l’eau en vin et multiplié les pains.
« Voici : Je demande cette grâce : Qu’une fois seulement mes yeux revoient celle qui les a rendus aveugles à toute beauté, qu’un instant je puisse la contempler encore, et que je meure aussitôt après. Je jure, ô sainte mère du Christ ! qu’au combat je ne ferai nul pas en arrière pour mon salut, que je tiendrai tête aux ennemis du Seigneur, fussent-ils cent contre moi seul, et que je me ferai tuer pour sa gloire. Prends en pitié ma faiblesse, ô très bienfaisante ! exauce-moi et pardonne à la folie de ma requête, qui ne mériterait pas même d’être écoutée. »
Il récita encore plusieurs Ave, planta le cierge qu’il tenait tout allumé dans un chandelier. Puis il sortit de l’église par une porte latérale.
Il suivit la rue de Sainte-Anne jusqu’à la rue de Josaphat et arriva devant le massif, taillé dans le roc, de la forteresse Antonia, où des vestiges d’antiques murailles étaient visibles encore parmi l’échelonnement des constructions de différents âges.
Plus bas se groupaient des bains arabes, des écoles et plusieurs luxueux hôtels appartenant aux barons et aux chevaliers. Un long passage, voûté en ogive, s’enfonçait sous la forteresse, Hugues s’y engagea et déboucha bientôt sur le parvis du Temple.
La cour du Temple s’étendait, belle et vaste, longue de deux portées d’arc et large d’une, toute pavée de dalles, soigneusement lavées, qui étaient pour la plupart le roc même du mont Moriah ; des arcades, formant cloître, s’appuyaient à la puissante muraille de l’enceinte sacrée, faisant le tour de la place, et vers le milieu du parvis, sur un terre-plein, soutenu par des murs très forts, s’élevait, léger, harmonieux et grandiose, le Temple du Seigneur.
L’ancienne mosquée d’Omar, construite sur l’emplacement du Temple de Salomon, devenue le Temple du Seigneur depuis que les chrétiens avaient conquis la ville, était une rotonde à huit pans coupés, revêtue de marbres et de mosaïques. La toiture, formée par une terrasse bordée d’arceaux à jours, entourait le tambour central, percé de hautes fenêtres, qui supportait la coupole. Celle-ci, allongée en forme d’œuf, était couverte de lames de plomb et surmontée de la grande croix d’or, qui remplaçait le croissant abattu.
Hugues traversa l’esplanade, que l’on nommait le Pavement, et, suivi d’Urbain, monta un des larges escaliers, terminés par de légers portiques, qui conduisaient à la plate-forme du Temple. Celle-ci était pavée de marbre blanc, et l’on voyait, à l’un de ses angles, l’abbaye des chanoines de Saint-Augustin, desservants du Temple.
Quatre portes, disposées en croix, donnaient accès dans le sanctuaire. Le chevalier y entra par celle qui regarde le nord, la Porte du Paradis, comme les infidèles la nommaient.
On ne pouvait pénétrer sans une émotion intense dans ce lieu vénérable où tant de souvenirs se réunissaient en un faisceau si glorieux. On était saisi de respect, dans ce demi-jour plein de mystère, au milieu de ces puissants parfums, dont les marbres et les porphyres semblaient imbibés, dans ce silence, sonore au moindre heurt et retentissant jusqu’au faîte de la coupole, comme si le ciel faisait écho.
Sur les murailles, de merveilleuses mosaïques représentaient des fleurs, des fruits, d’inextricables arabesques, où le regard se perdait. Des colonnes, de tous styles, faites des marbres les plus divers, formaient trois cercles, trois enceintes, que fermaient les ramages ajourés des grilles d’or, autour de l’autel, placé au centre de l’édifice, sous la vertigineuse coupole.
L’autel, construit par les croisés, s’appuyait à un roc nu qui surgissait du sol. C’était la Pierre sacrée et miraculeuse, célèbre depuis tant de siècles.
Sur cette roche, Abraham avait dressé le bûcher où il voulait sacrifier son fils ; David, plus tard, y éleva un autel, et, autour d’elle, Salomon édifia son Temple ; pendant quatre siècles, sur cette pierre, l’Arche d’alliance reposa. Au temps où Jésus enfant venait discuter avec les docteurs de la loi, un voile de pourpre environnait la roche sacrée, fermant ainsi la troisième enceinte, qui était le Saint des Saints.
Les offices n’étaient pas commencés encore quand le comte de Césarée s’agenouilla auprès de la roche sainte. Quelques frères servants, seulement, disposaient les ornements de l’autel. Le pèlerin redit son vœu, à haute voix, dans une si ardente prière, que les jeunes sous-diacres, interrompant leur besogne, écoutèrent avec une surprise craintive ; puis il baisa la Pierre auguste et se releva.
Il quitta le sanctuaire par la porte de l’Orient, qui donnait dans une chapelle dédiée à saint Jacques le Mineur. Elle était construite à la place même où l’apôtre martyr, précipité du sommet du Temple, tomba expirant. C’est là aussi que Jésus chassa les vendeurs, et sauva la femme adultère.
Après une courte oraison à saint Jacques, Hugues redescendit, de la haute plate-forme, au Pavement du grand parvis, il marcha vers le rempart de la ville, qui, du côté de l’orient, bordait la place. Il voulait saluer les Portes d’Or, dont les trois arches magnifiques s’élevaient à cet endroit. Les portes étaient murées, maintenant, et ne s’ouvraient que le jour de Pâques fleuries, pour laisser passer une procession.
Le chevalier mit un genou en terre, sur ce seuil illustre, et chercha à revoir, par l’esprit, la scène qui s’était passée là, près de douze siècles auparavant : le Sauveur, monté sur une ânesse, entrant à Jérusalem par les Portes d’Or, le peuple, accouru à sa rencontre, l’acclamant, jetant des branches vertes sous ses pas.
Quand il se remit en route, Hugues s’aperçut que son écuyer ne l’avait pas suivi. Il le chercha des yeux, avec surprise et impatience, et finit par le découvrir sur les dernières marches d’un des escaliers de l’esplanade, profondément endormi, au milieu d’un écroulement de cierges.
— Mécréant ! est-ce ainsi que tu fais ton service ? s’écria-t-il en l’éveillant d’un coup de pied.
Devant le visage irrité de son seigneur, Urbain retrouva subitement toute sa lucidité. Il se releva, les mains jointes, d’un air plein de contrition :
— Ah ! monseigneur, dit-il, dans l’intérêt de votre vœu, ne vous laissez pas entraîner à une juste colère : elle pourrait mécontenter Notre-Seigneur Jésus, le très miséricordieux.
Hugues haussa les épaules en souriant et s’éloigna, sans rien ajouter, tandis que l’écuyer ramassait les cierges et courait pour le rejoindre.
Le comte retournait sur ses pas, et il quitta l’enceinte du Temple par le passage voûté qu’il avait pris pour y entrer ; il voulait refaire, à partir de ce point, le chemin que le Sauveur, si péniblement, avait suivi pour aller à la mort. Il s’arrêta donc au milieu des constructions élevées sur l’emplacement de la forteresse Antonia, à l’endroit où avait été le prétoire de Pilate. Là, Jésus fut condamné, couronné d’épines et chargé de la croix ; de là, il commença la route douloureuse.
Le point où le Maître tomba pour la première fois sous le poids de la croix, est marqué par une antique colonne, cassée en deux et couchée contre une muraille, à l’issue de la rue Josaphat, là où elle se termine dans une rue transversale qui vient de la Porte des Pèlerins. Hugues, prosterné sur le sol, les bras grands ouverts, cria avec véhémence :
— Moi aussi, Seigneur, je porte une croix trop lourde pour ma faiblesse ! Puisque, je ne puis pas la rejeter, fais qu’elle soit, comme la tienne, l’instrument de mon supplice et me donne le repos de la mort !
Plus loin, il entra dans une ruelle, en souvenir de la rencontre de Jésus avec sa mère désolée. Puis il gagna la rue du Saint-Sépulcre, à l’entrée de laquelle Simon le Cyrénéen fut requis pour porter la croix du Christ.
Les rues étaient toujours étroites, inégales, coupées d’escaliers et de ravins. L’écuyer, qui, sous sa charge, buttait souvent, maugréait, et s’étonnait tout bas que le Seigneur, qui eût pu choisir pour y vivre le plus beau pays du monde, eût élu de préférence cette vilaine et sombre cité et il fredonnait la chanson, composée jadis, sur pareil sujet, par Robert le Frison.
Pourquoi s’hébergea-t-il en cette Sinaïe ? …
Ce devrait être ici bonne terre bénie ;
Encens y devrait croître, et l’or, et la rubie,
La myrrhe et le gingembre et la rose florie,
Ah ! mieux j’aime d’Arras la grand châtellerie !
À une centaine de pas plus avant dans la même voie, à l’endroit où une voûte enjambe la rue, un fragment de colonne, encastré dans le pavé, indique la place où s’élevait la maison de Véronique. C’est là que la pieuse femme vint essuyer le visage, tout couvert de sang et de poussière, du divin condamné et que s’accomplit le miracle de l’image du Sauveur empreinte sur le linge. Hugues ne s’arrêta là qu’un instant.
De puissantes vibrations de bronze roulaient, à présent, sur la ville : toutes les cloches sonnaient la messe matinale ; les habitants, éveillés, bruissaient, dans les échoppes qu’ils ouvraient, sortaient de tous les côtés à la fois, emplissaient la cité. Déjà on avait peine à circuler dans la rue grimpante et peu large ; des âniers, à grandes enjambées qui tendaient sur leurs mollets bruns leur chemise de toile bleue, se hâtaient vers les marchés, poussant devant eux leurs bêtes, ensevelies sous des bottes de légumes et d’herbes, si volumineuses qu’elles touchaient à la fois les deux murs de la rue. D’immenses paniers, pleins de volailles piaillantes et d’où sortaient, en s’agitant les longs cous des oies, accrochaient des mannes où luisaient de grands poissons, et d’inextricables bagarres, traversées de cris gutturaux, de coups de trique, d’imprécations et de menacés, barraient le passage pendant de longs moments. Au carrefour formé par la rue du Sépulcre et la rue Saint-Étienne, la cohue se compliquant encore d’un troupeau qui entrait dans la ville, Hugues, impatienté, renonça à l’itinéraire qu’il s’était tracé et, brusquement, tourna à gauche.
C’était un long détour, pour gagner le Saint-Sépulcre, dernière station de son pèlerinage ; mais on pouvait avancer plus vite dans la rue, relativement tranquille. Il traversa le change des Syriens, la où s’ouvrent aussi les échoppes des orfèvres, qui travaillent et battent le métal, accroupis au milieu des chaudes rutilences de leur étalage. Quelques pas plus loin, il jeta un regard aux alcôves de pierres, creusées au flanc des maisons, où l’on vendait les Palmes Idumées, ces preuves du saint pèlerinage si chères à tous ceux qui retournaient en Occident. Ces palmes étaient frettées, c’est-à-dire soigneusement entourées, pour se mieux conserver, de fils d’argent et de fils de soie.
Hugues passa, sans y entrer, devant l’abbaye des moines noirs de Sainte-Marie-Latine, puis devant celle des nonnes de Sainte-Marie-la-Grande ; ensuite il longea les murailles de l’Hôpital et, bientôt, s’engagea sous les voûtes ogivales de la rue Malcuisinat, qui, d’un côté, s’appuyait au domaine des Hospitaliers. Sous ce couvert, où les voix et les pas retentissaient, flottait une épaisse fumée et une âcre odeur de graisse et de friture. C’était là que l’on cuisait les viandes, pour les vendre à la foule des pèlerins. De tous côtés, les âtres s’allumaient, les charbons pétillaient, et les quartiers de chair embrochés grésillaient en laissant couler leur jus.
Déjà de nombreux pèlerins mangeaient, accroupis par terre, assis sur leurs talons, ou les genoux relevés leur servant de table. D’autres s’étaient livrés aux barbiers, établis aussi dans cette rue, qui leur savonnaient la tête vigoureusement, les délivraient, autant qu’il était possible, de la vermine.
Urbain, péniblement, se traînait derrière son maître, et son appétit matinal était vivement sollicité par ces chaudes odeurs de victuailles. Il ne put résister et, tirant tout à coup un denier de sa ceinture, il accota son paquet de cierges à l’échoppe d’un rôtisseur et acheta une brochette de mouton coupé en petits carrés. Il les dévora, tout en courant, se brûlant les doigts et se graissant la figure, tandis que, par-dessus les têtes, il regardait, loin devant lui, pour ne pas perdre de vue son seigneur. Il le rejoignit dans la rue Couverte, qui faisait suite à la rue Malcuisinat. Dans ces nouvelles galeries voûtées qui, par des travées, communiquaient avec le marché aux Herbes où se tenaient les marchands de fruits, de légumes et d’épices, les drapiers syriens avaient leurs boutiques, et l’on fabriquait les chandelles de cire.
Le chevalier déboucha enfin, à ciel ouvert, dans une rue transversale : la rue de David, et tournant à angle droit, il la suivit, en longeant une autre face de l’Hôpital. Loin devant ses yeux il voyait, au delà d’une grande place pleine de foule, où se tenait le marché au blé, la majestueuse masse du fort de David et les créneaux des remparts de la ville. Dans la baie cintrée de la porte ouverte, l’étrange silhouette des chameaux de charge, avec le feston de leur cou reployé, leur dos bossu et leur lèvre pendante, se profilait, sur la grande lumière fuyante de la campagne. Mais Hugues, bientôt, tourna à droite, dans la rue du Patriarche, où un, encombrement l’arrêta encore.
C’était un convoi de vivres qui entrait dans une cour de l’Hôpital. Sous l’arceau sculpté du portail, deux frères Hospitaliers, vêtus de noir avec la croix blanche à huit branches sur l’épaule gauche, maintenaient l’ordre, autant que possible, et comptaient les mules qui passaient le seuil. Le convoi était long, en proportion de ce qu’il y avait, dans ce domaine, de gens à nourrir. Le nombre des malades seuls, que l’on soignait dans les grandes salles de pierre, belles comme des cathédrales, atteignait, quelquefois, deux mille, si bien qu’il arrivait aussi que l’on emportait cinquante morts dans la même journée. Les pèlerins que l’on accueillait étaient innombrables, sans parler des chevaliers Hospitaliers eux-mêmes, de leurs écuyers et de leurs valets.
L’enceinte du Saint-Sépulcre n’était séparée des murailles de l’Hôpital que par une ruelle en contre-bas, où l’on descendait, de la rue du Patriarche, par une vingtaine de larges marches. Après avoir fait quelques pas dans la ruelle, on atteignait la maîtresse porte de l’enceinte, qui s’ouvrait sur le parvis.
La Basilique, le Calvaire, un grand nombre d’églises et de chapelles, le cloître et les logements des chanoines et des prêtres des différents rites, formaient une masse confuse de constructions disparates, dont le désordre était dominé par la puissante coupole qui recouvrait le Saint-Tombeau.
La façade de la Basilique apparaissait, dans un angle, au fond de la place pavée de marbre, massive et simple dans son ensemble, avec une double porte, presque en plein cintre, aux arcades formées de trois archivoltes, s’appuyant sur de minces colonnes et surmontée de deux grandes fenêtres. Au-dessous des tympans étaient des bas-reliefs, si merveilleusement sculptés que l’on n’avait encore rien vu de pareil, et que les personnages, à ce que chacun disait, semblaient vivants. Ces bas-reliefs représentaient des sujets pris au Nouveau Testament : la Cène, l’Entrée à Jérusalem, Lazare sortant du tombeau. La résurrection avait lieu devant un groupe de spectateurs, que l’odeur de la mort incommodait, sans doute, car tous se bouchaient le nez. À côté de l’église, en retour sur le parvis, montait le clocher neuf, carré, percé d’ogives, terminé par des créneaux et un dôme octogonal. Au moment où le comte de Césarée franchissait le portail de la cour, le bruit d’une violente altercation l’arrêta sur le seuil, dans un sursaut de surprise et de colère.
— Comment, murmura-t-il, quelqu’un ose élever la voix ici où notre divin Jésus cria vers son père, en expirant ?
— Monseigneur, dit Urbain, ce sont des pèlerins qui se disputent ; ils ont la figure cramoisie et se montrent le poing ; bien sûr, ils vont se battre.
Un vieux moine, en reconnaissant un des grands barons du royaume, accourut vers Hugues.
— Ah ! quel scandale ! s’écria-t-il : c’est un prêtre de Franconie qui le cause. Venez, seigneur : vous apaiserez peut-être ce mauvais chrétien.
Le rassemblement avait lieu à droite de la cour, dans l’angle formé par la Basilique et la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. On voyait à cet endroit plusieurs tombeaux, et c’était devant l’un d’eux — un sarcophage de pierre — que le religieux allemand, et un pèlerin venu de France, prêts à se ruer l’un sur l’autre, se soufflaient au visage de furieuses paroles. On faisait cercle autour d’eux. Hugues s’approcha, cherchant à démêler le sens de la querelle.
— Qu’est-ce que tu en sais, vantard ? criait le pèlerin français. Tu n’étais pas de ce monde quand on a pris la ville et que celui-ci est mort !
— Ose donc dire qu’on n’a pas gratté l’inscription, qui était sur le tombeau, pour la recouvrir d’une autre et cacher ainsi la vérité sous le mensonge !
— C’est toi qui mens.
— Ce tombeau est celui de Wigger ; c’est là la vérité ; mais elle ne plaît à personne.
— Il ne nous gêne guère, pourtant, ton Wigger, dont la valeur n’est connue que de toi.
— Il vous gêne si bien que vous effacez son nom pour mieux vilipender les Allemands et exalter les Français. Ce nom était la preuve que ceux de notre nation marchaient les premiers au combat.
— Ah ! ah ! ils se sont donc envolés après la victoire, ces vaillants chevaliers, sans rien réclamer du butin ? Car pas un carré du sol n’est à eux dans Jérusalem.
— Parce qu’ils n’ont rien demandé, tant ils avaient hâte de regagner leur pays. Aussi l’on a tout distribué aux Français, aux Normands avides, aux Lorrains, aux Provençaux, aux Auvergnats, au Italiens, aux Espagnols et aux Bourguignons, ce qui n’empêche que ce sont les Allemands qui ont pris la ville, et votre Godefroy même, lui aussi, était de notre nation.
Un rire général accueillit cette déclaration, et le pèlerin français leva le bras vers une inscription, gravée dans la pierre, sur le mur de la chapelle. Elle était ainsi :
L’an cent et mille moins un.
Du Seigneur resplendissant né de la Vierge.
Le quinze juillet étant déjà touché par la lumière de Phœbus.
Les Français prennent Jérusalem par leur puissant courage.
— Ceux qui ont écrit cela étaient donc des menteurs et des voleurs ?…
Relevant sa cagoule de pèlerin, le Franconien d’un bond s’élança sur le sarcophage, et dégainant un poignard, il égratigna la pierre, et écrivit, au-dessous de l’inscription française :
Ce ne sont pas les Français, mais les Franconiens, plus puissants par le glaive, qui ont délivré Jérusalem la Sainte, longtemps captive de différents païens. Franconiens et non Français Wigger, Guntram et Gottfried le duc.
Le fait est ainsi, et sa véracité est parfaitement établie.
Des huées éclatèrent. Les pèlerins lancèrent leur gourde à la tête de l’Allemand ; quelques pierres volèrent ; mais le forcené, dont le front saignait, ne se taisait pas.
— Oui, c’est là la vérité, hurlait-il, c’est nous qui avons pris la ville, et cette terre de chrétienté, il y a longtemps que ses limites s’étendraient jusqu’au Nil, au sud, et au delà de Damas, au nord, s’il était resté autant d’Allemands ici que de vos espèces !…
Hugues, fendant la foule, s’avança.
— N’avez-vous pas honte, s’écria-t-il, vous chrétien et prêtre, de tenir une telle conduite dans un lieu aussi sacré que celui-ci ?… À quelques pas, les bourreaux du Sauveur se sont partagé ses vêtements, et voilà qu’un de ceux pour qui il est mort, vient disputer à ses frères la vanité d’une gloire terrestre ! C’est du triomphe qu’il faut se réjouir et non pas de l’éclat qui peut rejaillir sur l’un ou sur l’autre. Le noble duc Godefroy n’a-t-il pas refusé de porter la couronne, dans la ville où le divin Maître a été couronné d’épines ?
— C’est vrai : mieux vaut se taire, dit le prêtre en sautant à bas du sarcophage. Les paroles sont vaines et fugitives.
D’autres avaient pris sa place sur le tombeau et rayaient ce qu’il venait d’écrire.
— Qu’importe ? s’écria-t-il en s’éloignant. Les monuments s’écroulent, les pierres s’émiettent ; le parchemin sera plus fidèle, et moi, Jean de Wurzbourg, j’écrirai la vérité, pour que l’avenir la sache.
Et il quitta le parvis, en secouant la tête d’un air de défi et de dédain.
Laissant les curieux accrus, se redire et commenter l’incident, le comte de Césarée se dirigea à droite de la cour et entra, pour y mettre un cierge, dans la chapelle de la Trinité, là où avaient lieu tous les mariages et tous les baptêmes de la ville. En en ressortant, il s’enfonça sous des galeries très sombres, formées par les voûtes et les piliers trapus, soutenant la plate-forme artificielle qui prolongeait le sommet du Calvaire en lui donnant une forme régulière, et il gravit l’escalier conduisant dans l’intérieur du sanctuaire, construit sur le lieu très sacré où le Sauveur a rendu l’âme.
Prosterné devant la place même où la croix fut érigée, le chevalier, en pleurant, redit encore une fois son vœu.
Un cercle d’argent entourait le creux dans lequel s’enfonça le bois du supplice ; les fidèles, maintenant, y jetaient leurs offrandes. De chaque côté, la place des deux larrons était marquée dans le sol par un disque de marbre noir.
Le pèlerin se releva, et, pour gagner le chœur de la Basilique, il passa auprès de la fissure miraculeuse qui se forma dans le rocher, au moment où le Seigneur rendit l’esprit, et par laquelle son sang coula, s’infiltra jusqu’à une grotte, sous la montagne, où Noé avait déposé le crâne d’Adam.
Lorsque Hugues plia le genou à cette place vénérable, un rayon de soleil, traversant le vitrail, répandit comme un ruisseau de sang sur le sol et jusqu’à la fissure, où il sembla s’enfoncer. Le jeune homme, frémissant d’émotion, joignit les mains et les tendit vers le ciel, car cela lui parut un signe certain que son vœu serait exaucé.
Dans le clocher neuf, la grosse cloche sonnait la messe, et sa voix sombre dominait le clair carillon des chapelles.
Hugues descendit un escalier tout proche qui donnait accès dans l’église, et il y entra à la gauche du maître-autel. La Basilique, vaste, haute, illustrée de fresques et rutilante de mosaïques, était déjà pleine de fidèles. Les chanoines, rangés à leurs places, entonnaient un chant ; le Patriarche montait à l’autel, et la messe commençait.
À l’autre extrémité de l’église, dans les chapelles ouvertes sur la rotonde qui entoure le Saint-Sépulcre et appartenant aux Grecs, aux Jacobites, aux Syriens, on officiait simultanément, selon les différents rites ; dans quelques-unes, aux sons des trompettes, ou au claquement des symandres de bois ; cela produisait un grand tumulte, mais on y était accoutumé.
Le chevalier écouta la messe avec recueillement, les regards fixés sur un tableau, en mosaïque à fond d’or, qui représentait le Christ brisant les portes de l’enfer pour arracher aux flammes Adam, le premier homme. La messe dite, il traversa l’église, fit une génuflexion au milieu, du chœur, devant le point que l’on dit être le Centre, l’Ombilic du monde, puis il baisa la Pierre de l’Onction, sur laquelle on lava avec des parfums le corps du Sauveur, avant de l’ensevelir, et, enfin, gagna la grande rotonde qui entoure le Saint-Tombeau, dernière station de son pèlerinage.
Cette rotonde était bordée de piliers massifs, soutenant deux étages de galeries, ornées d’arcades ogivales, et au-dessus s’arrondissait le dôme, percé en haut d’une ouverture par laquelle on voyait le ciel. Directement au-dessous était l’édicule, surmonté d’un clocheton à jour, qui recouvrait la grotte sépulcrale.
Hugues se courba pour passer sous la porte cintrée, il pénétra dans une première salle voûtée où était la pierre sur laquelle l’ange s’est assis, et, de là, par une ouverture basse et étroite, il entra dans le lieu auguste entre tous.
Quarante lampes d’or, suspendues par des chaînes, y brûlaient nuit et jour, tellement que le plafond en était tout noirci. Les murs brillaient, revêtus de belles mosaïques, dégradées cependant à différentes places par les larcins pieux des pèlerins. À droite, dans un angle, recouvert de plaques de marbre, le sarcophage, taillé dans le roc, qui a, pendant trois jours, enfermé le corps de l’Homme-Dieu, miroitait sous les lampes.
Le chevalier alluma à l’entour tous les cierges que portait Urbain, puis baisa le rocher, à travers les ouvertures rondes ménagées à cet effet dans le marbre.
Il s’abîma enfin, dans une longue, ardente et douloureuse prière, le front appuyé sur le rebord glacé du tombeau, qui communiqua à son sang quelque chose du calme et du froid de la mort.
III
Hugues revint chez lui assez las, sous un soleil déjà brûlant ; mais il se sentait apaisé, moins rebelle à la vie, comme certain d’être exaucé.
Son hôtel, ainsi que la plupart de ceux habités par les nobles chevaliers, à Jérusalem, était construit à l’orientale. Il avait doux étages à cause de l’espace restreint, et portait sur différents niveaux de terrain. Le rez-de-chaussée était occupé par les cuisines, les écuries, les logements des serviteurs ; un escalier extérieur conduisait à une cour centrale sur laquelle s’ouvraient les salles principales de l’habitation. Cette cour, pavée en pierres de diverses couleurs, avait à son centre un bassin d’où s’élançait un jet d’eau, qui, en retombant, éclaboussait quelques rosiers en fleurs.
Le comte de Césarée alla s’étendre, dans une des salles, ouvrant sur la cour par un portique, sur un large divan recouvert d’un tapis de Bagdad. Mais à peine y était-il, soupirant d’aise au bien-être de son corps, que l’écuyer Urbain reparut, annonçant qu’un esclave, avec un message secret, attendait depuis longtemps.
— Eh bien, qu’il vienne ici, dit Hugues en bâillant.
Le messager entra. C’était un eunuque abyssin, à la peau de bronze, vêtu de pourpre. Il déposa près du divan un riche coffret, puis se retira sans une parole.
Mais le comte avait eu le temps de reconnaître un esclave au service de la princesse Sybille ; et il s’était relevé vivement.
Maintenant, il tenait le coffret entre ses mains, le regardant fixement, presque avec effroi. C’était une jolie boîte en marqueterie, ayant la forme d’un reliquaire, avec deux poignées dorées, à l’une desquelles était attachée une petite clef. Le jeune homme la détacha ; mais il ne se hâtait guère d’ouvrir. Il réfléchissait très profondément, inquiet, perplexe. Enfin, il fit tourner la clef dans la serrure, souleva le couvercle et tira du coffret une étoffe ployée, qu’il déroula. C’était une manche de femme, très longue, en drap de soie couleur d’azur, ramagée de filets d’or.
— C’est bien ce que je pensais, murmura-t-il. Depuis longtemps, son regard me poursuit, et sa parole me caresse ; je feins d’être aveugle et sourd ; mais elle ne se lasse pas, et voici qu’elle m’envoie un gage d’amour : ses couleurs, dans le désir que je les porte, que je me déclare son chevalier. Et comment puis-je l’être, moi, captif d’une passion coupable ?…
Il froissait machinalement l’étoffe entre ses doigts, restait pensif, le front baissé, comme vaincu par l’inextricable danger de cette simple aventure.
Tout à coup, il eut la sensation que quelqu’un, qu’il n’avait pas entendu venir, était auprès de lui ; il releva la tête vivement.
— Vous ! connétable ! s’écria-t-il. Comment ne vous a-t-on pas annoncé ?…
— C’est moi qui n’ai pas voulu l’être, dit Homphroy du Toron.
Et, comme Hugues cherchait à dissimuler la manche couleur d’azur, il ajouta :
— Ne cachez pas ce gage : c’est à cause de lui que je suis venu.
— Voici un aveu bien étrange, s’écria Hugues, qui se leva, les sourcils froncés.
Mais, devant la tendre jeunesse de ce rival, qui rougissait en même temps de timidité et de colère, il se calma, se remit sur le divan et fit asseoir Homphroy à côté de lui.
— Expliquez-vous, messire, dit-il : je vous entendrai avec patience.
Homphroy, les yeux baissés, mordait ses lèvres, ne sachant par où commencer. Enfin, il dit d’une voix sourde, sans regarder Hugues ;
— Vous savez, comme tous le savent, que je suis, par héritage, maître d’un des plus grands fiefs du royaume, dont les revenus sont considérables et m’apportent une richesse extrême. C’est pour cela, plutôt qu’à cause de mes mérites qui sont très faibles, que je suis pourvu d’une des plus hautes charges de la cour et que le roi notre sire me traite avec grande faveur. Je le dis avec certitude, il verrait sans déplaisir une alliance de sa royale lignée, avec ma maison, et il m’aurait déjà octroyé son consentement si j’avais eu l’agrément de la princesse. Mais c’est cela que je ne peux obtenir, malgré tous mes efforts… Et voilà qu’elle vous choisit pour son chevalier ! qu’elle vous envoie un gage de sa foi !… Non ! non ! vous n’accrocherez pas cette manche à votre épaule : je ne le veux pas, je vous défends de la porter.
— Bien que vous ayez quitté vos enfances depuis très peu de temps, dit Hugues, sans élever la voix, vous êtes aussi vaillant et robuste qu’aucun homme fait. Je ne refuserai donc pas de combattre avec vous en prétextant votre jeunesse, car je sais ce que valent vos coups. Et cependant c’est avec grande douleur que je tirerai l’épée contre un chrétien, contre un compagnon d’armes. Votre vie m’est plus chère, je vous le jure, que ce précieux gage, que je n’attendais pas et que je n’ai nullement mérité.
— Ah ! Je n’ai que cette espérance : peut-être n’aimez-vous pas celle qui vous aime… Si vous l’aimez… alors il faudrait tremper de sang l’azur de cette étoffe, car, moi vivant, nul ne portera les couleurs de Sybille.
La voix du jeune homme s’entrecoupait ; ses paroles sortaient avec peine de sa gorge serrée. Tout à coup, un rauque sanglot la déchira, et, dans un élan spontané, il jeta ses bras autour du cou de son rival, en criant, à travers ses pleurs :
— Hugues ! Hugues ! Je vous en conjure, ayez compassion de moi.
Hugues, le cœur tout remué, retint l’adolescent sur sa poitrine, baisant ses boucles brunes, s’efforçant de l’apaiser.
— Écoutez, Homphroy, dit-il. Voir pleurer, un preux tel que vous, cela me cause trop grande peine, et je vais vous dire un secret qui devait n’être qu’entre Dieu et moi. Mais il faut me jurer, très solennellement, que vos lèvres toujours resteront scellées sur lui.
Homphroy se releva vivement, essuya ses longs cils noyés.
— Vous le voyez, messire, pour les larmes je ne suis qu’un enfant ; mais, pour l’honneur, vous l’avez dit, je suis un homme. Je jure, sur mon salut, que jamais je ne révélerai ce que vous voudrez bien me confier.
Hugues le fit se rasseoir auprès de lui.
— Ne craignez rien de moi, dit-il. Depuis trois années déjà, mon cœur est hanté par un rêve coupable dont rien ne peut me délivrer. J’aime avec folie et douleur, sans espoir, sans désir de guérison, une femme aperçue par fraude, une femme dont je ne sais même pas le nom et qui confesse Mahomet.
— Oh ! Seigneur Christ ! une infidèle !
— Dieu m’accordera de mourir bientôt, dit le comte en courbant la tête.
Mais Homphroy lui saisit la main.
— Mourir ! Pourquoi mourir ? Plutôt faut-il la retrouver, cette païenne, vous faire aimer d’elle, l’enlever peut-être. Je vous y aiderai.
— C’est l’impossible, cela, Homphroy : la revoir et vivre, ce serait la perte de mon âme. Que Dieu exauce ma prière, et que je meure.
Le jeune connétable se rapprocha d’Hugues et lui dit presque à voix basse :
— Ce n’est pas, après tout, un tel crime d’aimer un être qui n’a pas reçu, en naissant, la même foi que nous-même, et vous n’êtes pas le premier. Nous avons conquis ce pays ; mais il a, lui, conquis un peu de notre âme. Déjà nos pères étaient séduits par le luxe, par la science des Musulmans ; attirés par leurs coutumes, ils les avaient presque toutes adoptées, et nous, qui tous deux sommes nés dans ce pays et parlons le langage des infidèles aussi facilement qu’eux-mêmes, nous leur ressemblons plus encore. En lisant les relations des combats passés, nous avons dû souvent reconnaître que nos aïeux s’étaient montrés, dans la victoire, comme des loups altérés de sang, tandis que les ennemis étaient pitoyables et cléments.
Hugues songeait, en écoutant parler ainsi le jeune homme, au mystère qui planait sur sa naissance, et il le regardait, admirant la pâleur fauve de son visage, ses yeux noirs et lumineux, qui le faisaient plus semblable à un Syrien qu’à un Franc. Et, justement, Homphroy rappelait cet émir de Nour-ed-Din, frère d’armes de son grand-père.
— Nul ne fut plus fidèle et plus dévoué que lui, disait-il ; il avertit plusieurs fois son frère d’armes et le sauva de grands dangers. Mon père vantait souvent ses mérites, sa science, la douceur de ses mœurs, qui contrastaient si fort avec le dérèglement et la brutalité des nôtres.
— Il est vrai que, parmi nous, la corruption est grande, dit Hugues ; mais les pécheurs qui se repentent peuvent espérer la rédemption, tandis que, malgré leurs vertus, les infidèles seront damnés.
— Ah ! je ne puis le croire ! s’écria Homphroy. Dieu serait donc injuste ? Qui peut savoir, d’ailleurs, où est le faux et où est le vrai ?
— C’est offenser le Christ que d’avoir de telles pensées, s’écria Hugues, elles mettent notre salut en danger, et mieux vaut les chasser de notre esprit. Mais nous sommes loin d’être hors de peine, à propos de ce gage, que je ne puis refuser de porter sous peine d’offenser mortellement la princesse. Nos cœurs sont d’accord ; comment accorder nos actes à nos désirs ?
Homphroy attira à lui la manche soyeuse et la caressa du bout des doigts.
— Fiez-vous à moi, Hugues, dit-il, et tout s’arrangera.
— Je le veux, et bien volontiers, mais j’ai de très vives craintes.
— Écoulez. Quand, tout à l’heure, je suivais ce messager, j’étais résolu à lui prendre de force le coffret qu’il vous portait. J’ai redouté, au moment d’agir, un scandale en pleine cité. Mais, ce que je n’ai pas eu par la force, je peux l’obtenir par la séduction. Laissez-moi ce gage, si précieux pour moi : je le porterai ouvertement et je me charge du messager. Il avouera sous le fouet, à sa maîtresse, que je lui ai ravi le message avant qu’il ait pu arriver jusqu’à vous, et comme je soutiendrai son dire, on ne saurait le mettre en doute.
— Je me livre à vous, connétable, dit Hugues, si vous me répondez que mon honneur ne recevra nulle atteinte en ceci.
— Je serai le champion de votre honneur, s’écria Homphroy, qui, les yeux tout brillants de joie, replia l’étoffe et la remit dans le coffret.
Mais il s’émut soudain au son criard d’une trompe qui se fit entendre toute proche.
— Le temps a-t-il passé si vite ? dit-il. Serait-ce déjà l’heure du dîner ? N’ai-je pas entendu corner l’eau ?
— Rassurez-vous, dit Hugues en riant ; on corne l’eau, en effet, mais c’est pour m’avertir que mon bain est trempé et que je dois me rendre à la piscine si je veux ne pas manquer la réception royale.
— J’ai eu les tempes mouillées de sueur à l’idée d’avoir ainsi failli au devoir.
— Venez au bain avec moi, pour vous remettre, dit le comte. Certes, en cet hôtel étroit, mes étuves n’approchent pas de celles qu’un célèbre artiste syrien a décorées pour moi dans mon palais de Césarée ; elles sont cependant assez luxueuses et agréables.
— J’accepterais volontiers, car rien n’est plus plaisant que de se baigner en compagnie ; mais la messe du roi va bientôt sonner, et il faut que je retrouve l’esclave abyssin avant de me rendre au château, en grand apparat, pour y conduire l’ambassadeur.
— Adieu donc, chevalier ! Soyez merveilleusement prudent et circonspect en cette très difficile affaire.
— Ne craignez rien, dit Homphroy : je serais mortellement navré de tout ce qui pourrait vous nuire, car, autant je vous jalousais tout à l’heure, autant je vous aime à présent.
Les deux jeunes hommes se regardèrent en souriant, et, avant de se séparer, ils s’étreignirent et se baisèrent sur la bouche fraternellement.
IV
C’était l’heure annoncée pour la réception de l’ambassadeur, et la foule emplissait maintenant les rues de Jérusalem, se pressait aux abords de l’enceinte du Temple, qui contenait aussi le palais de Salomon : la résidence royale. On voulait au moins voir passer les barons et les chevaliers, puisqu’il n’était pas possible de pénétrer dans la grand’salle, on espérait apercevoir, peut-être, l’envoyé lui-même !
Cette ambassade d’un illustre prince syrien réjouissait beaucoup la population. Les bourgeois, préoccupés surtout de leur commerce, redoutaient les guerres, et la perspective d’une alliance leur plaisait fort. Ils savaient confusément de quoi il s’agissait : la renommée du Vieux de la Montagne, le redoutable sorcier aux vengeances implacables, était venue jusqu’à eux, et ils avaient entendu conter à son sujet de très terribles histoires.
Le brouhaha était prodigieux dans la rue de David, au Change des Latins, et surtout dans la rue du Temple. C’était, porté sur un bourdonnement grave, un jacassement de volière, traversé d’appels de cor, de cris, de hennissements : une confusion joyeuse, avec des instants d’effroi, quand des chevaliers, arrivant par les rues étroites, bousculaient les piétons, et éperonnaient leurs chevaux cabrés.
Sous les voûtes des boutiques, les marchands, en tuniques brunes ou grises, se tenaient debout, les pieds au niveau de leur étalage, enviés de tous, car ils dominaient la multitude et voyaient par-dessus les têtes.
De belles étoffes de couleurs gaies étaient tendues çà et là, d’un toit à l’autre, et palpitaient doucement au-dessus des rues, qu’elles abritaient du soleil. Le flot vivant, sous ces vélums, apparaissait zébré de larges zones de lumière et d’ombre qui avivaient ou éteignaient l’éclat des costumes de fête. Ces costumes étaient extrêmement variés, car il y avait là toutes sortes de races. On voyait, plus nombreux même que les Francs, les Syriens, dont les amples vêtements verts, pourpres ou blancs et les turbans brochés d’or attiraient les regards. Parmi eux étaient les chrétiens indigènes, parlant arabe, qui suivaient, avant la conquête, la liturgie grecque, mais s’étaient, depuis peu, soumis à Rome (en apparence seulement, à ce que donnait à entendre le clergé latin). On usait cependant à leur égard d’une grande tolérance, car ils tenaient toutes les ressources du pays, adonnés qu’ils étaient à l’agriculture, au commerce, à l’industrie ; le roi leur avait accordé même de grandes franchises commerciales. Il y avait aussi des Syriens maronites, gens très preux et d’un grand secours dans les guerres ; des Syriens jacobites, dont les prêtres s’adonnaient spécialement à la médecine ; des Syriens nestoriens, actifs et savants, initiateurs des Francs aux sciences orientales ; beaucoup d’Arméniens ; mais ceux-là, on ne pouvait les distinguer des Francs qu’à l’étrangeté de leur type, car, on copiant les mœurs, ils avaient pris aussi les costumes des vainqueurs. Par-dessus tout on les aimait, car leur fidélité et leur dévouement étaient solides ; ils prenaient part à toutes les expéditions militaires, dans lesquelles ils avaient plusieurs fois conquis de la gloire, tellement que les nobles francs ne dédaignaient pas de s’allier à eux. On voyait encore des Géorgiens, aux beaux traits purs, au teint lumineux ; des Grecs schismatiques, reconnaissables à leur haut bonnet pourpre, et un grand nombre d’Arabes, sujets des Francs, mais restés musulmans, qui ne différaient guère, dans leur aspect, des Syriens chrétiens.
À travers la foule, des moines et des nonnes de différents ordres, vêtus de bleu, de noir, de blanc, de gris ou de brun, se faisaient faire place, et ça et là se montraient quelques Bédouins du désert, qui, moyennant un droit de pacage, étaient venus faire paître leurs chameaux au creux des vallées voisines. Curieux de voir l’illustre ville, ils y étaient entrés, après s’être bouché le nez avec un peu d’étoupe, pour éviter les miasmes, et, très étranges dans leurs longues abâyes en poil de chameau, ils s’empêtraient dans la cohue et cherchaient à se dégager, avec de grands mouvements désordonnés d’oiseaux mis en cage. Dans le voisinage du Temple, une seconde foule bruissait au-dessus de la première : toutes les maisons bordant la rue qui aboutissait aux Portes-Précieuses avaient leurs terrasses couvertes de monde, de femmes surtout, et la plupart voilées à la mode syrienne.
Des rires cristallins, et des pépiements pareils à ceux des oiseaux, s’envolaient de deux belles maisons neuves, se faisant face, au portail orné de stalactites. On voyait, dans chaque ogive de leurs fenêtres, des grappes d’enfants, dont les yeux et les dents brillaient, se poussant, se taquinant, se faisant mille malices. C’était l’école des garçons et l’école des filles, où les écoliers avaient une heure de congé pour regarder défiler les chevaliers. Tous les passants levaient la tête et souriaient à cette joie.
Les turcopoles et les sergents d’armes refoulaient les curieux et faisaient la place libre à l’entrée d’un petit pont qui franchissait un ruisseau à sec. Les chevaliers s’arrêtaient là, un moment ; ils apaisaient leur monture, échangeaient entre eux des saluts, attendant que l’écuyer qui portait leur bannière, séparé d’eux par la foule, les eût rejoints ; puis ils prenaient la file pour franchir le ruisseau et pénétraient dans l’enceinte du Temple par le double arceau des Portes-Précieuses.
La cour du Pavement scintillait au soleil, toute pleine, d’éclats d’armes et de miroitements d’étoffes, car, sans compter les sergents de la cour des bourgeois et les turcopoles à cheval, qui faisaient la haie, elle était emplie par tous les privilégiés qui, par droit, ou faveur, pouvaient assister à l’audience du roi : les baillis, les vicomtes, les riches bourgeois, les écrivains, beaucoup de dames en belles toilettes.
Les femmes des poulains, comme on appelait, ceux qui étaient nés de mariages entre Francs et femmes indigènes, se faisaient remarquer surtout par la richesse de leurs parures : robes de soie jaune d’or, longs manteaux traînants, voiles de couleurs claires, brodequins dorés serrant leurs pieds, colliers bruissant à leur cou ; des parfums et des fards avivaient leur teint.
Des damoiseaux s’empressaient autour des chevaliers qui mettaient pied à terre, et des esclaves noirs emmenaient les chevaux, glissant et piaffant sur les pierres lisses.
À droite du Temple du Seigneur, dont l’esplanade et la haute terrasse, autour du dôme, étaient pleines de monde, tout à l’extrémité du grand parvis, apparaissait, d’une blancheur de marbre, la longue façade du Palais de Salomon ; avec ses sept portails, celui du centre haut et majestueux comme un arc de triomphe. Sous le péristyle, bariolé du frisson soyeux des bannières que les écuyers tenaient à deux mains, un instant les seigneurs s’arrêtaient, se retournant vers la place inondée de lumière et bourdonnante d’une si joyeuse cohue ; puis ils s’enfonçaient sous les voûtes, qui, dans la façade ensoleillée, perçaient sept ogives d’ombre.
Immense et sonore, emplie d’un demi-jour frais et reposant, la grand’salle ressemblait beaucoup à une église. Sept travées, correspondant aux sept portes, s’enfonçaient en mystérieuses perspectives, bordées de piliers puissants, que reliaient entre eux de légères colonnades, peintes d’arabesques et rehaussées d’or. Les trois nefs centrales, très élevées, avaient leurs plafonds plats, décorés de caissons entre poutrelles, et richement ornés, tandis que des voûtes couvraient les quatre autres nefs et figuraient un ciel d’azur parsemé d’étoiles d’or. Au fond s’étendait le transept, ayant à son centre une rotonde portant une coupole et éclairée par deux rangées de vitraux. Quatre gros piliers soutenaient la rotonde, et, entre eux, formant le cercle, un feston d’arcades ogivales posait sur de fines colonnes à chapiteaux corinthiens.
Sous le dôme revêtu d’or, dans cette salle ajourrée, faisant face à la nef du milieu, s’élevait le trône royal. Il était surmonté par un dais magnifique en diaspre d’Antioche, bleu céleste, avec, dans sa trame, des colombes tissées en fil d’or et d’argent. Un tapis de Bagdad couvrait les degrés et une partie du sol, interrompant le dessin de la mosaïque qui représentait une eau transparente, ridée par la brise et toute peuplée de poissons.
Il y avait des bancs pour les évêques, des tabourets pour les barons et les pairs, et, non loin du trône, un fauteuil pour l’ambassadeur. Partout de riches étoffes drapaient les colonnes et l’on voyait se balancer mollement, accrochés aux voûtes, les étendards pris à l’ennemi.
Rapidement, la salle s’emplissait. Le bruit des conversations, des rires discrets, des pas froissant le pavé de mosaïque, répercuté aux voûtes, s’enflait et grondait. Mais le silence, subitement, se fit quand des fanfares, déchirant l’air, triplées par les échos, annoncèrent l’arrivée des quatre grands barons du royaume ; il fut même un instant si complet que, les trompettes ayant cessé de vibrer, on entendit distinctement la gerbe d’eau qui jaillissait, d’un élan superbe, au milieu de la nef centrale, s’égrener en pluie dans la vasque de marbre rouge.
On faisait la haie à l’issue des portes pour voir entrer les seigneurs illustres ; mais les plus favorisés, ou plutôt les premiers arrivés, s’étaient rangés autour de l’enceinte royale et formaient, entre les piliers et les colonnettes, une muraille vivante.
Gautier de Tibériade, prince de Galilée, fils aîné de la belle Eschive, remariée au comte de Tripoli, parut le premier et s’avança d’un pas vif dans la nef. C’était un tout jeune homme, vêtu avec une somptuosité rare, car, maître de grands biens, il s’en montrait vain et dissipateur. Sur sa bannière, on voyait des armoiries, d’après une mode prise aux Sarrasins et qui commençait à se répandre parmi les croisés. Le blason, était d’azur à la fasce d’or.
Raymond de Tripoli entra en même temps que son beau-fils ; mais il marchait plus lentement et se laissa devancer par lui. Sur sa bannière en drap d’or était brodé un châtel de gueules.
Le seigneur de Joppé vint ensuite ; puis Hugues, suzerain de Césarée et de Sidon, qui dépassait tous les autres en stature.
Les quatre grands barons gagnèrent les sièges qui leur étaient réservés auprès du trône, tandis que les écuyers s’alignaient dans la travée du milieu, tenant droites leurs bannières, la hampe appuyée au sol.
Successivement arrivèrent : Baudouin de Rama, avec son frère Balian ; Arnulphe de Turnafiel, qui avait été prisonnier des Sarrasins en même temps qu’Hugues de Césarée ; Josselin de Samosate, commandeur de l’infanterie royale ; Gautier de Falkenberg, châtelain de Saint-Omer ; Régnier de Memphis, Guarimond de Tibériade, Jean d’Arsur ; puis deux très nobles seigneurs, nouvellement venus d’Occident ; Étienne, fils du duc de Sancerre, et son neveu, Henri le Jeune, duc de Bourgogne. Ils avaient fait par dévotion le voyage à Jérusalem, voulant visiter les Lieux-Saints, prendre la palme commémorative, « la Palme Idumée », et s’en retourner.
Le clergé parut ensuite, dans la lourde et majestueuse splendeur des habits sacerdotaux : Alméric, d’abord, prieur du Saint-Sépulcre, Patriarche de Jérusalem. C’était un Français, né à Néelle, dans le diocèse de Noyon, près de Compiègne ; âgé déjà, faible et simple, nul même, il était le souffre-douleur des frères de l’Hôpital, contre lesquels il ne savait pas se défendre. Avec lui entrèrent l’archevêque arménien et l’évêque jacobite de Jérusalem, comptés au nombre des suffragants du Patriarche.
Puis vinrent Régnier, abbé de l’église du Mont-Sion, Hernest, archevêque de Césarée, Guillaume, évêque d’Acre, don Albert l’ermite, évêque de Bethléem. Presque en même temps, au milieu d’un long fracas de fanfares, s’avança le Grand Maître des Hospitaliers : Roger de Moris, précédé de la bannière fameuse où l’on voyait, sur champ de gueules, une croix pleine, d’argent.
Le Grand Maître était vêtu d’une robe noire et d’une cotte d’armes rouge ; une riche agrafe retenait le manteau noir, à pointes, dont le capuchon, rejeté en arrière, laissait voir la face hautaine, les longs cheveux bruns et la barbe légère du chevalier ; sur son épaule gauche étincelait la croix blanche à huit branches.
Plusieurs frères de l’Hôpital accompagnaient Roger de Moris, entre autres Gerbert, surnommé Assalit, qui était un homme remarquablement magnanime, généreux jusqu’à la prodigalité. Il avait été Grand Maître avant Roger, mais, malgré son immense fortune, gravement endetté, il avait dû renoncer à son grade.
Des hérauts, sortant d’une salle voûtée, située à l’est du transept et qui communiquait avec les salles privées du palais, annoncèrent, aux sons des trompettes, l’arrivée de la cour et du roi. Puis un chevalier parut, portant l’étendard de Jérusalem, blanc à la croix potencée d’or, et, aussitôt, toutes les bannières s’agitèrent, saluant la bannière souveraine.
Amaury s’avança en vêtements royaux, ayant auprès de lui sa femme, la reine Maria Comnène, nièce de l’empereur de Constantinople. Elle souriait, sous sa couronne rayonnante de pierreries, et traînait après elle un manteau splendide, en se dandinant gracieusement, comme une tourterelle.
Avec le roi marchent les hauts dignitaires de la cour. D’abord, le hautain, superbe et arrogant sénéchal, Milon de Plancy, qui ne cède jamais le pas à personne. Il est proche parent du roi, et, par sa femme, Tiennette de Naplouse, veuve d’Homphroy du Toron, seigneur de la Syrie Sobal. Haut en couleur, noir de poil, l’œil dur, l’air brutal et présomptueux, il parle au roi, tout en marchant, et ricane. Après lui viennent Girard de Pugi, maréchal du royaume ; le chambellan Jean de la Rochelle ; puis Guillaume, archidiacre de Tyr, grand chancelier du royaume, qui va s’asseoir au banc des évêques.
Quelques Templiers entrent en même temps que la cour, car, lorsqu’ils résident à Jérusalem, ils habitent au palais, depuis que le roi Baudouin leur en a cédé une partie. Ceux-ci sont des chevaliers profès, vêtus de la robe blanche à croix rouge. Sur leur blason, on voit deux frères de la milice du Christ montant le même cheval. Derrière la reine marche la princesse Sybille, les comtesses, et un grand nombre de nobles dames. Puis, en dernier lieu, retardé par quelque jeu, essoufflé et le visage tout rose, le jeune Baudouin, fils du roi, héritier du trône. C’est un enfant de douze ans, aux longs cheveux bouclés, couleur de miel, beau et grand déjà pour son âge ; mais il a un bras inerte et porte en lui, sans que l’on s’en doute encore, le germe d’un mal terrible. Auprès de lui, des adolescents, ses compagnons : Abraham de Nazareth et Godescaut de Tuchorit.
Sybille était revêtue d’une robe magnifique en soie de Chine brochée d’argent, de ce tissu rare et précieux que l’on appelait « nacco » ; des cordons de perles et de turquoises s’enroulaient à ses longues tresses, et un voile aérien était attaché à sa légère couronne d’or, ornée de topazes.
Tout de suite son regard chercha Hugues de Césarée, et elle eut un choc au cœur en s’apercevant qu’il ne portait pas le gage qu’elle lui avait envoyé. Son œil bleu devint dur et cruel sous son sourcil froncé ; mais elle retint mal un cri de colère quand parut Homphroy du Toron, précédant l’ambassadeur et qu’elle reconnut, attachée à son épaule, la manche de soie couleur d’azur.
Un grand mouvement de houle agita les assistants, qui se poussaient, se haussaient les uns derrière les autres, pour apercevoir un instant l’envoyé du Vieux de la Montagne. Un diamant énorme flambait à son turban de mousseline lamée d’or, au-dessus de longs sourcils, de joues brunes et d’une barbe d’un noir bleu ; c’était tout ce que distinguaient ceux qui n’étaient pas au premier rang, avec, par moments, l’éclat pourpré du caftan, lourd de broderies.
Le roi fit quelques pas à la rencontre de l’ambassadeur, qui tenait à la main un rameau d’olivier. Il baisa l’Ismaïlien sur la bouche et le conduisit au siège préparé pour lui, tandis qu’un héraut criait :
— Le seigneur Abou Abd-Allah ! envoyé du très illustre Raschid ed-Din, prince des Sept-Montagnes !
Pendant ce temps, Homphroy s’était glissé auprès de Sybille, qui le regardait fixement, pâle de colère et les lèvres tremblantes.
— Oh ! ma princesse, murmura-t-il, prenez-moi en pitié. Votre courroux m’arrache l’âme du corps. Je suis un larron, c’est vrai ; j’ai dérobé un trésor et rompu votre volonté. Mais ce gage serait trempé de sang s’il était arrivé à son adresse. Votre esclave d’Abyssinie est mon prisonnier, et, pour rançon, je demande sa grâce.
— Je vous hais ! dit Sybille, au risque d’être entendue par la reine.
L’ambassadeur avait refusé les services de l’interprète ; il parlait avec facilité la langue franque, et il expliquait au roi le but de sa mission.
— Notre seigneur Raschid ed-Din — que sa bénédiction soit sur nous ! — salue le roi des Francs en lui souhaitant longue vie et prospérité. Il désire conclure avec lui une paix durable, être son ami et l’aider de son pouvoir, lui qui fait trembler les princes sur leurs trônes et disposo à son gré de leur vie. Mais il faut, pour cela, que le roi franc fasse cesser les méfaits et les abus criminels par lesquels les frères de la milice du Temple offensent Raschid ed-Din, notre Seigneur.
Des templiers qui étaient présents se levèrent brusquement à cette attaque, et l’un d’eux fit un pas vers l’ambassadeur. Un regard sévère du roi l’arrêta.
Abou Abd-Allah ne s’était pas interrompu.
— Que le Grand Maître, Odo de Saint-Amand, qui, par fraude et violence, extorque aux populations, voisines de la commanderie du Temple, soumises au prince des Sept-Montagnes, la dîme des récoltes, fasse cesser cet indigne larcin et qu’il respecte nos frontières.
Le templier qui s’était avancé prit la parole, sans l’agrément du roi.
— Il ne s’agit pas d’un larcin, s’écria-t-il, mais d’un tribut annuel de deux mille ducats consenti par le chef des Ismaïliens.
— Jamais aucun chef n’a consenti à ce tribut, toujours arraché par la force, dit Abou Abd-Allah. Le prédécesseur de notre prince actuel, abattu par l’âge, négligeait de punir le crime ; mais Raschid ed-Din ne le souffrira pas, et il serait déjà châtié si, aimant par-dessus tout la justice, notre Seigneur n’avait retenu le châtiment, voulant savoir si la tête a commandé au bras, si le roi Amaury ordonne cette félonie ou bien s’il l’ignore. Je la lui dénonce, et c’est à lui de la faire cesser. C’est ce que je réclame au nom de mon maître.
Amaury avait le visage empourpré et les yeux brûlants de colère. Il répondit vivement, en s’efforçant d’être calme :
— La félonie qui vient de m’être révélée m’offense moi-même autant qu’elle offense le seigneur Raschid ed-Din, car elle a lieu au mépris de mon autorité royale, trop souvent dédaignée par des sujets mutins et orgueilleux jusqu’à la démence…
Les frères du Temple sourdement murmuraient. Mais le roi, se levant de son trône, haussa la voix.
— Je jure que cet abus cessera, quand bien même il me faudrait, pour apaiser la rapacité des templiers, leur payer les deux mille ducats, de mon propre domaine. Je remercie Raschid ed-Din de m’avoir pressenti innocent dans cette affaire. Je veux être dorénavant son ami sincère et dévoué. Voici ma main, en signe de foi.
Le roi s’avança et mit sa main dans la main ouverte de l’ambassadeur. Celui-ci la retint un instant en silence ; puis il s’écria d’une voix éclatante :
— J’accepte ton serment et le tiens pour loyal et irrévocable. Comme gage de notre sincérité, nous sommes prêts, moi et ceux de ma suite, à recevoir le baptême et à confesser la foi chrétienne.
Tous les évêques, en entendant cette déclaration, se levèrent de leurs bancs, et l’archidiacre Guillaume, les bras en croix, entonna avec enthousiasme un cantique d’action de grâces.
Une immense acclamation emplit la salle, se répercutant de nef en nef, à mesure que la nouvelle se répandait. Beaucoup s’élancèrent dehors, en poussant des clameurs de joie. Bientôt, toute la ville, émotionnée jusqu’aux larmes, connut le miracle de ces conversions inespérées, et les cloches se mirent à sonner, comme pour une fête, en l’honneur des nouveaux chrétiens.
V
Le long de la mer, dans l’exquise fraîcheur du matin, quelques cavaliers arabes escortent une litière, portée par quatre mules blanches.
L’azur des premières lames est assombri par l’ombre de rochers gigantesques, qui bordent le rivage et derrière lesquels le soleil se lève. Et ces grandes ombres des montagnes créent sur la plage une atmosphère bleue et froide où la blancheur laiteuse des mules éclate vivement. Les bêtes fringantes sont joliment harnachées de cuirs de couleur découpés à jour et ornés de paillettes et de cabochons. À chacun de leurs pas on voit luire leurs fers d’argent, et elles secouent sur leur front des franges et des houppes soyeuses. Elles sont attelées à la file, deux devant et deux derrière, entre les longs brancards de la litière, et des muletiers les guident.
Sous les rideaux relevés, accoudée à des coussins brodés d’or, une femme dont on n’aperçoit entre ses voiles que les grands yeux mouillés de larmes, sans la voir, regarde la mer.
À ses pieds, une jeune fille, le visage découvert, est accroupie et, contemple sa compagne, en poussant de profonds soupirs.
— Ne pleure plus, Gazileh, dit-elle, après un long silence. Je t’en conjure, regarde les splendeurs qu’Allah a créées et qui se révèlent à nos yeux pour la première fois. Vois ces roches et ces montagnes, colorées de tant de nuances qu’elles semblent taillées dans des marbres rares et formées de pierres précieuses. Vois comme leurs grands reflets s’allongent sur la mer, qui, couleur de turquoise à l’horizon, est, jusque bien loin du rivage, plus foncée que le saphir. Regarde, Gazileh, ô ma chère princesse ! à travers le prisme de tes larmes contemple, au moins un instant, cette merveille de la nature : les premiers degrés du Liban sacré.
— Est-ce que j’ai, rêvé, Nahâr ? est-ce que, vraiment, nous sommes on route pour l’exil ? dit Gazileh, sans tourner la tête. Hier encore, j’étais dans mon palais d’été, à Djebêlé, près de la mer ; j’errais, comme à l’ordinaire, dans le jardin ombreux, sans que rien vînt m’avertir du malheur qui planait sur moi ; paisible, j’émiettais des gâteaux de froment aux oiseaux aquatiques, je riais de leur course folle, de leur cou tendu, des ailes brillantes battant l’eau comme des roues de moulin, de leurs cris rauques, de leurs combats… Soudain, le cher prince parut, oh ! si pâle et dévorant ses larmes ! L’une d’elles, je la vois toujours, restait suspendue à sa barbe blanche ; puis elle roula sur sa main !… Ah ! Nahâr ! est-ce vrai qu’aujourd’hui je suis une captive, un otage ?… que l’on m’entraîne loin de tout ce que j’aimais ?…
— Oh ! toi, si sage et si courageuse, ne m’as-tu pas dit souvent qu’il fallait se ployer devant la destinée, être comme le colimaçon qui prend la forme de sa coquille ? Oui, nous sommes prisonnières ; mais les femmes musulmanes ne le sont-elles pas toujours ? Tu disais aussi : « Contentons-nous d’être comme les fleurs, qui s’épanouissent et embaument à la place où on les a plantées ; n’envions pas les oiseaux. » Et voilà que les fleurs sont des oiseaux aujourd’hui…
— Des oiseaux en cage, Nahâr.
— C’est quelque chose déjà que de changer de cage. Ouvrir les yeux sur des aspects nouveaux ! Ne pas savoir ce qui va vous arriver ! Avoir peur même !…
— C’est toi qui parles ainsi ? toi, si peureuse ? Ton affection pour moi te donne un étrange courage ! Tu veux me soutenir et me consoler quand l’angoisse serre ton cœur comme le mien. Eh bien, par reconnaissance pour ton héroïsme, je vais tâcher d’être moins faible, plus fière devant le malheur.
— N’ai-je pas bien réussi ? s’écria Nahâr en frappant ses petites mains brunes l’une contre l’autre. Ne suis-je pas bien récompensée de mes efforts pour être brave ?
— Nous sommes à Dieu et nous retournons à lui ! dit Gazileh avec un profond soupir. Soyons résignées, comme notre religion ordonne de l’être.
— Écoute, dit Nahâr, en baissant la voix. Nos muletiers causent entre eux. J’ai cru leur entendre prononcer le nom de Raschid ed-Din.
— Ce serait bien singulier, dit Garileh, en se soulevant un peu.
— Les muletiers sont les grands colporteurs de nouvelles ; ils savent tout et répètent tout. Peut-être entendrons-nous quelque chose qui pourra nous être utile.
Elles se turent, tendant l’oreille.
Deux des muletiers marchaient à côté de leurs bêtes, un peu en avant de la litière ; ils causaient, d’abord à voix basse, par respect, puis, peu à peu haussant le ton sans s’en apercevoir.
— Si les Francs sont en marche, disait l’un, c’est pour massacrer et piller. Ils ne font jamais que cela.
— Ils n’étaient pas en route pour des batailles, dit l’autre. On a signalé une flotte vers la pointe de Chypre, qui, sans doute, vient de Byzance : un renfort que l’empereur envoie au roi de Jérusalem, qui est son neveu, puisqu’il a épousé sa nièce. Le roi franc va au-devant de cette flotte, qui mouillera peut-être à Latakieh : il veut protéger le débarquement. On dit qu’on a vu son avant-garde s’engager dans les gorges des montagnes.
— Pourquoi, s’ils n’ont pas quelque projet de pillage, prennent-ils ce chemin, qui est malaisé aux chevaux et deux fois plus long que l’autre ?
— Je te dis qu’ils vont rendre visite au prince des Sept-Montagnes.
— Tu dis cela pour te moquer. Le Scheikh el-djebel ne se laisse pas approcher aussi facilement.
— Il y a des accords entre eux.
— À la place des Francs, j’aimerais mieux m’accorder de loin avec un aussi terrible seigneur.
— Si ces ennemis de la foi, ces satans d’outremer, tombent dans quelque embûche, je dirai seulement : Dieu est grand !…
Et, brusquement, tirant du fond de sa gorge une vibration rauque, le conducteur s’élança à la tête de la première mule, qui allait butter contre un rocher.
— Eh bien, princesse, que penses-tu de cela ? dit Nahâr.
— Je ne vois rien dans ces propos qui puisse nous intéresser directement, dit Gazileh. Nous savons seulement que d’autres victimes que nous-mêmes sont à la merci du redoutable prophète, et que ce malheureux pays, trempé de sang, au nom du Dieu très bon, recevra sans doute une nouvelle rosée.
— Déplorons nos propres peines, Gazileh, je t’en conjure : elles sont assez lourdes pour nos faibles cœurs, sans que nous nous chargions encore des peines de toute l’humanité.
Gazileh eut un sourire et détacha son voile pour respirer mieux, laissant un instant rayonner sa merveilleuse beauté dans la solitude de cette grève. Puis, ses regards, lourds de tristesse, suivirent distraitement, sur les flots, de plus en plus lumineux, les voiles doubles, couleur de neige, hautes et aiguës, qu’une brise faible gonflait doucement. Elle s’intéressa, malgré elle, au vol si gracieux de ces barques de pêcheurs, qui semblaient seulement effleurer l’eau bleue.
— Certes, elles sont bien nommées kirlanguitch, avec leurs longues ailes minces, ces barques. Elles ressemblent tout à fait à des hirondelles, des hirondelles qui seraient blanches.
— Ah ! vois donc, s’écria Nahâr, qui se penchait pour mieux regarder : des étincelles ! de l’argent fluide !… Les pêcheurs tirent leurs filets de l’eau !
Bientôt, une ville apparut, dans une courbe du rivage, un port, des navires à hautes coques peintes, des fumées qui montaient. C’était Markab, une grosse bourgade, sur la frontière de la principauté d’Antioche et du comté de Tripoli.
Les Arabes de l’escorte se rapprochèrent, éperonnant leurs chevaux frêles, aux longues crinières envolées. Gazileh, vivement, referma son voile. On donnait des ordres aux muletiers, concernant la route à suivre. Un ruisseau torrentueux bondissait, coupant la plage, dont il creusait le sable. Tournant le dos à la mer, la petite, caravane suivit le bord du ruisseau, le remontant, et s’engagea dans la gorge étroite, resserrée entre deux rochers gigantesques, où le torrent courait en cascades folles.
Ce chemin était ardu et vertigineux ; les hautes parois de grès sombre semblaient monter jusqu’au ciel, et un demi-jour de souterrain régnait au fond du ravin.
Une tristesse plus lourde s’abattit sur le cœur des deux femmes, qui se penchèrent pour voir encore une fois la mer et le ciel libre. Elles ne parlaient plus, assourdies par le tumulte effrayant de l’eau rebondissante, qui, même, empêchait de penser.
La route montait rapidement, tout en s’enfonçant dans la montagne. Les muletiers tenaient la bride des mules tout près du mors et marchaient entre elles et le torrent. Malgré tous leurs soins, la litière était cahotée et penchait en arrière. Les voyageuses ne pouvaient s’occuper d’autre chose que de s’y tenir en équilibre. Puis la route devenait plus plane. Étourdies et lassées, elles tombèrent dans une sorte d’engourdissement, presque de sommeil.
Quand on fit halte sur un haut plateau, près d’un bouquet de sycomores, il était déjà plus de midi, et il ne fallait plus que quelques heures de marche pour atteindre le but du voyage.
On était en pleine montagne maintenant, et, de ce point élevé, les regards embrassaient, de toutes parts, un tableau si merveilleux que Gazileh oublia ses peines à le contempler.
À perte de vue, les monts ondulaient comme les lames monstrueuses d’une mer pétrifiée, les uns pelés et aigus, les autres arrondis en dômes, creusant entre eux des abîmes aux parois droites comme des murailles, avec des luisants de miroirs, ou bien glissant en pente douce, jusqu’au fond des vallées verdoyantes et fécondes. Des végétations puissantes escaladaient les côtes, les arbres ayant leurs cimes au niveau des racines de ceux qui les précédaient. Il y avait des cyprès et des pins, des chênes et des genévriers au bois incorruptible. Sur les plateaux apparaissait la merveille du Liban : les cèdres plusieurs fois séculaires. De leurs larges bras, chargés de draperies sombres, ils semblaient bénir toute la contrée.
Des villages d’un blanc éclatant se montraient suspendus au-dessus des abîmes ; ils s’accrochaient aux parois des rochers, à des hauteurs invraisemblables. Quelques-uns se faisaient face et ainsi étaient tout proches dans l’air, si bien que leurs habitants pouvaient se parler en haussant un peu le ton, tandis que, pour aller de l’un à l’autre, il fallait faire plus de quatre lieues en descendant et en remontant les sentiers.
Sur les moins hautes des collines prospéraient les mûriers et les oliviers au feuillage cendré ; plus bas encore, les palmiers, les dattiers et aussi les bananiers, ces « arbres du paradis ». Dans les vallées, où l’argent des rivières luisait, les champs cultivés se déployaient comme de riches tapis de couleurs diverses. Le jaune des blés s’arrêtait net où commençait le vert tendre d’un champ d’asperges, des plantations de canne à sucre côtoyaient les larges bandes où poussait le henneh, et des parterres de roses, de narcisses et de giroflées s’étalaient, promettant une riche moisson de parfums.
Gazileh fit le tour du bois de sycomores pour regarder à l’autre versant du mamelon. Mais alors elle eut un sursaut de saisissement en voyant se dresser devant elle, au sommet d’un rocher à pic qui semblait inaccessible, un formidable château.
— C’est Maçiâf, s’écria-t-elle en s’appuyant presque défaillante, à l’épaule de Nahâr.
— Le château de Raschid ed-Din ! notre prison, dit la jeune fille. Hélas ! il est aussi terrible que superbe.
On eût dit qu’il était taillé dans la montagne même, que ce rocher vertigineux en faisait partie, que ses tours, ses créneaux, ses dômes, ses arcades avaient été découpés ainsi par la main géante d’un enchanteur. Il était si haut que les oiseaux à peine y pouvaient atteindre et que les orages éclataient à ses pieds.
Aux deux jeunes femmes, qui le regardaient, fascinées d’horreur et d’admiration, il semblait tout proche ; cependant elles en étaient séparées encore par plusieurs collines et par une large vallée, dans laquelle une jolie ville apparaissait, ceinte de murailles, avec une mosquée à son centre.
Les gens de l’escorte donnèrent le signal du départ, et on commença à descendre, entre des arbres et des rochers, un sentier qui s’enroulait en spirale autour du mamelon. Puis le chemin s’encaissa, dévalant presque à pic ; ensuite, on contourna une roche énorme, qui semblait un quartier de montagne brisé, pour aboutir à un haut vallon qu’il fallait traverser.
Tout à coup, au tournant du rocher, au moment où l’on débouchait dans le vallon, les mules bronchèrent, se rejetèrent d’un brusque mouvement en arrière, effrayées par un horrible tumulte qui éclata si soudainement que la petite caravane demeura un instant comme pétrifiée, incapable de comprendre ce qu’elle voyait ni ce qu’elle entendait.
Les cavaliers de l’escorte se remirent les premiers et firent descendre rapidement les deux femmes de la litière, secouée d’une façon désordonnée par les bêles affolées.
On était tombé au beau milieu d’un combat engagé entre des Francs et des Arabes, dans une mêlée féroce atteignant son paroxysme. Tous les bruits de la montagne, le grondement continu des torrents et des cascades avaient sans doute couvert le bruit de ce carnage, enfermé dans cette gorge étroite, qui en gardait la clameur sinistre et en buvait le sang. Et ainsi, brutalement, le danger se révélait trop tard pour qu’on pût l’éviter.
Masquée à demi par des buissons, une grotte ouvrait sa bouche obscure, à quelques pas dans le vallon. Gazileh et Nahâr se réfugièrent là, tandis qu’on dételait les mules, qui menaçaient de tout briser et ne pouvaient tourner dans le sentier trop étroit. Les gens de l’escorte rebroussèrent chemin, afin de chercher, sans doute, une autre issue.
Une poussière brûlante emplissait ce val, mêlée à une buée de sueur et de sang, que le soleil vaporisait. On entendait, au milieu des hurlements de rage ou de douleur, d’affreux chocs, des grincements de métal, des coups sourds, et, confusément, l’on voyait des chevaux renversés, donnant des ruades d’agonie ; des hommes, pareils à d’étranges monstres luisant d’écaillés, s’étreignant comme pour s’embrasser ; des bras levés qui retombaient ; des globes de fer hérissés de pointes, allant et venant, pleurant du sang, pareils à des têtes coupées. Les lances et les épées qui se croisaient semblaient former une palissade, et, par moments, le chanfrein d’acier d’un cheval cabré jetait une lueur aveuglante.
Les jeunes femmes, frémissantes d’horreur, ne pouvaient cependant pas arracher leurs regards de cet effrayant spectacle.
Bientôt elles se rendirent compte de la marche du combat et distinguèrent l’inégalité des adversaires : les Arabes étaient beaucoup plus nombreux que les chrétiens, qui se battaient en désespérés, retardant seulement, à force d’héroïsme, leur mort certaine.
Les chrétiens semblaient avoir été surpris dans leur camp, car, de loin en loin, quelques tentes restaient encore debout. Les vivants diminuaient rapidement ; beaucoup se rendaient, jetant leurs armes, et on leur liait les mains. Ceux qui restaient s’enfuirent, et les vainqueurs se jetèrent à leur poursuite.
Quelques combattants isolés, cependant, entourés d’ennemis, restaient en arrière, luttant encore. Gazileh en remarqua un, à vingt pas de la caverne où elle était blottie avec sa compagne, si grand qu’il dépassait de la tête tous ceux qui l’attaquaient, d’une force si terrible que la nuée d’adversaires qui l’entourait ne l’avait pas encore abattu. Il portait, comme tous les chevaliers francs, la chemise de mailles et le casque conique avec le nasal massif qui masquait entièrement le visage. Il n’avait plus d’autre arme qu’un tronçon d’épée ; un pied sur le cadavre de son cheval, il se servait de la lame rompue avec tant d’adresse qu’il faisait plus de blessures encore qu’il n’en recevait. À travers les cris que poussaient ses assaillants pour l’étourdir, on distinguait le halètement rauque de sa respiration, et Gazileh était oppressée horriblement par ce souffle, pénible comme un râle, qui trahissait les derniers efforts du héros, prêt à succomber.
— Ah ! c’est lâche, dit-elle enfin, tant d’adversaires contre un seul homme…
— Puisqu’il refuse de se rendre ! dit Nahâr.
Un cavalier kurde accourut, fit tournoyer sa masse d’armes et, de haut, assomma le chevalier franc, qui tomba, tout d’une pièce, en arrière.
Gazileh s’était caché le visage, en poussant un cri d’horreur, qui se perdit dans les cris de triomphe.
Quand elle découvrit ses yeux, les vainqueurs avaient disparu. Un silence plus terrible encore que le tumulte de tout à l’heure régnait sur le lieu du carnage. Rien que de faibles plaintes, quelques gémissements qui allaient s’éteignant.
Gazileh tendait l’oreille.
— Ce chevalier n’est pas mort ! s’écria-t-elle.
— Il râle, dit Nahâr.
Elles écoutaient, regardant vera la place où il était tombé.
Le mourant, en effet, eut un tressaillement, s’efforça de se soulever et, d’une voix à peine distincte, cria :
— À boire !
Puis il retomba.
Gazileh s’était élancée hors de la caverne ; mais Nahâr se jeta au-devant d’elle, la saisit à bras-le-corps. Elle criait :
— Que veux-tu faire ? N’y va pas ! n’y va pas ! C’est un infidèle, un soldat franc !…
— C’est un blessé !
Et Gazileh se dégagea, courut vers le chevalier, enjambant les morts, traînant, sans y prendre garde, sa robe dans des flaques sanglantes. Elle s’agenouilla près de lui, le souleva, fit sauter le casque, bosselé et troué, à travers lequel le sang jaillissait comme d’une source.
Le chevalier était évanoui, s’il n’était mort. Sa tête roula, inerte, sur les genoux de la princesse.
— Le coffret ! Nahâr,… et qu’un des muletiers cherche de l’eau.
La voix saccadée et impérieuse ne souffrait pas de réplique ; Nahâr obéit.
Elle revint promptement, apportant de l’eau dans le seau de cuir qui servait à faire boire les mules, et, curieuse, elle se pencha vers le blessé.
— Ah ! il fait peur avec sa face toute voilée de sang, dit-elle en se rejetant en arrière.
Gazileh avait dénoué pour l’imbiber l’écharpe qui serrait sa taille, et elle baignait avec précaution le visage du chevalier.
— Vois comme le voile se déchire et s’écarte.
— Mais, c’est un tout jeune homme !… s’écria Nahâr. Je n’ai jamais vu d’aussi près un infidèle. Il est beau, n’est-ce pas ?…
— La blessure est là, au sommet du front, sous, les cheveux, béante et laissant fuir le sang à flots. Il faut l’arrêter, ce sang.
Un coffret de velours bleu, à coins d’argent, que Nahâr lui présentait tout ouvert, contenait tous les objets nécessaires à un pansement, et Gazileh, d’une main légère ot experte, rapprocha les bords de la plaie, qu’elle lava plusieurs fois avec un baume puissant, sous lequel le sang se figea ; puis elle la couvrit d’amadou et entoura la tête d’un bandeau serré.
— Je crois que tu assistes un mort, disait Nahâr.
— Mort ? Non, il ne l’est pas. Je sens battre son cœur sous ma main. L’épaisseur du casque a amorti le coup ; c’est sa brisure qui a creusé cette plaie affreuse. Mais l’os n’est pas atteint, et la blessure peut n’être pas mortelle. Vois, il soupire… Aide-moi ; essayons de le faire boire.
Elle prit vivement, dans le coffret, un gobelet et y versa tout le contenu d’un flacon d’or.
— L’élixir ! s’écria Nahâr… Ah ! princesse, tu oublies donc combien des nôtres il a tué ? C’est crime, vraiment, de vouloir ressusciter un pareil adversaire.
— Ne serait-ce pas humiliant pour la vaillance de nos guerriers de laisser mourir celui-ci à cause de sa vaillance ? Aide-moi !
Elle eut beaucoup de peine à écarter les dents serrées du blessé ; mais dès que la première goutte de la liqueur eut glissé jusqu’à sa gorge, il but avidement et parut se ranimer.
Ses yeux se rouvrirent, troubles et las, sans regard encore.
Gazileh avait rejeté son voile, elle se penchait, guettant avec anxiété ce lent retour à la vie. Mais, tout à coup, la pensée revint dans ce regard ; le visage du mourant, crispé par la souffrance, se détendit ; un sourire entr’ouvrit ses lèvres, et il contempla Gazileh avec une expression si ardente de joie et d’amour qu’instinctivement elle ramena les plis de son voile.
— Puisqu’il t’a vue ! dit Nahâr.
Le blessé avait joint les mains.
— Merci, seigneur Christ, dit-il : vous avez exaucé mon vœu, vous faites un miracle pour votre soldat !…
— Ce n’est pas votre Dieu qui fait le miracle, dit Nahâr, mais bien Allah, le très grand. C’est lui qui a conduit près de vous la femme unique qui, au lieu de pierreries et de parures, porte, en voyage, des drogues et des baumes dans son coffret à bijoux, estimant que trop de rubis déjà ruissellent par le fait des épées et qu’une larme de pitié vaut tous les diamants du monde.
— Tais-toi, folle. C’est le premier devoir des femmes, en ce temps de constantes batailles, de savoir panser les blessures… N’en avez-vous pas d’autres, chevalier, que celle qui, si douloureusement, vous meurtrit le front ?
— Qu’importe ? dit le jeune homme, d’une voix pleine de douceur. Je vais mourir, puisque vous êtes là !
— Me prenez-vous pour Israfil, l’ange de la mort ?
— Vous êtes la récompense de toutes mes peines terrestres, vous êtes celle qui emplissait mon cœur de douleur et de délices… J’ai demandé à Dieu de vous voir une fois encore et de mourir, et Dieu m’a entendu.
— Il a le délire, Nahâr, dit Gazileh.
— Un délire heureux, en tout cas, car son visage exprime la plus douce extase.
— Oui, cette folie est une grâce du ciel ; elle l’empêche de sentir son mal.
— J’ai toute ma raison, dit le chevalier. Il y a trois ans, étant prisonnier de guerre, je vous ai vue à Djébélé.
— À Djébélé ?
— Je vous ai vue au prix d’un crime : j’ai violé le secret de votre retraite, par fraude et escalade, tandis que vous rêviez dans un kiosque, près d’un ruisseau, mon regard a dérobé votre image divine.
— Le kiosque d’or de ta maison d’été ! dit Nahâr.
Gazileh était tout interdite et contemplait avec une sympathie croissante cette belle tête blonde, à laquelle le bandeau sanglant faisait comme une couronne ; cette tête inconnue, qui avait son genou pour oreiller.
— Après trois années, vous avez pu me reconnaître ? dit-elle.
— Pendant trois années, nuit et jour, je n’ai vu que vous… Ah ! donnez-moi l’absolution de mon forfait, et dites-moi votre nom, que je l’emporte dans l’éternité.
— Vous ne l’emporterez pas aussi loin, j’espère. Gazileh est mon nom… Ne me direz-vous pas qui vous êtes ?
— Je suis Hugues de Césarée, le plus humble des serviteurs du Christ.
— Ce nom est illustre, même parmi nous, dit Gazileh. Je suis heureuse d’avoir pu secourir un aussi preux chevalier, de l’avoir sauvé, j’espère.
— Ah ! Madame, je dois mourir, puisque le ciel a exaucé un vœu dont ma vie est le prix.
— Voyez, votre sang a cessé de couler ; il fuyait à flots, et c’est cela qui vous eût fait périr. Vous vivrez, j’en réponds.
— Ah ! princesse ! s’écria tout à coup Nahâr, on dirait que les vainqueurs de tout à l’heure reviennent en désordre, comme s’ils étaient poursuivis. Ne restons pas ici : les chrétiens pourraient nous faire prisonniers.
— Hélas ! dit Gazileh, prise par les Francs, cela ne sera pas pire pour moi que d’arriver saine et sauve au château de Raschid ed-Din !
— N’allez pas là, s’écria Hugues de Césarée, en faisant un effort pour se soulever. Le Vieux de la Montagne est un traître, un maudit. Nous campions ici, en amis, sur la foi de sa parole, et, brusquement, sans même nous défier, ses sectaires se sont rués sur nous… Vous êtes en danger ?… Ah ! je veux vivre pour vous défendre… Dites, que faut-il faire ?
— Il n’y a pas de défense possible, répondit Gazileh, en baissant la tête. Raschid ed-Din n’accorde la paix à mon grand-oncle, le prince de Hama, accablé par les défaites, qu’à la condition que je lui serai livrée comme otage. À la moindre irritation contre le vaincu, l’implacable prophète me brisera. Et quel secours espérer dans cette inaccessible forteresse, dont la vue seule fait frémir ?
— N’y entrez pas. Fuyez : je vous protégerai.
— Et alors mon bien-aimé prince tomberait sous le poignard !… Non, je dois me résigner. D’ailleurs, la fuite est impossible. Les gens qui nous conduisent veillent aux alentours ; ils se sont éloignés pour ne pas dénoncer par leur présence, sans doute, notre refuge ; mais ils ne nous laisseraient pas nous échapper…
Des cris éclataient, de plus en plus proches. Celui-ci domina bientôt :
« Dieu aide son Sépulcre ! »
— Victoire au Christ ! s’écria Hugues. Ce sont les Francs !
Des Arabes passaient au galop de leurs chevaux. Ils criaient : « Dieu est grand ! » tout en fuyant, sans désordre toutefois.
— Viens vite, princesse, dit Nahâr : nos gardiens te cherchent.
— Adieu, dit Gazileh.
Mais Hugues s’accrochait à sa robe.
— Par grâce, à ce château, un signe, quelque chose qui m’avertisse que le danger est venu pour vous !…
— Eh bien ! mon voile blanc à l’un des créneaux.
— Merci !
— Adieu !… mon chevalier.
Elle s’enfuit, en masquant son visage dans les mousselines, tandis que Hugues, se soutenant sur les mains, la suivait des yeux avidement : mais bientôt, à bout de forces, sa vue se troubla, et il retomba, évanoui, au milieu des cadavres.
VI
Homphroy du Toron se penchait vers lui et tenait sa main, lorsque Hugues rouvrit les yeux.
Il était sous une tente, et, à quelques pas de son lit, le médecin arabe du roi préparait un breuvage.
— Il s’éveille ! il s’éveille ! s’écria le jeune connétable.
Et le médecin, s’approchant, fit boire la potion au blessé.
— Où donc sommes-nous ? demanda Hugues.
— Dans la vallée de Maçiâf, en face du château du Vieux de la Montagne, répondit Homphroy. Le roi s’est établi là.
— Le roi ?…
— Nous étions tout près de rejoindre l’avant-garde, que vous commandiez, quand votre messager accourut pour nous dire de ne pas avancer, qu’il y avait trahison. Au lieu de nous arrêter, cette nouvelle nous a fait nous jeter en avant pour vous secourir. Mais les ennemis ont fui devant nous sans accepter le combat. Ils ont disparu dans ce château, au pied duquel le roi a fait dresser son camp. Il va assembler le conseil afin de délibérer sur ce qu’il nous reste à faire, pour tirer vengeance de ce chien.
— Pourrai-je assister au conseil ? demanda Hugues au médecin.
— Sa Majesté attend que je me prononce sur votre état, répondit celui-ci.
— Il n’est pas en danger ? demanda Homphroy.
— Non, connétable ; j’espère même une prompte guérison. Je vais dire au roi qu’il peut assembler le conseil ici même, comme il le désire.
Et le savant arabe sortit de la tente.
— Hugues ! mon cher Hugues ! s’écria alors Homphroy, que je suis heureux de vous voir revivre. C’est moi qui vous ai découvert parmi les morts. Dieu ! avec quelle douleur ! car vous sembliez n’être plus de ce monde… Mais dites-moi, maintenant que nous sommes seuls, comment se peut-il que, navré si grièvement et n’ayant pas un vivant auprès de vous, nous vous ayons trouvé pansé si merveilleusement que le médecin n’a rien trouvé à reprendre ?
— Ah ! c’est donc vrai ! je n’ai pas rêvé ! dit le blessé. C’est elle ! Elle est venue ! Je sais son nom !… Le Christ a fait pour moi un miracle : il a exaucé mon vœu, et il me laisse la vie !
— Quoi ?… Cette infidèle, vous l’avez revue ? Mais, silence ! Voici les damoiseaux qui viennent disposer des sièges : le roi est impatient de délibérer.
Amaury parut presque aussitôt, en effet, et s’approcha du blessé.
— Que Dieu vous conserve à notre amour, lui dit-il, vous, un de nos plus parfaits chevaliers ! Dans quel état vous voici !
— Votre compassion m’est bien précieuse, sire, dit Hugues. J’espère vous servir encore, avec l’aide du Christ.
— Pouvez-vous me dire, sans lassitude, en quelles circonstances le prince des Montagnes vous a attaqué ?
Hugues se souleva un peu, tandis que Homphroy lui amassait des coussins derrière le dos. Il répondit :
— Nous campions depuis trois jours dans ce haut val où vous nous avez trouvé, sans voir âme qui vive, sans que rien ait bougé dans le château muet. Des hérauts envoyés par moi, tout d’abord, restèrent une demi-journée au pied des murailles, sonnant de leurs trompettes, sans obtenir de réponse. Plusieurs des nôtres disparurent, entre autres mon écuyer Urbain, le fils du vicomte de Chaco. Je pensais que le Vieux de la Montagne, qui passe pour être un magicien, voulait surprendre notre imagination par quelque étrangeté ; mais la surprise fut autre : une troupe de cavaliers, dix fois nombreuse comme celle que je commandais, se jeta sur nous à l’improviste et nous mit dans l’état que vous voyez.
— Et, devant moi, cette même troupe a fui, précipitamment, en refusant le combat, dit le roi. On a cru voir un signal sur le donjon du château. Je redoute un piège. Ces sectaires ont la réputation de ne jamais reculer, et le Vieux de la Montagne nous laisse nous installer bien près de sa ville et de son château.
— Voici le conseil du roi, dit le connétable.
Milon de Plancy entra le premier, le visage rouge et les sourcils froncés.
Puis vinrent le comte de Tripoli, l’archidiacre Guillaume et les principaux barons. Le roi s’étant assis, quelques-uns l’imitèrent ; les autres restèrent debout.
Amaury mordillait sa barbe avec impatience, toujours embarrassé quand il fallait parler. Il commença d’une voix sourde, en zézayant comme d’ordinaire.
— Vous savez tous de quelle façon courtoise j’ai traité Boabdil, l’ambassadeur du Vieux de la Montagne ; vous vous souvenez de la magnificence des fêtes données en son honneur, et de la cérémonie de son baptême, qui avait mis toute la ville en liesse. Il quitta Jérusalem, très satisfait en apparence, emportant des présents pour son maître et, pour le préserver lui-même de toute attaque, notre sauf-conduit royal. Il était chargé de dire à Raschid ed-Din qu’il nous précédait seulement de quelques jours, que, passant dans les environs de ses domaines pour aller protéger le débarquement d’un renfort qui m’arrive par mer, je ferais, avec plaisir un détour afin de me rencontrer avec lui. Comment celui qui nous offrait son amitié et ordonnait aux siens d’embrasser notre foi, est-il devenu tout à coup notre ennemi ? Il y a dans ceci quelque chose d’incompréhensible…
— Allez-vous attendre d’avoir compris pour attaquer le château ?… s’écria Milon de Plancy en interrompant le roi. Égorgeons ce traître et pillons son repaire : on dit qu’il y a là d’immenses richesses.
— Il vaut mieux trop méditer avant d’agir que de se repentir plus tard d’avoir agi sans réflexion. Ton avis, Guillaume ?
— Si je puis parler franc, sire, dit le chancelier, je dirai qu’il faut, dans le cas présent, patience et prudence, car la colère du prince des Assassins peut amener la ruine irréparable du royaume de Jérusalem.
— Voilà bien un discours de prêtre ! s’écria Milon d’une voix furieuse. Essuyons patiemment le crachat sur notre face, n’est-ce pas ? Tendons l’autre joue si on nous soufflette !… Sommes-nous fous ?… L’ennemi est en fuite, et c’est nous qui tremblons.
Guillaume, sans cesser d’être calme, reprit, parlant au roi :
— Vous pensez comme moi, sire, que, le royaume du Christ étant fondé, tous nos efforts doivent tendre à le conserver en recherchant la paix, car, aujourd’hui, une alliance vaut mieux pour nous que plusieurs victoires.
Mais le sénéchal ne le laissa pas finir.
— C’est une honte d’entendre de pareilles choses ! cria-t-il. Des alliances avec les mécréants ! N’êtes-vous plus chrétiens ? Ah ! ces païens ! Ils vous ensorcèlent ; tout en eux vous attire ; vous prenez leurs atours, leurs armes, leur mollesse ; au lieu de horions, vous échangez avec eux des présents, et même on voit cette chose incroyable : des fraternités d’armes entre des soldats du Christ et des sectaires de Mahomet.
Et, comme il y eut des murmures, il reprit :
— Il ne faudrait pas chercher bien loin… Personne ne niera qu’Homphroy du Toron, l’ancien, n’ait eu pour frère d’armes un émir de Nour ed-Din, et le comte de Tripoli…
Homphroy s’élança, tout pâle.
— Je ne permets à personne de toucher à la mémoire de mon grand-père, dit-il.
Raymond de Tripoli se contentait de ricaner en tiraillant sa barbe.
— Allons, paix ! paix ! dit le roi. Vous fatiguez le blessé.
— Haïr l’ennemi, le tuer et le piller, voilà ma devise en terre sainte, et c’est la bonne !
— Sénéchal, tu parles beaucoup, dit Amaury.
— Eh bien ! bonsoir ! Je vais dormir. Quand vous aurez fini vos piteux conciliabules et que ce sera aux langues d’acier de s’agiter, vous me trouverez.
— Bon somme, cousin ! dit le roi.
Et Milon de Plancy s’en alla, en remuant ses fortes épaules qui lui engonçaient le cou.
— Quelle insupportable arrogance ! s’écria Homphroy.
— Il nous réduit tous au silence, dit Guillaume.
Et le comte de Tripoli ajouta :
— C’est comme un bœuf affolé par les mouches : il n’y a qu’à laisser la route libre devant sa course.
— Pardonnez-lui, dit le roi, pour les rudes coups qu’il donne dans les combats, et hâtons-nous de délibérer. Quel événement a pu changer si brusquement l’amitié en haine ? Voilà ce qu’il faudrait savoir. Nous étions partis le cœur en joie, comme pour une fête, à tel point que les dames nous accompagnaient et que nous avons chassé tout le long du chemin. Et voilà que nous arrivons pour relever des morts et des blessés… Nous écrirons à Raschid ed-Din, pour lui demander la raison de sa conduite, et, si c’est seulement par caprice et traîtrise qu’il a ainsi changé d’humeur, nous lui déclarerons la guerre. Direz-vous comme moi, Hugues de Césarée ?
— Sire, vous parlez sagement, et, malgré que j’aie le cœur navré d’avoir vu périr autour de moi tant de braves compagnons, je me soumets à votre avis.
— Faisons comme vous dites, mais faisons vite, sire, dit Raymond ; sinon, il y aurait de la honte sur nous.
— Dès l’éveil, demain, j’adresserai une lettre au prince des Assassins, et un héraut cornera devant son donjon, dit le roi en se levant.
La nuit était venue, très rapide et très profonde entre ces hautes montagnes, et, de tous côtés, dans le camp chrétien, des feux s’allumaient. Entre les pics qui dentelaient le ciel, les étoiles brillaient aussi, et toutes ces lumières, au fond de la vallée, faisaient croire qu’un lac reflétait les astres.
La tente du roi était dressée au milieu du camp. On tripla les gardes autour d’elle, et, même, plusieurs chevaliers veillèrent à l’intérieur. Sans relâche, on fit des rondes, et, de temps à autre, les sentinelles s’appelaient pour marquer leur vigilance.
Homphroy était resté auprès de Hugues. Il avait fait dresser un lit à côté du sien, et, comme le blessé, tourmenté de fièvre, ne pouvait dormir, ils causaient tous deux à demi-voix. Hugues contait l’apparition de Gazileh au moment où il croyait mourir et le bonheur céleste qu’il avait eu de la revoir. Homphroy lui parlait de Sybille, de ce voyage fait en sa compagnie. Elle le traitait comme un esclave et l’assurait de sa haine ; pourtant, il continuait à porter la manche d’azur et ne se rebutait de rien. La jalousie ôtée de son cœur, il n’y avait plus que de l’amour, et il espérait vaincre à force de constance.
Pendant la route, il avait eu le bonheur de faire revenir un tiercelet à la princesse auquel elle tenait beaucoup et qui s’était échappé. Elle l’avait payé d’un « merci » bien sec, mais n’avait pu cacher le plaisir qu’elle avait à revoir son oiseau favori. Et il semblait à Homphroy qu’à cause de cela elle le haïrait moins.
Hugues, à la fin, s’assoupissait. Homphroy se tut, et il allait s’endormir à son tour, quand un cri terrible, parti du centre du camp, le fit bondir à bas de son lit et s’élancer hors de la tente.
Il se heurta à des gens demi-nus, éveillés comme lui et affolés par ce cri. On courait de-ci de-là, s’interrogeant :
— Quoi ? Qu’y a-t-il ? Ce cri !…
— J’en suis tout tremblant !
— Qui a crié ?
— C’est chez le roi !
— Que Dieu nous assiste !
— Oui, oui, c’était la voix du roi !
— Courons…
Devant la tente royale, en effet, des lumières s’assemblaient. Tout à coup, le roi parut, en vêtement de nuit, très pâle, tremblant d’émotion et de colère. Il tenait à la main un poignard.
— Voilà comment on veille ! dit-il d’une voix altérée ; c’est ainsi que l’on garde le roi ! Fouillez la tente. Quelqu’un y est entré, et vous l’avez laissé faire.
Sybille accourut, ses beaux cheveux blonds épars sur sa tunique blanche. Elle se jeta dans les bras du roi.
— Ah ! mon père, s’écria-t-elle, qu’est-il arrivé ? Qui a poussé ce cri ? Il m’a semblé que c’était vous !
— Chère fille ! J’aurais pu t’embrasser hier pour la dernière fois.
— Ce poignard ! Vous êtes blessé ?
— Non, grâce à Dieu ! Ou plutôt parce que mon ennemi m’a fait grâce. Voyez, messires : malgré votre vigilance, au milieu du camp, gardé par mes meilleurs chevaliers veillant dans ma tente même, ce poignard vient d’être planté, au chevet de ma couche et d’y clouer ce papier !
Sybille prit le papier et lut à la clarté des torches :
« Celui qui a enfoncé là ce poignard pouvait aussi aisément le plonger dans ton cœur. »
— Je me suis éveillé en sursaut et j’ai vu briller cette lame tout près de ma tempe, dit Amaury ; l’angoisse et la surprise m’ont arraché ce cri.
Sybille faisait remarquer que le poignard était empoisonné jusqu’à mi-lame et que des mots étaient gravés. Homphroy lut en arabe : « Le Khâlîfe de Dieu. »
— C’est ainsi que l’impudent signe ses crimes, dit-il.
On avait fouillé la tente sans rien découvrir. Tout était en ordre et tout était changé de place cependant. Les grands chandeliers qui brûlaient au pied du lit avaient été transportés au chevet ; les sièges qui étaient à droite étaient à gauche.
— Ah ! homme terrible mais lâche et sournois ! Sors donc de ta forteresse et viens te mesurer avec moi, s’écria Homphroy en tendant le poing dans la nuit.
— Pas de menaces vaines, dit le roi. Puisque Raschid ed-Din ne m’a pas tué, m’ayant en son pouvoir, c’est qu’il ne veut pas ma mort… Dès que le jour sera venu, nous nous efforcerons de lui faire parvenir la lettre que je vais écrire.
Amaury rentra sous sa tente et appela auprès de lui le chancelier Guillaume, qui remarqua, avec chagrin, combien le roi paraissait troublé et abattu.
— Sire, remettez-vous, dit-il : le ciel ne vous abandonnera pas.
— Ah ! Guillaume, vois à combien peu tient notre vie.
— Un soldat du Christ doit être prêt à toute heure à paraître devant son Juge.
— Ce n’est pas la mort qui m’effraye, tu le sais bien ; mais j’ai peur d’être surpris par elle en état de péché. Tiens… j’aurais pu m’en aller là, tout à l’heure, sans confession, et la conscience chargée d’une faute que je n’ai jamais osé t’avouer.
— Quoi ? mon fils ! s’écria Guillaume d’un ton sévère, vous avez des secrets pour Dieu, qui sait tout ? Voyez à quoi cela vous expose.
— J’ai eu tort, c’est vrai… Eh bien ! écoute-moi tout de suite. Qui sait si la minute prochaine m’appartient ?
— Je vous écoute, mon fils. Confiez-vous à Dieu : sa miséricorde est infinie.
— Voici. C’est très ancien, ce péché-là ; ce n’est pas le roi qui l’a commis, c’est le jeune Amaury, comte de Jaffa. J’étais alors prisonnier de Nour ed-Din. Dans la première fougue de l’adolescence et trop facile à enflammer dans ce temps-là !…
— Ah ! sire ! s’écria Guillaume en joignant les mains, vous l’êtes toujours ; les années n’ont rien fait à cela, car vous ne péchez jamais que contre la chasteté. Le sacrement de mariage, même, n’est pas sacré pour vous, et vous donnez l’exemple du scandale !
— Si tu grondes déjà…
— Je ne gronde pas : je déplore seulement un défaut que nulle pénitence n’a pu amender.
— Cela passera, va, avec le temps, quoi que tu en penses… Donc, voilà ce que j’ai peine à confesser : Quand j’étais prisonnier du sultan, j’ai follement aimé et pris pour femme, en secret, la fille d’un prince musulman.
— Vous, le mari d’une païenne !
— D’après les lois de son pays, elle était ma femme ; mais, d’après celles du mien, je n’étais pas tout à fait son mari… Bref, le père découvrit trop tôt nos amours, et, à mon grand désespoir, la princesse me fut enlevée… Elle était grosse. C’est cela surtout qui me cause grand souci : je songe, avec effroi, qu’il est bien probablement de par le monde un fils de mon sang qui confesse Mahomet.
— Ah ! sire, voilà donc pourquoi le ciel vous frappe si cruellement en la personne du très vertueux prince Baudouin, votre héritier ! Hélas ! je comprends maintenant : si la lèpre affreuse menace son jeune corps, c’est pour vous faire souvenir qu’un autre enfant, né de vous, a l’âme rongée par la lèpre de l’impiété. Il faut, à tout prix, retrouver ce malheureux, menacé de damnation, et qu’il soit purifié dans les eaux saintes du baptême.
— Oui, il le faut, dit le roi, pensif : mais où le chercher ? La vie privée de ces païens est sévèrement murée, et rien n’en transpire au dehors. Enfin, tu m’aideras, et je te léguerai ce devoir sacré, si je meurs sans l’accomplir.
— Avec l’aide de Dieu nous réussirons.
Le roi mit un doigt sur ses lèvres :
— Garde le secret bien fidèlement, dit-il : si la reine savait !…
Il y avait un grand brouhaha au dehors ; tout le monde était sur pied. Le camp, éveillé, ne s’était pas rendormi ; de proche en proche, on se contait l’événement et ce danger mortel couru par le roi.
Le jour naissait, d’ailleurs. Les sommets devenaient roses, comme des fleurs, tandis que le fond des vallées bleuissait ; puis la rosée se vaporisa, et on eût dit que des mousselines traînaient partout, si légères que, la brise les déchirait. Les champs de narcisses et de giroflées embaumaient, et, dans les bouquets d’oliviers, les oiseaux, tout à la fois, commençaient leurs chants.
Le roi parut. Il s’était fait vêtir et avait dicté à Guillaume la lettre à Raschid ed-Din. Il la tenait à la main, et l’on voyait osciller, au bout d’un ruban blanc, le sceau royal empreint sur la cire rouge.
Amaury s’arrêta sur le seuil de sa tente, sans prendre garde aux acclamations dont on le saluait.
Le merveilleux château du prince des Sept-Montagnes fascinait ses regards. Il s’élevait au delà d’une colline rocheuse qui bordait la vallée du côté du camp, et il fallait se renverser la tête pour voir son faîte, qui, recevant déjà toute la lumière du soleil, montrait des coupoles d’or, des tours et des tourelles, des murs dentés de créneaux, où des gemmes incrustées scintillaient et jetaient des flammes. Le roi mesurait de l’œil cette vertigineuse paroi que le rocher à pic prolongeait jusqu’au fond d’un gouffre. Elle était lisse et tout unie, à l’exception d’une voûte large et haute qui la perçait au niveau de la colline et que le pont-levis relevé masquait à demi. Amaury soupirait en se disant qu’assiéger ce château formidable serait une folie bien vaine et que, si les avances du Vieux de la Montagne cachaient un piège, il regrettait amèrement de s’y être laissé prendre.
Tout à coup, des trompettes sonneront dans le château, claires, puissantes, et si mélodieuses, qu’à les entendre un sourire naissait sur toutes les lèvres. Les chrétiens déclarèrent même qu’elles devaient être enchantées, car jamais aucune musique n’avait aussi voluptueusement caressé leur oreille.
Silencieusement, le pont-levis s’abaissa, posa son extrémité au sommet de la colline, et, du fond noir de l’ogive géante, des cavaliers, vêtus de blanc, montés sur des chevaux blancs, s’avancèrent. Ils franchirent le pont-levis et descendirent au galop la pente de la colline.
— C’est le Vieux ! c’est le Vieux ! criait-on.
— Il vient, sans doute, au-devant des explications, dit le roi.
Mais un écuyer accourut qui annonça des Frères de la Pureté, envoyés du Prince des Assassins.
— Ah ! ce n’est pas lui-même, dit Amaury, un peu déçu, tant il était curieux de voir enfin ce singulier personnage. Eh bien ! que ces messagers approchent.
La foule s’écartait. Un seul des envoyés parut ; il s’avançait à pied.
— Sois le bien-venu, mon hôte, dit le roi, que tu apportes paroles d’amitié ou de haine.
Le messager posa la main sur son cœur, puis sur son front, et il dit, dans la langue des Francs :
— J’apporte la réponse du prince des Sept-Montagnes, khalife de Dieu, notre Seigneur Raschid ed-Din — que sa bénédiction soit sur nous !
— La réponse ?…
— À la lettre que vous tenez à la main.
— Mon sceau est intact cependant.
— Notre Seigneur sait lire à travers tous les voiles et toutes les distances.
Les assistants se poussaient du coude et chuchotaient :
— C’est le diable !
— S’il répond vraiment, voilà un miracle.
L’envoyé tendait une lettre à Amaury, qui la prit et rompit les cachets.
Tous les chevaliers s’étaient rassemblés devant la tente royale. Hugues même, malgré le médecin, s’était traîné jusque-là. Un grand silence régnait. On épiait le visage du roi, qui, tandis qu’il lisait, était devenu très pâle, puis s’empourpra.
— Par l’enfer ! s’écria-t-il bientôt, sans cacher la colère qui lui étranglait la voix, s’ils ont fait cela, je jure qu’ils s’en repentiront !… Lis tout haut, Guillaume ! toi qui détestes si fort les Templiers.
Et il tendit la lettre à l’archidiacre, qui la prit en disant :
— Rien de bon ne peut nous venir d’eux.
— Lis ! lis !…
Guillaume, d’une voix haute, lut ceci :
« Louange à Dieu, maître de l’Univers. Que ses bénédictions reposent sur ses prophètes !
« Tu me demandes pourquoi j’ai livré bataille à tes soldats, qui me croyaient ami, et tu m’accuses de trahison. Lequel de nous est un traître ? Où est mon ambassadeur Abou Abd-Allah ? Quelle réponse as-tu faite à mes paroles de paix ! Triste royaume que le tien si, vraiment, tu ignores toujours ce qui s’y passe ! Abou Abd-Allah gît égorgé, sur le chemin qui sépare tes domaines des miens. Ta réponse, ce sont les Templiers qui l’ont lue, puis jetée au vent. Si tu es encore en vie, c’est que j’ai bien voulu croire que, peut-être, tu ignores aussi ce crime. Hâte-toi de me donner réparation, et sache, qu’avant cela, toi et tes soldats vous ne sortirez pas de mes possessions. Essayez de fuir si vous voulez. »
Des cris d’indignation s’élevèrent de tous côtés :
— Égorger un ambassadeur portant sauf-conduit du roi !
— Un chrétien !
— Notre parole tournée en dérision !
— Vraiment, les seigneurs du Temple nous déshonorent ! dit l’archidiacre Guillaume.
— Leur insolence n’a plus de bornes ! s’écria le roi. Ne dirait-on pas qu’ils sont sûrs de l’impunité ? Oublient-ils donc que c’est moi qui fis pendre douze d’entre eux, comme de simples manants, quand ils rendirent à l’ennemi la forteresse de Tyr ? Par la Sacrée-Hostie ! Je leur rafraîchirai la mémoire !…
Le messager, impassible, attendait.
— Pardonne à ma surprise et à ma colère, continua Amaury, en s’efforçant de se calmer. Dis à ton maître que je suis honteux et navré jusqu’à l’âme de ce que je viens d’apprendre. Il m’avait bien jugé en pensant que je l’ignorais et il peut me plaindre, en effet, de la façon dont on trahit mon autorité royale. Quelle réparation exige-t-il ? Je n’aurai pas de repos qu’elle ne lui soit donnée.
— Notre Seigneur Raschid ed-Din, — sa bénédiction soit sur nous ! — eu égard au sang des tiens qu’il a versé dans le premier emportement de son indignation, exige seulement que celui qui a frappé Abou Abd-Allah soit dénoncé et puni de mort.
— Certes ! c’est grand’pitié que tant d’innocents aient payé pour le coupable. Mais le forfait est si odieux qu’il me faut reconnaître que cette cruauté, déplorée par nous avec des larmes, est équitable ; ton maître montre même une modération dont je lui sais gré. Dis-lui que c’est de ma propre volonté que moi et mes soldats nous resterons sur son territoire. Je jure que pas un de nous, excepté le messager que je vais envoyer, sur l’heure, à Odon de Saint-Amant, le Grand Maître du Temple, ne quittera ce lieu avant que le coupable ait expié son crime.
— C’est bien ! Sois donc en paix : tu es ici à l’abri de tout mal.
— Dieu te garde ! dit le roi.
L’envoyé remonta a cheval et, suivi de ses compagnons, gravit au galop la colline. Puis les sabots des chevaux sonnèrent, comme sur un tambour, contre le bois du pont-levis, qui se releva derrière la petite troupe et masqua de nouveau la haute porte ogivale, étouffant subitement la claire fanfare des trompettes enchantées.
VII
Dans cette vallée délicieuse, le camp d’Amaury s’étalait à l’aise sur la pente douce d’une prairie, couverte d’anémones et parsemée de bouquets de bois. Les bannières, haut plantées devant les tentes des soigneurs, flottaient mollement, et les somptueuses étoffes dont elles étaient faites, leurs brillantes couleurs, frangées d’or, et richement brodées, enveloppaient d’un frisson joyeux cette ville improvisée.
Les damoiseaux et les chevaliers couraient tout le jour à cheval, escortant la princesse Sybille et les nobles dames qui l’avaient suivie dans ce voyage. On explorait les gorges voisines, on allait à la découverte, sous l’ombre fraîche des térébinthes, on buvait aux cascades et, pendant des heures, on s’amusait à faire répondre l’écho.
Homphroy était toujours auprès de Sybille, qui affectait de ne lui point parler. Et, pendant ce temps, Hugues, trop faible encore, restait dans le camp, assis au bord de la petite rivière, une rivière pressée, qui courait très vite en remuant de jolis cailloux bleus. Il regardait le fantastique château, qui changeait d’aspect à chaque heure du jour : tout vermeil au soleil levant, il flamboyait à midi et, le soir, paraissait noir comme du velours, sur le ciel empourpré. Parfois, il semblait se reculer, vaporeux et comme prêt à se dissoudre, ou bien des nuages s’enroulaient à ses tours comme des écharpes à demi nouées. Hugues, avec ferveur, le contemplait, l’étudiait, cherchait par les yeux de l’esprit à voir à travers les murailles. Elle était là. C’était vrai ! Son lourd désespoir l’avait quitté ; son sang courait vif et ardent, dans ses veines à présent. L’impossible s’était réalisé : il l’avait revue, et cette vie par lui offerte à Dieu pour la revoir, c’est elle qui, miraculeusement, la lui avait conservée. Ah ! il n’y tenait maintenant que pour la servir. N’avait-elle pas dit : « Adieu, mon chevalier… »
Et il rêvait de folles escalades, ne se lassait pas de guetter.
Parfois, le comte de Tripoli, croyant le distraire, venait lui tenir compagnie. Il lui contait, longuement, l’histoire de cette captivité de huit années, pendant lesquelles il avait vécu dans l’intimité des Sarrasins, où était née la sincère amitié qui le liait à Saladin.
— Il m’a juré même, disait-il, de me prêter main-forte si j’en ai jamais besoin pour une querelle personnelle.
Hugues, qui suivait sa rêverie, l’écoutait à peine, et il souriait de temps en temps, par courtoisie.
Un jour, le soleil trop brûlant les chassa du bord de la rivière, et ils gagnèrent un bouquet d’oliviers pour s’asseoir à l’ombre. Au moment d’y arriver, Raymond de Tripoli trébucha sur quelque chose.
— Au diable, s’écria-t-il, j’ai failli choir ! Qu’avons-nous là ?
Et, de derrière un buisson, il tira, par les pieds, un corps inerte.
— Tiens ! continua-t-il, quelle surprise ! Voyez donc : c’est votre écuyer.
— Urbain ! Il est mort ?…
— Non, certes : entendez comme il ronfle.
— Comment se peut-il qu’il soit là ?
— Son retour est aussi mystérieux que son départ… Eh ! l’ami !
Hugues le secoua.
Urbain ne s’éveilla pas, mais se mit à parler, d’une voix brève, comme s’il rêvait :
— « Que la musique joue, maintenant, très doucement et que les danseuses s’éloignent. Je ne veux près de moi que les princesses qui m’éventeront avec leurs cheveux. »
— Que dit-il là ?
— Par la Sainte-Messe ! il a de beaux rêves !
Et Raymond, riant d’un large rire, les mains sur les cuisses, se penchait pour mieux entendre.
— « Vraiment, damoiselles, vous êtes exquises. Vos parfums me mettent la tête à l’envers, et vos charmes me transportent. Par Allah ! je suis un homme heureux. ».
— Il blasphème ! s’écria Hugues.
— Éveillons-le. Il va se damner en dormant.
Urbain se débattait, violemment secoué.
— « À moi les phalanges célestes ! cria-t-il. Défendez-moi ! Le diable est entré ici… »
— Eh ! coquin ! Est-ce ainsi que l’on traite son seigneur ?
Et Hugues lui donna sur la tête une tape qui l’éveilla net.
— Mon seigneur !… balbutia-t-il. Comment ?… Où suis-je ?
— Tu t’éveilles enfin ! dit Raymond. Raconte un peu d’où tu viens.
Des écuyers, attirés par cette scène, s’étaient approchés et, curieusement, regardaient.
Urbain disait d’un air égaré :
— Moi ! je suis mort… J’étais au ciel.
— Ah ! ah ! il est fou, le pauvre sire.
— Fou ! non pas, s’écria Urbain, en se levant. Que se passe-t-il ?… Où sont mes habits d’or et de soie ? Où sont mes pierreries ? Et les princesses ?… Disparues !… Voici bien mon maître… Voici des rochers, des arbres !… Ah ! quel malheur ! Je suis vivant ! J’aurai donc rêvé ?…
— Explique-toi, voyons ! Tu nous lasses, dit Hugues.
Et le comte de Tripoli, s’asseyant sur l’herbe, ajouta :
— Narre un peu ton aventure.
Urbain, l’air égaré, cherchait à rassembler ses souvenirs, il dit enfin, d’une voix entrecoupée :
— Après ma mort… je m’éveille au son d’une grande mélodie, je respire un air plein de parfums, si doux ! si doux, que je me pâme de plaisir. J’ouvre les yeux. Quelle surprise ! Un jardin enchanteur, sablé de poudre d’or, des portiques, des fontaines, des grottes d’émeraude !… Ah ! que c’était beau, que c’était beau !
— Quel délire ! dit Hugues.
— Ensuite, qu’advint-il ? demanda Raymond.
— Une voix délicieuse laisse tomber ces mots :
« Mort sur la terre, tu t’éveilles au paradis d’Allah, le vrai dieu ! Désire, ordonne : tous tes vœux seront réalisés. » Alors, ayant grand’faim, j’ai désiré un bon repas. Ah ! jamais pareille cuisine n’a caressé le palais d’aucun roi de la terre ! J’ai mangé, mangé, avec une si singulière gloutonnerie que, partout ailleurs qu’au paradis, je serais mort d’indigestion… Et puis…
Urbain, hésitant, baissait les yeux.
— Eh bien ?
— C’est que j’ai eu d’autres fantaisies… Mon cœur était affamé aussi… Enfin, je n’ose vous dire… Sachez seulement que, là-haut, tout était supérieur aux choses de la terre, dans les mêmes proportions que la cuisine.
Le comte de Tripoli éclata de rire :
— C’est donc pour cela, coquin, qu’en rêve tu jures par Allah ?
— Mais, au ciel, c’est ainsi qu’on appelle Dieu.
— Misérable ! s’écria Hugues en le saisissant à la gorge.
Raymond le retint.
— Laissez-le, seigneur, dit-il : le malheureux n’a pas toute sa raison. Je devine ce qui lui est arrivé. Les affidés du Vieux de la Montagne lui auront fait boire le haschîsch, ce philtre magique qui donne des extases.
— Vous croyez ?
— Ce n’est pas la première fois que j’entends pareil récit. Voyons, continua-t-il, en s’adressant à Urbain, brave écuyer, vaillant défenseur du Christ, secoue cette torpeur et tâche de te souvenir. Où étais-tu ? Que faisais-tu au moment de ta mort ?
— Ma foi, je devisais gaiement avec des inconnus fort courtois.
— Des païens ?
— Non, des écuyers comme moi.
— Où cela ?
— Dans le camp chrétien, établi ici depuis quelques heures à peine.
— Et ces hommes t’ont fait boire ?
— M’ont-ils fait boire ?… dit Urbain, cherchant à se souvenir. Oui, oui, l’un d’eux a versé de sa gourde dans mon gobelet.
— Vous voyez, soigneur Hugues, c’est bien cela. Il est tombé dans un sommeil léthargique, pendant lequel les Assassins l’ont enlevé, et il s’est réveillé… au ciel ! On vient de le rapporter sur terre par le même procédé.
— Est-ce possible ?… disait Urbain consterné.
— Dans quel but ce magicien enlève-t-il ainsi les nôtres, demanda Hugues, pour les rendre bientôt sains et saufs ?
— Ah ! que sais-je ? répondit Raymond. Il les enivre par des délectations diaboliques, qui troublent leur raison et ébranlent leur foi. Puis le malheureux qui a goûté de ces choses émerveille ses compagnons par le récit qu’il en fait et, volontiers, il se rendrait esclave du magicien, pour retrouver les délices perdues. Regardez votre écuyer : il a l’air fort navré d’être en notre compagnie.
— Malheureux ! s’écria Hugues, tu ne songes pas à te repentir, et à faire une prière d’action de grâce pour remercier Dieu de t’avoir tiré des griffes de Satan ?…
L’écuyer se jeta à genoux ; mais sa prière fut peu orthodoxe :
— Seigneur Jésus-Christ, disait-il, je vous rends grâce de m’avoir ressuscité et je vous supplie de me recevoir bientôt dans votre paradis s’il ressemble à celui d’où je sors.
— Vous l’entendez !
— Sa cervelle sera longtemps troublée par le philtre qu’il a bu.
— Allons, dit Hugues, va trouver mon aumônier et confesse-toi à lui. Ne reparais pas devant nous avant d’avoir fait pénitence. Loin d’ici, damné !
Urbain baissa la tête et s’éloigna ; mais il grommelait à part lui :
— On avait plus d’égards pour moi dans le paradis d’Allah !
VIII
Comme un aigle dans son aire, qui de haut contemple le monde, Raschid ed-Din, au sommet du donjon, couché sur un lit de repos, rêveusement, laissait tomber ses regards sur le merveilleux chaos de pics, d’abîmes, de forêts et de vallées dont le tableau, noyé de soleil et de brumes d’or, se déployait au-dessous de lui.
Cette altitude de laquelle il planait était comme un symbole de sa vie. Il s’était élevé, en effet, sur les ailes de sa volonté, au-dessus des hommes, au-dessus des faiblesses mortelles, au-dessus des lois et des dogmes. Sans être roi, il était plus que les rois ; sans armée, il repoussait les armées ; il n’avait pas de sujets, mais des disciples, fanatisés jusqu’au délire. Pour eux il était le vrai Dieu, et ils mouraient pour lui en le bénissant. Les mystères de la nature, il avait su les pénétrer. « Il disposait du clair de lune », était maître de la foudre, composait le philtre magique qui entr’ouvrait le paradis.
Le Prince des Assassins, le Scheikh-el-Djebel, que les Francs appelaient le « Vieux de la Montagne », avait trente ans à peine et était souverainement beau.
Il fallait l’être d’ailleurs : la moindre imperfection physique, la moindre infirmité, l’eût fait déchoir de son rôle divin.
Des prunelles d’aigle, sous de longues paupières, qui ne cillaient presque jamais, une pâleur ambrée, entre les boucles noires des cheveux et la barbe fine et touffue, une bouche dédaigneuse, d’un rouge ardent, dont le sourire, bien rarement, découvrait les dents, petites et charmantes, une expression habituelle de fierté sereine, d’inflexible volonté, une majesté presque surhumaine, qui mettait, entre lui et ceux qui l’approchaient, des espaces et des abîmes.
Pour vêtement, il portait une ample simarre blanche, serrée à la taille par une ceinture pourpre.
Le coude sur un coussin, les doigts dans les cheveux, il semblait statue par son immobilité ; mais la contraction de ses grands sourcils, l’éclat fixe de son regard et le léger frémissement de ses lèvres, dénonçaient, sous cette inaction, l’activité d’ardentes pensées.
Se revoyait-il, tout jeune encore, tourmenté d’ambition et riche seulement de son génie, quittant secrètement la Chaldée, où il était né, pour se rendre à pied, en pèlerin avide d’initiation, à l’illustre et redoutable château d’Alamout, en Perse, où résidait le Grand Maître des Ismaïliens ? Se souvenait-il de cette matinée, qui était l’aube de sa fortune, où le Grand Maître, devinant dans l’enfant inconnu une créature d’élection, l’avait accueilli si paternellement, déclarant qu’il le ferait élever avec ses fils et initier à tous les mystères de la secte ?
Le temps venu, on avait tenu la promesse.
Il avait appris, alors, que bien au-dessus du dieu révélé par le Qorân au vulgaire, inaccessible à la conception humaine, le vrai Dieu est. Il a créé l’univers, non pas immédiatement, mais par le ministère d’un être sublime, né de sa volonté : la Raison Universelle. À son tour, la Raison manifesta, hors d’elle-même, l’âme Universelle qui créa aussitôt la Matière Primordiale, le Temps, l’Espace. Ces cinq principes sont les causes de l’univers.
L’homme est une émanation des cinq principes et il tend passionnément à remonter à sa source. Son but est l’assimilation, l’union parfaite avec la Raison Universelle. Mais par sa seule force, il est incapable de réaliser cette union ; c’est pourquoi, afin de le guider vers la lumière, la Raison et l’Âme universelles viennent s’incarner parmi les hommes, dans le corps des prophètes et des imans.
Depuis l’origine du monde, six périodes religieuses, toujours en progrès l’une sur l’autre, se sont succédé, chacune marquée par l’incarnation d’un prophète : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet.
Mais, à côté de Mahomet, qui révélait aux hommes la lettre de la religion, il y avait Aly, son gendre, plus mystérieux et plus sublime, qui en dévoilait le sens réel, à quelques esprits d’élite seulement. Et, après sa mort, Aly transmit son essence divine à ses descendants.
Sept fois, son âme s’incarna dans les aînés de sa race, qui, après lui furent imans jusqu’à Ismaïl, le fondateur de la secte Ismaïlienne.
Avec lui prit fin la sixième période du monde. La septième et dernière commençait, la plus parfaite. Et ce fut alors non plus l’Âme et la Raison Universelles qui s’incarnèrent dans un homme, mais Dieu lui-même.
Sa première manifestation fut le khâlife Hakem, qui régnait au Caire, et, après lui, son successeur, le khâlîfe Mostansér, fut dieu.
À cette époque, un homme obscur, un paysan, nommé Hassan ben Sabbah, ami du grand poète Omar Kheiyâm, se fit initier à la religion ismaïlienne. Voulant voir alors le chef auguste de la secte, il se rendit au Caire et fut bien reçu à la cour. Mais, après un an de séjour, devenu suspect d’ambition, il fut persécuté et exilé du pays. Il retourna en Perse, résolu à préparer sa vengeance. Il se mit à prêcher avec ardeur la doctrine ismaïlienne, répandit partout des missionnaires et parvint à fanatiser un grand nombre de nouveaux adeptes. Il se fit alors livrer le château fort d’Alamout, situé dans les montagnes, sur les rivages de la mer Caspienne, et, sans se révolter contre le pontife du Caire, se donnant seulement pour son mandataire, il établit sa puissance sur toute la contrée.
La voyant solidement établie, il songea à châtier ceux qui avaient voulu lui nuire et il institua le corps des Fidawis (les fidèles). C’étaient de jeunes hommes, dévoués jusqu’à la mort, la désirant même avec ardeur, car elle était, pour eux, la porte d’un paradis de volupté, dont leur maître, déjà sur cette terre, leur avait par sa magie fait goûter les délices. Ils obéissaient aveuglément ; armés du poignard empoisonné, implacables, invincibles à force de témérité, ils frappaient les victimes désignées, sans colère comme sans pitié.
Après Hassan ben Sabbah, trois Grands Maîtres se succédèrent à Alamout, toujours soumis aux pontifes du Caire, jusqu’au jour où un des Grands Maîtres, Hassan ben Mohammed, sentit en lui la présence divine et se déclara l’iman, le khâlîfe de Dieu sur la terre.
Cet Hassan ben Mohammed était le compagnon d’étude de Raschid ed-Din, et, dès qu’il fut au pouvoir, il investit son jeune ami de la dignité de Grand Maître des Ismaïliens de Syrie, où, depuis longtemps, le grand maître de Perse avait un mandataire.
Raschid entra alors en Syrie, secrètement, et vint s’établir dans les monts de l’Anti-Liban, aux environs du château, où résidait le vieux chef des Ismaïliens de la contrée.
Durant sept années, le nouveau venu laissa tout ignorer de lui. Il vivait d’aumônes, comme le plus pauvre des derviches, ne se montrait que vêtu de grossiers habits de poil, et cependant il inspirait le respect, l’admiration, plus encore : la reconnaissance ; car le médecin d’Irâk, comme on l’appelait, guérissait tous les maux, même ceux de l’âme. Aussi, bien avant qu’il eût révélé sa dignité, on le tenait pour un être surnaturel, ayant des relations avec le monde invisible.
Un jour il entra dans la chambre du Grand Maître et lui annonça sa fin prochaine ; puis il déploya devant lui le diplôme d’investiture qui le nommait son successeur. Le vieux chef s’éteignit en effet, et Raschid fut Grand Maître après lui. Mais Hassan ben Mohammed était mort aussi, à Àlamout, et il léguait au compagnon de son enfance le plus magnifique des héritages : la Divinité.
Et, en effet, pour plus de soixante mille croyants, Raschid ed-Din était une incarnation de la Véritable Existence, de l’Essence des Essences, et son âme ne contenait aucune parcelle de néant.
Cependant, tandis qu’il rêvait, immobile, au-dessus des paisibles abîmes, son âme si divine, comme un ciel où naît l’orage, s’emplissait d’ombres tumultueuses. Une tempête, peut-être, la ravageait, sans que le corps, impassible, voulût rien en laisser paraître ; mais, ainsi que des reflets d’éclair, des redoublements de pâleur blêmissaient la face, trahissant la tourmente antérieure.
À quelques pas du prophète, un vieillard, noir de visage, à barbe blanche, le chambellan Dabboûs, se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, et regardait son seigneur avec une anxiété croissante.
Enfin il éloigna, d’un geste, les esclaves qui rythmaient le silence en faisant sourdement vibrer les cordes des rébabs, et il se rapprocha du maître.
— Toi, l’inaccessible, dit-il, le prophète inspiré, le khâlîfe de Dieu, qu’as-tu-donc ? Quelle lourde tristesse pèse sur ton cœur et t’absorbe tout entier ?
Raschid eut un sursaut et répondit évasivement :
— Quoi ?… Je n’ai rien.
— Ô seigneur ! dit Dabboûs, à quoi bon retarder ta réponse ? Ne suis-je pas ta conscience ? Souviens-toi de tes propres ordres. Suis-moi, m’as-tu dit, suis-moi dans mon ascension glorieuse, pour me préserver de l’orgueil et du vertige de la puissance ; signale-moi mes fautes, mes faiblesses ; surveille mon âme, afin qu’aucune des misères humaines ne puisse l’atteindre ; sois vigilant et rigide, et que rien, pas même ma colère, ne te détourne de ta mission. J’ai juré de t’obéir. Raschid ed-Din, je suis ta volonté même, incarnée et vivante. Écoute donc ta propre voix, qui te crie par ma bouche : « Prends garde ! Prends garde ! ton âme chancelle. »
Avec un mouvement d’impatience, le prince dit d’un ton ironique :
— Ton zèle t’égare, ou bien ta vigilance est en défaut, puisque tu ne l’as pas vu naître, ce mal, que tu signales aujourd’hui, sans pouvoir dire quel il est.
— L’incapacité du médecin n’est pas en cause. Ah ! prophète, cette réponse est indigne de toi !
— Que veux-tu ?… dit Raschid avec plus de douceur. J’ai vraiment honte de l’avouer quelle piqûre infime me fait souffrir… D’ailleurs, c’est passé ; ce n’était rien.
— Ce n’était rien ! Et, pour la première fois, une défaillance de ton esprit est cause qu’une légère tache a éclaboussé ta gloire.
Le prince eut un froncement de sourcils qui eut fait frémir tout autre que Dabboûs. Celui-ci reprit d’une voix plus haute :
— Oui, seigneur, c’est par ta faute que les Fidèles, envoyés par toi au secours d’un de tes alliés, ont été surpris. Les oiseaux rapides t’apportaient la nouvelle de l’embuscade ; mais tu t’es rendu trop tard, au sommet de la montagne, pour recevoir leur message, et les fidèles sont tombés dans le piège.
— Le mal est réparé déjà, et l’éclat de cent victoires efface cette légère ombre.
— C’est passé, dis-tu, et ce n’est pas le souvenir de cet échec qui creuse ce pli soucieux sur ton front !
— Je te trouve audacieux d’affirmer cela.
Plein de tristesse ; Dabboûs s’agenouilla et tendit un poignard nu à Raschid.
— Maître, dit-il, fais-moi la grâce de me tuer, si je dois voir un esprit tel que le tien s’abaisser jusqu’au mensonge.
Mais Raschid, vivement, le releva.
— Pardonne-moi, Dabboûs, dit-il. Si je taisais la cause misérable de ce tourment, indigne de moi, c’était pour mieux l’étouffer dans son germe.
— Mais tu es malade ! tes mains brûlent ! s’écria Dabboûs.
— J’ai la fièvre, n’est-ce pas ? c’est une maladie, une démence ! Eh bien, guéris-moi si tu le peux, et ris de l’orgueilleux prophète : Pour la première fois, il est vaincu et c’est une femme qui triomphe de lui.
Alors Dabboûs, rassuré, prononça avec un dédain suprême :
— L’amour ?
— L’amour ! répéta Raschid gravement.
Mais le Vieillard souriait.
— Gazileh, n’est-ce pas ?
— Gazileh ! ce nom sur mes lèvres est une liqueur divine qui suffit à m’enivrer.
— L’ardeur de ta jeunesse et l’austérité de ta vie excusent cette griserie passagère… Mais je ne comprends pas le tourment. La jolie princesse est en ton pouvoir. Ce sera une beauté de plus dans ton harem, déjà peuplé de houris.
— Non, non, jamais ! Je serais perdu ! La seule pensée qu’elle pourrait être à moi, me donne un tel vertige que j’en suis épouvanté ! Mais tu ne comprends donc pas ? Pour la première fois, il m’a saisi, ce mal terrible, auquel je ne pouvais croire. Si je cède, vois-tu, c’est fait de moi. Cette puissance, presque surhumaine, conquise par tant de labeurs et qui, pour ne pas déchoir, exige toute ma volonté, toutes mes forces, s’écroulerait dans les fleurs ; et le prophète formidable, dont le nom seul fait trembler les rois, ne serait plus rien…, plus rien qu’un homme heureux !
Dabboûs souriait toujours.
— Quelques semaines de folie, dit-il, puis une illusion qui se dissipe, et la sagesse triomphant.
— Ne crois pas cela ! s’écria Raschid. Ce n’est plus le charme passager qui s’exhale de mes belles amantes comme dés fleurs le parfum. C’est quelque chose de violent et de douloureux, une obsession, une brûlure, une force qui brise ma volonté. Je veux chasser cette pensée, et elle seule emplit mon esprit. Cette femme je la fuis, et je ne vois qu’elle !
— Tu la fuis ?
— Depuis le jour où je l’ai reçue ici, avec les égards que son rang exigeait, je ne l’ai pas revue, si ce n’est par surprise, de loin, un instant, quand elle erre, rêveuse et triste, dans ce château où je la laisse libre.
— Tu la fuis ?… Pourquoi cette lâcheté ? Tu es le jouet d’un prestige, seigneur, d’une illusion créée par toi. Chaque jour que tu passes loin de Gazileh, tu la revêts d’une beauté nouvelle. Ta pensée, dardée sur elle, l’enveloppe d’un nimbe de lumière, qui t’éblouit toi-même. Va, ne crains rien. Quelle femme peut égaler ton rêve ? Mais celle-là seule que tu rêves, peut déchirer le voile splendide dont tu la pares, en se montrant telle qu’elle est vraiment. Garde-toi de l’éviter ; rapproche-toi d’elle au contraire, rassasie ton esprit de son babil d’enfant, sonde le vide de son âme, l’inanité de ses pensées, la folie de ses caprices, et lorsqu’il ne lui restera plus à tes yeux que sa beauté fragile, prends-la pour femme, et oublie-la bientôt.
— C’est là le conseil que me donne ta sagesse ? s’écria Raschid dans une agitation joyeuse : la revoir ? Tu le veux !… Dabboûs, ne t’y trompe pas… c’est par lâcheté que je céderai à ton conseil, sans croire nullement qu’il soit judicieux. Mais il est trop tard pour le reprendre ; tu as tranché les liens dans lesquels je tenais captif mon désir le plus ardent ; C’est un fauve affamé qui a rompu sa chaîne : ne tente plus de le retenir.
— Plus l’élan est vif, moins longue est la course.
— La voir ! murmurait le prince. Depuis que j’existe aucune émotion n’a fait à ce point brûler mon sang… J’ai peur de mourir.
— Khâlîfe de Dieu ! tu guériras, dit le vieillard, en baisant la main de son seigneur.
IX
Après l’alanguissante chaleur du jour, une brise accourait de la mer, un peu avant le coucher du soleil, se roulait mollement dans les vallées, et soulevait jusqu’aux sommets, les parfums des parterres pâmés.
C’était comme une renaissance pour les vivants ; on s’éveillait de la lourde sieste ; les poumons humaient l’air rafraîchi ; l’énergie revenait, et une animation joyeuse succédait au morne silence de l’après-midi.
Dans le château de Raschid ed-Din, au-dessus de la première muraille, régnait un large chemin de ronde, où Gazileh se promenait de préférence. Il donnait sur la vallée et sur la ville, il était le point le moins élevé de ces constructions prodigieuses, qui se haussaient, les unes au-dessus des autres, jusqu’au pic suprême.
Ce jour-là, comme d’ordinaire, la jeune princesse vint se promener sur la muraille, accompagnée de son amie Nahâr, qui souriait avec un peu de malice.
— J’étais bien sûre que c’était là que nous venions, disait-elle. Les jardins, les plus magnifiques qui soient au monde, ne sont rien pour toi à côté de cette crête de mur, et je ne serais pas grande magicienne si je devinais pourquoi tu l’aimes tant.
— Vraiment, dit Gazileh, n’est-ce donc pas parce que l’air y est plus vif et que, de là, on découvre toute la vallée ? Voir de l’espace, c’est quelque chose pour une prisonnière.
— Oui ! oui ! reprit Nahâr, l’espace ! Pourtant il y en a plus encore à l’orient du château ; mais nous n’allons jamais par là : il ne te plaît que de ce côté-ci… C’est donc qu’il y a espace et espace, et que tu préfères celui qui enveloppe les tentes des Francs.
— Tu crois ?…
Et Gazileh, en souriant, s’accouda dans un créneau, laissant courir ses regards, par-dessus l’épaisseur du mur et l’abîme qu’elle ne voyait pas, sur le vallonnement verdoyant et fleuri.
— Oui, continua Nahâr, s’appuyant de l’épaule au merlon voisin, d’ici l’on découvre tout le camp des infidèles, et même, par moments, les nobles chevaliers sont reconnaissables à l’éclat de leurs armes, que le soleil fait étinceler. On les voit, dans leur désœuvrement, s’en aller par groupes nonchalants, ou bien ils s’exercent au combat, et l’on suit avec intérêt les cavaliers qui roulent l’un vers l’autre et se joignent dans un choc, dont nous entendons le bruit. Mais, de si loin, dans cette foule, comment reconnaître le beau chevalier auquel on pense ?
— En effet, c’est impossible, dit Gazileh avec un soupir. Ah ! je voudrais seulement savoir s’il a survécu à cette terrible blessure, que j’ai pansée de mon mieux.
— Tu répondais de sa vie. Il est guéri certainement.
— Songe-t-il encore à cette musulmane qu’il a juré de défendre ?…
— Puisqu’il l’adorait depuis trois ans !
— Ne crois-tu pas, Nahâr, qu’il avait le délire quand il nous a fait cet invraisemblable aveu ?
— Il a su donner des preuves qu’il disait vrai.
— Comme c’est singulier !… Et que justement je sois allée à lui. Une force me poussait. Cela, sans doute, plaisait à Dieu, qu’il avait si ardemment prié. Mais la pensée du sacrilège a déjà étouffé, peut-être, cette flamme fragile.
— Ah ! ne crains pas cela ! s’écria Nahâr : si la peur du sacrilège, au contraire, soufflera sur le feu, à la façon de l’ouragan et en fera un incendie.
— Es-tu savante ! dit Gazileh en souriant.
— Toutes les femmes le sont sur ce sujet ; mais toutes sont imprudentes. Et, pour faire exception, moi, je t’avertis, ma princesse, que tu penses beaucoup à cet infidèle et que tu laisses croître dans ton cœur, un sentiment qui ne peut te procurer que des chagrins.
— Que veux-tu ? c’est la dernière vision que j’ai emportée dans ma prison… Toujours je revois cette tête mourante, si pâle dans la pourpre qui l’inondait, ces boucles éparses, cette barbe d’or, et l’extase de ces yeux clairs, quand ils reflétèrent mon image. Cela m’est très doux de savoir qu’une pensée monte vers moi, ardente et fidèle, qu’un dévouement veille, prêt à tout. Mon chevalier ne pourra me secourir, mais il m’aide, au moins, à supporter plus patiemment ma captivité.
— Mais que crains-tu donc, maîtresse, dans ce château plein de merveilles, où l’on te traite comme une reine ? Le terrible prophète, nous ne l’avons vu qu’une fois, et il nous est apparu tellement imposant et beau que nous avons été pénétrées pour lui d’admiration et de respect.
— Oui, dit Gazileh, Raschid ed-Din est revêtu d’une majesté divine, et pourtant il m’épouvante. Quand il m’a priée de lever mon voile, son lourd regard, pesant sur moi, m’a rendue tremblante et sans souffle, comme une colombe qu’un aigle va saisir. Ah ! qu’une femme est peu de chose pour lui ! Il la brisera, sans colère ni pitié, pour le plus faible motif.
— Mais ton oncle, qui t’aime si tendrement, ne donnera au prince des Montagnes aucun sujet de mécontentement aussi longtemps que tu seras entre ses mains comme otage. Que redoutes-tu donc ? Nous sommes plus libres dans ce château que nous ne l’étions dans le harem, et tous nos désirs sont comblés sans que nous les formulions. Pourtant, gagnée par tes alarmes ; sans cesse j’épie, j’écoute, je tâche de surprendre quelque complot terrible contre notre vie ; mais je n’ai rien vu, rien entendu. Nous n’avons pas plus à craindre ici que les oiseaux de la volière et les fleurs des jardins.
— C’est possible ! Je suis folle peut-être. Eh bien, ne pensons plus à cela. Je veux chasser cette étrange appréhension qui me serre le cœur… Vois donc, Nahâr, dit-elle, après un long moment de rêverie, cette colline qu’une haute bannière surmonte. Les tentes, alentour, sont plus belles qu’ailleurs, et, de temps eh temps, des fanfares résonnent de ce côté. Le roi franc est sans doute établi à cet endroit.
— Cela doit être, dit l’esclave : toute l’armée entoure le mamelon comme pour le protéger ; et ces taches brillantes qui enveloppent la colline comme une guirlande de fleurs, ce sont, je crois, les riches étendards des princes, plantés en terre devant l’entrée de leur tente.
— C’est donc de ce côté que doit être le seigneur Hugues de Césarée,… mon chevalier !
— Prends garde, dit tout a coup Nahâr, quelqu’un vient.
De beaux noirs d’Abyssinie, vêtus d’amples tuniques de damas pourpre et or, des sabres à riches poignées passés dans les plis de leurs ceintures, s’avançaient d’un pas cadencé et majestueux.
Gazileh se retourna vivement.
— Ce sont des esclaves du palais, dit-elle.
— C’est toi qu’ils cherchent.
Les esclaves, en effet, s’arrêtèrent devant la princesse, et l’un d’eux lui dit, en s’inclinant devant elle :
— Notre Seigneur désire ta présence.
Gazileh avait pâli et porté la main à son cœur ; mais elle eut honte de sa faiblesse et répondit, d’une voix tranquille :
— Je suis prête à obéir.
Pour lui éviter toute fatigue, on posa près d’elle une litière légère, et, quand elle s’y fut assise, deux porteurs la soulevèrent et l’emportèrent. Ils marchèrent longtemps, à travers les vastes galeries du château, par les merveilleux jardins, et s’arrêtèrent enfin devant un kiosque d’or ajouré, cerné d’un fossé plein d’eau de rose que traversait un pont de marbre roux, figurant une gazelle bondissante.
Raschid ed-Din s’avança Vers la jeune fille, l’enveloppant d’un regard avide ; l’assouvissement de ce désir de la voir, si longtemps dompté, lui apportait une émotion nouvelle, tellement intense qu’il fut un moment incapable de parler. Un apaisement lui vint ensuite, un sentiment de bien-être et de repos, une détente des nerfs, un rafraîchissement délicieux, comme doit l’éprouver la terre desséchée après le bienfait d’une pluie d’orage.
Oppressée sous le poids de ce regard, Gazileh baissait les yeux, et, doucement, la houle de son sein faisait bruire son collier d’or.
— Approche, jeune fille, dit enfin Raschid, en tendant la main vers elle comme pour l’attirer. Je veux obtenir mon pardon, car j’ai manqué de courtoisie : absorbé par les soins de la guerre, n’ai-je pas paru oublier l’adorable princesse qui embellit mon palais ?
Et Gazileh, redevenue calme, répondit d’une voix qui ne tremblait pas :
— Que suis-je, seigneur, pour occuper, même une minute, l’esprit qui commande au monde et à qui Dieu révèle les mystères du ciel ?
— Ah ! Gazileh ! s’écria Raschid avec passion, quelquefois la créature reflète si merveilleusement le Créateur, qu’il est oublié pour elle.
— Mais, par une déception cruelle, Dieu punit le sacrilège, ô prophète ! Ainsi le soleil, disparu, vous laisse entre les doigts un vil caillou qui, en le reflétant, éblouissait.
— Comment ! toi que les houris ne peuvent surpasser, tu n’es donc pas, ainsi que les autres femmes, orgueilleuse de cette beauté qui fait ta gloire ?
Avec un vague sourire, Gazileh secouait la tête.
— Certes, dit-elle, je suis reconnaissante à Dieu de n’avoir pas donné pour enveloppe à mon âme un corps difforme. Mais pourquoi être vaine d’un charme fragile, qui passe sans laisser de traces ?… Qu’est devenue, hélas ! la beauté de nos aïeux, dont est faite, peut-être, la poussière du chemin ?
— Est-ce bien possible ? dit Raschid, en faisant asseoir la jeune fille auprès de lui sur le divan, toi, femme, tu estimes vraiment l’esprit plus que le corps ?
— Aussi faible que soit la lumière, que vaut le flambeau sans elle, fût-il fait d’or et de diamants ?…
— Mais comment la vie frivole et paresseuse du harem a-t-elle pu laisser éclore en toi de telles pensées ? dit le prince, de plus en plus surpris et charmé, et, ces pensées écloses, comment| cette existence ne t’a-t-elle pas tuée d’ennui ?
— Ah ! seigneur, dit Gazileh, j’avais auprès de moi d’immortels amis qui ne me quittaient jamais. Ils peuplaient ma solitude en me laissant solitaire ; sans rompre le silence ils avaient une éloquence divine ; ils m’emportaient à travers l’espace sans que j’aie quitté ma place.
— Quels sont ces amis ?
— Les livres ! Ah ! mieux que les rois, qui n’ont que le présent, qui les possède possède le monde. Le Qorân ne nous révèle-t-il pas que l’étude éclaire le chemin du paradis, qu’elle vaut mieux que le jeûne, plus que la prière, qu’elle sauve du péché, qu’elle libère les esclaves, qu’elle est notre bouclier, notre parure ?… Aussi, quand je la quittais et que mon miroir me montrait mes yeux rayonnant de la joie qu’elle m’avait donnée, alors, oh ! oui, alors je me trouvais belle !
— Tu m’enchantes ! Gazileh ! s’écria Raschid ed-Din. Tout ce que le rêve a pu concevoir, tu le surpasses, car ton âme est digne de l’écrin merveilleux où Dieu l’a enfermée.
Il se tut, la contemplant, profondément songeur, tandis que, prise d’une sorte d’angoisse, elle regrettait de s’être ainsi montrée tout entière. Il murmura :
— Peut-être es-tu ma récompense terrestre.
Puis, après un nouveau silence :
— Écoute, Gazileh, à toi seule je veux le dire. Une âpre solitude oppresse mon cœur sur le sommet où Dieu m’a placé, trop loin du ciel, trop près de la terre encore. Bien souvent, j’ai crié vers l’Être Unique, le suppliant de m’appeler dans les régions suprêmes, si le vide affreux que me laissent ma gloire et ma puissance ne peut être comblé ici-bas. Le ciel m’exauce-t-il en t’envoyant vers moi, toi dont la beauté n’est pas décevante, puisque l’âme qu’elle voile est divine ?
Gazileh, presque défaillante, balbutia :
— C’est par dérision, seigneur !
— Tu trembles ! tu t’éloignes ! Mais ne vois-tu pas que c’est moi plutôt qui devrais craindre, car ton cœur m’est encore fermé, et je t’ai livré le secret du mien. Ô Gazileh ! le prophète, qui commande à tous, est un suppliant devant toi.
— Cet honneur est trop grand : il m’épouvante !…
Mais Raschid, d’un geste, arrêta ses paroles.
— Non ! non ! ne dis rien… Plus tard, plus tard. Puisque tes regards ne cherchent pas les miens, puisque mon aveu ne t’a pas fait, d’un élan irrésistible, te jeter sur mon cœur. J’en sais assez, va ! Laisse le temps faire son œuvre. J’attendrai que ton amour fleurisse, car c’est ton âme qu’il me faut. Sans elle, je dédaigne cette beauté merveilleuse, qui est à moi, si je la veux.
— Hélas ! pensa Gazileh, je suis perdue !…
La grave et noire figure du chambellan Dabboûs apparut à l’entrée du kiosque.
— Ah ! dit Raschid, comme, en sa présence, l’heure s’envole légère et délicieuse ! Dabboûs doit me rappeler mes devoirs. Ma volonté m’échappe ; je ne suis plus mon seul maître.
Gazileh s’était levée.
— Permets, seigneur, que je me retire.
— Va, puisque ton désir est de t’éloigner. Que le bonheur soit ton ombre !… Je te rends grâce d’exister !
— Je te révère, ô prophète !
— C’est trop peu : c’est tout ton amour qu’il me faut.
Et, quand il l’eut vue disparaître, emportée par les esclaves, il appuya ses deux mains sur les épaules de Dabboûs et lui dit avec un sourire :
— Cette fois, ta sagesse est folie. Aucun rêve n’égale cette Gazileh… à l’écouter, j’étais à tel point charmé que j’oubliais presque qu’elle est si belle.
— Tu la vois avec les yeux éblouis de l’amant, dit Dabboûs. Plus l’illusion est ardente, plus vite elle se consumera.
— Non, non, n’aie pas cette illusion.
— Si c’était vraiment aussi grave, pour être digne de toi-même, il faudrait arracher violemment de ton cœur un sentiment qui peut le faire déchoir.
— Je ne le pourrais plus, dit Raschid.
— Est-ce toi qui as parlé ? s’écria Dabboûs avec une surprise douloureuse. C’est la première fois qu’une telle phrase passe entre tes lèvres ! Veux-tu me railler ? Toi l’esclave d’une femme ! Cela n’est pas vraisemblable. Non, non, romps vite ces honteuses chaînes. Déjà l’humiliation de les porter courbe ton front et assombrit tes regards.
— Ce n’est pas cela, dit le prince : j’ai peur qu’elle ne veuille pas m’aimer.
— Ne pas t’aimer ! L’orgueil seul de t’avoir conquis va l’enivrer jusqu’à la folie… Mais ne suis-je plus qu’un confident d’amour ? L’heure passe. Plusieurs des Frères de la Pureté viennent te rendre compte des missions accomplies ; ils sont là, ils attendent.
— Ah !… est-ce donc l’instant des audiences ? demanda le prince avec ennui.
— Raschid ed-Din ! s’écria Dabboûs d’un ton sévère, cette femme est-elle donc suscitée par le démon, pour te faire tomber des hauteurs où Dieu t’a permis d’atteindre ?…
— Ne gronde pas, Dabboûs, dit Raschid avec douceur ; songe que je suis encore tout embaumé de sa présence. Une délicieuse lassitude m’accable et je voudrais savourer cette ivresse, si nouvelle dans ma vie… Mais je t’obéis ; je me soumets. Fais introduire un des frères : je suis prêt à l’entendre.
X
L’ost des Francs s’étendait à l’aise sur le velours fleuri de ces hauts vallons, entre ces étranges montagnes dont chaque heure variait les nuances. Et, de jour en jour, la multitude augmentait. Des marchands, génois ou vénitiens, se joignaient au campement, s’établissaient là et faisaient leur commerce. De tous les châteaux des principautés voisines, les seigneurs venaient rendre hommage à leur souverain, ne s’en allaient plus. Ils arrivaient des frontières de Tripoli, du Krak des chevaliers, la merveilleuse forteresse que les Arabes nomment le château des Kurdes et que Raymond III avait récemment cédé aux Hospitaliers ; de Markab le Lieu du Guet, place forte tenue en fief par la noble famille de Mansoer, de Tortose, du château de la Veille, du mont Pèlerin, du Chastel-Blanc de Safita, d’Émèse, de Laodicée.
Les châtelains, qui gouvernaient en l’absence des seigneurs attachés à la cour du roi, beaucoup de nobles vassaux, les vicomtes des châteaux situés sur les territoires voisins, profitaient de la trêve et de la présence de leurs suzerains dans l’ost royal, pour venir leur faire des rapports, leur donner des nouvelles, soumettre à leur jugement des causes difficiles. Le comte de Tripoli tenait une cour de justice à l’ombre des figuiers.
Des envoyés, ayant pour chef le sénéchal Milon de Ploncy, étaient partis, afin de porter à la commanderie du Temple les reproches et les ordres du roi. Raschid ed-Din se contentait momentanément de cette satisfaction, et il avait fait remettre son anneau d’or à Amaury, comme gage de paix et de sauvegarde.
Avec la soif du plaisir, naturelle aux hommes dont la vie est sans cesse menacée, les Francs se réjouissaient, sans répit et sans mesure. Danses, festins, orgies se succédaient au son des musiques, retentissant nuit et jour, si sauvages et si formidables parfois que les oiseaux, volant au-dessus de ces orages d’harmonie, tombaient comme foudroyés.
Les croisés fraternisaient avec les Arabes ; ils organisaient ensemble, selon leurs différents modes, des joutes et des tournois.
Tout le long de la journée, la jolie ville de Maçiâf, couchée entre le pic géant et la formidable forteresse, était envahie par les soldats du Christ, qui aimaient, par-dessus tout, la gaieté de ses bazars et l’animation de ses rues étroites et fraîches ; mais, le soir on fermait les portes et on relevait les ponts, après avoir laissé sortir les chrétiens.
Urbain, l’écuyer d’Hugues de Césarée, avait choisi, pour battre sa coulpe et subir la pénitence qu’on lui avait imposée en expiation de ses péchés, une délicieuse place située au cœur de cette cité. Là, sous la transparence verte de larges platanes, une fontaine carrée, en albâtre, ornée d’arabesques et d’inscriptions d’or, protégée par une élégante toiture, laissait couler dans ses quatre vasques un filet d’eau claire et froide.
Le pécheur était condamné à s’appliquer cinquante coups de lanière sur la peau nue, et, ce jour-là s’y résignant enfin, mollement, en poussant des clameurs, il se cinglait les reins et le dos.
Debout ou à demi couchés, des écuyers et des sergents faisaient cercle autour de lui.
— Aïe ! aïe ! criait-il. Ah ! mes reins ! ah ! malheureuse chair ! Grâce, bourreau ! je ne suis qu’une plaie.
Les écuyers comptaient les coups et riaient.
— Dix-neuf, vingt… Plus fort donc, poltron !
— Il y touche à peine.
— On dirait qu’il chasse les mouches.
— Va, va, chasse tes péchés ! frappe ferme !
— Encore trente coups seulement.
Mais Urbain, avec impatience ; jeta la discipline loin de lui.
— Eh ! au diable ! J’en ai assez comme cela. Un cilice sur ma peau, du pain sec pour régal et des cinglons pour me récréer ! Je sais ce que je sais… Foin du paradis que l’on gagne par l’enfer en ce monde !
Un des écuyers leva le nez vers le château.
— Celui de là-haut te plaisait mieux ? dit-il.
— Ah ! si j’en retrouvais la route ! murmura Urbain en poussant un profond soupir, je serais plus content que si je tenais Dieu par les pieds !
Et il demanda du vin à un de ses camarades.
— Tu romps le jeune ? dit celui-ci en lui tendant sa gourde.
Mais Urbain la repoussa après la première gorgée.
— Pouah ! dit-il, comme il est aigre !
— Du vin de Galilée ! Tu es difficile.
— Ah ! dit un sergent, depuis son aventure magique, il trouve tout indigne de lui.
— Quand on a goûté aux joies du paradis, la vie commune doit vous sembler, en effet, bien amère.
— Il est heureux, ma foi, d’avoir goûté à ces joies-là, reprit le sergent. J’aurais voulu être à sa place.
Un jeune écuyer se rapprocha et, baissant la voix :
— Dis-nous, l’as-tu vu, le Vieux ? Est-il bien laid ? A-t-il des dents de sanglier et de grandes cornes ?
— Ne parle pas ainsi du Prophète ! s’écria Urbain avec colère. D’abord, il n’est pas vieux. C’est un jeune homme, plus beau qu’aucun de nos chevaliers et plus imposant que le roi.
— Le diable prend la forme qu’il veut.
— Si c’est là le diable, je demande à être damné.
— Urbain ! Urbain ! tu sens le roussi et tu serais, bien sur, excommunié si le saint évêque t’entendait.
— Eh bien, je pense comme lui, dit un des écuyers, et je me confierai bien à ce diable-là s’il veut de moi ! En somme, il n’y a que peines et tourments en ce monde, et on nous promet encore, dans l’autre, grandes brûleries et tortures, si seulement nous mourons sans avoir eu le temps de nous laver de nos péchés. Qui trouve son paradis sur la terre a toujours attrapé cela.
— C’est bien vrai : misère ici, misère là-bas. Autant se donner du bon temps, si on le peut.
— Du bon temps ! Nous n’en avons guère en terre sainte ! s’écria le sergent. Avons-nous assez pâti de soif, de faim, de fatigues ! Avons-nous assez arrosé les chemins de nos sueurs et de notre sang ! Ah ! Notre Seigneur Jésus nous devra bien le paradis.
Un Arabe qui les écoutait, adossé à la fontaine, dit d’une voix grave :
— Le Prophète de là-haut ne le vend pas aussi cher que votre dieu né d’une vierge, et il a le pouvoir de vous y faire goûter en ce monde.
Il y eut un moment de silence pendant lequel on regarda l’inconnu en dessous. Mais le sergent se rapprocha de son camarade, le poussant du coude.
— Dis donc, Urbain, c’était fameux, hein ?…
— Ah ! j’y songe le jour, j’en rêve la nuit et je maigris, je dépéris de regret.
— Il y avait donc de bien belles femmes ?
Urbain ne répondit que par un soupir long et profond.
— Ah ! tant pis ! j’en suis ! s’écria le sergent. Que faut-il faire ?… Signer un pacte ? vendre son âme ?
— Nullement, dit l’Arabe qui avait déjà parlé, il suffit de jurer au Prophète dévouement et obéissance.
— Le difficile est d’arriver jusqu’à lui.
— Puisqu’il sait tout, il saura votre désir.
— S’il vient, faites-moi signe, dit un écuyer. Tous se rapprochèrent.
— Et à moi…, à moi aussi.
L’Arabe les enveloppa d’un rapide regard.
— Écoutez, dit-il en baissant la voix, que tous ceux qui sont décidés à jurer fidélité à Raschid ed-Din ne quittent pas la ville et reviennent ici, cette nuit même : je me charge de leur gagner le paradis.
Et, sans attendre de réponse, il s’éloigna.
Écuyers et sergents se dispersèrent, la tête basse, sans oser s’entre-regarder.
Dès l’aube, un matin, des hérauts vinrent annoncer au roi Amaury que le prince des Montagnes, redoutant pour son hôte l’ennui de l’inaction, avait donné l’ordre d’organiser une chasse, dans les forêts voisines, et qu’elle serait dirigée par le très illustre émir de Schaïzar, Ousama, fils de Mourschid, un puissant seigneur des environs, pour le moment en paix avec Raschid ed-Din et qui était venu lui rendre visite.
Cette nouvelle fut accueillie par des acclamations joyeuses. Le roi fit répondre qu’il remerciait le prince des Montagnes et acceptait avec plaisir.
Presque aussitôt le pont-levis s’abaissa, la porte du château s’ouvrit toute grande, et, sur le noir profond de la voûte, apparut toute une foule de jeunes piqueurs, dont les costumes aux vives nuances chatoyèrent comme les fleurs d’un bouquet. Ils s’élancèrent sur le pont, avec impétuosité, entraînés par les bonds de superbes lévriers blancs, aux colliers brodés de pierreries, qu’ils retenaient par des chaînes d’or. Une compagnie de fauconniers, vêtus à la persane, sortit ensuite, tenant sur le poing les gerfauts, les faucons, et les sacrés qui s’attaquent aux lièvres et aux outardes. Ils furent suivis par quarante cavaliers munis d’épieux, de haches, d’arcs et de filets et par de nombreux esclaves nègres, en tuniques rouges, qui tenaient par couples des chiens turcomans, à la peau bleue, grands comme des tigres, et aussi des guépards dressés à la chasse.
Dès qu’ils eurent franchis le pont, les cavaliers poussèrent, d’une seule voix, un cri aigu, strident, vibrant et se lancèrent sur la pente verte de la colline dans une course folle ; tournoyant, voltant, galopant, avec une légèreté et une prestesse qui émerveillèrent les Francs, dont les grands et vigoureux chevaux n’avaient pas cette agilité ; puis, tous ensemble, brusquement, les Arabes s’arrêtèrent, se turent et présentèrent une seule rangée parfaite de cavaliers immobiles. Une longue acclamation accueillit cette prouesse.
Amaury lança son cheval et s’avança jusqu’à l’extrémité du pont pour saluer l’émir Ousama qui sortait du château.
Ce prince syrien, vieillard ayant alors plus de soixante-quinze ans, mais d’une verdeur et d’une force extraordinaires, était célèbre parmi les Francs, car il avait eu des relations avec plusieurs rois chrétiens. S’il était un adversaire redoutable à la guerre, on le savait, en temps de paix, parfait chevalier, seigneur courtois et généreux. C’était aussi un grand chasseur de lions : il en avait tué un nombre incroyable, et l’on racontait que, dans son palais, une salle était ornée, de façon très farouche, par des arceaux et des rosaces faits de têtes de lions et de têtes d’hommes.
Ousama était grand, maigre et d’un aimable visage, où l’on voyait encore les traces d’une beauté fameuse, chantée jadis par les poètes. Il se plaisait à présent à redire lui-même les vers à sa louange, en souriant, et en soupirant de regret ; ceux surtout qui célébraient ses yeux, qu’il avait eu magnifiques et dont l’éclat n’était pas éteint tout à fait :
« Le coup de l’épée acérée, qu’est-ce donc auprès de ce coup d’œil, d’une langueur si séduisante ?
« Qu’est la magie babylonienne comparée aux enchantements des yeux d’Ousama ?… »
Toutes les châtelaines venues du voisinage s’étaient jointes aux trois dames qui, seules, avaient accompagné le roi dans son voyage, et, bien campées à cheval, le faucon sur le poing, elles formaient un charmant groupe avec leurs voiles de toutes les couleurs, disposés, sous de légères couronnes, de façon à garantir du soleil les frais et jolis visages.
On laissa les piqueurs et les pages prendre de l’avance et on se mit en marche, dans un joyeux désordre, au son des trompettes d’ivoire.
Tout de suite, pour des oiseaux sans importance, on décapuchonna des faucons, et, un lièvre ayant dévalé, plusieurs chevaliers, éperonnant leurs chevaux, se jetèrent, comme des fous, à sa poursuite.
— Laissez ! laissez ! cela n’est rien, criait le vieil émir, qui aimait ordonner une chasse avec autant de soin qu’une bataille.
Mais il haussa les épaules d’un air résigné, comprenant qu’il ne fallait pas chercher à discipliner les Francs, qu’à la chasse, aussi bien qu’à la guerre, ils allaient toujours chacun selon sa fantaisie. Et il suivit d’un œil curieux ces jeunes hommes, nés pour le combat, violents, emportés, dont les fiers visages étaient pour la plupart balafrés de cicatrices, et qui avaient une joie exubérante, à la fois enfantine et formidable, tellement que leurs cris et leurs éclats de rire semblaient terribles comme des rugissements de bêtes fauves.
Le roi racontait à Ousama combien la vue d’un lièvre lui serrait le cœur, son oncle, le roi Baudouin, s’étant tué, dans les environs d’Acre, à là poursuite d’un lièvre, levé, par hasard, devant sa promenade. Il avait lancé son cheval dans un chemin impraticable, et la bête l’avait jeté bas, contre un rocher, où il s’était rompu le crâne.
— La cervelle lui sortait par le nez et par les oreilles, disait Amaury. Je n’avais alors que sept ans, mais je n’ai jamais oublié ce malheur. Être venu d’outre-mer pour défendre son Dieu et mourir pour un lièvre !
L’émir admirait celle témérité des chevaliers francs, qui allait parfois jusqu’à la démence et leur devenait fatale, mais, souvent aussi, tournait à leur gloire.
— J’ai connu un des vôtres, disait-il, qui, à lui seul, est venu à bout de plusieurs centaines d’adversaires, lesquels s’étaient réfugiés dans des cavernes inaccessibles. On n’y pouvait accéder qu’à l’aide de cordes suspendues aux cimes. Ce satan parmi vos cavaliers se fit construire une caisse de bois qu’on attacha par des chaînes de fer. Il s’y installa, avec son arc et ses flèches, et se fit descendre au niveau des cavernes. Et là, tout à son aise, il massacrait si bien les malheureux, entassés dans ces grottes, qu’ils se rendirent à merci. Il y a bien longtemps de cela : c’était au temps où le prince d’Antioche, Tancrède, nous faisait la guerre.
— Vous avez connu Tancrède ? s’écrièrent les dames, en se rapprochant, curieuses.
Se pressant autour de lui, elles écoutaient les anecdotes, que le noble vieillard, si riche en souvenirs, contait volontiers, et par courtoisie, elles se retenaient de rire à la façon dont il parlait la langue franque, requérant à chaque moment l’aide de l’interprète, impassible, qui le suivait. Puis elles l’interrogèrent sur le Vieux de la Montagne, sur les splendeurs de son château et les mystères de sa puissance.
— C’est un prince tout à fait au-dessus des hommes, disait Ousama. Par la supériorité de son savoir, il a confondu tous les savants de l’Orient, venus pour lutter avec lui. Il est juste et généreux, terrible seulement à ses ennemis, inaccessible aux passions, on assure que l’eau ne peut refléter son image, et, vraiment, la force de sa volonté est telle qu’elle fait des miracles.
— Des miracles ! Lui en avez-vous vu faire ?
— J’ai vu des choses singulières, dit l’émir. Une fois ceci : Auprès du trône de Raschid, sur un plat d’or, une tête baignait dans son sang. Le Grand Maître, devant les frères, stupéfaits, lui parlait : « Veux-tu revenir sur la terre ou préfères-tu rester au paradis ? » Et la tête, ouvrant des yeux très brillants, répondit : « Qu’ai-je besoin de revenir au monde après avoir vu mes pavillons au paradis, et les houris, et tout ce que Dieu m’a préparé ? Saluez ma famille, camarades, et gardez-vous de désobéir à ce prophète… »
Un autre jour, je chevauchais avec le seigneur des Montagnes dans les environs de Kahf. Un vagabond s’approcha qui faisait danser un singe. Raschid dit à quelqu’un de son entourage : « Prends ce dinar et donne-le à ce singe. » Le singe retourna en tous sens la pièce d’or, la regarda avec une attention extraordinaire et, soudain, expira. Le seigneur fit compter une somme au vagabond, qui se lamentait, et comme la cause de cette mort brusque nous échappait, il nous dit : « Ce singe fut jadis un roi puissant, et le dinar que je lui ai donné était frappé à son nom ; en le voyant, le souvenir de sa grandeur passée lui est revenu, avec le sentiment de sa dégradation présente. La violence du chagrin l’a tué. »
— Je ne sais comment le magicien a su que je désirais avoir de lui mon horoscope, dit la princesse Sybille, qui, sombre et préoccupée depuis le départ, semblait méditer quelque projet. Un page me l’a remis ce matin, enfermé dans un étui d’or orné de pierreries magnifiques.
— L’horoscope est plein de belles promesses, je pense ? dit le roi.
— Il est tel que pouvait l’attendre une fille d’un esprit turbulent et félon comme je le suis.
Et, rageusement, Sybille piqua son cheval, bondit en avant du groupe, dans le vallon tout en fleur.
Les châtelaines se récriaient d’être forcées d’écraser, sous les sabots de leurs montures, les anémones, si belles, de si riches couleurs, qui formaient, à perte de vue, des tapis, comme n’en auraient pas pu tisser les plus habiles artistes de Bagdad ou de Perse, qui prenaient cependant pour modèle ces merveilleuses prairies.
On atteignit la forêt ; on entra sous le couvert des arbres. Là, des cris retentissaient de toutes parts, de longs aboiements, des appels de trompes. Le gibier, débusqué, fuyait, suivi de près par les grands lévriers couleur de lait, aux beaux colliers de pierreries !
Alors le vieil émir donna le signal et mit son cheval au galop.
La journée fut rude et brillante, le carnage immense, de victimes de toutes les espèces. Pendant les haltes, on fit rôtir des chevreuils entiers, des paons et des outardes ; abondamment le vin coula des outres, pour les chevaliers, et l’on servit aux dames des fruits délicieux : pastèques, figues, grenades, oranges, et aussi des sorbets et de l’eau de neige.
Vers le soir, la princesse Sybille, qui n’avait pas cessé de chercher Hugues de Césarée dans l’éparpillement de cette foule, sans être parvenue à le joindre, l’aperçut enfin, arrêté près d’un ruisseau. Le chevalier rendait les rênes à son cheval, qui baissait le cou pour boire.
Impétueusement, elle courut au jeune homme et, en évitant de le regarder, lui dit d’une voix impérieuse :
— Cette nuit, sous votre tente, veillez en m’attendant.
Puis, enlevant sa monture, elle franchit le ruisseau et s’éloigna rapidement, sans se retourner.
Quel moyen d’échapper à cet ordre sans réplique ? Hugues, aussi surpris qu’inquiet, demeura longtemps à la même place, l’esprit remué par toutes sortes de pensées. Il était, malgré lui, flatté d’être recherché, avec tant de persistance, par une princesse royale, belle et orgueilleuse. Mais son cœur, si profondément épris, rapportait toutes choses à la bien-aimée, qui restait pour lui bien au-dessus des mortelles et toujours inaccessible. Si un peu de vanité le faisait sourire, c’était à l’idée que, peut-être, il pourrait ne pas paraître trop indigne aux yeux de Gazileh, puisque d’autres yeux ne voulaient voir que lui seul.
Cependant, à l’attente de cette entrevue, l’angoisse lui serrait la gorge. Jeunes femmes et jeunes filles, pour la plupart, intrépides et effrontées, n’avaient aucune honte à déclarer leurs sentiments aux chevaliers de leur goût ; elles les requéraient en mariage, ou même pour de passagères amours.
Combien discourtois et digne de moquerie le jeune homme qui se dérobait à de si douces réquisitions !… Et lui, surtout, qui vivait chaste comme un prêtre depuis qu’une passion impossible l’absorbait tout entier, saurait-il résister à de trop charmantes séductions ?
Un instant, il eut l’idée de déserter sa tente, de se réfugier auprès de son frère d’armes. Cependant il n’en fit rien, et même fut rentré un des premiers au campement.
Quand ses valets vinrent pour le dévêtir et le mettre au lit, il leur ordonna de disposer de nombreuses chandelles de cire, dans les grands chandeliers de vermeil, et de les allumer : beaucoup de lumière lui semblait une sauvegarde.
Il changea de vêtements et après avoir congédié tous les pages, il fit sa prière, plus longue et plus fervente que de coutume.
Il se relevait en terminant le signe de croix lorsque Sybille entra, voilée à la façon des Turques. Un moment éblouie par tant de clarté, elle se remit vite et le remercia d’avoir illuminé sa tente, comme une chapelle, pour la recevoir.
— Vous êtes, pour moi, aussi respectable et sacrée que Madame la Vierge, dit-il.
Elle secoua la tête d’un air mutin et un peu moqueur et, se dévoilant, lui laissa le loisir d’admirer les grâces de sa personne et de sa parure, que faisait valoir l’éclat de tant de cierges. Mais elle était blonde, blanche et rose, avec des yeux couleur de ciel : le contraire de ce qu’il adorait. Entre elle et lui, il évoqua le pâle visage au front pensif, les cheveux de cuivre sombre, le beau regard, frère de nuits étoilées, et il eut un sourire extasié, auquel Sybille se méprit.
— Hugues, dit-elle, en se rapprochant, je ne me serais jamais pardonné d’avoir manqué ma vie et mon bonheur, faute de m’être franchement expliquée avec vous. Je suis d’assez noble sang pour ne rien craindre de mes actes ; ma démarche, d’ailleurs, n’a rien que de loyal et de juste. Depuis assez longtemps je songe à vous pour être certaine qu’il ne s’agit pas, dans mon cœur, d’une fantaisie vite oubliée. Je vous avais choisi pour être mon chevalier, je vous désirais pour mari ; mais quelqu’un, toujours, de façon indiscrète et tyrannique, s’est jeté entre nous, et peut-être n’avez-vous rien vu de ce que mes yeux pensaient vous dire, peut-être ne savez-vous pas que je vous aime.
— Madame, dit Hugues, qui, soudain, se sentit parfaitement calme et maître de lui, ce quelqu’un dont vous parlez sera toujours comme un bouclier entre vous et moi : nous avons bu le sang l’un de l’autre et nous avons échangé le serment de fidélité constante. Au prix de ma vie j’aurais renoncé à un bonheur et à un honneur digne d’un roi, j’aurais arraché l’amour de mon cœur, puisque mon frère d’armes vous aimait.
— Ah ! c’est démence de parler ainsi, s’écria Sybille avec passion. Est-ce que l’on arrache l’amour ? Il s’enracine d’autant plus qu’on cherche à le tirer du cœur. Quant à celui que vous dites, sachez que je le hais et que votre sacrifice, jamais, en aucun cas, ne sera à son profit. N’ayez donc pas scrupule à m’aimer, messire de Césarée, et acceptez ma royale alliance.
Hugues, devant son élan, s’était imperceptiblement reculé. Ce fut assez pour que, prise de colère, elle lui dit d’un ton méprisant :
— Ne fuyez pas, chevalier ; c’est inutile : je n’ai nulle envie de vous faire jouer le rôle de Joseph avec son Égyptienne.
Mais sa colère tomba. Elle s’assit loin de lui, faible, et vaincue par la ténacité de son désir, ne voulant pas y renoncer encore. Les sourcils contractés, elle regardait le jeune homme, avec l’amer dépit de ne pouvoir se défendre du plaisir, toujours aussi vif, que lui causait sa vue. L’élégance et la force de ses membres souples, la taille menue, les puissantes épaules, l’éclat fugitif des dents, sous l’or fluide de la barbe, entre les lèvres fraîches, et surtout, sous la pénombre des grands sourcils veloutés ; les yeux changeants, si rêveurs, si doux et si mystérieusement tristes ! Il lui semblait qu’elle les aurait contemplés des jours entiers, sans assouvir son envie de les voir.
Impatiente contre elle-même, elle frappa du pied, tandis que, muet, un peu gauche, il se tenait devant elle.
— Écoutez-moi, dit-elle enfin. Aujourd’hui, j’ai lu des prédictions. On m’annonce que je serai reine. Reine, je ferai roi mon époux. Peut-être une couronne vous tentera-t-elle, puisque je n’ai pas, sans elle, le don de vous plaire.
— Homphroy est plus digne que moi de la couronne et de la reine, dit-il. Aimez-le, princesse, je vous en conjure : nul plus que lui ne mérite l’amour.
Elle se leva, pâle de rage, l’œil brillant d’une larme, que son orgueil brûla sous sa paupière.
— C’est bien ! dit-elle. Tout ce que j’avais de bon en moi, je le brise, ici, à vos pieds. On me prédit aussi que mon ambition ne reculera devant rien, pas même devant le crime, J’accepte ! Les révoltes de mon âme violente se seraient fondues en amour sur votre cœur ; je vous rends responsable de tout le mal que je ferai. Vous n’avez pas voulu de ma tendresse : redoutez mon ressentiment, et, si je suis jamais reine, hâtez-vous de quitter le royaume.
Elle écarta si violemment le rideau de la tente qu’elle l’arracha à moitié et elle s’enfuit dans l’ombre du camp endormi.
Aussitôt, les tapis et les coussins, qui formaient le lit s’agitèrent, et Homphroy, tout rouge de honte et de douleur, en sortit et se jeta aux pieds de son ami.
— Je suis un traître et un félon, cria-t-il. Je l’ai vue entrer sous ta tente, j’ai douté de toi, j’ai voulu entendre. Pardonne-moi, et réjouis-toi aussi, car mon fol amour est mort, et mon cœur n’est plus qu’à toi seul.
XI
C’était l’heure des audiences du prophète. Le chambellan Dabboûs venait d’introduire un frère de la Pureté, que Raschid, rêveur, oubliait à ses pieds.
— C’est l’homme qui avait mission de suivre l’envoyé des Francs, dit Dabboûs en haussant la voix.
— Eh bien, qu’il parle.
— Ta bénédiction soit sur moi ! ô saint prophète ! dit le frère. Selon ton ordre, en même temps que l’envoyé du roi franc, je suis arrivé chez les Templiers, déguisé en moine quêteur. Milon de Plancy s’est acquitté de sa mission, mais le Grand Maître du Temple n’a pas consenti à livrer le meurtrier de ton ambassadeur. Il affirme qu’il l’a envoyé à Rome, afin que le pape le relève de son crime.
— Raschid, dit le chambellan, ta pensée est ailleurs : tu n’écoutes pas.
— Si !…, si !… Il l’a envoyé à Rome. Ensuite.
— Je me suis assuré, continua le frère, que personne n’est parti pour Rome, aucun navire n’a quitté les ports. Le Grand Maître du Temple a menti.
— L’envoyé franc est-il retourné vers le roi ?
— Nul ne peut nous devancer, seigneur, tu le sais. Mais Milon de Plancy ne songeait pas encore au retour : il fait, là-bas, bonne chère et s’enivre jusqu’à perdre le sens. Je le crois, d’ailleurs, traître à son roi et occupé à ourdir quelque complot, en compagnie d’un Templier qui ne le quitte guère.
— Le nom de ce Templier ?
— Gauthier du Mesnil, un homme fort laid et borgne. Deux de nos frères surveillent leurs actes pour t’en rendre compte. J’ai tout dit, maître.
— C’est bien. Retire-toi !
Et, quand il fut sorti, le prince dit à Dabboûs :
— Il faut faire savoir à l’instant au roi Amaury, ce que son ambassadeur ne lui redira que dans quelques jours, et lui dévoiler aussi la félonie et le mensonge du Grand Maître ; mais qu’il ne soit pas parlé de la trahison possible que le seigneur Milon complote avec le Templier : nous savons encore trop peu de chose sur ce sujet.
— J’entends, dit le chambellan, en introduisant un autre frère. Celui-ci, ajouta-t-il, dit avoir des révélations importantes à te faire. Il ne vient pas de loin : blessé à la dernière bataille contre les Francs, il a été soigné et guéri par eux.
Et Dabboûs s’éloigna pour faire exécuter l’ordre du maître.
L’homme était prosterné et baisait les pieds de Raschid.
— Je t’écoute, dit celui-ci.
— Ô prophète de Dieu ! dit l’Arabe, combattant pour ton service, l’heure de la récompense semblait sonner pour moi, car, criblé de blessures, étouffé sous un tas de morts, je croyais que j’allais retrouver enfin les joies du paradis, que tu as entr’ouvert pour moi. Mais, par la volonté de Dieu, malgré mon agonie, je dus voir et entendre encore, être témoin d’une scène qui intéressait son prophète.
— Qu’as-tu donc vu ? dit Raschid, subitement attentif.
— Un chevalier franc, blessé, criant à l’aide, une femme, une houri céleste, accourait, qui le ranima, le pansa et, après divers échanges d’affectueuses paroles, lui révéla qu’à sa grande terreur on la conduisait, comme otage, dans le château de Raschid ed-Din.
— Cette femme, elle s’est laissée voir à lui, sans voile ? s’écria Raschid sans dissimuler son émotion.
— Oui, maître : croyant que l’homme allait mourir, elle s’est dévoilée.
— Poursuis.
— Le blessé lui offrit de la défendre, d’être son chevalier.
— Qu’a-t-elle répondu ?
— Elle a accepté et doit l’avertir par un signal, si un danger la menace.
— Un signal ?
— Son voile blanc, flottant à l’un des créneaux.
— Est-ce tout ?
— Elle lui a dit son nom.
— Ce chevalier, qui est-ce ?
— Le comte Hugues de Césarée.
— Va, va, laisse-moi, dit Raschid. Tu as bien agi, et, puisque tu es impatient de la mort, je te promets d’obtenir de Dieu qu’il abrège ta vie de dix années.
Dabboûs revenait. Le prophète lui fit signe de mettre fin aux audiences.
— Non ! non ! plus personne, dit-il.
Le chambellan, effrayé, s’élança vers son maître :
— Quelle nouvelle funeste vient-on de t’apprendre qui te bouleverse ainsi ?
— Ah ! toujours cette folie, qui déjà me couvre d’humiliation ! s’écria Raschid. Peux-tu le croire, Dabboûs ? je suis trahi, dédaigné. Cette femme élue par mon cœur, qui pouvait être plus glorieuse qu’aucune reine du monde, au premier venu, à un soldat franc, elle dévoila sa beauté et demande assistance contre moi !
— La femme est toujours la femme, de quelque séduction que le diable l’ait parée.
— Elle s’est laissé voir ! Un autre regard que le mien possède son image ! Un autre amour se heurte à mon amour ! Ah ! je le sentais bien, qu’il y avait un obstacle, qu’elle ne m’aimerait pas. C’est ce chevalier qui occupe sa pensée. Elle l’aime peut-être… C’est pour lui un arrêt de mort. Mais, avant de le faire disparaître, je l’aurai envié, j’aurai subi cette honte d’être jaloux d’un homme !… Non ! non ! à tout prix, il faut me délivrer de cette obsession.
— Hâte-toi de renvoyer Gazileh à son oncle, dit Dabboûs : l’éloignement amènera l’oubli.
Mais Raschid, abaissant ses paupières sur ses yeux, brûlés de larmes, dit, d’une voix qui tremblait :
— Entre elle et moi il faut l’impossible, l’irrémédiable ou jamais je ne l’oublierai. Hélas !… je dois briser la coupe, répandre l’ambroisie dont je suis avide… pour rendre ma soif vaine à jamais.
— Que veux-tu dire ?… s’écria Dabboûs en frissonnant.
— Gazileh doit mourir.
— Prends garde, dit le chambellan après un silence. Certes, au prix de ton repos, la vie d’une femme est peu de chose, et le crime de s’être montrée sans voile à un infidèle justifierait sa condamnation. Mais ce n’est pas au nom seul de la justice que tu la condamnes.
— Elle doit mourir, répéta Raschid.
— Tu n’es plus un juge impartial.
Mais Dabboûs s’interrompit ; brusquement il souleva une portière… Il avait cru entendre un cri étouffé, des pas légers…
— Je ne m’étais pas trompé, dit-il : la jeune suivante était là, cachée… elle a entendu ton arrêt et vu le rapporter à sa maîtresse.
Et il montra Nahâr, qui s’enfuyait par la galerie montant aux remparts.
— Laisse-moi, dit Raschid, je veux les rejoindre.
Gazileh était sur cette haute terrasse qu’elle affectionnait, les coudes sur la pierre d’un créneau, regardant au loin. La course effarée de Nahâr la fit se retourner, et elle demeura muette devant le visage bouleversé de la jeune fille, qui, elle non plus, ne pouvait pas parler.
— Tu es perdue ! dit-elle enfin, en contenant à deux mains les battements de son cœur : il veut te tuer !
— Me tuer ?…
— « Gazileh doit mourir », a-t-il dit. J’aurais du me jeter à ses pieds, lui crier que tu l’aimes, puisque c’est ton amour qu’il veut.
— Tu aurais menti : je ne l’aime pas.
— Tais-toi ! tais-toi ! Il faut bien feindre de l’aimer pour sauver ta vie.
— Je préfère mourir.
— Mais pourquoi cette folie ? s’écria Nahâr, en se tordant les bras ; pourquoi repousser l’amour d’un homme qui est plus qu’un roi, qui est jeune, beau, tout-puissant, et que Dieu a marqué de son sceau ?…
— Que sais-je ? dit Gazileh. Il m’épouvante. Il est trop surhumain, trop terrible ; il me paraît marcher le front dans le ciel, les pieds dans le sang.
— Ah ! dis-le donc plutôt : tu aimes ce chevalier, que tu as tenu un instant évanoui entre tes bras. Si ton cœur n’était pas à lui déjà, tu te résignerais facilement à un amour aussi glorieux.
— Oui ! mon cœur est ainsi fait : j’aime celui qui voudrait mourir pour me sauver, et non pas celui qui veut me tuer parce qu’il m’aime.
— Ah ! malheureuse ! dit Nahâr en pleurant, le prophète sait tout, et tu rends son arrêt irrévocable… Au moins, appelons-le, ce chevalier : qu’il vienne à ton aide, qu’il te sauve donc. Donnons-lui le signal convenu.
— Quelle dérision ! Que veux-tu qu’il fasse ? À quoi bon le perdre inutilement ?
— De toute façon, il est perdu, car Raschid ed-Din sait la vérité. Que le chevalier tente au moins quelque chose pour sa dame !
La jeune fille détacha le voile de Gazileh, qui se défendait, et, malgré elle, fixa le léger tissu à une moulure du créneau, puis elle entraîna la princesse loin du rempart.
Par l’étroite meurtrière d’une tourelle d’angle, Raschid avait vu et entendu les jeunes filles. Il s’avança sur le chemin de ronde, lorsqu’elles furent parties, jusqu’au créneau où le voile était attaché.
— C’est bien cela, murmura-t-il : le signal ! La gaze s’agitant comme une main blanche qui appelle… Je suis curieux de voir ce que fera l’amoureux.
Mais une bouffée de rage lui fit crisper les poings.
— Est-ce bien possible ? cria-t-il. C’est moi qui suis ici, le cœur déchiré de haine et d’amour, guettant furtivement les actions d’une femme !… Ah ! la honte m’écrase ! Mais je terrasserai cette révolte de mon corps misérable. Je le veux ; il le faut !
Au même moment, sous la caresse fugitive du parfum suave qui flottait, il eut une défaillance et, pour échapper au désir d’appuyer sur ses lèvres le voile aérien, tout embaumé, il se recula brusquement, en disant d’une voix brisée :
— Il n’y a pas d’autre issue ; c’est irrémissible… Elle doit mourir.
XII
— Hugues, mon frère, vous êtes tout songeur et triste, dit Homphroy du Toron à son ami, étendu à quelques pas de lui, sur l’herbe, au bord de la petite rivière qui fuyait si vite…
— Hélas ! je ne sais quelle angoisse me tourmente, répondit Hugues. Il me semble que ce château, vers lequel tendent toutes mes pensées, a l’air diabolique plus que de coutume. J’ai peur à l’idée qu’elle est là, sans défense, si belle, à la merci d’un homme… Mais, cher Homphroy, vous vous inquiétez de mes peines, en taisant les vôtres. Autant que moi vous êtes soucieux.
— Je souffre d’étrange façon, c’est vrai, dit Homphroy : c’est en moi comme un silence subit, après un grand tumulte. Ne me jugez pas fou, Hugues, mon ami : il me semble que je souffre de ne plus souffrir… Mon cœur est vide de sang, comme une plante dont la sève est desséchée. Sans doute, c’est une fleur, l’amour. Pour s’épanouir, elle aspire avidement au tiède printemps, et c’est la gelée qui est venue. La voici, à peine ouverte, flétrie et morte, cette fleur qui était le parfum et l’enchantement de ma vie, et je la pleure, en dépit des épines dont elle me déchirait.
— J’ai détourné sur moi, sans le vouloir, la faveur qui vous était due, et cela m’est un constant chagrin…
— Souvent Dieu vous envoie un mal pour votre bien, dit Homphroy avec vivacité. À cause de vous, la fleur s’est dénoncée vénéneuse. Vous m’avez sauvé du poison, et votre amitié, comme un baume, me guérira.
Ils échangèrent un triste et affectueux sourire et, pensifs, ne parlèrent plus, regardant le remous de l’eau, jusqu’à s’étourdir.
Le camp, si animé d’ordinaire, était silencieux, presque désert. Les tentes, claires au soleil, avec le triangle noir de leur entrée ouverte, moutonnaient comme des monticules de sable. Aucune brise n’agitait les étendards, qui retombaient le long des hampes, ainsi que des linges mouillés. Des sergents dormaient par terre, dans les morceaux d’ombre.
Le roi était allé en pèlerinage à Notre-Dame de Tortose, une magnifique cathédrale, la première édifiée en Terre sainte, en l’honneur de la mère du Christ. La montagne des Ansariés n’en était distante que de quelques lieues, et le sanctuaire était particulièrement vénéré, : à cause des grands miracles que Madame la Vierge y faisait.
Toute la cour accompagnait le roi, et tous les chevaliers avaient chevauché à sa suite, dans un grand recueillement, car Amaury réclamait les prières de chacun, afin que son pèlerinage fût bien accueilli de la miraculeuse Notre-Dame, qu’elle lui accordât ce qu’avec ferveur il lui demandait.
Excepté l’évêque Guillaume, nul ne savait quelle était cette demande ; tous, néanmoins, priaient très dévotement, Hugues et Homphroy avaient voulu rester pour veillera la garde du camp.
Vers le milieu du jour l’attention d’Homphroy, dont le regard portait loin comme celui de l’aigle, fut attirée par un homme qui déboucha d’une gorge étroite et dont les allures furtives étaient inquiétantes. Il se dissimulait derrière les rochers, regardait tout alentour avant d’avancer, et souvent levait les yeux vers le château de Raschjd ed-Din. Les mouvements du terrain le cachaient par moments ; puis il reparaissait plus proche. Il fut bientôt évident qu’il se dirigeait vers le camp des Francs.
Homphroy posa la main sur le bras de son compagnon :
— Voyez donc, dit-il, ce vieil homme qui vient ici, tout las et suant, comme s’il avait fait une longue route.
— C’est un infidèle, dit Hugues après avoir examiné l’étranger ; il porte le costume des derviches. Que peut-il chercher parmi nous ?
Les deux chevaliers s’étaient levés ; mais le nouveau venu, comme épuisé, s’affaissa sur un tertre, au pied d’un arbre.
— Son âge commande le respect, et il a grand air, malgré son vêtement modeste, dit Homphroy. Nous devons le saluer et lui offrir nos services, puisqu’il est dans notre camp.
Ils s’approchèrent.
— Salut ! hôte étranger, qui semblez arriver de loin, dit Hugues. La chaleur est forte, la route poudreuse : nous aurons plaisir à vous réconforter par des boissons fraîches et quelques aliments à votre goût.
— Le salut soit sur vous ! jeunes hommes, répondit le vieillard, en posant la main sur son cœur. Si vous voulez m’obliger, conduisez-moi sans retard, vers Amaury, le roi de Jérusalem.
— Le roi notre sire s’est éloigné du camp.
— Il n’est plus ici ?… s’écria le vieillard, dont tous les membres furent secoués d’un tremblement.
— Il y reviendra sur l’heure, continua Homphroy, ému de cette angoisse. Déjà je crois entendre le son des orgues portatives et la mélodie des cantiques. La procession n’est pas loin, et le roi sera là, bientôt.
— En attendant, ne refuse pas le réconfort, dit Hugues, en aidant l’inconnu à se lever.
— J’en ai grand besoin, c’est vrai, répondit l’étranger ; l’esprit inquiet ne se soucie pas du corps, et, pourtant, le corps épuisé peut vaincre l’esprit.
— Venez ! nos tentes sont tout proches, dit le jeune connétable.
Déjà l’on entrevoyait, au loin, les pennons des chevaliers, qui chevauchaient, en une interminable file, par les vallons peu larges. Les chanteurs de psaumes et les ménestrels formant l’avant-garde, marchaient à pied ; plusieurs d’entre eux portaient dans leurs bras des orgues, formées d’un registre de pipeaux ; d’autres avaient des violes ou des psaltérions. Mais les musiciens avaient épuisé tout leur répertoire pieux, et, pour se délasser, maintenant, ils chantaient un poème tout récent, qui racontait, sans rien omettre, l’aventure d’Hugues de Césarée, armant chevalier le musulman Saladin. Ils avaient déjà égrené beaucoup de couplets, le long de la route, et en étaient au moment où Saladin vient de quitter le bain symbolique :
Après qu’il l’a du bain ôté,
En un bel lit il l’a couché.
— Hugues, dites-moi sans faillance
De ce lit la signifiance.
— Sire, fait-il ; ce signifie
Qu’on doit par la chevalerie
Conquérir lit en paradis
Que Dieu octroie à ses amis.
Après, deux éperons lui mitEn ses deux pieds et puis lui dit :
— Sire, tout aussi bien il faut,
Comme éperonnez vos chevaux,
Qu’à l’aide de ces éperons,
Qui dorés sont tout environ,
Vous gardiez bien votre courage
De Dieu servir en tout votre âge,
Car tous les chevaliers le font
Qui Dieu aiment de cœur profond.
Puis ils énuméraient les nombreux devoirs du nouvel initié :
Un chevalier, premièrement,
Ne doit être à faux jugement ;
Si le mal ne peut détourner,
Il doit sitôt s’en retourner…
Une autre chose aussi est belle :Dame ne doit ni demoiselle,
En aucun pas mal conseiller,
Mais c’est la loi du chevalier
De les aider de son pouvoir
S’il veut louange et gloire avoir,
Car femmes doit-on honorer
Et pour leurs droits grands faits porter.
À une centaine de pas derrière les chanteurs, venait le roi, ayant auprès de lui le grand-chancelier.
Amaury, admirablement majestueux à cheval, se tenait droit, la tête haute, un poing sur la cuisse. Le soleil mettait un brasillement d’or dans la barbe fauve et sur les longues boucles, qui ruisselaient sous l’étoffe blanche, nouée par une cordelière au front royal ; la poitrine vaste et les épaules athlétiques tendaient la soie tout unie de la tunique, qui laissaient deviner le jeu des muscles et du souffle puissant. Auprès du maître ; Guillaume, coiffé de la mitre, tenait contre son épaule la crosse d’or, dont l’extrémité inférieure posait sur l’étrier.
Jugeant le souverain recueilli dans sa dévotion et peu disposé aux courtois bavardages, les dames restaient en arrière, s’égayant avec les hauts barons.
Le roi et l’évêque étaient engagés, en effet, dans une grave discussion, qui même semblait n’être nullement du goût de Guillaume, car il mordait ses lèvres, fronçait les sourcils, ne cachait pas son embarras et son humeur, tandis qu’un peu de malice riait dans les yeux d’Amaury.
— Les saints apôtres, les pères et même l’Ancien Testament, nous confirment cette vérité, disait l’évêque ; à quoi bon s’enquérir d’autres raisons ?
— Je ne fais pas doute de ces choses, reprenait le roi ; pour moi, je les crois très fermement. Mais, par exemple, quelle raison pourrai-je donner comme preuve de la future, résurrection et de l’autre vie après là mort à celui qui voudrait débattre contre moi cette doctrine en refusant de la croire ?
— Ah ! sire, j’ai le cœur navré et je suis profondément ému de voir un prince catholique avoir tant de scrupules et de doutes en sa conscience… Tenir de tels discours au retour d’un saint pèlerinage !… Mais, puisque vous le voulez, débattons, Ne confessez-vous pas que Dieu est juste ?
— Certes, je le confesse.
— Il appartient à celui qui est juste de rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal.
— C’est vrai.
— Or cela ne se fait pas toujours en cette vie, car il y a, au siècle présent, plusieurs gens de bien qui n’endurent que malheur et adversité, quand les méchants, au contraire, jouissent d’une félicité constante.
— Cela est certain..
— C’est pourquoi, conclut Guillaume d’un air triomphant, il faut reconnaître que la résurrection de la chair est certaine et, qu’en l’autre vie, se fera la rémunération du bien et du mal méritée en ce monde, car il ne se peut pas que Dieu laisse le bon puni et le méchant récompensé.
— Ta réponse me plaît grandement ! s’écria le roi. C’est au point que, par ta parole, tu as ôté tout le doute qu’il y avait en mon cœur.
On était arrivé au camp. Amaury mit pied à terre, et, tout aussitôt, Hugues de Césarée s’avança vers lui, suivi du vieillard inconnu.
— Qu’y a-t-il, chevalier ? dit le roi. Vous semblez désirer audience.
— Sire, répondit Hugues, cet étranger venu de loin demande à vous entretenir sur l’heure et secrètement.
Amaury fit un pas vers le vieillard.
— Dieu te garde, mon hôte, dit-il. Que veux-tu de moi ?
L’inconnu, en voyant le roi, avait pâli et dardé sur lui un farouche regard. Il balbutia :
— Avec toi soit le salut, noble Franc.
—Tu parais douloureusement ému, dit Amaury, qui vit ce trouble. Parle, ne crains rien.
Mais l’autre baissa la tâte et murmura comme pour lui-même :
— Le saint Qorân nous l’enseigne : le paradis est à ceux qui pardonnent.
— J’attends, dit le roi, les sourcils froncés.
Alors le vieillard se rapprocha, baissa la voix :
— Roi chrétien, te souviens-tu de la musulmane Zobeïde, fille du prince de Hama ?
Amaury, pâle à son tour, eut un cri de surprise, et vivement entraîna l’étranger sous sa tente, en faisant signe à Guillaume de les suivre.
— Zobeïde ! C’est bien le nom que tu as dit ? s’écria le roi haletant d’émotion, dès que le rideau fut retombé. Vois, Guillaume : Notre-Dame de Tortose nous favorise d’un miracle. Ce que nous la supplions de nous faire savoir, ce vieillard, sans doute, vient nous l’apprendre.
— Vous avez combattu pour le ciel : le ciel veut effacer vos fautes, dit l’évêque.
Le roi montra Guillaume à son hôte en lui disant :
— Il est mon confesseur et sait mes faiblesses. Parle : tu peux t’expliquer devant lui. Zobeïde, dis, que sais-tu d’elle ? Depuis que son père me l’arracha si cruellement, rien, plus rien ! Le mystère, le silence de la mort.
— C’était la mort, en effet, seule capable d’emporter avec elle le déshonneur.
— Ah ! ce père implacable, ce monstre, il l’a tuée ?
— C’était mon frère, il n’est plus, dit le vieillard avec dignité. Je suis prince de Hama.
— Pardon, prince… Zobeïde est morte ?
— Elle était condamnée au glaive ; mais, à force de prières, j’obtins un sursis, au nom de l’innocente créature qui allait naître, et, par bonheur, épuisée de honte et de chagrin, Zobeïde mourut quand son enfant vit le jour… Ainsi, elle échappa au bourreau. Son père, miné par le désespoir, succomba bientôt après.
— Voyez, roi, dit Guillaume, combien la légèreté de la jeunesse peut engendrer de malheurs en quelques instants de plaisirs coupables.
— Ah ! j’expie, Guillaume, j’expie ! dit Amaury en couvrant ses yeux de sa main.
— Daignerez-vous nous dire, prince, demanda l’évêque, ce que l’enfant est devenu ?
— Je l’ai élevé : une fille, la joie de ma vieillesse. On me l’a prise !
— On vous l’a prise ? Qui, qui donc ? décria le roi.
— Qui ?… le terrible Raschid ed-Din, le vautour de la montagne, qui nous tient tous les deux dans ses serres.
— Lui ! Pourquoi ?
— Je l’ai bravé ; il m’a vaincu jusqu’à m’avoir à sa discrétion et ne m’accorda la paix qu’en exigeant ma Gazileh comme otage. J’ai cru d’abord que ce n’était là qu’un caprice du vainqueur, pour me torturer mieux ; mais, en apprenant que le roi de Jérusalem l’avait gravement offensé, j’ai tout compris.
— Comment ? qu’as-tu compris ?
— Qu’il a pris cette jeune fille pour nous mieux tenir, toi et moi.
— Il saurait qu’elle est ma fille ?
— Sans aucun doute, il le sait. Que ne sait-il pas ?… C’est pourquoi, dès que la nouvelle de votre différend est arrivée jusqu’à moi, je suis parti, déguisé en derviche. Ai-je échappé aux espions du jaloux Raschid ? Je ne sais ; en tout cas, les poignards de ses Dévoués n’ont pas cherché mon cœur. Je suis venu à pied ; l’angoisse me donnait des forces, et me voici. Je te révèle l’existence de cette enfant, que je voulais taire à jamais, pour te supplier en même temps de ménager toutes les susceptibilités de l’ennemi, si tu veux réparer un peu de ta faute passée, en protégeant ta fille.
— Si je le veux ! dit Amaury, en serrant les mains du prince. Mais bannis toute crainte : Raschid sait que mes torts envers lui n’étaient qu’apparents et combien est sincère mon désir de lui donner satisfaction. Je suis son prisonnier volontaire, et, bien qu’il ne m’ait pas encore visité, il se montre envers moi plein de courtoisie. Il sait cependant que les Templiers maudits, que Dieu damne ! refusent la réparation demandée, et que l’affaire menace de traîner en longueur.
— Dieu soit loué ! s’il en est ainsi.
— Il nous protège, sois-en certain. Ta venue ici en est la preuve. Cette enfant que je désespérais de connaître jamais, elle est là à quelques pas. Bientôt, elle nous sera rendue. Reste près de nous, prince, reste jusqu’à ce jour heureux.
— Soit, je resterai, dit le prince de Hama : il me semble que plus près de Gazileh, je serai moins malheureux.
Le roi ordonna de dresser une lente pour l’hôte que Dieu lui envoyait et de préparer un festin. Et, lorsque le vieillard se fut retiré pour se reposer, Amaury courba le front devant l’évêque et lui dit :
— Quelle oblation dois-je au ciel pour la faveur qu’il m’accorde ?
— Si on la mesurait à la grandeur de la grâce, elle serait magnifique.
— Qu’elle le soit, Guillaume. Je le laisse libre de la fixer !
XIII
À cette heure-là même, Hugues de Césarée, levant les yeux, pour la centième fois en ce jour, vers le château du Vieux de la Montagne, aperçut, à un des créneaux, quelque chose de blanc qui palpitait. Avec un cri, il s’élança jusqu’au bord du fossé vertigineux, la main sur les sourcils, regardant de tout son pouvoir. Mais c’était si confus, ce qu’il voyait, si léger, si perdu dans la lumière du ciel !
Le comte de Tripoli et Homphroy étaient accourus auprès de Hugues, en entendant son exclamation.
— Qu’est-ce donc, chevalier ? dit Raymond. Vous êtes tout ému…
— Et si pâle, ami, qu’avez-vous ?
— Dites, dites, s’écria Hugues en saisissant la main de son frère d’armes, vous, dont la vue dévore les distances : là-haut, à cette tour, est-ce une colombe qui bat des ailes, le lambeau d’un nuage déchiré ?…
Homphroy regarda un instant.
— C’est un tissu léger qui flotte au vent, dit-il.
— C’est bien cela : le signal ! Ma bien-aimée m’appelle à son secours.
Raymond de Tripoli écarquillait les yeux.
— Perdez-vous l’esprit, seigneur ?
— Je n’ai pas le loisir de vous expliquer, dit Hugues… Sachez seulement qu’il me faut pénétrer dans ce château, ou bien mourir.
— Que voulez-vous faire ? s’écria Homphroy. Vous savez bien que toute une armée ne forcerait pas ces murailles.
— Le courage de l’homme s’arrête devant l’impossible, dit le comte de Tripoli.
— Si Eschive était, là, prisonnière, et vous appelait à son aide, songeriez-vous à l’impossible ? dit Hugues, qui mesurait de l’œil le précipice.
Raymond, d’abord interdit, réfléchissait.
— Il y a de l’eau dans ce gouffre, dit-il. On pourrait peut-être y descendre et le traverser à la nage. Mais comment escalader ensuite ce massif, qui est comme une muraille ?
— Mieux vaudrait une poutre, s’il en était d’assez longue, abaissée avec précaution et qui atteindrait cette embrasure, dit Homphroy.
— L’honneur m’interdit un pareil moyen, ainsi que tous ceux qui pourraient faire penser que nous rompons la trêve, répondit Hugues. La folie de l’entreprise doit affecter seulement le fou… Priez pour moi, mes amis.
— Que ferez-vous donc ?
Il leur montra de la main un rocher qui faisait saillie et formait une plate-forme à peu près unie en avant d’une poterne basse.
— Voyez, dit-il : là seulement on pourrait s’élancer… Ah ! depuis longtemps j’y songe !
Et il appela un écuyer, lui ordonna d’apporter ses armes et de lui amener son cheval, Iblis, un arabe noir, n’ayant pas son pareil.
— Quoi ? Que voulez-vous faire d’un cheval ? s’écria Raymond. Vous ne songez pas, j’espère, à lui faire sauter cela d’un bond ?
Homphroy, pâle d’épouvante, murmura :
— Non, non, il n’a pas une telle idée !
Hugues, les bras croisés, comme figé dans sa résolution, répondit avec calme :
— Iblis est un animal incomparable. Saladin m’en a fait don, pour me remercier, quand je l’ai armé chevalier. Ce cheval descend, m’a-t-il dit, de la monture de Mahomet : cette jument à tête de femme qui avait dix paires d’ailes, à ce qu’il paraît. Iblis en garde quelques plumes à ses sabots… Voyez, ajouta-t-il en visitant la bride du cheval, qu’on venait d’amener, n’est-ce pas une bête admirable ?… Tous ses muscles frissonnent d’impatience ; il semble ne pas pouvoir tenir à la terre.
— Seigneur, le suicide est un crime qui perdrait votre âme, dit le comte de Tripoli.
— Qui meurt pour sa dame assure son salut !
Il passa sa chemise de mailles, ceignit son épée et se coiffa d’un léger casque.
Homphroy se tordait les bras.
— Hugues ! Hugues ! cria-t-il, que je regrette de ne plus vous haïr, puisqu’il me faut endurer une telle angoisse à cause de vous !
— Dieu protège mon amour : j’en ai eu des preuves, vous le savez. J’ai bon espoir.
Attirés par cette scène, des chevaliers et des soldats s’étaient approchés ; de plus en plus nombreux, ils s’attroupaient, discutaient, tout émerveillés.
— Qu’il n’aille pas faire un pareil saut, pour se rompre le cou, disait-on ; le château est enchanté ; pour y entrer, il faut être comme mort, et emporté par le magicien.
Homphroy se jeta à genoux.
— Je vous en supplie, renoncez à cette folie !
Mais Hugues le releva, l’embrassa tendrement, puis se mit en selle. Alors Raymond saisit la bride et cria :
— Par la force il faut s’opposer à un accès de délire. Barrez-lui la route !
— Ne m’arrêtez pas, comte de Tripoli, dit Hugues, dont le visage s’empourpra ; restons amis, je vous en conjure.
Puis, dardant son regard clair sur tous, il toucha la poignée de son épée :
— Le premier qui bouge a vécu !
Un sergent s’avança cependant.
— Non pas celui, j’imagine, qui, plein d’enthousiasme, réclame l’honneur de verser à un héros le coup de l’étrier, dit-il, en tendant au chevalier un gobelet plein de vin.,
— Je n’ai pas le cœur à boire.
— Ce vin a été récolté à Bethléem, sur l’emplacement même de la crèche. C’est un philtre divin qui doit centupler les forces. Le refuser serait impie.
— Donne donc, dit Hugues, qui vida le gobelet. Adieu, mes amis, ajouta-t-il. Je ne vous demande plus qu’une grâce. Retenez tout mouvement, toute clameur, qui pourraient effrayer mon cheval et diminuer son élan. Mon salut est dans la force de ses jarrets.
Il baissa la visière de son casque et tourna le dos au château pour prendre du champ. Puis il fit volte-face, s’affermit sur ses étriers et, après avoir fait un signe de croix, il éperonna la bête frémissante.
L’angoisse tenait la foule immobile, oppressée, muette. Homphroy, pâle d’épouvante, s’aveuglait de ses mains.
Le cavalier passa, presque invisible, froissant l’air comme un grand vent, s’élança au-dessus du gouffre.
Aussitôt, un grand fracas de branches et de métal, un cri d’horreur, jaillissant de toutes les poitrines. Homphroy était tombé à genoux, se cachant davantage les yeux sous ses mains.
— C’est fini ! murmurait-il.
Tous étaient penchés maintenant sur l’abîme, que de légers feuillages et des fleurs couvraient çà et là. Parmi les cris confus et le brouhaha, des mots se détachaient :
— Quelle pitié ! — Jésus, fais grâce à son âme ! — Brisé sur les rochers ! — Son sang a jailli !
Puis, tout à coup, la clameur redoublant et une seule voix criant :
— Victoire !… Il vit !… C’est un prodige ! Le cheval seul rebondît de roche en roche ! le chevalier s’est retenu à des branches ! Il vit ! le voilà !…
Homphroy se releva d’un bond, découvrant son visage trempé de larmes.
— Que disent-ils ?
— Oui ! oui, c’est vrai, dit le comte de Tripoli. Au moment où le cheval s’abîmait, Hugues, d’un élan désespéré, s’est jeté dans un buisson et s’y est retenu, Dieu sait comment. Le voici qui remonte du gouffre ; mais il semble à bout de forces.
— Ah ! Madame la Vierge ! s’écria Homphroy, les mains jointes, je construirai une chapelle en votre honneur pour vous remercier d’avoir sauvé mon frère d’armes.
— Que fera-t-il, maintenant ? dit Raymond. Il ne peut ni escalader les murailles, ni forcer les portes. Sa situation est digne de pitié.
— Nous veillerons sur lui pour l’aider, s’il est possible, dit le connétable… Mais voyez donc ! Qu’a-t-il ?… Est-ce qu’il est blessé ? On dirait qu’il perd connaissance.
Hugues avait réussi à se hisser jusqu’à la saillie de rocher qui précédait la poterne. Mais là, comme épuisé, il chancelait, passait la main sur ses yeux, semblait vouloir échapper à un engourdissement. Puis il tomba sur un genou, s’étendit et ne bougea plus.
— Hélas ! est-il mort ? dit Homphroy.
— Non, non, je comprends, s’écria Raymond : il s’endort ! Cet homme qui l’a fait boire là, tout à l’heure : un sectaire déguisé !… Où est-il ? Disparu… Je l’aurais juré ! Tenez, voyez.
Silencieusement, la poterne s’ouvrit ; des Frères de la Pureté parurent.
— Hugues ! Hugues ! prenez garde ! cria Homphroy, éveillez-vous !
Deux des Assassins se courbèrent vers le chevalier, le prirent par les épaules et par les pieds, comme un mort, et l’emportèrent dans le château.
Lentement, la porte se referma.
XIV
En sortant d’un sommeil profond et noir, vide comme la nuit du néant, Hugues de Césarée ne se souvint pas du chevalier qu’il était. Il lui sembla voir la lumière pour la première fois, naître à la vie, dans la plénitude de la jeunesse, mais vierge de corps et d’âme, autant qu’un enfant.
Une joie intense le pénétra, en même temps que la lumière l’éblouissait : joie d’exister, de comprendre, d’être libre. C’était Adam s’éveillant dans le paradis.
Le front au ciel, ses yeux buvaient le jour, dont il était avide, comme le nouveau-né du lait qui lui donne la vie. Il croyait l’absorber, et il le sentait pétiller dans son sang, s’épanouir en gerbes d’étincelles dans son cerveau, l’exalter, l’enivrer.
Longtemps il savoura cet enchantement qui rayonnait du ciel ; puis il se souleva un peu, dans les mollesses exquises de son lit de fleurs, abaissa ses regards et il eut un sourire extasié devant l’harmonieuse beauté des choses.
Sous une brume odorante, des frondaisons splendides, des palmes géantes, entre lesquelles apparaissaient la candeur et la grâce des jeunes corolles. Il le savait, c’étaient pour lui qu’elles fleurissaient, à lui qu’elles vouaient leur suave amour. Le parfum portait jusqu’à lui les confuses rêveries de ces fleurs, et, dans son esprit, elles se précisaient, palpitaient, puis s’envolaient en forme d’oiseaux et de papillons. Multipliés par sa fantaisie, ils formaient comme une nuée frémissante, et il suivait le vol de tant d’ailes brillantes, le frisson multicolore des plumes, tout heureux de sentir tomber sur lui, en pluie mélodieuse, les cris et les chants de ces merveilleux oiseaux.
Mais un désir le piqua : il voulut connaître son Eden, le parcourir en entier. Cependant une douce paresse le retenait sur la couche moelleuse, un accablement délicieux, auquel il était impossible de s’arracher.
L’élan de sa volonté avait suffi : une onde caressante souleva le lit comme une nacelle, et il glissa, avec un bercement léger, qui ajouta encore de plus subtils charmes à cette lassitude heureuse. Par les jardins prodigieux, où les fleurs semblaient des étoiles et les feuillages des émeraudes, il allait et, sans effort, jouissait du plus menu détail : des fibrilles rayant la transparence des feuilles, des dentelures délicates, du velouté des pétales où les nuances se mouraient en tendres pâleurs, et, même, il distinguait, hors des calices, comme une haleine, les parfums s’exhalant en d’immatérielles fleurs, qui frôlaient leurs aromes, et il croyait voir des baisers d’âmes.
Puis parut un portique, haut, grandiose, d’une majesté saisissante, et la beauté de la courbe de porphyre, où s’enchâssaient des turquoises, lui causa une émotion extrême. Il comprenait l’amicale tendresse qui unissait les gemmes et les marbres, le bonheur avec lequel le doux azur s’appuyait aux blancheurs opalines, en recevait et lui donnait des charmes. Tout l’édifice, qui sculptait l’air en une forme précise, limitant l’espace, lui sembla plus grand que l’illimité. La lumière et l’ombre étaient là soumises, se posant, selon l’ordre, aux rondeurs des colonnes, aux nervures des arceaux fleuronnés, allumant les ors et les émaux, tissant des voiles de mystère au lointain des perspectives.
Incrustées dans l’or, des végétations de pierreries fleurissaient l’albâtre des parois : des pierreries belles comme des yeux. Et, avec elles ; il échangea des regards.
Mais, dans sa béatitude, quelque chose l’oppressait : était-il donc seul de sa race ? N’y avait-il que lui au monde ?… Dans des ajourements de l’architecture, de grands aigles, posés comme des statues, vivaient. D’un mouvement de leurs prunelles, couleur de soleil, ils lui montrèrent, au loin, quelque chose de brillant. Et il vit, debout sur une sphère de cristal, vêtue de brouillard et inondée de rayons de lune, une femme qui dansait. Des flèches de lumière jaillissaient à chacun de ses gestes ; elle s’avançait, en faisant rouler le globe clair sous ses pieds nus, avec une harmonieuse vibration qui rythmait la danse. Hugues était criblé de lueurs, dont chacune le brûlait comme une caresse, et les changeantes attitudes de ce corps délicieux ondoyaient jusqu’à lui, l’enlaçant de chaînes invisibles ; mais il les rompait d’un sourire.
Elle vint tout près, dans une musique grandissante, tellement lumineuse qu’elle aveuglait ; puis elle recula, ; servant de guide, jusqu’à une salle magnifique, doucement éclairée par des vitraux faits de pierres précieuses. Le centre était creusé en piscine, autour d’un jet d’eau qui jaillissait jusqu’à la coupole et retombait en poussière irisée. Sur des marches en lapis-lazuli, dont le bleu foncé faisait ressortir la neige ou l’ambre de leurs corps, des baigneuses nues, belle chacune d’une beauté spéciale, étaient groupées, dans des poses d’une grâce savante. Toutes avaient des yeux de lumière et des sourires de fleurs.
Le jeune enivré se penchait, étreint par un désir poignant, et, pour lui plaire, elles se roulaient dans l’eau limpide, glissaient avec de gracieuses torsions, arquaient leur torse souple, et l’on voyait leur cœur gonflé d’amour, battre sous les veines bleues de leurs seins. Elles tendaient les bras vers lui et, comme pâmées, les yeux clos, se renversaient dans l’éparpillement de leur chevelure.
Mais lui, dans une angoisse, cherchait, plein d’impatience, au delà d’elles, il ne savait quoi. Pourtant, il en était certain, elles lui voilaient l’absolu bonheur.
Devant son dédain, elles pleurèrent, tordirent leurs beaux bras et leurs doigts frêles ; puis, fâchées, l’éclaboussèrent de gouttes d’eau et de larmes. Il eut alors les mains pleines de diamants. Elles plongèrent et disparurent sous l’onde devenue opaline, et lui, déjà, les oubliait à regarder le diamant impénétrable se livrant avec amour à l’intangible lumière.
Il releva les yeux devant une haute porte, belle et sévère, où, sur les battants fermés, une inscription flamboyait :
« LE SAVANT, DANS, SES ŒUVRES, VIT LONGTEMPS APRÈS SA MORT.
« L’IGNORANT EST MORT, MÊME PENDANT QU’IL MARCHE SUR TERRE. »
La porte s’ouvrit, et la musique d’harmonieuses pensées embauma l’air. Il n’y avait, là que des livres, antiques ou récents ; des écrits, tracés en vermillon, en or, en azur, sur le vélin ou la soie, les uns en rouleaux, les autres en feuillets, enfermés dans des étuis d’ivoire, de laque et d’argent ciselé, dans des boîtes de bois de santal, d’or pavé de pierres fines, ou bien faites de deux larges turquoises ramagées d’écriture. Sur des divans et sur le sol, couvert de tapis brodés de perles, des vieillards lisaient des rouleaux dépliés. Ils étaient absorbés et haletants, les sourcils froncés par l’effort, sur leurs yeux rougis de fatigue.
Hugues considéra ces nobles hommes, dont la longue vie ne suffisait pas à absorber toute la science et il eut un sourire compatissant. Pour lui, sans lassitude, d’un coup d’œil il lisait tout un rayon. Il n’était pas besoin de dérouler les manuscrits, et pas une ligne ne lui échappait. Il lut ainsi l’histoire du monde, les légendes, les théologies, les guerres des peuples, la gloire des rois et leurs crimes ; il s’initia aux secrets de l’astronomie, de l’astrologie, à la médecine, à l’alchimie. Il n’omit rien, ni les traités d’agriculture et de jurisprudence, ni la morale des philosophes, ni les divans des poètes. Et le jour n’avait pas sensiblement décru pendant le temps qui lui avait suffi pour boire tout le savoir humain.
Un immense orgueil l’emplissait à l’idée de sa supériorité et de l’étrange puissance de son esprit, qui lui permettait de vivre plusieurs existences dans le battement de quelques heures. Et il eût voulu plus d’air devant l’essor de son rêve pour qu’il pût s’envoler, plus libre, dans un espace illimité.
À l’ordre de son désir, une arche énorme découpa l’azur du ciel, l’azur de la mer.
L’écume des lames neigea sur la neige du vaste escalier qui descendait jusqu’à elles ; il entendit leur caresse soyeuse, respira la senteur fraîche de la brise du large. Et l’impatience du voyage le saisit lorsqu’il vit une galère à l’ancre, belle et fringante ainsi qu’un cheval de race, s’agitant et tirant sur la chaîne comme pour la rompre. Ses mâts s’élançaient, droits et minces, dans la dentelle des cordages ; sa proue gonflée était revêtue d’or repoussé et toute fleurie d’escarboucles ; sur ses flancs retombaient des tapis brodés dont les franges jouaient avec l’eau, et des flots de banderoles, gaiement, tout autour d’elle, claquaient dans le vent. Des adolescents, d’une beauté extrême, formaient l’équipage, vêtus de tuniques courtes, les bras nus, de légères toques rouges sur leurs cheveux bouclés ; ils couraient çà et là, bondissaient, grimpaient dans la mâture, larguaient les voiles, tandis que, sous un tendelet, l’Émir Al Bâhrr, Seigneur de la Mer, drapé dans la blancheur de son burnous, surveillait l’appareillage.
Hugues était déjà sur le pont, et aussitôt l’ancre fut levée, car c’était lui qu’on semblait attendre. Les voiles se bombèrent, le gouvernail doré cria, et, saluant la route, le navire bondit sur les lames.
La terre disparut bientôt. Il vola sur la mer, prit une course de vertige. Et pourtant le voyageur trouvait celle allure trop lente, tant il avait hâte d’aborder aux lointains rivages ; car, il le savait maintenant, il partait, à la conquête d’un mystérieux trésor, à la recherche de ce bonheur inconnu, dont le désir le dévorait, mais qu’il ne pouvait préciser.
Il visita d’innombrables royaumes, et, partout, on l’accueillait comme le suzerain du monde.
Les princes venaient lui rendre hommage, et tous, s’efforçant de le retenir, lui offraient en mariage la plus belle de leurs filles.
On lui amenait les princesses, tantôt en palanquins ornés de plumes, tantôt dans des chars traînés par des bœufs blancs, tantôt sur des dromadaires ou sur des éléphants caparaçonnés de brocart. Éperdu d’espoir, il regardait ardemment chaque fiancée nouvelle, mais, déçu, toujours, il la repoussait et reprenait la mer.
À bout d’espérance, il médita. Il comprit enfin que son cœur était, captif dans une prison de rubis dont la clef était perdue, que cette clef était un nom.
Alors, la brise lui révéla qu’elle seule pouvait le conduire au port inconnu qu’il cherchait. Et le navire livra toutes ses voiles au caprice du vent, qui le poussa vers une île merveilleusement touffue et fleurie ; de laquelle un oiseau était roi.
Tous les arbres de cette île charmante avaient leurs branches en argent et leurs feuillages en or de différentes nuances, si légers que le moindre souffle les agitait ; les oiseaux qui voletaient étaient des pierreries vivantes.
L’énamouré courut d’un arbre à l’autre, cherchant le roi ailé qui avait trouvé le nom perdu. Les yeux suppliants, l’oreille attentive, il attendait ; mais les gais chanteurs chantaient leur chant d’oiseau et ne disaient aucun nom.
Il s’avança encore, s’enfonçant dans la forêt mélodieuse, ému, haletant. Quand, las de la course, il avait soif, les fruits se penchaient vers sa bouche, et c’étaient des coupes, creusées dans une pierre, précieuse, pleines d’exquises liqueurs, qu’il savourait délicieusement. Une fois, pourtant, exténué, il entr’ouvrit ses lèvres pour boire encore, et, au lieu du fruit au frais breuvage, une divine jeune fille tendit ses lèvres a son baiser. Elles souriaient à demi, veloutées comme les pétales des roses, tout emperlées et plus embaumées que la fleur. Elles le grisaient, le fascinaient, et, peu à peu, il se rapprochait, plein de frissons, avide de la brûlure et du rafraîchissement qu’elles promettaient. Cependant, avec un cri, dans un effort douloureux, il se déroba, fit à sa bouche un bouclier de sa main.
Alors, dans les branches de l’arbre d’or, l’oiseau roi, à pleine voix, chanta ; il redit enfin le nom oublié : « Gazileh ! Gazileh ! » Et, après lui, toute la forêt le proclama.
Le cœur du jeune homme se dilata à se rompre, sous le sanglot heureux de son amour délivré, et, quand, à son tour, il prononça le nom bien-aimé, tout son être fut traversé par la fulguration d’une volupté tellement surhumaine qu’elle le terrassa, le jeta brusquement dans l’anéantissement de la mort.
XV
Raschid ed-Din, un poignard à la main, était debout près du lit sur lequel Hugues de Césarée gisait, inerte. Appuyé du genou au rebord de la couche, ses bras croisés comprimant sa haine, les prunelles fixes, le prophète contemplait le chevalier.
— Le voici donc, songeait-il, celui qui triomphe de moi ! Le premier homme qui m’ait vaincu ! Quelle puérile curiosité me pousse à l’examiner ainsi ? Est-ce pour surprendre sur ses traits le secret de sa victoire ? Peut-être !… Eh bien, je ne vois rien de plus, sur ce visage, qu’une téméraire ardeur de jeunesse, dans ces membres souples, que la grâce et la force ; mais sur le front blanc et lisse, je ne distingue aucun de ces signes qui dénoncent le génie, aucun de ces sillons souverains de la pensée, rien de cette empreinte lumineuse, dont Dieu marque les dominateurs du monde. Non ; mais j’y puis lire l’expression d’un dévouement passionné, une candeur d’enfant, un oubli de soi-même qui conquiert à cet homme l’amour, tandis qu’à moi on ne me rend que des hommages.
Ah ! j’ai voulu être plus qu’un mortel ! Par la force de ma pensée, je me suis élevé au-dessus de mes semblables ; je les ai dominés par la science ; par la solitude, j’ai empli le monde de ma renommée ; par la continence, j’ai tout possédé. Rien ne m’atteignait plus des misères d’ici-bas… Et voilà, ainsi qu’un fils rebelle, mon cœur, si bien dompté, qui, brusquement, rompt le joug pour battre et souffrir comme un cœur vulgaire ! Aussi déchu de ma grandeur, je suis l’égal du premier homme venu, moins que lui, même, puisqu’on me le préfère.
Est-ce bien possible ? J’envie ce soldat ! Je suis jaloux de lui !… Moi, jaloux !… Se peut-il que je le haïsse au point de vouloir l’égorger de mes mains ?… Oui ! oui ! cela est. Je ne commande plus au désordre de mes pensées : j’y assiste comme le médecin impuissant qui analyse sa propre agonie. On ne résiste point à un fléau. Il faut le laisser épuiser toute sa rage, avant d’expirer ou de guérir. Guérir ?… Le mal a-t-il même distillé pour moi tout son venin ? Non ; je le sais bien, ce n’est rien encore. Je voudrais, en tuant cet homme quelques heures plus tôt, échapper à l’épreuve. Je ne le dois pas : il me reste à voir ces amants l’un près de l’autre, à épier leurs aveux et leurs transports… Alors peut-être, l’excès de la fureur et de la honte, comme le choc du noyé, qui touche le fond de l’eau, le fait remonter, me rejettera hors de cette folie.
Allons !… Il le faut… Je le veux. Bientôt, il va s’éveiller de son ivresse, plein de langueur encore. Qu’elle vienne donc ! Qu’elle me fasse subir cette heure d’enfer, heure de paradis pour eux, la seule ! car ni lui ni elle ne verront la fin de ce jour.
Lentement, il remit le poignard dans la gaine passée à sa ceinture et, après un dernier regard farouche jeté sur son ennemi, il s’éloigna.
Hugues revenait à la vie peu à peu, et ses regards, troubles encore, erraient paresseusement autour de lui, sur les arbres et les fleurs, sur la fontaine de porphyre d’où jaillissaient des gerbes d’eau de rose, et ils s’arrêtaient, comme éblouis, sur la haute baie d’une porto en plein cintre, fermée par un rideau de gaze qui, du haut en bas, frémissait d’un étincellement de pierreries.
Au même moment, Gazileh était conduite avec Nahâr, dans cette partie des jardins qu’elle ne connaissait pas, et, lorsqu’elles eurent atteint la fontaine d’eau de rose, on les laissa libres.
La jeune princesse, irritée et fiévreuse, s’assit sur la margelle polie, laissant la fine poussière des gerbes rafraîchir ses joues brûlantes.
— Pourquoi nous a-t-on poussées de ce côté ? dit-elle. Est-ce ici que je dois mourir ? À quoi bon me faire languir ainsi ? Le tigre au moins déchire sa proie dès qu’il l’a saisie, et dédaigne ce jeu cruel du chat avec la souris.
— Ah ! ne brave pas ainsi le maître, par des paroles outrageantes, s’écria Nahâr : il les entend toutes. Tâche de le fléchir plutôt.
— À la condition de l’aimer, peut-être ? Non : mourir me plaît mieux.
— Quand d’un mot tu pourrais être plus qu’une reine !
— Tu te trompes, Nahâr : il n’est plus temps. Même si je le disais, ce mot, le prophète ne ferait pas grâce. La jalousie l’enflamme, aujourd’hui, et change son amour en haine. Et comment pourrait-il pardonner, en effet, lui, un dieu, de s’être vu préférer un mortel ?
— Eh bien, où est-il ce mortel ? Qu’a-t-il tenté pour te délivrer ?
— Plût à Dieu qu’il n’ait pas vu ce signal, ni risqué quelque sanglante folie…
— Gazileh !…
Hugues, déjà, était à ses pieds.
Tous deux, sans souffle, sans voix, ils s’étreignirent éperdument, se buvant du regard.
Nahâr, toute tremblante, les contemplait.
— Lui ! c’est lui ! murmurait-elle. Tout est bien perdu maintenant ! Ah ! quelle folie ai-je faite en l’appelant !
Gazileh, chancelante, serait tombée si Hugues ne l’eût retenue dans ses bras. Doucement, elle essayait de se reprendre, de se dégager.
— Comme c’est étrange, dit-elle, j’étais forte contre l’adversité, et la joie me fait presque défaillir… Vous pleurez ? mon chevalier !
— Ah ! ce sont mes premières larmes, dit-il ; la violence du bonheur me les arrache !
— Vous revoir, je ne le croyais pas !
— Est-ce bien possible ? Tandis que, si ardemment, je vous appelais, vous désiriez ma présence ?
Mais Gazileh, épouvantée, s’arracha de ses bras.
— Ai-je dit cela ? s’écria-t-elle, ai-je désiré votre mort ?
— Ma mort !… Oh ! qu’avez-vous ? Vous ai-je fâchée ?
— Pouvez-vous fuir d’ici ?… Comment y êtes-vous venu ?
— Une nuit opaque s’étend sur mes souvenirs, dit-il ; je sais seulement que vous êtes toute ma vie et qu’elle a atteint son but, puisque je suis près de vous. Comment je suis, venu, quel est ce lieu, je l’ignore. Qu’importe ?… Quant à fuir, si cela m’éloigne de vous, c’est une dérision de le proposer.
Gazileh, au désespoir, se tordait les bras.
— Hélas ! pourquoi vous ai-je secouru, quand votre voix mourante m’appela ! Pourquoi, n’ai-je pas laissé tout voire sang fleurir le sol, comme un parterre de roses, au lieu d’arrêter le fugitif, de refermer sa prison ? Il a couru de nouveau, ce noble sang, jusqu’au cœur ardent et fier, qui s’est remis à palpiter, et que j’attire aujourd’hui sous le poignard.
— Comment ne comprenez-vous pas que mille fois mieux me plaît de mourir par vous, que de vivre sans vous avoir revue ?
Mais Nahâr s’élança entre eux.
— Ah ! laissez toutes ces paroles flatteuses, dit-elle, et songez que vous êtes venu pour la sauver. Vous êtes vraiment un héros, puisque vous avez pu entrer ici. Alors, faites quelque chose.
— Parlez ! parlez ! dit Hugues, attentif. La brume qui couvre ma mémoire est comme traversée d’éclairs.
— Du haut de la tour, son voile blanc vous annonçait sa détresse…
— Oui ! oui ! couvert de mes armes, je m’élance ; mon cheval s’abîme dans le gouffre, tandis que moi, par miracle, j’échappe à la chute. Je remonte, j’atteins le château… puis… la nuit… le sommeil… un rêve merveilleux… un enchantement digne du ciel… ou de l’enfer… des délices sans pareils… et de nouveau l’oubli, l’évanouissement.
— Ah ! le magicien vous a pris dans ses pièges. Vous êtes, comme moi, en son pouvoir, prisonnier par ma faute.
— Dans la prison où vous êtes captive, dit Hugues, n’est-ce pas là une grâce du ciel ? Quand je pouvais m’écraser au fond du gouffre et mourir sans vous avoir revue…
— J’étais courageuse et forte quand je craignais pour moi seule. Maintenant, ma crainte est doublée, et elle m’accable.
— Dites, que redoutez-vous ?
Gazileh se taisait. Ce fut Nahâr qui répondit :
— Le chevalier franc a vu Gazileh et l’a aimée. Raschid ed-Din a aimé Gazileh dès qu’il l’a vue ; et, s’il n’est pas choisi, celui qui jamais n’a été vaincu, il sacrifiera le vainqueur, avec celle qui décide la victoire.
Une brusque douleur crispa le cœur du jeune homme :
— Il vous aime, Gazileh ! dit-il. Et vous ?…
— En cela du moins, j’échappe à sa puissance ! s’écria-t-elle avec enthousiasme. Quel est le geôlier qui peut tenir captifs la pensée et le sentiment ? Il n’y a pas de cage pour ces ailes divines ; aucun lien ne les enchaîne, nulle torture ne les dompte. Eût-on même, par la souffrance, arraché à mes lèvres un aveu menteur, mon cœur resterait son maître : il garderait intact le trésor de son amour. Ah ! n’est-ce pas la plus grande gloire de l’homme, cette liberté de l’âme que rien, jamais, ne peut lui ravir ?
— Ô Gazileh ! dois-je comprendre ?
— Comprends donc, malheureux ! Le temps nous manque pour ces douces et coquettes manœuvres de la pudeur qui retardent un aveu. Sache au moins, puisque tu te perds pour lui, que mon amour est à toi et que j’aime mieux mourir pour l’avoir dit que de vivre en me taisant.
— Est-ce que c’est un rêve encore ? dit Hugues, perdu dans une extatique contemplation. Vous dont le front rayonne d’autant de majesté que celui de Dieu même, vous dont un sourire vaut plus que la vie de dix chevaliers, vous qui, pendant de si cruelles années, étiez loin de moi, autant que les archanges du ciel, et pour qui seulement je désirais mourir, c’est vous qui m’avez parlé ?…
Avec une curiosité avide, ils se regardaient, car ils se connaissaient si peu que la réalité de leur existence leur causait à tous deux la même surprise. Cette image, qu’ils portaient l’un de l’autre dans leur pensée et qui était leur trésor unique, dérobée en de si rares minutes, restait imprécise, fuyante, insaisissable au souvenir, ne se montrant qu’en de brusques éblouissements, qui enivraient l’âme, mais laissaient les yeux inassouvis. Aussi éprouvaient-ils un indicible bonheur à compléter la vision, à attarder leur contemplation à des détails évoqués souvent en vain.
Elle plongeait son regard dans les yeux du chevalier, s’étonnait de l’envahissement de la claire prunelle par la pupille, qui s’épanouissait, pareille au cœur noir d’une fleur d’azur, élargissait son ombre fluide, comme pour mieux laisser voir l’âme.
Ses yeux à elle, sous l’irradiation des cils, semblaient des soleils noirs, du velours plein de diamants, un infini d’ombres et de lueurs. Leur scintillation profonde engourdissait l’âme, absorbait la volonté et donnait l’alanguissant désir de s’endormir à jamais dans une nuit d’éternelles délices.
Elle l’avait rêvé toujours pâle sous un ruissellement de pourpre et s’émerveillait maintenant de cette carnation blonde, si doucement rosée, gardée pure malgré la rude vie du soldat ; des cheveux clairs roulant en longues boucles, de cette fleur de jeunesse veloutant le bord des lèvres, de toutes les douces nuances de cette peau d’Occidental qui, malgré la haute taille et les muscles puissants du héros, lui laissaient comme une grâce et une délicatesse de jeune fille.
Lui, au contraire, trouvait, par-dessus tout, splendide ce teint uni, qui lui semblait d’un tissu plus rare que la chair mortelle, vivifié par un sang divin, fait d’or et de lumière.
Et, incrédule à son bonheur, il murmurait, avec un frémissement de joie inquiète :
— Est-ce bien possible ? C’est vous qui me faites don d’une félicité digne des anges ?…
— Hélas ! cette félicité sera bien courte !
— Toute une existence heureuse vaudrait-elle les délices de cette minute ?
— C’est vrai, et cependant la vie terrestre semble trop brève pour épuiser les joies d’un vrai amour. Il nous faut emporter le nôtre tout entier. Qu’importe si une tyrannie cruelle nous prive des jours qui nous sont dus ? L’éternité du ciel est à nous. Au lieu de nous séparer, la mort, délivrant nos âmes, nous réunira pour toujours.
Mais le visage du chevalier, soudain, se couvrit de pâleur, et il murmura d’une voix brisée :
— Ah ! malheureux que nous sommes !… Séparés ! séparés à jamais !
— Séparés ? pourquoi ? dit-elle. Mon Dieu, d’où vient cette angoisse horrible sur votre visage ?
— Hélas ! ma bien-aimée, le ciel est fermé pour vous ! Hors l’Église chrétienne pas de salut, et vous êtes mahométane.
— Pas de salut ? dit Gazileh surprise…
— C’est la loi.
— La nôtre, alors, est moins cruelle que celle des Francs, car elle ne déclare pas Dieu injuste. Tout être vertueux, chrétien ou juif, recevra sa récompense. Le paradis ne lui sera pas fermé. Cela est écrit dans le saint Qorân.
— Ce livre impie est un livre de mensonges.
— Qu’en sais-tu, enfant ? dit la jeune fille avec douceur. Notre loi est venue après la vôtre et a fait, sans doute, un pas de plus vers la vérité.
— Oh ! quelle torture ! entendre ces lèvres chéries blasphémer !
Mais Gazileh dit gravement :
— Quel que soit le nom qu’on lui donne, Dieu est Dieu, il est unique, et tous deux nous l’adorons. Mais nos prêtres prient différemment, et, pour cela, les hommes se haïssent ; pour cela, ton âme s’éloigne de la mienne et ton amour bat en retraite ?
— Le crois-tu ?… le crois-tu vraiment ? s’écria Hugues. As-tu la pensée que le ciel puisse être autre chose pour moi qu’un exil, si tu es absente du ciel ? Ah ! comme tu me méconnais ! Sache-le donc, la damnation m’effraye moins que l’idée d’être séparé de toi. Et moi, soldat du Christ, moi qui me suis voué à la défense du saint berceau de mon Dieu, je suis prêt à renier toute ma vie, à renoncer à la récompense qui m’est due, pour me damner avec toi.
— Tu consentirais à abjurer ta foi ? dit Gazileh avec une profonde émotion.
— En le faisant, j’arracherai des morceaux de mon cœur !
Et Hugues se cacha le visage dans les mains pour étouffer un sanglot.
Mais, de ses doigts légers, elle lui découvrit les yeux, retint ses mains dans les siennes, en le regardant avec une ineffable tendresse :
— Ainsi, pour moi, tu renierais ton Dieu ? Toi qui crois si fermement que les flammes éternelles puniraient ton parjure !… Tu m’aimes au point de renoncer au ciel !… Ah ! rassure-toi, chère âme : ta résolution suffit à l’orgueil de mon amour. À nous, musulmanes, il nous est ordonné d’adopter la patrie et les croyances de notre époux. Il est le maître en toute chose. Va, sans rien redouter de l’enfer, confiante en la suprême justice, si tu le veux, je me fais chrétienne.
— Vous ! chrétienne ! Ô céleste joie !
Mais Nahâr, indignée, se jeta entre eux.
— Qu’ai-je entendu, princesse, renier l’islam !
— N’est-ce pas mon devoir, puisque je l’aime ?
— Ah ! défendez-vous donc plutôt ! tentez quelque chose pour sauver votre vie. Vous songerez ensuite à votre âme.
— Non, non, dit Hugues, ; quand nos âmes seront sûres de l’éternité, il sera temps de songer à leur enveloppe fragile Notre vie bat peut-être ses dernières pulsations sur terre ; ne perdons pas l’avenir du ciel. Tout chrétien a le pouvoir, quand la mort menace, d’effacer le péché, en donnant le saint baptême. Gazileh, voulez-vous le recevoir de moi ?
— Je le veux.
Il l’attira doucement vers la fontaine où s’égrenait l’eau odorante.
— Cette eau, dit-il, te rendra la pureté primitive, celle qui régnait dans l’Eden avant le péché des premiers hommes. Crois-tu à ce pouvoir miraculeux ?
— Je crois, dit-elle, en se laissant glisser à genoux.
Alors il prit de l’eau dans le creux de sa main et en secoua quelques gouttes sur le front de la jeune fille, en prononçant avec une ferveur ardente, les yeux au ciel, la formule sacrée :
— Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !…
Et il ajouta :
— Reçois le nom de Notre-Dame la Vierge : appelle-toi Marie !
Et, la relevant, il s’écria dans un transport de joie :
— Sauvée ! sauvée ! Ô mon épouse chrétienne.
— Comment, dit Nahâr, ironique, c’est là toute la cérémonie ? Quelques gouttes d’eau ont suffi pour effacer les croyances passées. La princesse de Hama est chrétienne !… Eh bien, défendez-la à présent.
Le chevalier poussa un cri en s’apercevant qu’il n’avait plus d’épée.
— Mon ennemi m’a enlevé mes armes, s’écria-t-il ; nous sommes à sa merci. S’il se montrait, cependant, s’il acceptait le combat avec moi, par la seule force de mon bras je pourrais le vaincre.
Il cria, se tournant vers la haute porte voilée :
— Parais donc, misérable lâche, qui ne sais triompher qu’en te cachant, tuer que par traîtrise et qui ne règnes que par la magie.,.
— De grâce, taisez-vous, dit Nahâr, suppliante. Ce sont des prières qu’il faudrait ! ces défis ne serviront qu’à hâter votre fin… Ah ! tenez ! ajouta-t-elle, en se rejetant en arrière.
Le rideau de pierreries venait de se relever, et, au sommet d’un escalier, couvert de tapis brodés d’or, dans l’éblouissement d’une lumière bleuâtre et surnaturelle, le Vieux de la Montagne apparut sur son lit royal. À chaque marche, alternant avec un lion enchaîné, était debout un frère de l’ordre, appuyé sur un glaive nu, coiffé d’un léger casque damasquiné d’or, dont les franges de mailles tombant jusqu’aux épaules, lui cachaient presque le visage, vêtu d’une tunique blanche nouée d’une ceinture pourpre, symbolisaient l’innocence et le sang. Tous ces hommes semblaient ne vivre que par le maître et pour lui. Leurs yeux, tournés vers les siens, avaient des clartés d’opale dans leurs faces brunes ; ardemment soumis, ils guettaient le moindre signe, prêts, si c’était le bon plaisir de leur dieu, à se plonger dans le cœur le poignard passé à leur ceinture, à se précipiter du haut des remparts, dans l’abîme, ou à égorger la victime désignée, pour la plus grande gloire du prophète et la conquête du ciel.
Debout auprès du trône, attristé et sévère, Dabboûs, le chambellan au noir visage, semblait, sous sa barbe et ses cheveux blancs, une statue de basalte éclaboussée de neige.
La voix de Raschid, ironique et froide, rompit le religieux silence :
— Tu t’appelles Hugues de Césarée, dit-il. De qui es-tu l’ambassadeur ? Est-ce au nom du roi de Jérusalem que tu cries de telles invectives contre moi, dans mon propre palais ? Est-ce par son ordre que tu as rompu la trêve ? Veut-il donc la guerre ?
— La guerre ! la guerre ! s’écria Hugues, mais entre toi et moi. Laisse le roi en paix, car il n’a que faire ici !
— Pauvre roi !… Vraiment, j’ai grande compassion de lui. Combien il est peu de chose dans son royaume ! Personne ne lui obéit ; on bafoue ceux qui portent ses ordres, et ses soldats sont dangereux, surtout pour lui…
Le prophète s’était levé ; il descendit lentement les marches du trône, tandis que les lions tendaient leur large mufle et dardaient sur lui leurs yeux d’ambre. Il s’avança vers le chevalier :
— Eh bien, quelle guerre veux-tu ?
D’un bond si subit qu’il ne put l’éviter, Hugues arracha le sabre de l’un des frères :
— Le combat corps à corps avec toi ! cria-t-il.
Mais Raschid, apaisant d’un geste l’émotion des siens, dit, toujours ironique :
— Quoi ! n’es-tu pas satisfait de mon hospitalité ? Ne t’ai-je pas donné un avant-goût du paradis, dans le mirage d’un rêve enchanté ? Et cette enivrante entrevue avec la dame de tes pensées, qui donc te l’a ménagée ? Tu ne saurais même pas me reprocher d’être venu l’interrompre avant ton gracieux appel.
— Ah ! cesse de railler ! prends une arme et combattons, dit Hugues tout frémissant d’impatience.
— Viens donc, si tu crois n’en avoir pas fait assez pour que toi, et toute la vermine chrétienne, ne disparaissiez du monde au souffle de ma colère.
Le prince, les bras croisés, le couvrait de son grand regard immobile. Et le jeune homme qui, pour la première fois, voyait celui qu’un tel prestige d’épouvante environnait, sentit tourbillonner dans son esprit toutes sortes de pensées, qui l’étourdirent un moment. Il se souvenait du magicien arrêtant par son seul pouvoir les cavaliers de Saladin et il s’attendait, sous ce regard, à ce que son bras se desséchât. Cependant le preux n’éprouvait aucune terreur et ne voulait pas attaquer un ennemi sans armes.
— Eh bien ! qu’attends-tu ? dit Raschid en s’avançant encore.
Une clarté subite dissipa le trouble qui embrumait l’esprit du chevalier, Soudain, il recula et jeta le sabre.
— Ah ! je comprends ! s’écria-t-il ; tu veux me déshonorer, vouer ma mémoire à l’exécration, en massacrant mes frères à cause de moi. Eh bien, non ! Je suis a ta merci : fais de moi ce que tu voudras, c’est juste : Torture-moi, fais-moi subir mille morts en un jour, invente par ta magie des supplices atroces, mais rassasie sur moi seul ta vengeance, et je te remercierai.
Raschid évitait de lever son regard sur Gazileh ; malgré lui, pourtant, il la vit, fière et digne, si douloureusement belle de l’angoisse qui la torturait, qu’il ferma les yeux pour échapper au despotique charmé de sa présence. Mais, la seconde d’après, sa rage s’augmenta encore sous la honte de cette faiblesse. Et il répondit à Hugues, d’une voix basse et tremblante, qui ne se contenait plus :
— Des supplices ?… Lesquels ?… En connais-tu, dis, capables de m’apaiser ? Toi qui es aimé, peux-tu même imaginer ce que j’éprouve, moi qui aime en vain ? Songe que j’ai voulu la voir dans tes bras, l’entendre te donner son âme : je croyais que cette vision-là arracherait de moi la folie ; je croyais pouvoir faire grâce peut-être, étant redevenu moi-même. Mais non ; la douleur l’emporte ; le mal est plus aigu, l’outrage plus cuisant… Un outrage ! à moi ! Ah ! pour l’effacer, je veux noyer le monde sous un déluge de sang,
Hugues, levant sur lui le loyal regard de ses beaux yeux clairs, où toute colère s’éteignait, dit, avec une émotion vraie :
— Ô malheureux ! je comprends ce que tu souffres et j’ai compassion de toi ; je mesure ta douleur à l’immensité de ma joie ! Avant de mourir par toi, je te pardonne.
— Tu me pardonnes ! Vraiment ? dit Raschid. Eh bien, moi, je le condamne, non pas à mourir : c’est trop doux et trop prompt, la mort. Je te condamne à vivre. Vous croyez m’échapper, n’est-ce pas ? Elle a renié sa foi ; vos âmes sont d’accord, toutes prêtés à s’envoler ensemble dans l’éternelle félicité ! Non, non : elle seule va mourir, et toi, vivant, tu la pleureras. D’après tes croyances, le suicide te séparerait d’elle, en te damnant : tu vivras donc, et la jeunesse me répond de la longueur du supplice,
— Oh ! grâce ! s’écria Hugues en se laissant tomber à genoux. Faites-moi mourir avec elle !
Gazileh, vivement, s’élança vers lui, le releva.
— Courage, mon bien-aimé, dit-elle ; ne t’abaisse pas à de vaines prières, ne ploie pas le genou devant le bourreau. L’éternité est à nous. Dieu nous attend et t’abrégera la peine.
— Gazileh ! emporte mon âme sur tes lèvres ! cria-t-il avec un sanglot.
Elle se jeta dans ses bras, lui tendit sa bouche, la haussant jusqu’à son baiser.
Pour la première fois le pâle visage du prophète s’empourpra sous l’excès de la fureur :
— Séparez-les ! cria-t-il d’une voix qui épouvanta les lions, jetez ce misérable hors du château ; et elle, emmenez-la, qu’elle meure !
Dabboûs, le visage inondé de larmes, s’approcha de Raschid.
— Raschid ed-Din, dit-il, tu as tué le Dieu que tu étais ; tu es aujourd’hui moins qu’un homme !
— Assez !… quand l’éclair a lui, qui donc veut arrêter la foudre ?
Pendant qu’on l’emportait, Gazileh jeta du bout des doigts un dernier adieu au chevalier qu’on entraînait, tandis que les lions, tirant sur leurs chaînes, poussaient des rugissements terribles.
XVI
Souvent, le prince des sept Montagnes chevauchait par les monts et les vallées, allant de l’un à l’autre des sept châteaux forts qui protégeaient ses domaines : Qadamoùs, Kahf, Rosâfah, Khawabi, Maïnaqah, Ollaïqah. Il voulait tout voir par ses yeux, tout diriger, ne rien négliger jamais des intérêts et de la gloire de la secte dont il était le chef.
Pour la première fois, cependant, aux clartés pâles du jour qui se levait, dans les âpres sentiers, taillés par son ordre, le maître errait au hasard, sans autre but, peut-être, que de se fuir lui-même.
Le visage caché sous un voile de gaze d’or, enveloppé dans un manteau blanc, qui se confondait avec la robe de son cheval couleur de lait, il montait, montait de pic en pic ; éperonnait l’ardente bête que d’ordinaire un mot, dit tout bas, suffisait à diriger. Elle hennissait d’inquiétude devant la folie du cavalier, dilatait ses naseaux bleuâtres, éparpillait au vent de la course les fils soyeux de sa crinière, tandis que des étincelles jaillissaient du roc sous ses fins sabots.
De loin, dans les village accrochés aux flancs des monts, ceux qui apercevaient le prophète, gravissant ainsi les hauteurs inaccessibles, se prosternaient et lui adressaient leur prière matinale. Ils disaient en se relevant : « Un dieu seul peut ainsi courir dans des sentiers où aucun cavalier ne saurait avancer, même au pas. »
Déjà la neige des suprêmes sommets volait sous les pieds du cheval, toujours excité par l’éperon ; mais, brusquement, l’animal s’arrêta, frémissant sur ses jambes raidies, qui semblèrent s’incruster dans le sol glacé. L’abîme était à deux pas. De ce côté, le haut pic s’achevait en une cassure brusque.
Raschid resta là, immobile. Le vent avait rejeté le voile d’or et heurtait le front pâle de l’homme, sans en rafraîchir la brûlure fiévreuse. De grands aigles noirs, que la houle de l’air balançait au-dessus du gouffre, se haussèrent à bruyants coups d’aile, pour regarder celui qui violait l’altière solitude.
Le merveilleux spectacle que ses yeux fixes reflétaient, Raschid ne le voyait pas. Mais elle le hantait, tyranniquement, la scène pendant laquelle lui, l’impassible, avait hurlé de colère ; où lui, le justicier, avait été injuste ! Une immense douleur l’anéantissait. Il sentait en lui un écroulement, des ruines, sa divinité brisée.
— C’était une épreuve, se disait-il, et je n’ai pas pu la subir ; honteusement, j’ai été vaincu par elle. L’amour est venu, l’amour qui rend l’homme pareil à la bête, et, malgré le masque sublime dont il se parait, il a fait, du mage que j’étais, un tigre en fureur. Oui, je comprends maintenant, je vois. C’était la suprême épreuve et elle était digne de mon orgueil. Un miracle : la femme aussi belle d’âme que de corps, pouvant donner l’ivresse divine des sens et de l’esprit. L’incendie de la passion me brûlant tout entier ; mais elle, froide et sans amour, gardant toutes les merveilles de son être pour un homme au-dessous de moi. Oh ! oui, là était l’épreuve, l’effort vraiment mesuré à ma grandeur. Et moi, le vainqueur des faiblesses humaines, pour la première fois j’ai été vaincu, je me suis montré indigne, lâche, cruel. Eh bien ! je suis venu ici pour me juger, tout près du ciel, dans la pureté de la neige.
Raschid mit pied à terre. Dès qu’il fut libre, le cheval bondit loin du précipice, puis il s’enfuit par des sentiers familiers.
Alors le prophète s’agenouilla à l’extrême bord du gouffre et prit sur sa poitrine une écharpe rougie de sang.
Un instant, il ferma les yeux, comme défaillant à la vue de cette pourpre, fraîche encore, brodant d’étranges fleurs la soie lamée d’or qui avait entouré la taille de Gazileh.
— Le sang innocent crie vers moi, dit-il ; il m’accuse et me condamne. Mes Fidèles, pourtant, ont ouvert en mon nom plus d’une source rouge, il en a coulé des ruisseaux qui, réunis, pourraient me submerger. Et jamais pourtant, aucune ombre n’a fait vaciller l’éclatante clarté de mon âme. D’où vient qu’elle est aujourd’hui à ce point obscurcie,… éteinte peut-être ? C’est que, jusqu’alors, j’étais un juge équitable, que je punissais des coupables, dont les offenses avaient comblé la mesure de ma clémence et que la mort leur était due. Tandis que, cette fois !… Ai-je cru vraiment avoir le droit de détruire l’obstacle trop séduisant qui barrait ma route ? Ai-je mis en balance l’avenir de mon peuple ; compromis par ma folie, et la grandeur de ma mission, avec l’humble vie d’une femme ?… Je dois à la vérité de me répondre : « Non ! » Je cherchais à me tromper moi-même. L’idée de sa mort s’est allumée en mon esprit au seul feu de la jalousie. Avant cela, je savais qu’elle ne m’aimait pas, je souffrais avec une sorte de volupté, sans rancune et sans colère. L’homme, le rival surgissant, la démence est entrée en moi ; j’ai donc cédé au sentiment le plus bas, le plus bestial, le plus injuste, et aussi le plus terrible, car mon cœur était comme entre les griffes d’une bête fauve, et rien n’aurait pu m’apaiser. Un instant, cependant, le clair regard de l’amant, levé sur moi dans un élan de pitié, a failli me rendre la raison ; mais l’humiliation de le sentir plus noble que moi a aussitôt éteint cette lumière. Alors le baiser d’adieu, qui, sous mes yeux, a scellé leurs lèvres, m’a aveuglé de fureur… Ce baiser dont le souvenir me fait grincer des dents encore. Ô ! malheureux que je suis !…
Oui, je le confesse, devant le jour qui se se lève : J’ai condamné Gazileh injustement, j’ai fait une morte de ce chef-d’œuvre du Créateur parce qu’il se refusait à moi et pour qu’il ne fût à personne. Moi qui ai, pendant tant d’années, travaillé au perfectionnement de mon âme et de mon intelligence, qui savais tout de la terre et devinais le ciel, un piège vulgaire m’a fait trébucher. Donc, je me juge et je me condamne. Je suis déchu de ma grandeur et indigne de commander.
Il s’était levé, les yeux sur le soleil, qui surgissait, comme un faisceau de glaives, entre les pics dont il ensanglantait la neige. Debout, si près du vide que des fragments du sol croulaient sous son pied, sa robe blanche rougie par le reflet, il courbait la tête, contemplant l’immensité béante, avec l’idée de se faire dévorer par elle, de lui jeter son corps périssable, pour qu’en se brisant il laissât s’échapper l’âme immortelle vers les hauteurs reconquises. L’angoisse du vertige, ou l’épouvante d’une douleur surhumaine noya soudain les prunelles fixes du prophète et arracha à sa poitrine un effrayant sanglot !… Une goutte brûlante tomba qui fit un trou dans la neige… et Raschid, chancelant, s’abandonna à la chute…
Un bras vigoureux le saisit alors, l’arracha au gouffre. C’était l’homme au dévouement infatigable, l’ami impeccable et sûr, l’austère conseiller Dabboûs. Il avait rejoint le maître, depuis longtemps l’observait, veillait sur lui.
— Relève le front, prophète, dit-il d’une voix grave. Ta douleur et ton repentir sont aussi grands que tes crimes ; mais cette larme, où s’est fondu tout ton orgueil, tombe dans la balance et la fait pencher du côté du pardon.
— Non, ami, je ne mérite pas le pardon, dit Raschid d’une voix défaillante ; laisse-moi mourir, car ce que je pleure, ce n’est pas, comme tu le crois, ma gloire obscurcie. Mon désespoir est autre, hélas ! Je pleure la morte adorée, celle que j’ai tuée par amour et que, vivante à jamais dans mon cœur, j’aime d’un immortel amour !
Et, aux pieds du grand vieillard, le Prince des Montagnes, mortellement pâle, roula, évanoui, sur la neige.
XVII
Le sénéchal Milon de Plancy, debout devant le roi Amaury, lui présentait un Templier, le frère Gauthier du Mesnil. Mais l’accueil du roi était glacial, et il n’avait aucune parole courtoise pour le nouveau venu.
Milon, la face enluminée par l’abus du vin, manifesta sa surprise en soulevant ses sourcils et dit d’un ton goguenard :
— À ce qu’il paraît, le roi est irrité contre nous.
— C’est plus que de l’irritation, cousin, s’écria Amaury : c’est de la colère, et malheureusement une colère trop juste. Tu as trahi ma confiance en mettant si peu de hâte à m’apporter une nouvelle que je sais depuis longtemps, et que je tiens pour fausse.
— Le messager ne peut que rapporter le message. N’ai-je pas fait au mieux cependant en vous amenant ce noble chevalier du Temple, afin qu’il vous redise lui-même la réponse du grand-maître ?
Le Templier, un homme robuste, trapu, à l’air brutal, fort laid et privé d’un œil, qu’une pointe de lance lui avait emporté, salua le roi.
— Sire, la vérité, la voici, dit-il : le meurtrier de Boabdil, l’ambassadeur du Vieux de la Montagne, est parti pour Rome, afin de demander au pape l’absolution.
— C’est faux ! Aucun Templier n’a quitté la Terre sainte, dit le roi. Et, cela fût-il vrai, cette expiation ne nous suffit pas. Dès demain, vous retournerez vers Odon de Saint-Amand et vous lui direz que voici mon dernier mot : Si la satisfaction que je demande m’est refusée, si on ne me livre pas immédiatement le coupable, je marche sur la commanderie du Temple et je la détruis de fond en comble.
Gauthier du Mesnil dissimula à peine un sourire moqueur devant cette menace, que le roi, peut-être, n’aurait pas eu la puissance de réaliser ; mais, comme il était congédié, il s’éloigna, en chuchotant avec Milon de Plancy d’un air de mystère.
Une lourde inquiétude, d’ailleurs, pesait sur le camp royal. On pressentait que le Vieux de la Montagne se lassait d’attendre en vain. Le château, depuis quelques jours, était muet ; aucun messager courtois n’en venait plus. Beaucoup d’écuyers, des chevaliers même, disparaissaient, enlevés par le magicien, à ce qu’on disait. Les châtelaines et les seigneurs venus du voisinage étaient repartis. Un vague ennui tenait tous ces hommes, captifs sur parole ; ils avaient épuisé les jeux, les festins, les excès de toutes sortes, et ils étaient las, désœuvrés, impatients de l’inaction.
Vers le prince de Hama, toujours l’hôte du roi, une jeune fille en deuil était venue, et, depuis, le vieillard, enfermé sous sa tente, restait invisible. Raymond de Tripoli racontait que le comte de Césarée, échappé par miracle au château magique, dans lequel il s’était si follement jeté, en avait rapporté un désespoir incompréhensible et était résolu à se faire prêtre. Son frère d’armes, Homphroy, ne le quittait pas et pleurait avec lui.
En dépit de tout cela, le soleil ayant brillé après quelques jours de pluie, la cour s’était assemblée dans une clairière de l’oliveraie toute rafraîchie, pour essayer de se distraire. Les dames disposaient en bouquets des anémones et des roses, cueillies par des pages et amoncelées en tas devant elles, tandis qu’un jongleur, frottant l’archet sur les cordes du rebec, chantait la chanson de Jérusalem : l’arrivée des preux devant la ville sainte et l’émotion qui, à sa vue, les transporta :
Là eussiez vu de pleurs si grande floraison
Que chacun s’en mouillait la face et le menton…
Mais chacun la savait, cette chanson, et on ne l’écoutait que d’une oreille distraite.
Un oiselier arabe, portant une cage suspendue à un roseau, passa en criant :
— Voici des oiseaux à libérer !
La belle Eschive l’appela, et il vint s’agenouiller près d’elle.
— Voyons, montre-nous cela.
— Ils n’ont rien de bien remarquable, dit Tiennette, en se penchant. Jolis comme tous les oiseaux, mais pas dignes de la volière.
— Ils ne sont pas destinés à être gardés.
— C’est bien petit pour être mangé, fit remarquer la princesse Sybille.
L’oiselier se releva, prêt a s’éloigner.
— Oh ! madame, dit-il, je ne vends que le droit de leur ouvrir la cage pour leur rendre la liberté.
— Alors, s’écria Tiennette, la marchandise s’envole, et l’acheteur est volé ?
— Volé ! N’est-on pas cent fois payé par le cri de joie de ces prisonniers qui s’évadent ? Voyez comme ils sont désespérés, comme ils se débattent en se meurtrissant la tête contre les barreaux. Ils souffrent ; mais leur peine est momentanée, et la rançon que j’exige m’aide à faire vivre ma famille. Ah ! n’est-il pas bien heureux, celui qui, doublement charitable, fait l’aumône à l’un de ses frères et rend le ciel aux oiseaux ?
— Quelle jolie invention ! dit Eschive. Ils ont bon cœur, ces infidèles.
Elle prit la cage en glissant vers le roi, pensif et sombre, un tendre regard.
— Je souhaite, dit-elle, qu’ils emportent, en fuyant, les tristes pensées qui volent sur le front du roi.
— Un regard de vous suffit à les dissiper aussi bien que le soleil sèche la pluie, répondit Amaury courtoisement.
Elle le remercia d’un beau sourire et reprit :
— Dites toutes, mesdames, ce que vous voulez qu’ils prennent sur leurs ailes.
— Pour moi, s’écria Tiennette, qu’ils emportent l’ennui de mon cher fils Homphroy, et aussi la peine du seigneur de Césarée, qu’il a faite sienne, qu’ils emportent le courroux du roi contre le sire de Plancy, mon époux, et, par-dessus le marché, les années que j’ai en trop.
— Et vous, princesse ?
— Je suis moi-même une cage vide, dit Sybille ; tout ce qui avait des ailes est parti.
La comtesse de Tripoli ouvrit la petite porte, et, avec des cris aigus, les oiseaux s’échappèrent.
— Frou !… Comme ils se sauvent ! Ils ne seront jamais assez loin de leur prison.
Elle rendit la cage et donna une pièce d’or à l’oiselier, qui s’éloigna en la bénissant.
À ce moment, Milon de Plancy s’élança, tout chancelant, et vint tomber, sur un genou, devant le roi en criant :
— À moi ! cousin !
Tout de suite, une mare, de sang se forma autour de lui, et il s’affaissa, râlant. Le roi avait couru à lui.
— Milon !… Quoi !… il est mort ?
— Oh ! Sainte Vierge ! Mort ! mon mari ! s’écria Tiennette, avec plus de surprise que de douleur.
Sybille ramassa le poignard, qu’un flot de sang avait rejeté hors de la blessure.
— « Le Khâlife de Dieu ! » Comme d’habitude, le meurtre est signé.
Raymond de Tripoli accourait, tout ému.
— Sire, dit-il, le noble templier Gauthier du Mesnil est mortellement blessé.
— Ah !… lui aussi !
— Il a demandé un prêtre, et l’évêque Guillaume est près de lui.
— Ah ! c’est la guerre, cette fois, s’écria le roi. Il n’y a plus à hésiter, car ceci est intolérable. Un parent ! un hôte ! égorgés tous deux dans mon camp !… Il faut venger un pareil outrage, ou mourir. « Dieu aide son Sépulcre ! »
Et Amaury fit aussitôt crier un ban, pour assembler le conseil, afin de décider qu’on mît le siège à l’instant devant le château.
Mais, dans le camp en rumeur, l’alarme était à peine répandue, que la nouvelle courut qu’une troupe sortait de la forteresse en élevant des branches d’olivier. Bientôt, en effet, des hérauts écartant la foule crièrent :
— Rangez-vous devant celui qui tient en son pouvoir la vie et la mort des rois.
Et les chevaliers, faisant la haie sur le passage du Vieux de la Montagne, oubliaient tout dans la curiosité de le voir.
— Il daigne enfin se montrer lui-même ! se disait Amaury, en le regardant s’avancer. Il vient sans armes, avec une escorte restreinte, dédaigneux du danger.
Et, comme tous les autres, il était impressionné par l’air souverainement majestueux du magicien, par sa jeunesse, mais surtout par la douloureuse pâleur de son visage.
— On dirait qu’une clarté nocturne l’enveloppe, pensait-il, et il est, certes, étrangement beau.
— Roi Amaury, dit Raschid, d’une voix très douce, pourquoi songes-tu à attaquer ce château, que tu reconnais en toi-même être imprenable ? Pourquoi veux-tu me déclarer la guerre, quand la cause qui aurait pu la faire naître entre nous n’existe plus ?
— Comment ? s’écria le roi en faisant un pas en arrière, il faudrait te laisser égorger les miens sous mes yeux, sans crier vengeance ?
— J’ai seulement fait justice et je t’ai vengé ! Écoute ce que ton évêque vient te dire.
Guillaume accourait, en effet, faisant de loin des gestes d’apaisement.
— Suspendez votre, colère, sire, dit-il, tout haletant. Le Templier qui a traîtreusement occis l’ambassadeur Boabdil, vient d’expier son crime. C’était ce Gauthier du Mesnil. J’ai reçu sa confession, qu’il me charge de rendre publique.
— Quoi ? dit Amaury, il venait me braver ici, se railler de moi ?…
— Pis que cela, seigneur : d’accord avec le sénéchal Milon de Plancy, il t’allait trahir. Une troupe de Templiers devait le joindre, ce soir même, pour tâcher de s’introduire, par ruse, dans le château, afin d’en piller les richesses et d’en égorger le maître.
— Milon ! traître !… lui que j’ai comblé de biens, s’écria le roi, en courbant la tête.
— Ne tardez pas, seigneur, dit l’évêque : ces soldats du Temple, il faut les découvrir et s’emparer d’eux.
— Ils sont déjà mes captifs, dit Raschid.
— Ah ! cédez-moi le droit de les punir.
— Crois-en ma sagesse, roi de Jérusalem, ne les punis pas.
— Que dites-vous ?
— Les coupables ont expié. Par égard pour toi, je me contente de cette réparation. Fais de même, je te le conseille. On me dit prophète ; mais il n’est pas besoin de l’être pour vous prédire, à vous, chrétiens, que c’est par la désunion que vous périrez. Oui, je l’avoue, j’ai été tout d’abord frappé d’admiration par la sublime folie de votre conquête, par votre force, votre étonnant courage. Je vous ai observés, j’ai étudié votre croyance. Je songeais à m’allier à vous. Nos deux puissances réunies auraient formé un torrent irrésistible ; nous étions les maîtres de l’Orient. Mais j’ai vite reconnu que rien de stable ne peut s’établir par vous. Orgueilleux à l’excès, vous ne savez pas obéir. Vous négligez, le plus souvent, l’ennemi, pour vous déchirer entre frères. Et ce dieu même, ce dieu pour lequel, de si loin, vous venez mourir, bien facilement vous le renieriez !
— Ah ! seigneur ! dit Guillaume d’un ton de reproche.
— Noble évêque, dit Raschid, j’ai pour ton grand esprit, ton savoir et la droiture de ton âme, la plus profonde estime ; j’ai été vivement touché de l’opinion flatteuse que tu as maintes fois proclamée pour ma personne et je ne voudrais pas t’attrister en vain. Mais, aujourd’hui même, un grand nombre des vôtres, attirés par de vulgaires séductions, viennent d’abjurer le Christ et de se donner à moi. Je te les renverrai, ajouta-t-il, parlant au roi ; ne cherche pas à savoir leur nom. Évitez tout sujet de division, restez unis. Une guerre cruelle se prépare contre vous, car Salâh ed-Din rassemble ses forces pour une lutte suprême. Il recherche mon alliance ; mais, tant que tu vivras, roi Amaury, je jure de ne rien conclure avec lui. Crois-moi : je te parle d’un cœur ami ; ne hâtez pas votre perte. Pardonne aux soldats du Temple. Je te les rends, sans vouloir aucune rançon.
— Merci, seigneur, dit le roi, très ému. Vos nobles paroles me troublent profondément. Elles touchent à une plaie vive, qui me ronge sans cesse. Vous n’avez que trop raison, hélas ! et, malgré mon ressentiment, je suivrai vos conseils.
Brusquement, le prince de Hama, défait et tout en larmes, s’élança d’un pas incertain.
— Raschid, cria-t-il, ai-je rompu la paix, moi ?… Peux-tu me reprocher la plus légère faute contre toi, en action ou même en paroles ? Qu’as-tu fait de l’otage précieux que je t’ai confié ?… Où est mon enfant bien-aimée ?
— Il l’a tuée ! criait Hugues de Césarée, qui, hors de lui à la vue, du meurtrier, avait tiré son épée.
Homphroy, suppliant, le retenait à pleins bras.
— Tuée ! ma fille ! murmurait le roi.
Raschid ed-Din, les yeux fixes, comme accablé de douleur et de honte, baissait la tête.
Dabboûs alors s’approcha de lui :
— Debout, dans ton orgueil intact ! mon fils, lui dit-il à demi-voix. Mon devoir était de te sauver de toi-même. Par un ordre signé de toi, le blanc-seing que tu m’as jadis confié, l’ordre inique a été suspendu. Le sang d’une colombe a trempé la ceinture de l’innocente.
— Gazileh ! vivante !… murmura Raschid, prêt à défaillir.
— Courage maintenant, khalife de Dieu ! Ce que j’attends de toi doit être digne de ta grandeur.
Et le noir chambellan, prônant par la main la princesse de Hama, dissimulée parmi les gens de l’escorte, lui enleva son voile…
Un long murmure d’admiration s’éleva à la vue de cette beauté si parfaite ; mais elle, avec un cri de joie s’était jetée dans les bras de son vieil oncle, qui sanglotait.
Nahâr, dans un délire de bonheur, arrachait ses habits de deuil et couvrait de baisers les mains de son amie. La stupeur heureuse, qui étourdissait tous les assistants, donna à Raschid le temps de se remettre un peu.
— Merci, prophète, dit enfin le prince de Hama, riant et pleurant ; pardonne-moi de t’avoir accusé.
— Gazileh ! dit Raschid d’une voix mal affermie encore, voici le roi Amaury, votre père.
Et, comme la jeune fille, stupéfaite, interrogeait des yeux son oncle :
— C’est vrai, dit-il.
Alors, surprise et souriante, elle s’avança vers le roi :
— Je vous la rends à tous deux, dit Raschid, à une condition…
— Parle, dit Amaury : que pourrions-nous te refuser ?
Une oppression terrible semblait serrer la gorge du prince des Montagnes. Il dit pourtant :
— C’est que tu m’accorderas sa main… pour le plus brave de tes chevaliers, qui l’aime… et a le bonheur d’être aimé d’elle.
Amaury tenait Gazileh par le bout des doigts et la contemplait avec admiration.
— Certes, dit-il, il est heureux, celui qu’elle a élu !… Vit-on jamais pareille merveille ?… Nomme-le, ce mortel fortuné, et, si mon hôte y consent, il est mon gendre.
— C’est le comte Hugues de Césarée.
Hugues, qui avait tout écouté dans un indicible frémissement d’émotion, s’élança vers Raschid.
— Est-ce bien possible ? s’écria-t-il. Vous ai-je à ce point méconnu ?… Mais, pardon, ma présence vous fait mal… Pourtant la grandeur de votre sacrifice m’écrase ; je ne puis faire autrement que de ployer le genou devant vous.
Mais, vivement, le prince le releva :
— Encore ceci, murmura-l-il.
Et il lui ouvrit ses bras.
— Ah ! vous êtes vraiment plus qu’un homme !
— Ô prophète, vous qui savez tout, dit Gazileh, tandis que le chevalier se détournait pour cacher ses larmes, vous voyez ce que mon âme éprouve.
Pour la première fois, Raschid osa la regarder.
— Ô Gazileh ! fleur exquise dont le parfum m’avait fait perdre la raison, dit-il, pardonne-moi le mal que je t’ai fait, au nom de ce que j’ai souffert.
— Ô seigneur !… Je vous pardonne et je vous aime.
Elle s’avança pour lui baiser la main ; mais il la retint et, lentement, posa ses lèvres sur le beau front levé vers lui.
— C’est dans mon château qu’auront lieu les fêtes nuptiales, dit-il d’une voix haute : il peut vous contenir tous, et je veux que les réjouissances soient assez magnifiques pour vous payer de l’ennui où je vous ai tenus ici pondant de longs jours.
Une immense acclamation éclata, bénissant le nom du Vieux de la Montagne, et celui des fiancés, qui, savourant en eux-mêmes leur immense bonheur, n’échangeaient pas même un regard.
Raschid s’était approché de Dabboûs.
— Es-tu content, mon maître ? dit-il. Vois, tout est mort en moi de l’homme vulgaire. Mon cœur est calme, mon pouls ne frémit pas. Je suis sans haine, sans amour, impassible comme un dieu.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les poilus étaient-ils poilus ?
Cilou

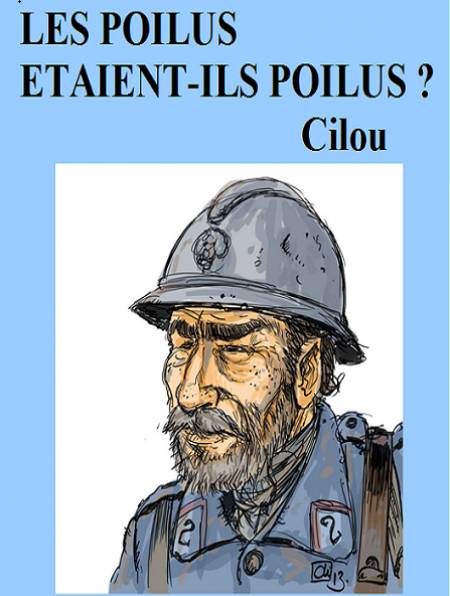
« Poilus », c’est bête, mais je suis sûr que mes élèves vont retenir cette expression. Cela les fait vaguement sourire, c’est imagé, pas compliqué, tout le monde peut comprendre. Cela ajoute à la véracité des tranchées sales, insalubres, dangereuses. La puanteur devient plausible, la lassitude des soldats plus sincère, le désespoir est probable.
Avec tout ce que je leur ai raconté, ils commencent à ressentir un peu de compassion en mémoire de nos soldats. Ils imaginent, ils brodent, ils font ce qu’ils peuvent pour visualiser la tranchée. Ils font des ahhhhh et des hannnn à la lecture des récits qui racontent la boue, le froid, la faim, les mourants.
Quand on y ajoute les poux, la vermine, l’urine, les rats… c’est le dégout général et ils résument leur répulsion en s’indignant « Madame, c’est abusé là ! ».
Alors, pour détendre l’atmosphère je leur montre cette planche peu académique, mais dans l’espoir que l’on partage quelques complicités humoristiques. Cela me permettra par la même occasion d’évoquer la censure si pratiquée en tant de guerre. C’est vrai que ça les fait sourire et surprise ils prennent conscience qu’ils ne sont pas les inventeurs de l’argot.

« Madame ils ne sont pas si poilus vos poilus. Regardez sur son buffet et son bide, ses abattis, ses gambettes ou ses guibolles il n’y a pas tant de poil. Vous avez vu je connais l’argot de la guerre 14 18 moi ! »
Oui en effet, il n’avait pas tort, ce poilu était dans le cas présent bel et bien imberbe.
— Mais ce n’est qu’une image, tu vois bien, un dessin, on représente comme on le désire.
— Alors pourquoi sur cette photographie ils sont nickels aussi les poilus ? Là vous ne pouvez pas dire le contraire, on voit bien que c’est une photographie alors c’est forcément pour du vrai. Et on voit bien qu’ils se sont rasés.

— Apprends jeune effronté que même les photographies ne sont pas toute la vérité surtout en temps de guerre. On les censure, les triture, les tronque et on les met en scène. Là par exemple il se peut que le supérieur ait demandé à ses soldats d’aller se raser et de nettoyer la tranchée avant de poser pour une belle photo. Il ne fallait pas trop montrer que l’on souffrait et encore moins que l’on n’y croyait plus à cette guerre sinon comment les femmes auraient gardé le moral pour aller usiner à fabriquer les armes ?
Cependant, l’effronté était perspicace et ses remarques pertinentes m’amenaient à faire quelques recherches. Je savais bien que les photographies participaient à la propagande et qu’elles n’étaient jamais prises sur le vif. Mais plus je visionnais des clichés plus je découvrais que les « poilus » étaient effectivement rarement poilus tout du moins pas tels qu’on les imaginait soit disant dépourvus de toute hygiène, crasseux, hirsutes, débraillés au fond de leur tranchée. Je les trouvais au contraire relativement soignés, souvent le menton net et rasé, rarement agrémenté de barbe et la moustache impeccablement fière.
La planche ci-dessous témoigne de cette mode masculine, celle de la moustache. Elles étaient de toutes les formes, de tous les pays et l’on nommait celle des poilus, la « moustache en guidon » car on la lustrait avec de la cire pour qu’elle adopte cette forme de guidon de vélo.

Bref aucune négligence pileuse dans l’affaire alors pourquoi donc surnommer nos soldats les poilus ?
L’affaire devenait poilante avant de devenir rasoir pour profiter de jeux de mots désopilants !
C’est ainsi que je découvris que l’expression « poilu » était bien plus ancienne que notre Grande Guerre et qu’elle ne désignait point ce que l’on pouvait en dire. Le poil évoquait des qualités humaines telles que le courage, la bravoure, l’expérience de l’homme qui ne recule devant rien. En fait l’homme poilu est viril parce qu’il n’a pas de poil dans la main ! De là s’éclaircissait une flopée d’expressions comme :
« Avoir un poil dans la main » : un fainéant qui n’est pas viril, car il a les poils dans la main au lieu de les avoir sur le torse
« Reprendre du poil de la bête » : retrouver sa force virile grâce aux poils
« Leur tomber sur le poil » : Attaquer par surprise quelqu’un grâce à son courage
« Avoir du poil au menton » : devenir viril grâce à sa pilosité naissante
Bref tout un système de valeurs fort adapté au courage militaire et aux temps de guerres. Le poilu a bel et bien existé, mais ce n’est point un soldat négligé non ! Ce n’est pas non plus un soldat barbu, la barbe ayant été interdite lors de la distribution des masques à gaz.
C’est ce soldat fier, courageux, offensif qui bombe son torse poilu et lustre sa moustache en guidon de vélo. L’honneur est sauf !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Comme une poupée
Delphine Coussement

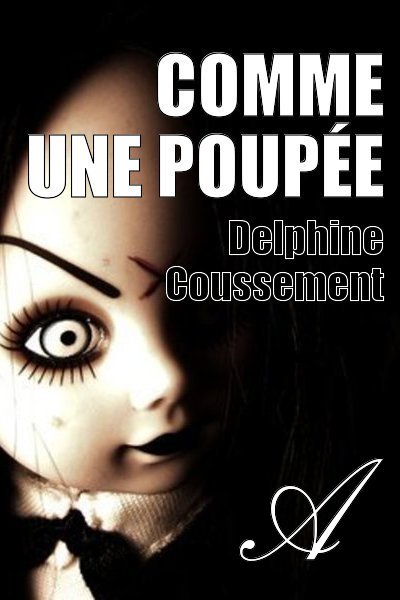
Samedi 1er novembre
La fin de la journée se profile à l’horizon. Lucie pédale pour retourner chez elle. Elle vient de rendre visite à sa tante Norma. Elle apprécie ces petites après-midi passées avec elle. Norma lui fait à chaque fois découvrir une nouvelle plante qu’elle a achetée ou déterrée dans le bois tout proche. S’en suit le casse-tête pour lui dégoter une place dans le jardin qui s’apparente plus à une jungle. Sa tante divague parfois et lui relate des conversations tenues avec ses végétaux. Cette folie douce amuse Lucie et lui fait oublier son quotidien d’étudiante.
La petite rouquine tente de devenir assistante sociale mais la tâche s’est avérée plus ardue que prévu. Elle double sa deuxième année. Ce n’est pas par défaut de travail mais les matières sont vastes et nécessitent beaucoup de mémoire, le point faible de la jeune fille.
Le ciel se couvre rapidement et des nuages gris se mettent à déverser des trombes d’eau sur la petite route de campagne et sur Lucie qui se met à accélérer. C’est à peine si elle voit encore devant elle. Et aucun abri à l’horizon. Une voiture la dépasse à grande vitesse. En plus de l’arroser, elle la fait vaciller dangereusement. Lucie s’approche un peu trop du fossé et s’y retrouve entraînée par une coulée de boue. Le trou est profond d’un bon mètre et la cycliste chute lourdement au fond. Une douleur vive à la cuisse droite lui arrache un cri perçant. Rassemblant ses forces, elle se dégage de l’emprise de son vélo. Dans la pénombre, elle tâtonne son corps jusqu’au lieu de douleur. Là, sa main tremblante touche quelque chose de dur qui lui sort du côté de la jambe droite. Paniquée, elle se met à crier des « au secours » désespérés.
Le fossé se remplit comme le lit d’une rivière asséchée. Prenant son courage à deux mains, elle tente de se hisser sur le flanc de la pente. A ce moment, elle sent des mains lui agripper les bras et la remonter au niveau de la route. Elle entraperçoit deux visages ridés qui lui sourient mais ne lui adressent pas la parole. L’homme, plus fort que ne l’aurait laissé penser sa petite stature, soulève Lucie sous les jambes et l’amène vers une maison au bout d’une allée de graviers, pendant que la dame tient un parapluie sombre au-dessus de la blessée.
L’homme la dépose sur un vieux canapé dans un salon chauffé et éclairé par un vif feu de bois. Il observe longuement la blessure avant d’interroger Lucie :
« Tu as mal ailleurs ?
- Non. Je ne crois pas. Merci de m’avoir sortie du fossé. J’ai cru devoir rester là toute la nuit.
- Nous avons entendu tes appels et nous avons accouru. Tu as eu de la chance car il n’y a pas beaucoup d’habitations dans le coin. Bon, on va te soigner maintenant.
- Il vaudrait mieux appeler une ambulance, je pense.
- Ce n’est pas nécessaire. Et puis, un jour férié, ils ne viendront pas avant demain. »
Lucie trouve sa réflexion étrange mais elle est épuisée et ne souhaite pas ouvrir le débat. Le vieillard ouvre une mallette digne d’un musée et en sort divers instruments. Il découpe le pantalon autour de la blessure. Lucie jette un œil. La lumière vacillante du feu lui permet de constater qu’un morceau de branche s’est planté dans sa cuisse lors de sa chute et y est toujours logé. Le retraité lui colle un mouchoir en tissu dans la bouche en annonçant : « Mords là-dedans ! ». Sans prévenir, il arrache d’un coup sec le corps étranger. Lucie perd connaissance.
Elle ouvre peu à peu les yeux. Le dernier souvenir avant son évanouissement lui revient. Elle tâtonne sa cuisse et constate, avec soulagement, que le morceau de bois a été remplacé par un gros pansement. Elle est maintenant sèche et en robe de nuit longue.
Elle observe la nouvelle pièce qui s’offre à elle. Il s’agit d’une chambre d’enfant. A la lumière de la lune qui s’immisce par la fenêtre, elle aperçoit des poupées anciennes qui l’observent de leurs yeux de porcelaine. Une maisonnette en bois leur semble consacrée. Sur la table de nuit, un vieil ours en peluche a été disposé. Il la contemple du seul œil qui lui reste. Son pelage élimé évoque un passé riche de partages avec un jeune enfant.
L’horloge à balancier affiche trois heures. Il faut qu’elle se repose même si la douleur lancinante semble vouloir l’en empêcher. Elle finit par succomber à l’appel de ses rêves.
Dimanche 2 novembre
Lucie ouvre doucement les paupières. Le soleil a repris ses quartiers et inonde la chambre d’une douce lumière apaisante. Dans l’embrasure de la porte, la vieille dame de la veille apparaît. Elle adresse un sourire radieux à la jeune fille ainsi qu’un « bonjour » enjoué.
« Bonjour Madame. Je vous remercie pour hier soir.
- C’est normal Marguerite.
- Je m’appelle Lucie. »
La dame s’arrête un moment, pensive. Elle marmonne entre ses dents : « Je préférais Marguerite. Tant pis.
- Pardon ?
- Oh, rien. Tu as faim ?
- Oui, très. »
La maîtresse de maison quitte rapidement la pièce pour faire une entrée triomphale, quelques minutes plus tard, avec un plateau en bois qu’elle dépose sur les genoux de Lucie. L’odeur de café et de pain frais lui saute aux narines et la fait saliver. Elle ne se fait pas prier pour attaquer les tartines beurrées et le jus d’oranges. La dame la regarde s’empiffrer avec une mine ravie. Entre deux bouchées, Lucie a le temps de l’observer. Elle doit avoir au moins quatre-vingts ans. Ses cheveux gris sont coiffés en un chignon parfait. Des rides profondes lui parcourent le visage. Derrière ses lunettes en écaille, elle ne quitte pas Lucie des yeux. Elle porte une robe à fleurs des années soixante. Un petit tablier bleu lui enserre la taille qu’elle a fine, lui donnant un air de soubrette. Après avoir terminé tout le contenu comestible du plateau, Lucie s’exclame :
« Un grand merci, Madame.
- Ne m’appelle pas Madame. Je suis Mom. »
Mom ? Quel étrange prénom se dit Lucie.
Mom reprend son plateau et repart en bas. Peu après, c’est le maître de maison qui vient s’enquérir de l’état de Lucie, en pleine digestion. L’homme est d’une stature modeste, diminuée par un dos voûté. Ses cheveux, plaqués en arrière, sont totalement blancs et une légère calvitie semble naître au-dessus du front. Son visage émacié, son nez et ses doigts crochus lui donnent un air de rapace. Il adresse un sourire grimaçant à Lucie.
« Comment te sens-tu, mon enfant ?
- ça peut aller. Puis-je téléphoner à ma famille ? Ils vont s’inquiéter.
- Mais nous n’avons pas le téléphone. Cela coûte trop cher.
- Ah ? Ce n’est pas grave. J’ai mon portable dans la poche de mon jean.
- Jean ?
- Mon pantalon … »
Le vieil homme se dirige vers une chaise dans le coin de la pièce. Il tend le pantalon, découpé et maculé de sang, à Lucie. Elle sort son téléphone de la poche gauche. Ce geste fait naître une petite lueur d’inquiétude dans le regard du vieux monsieur. Elle tente d’allumer l’appareil mais l’écran porte des taches d’humidité et reste impassible, malgré les tentatives désespérées de sa propriétaire. Elle finit par se résigner en annonçant :
« Il a pris l’eau hier soir. Je pense qu’il est foutu. Vos voisins … ils ont le téléphone ?
- Nos plus proches voisins sont à dix kilomètres. Ce n’est pas grave. Ma femme et moi-même allons bien nous occuper de toi. Je m’appelle Dad. Tu es entre de bonnes mains. »
Dad ? Lucie se dit qu’ils se sont bien trouvés ces deux-là avec des prénoms aussi bizarres.
L’homme pose sa mallette, la même que la veille, sur la table de chevet et l’ouvre. Il en retire soigneusement des pansements et un flacon sans étiquette, contenant un liquide transparent. Il retire les bandes et le pansement sanguinolents. Lucie manque de tourner de l’œil à la vue du trou béant dans sa cuisse, entouré d’un hématome impressionnant. Il badigeonne la plaie avec du liquide provenant du flacon mystérieux et lui tend un comprimé et un verre d’eau.
« Avale. Tu te sentiras mieux.
- C’est pour la douleur ?
- Oui. »
Dad panse la blessure et remballe son matériel, Lucie l’interroge :
« Il vaudrait mieux que je passe une radio. Non ? Vous avez une voiture ?
- Non. Il te faut du repos. C’est moins grave que cela en a l’air.
- Ma tante habite à quelques kilomètres. Si vous avez une voiture, vous pourriez me conduire chez elle.
- Non, je n’en ai pas.
- Et mon vélo ?
- Je l’ai sorti du fossé. Il était bien abîmé. Je l’ai mis dans le garage. Maintenant, repose-toi jusqu’au dîner. »
Et il sort prestement. Lucie a une étrange impression dans cette maison qui semble totalement coupée du monde. Pas de téléphone, pas de voiture et elle ne se souvient pas avoir vu de télévision dans le salon, hier soir. Elle cogite sur le meilleur moyen de joindre ses proches. Ils ne vont pas s’inquiéter dans l’immédiat car elle vit seule dans un petit appartement. Ses parents sont en vacances deux semaines en Corse. Personne n’est censé s’enquérir de son sort, aussi malheureux soit-il, pour l’instant.
Vers 10 h, Mom revient avec une bassine archaïque remplie d’eau, un pain de savon, un gant de toilette et un grand essuie.
« C’est l’heure de la toilette ! annonce-t-elle joyeusement. »
Elle aide Lucie à s’asseoir, le dos calé par trois oreillers, puis à retirer la chemise de nuit d’emprunt. La jeune fille, un peu gênée, est soigneusement lavée de la boue qu’elle a encore jusque dans les oreilles.
Mom se dirige ensuite vers une imposante garde-robe ancienne. Les gonds grincent de façon sinistre comme s’ils n’avaient pas été sollicités depuis des lustres. La dame en retire une robe Vichy mi-longue.
« Tiens. Enfile ça. Tu seras très jolie.
- ça appartient à votre fille ?
- Appartenait, oui. Elle est morte.
- Oh. Je suis désolée. Que lui est-il arrivé ?
- Elle n’a pas survécu à une vilaine pneumonie. Elle avait seize ans. Tu lui ressembles un peu. »
Lucie observe la chambre mais s’étonne de ne trouver aucune photo de la défunte. Les jouets lui font plutôt penser à une enfant partie plus jeune. Quelle fille raisonnable dormirait encore avec un nounours à seize ans ?
Mom semble très émue de découvrir Lucie revêtue de la robe d’un autre temps. La jeune femme n’ose rien dire, même quand son hôte commence à brosser consciencieusement sa tignasse rousse. Quelques minutes plus tard, Lucie se retrouve avec le même chignon que Mom. Cette dernière semble satisfaite de son travail. Lucie s’enquiert du lieu où siègent les toilettes. Sans répondre, la vieille dame quitte la pièce. Elle revient peu de temps après avec une chaise percée en bois. Elle la dispose sur la gauche du lit de Lucie en annonçant :
« Voilà. C’était celle de ma grand-mère. On a changé le seau.
- Pourquoi ? Il était plein ? »
Mais la vieille dame ne semble pas sensible à l’humour de Lucie. Elle lui adresse un sourire et sort à nouveau.
Lucie se sent de plus en plus mal à l’aise. Ce couple a un comportement étrange. Il ne semble pas pressé de voir Lucie les quitter. Même si elle leur rappelle leur fille, elle ne compte pas faire de vieux os ici. Elle décide de vérifier si une fuite, même lente, est envisageable. A deux mains, elle soulève sa jambe droite et pivote, non sans serrer les dents. La voilà assise. Elle tente de se mettre debout, appuyée sur sa jambe gauche. Son équilibre est précaire. Elle essaie de faire un pas mais le sol semble se dérober sous elle et elle se retrouve nez à nez avec la descente de lit poussiéreuse. Le bruit de sa chute et de ses plaintes alerte ses hôtes qui arrivent aussi vite que leurs vieilles jambes leur permettent encore.
Avec une aisance déconcertante, le maître de maison soulève Lucie et la dépose à nouveau dans le lit à baldaquins.
« Que s’est-il passé ? Tu es tombée du lit en dormant ? »
- Euh … non. Je voulais vous rejoindre en bas. Je me sens seule ici. »
Lucie ne peut dévoiler ses intentions profondes, de peur de susciter leur courroux et d’aggraver sa situation plutôt précaire.
« Il fallait demander. »
Et il la transporte jusqu’au salon. Lucie découvre la pièce qu’elle a entrevue la veille. Le canapé aux couleurs passées laisse apparaître le rembourrage sur le bord des accoudoirs. La décoration est très rustique : tableaux avec scènes de chasse, meubles Louis XVI piquetés par l’humidité, tapis d’Orient mités et … aucune télévision, ni de photo d’enfant. Ils ont dû être traumatisés par la disparition de leur fille et ont décidé d’en cacher tous les portraits. Il y a une vieille radio des années cinquante que Dad allume avec une joie non dissimulée. Un air d’accordéon se met à résonner dans la pièce. Lucie se pince discrètement afin de déterminer si cette scène est réelle. Elle accentue la force de sa pincette lorsque ses hôtes se mettent à valser devant elle.
La danse terminée, les amoureux essoufflés saluent l’assistance, se réduisant à leur prisonnière. Lucie fait mine d’applaudir. Mom file ensuite dans sa cuisine et Dad dans son jardin.
Le coucou suisse au-dessus de la cheminée commence à entonner son cri de midi. Dad transporte Lucie jusqu’à table. Sa femme a sorti sa porcelaine de Limoges et son argenterie. De délicieux effluves s’échappent des divers plats disposés sur la table. Lucie mène sa petite enquête :
« Comment faites-vous pour vous ravitailler ? »
Dad termine de remplir son assiette avant de répondre :
« Un livreur passe une fois par mois. Nous stockons dans le congélateur. J’ai un potager pour les légumes, des poules pour les œufs et la viande. Mom fait son pain elle-même.
- Et vous n’avez plus de famille qui vienne vous rendre visite ?
- Non … jamais ! s’exclame Mom sur un ton cinglant. »
Ils ont beau faire frémir, ce n’est pas une raison pour les abandonner à leur triste sort !
« Et que se passerait-il si l’un de vous deux tombait gravement malade ?
- Mon jardin regorge de plantes médicinales.
- Pas très efficaces en cas d’infarctus tout de même !
- Ne t’en fais pas pour nous. Personne ne le fait. »
Lucie s’inquiète surtout pour elle !
« Quand passe votre livreur ?
- Dans quelques semaines. Pourquoi ? Tu as besoin de quelque chose ? s’énerve Dad.
- Euh … je me disais qu’il pourrait m’emmener chez ma tante.
- Pas nécessaire. Mange et tais-toi. »
Cette dernière phrase résonne dans la cuisine et Lucie préfère ne pas insister car elle est affamée. Mom remplit généreusement l’assiette de son invitée qui s’en verra servir rapidement une seconde fournée. Le dessert a juste un petit coin de son estomac pour se loger. Lucie remercie la vieille dame et loue ses talents de cuisinière.
« Je t’apprendrai quand tu iras mieux. Tu deviendras un cordon bleu, ma fille !
- Enfin, je ne compte pas rester ici indéfiniment mais je serai ravie de revenir vous saluer. »
L’expression de Mom change brusquement et Lucie perçoit de la colère dans ses yeux clairs. Elle se met à débarrasser nerveusement la table. Dad l’aide, tout en lui glissant de petites phrases dans l’oreille. Lucie ne parvient pas à en déterminer la teneur mais elles ont le don de l’apaiser. Le vieillard remet ensuite Lucie dans le canapé. En quelques minutes, elle glisse vers une sieste peu réparatrice, peuplée de cauchemars, avec la sensation d’une fuite obligatoire alors que ses jambes refusent de lui obéir.
Lucie s’éveille en nage. Il est près de quinze heures. Elle remarque que Mom est restée près d’elle et a terminé la confection d’un bonnet de laine avec un reste de pelote couleur saumon. Elle le fait essayer à son modèle et semble satisfaite du résultat.
« Veux-tu que je te tricote des moufles ?
- Non, merci. Par contre, je désire me rendre aux toilettes, s’il-vous-plaît. Pourriez-vous m’aider ? »
La vieille dame se met à crier : « Dad ! Viens ici ! »
Son mari fait une apparition, les mains pleines de terre en demandant de quoi il retourne. Debout, les bras autour des cous de ses hôtes, Lucie est amenée à la porte des toilettes qui arbore un trou en forme de cœur. Dans un coin, une énorme araignée est postée au milieu de sa toile. Lucie pousse un hurlement de terreur.
« Pourriez-vous tuer cette affreuse bête ?
- Vous êtes folle. C’est moi qui la nourris. Elle est notre hôte, comme toi, s’indigne l’homme.
- Vous avez d’autres toilettes ?
- Accroupie dans le jardin ? »
Dad semble plus enclin à l’humour que sa femme. Lucie ne peut que se résoudre à se dépêcher, en priant que le monstre ne se décide pas à faire connaissance avec une homologue prisonnière.
De retour dans le salon, Mom s’approche de Lucie avec une boîte. Elle craint un peu d’en connaître le contenu mais il ne s’agit que de matériel de maquillage. Sans lui demander son avis, la vieille dame commence par lui poudrer le visage. Ensuite, elle souligne ses yeux de mascara noir, lui passe du rouge à lèvres couleur sang et termine par quelques touches de rose sur les joues. Elle annonce alors joyeusement :
« Tu es prête pour les photos. »
Les photos ? Lucie se demande ce qui l’attend. Elle entend le couple en grande discussion dans la cuisine avant que Dad vienne la cueillir pour aller la déposer sur une chaise de la terrasse. Lucie se trouve pour la première fois dans le jardin. Il est grand vaste et s’apparente à un parc. Sur la gauche, se trouve un potager bien garni. Lucie s’étonne de la taille des citrouilles. Elles sont dignes de participer à un concours.
Dad apporte un vieux Polaroid. Se peut-il que ce « machin » puisse encore fonctionner ? Inutile de leur parler de l’ère du numérique. Mom fait les dernières retouches maquillage à la lumière du jour, elle dispose correctement la robe lorsqu’elle se met à souffler. A droite, le vêtement porte une tache de sang provenant du pansement. La dame semble plus inquiète de la réussite de la photo que de l’état de santé de Lucie. Elle dispose un bouquet de roses sur la tache et demande au modèle malgré elle de poser ses deux mains sur les fleurs. Dad se positionne, l’attente est longue avant que le bruit caractéristique du déclencheur se fasse entendre. La photo sort du tiroir. Les deux vieux attendent impatiemment de découvrir le résultat. Un sourire naît à la fin du processus de colorisation. Dad présente à Lucie le cliché. Quelle horreur ! Elle est méconnaissable. Ce maquillage blafard, cette expression de fatigue, on dirait … une poupée de porcelaine.
Les heures passent et, à dix-neuf heures, elle se retrouve face à une casserole de soupe à la citrouille et des tartines beurrées. Le repas se déroule dans un silence pesant. Les bols vides, Dad la monte dans la chambre d’enfant. Mom l’aide à enfiler la robe de nuit qu’elle a lavée à la main et séchée au vent de novembre. Avant de quitter la pièce, Mom borde religieusement Lucie et lui dépose un baiser sur le front.
« Bonne nuit, ma chérie !
- Mais il est trop tôt, proteste Lucie. Auriez-vous … un livre ? »
La vieille dame attrape un bouquin au hasard dans la bibliothèque rose bonbon et le dépose dans les mains de Lucie. Il s’agit d’un recueil de contes pour enfants.
« Vous n’auriez rien pour adulte ? Je les connais depuis longtemps ces histoires.
- Non. Mais c’est parfait pour t’endormir et faire de jolis rêves. Tu veux que je te les lise ?
- Non, ça ira. Merci. Bonne nuit. »
La jeune femme, enfin seule, a une envie folle de crier : « Au secours ! Sortez-moi de cette maison de fous ! ». Mais sa voix ne porte pas à dix kilomètres. Il faut qu’elle échafaude un plan. La nuit est parfaite pour cela. Dans les contes, peu d’inspiration. Raiponce s’est échappée de sa tour grâce à ses cheveux surdimensionnés. Lucie aimerait s’enfuir par la fenêtre mais ses cheveux n’ont pas la taille minimale requise. Hansel et Gretel ont failli être dévorés. Pourvu que le couple ne l’engraisse pas en vue de la cuisiner cet hiver, lorsque leurs réserves de viande seront épuisées. Le Petit Poucet était très malin avec ses petits cailloux blancs. Si Lucie avait su ! Et Cendrillon ? Le Prince est venu la sauver des griffes de sa belle-mère grâce à son escarpin. Et si Lucie lançait sa basket par la fenêtre de sa chambre, quelqu’un s’inquièterait-il de savoir à qui elle appartient ? Jack avait un haricot magique …
Non ! Ce qu’elle vit est loin d’un conte de fée. Elle a plus l’impression d’être Paul Sheldon, prisonnier d’Annie dans « Misery ». Comment s’en est-il sorti ? Lucie n’a vu que le film, incapable de finir un bouquin. Elle se souvient qu’il était recherché car c’était un écrivain célèbre et sa voiture accidentée a été retrouvée dans un ravin. Mais Lucie est loin d’être une célébrité et son vélo est dans le garage.
Elle a beau retourner le problème dans tous les sens, elle est bel et bien coincée ici avec ces deux vieux fous qui la prennent pour une poupée. Bon, au moins, elle est nourrie et soignée, tous les otages n’ont pas cette chance. Quelqu’un finira bien par s’inquiéter de son absence … dans quelques semaines ! Mais personne ne sait qu’elle a rendu visite à sa tante. Elle le fait un peu en cachette car Norma n’est pas très appréciée par les autres membres de la famille. Le pire est que sa tante risque de ne même plus se souvenir de son passage hier. Toutes ces considérations l’angoissent. Lucie trouve tardivement le sommeil.
Lundi 3 novembre
Il est près de neuf heures quand Lucie ouvre les yeux. La porte de sa chambre est grande ouverte. Cela lui fait supposer que Mom guette son réveil. C’est pourtant Dad qui la salue en premier et entame la séance de soins qui ne semblent pas apporter la guérison espérée. La plaie est toujours rouge et boursoufflée, et du sang ne cesse de s’écouler doucement. Lucie interroge le vieil homme :
« C’est quoi votre produit ? Un désinfectant ?
- C’est un remède maison. Je le fabrique moi-même avec des plantes de mon jardin.
- Il n’a pas l’air très efficace.
- Patience. »
Des plantes du jardin ! Ces mots n’ont pas le don de rassurer Lucie.
La matinée se calque sur celle de la veille. Aujourd’hui, elle porte une robe bleue et une tresse dans les cheveux. Après un repas un peu plus frugal qu’hier, Lucie traîne dans le canapé. Peut-être devrait-elle se gaver afin que le livreur passe plus rapidement. En même temps, comment le préviennent-ils ?
En milieu d’après-midi, Mom revient avec sa boîte. Lucie tente maladroitement de s’opposer à la séance de maquillage d’Halloween. En réponse, la vieille femme lui bloque les mains et lui assène une petite tape sur la joue, comme on le ferait pour un chien non docile. Lucie s’étrangle d’étonnement. Elle tente alors de la raisonner :
« Je vous en prie. Laissez-moi tranquille.
- Sois un peu plus reconnaissante ! »
Que répondre à cet argument ? Lucie se laisse maquiller et photographier. Le cliché reflète toute la tristesse et la résignation qui la rongent.
La jeune fille reprend sa place sur le canapé du salon. Elle somnole quand un coup de sonnette retentit. Une personne extérieure ? La porte de sortie de cette prison dorée ! Elle entend Dad ouvrir et discuter avec un homme qui lui annonce un prix. Elle suppose que c’est le livreur de courses, seul moyen pour ses hôtes de se ravitailler. Dad va-t-il lui parler de Lucie et le solliciter pour les en débarrasser ? Il n’en est apparemment rien. Elle doit agir avant qu’il ne reparte. Lucie se met à crier : « Au secours ! On me retient prisonnière. Prévenez la police, je vous en supplie. »
Dad claque la porte entre le couloir et le salon. Lucie l’entend expliquer :
« C’est une nouvelle émission de radio. Ils diffusent des histoires effrayantes. Mom adore les écouter. Mais je pense qu’elle devient un peu sourde, elle met le son trop fort. Je lui ai déjà dit. Voici. Merci et au revoir. »
Et la porte d’entrée se referme sur le seul espoir de Lucie. La jeune fille se met à éclater en sanglots, quand elle sent une main sur son épaule. Elle lève la tête et croise le regard désapprobateur de Dad.
« Ne fais plus jamais cela. Tu vas faire de la peine à ta mère. »
Lucie l’implore : « Laissez-moi partir ! » Sur ce, il quitte la pièce, laissant la prisonnière en proie à de longs hoquets.
Le soir, Mom insiste pour lui lire un conte. Lucie ne lutte pas. Elle est trop fatiguée pour le faire de toute façon. Une nuit de plus … jusqu’à quand ? Tout en écoutant d’une oreille, elle cogite : il lui faudrait une voiture ou … retrouver son vélo. Dad lui a dit qu’il était dans le garage. Lucie se souvient vaguement qu’en arrivant, sous la pluie, elle avait vu le garage attenant, à droite de la bâtisse. Il lui suffit de trouver la porte qui y mène. Il faut aussi que sa jambe lui permette d’y arriver. Elle remarque, dans un coin de la chambre, un bâton assez épais, d’un peu plus d’un mètre de haut. Lucie n’en connaît pas l’utilité première mais elle entrevoit de suite un usage en ce qui la concerne. Elle feint de cligner des yeux et de s’endormir.
Mom sort de la pièce, sans faire de bruit. Ses pas, la menant jusqu’à la chambre conjugale, résonnent dans le couloir. Lucie attend patiemment une bonne heure, le temps que ses geôliers plongent dans un sommeil profond.
Elle enfile ses chaussures et sa veste, dans la perspective d’une fuite dans la nuit froide, avant de sautiller vers le morceau de bois. Doucement, Lucie s’avance, appuyée sur sa canne improvisée. Coup d’œil de part et d’autre du couloir, avant de se diriger vers l’escalier en chêne. La descente est périlleuse.
Au rez-de-chaussée, direction l’arrière droite de la demeure. Lucie y trouve une première porte mais elle mène au sous-sol. Une seconde s’ouvre sur une pièce sombre. Lucie tâtonne les murs. L’interrupteur allume une ampoule nue au plafond, juste au-dessus d’une vieille DS bleue. Pas de voiture, hein !
Dans un coin, son vélo rose est posé contre un mur. Elle s’en approche. Il ne semble pas si mal en point, à part les pneus qui sont complètement à plat. A y regarder de plus près, ils semblent avoir été lacérés à coups de couteau. Il n’est pas possible qu’une chute dans un fossé ait causé de tels dommages ! Sur l’établi, tout près, Lucie aperçoit un cutter. La lame brillante est sortie. Se pourrait-il que … Lucie sent son cœur se serrer dans sa poitrine.
Elle doit se résigner à abandonner l’idée d’une fuite en vélo. Reste la voiture. Elle n’a pas encore obtenu son permis mais ses connaissances en conduite sont suffisantes pour faire avancer cette épave. Elle tente d’ouvrir la portière qui, à son grand étonnement, cède immédiatement. Assise au volant, elle fouille, à la recherche de la clé. Celle-ci est tout simplement dans la boîte à gants. Fébrilement, elle la tourne dans le contact, tout en priant que le sommeil du couple soit profond et que cette voiture soit en état de marche. Le moteur émet un faible cliquetis. Lucie remet la clé en position initiale et refait une tentative. Mais rien ne se passe. Pas de miracle prévu pour ce soir.
Que faire ? S’enfuir à pied ? Elle ne parviendra jamais à parcourir dix kilomètres. En plus, leurs voisins sont peut-être morts depuis des années, sans qu’ils le sachent. Lucie ressent déjà des élancements terribles et risque de ne même pas atteindre le bout de l’allée. Elle doit se résigner à retourner dans sa chambre pour ne pas éveiller de soupçons. Elle emporte le cutter, on ne sait jamais ! Il pourrait s’avérer utile.
Elle atteint péniblement sa chambre. Son périple nocturne n’a pas réveillé le couple infernal. Lucie cache sa trouvaille sous le matelas et se couche.
Mardi 4 novembre
C’est reparti pour les traditionnels soins qui la font de plus en plus souffrir. Dad s’étonne de la quantité de sang qui s’est échappée de sa blessure.
« Je ne comprends pas. Tu es pourtant restée tranquille hier.
- C’est bizarre … »
Dad ne remarque pas que Lucie rougit.
Le cachet qui lui est remis ensuite, ne semble apporter aucun soulagement. Est-ce mauvais signe ? Tant pis, elle n’a qu’à se laisser mourir, ce sera une façon comme une autre de s’échapper.
Tiens, encore une autre robe. Elle est à fleurs rouges celle-ci. La coiffure du jour est une queue de cheval. Ensuite, un peu de solitude dans la chambre en attendant midi et son concert de casseroles qui annonce le repas. Lucie a le temps de cogiter à nouveau. Suite à sa découverte d’hier soir, elle ne peut se résigner à rester ici sans tenter quelque chose.
Après le dîner, elle doit attendre le passage habituel devant l’objectif. Mom n’a plus besoin de blanchir son teint qui a pris une couleur naturellement très pâle. Ils affichent toujours le même sourire béat à la découverte du cliché. Ensuite, allongée sur le canapé, Lucie demande à Dad d’allumer la radio du salon, prétextant que cela l’aiderait à s’endormir. Le vieil homme s’exécute et repart dans son jardin pendant que sa femme entame le grand nettoyage de sa cuisine.
Lorsque Lucie est sûre que personne n’entrera dans la pièce, elle se lève et sautille jusqu’à la carabine qui trône au-dessus de la cheminée. L’objet semble ancien et est assez lourd. Elle se demande s’il est chargé mais peu importe, elle ne le destine pas à trucider les vieux. Elle le pose droit et s’en sert comme appui afin d’atteindre la porte d’entrée.
A l’ouverture, un froid piquant s’engouffre dans le couloir. Lucie sort et referme doucement derrière elle. Un frisson lui parcourt l’échine. Elle porte le bonnet que Mom lui a tricoté. Elle aurait dû accepter la proposition des moufles et même demander des chaussettes. Lucie s’avance lentement dans l’allée. Son pied droit, nu et traînant, creuse un sillon dans le gravier blanc. La route semble à des kilomètres. Une fois la grille atteinte, la jeune fille s’arrête, essoufflée et grimaçante. Un coup d’œil aux alentours lui confirme que cette maison est très isolée. Aucune habitation à l’horizon. Pas âme qui vive, seulement des vaches qui broutent au loin. La route en terre est étroite et ne permet pas la circulation des véhicules dans les deux sens.
Que faire ? Elle ne peut pas rester là à faire de l’autostop. Avec sa chance, elle risque de tomber sur quelqu’un d’encore plus fou que ces deux vieillards. A gauche ou à droite ? Lucie est en plein doute lorsqu’elle entend un « Hé ! » derrière elle. C’est Dad qui court vers elle. Paniquée, Lucie braque la carabine comme un chasseur vers sa proie en criant :
« Arrêtez ou je tire ! »
Le vieil homme marque une pause et observe Lucie avec un léger rictus. Il continue son avancée, plus lentement. La jeune fille tremble autant de froid que de peur. Elle tient son geôlier en joue, pose son index sur la gâchette … et appuie. Mais rien ne se passe.
« Il n’est plus chargé depuis longtemps, mon enfant, rigole Dad. Donne-moi cette arme et rentrons. Tu vas attraper la mort. »
Lucie ne s’avoue pas encore vaincue. Elle retourne la carabine et la saisit par le canon en la brandissant comme une batte de baseball. L’homme ne semble nullement impressionné car il continue son approche. Le cœur de Lucie bat la chamade, elle se prépare pour un « home run ». Elle assène un premier coup … dans le vent. Puis, elle tente un second mais perd l’équilibre. Dad en profite pour lui arracher l’arme des mains.
Il lui reste ses poings qu’elle serre et lève, sans grande conviction. Postée sur une jambe, l’image du combat final de « Karaté Kid » lui traverse l’esprit. Elle regarde décidément trop de films ! Même en l’ayant vu une dizaine de fois, elle reste incapable d’une telle prouesse. Restent ses poings à la « Rocky » mais elle ne possède malheureusement que la musculature de sa femme Adrienne ! Le vieillard part dans un rire moqueur avant de fondre sur Lucie, comme un rapace sur sa proie affaiblie. Pas le temps de décocher un uppercut ou un direct du droit, qu’elle se retrouve maintenue au sol. Les yeux bleus, presque translucides, de Dad la contemplent. Lucie est glacée et terrorisée. Sans la quitter du regard, il se met à presser de sa main charnue la cuisse droite de la pauvre jeune fille, juste là où ça fait mal ! Elle hurle autant de désespoir que de douleur.
« Vas-y. Hurle autant que tu veux ! Personne ne peut t’entendre ici ! »
Il relâche son étreinte et attrape le corps sans force de Lucie. Il la jette sur son épaule comme un vulgaire sac de pommes de terre, et reprend sa carabine.
Dans la maison, il la dépose, sans ménagement, dans son lit en annonçant, magnanime :
« Je ne dirai rien à ta mère pour cette fois. Mais ne t’avise plus de recommencer sinon je devrai sévir. Couvre-toi pour te réchauffer sinon tu vas attraper une pneumonie toi aussi. »
Lucie est secouée de tremblements incontrôlables. Elle se cale sous les couvertures en se massant doucement la cuisse pour tenter d’apprivoiser la douleur. Des larmes lui inondent le visage et viennent tremper son oreiller. Elle a une pensée pour Marguerite. Est-elle décédée car ses parents ont tenté de la soigner au moyen de décoctions de pissenlits sans se rendre compte de la gravité de son état ? C’est affreux et cela ne la rassure en rien. Que va-t-elle devenir ? Elle finit par sombrer dans un sommeil agité.
En début de soirée, la porte de sa chambre s’ouvre en grinçant. La respiration de Lucie s’accélère. Mom apparaît avec un plateau.
« Dad m’a dit que tu ne te sentais pas très bien. Alors, je te ramène de quoi te retaper : de la bonne soupe au potiron. »
Lucie ne dit mot. L’homme a tenu sa promesse de ne rien révéler de la tentative infructueuse de fuite de Lucie. La soupe lui réchauffe le corps et l’âme. Elle repense à Hansel et Gretel …
Après avoir tout ingurgité, Mom l’aide à se déshabiller et la réprimande :
« Tu as des traces de boue sur ta robe !
- Euh … je pense que Dad a oublié de se laver les mains avant de me porter. »
La vieille dame souffle en grattant nerveusement la boue séchée qui macule le bas de la robe. Elle sort en annonçant :
« Il va m’entendre celui-là ! »
Lucie tend l’oreille. Une dispute conjugale éclate au rez-de-chaussée. Impossible d’en saisir un traitre mot mais le ton monte. Lucie espère secrètement qu’ils finissent par s’entre-tuer, cela lui faciliterait la tâche. Mais tout s’arrête d’un coup. Quelques minutes plus tard, elle entend des pas dans le couloir. Le couple rejoint silencieusement sa chambre.
Mercredi 5 novembre
Matinée sans surprise avec son train-train quotidien. Aujourd’hui, la robe est brune, à volants et ses cheveux arborent deux couettes. On dirait Fifi Brindacier ! Cette pensée fait sourire la jeune fille. Enfin seule, ses cogitations peuvent recommencer mais, elle a beau retourner le problème dans tous les sens, elle se retrouve bel et bien coincée ici, incapable de s’échapper ou de prévenir qui que ce soit. A moins que …
Lucie ouvre le tiroir de la table de chevet. Elle retrouve son portable, seul objet moderne dans toute la baraque. Elle remarque que les gouttes sur l’écran ont à présent disparu. Elle appuie fébrilement sur le bouton d’allumage. L’écran clignote et redonne des signes de fonctionnement. Son code pin entré, Lucie prie pour que la batterie soit suffisamment chargée pour passer un appel et qu’il y ait du réseau dans cette partie reculée de la Belgique. Une barre sur cinq ! Ouf. Elle forme le 112 et attend, en jetant des regards inquiets vers la porte, redoutant qu’elle ne s’ouvre.
Trois longue sonneries et une voix féminine la salue. Lucie se lance :
« Je suis retenue prisonnière chez des personnes. Je suis blessée …
- Connaissez-vous l’adresse ?
- Non. Je revenais de chez ma tante. Elle habite à Trouville et s’appelle Norma Leman. J’ai parcouru quelques kilomètres en vélo en direction de chez moi, à Mastad, quand j’ai eu un accident. Vite, je vous prie.
- Avez-vous plus d’informations sur le lieu ?
- C’est une grande demeure isolée avec une allée en graviers devant. Le couple dit s’appeler Dad et Mom. Ils ont eu une fille, décédée à l’âge de seize ans et prénommée Marguerite. Dépêchez-vous. Je pense que mon état se dégrade. »
A ce moment, Mom entre. Surprise de voir Lucie au téléphone, elle reste un instant figée avant de se précipiter vers elle. Elle lui arrache le GSM des mains, ouvre la fenêtre et le lance dans les taillis de l’allée, avec une puissance impressionnante pour une femme de son âge. Elle s’approche de la jeune femme aux yeux écarquillés de terreur, et la gifle violemment en criant :
« Vilaine fille ! Tu seras privée de repas jusque demain ! »
Elle sort en claquant la vieille porte de bois. Lucie halète en se frottant la joue endolorie. C’est un vrai cauchemar. Elle espère que les secours ne vont pas tarder. Elle leur a donné suffisamment d’éléments. Pourvu qu’ils ne croient pas à un canular !
Lucie reste seule et affamée toute la journée dans la chambre d’enfant dont les poupées lui paraissent de plus en plus effrayantes. Pas de photo aujourd’hui, c’est déjà ça de gagné.
Il est plus de vingt-et-une heure lorsque la porte s’ouvre doucement. C’est Dad. Il lui tend une tartine au fromage. Lucie avale goulûment le frugal repas pendant que le vieil homme entame un plaidoyer.
« Tu sais. Tu as fait beaucoup de peine à Mom. Elle voit que tu veux fuguer. Pourquoi ? Tu es bien ici. Tu es nourrie, soignée, lavée, habillée. Que veux-tu de plus ? Dehors, il y a des gens dangereux qui risquent de te faire du mal. Reste avec nous. »
Lucie choisit de répondre par un silence qu’elle laisser croire contrit. Il sort et la laisse en proie à ses interrogations et ses angoisses. Elle n’en dort quasi pas de la nuit. Vers trois heures, elle finit par succomber à l’inconscience.
Jeudi 6 novembre
Lucie ouvre un œil. L’horloge indique huit heures. Personne n’est venu la sauver pendant la nuit. Mais que font-ils ? Ils ont dû interroger sa tante. De quoi se sera-t-elle souvenue ? Elle ne sait même pas quel jour on est. Elle en oublie le prénom de Lucie parfois. Elle leur aura peut-être juste parlé de sa dernière conversation avec un rhododendron.
Et après, ils auront cherché les différentes routes que Lucie aurait pu emprunter pour rentrer chez elle. Sur celles-ci, il faut trouver une maison isolée, habitée par deux retraités. Même Derrick y arriverait en moins de vingt-quatre heures !
Dad débarque et effectue les soins comme si de rien n’était. Le silence qui règne est juste entrecoupé par les gémissements de Lucie, ce qui n’inquiète aucunement le vieillard. Mom dépose la bassine, le nécessaire de toilette et une robe verte au bout du lit. Puis elle sort sans échanger un regard avec sa prisonnière.
Lucie se débarbouille et se change. Elle trouve la robe du jour encore plus horrible que les précédentes. Faute de mourir de septicémie, elle mourra peut-être de honte. Elle ne veut pas perdre espoir, confiante dans la compétence de la police fédérale.
Un coup de sonnette résonne dans toute la maison. Lucie retrouve un regain de vie. Elle entend Dad discuter avec une voix masculine. Lucie se hisse péniblement hors du lit afin d’atteindre sa fenêtre qui surplombe l’entrée. A ce moment, Mom entre en trombe dans la pièce. Elle repousse Lucie dans le lit et lui maintient une main sur la bouche en posant un index sur ses lèvres ridées. Lucie se débat mais ne peut se déparer de l’étreinte de la vieille dame. Elle tâtonne le matelas de la main et retrouve le cutter. Elle le brandit, en fait sortir la lame neuve et entaille la main de Mom. Celle-ci hurle et recule en regardant le sang gicler de son poignet. Lucie en profite pour sautiller vers la fenêtre, l’ouvrir et hurler à l’adresse des deux policiers qui s’éloignent déjà dans l’allée.
L’un des deux se retourne et ils se mettent à courir vers l’entrée. Le plus grand sonne et tente de forcer la porte. Lucie voudrait sauter dans leurs bras mais la chute s’avérerait fatale pour elle ou celui qui tenterait de la rattraper.
Elle se retourne et fait face à Mom. Celle-ci s’est emparée du bâton qui siégeait dans le coin et lui assène un méchant coup dans la cuisse droite. Lucie s’écroule dans un râle. Par la fenêtre toujours ouverte, la voix d’un policier s’écrie : « Passons par derrière ! ». Mom part rejoindre le rez-de-chaussée, sûrement pour prévenir son mari, pensant Lucie hors service. Celle-ci rampe péniblement jusqu’à l’escalier. Elle dépasse la tête entre les barreaux et aperçoit ses deux tortionnaires menottés par les forces de l’ordre. Mom crie :
« Mais c’est notre fille. Elle est devenue folle et prétend qu’on la séquestre. Je vous assure. Ne nous la prenez pas ! »
Lucie éprouve presque de la pitié ; ce doit être ça, le syndrome de Stockholm. Un gars en uniforme s’approche de Lucie. Il la rassure, lui explique qu’elle est hors de danger, avant de solliciter une ambulance dans son talkie. Quelques minutes plus tard, la camionnette jaune, sirènes hurlantes, fait son entrée dans la cour. Les brancardiers montent l’escalier quatre à quatre. Lucie, à moitié consciente, parvient à peine à répondre aux questions des ambulanciers. Ils lui prodiguent les premiers soins et lui posent la perfusion de circonstance. Lucie entend les sirènes avant de sombrer dans un trou noir.
Vendredi 7 novembre
Lucie est réveillée par des bruits autour d’elle. Elle se relève d’un bond dans son lit, réveillant sa douleur à la cuisse. Elle lance un regard apeuré vers l’infirmière qui s’affaire. Celle-ci lui adresse un doux sourire en déclarant :
« Calmez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. »
Et elle invite Lucie à se recoucher. Celle-ci se remémore les événements de la veille et demande :
« Combien de temps suis-je restée inconsciente ?
- Plusieurs heures. Vous avez subi une intervention chirurgicale hier. Tout s’est bien passé. La police attend pour vous interroger. Vous vous en sentez capable ? Sinon, je peux leur demander de passer plus tard.
- Non. ça va. »
La femme en blouse blanche laisse entrer un petit homme bedonnant. Il porte une belle moustache à la Hercule Poirot. Il a un air rassurant.
« Bonjour Mademoiselle. On vous a trouvée à temps, d’après le médecin.
- Ah bon ?
- Oui. Encore quelques jours et …
- C’est étrange car il me soignait. Il avait une mallette.
- Nous l’avons trouvée. Elle contenait quelques ustensiles, un flacon contenant de l’eau et une boîte de vitamines périmées.
- Je comprends mieux maintenant pourquoi j’avais l’impression de sombrer. S’appellent-ils vraiment Mom et Dad ?
- Non, ils se prénomment Agnès et Albert. Ce ne sont que leurs surnoms. Cela signifie maman et papa en anglais. Vous ne saviez pas ?
- Je ne suis pas très férue de langues. Ils m’ont raconté que leur fille était morte à seize ans.
- Ils n’ont jamais eu d’enfant !
- Voilà pourquoi il n’y avait aucune photo.
- On a fouillé le jardin et on a découvert … un corps. »
Lucie ne peut réprimer un « Oh mon dieu ! » d’effroi. Elle imagine cette fille dont les parents se seront obstinés à la soigner à l’eau et à la soupe de potiron et qui a fini par mourir à petit feu. Ils n’auront pas su quoi faire du corps et aurait finalement décidé de l’enterrer dans leur jardin, comme un vulgaire chien. Lucie est bouleversée et est prise de hauts-le-cœur. Le pire, est qu’elle a failli elle-même subir le même sort et personne n’aurait jamais retrouvé son corps. Le policier continue ses explications.
« Nous avons effectué des recherches. Il s’agirait d’une jeune fille, de seize ans justement, qui a disparu il y a six ans. Elle se promenait sur cette route de campagne et ils l’ont sûrement attirée. Elle s’appelait Marguerite. »
Lucie va de surprise en surprise. Mais cette révélation est plus cohérente. Il est plus facile de laisser crever une inconnue que son enfant. Ils ont attendu de la remplacer … par elle ! La jeune fille interroge :
« Et où dans le jardin ?
- Dans le potager.
- Je comprends mieux pourquoi ses citrouilles poussaient si bien.
- On a aussi retrouvé des photos d’elle dans un tiroir. Elles ont été prises avec un vieux Polaroid. Ils l’avaient fardée étrangement.
- Je sais ce qu’elle a enduré ! Ils avaient l’air sympathique … au début. Que va-t-il leur arriver ?
- Inculpation pour séquestration et sûrement meurtre. Ils ne sont pas prêts de retourner chez eux.
- J’espère qu’il y a des prisons maisons de retraite, vu leur âge. J’ai donc eu du bol d’en réchapper. Comment m’avez-vous trouvée ? Grâce aux éléments que j’avais donnés ?
- Non. En fait, votre portable a continué à émettre un signal intermittent qui a permis de vous localiser. Tenez, on l’a retrouvé.
- Merci. J’ai été sauvée par la technologie, des griffes d’un couple qui en avait horreur. Quelle ironie du sort !
- Je vais vous laisser. Bon rétablissement, Mademoiselle. »
Lucie est toute retournée. Elle imagine le kidnapping. Mais comment ont-ils attiré Marguerite ? Était-elle blessée, elle aussi ? S’était-elle perdue sur cette route de campagne et avait demandé son chemin à la seule maison à des kilomètres à la ronde ? Pourtant, ils n’ont pas de maison en pain d’épices … Elle évoque divers scenarios mais ne saura jamais lequel est le bon. Exténuée, elle finit par s’endormir.
0000
Lucie s’éveille doucement. La lumière de la lune est douce. Elle se lève lentement, sans ressentir aucune douleur. Elle observe sa cuisse droite qui ne porte aucune blessure ni cicatrice. Tout ceci n’aurait-il été qu’un cauchemar ? La jeune fille se dirige vers un objet étrange qui attire son regard. Il s’agit d’une boîte à musique avec une manivelle qu’elle commence à faire tourner. Une petite musique pour enfant s’en échappe. Quand brusquement, la boîte s’ouvre, laissant sortir la tête d’un clown défiguré. Lucie crie et recule. Elle marche alors sur quelque chose de mou, qui émet un petit gémissement. Le cœur battant, elle ramasse l’objet informe. Un nounours la fixe de son unique œil avant de déclarer : « Nous t’attendions depuis si longtemps ! ». Lucie, effrayée, lance l’ours en peluche au loin et cherche la porte. Un coup d’œil vers l’ensemble de la pièce l’informe que la pièce en est totalement dépourvue. En tâtonnant les murs à le recherche d’une sortie, elle passe devant le miroir géant de la coiffeuse. Celui-ci lui renvoie un reflet qui lui est étranger. Elle s’approche pour en avoir le cœur net. Sa peau est devenue blanche et mate avec des pommettes roses parfaitement rondes. Ses yeux sont devenus noirs et brillants … comme de la porcelaine ! Lucie voudrait crier mais aucun son ne sort de sa bouche immobile, scellée à jamais.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Une tisane pour l'enfer
François Maillet


Ce véhicule semblait être sorti des ténèbres, il était arrêté à une intersection, il ressemblait au cavalier de la mort, comme si Salvador Dalí avait reproduit son œuvre sur cette camionnette. Ce jour-là la voiture de Monsieur et Madame Kidal se dirigeait vers ce croisement. C’était un couple qui était marié depuis sept-ans, ils étaient heureux de voir grandir leur fille Christel. C’était son anniversaire, elle venait d’avoir cinq ans, ils lui avaient acheté une magnifique poupée qui pouvait, marcher et parler. Christel était restée chez sa grand-mère. Il était dix-sept heures vingt quand la voiture de ses parents franchissait le milieu de la croix que formait les deux routes, c’est alors que la camionnette démarra et faucha avec une extrême violence leur véhicule qui s’écrasa contre un platane. Pour Henriette Kidal ce fut une terrible épreuve de perdre son fils et sa belle-fille. Christel regardait sa grand-mère.
— Tu as mal, mamie ? Pourquoi, tu pleures ?
— Viens ma chérie, viens t’asseoir sur mes genoux. Il faut que je t’annonce une bien triste nouvelle, ton papa et ta maman ont eu un accident de voiture. Tu te souviens quand nous avons trouvé l’oiseau mort, tu m’avais demandé pourquoi il ne pouvait plus voler ? Pourquoi il ne respirait plus ? Je t’avais expliqué que son cœur s’était arrêté de battre, c’est pour cela qu’il ne pouvait plus bouger, alors, tu m’avais répondu : « Il va pouvoir dormir pendant longtemps, il n’a plus besoin de nous maintenant. »
— Oui ! Je m’en souviens, mais, papa et maman, ils reviennent quand ? Je voudrais avoir mon cadeau.
— Écoute mon trésor, ce jour-là, je t’avais dis que pour les êtres humains, cela se passe de la même façon, il faut que tu saches que tes parents ne pourrons plus revenir, maintenant, ils sont comme l’oiseau leur cœur s’est arrêté de battre, ils n’ont plus besoin de nous.
— Tu es une menteuse ! C’est pas vrai ! Ils m’ont dit à ce soir en me faisant un gros bisou et puis s’ils ne veulent plus revenir, c’est parce que j’ai désobéi, je n’ai pas été gentille avec eux. Mamie, toi aussi, tu vas me laisser toute seule ?
— Oh non ! Je vais m’occuper de toi pendant très longtemps. J’ai une idée ma chérie, nous allons faire quelque chose que tu aimes, tu vas venir avec moi, nous allons choisir les plus belles photos, ensuite, tu pourras faire un magnifique cahier photos pour maman et papa, je le poserais à côté d’eux, je te le promets. Tous les soirs avant de nous endormir, nous ferons une prière, tu pourras leur raconter ce que tu as fait dans la journée. Pour finir, nous déposerons dans le creux de nos mains, plein de grosses bises que nous lancerons par la fenêtre en criant : « C’est pour vous, maman, papa. » Viens près de moi mon petit amour, viens tout près de mon cœur.
Pendant longtemps Henriette a rassuré Christel en étant à l’écoute de ses émotions, elle lui a permis d’avoir petit à petit de nouveaux repères, même si parfois des larmes se glissaient entre les mots pour les bousculer. Maintenant, elle était seule à élever sa petite fille, sans travail les fins de mois étaient parfois bien difficiles. Heureusement, elle avait la chance de bien connaître les plantes médicinales. Les gens venaient de très loin pour se faire soigner. Pour la remercier, ils lui donnaient un peu d’argent, chacun donnait ce qu’il voulait. Christel avait grandi, huit années s’étaient écoulées. Faire les courses pour elle, était un moment désagréable, surtout quand elle savait que les aliments qu’elle mettait dans son panier, elle ne pourrait pas les payer. Elle ressentait de la honte, mais Josette l’épicière lui disait souvent : « Ne t’inquiète pas, je marque sur l’ardoise et à la fin du mois Henriette me règle l’addition. » Josette marquait sur son ardoise, certains produits étaient ignorés, c’était sa façon à elle de leur rendre un petit service. Heureusement, Christel avait sa meilleure amie Tara qui était toujours là, elles étaient comme des sœurs, du matin jusqu’au soir, elles étaient ensemble. Elles avaient le même âge, Tara était une petite fille fragile, elle était asthmatique, sa présence était très importante pour Christel. Pour les deux enfants, la grande porte vers l’avenir était ouverte. Elles habitaient à Arcachon, leur maison était mitoyenne. Pour se baigner, elles recherchaient toujours des endroits désertés par les adultes. En voulant attraper un petit chat noir avec des tâches blanches, elles avaient découvert une minuscule plage qui était cachée par de gros buissons. Le sable était magique, les vagues venaient le caresser avec une grande douceur, c’était leur petit Paradis. Mais un jour, alors que Christel se baignait, un vieux pervers est arrivé doucement près de Tara. Elle était allongée sur le ventre, elle avait dégrafé le haut de son maillot de bain, les rayons du soleil lui réchauffaient légèrement le dos. L’homme s’installa doucement près de Tara en lui disant : « Si tu veux, je vais te mettre un peu de crème sur ta peau, je ne vais pas te faire de mal, j’ai les mains très douces, tu n’as pas peur de venir ici toute seule ? » La pauvre petite fille sursauta, son corps se mit à trembler, elle était paralysée par la peur. Christel, qui, était toujours dans l’eau, l’interpella : « Eh ! Espèce de vieux cochon, je vais prévenir la police, laissez-la tranquille. » L’homme surpris se volatilisa très vite dans la nature. Depuis ce jour, elles ne sont jamais revenues sur cette plage qu’elles adoraient. Parfois, elles aidaient Henriette à cueillir des fleurs et à préparer des potions miraculeuses. Christel était très douée pour faire certains mélanges de plantes, Tara, elle aussi, savait choisir des fleurs, pour lutter contre les petites maladies. C’est en se promenant qu’elles découvraient les plantes les plus rares et surtout les plus efficaces. Les parents de Tara travaillaient pour Monsieur George Marchand, un homme d’affaires, il était le propriétaire de plusieurs hôtels luxueux sur le Bassin d’Arcachon. C’était un homme très dur, les sentiments, la gentillesse, il ne connaissait pas. Souvent, il demandait au papa de Tara : « Alors ! Votre erreur de jeunesse, elle pousse bien ? » Il notait ses salariés d’une drôle de façon, il avait dessiné un feu tricolore et dans l’alignement de ce feu, il inscrivait leur nom. Celui qui se trouvait dans la case verte était tranquille. C’était vraiment exceptionnel de voir son nom dans cette belle case, il fallait travailler comme un fou, se plier aux bons caprices de son employeur, il ne fallait surtout pas compter les heures supplémentaires. Celui qui se trouvait dans la case orange, était constamment sous pression pendant ses heures de travail, le soir quand il débauchait, il avait déjà peur du lendemain. Pour le rouge, le salarié le savait bien, cette couleur représentait son licenciement. George Marchand était un homme divorcé, son fils Rudy, âgé de dix-sept ans, collectionnait les bagarres dans les bars, quand il était ivre. Heureusement pour lui, papa était toujours là, avec ses enveloppes et jamais les gens ne portaient plainte. C’était un enfant qui pouvait avoir tout ce qu’il voulait, son père le couvrait de cadeaux. Après le départ de sa mère, il était souvent malade, il avait des crises d’angoisse, il était révolté contre le monde entier. Sa souffrance, il l’a soigné à grand coup de whisky. Il était toujours en compagnie de Jimmy, un copain de bar, un garçon étrange, un peu attardé. Il ramenait souvent Rudy chez lui quand il avait trop abusé de l’alcool. Jimmy était très amoureux de Tara. Un jour, une amie des filles avait organisé une petite fête. Tout le monde pouvait venir, Jimmy se trouvait dans un coin, il buvait une bière, sur une musique douce, il invita Tara à danser, elle ne refusa pas son invitation. L’ambiance était bonne, les copains et copines s’amusaient bien. Jimmy, lui, ne regardait que le visage de sa cavalière, il se rapprocha encore plus près d’elle pour sentir le souffle de sa respiration, l’odeur de sa peau, Tara se recula en fronçant les sourcils, avec force, il essaya d’obtenir un baiser, elle lui donna une énorme gifle. Le garçon rouge de colère et de honte, se dirigea vers la sortie pour ne plus revenir. De nombreuses fois, il avait essayé de sortir avec Tara, mais à chaque fois, elle l’avait repoussé. Les deux petites préféraient changer de trottoir quand elles voyaient arriver Rudy. Il avait un caractère imprévisible.
— Il faut absolument que l’on puisse se prévenir quand l’une d’entre nous aperçoit Rudy. As-tu une idée Tara ?
— Laisse-moi réfléchir deux secondes, voilà, j’ai trouvé, nous allons croiser notre majeur sur notre index.
— Oui ! C’est super comme idée, maintenant, il faut que cela devienne automatique.
— Il faut que je te dise quelque chose Christel, souvent le soir, quand je ferme mes volets, j’aperçois une ombre, j’ai l’impression qu’elle m’observe quand je me trouve dans ma chambre.
— Tu n’as pas à avoir peur, je suis là pour te protéger. Bon ! Demain, nous allons à la plage et je vais te montrer qui est la meilleure au frisbee.
Après avoir passé une bonne nuit, chacune d’elle prépara son sandwich, sa boisson rafraîchissante. À la plage, elles faisaient une magnifique démonstration de lancer de frisbee, mais ce jour-là, Christel n’a pas eu de chance, elle se coupa le dessous du pied avec une coquille d’huître, heureusement la plaie n’était pas profonde. Cette blessure arrêta leur compétition, elles étaient obligées de rentrer chez elles pour nettoyer cette coupure. Henriette regarda le pied de sa petite fille.
— Bon ! Je vais prendre du fil et une aiguille pour coudre cette belle entaille.
— Mamie ! Tu me fais peur, c’est si grave ?
— Ne panique pas Christel, tu sais bien que je plaisante. Il faut aller me chercher l’herbe aux charpentiers. Tara, tu connais cette plante, tu veux bien aller en chercher, s’il te plaît, il va falloir que tu te dépêches, je pense qu’un orage se prépare.
— Ah ! Enfin, cela me fait plaisir de pouvoir aider Christel. Je vais passer chez moi pour prendre mes bottines, je reviens très vite.
Tara était très fière d’aller chercher cette plante pour soigner Christel. En marchant sur le chemin qui aboutit à un champ qui se trouve à côté de la forêt, elle fredonnait une chanson. Elle ignorait qu’un individu la suivait depuis qu’elle était partie de chez elle. On ne voyait pas son visage, il était caché par une capuche, dans la main, il avait une bouteille d’alcool. Il se rapprochait de plus en plus de Tara, quand elle voulut courir pour s’enfuir, c’était trop tard, il lui avait déjà attrapé ses longs cheveux.
— Arrête-toi ! Maintenant, tu prends le sentier pour rejoindre la forêt. Tu pousses un seul cri et tu es morte.
Elle ne comprenait pas ce que lui voulait son assaillant, elle pleurait, elle tremblait. L’air devenait instable, humide, au milieu des rafales de vent, on entendait le tonnerre, le ciel s’assombrissait.
— Stop ! Ici, personne ne pourra nous voir, nous sommes trop loin de la route.
Après avoir fait basculer Tara, pour quelle tombe à terre, son agresseur se jeta sur elle. Elle voulut se dégager, mais, c’était impossible, il avait trop de force. Il mordait le filtre de sa cigarette, la cendre tombait sur le cou de la pauvre petite.
— Si tu ne fais pas ce que je te demande, avec cette cigarette, je vais te brûler les yeux.
— Je t’en prie, je t’en supplie, ne me fais pas de mal.
— Déshabille-toi entièrement, aller ! Enlève-moi tous ses vêtements.
— Ne me demande pas ça, je ne pourrais jamais me montrer nue devant toi, tu es ivre, laisse-moi partir, je te promets de ne rien dire.
— Tant pis pour toi, je t’avais prévenu.
— Attends ! Je le fais, surtout ne me brûle pas, par pitié ne me viole pas.
— Eh bien voilà, tu es magnifique, tu es très en avance pour ton âge, tu en caches des belles choses. Mais toi à genou, prend ça dans ta main, ouvre la bouche et boit le contenu de la bouteille.
Tara commença à boire, parfois, elle rejetait ce qu’elle buvait par la bouche, le nez. Sa vue devenait trouble, l’alcool faisait déjà son travail, son agresseur était debout derrière elle. Après avoir vidé la bouteille, Tara s’écroula comme un château de cartes, elle était allongée par terre, ivre et complètement nue. Comme un jeune animal qui apprend à chasser, il avait abandonné sa proie, après avoir suffisamment joué avec elle. Chez Henriette l’inquiétude était palpable.
— Mamie, je pense que Tara a eu un problème, ce n’est pas normal ce retard. J’espère qu’elle ne sait pas fait mal. En plus, je ne peux pas l’appeler sur son portable, il est resté sur la table de la cuisine.
— Tu vas rester ici ma chérie et moi, je vais aller à sa rencontre.
Henriette se dirigea vers la forêt, sur le chemin, elle s’arrêtait de temps en temps pour appeler :« Tara ! Tu m’entends ? Réponds-moi ? » Mais hélas, elle n’avait aucune réponse. Les éclairs illuminaient d’un reflet bleuâtre la nature, le vent soufflait de plus en plus fort, une violente averse de pluie obligea Henriette à faire demi-tour. Une fois revenue dans sa maison, elle regarda sa petite fille en lui disant :
— J’espère que Tara est rentrée chez elle, appelle sa maman.
— Bonjour, c’est Christel, je vous appelle pour savoir si Tara est avec vous ?
— Non ! Elle n’est pas encore là, je pensais qu’elle était avec toi comme tous les jours.
— Elle était avec moi, mais comme je me suis un peu blessé sous le pied, mamie lui a demandé si elle voulait bien aller chercher une plante, ce qui nous inquiète, c’est que nous ignorons où elle se trouve en ce moment.
— Peut-être qu’elle a été se mettre à l’abri quand il y a eu l’orage, maintenant qu’il est passé, elle va rentrer.
Les minutes et les secondes étaient interminables. Au bout d’une demi-heure Tara n’était toujours pas rentré. Madame Louise Bradel arriva chez Christel.
— Bonsoir Henriette, avez-vous des nouvelles ?
— Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je lui ai demandé d’aller me chercher cette plante, si tu savais comme je regrette.
— Mais ! Mamie, Tara était tellement heureuse de nous rendre ce service.
Madame Bradel décida de prévenir la gendarmerie. Après avoir pris cette sage décision, le lieutenant de gendarmerie Patrice Morel se présenta chez Henriette Kidal.
— Bonjour Mesdames, je vais vous demander de bien m’expliquer ce qui se passe exactement.
Alors Christel commença le récit de sa journée avec Tara. Morel fut surpris que cette petite fille lui donne autant de précision.
— Je te remercie pour toutes ses informations. Mesdames, nous savons que personne n’a vu Tara depuis son départ, il ne me reste qu’une chose à faire, je rassemble tous mes hommes pour déclencher une battue.
— Attendez ! Je suis certaine que ma petite fille ne nous a pas dit toute la vérité. Je veux savoir ce que tu caches.
— Oui ! Tu as raison mamie, j’ai peur du vieux Monsieur.
— Quel vieux Monsieur ? Enfin, explique-toi ?
— Un jour, alors que Tara se faisait bronzer à la plage, un vieil homme s’est allongé près d’elle. Il a commencé à la caresser, j’ai réussi à lui faire peur en criant, il est parti très vite. Quand nous sommes revenues à la maison, peut-être qu’il s’est caché, pour nous suivre, c’est pour cela que j’ai peur. J’espère qu’il n’a pas enlevé Tara pour la séquestrer. Il y a aussi Jimmy qui peut faire du mal à Tara, elle l’a repoussé très souvent, même une fois, elle lui a donné une gifle. Il avait eu tellement honte qu’il avait frappé le mur avec sa main.
Il fallait agir rapidement avant que la nuit ne tombe. La battue fut organisée très vite, la maison d’Henriette était le point de départ. Chaque gendarme était à sa place, ils étaient appuyés par la présence d’un hélicoptère. Tout était inspecté minutieusement, les branches, les broussailles étaient soulevées. Tous les animaux prenaient la fuite. Ce n’est qu’une heure plus tard qu’un gendarme s’écria « J’ai trouvé des vêtements », c’était bien les habits de Tara Après cette découverte, les gendarmes commençaient à ressentir une grande inquiétude, à chaque nouveau pas, elle s’intensifiait. Dix minutes plus tard cette longue chaîne humaine, couleur kaki s’arrêta. Un silence oppressant s’était installé sur toute la forêt, quand tout à coup, on entendit « Venez tous par ici, nous l’avons trouvé. » Chez Madame Kidal, l’angoisse était permanente, insupportable. Le crépuscule du soir commençait à recouvrir la forêt. Christel s’était installée dans sa chambre, elle appuyait son front contre la fenêtre. Elle était très anxieuse ce qui accélérait sa respiration. De temps en temps avec sa main, elle essuyait le petit nuage de buée qui s’était formé sur la vitre. Une heure plus tard, la scène qui se déroulait sous ses yeux était terrifiante. Il y avait des gendarmes qui marchaient sur le côté gauche du chemin, d’autres qui marchaient sur le côté droit, le plus horrible était les quatre gendarmes qui se trouvaient au milieu du chemin. Ils portaient un sac housse de couleur noire. En regardant ces ombres qui semblaient être sorties d’un cauchemar, Christel ressentait une grande souffrance qui lui déchirait le cœur, la douleur était tellement forte qu’elle s’écroula sur le plancher. Très vite sa grand-mère lui porta secours. Pendant ce temps Morel frappait à la porte d’entrée. Henriette et Louise se précipitèrent pour aller ouvrir. Morel entra dans la pièce.
— Nous avons terminé les recherches. Je suis désolé Madame, nous avons retrouvé le corps de votre fille. Quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. Le légiste pense qu’elle est morte depuis plus d’une heure. Nous n’avons trouvé aucun indice, l’orage a tout effacé, tout détruit. Maintenant, Madame Bradel, il faut me suivre pour identifier votre fille. Afin d’établir avec certitude la cause de sa mort, le légiste effectuera une autopsie, si vous voulez obtenir une copie du rapport, il vous suffira d’écrire au procureur. Pour l’instant, nous gardons tous ses vêtements pour les besoins de l’enquête.
Louise était à genoux devant ce sac noir, la fermeture de celui-ci était ouverte jusqu’au niveau des épaules de Tara, elle embrassa sa fille sur les joues en hurlant de douleur, Henriette l’aida à se relever, Louise regarda son enfant en disant à Morel :
— Elle n’a plus son collier avec son hippocampe, je lui avais offert pour son anniversaire.
— Je suis désolé, Madame, mais la police scientifique n’a trouvé aucun collier, je vais demander que l’on élargisse la zone de recherche.
Christel s’était réfugiée sous ses couvertures, elle ne voulait plus voir, plus entendre, s’isoler de ce monde impitoyable où il existe encore des êtres humains qui vivent comme des bêtes, assoiffées de chair et de sang. Le lendemain, alors que la nuit commençait à tomber, elle voulut aller dans la chambre de Tara, pour revivre pendant quelques instants les bons moments qu’elles avaient passés ensemble. Quand elle arriva, l’intérieur de la maison de Bradel était éclairé avec des bougies, un court-circuit était à l’origine de cette panne de lumière. La porte vitrée du séjour était restée entrebâillée. Quand Christel voulut frapper contre la vitre, elle fut surprise de voir le papa de Tara attablé en compagnie de Monsieur George Marchand. Elle recula pour ne pas être vue, les deux hommes étaient face à face, un petit courant d’air faisait dandiner les flammes des bougies. Les deux ombres qui apparaissaient sur les murs, suivaient le rythme des flammes. Christel pouvait entendre toute la conversation, Marchand disait à Bradel : « Je suis venu le cœur serré, rempli de tristesse, je veux aussi vous apporter une aide financière en réglant la note des funérailles. » Louise commença à faire une génuflexion pour lui embrasser les mains en signe de remerciement. L’homme était venu pour tout autre chose.
— Mon cher Bradel, pouvez-vous me rendre un petit service ? Nous pouvons rester seuls ?
— Oui ! Louise, tu devrais aller ranger les assiettes dans la cuisine. Je vous écoute Monsieur Marchand, mais d’abord, il faut que je ferme cette porte vitrée.
Christel eut juste le temps de se mettre sur le côté de la maison, elle ne pouvait plus entendre la conversation des deux hommes. Quand elle regarda quelques minutes plus tard, Bradel et Marchand étaient debout, ils se serraient la main. Ne pouvant pas aller dans la chambre de Tara, elle rentra chez elle. De son côté Morel continuait son enquête, il voulait aussi connaître les résultats de l’autopsie. Il téléphona au légiste.
— Salut ! C’est Morel, je t’appelle pour avoir des informations sur la mort de Tara Bradel.
— Oui ! J’ai des résultats, elle avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang, elle était dans un coma éthylique, avec ses vomissements, elle s’est étouffée. À part ses poignets, elle n’avait aucun sévice corporel, elle n’a pas était violée, elle était vierge.
— Je te remercie, passe une bonne soirée, mon cher légiste.
Morel soupçonnait Rudy, il avait été arrêté plusieurs fois pour violence. Certaines filles avaient peur de lui. Rudy fut convoqué à la gendarmerie. Le jeune garçon se présenta, en mâchant un chewing-gum avec lequel il faisait de grosses bulles, il souriait d’une joue en regardant le lieutenant.
— Vous m’avez demandé de venir, Monsieur Morel, me voilà, pourquoi cette convocation ?
— Mon petit Marchand, tu vas arrêter de jouer les gros bras avec moi. Maintenant, tu prends place sur cette chaise et tu réponds à mes questions. Je veux que tu me dises ce que tu faisais le 21 août ? As-tu rencontré la petite Bradel ce jour-là ?
— Comment voulez-vous que je me souvienne du 21, c’était un jour de la semaine ? Un week-end ?
— C’était mercredi dernier, tu vois ce n’est pas si loin que cela. Tu as déjà eu des problèmes avec cette fille ? Surtout, tu prends ton temps pour répondre, réfléchis, si jamais tu as eu un coup de folie, une pulsion, ce jour-là, tu peux me le dire, tu n’as pas à t’inquiéter, si cela te dérange d’en parler, je te donne un stylo et une feuille de papier pour que tu puisses tout écrire.
— Oh ! Doucement, pourquoi toutes ces questions ? Ce n’est pas de ma faute ce qui s’est passé. Voilà, je me souviens, l’après-midi du 21 août, j’étais chez Tara, je donnais un coup de main à son père, il fallait remuer des meubles. Vous pouvez lui téléphoner, il vous le confirmera.
— Je vais le faire, regarde, je prends mon téléphone, je compose son numéro et voilà. « Bonjour, c’est le lieutenant Morel, le fils de Monsieur Marchand me dit que mercredi dernier, il était chez vous pour vous aider ? »
— Oui ! C’est exact, nous avons déplacé des armoires.
— Bon, je vous remercie, c’est tout ce que je voulais savoir.
Rudy regardait le plafond de la pièce, le sol, puis tout en soupirant, il s’adressa à Morel en lui disant :
— Alors ! Vous êtes satisfait ?, j’espère que vous avez compris, que pour moi, il m’était impossible d’agresser Tara, puisque je me trouvais chez elle. Vous m’avez soupçonné un peu trop vite, je vais en parler à mon père.
— Tu fais le fier, parce que tu as un bon alibi, fais bien attention à toi, Marchand, je vais te surveiller et à la prochaine bagarre, tu peux en être certain, je te coffre. Tu peux partir, je ne te retiens pas.
Pour Morel, l’enquête s’annonçait difficile, aucun indice, aucun témoin. Après de nombreuses recherches, de surveillances, sa patience fut récompensée. Il avait réussi à appréhender un individu qui correspondait au vieux Monsieur de la plage. Il avait dans les soixante-dix ans, il était de taille moyenne, son visage ressemblait à une pomme bien ronde, malgré son âge, ses cheveux étaient encore plus ou moins bruns, ils étaient, huileux, graisseux et coiffaient en arrière. Il avait de tout petit yeux, son nez était écrasé, il avait des lèvres très fines que sa langue blanchâtre, chargeait de bactéries venait lécher à chaque fin de phrase, pour finir, il avait sur lui, une forte odeur de transpiration. Fréquemment avec son mouchoir plus ou moins propre, il épongeait les gouttes de sueur qui dégoulinaient sur son front. Morel commença à interroger son suspect.
— Votre nom de famille est bien Ribote, votre prénom est Lucas, vous habitez, trente-six rues des fauvettes, à Arcachon.
— Oui, tout à fait Monsieur, c’est bien mon adresse.
— Je viens de regarder votre casier judiciaire, Ribote, il est très intéressant, à Bordeaux en 1982, vous avez écopé d’un an de prison avec sursis pour voyeurisme, à Montauban, en 1986, vous avez été condamné à cinq ans de prison pour attentat à la pudeur.
— Oui, j’ai honte de ce que j’ai fait, mais, ses cinq années de prison m’ont fait beaucoup de bien. Pendant tout ce temps, un psychologue s’est occupé de moi, maintenant, je suis devenu un autre homme.
— Je suis très heureux pour vous Ribote, puisque vous n’avez plus rien à cacher, on vous emmène chez vous, pour effectuer une perquisition.
Dans la maison de Ribote, une grande fouille commença. Le suspect était resté debout devant un grand miroir qui était fixé au mur. Morel était très énervé, il ne trouvait rien d’intéressant, pas le moindre indice qui pourrait faire avancer son enquête. Ribote tenait dans sa main un verre d’eau qui était à moitié rempli. Morel le regardait droit dans les yeux, c’est à ce moment-là qu’un gendarme, avec une voix de baryton, s’écria : « R.A.S. »Ribote, surpris par cette voix qui venait de mettre fin au silence qui s’était installé dans la pièce, lâcha son verre, qui tomba, sans se briser, sur le plancher, près de la plinthe. Morel fut surpris de voir l’eau du verre s’écouler aussi vite, Ribote transpirait de plus en plus, il s’essuyait, le front, la nuque, dans sa main tremblante, il tenait son mouchoir qui était à tordre comme une serpillière. Morel demanda à Ribote de se déplacer, puis il s’adressa à ses hommes.
— je suis certain qu’il y a un passage, aidez-moi à le trouver.
Ribote pris la parole :
— Ne vous fatiguez pas, derrière ce miroir, il y a une porte secrète, elle conduit à une ancienne cave qui est fermé depuis plusieurs années. Il faut que je vous prévienne, c’est peut-être dangereux de descendre les escaliers.
Morel lui répondit :
— Je vous remercie, Ribote, de vous inquiéter de notre santé, je demanderais au juge qu’il ne soit pas trop sévère avec vous.
Après avoir ouvert la porte qui était dissimulée derrière le miroir, Morel était prêt à descendre vers l’inconnu. Dans sa main gauche, il tenait une lampe torche, dans sa main droite, il avait son arme de service. Il posa un pied sur la première marche, puis il commença à descendre en appuyant son dos contre le mur, à la huitième marche, l’escalier se dirigeait vers la droite, une odeur d’encens s’était incrustée dans les murs et le plafond, Morel dirigea le rayon de lumière de sa lampe torche en direction de la dernière marche, qui se terminait sur une petite porte de couleur mauve, en ouvrant la porte, Morel marmonna : « Merde de merde », Ribote avait transformé sa cave, en une classe d’école. Il y avait deux bureaux d’élèves, dans les coins de la pièce, il y avait des lampes de chevet et un petit lit, au plafond, une boule lumineuse tournante. Trois petits mannequins de vitrine représentaient des élèves de sexe féminin. Ils avaient une perruque de couleurs différentes, leur visage était maquillé à outrance, ils étaient assis, les vêtements qu’ils portaient auraient pu servir aux femmes qui se promènent le soir sur les trottoirs près d’un hôtel de passe. « Venez me rejoindre avec Ribote » s’écria Morel. En descendant à la cave, les gendarmes, avaient l’impression d’entrer sur une scène de théâtre. Morel demanda à Ribote :
— Alors ! Lucas, pourquoi avoir monté ce décor ?
— Attendez ! Ce n’est pas ce que vous pouvez imaginer, depuis tout petit, j’ai toujours rêvé de devenir professeur, alors de temps en temps, je fais semblant de m’occuper de cette classe.
— Je veux bien te croire Lucas, mais, ce qui m’étonne, c’est de trouver dans les bureaux, des livres pornographiques et dans les trousses des élèves des objets, achetés, dans un sex-shop. À partir de maintenant vous êtes en garde à vue, Monsieur Ribote
De retour à la gendarmerie, Morel demanda à Madame Kidal de venir avec sa petite fille, pour identifier l’homme. Morel installa Christel derrière une glace sans tain.
— Est-ce que tu connais cet homme ? Surtout ne t’inquiète pas, il ne peut pas te voir.
— Mais ! C’est Lucas, pourquoi est-il là ?
— Tu connais ce Monsieur ?
— Oui, il est très gentil, on passait souvent devant chez lui avec Tara, il nous faisait rire, il nous racontait des histoires, il nous donnait des cerises et des pommes, à chaque fois, il nous invitait à boire une menthe à l’eau bien fraîche, alors, je lui répondais : « Non merci, pas aujourd’hui, peut-être une prochaine fois. »
— Vous avez bien fait de refuser ses invitations. J’étais pourtant certain que cet homme était le vieux Monsieur qui avait agressé Tara sur la plage. Bon, je vous remercie Madame Kidal d’être venue aussi vite avec Christel.
Morel retourna interroger Ribote :
— Lucas ! Il faut que tu me dises ce que tu faisais l’après-midi du 21 août, si tu ne veux pas répondre, il y a de fortes chances que tu sois mis en examen pour meurtre.
— Eh ! Doucement, je ne suis pas un assassin. Bon, d’accord, je vais vous dire où je me trouvais le 21 août. J’étais à la piscine municipale d’Arcachon, j’avais réussi à me cacher dans les douches des femmes. Comme les cloisons de séparations ne montent pas jusqu’au plafond, c’est très facile de voir ce qui se passe dans l’autre douche.
— Comme alibi, tu aurais pu trouver mieux, est-ce que quelqu’un t’a vu ?, une personne pourrait me confirmer ta présence à cette piscine ?
— Je vais vous dire quelque chose qui va prouver que j’étais bien présent dans les douches. Toutes les femmes ont hurlé, quand l’eau chaude a été coupée.
— Eh bien voilà, j’appelle la secrétaire de la piscine et je vais savoir si tu m’as dit la vérité. « Bonjour Madame, je suis le lieutenant de gendarmerie Morel. Une personne me dit que le 21 août, il y a eu un problème d’eau chaude dans les douches des femmes, vous pouvez vérifier s’il vous plaît. »
— Je vais pouvoir vous renseigner dans une minute, car le plus petit incident est enregistré sur un fichier, effectivement à seize heures quinze, le 21, l’eau chaude des douches a été coupée. Pourquoi ? Une personne est venue vous voir pour déposer une plainte ?
— Non, pas du tout, c’est pour le besoin d’une enquête, je vous remercie, les informations que vous m’avez données me sont suffisantes. Au revoir Madame.
Ce fut une grande déception pour Morel, maintenant, il savait que Ribote ne lui avait pas menti et que son alibi tenait la route. Morel était déterminé à arrêter le responsable de ce terrible drame. Il décida de lancer un appel à témoins. Trois jours plus tard, Madame Juliette Lambert, âgée de quatre-vingt-cinq ans, se présenta à la gendarmerie. Morel lui proposa de s’asseoir.
— Je vous écoute, Madame.
— Eh bien voilà, Monsieur, l’après-midi du 21 août, j’allais chez Henriette Kidal me chercher une tisane qu’elle m’avait préparée, elle est formidable cette femme, elle a un savoir-faire incroyable pour mélanger les plantes.
— Vous avez sûrement raison Madame, mais, le plus important pour moi est de savoir ce que vous avez vu.
— Oui, pardon, je continue, en arrivant près de la maison de Bradel, il y avait un garçon qui était derrière un arbre, peut-être qu’il se cachait, ou alors il urinait. Il avait une veste grise, une capuche lui recouvrait le visage, je ne suis pas certaine, mais, je pense que c’était le petit Jimmy Dorian.
— Je vous remercie, Madame, nous allons vérifier tout ceci.
Après ce témoignage, il demanda une commission rogatoire pour effectuer une perquisition chez Dorian. C’est la maman de Jimmy qui ouvrit la porte à Morel.
— Bonjour, Madame, ou se trouve votre fils en ce moment ?
— Il est dans sa chambre, je vais aller le chercher.
— Non ! Je préfère que vous restiez là, montrez-moi la porte de sa chambre s’il vous plaît.
— C’est la bleue, au fond du couloir, faites doucement, surtout, ne lui faites pas de mal.
Morel entra sans frapper pour surprendre Jimmy. Le garçon eut la plus grande peur de sa vie, d’un bon, il sauta de son lit en jetant son casque audio sur le sol.
— Nous sommes là pour effectuer une perquisition, tu n’as pas à avoir peur. Je voudrais savoir ce que tu faisais le 21 août.
— Euh, je crois que j’étais ici, je regardais des clips sur mon ordinateur, ensuite, je me suis amusé sur ma console.
Pendant ce temps, les gendarmes vidaient les meubles de tout leur contenu. Ils ne trouvaient rien de suspect. Jimmy avait un petit bureau sur lequel il y avait son ordinateur, mais aussi, beaucoup de désordre, des crayons cassés, des DVD, des feuilles de papier, déchirées, froissées, la poussière faisait partie du meuble, pour finir un doudou d’enfant se trouvait là. Morel pris place sur la chaise et alluma l’ordinateur. Il n’y avait rien de particulier sur le disque dur. Morel se leva en prenant le doudou, il sentit quelque chose de dur à l’intérieur, il n’hésita pas une seconde, il ouvrit le ventre du doudou. « En voilà une surprise, une clé USB, un collier avec un magnifique hippocampe, très intéressant », s’exclama Morel. Le contenu de la clé USB était surprenant, il y avait des photos, sur lesquelles Jimmy avait fait des montages. Tara était photographiée les seins nues, Morel regarda Jimmy.
— Eh bien ! Bravo mon garçon, je commence à comprendre ce qui s’est passé. Tu as vu Tara qui était seule sur le chemin, tu as voulu profiter de cette occasion pour l’embrasser, elle t’a repoussé, comme tu avais bu, tu n’as pas pu te maîtriser, alors tu as voulu la violer, mais juste à ce moment-là, tu as entendu quelqu’un qui appelait Tara, ce qui a interrompu ton agression. Certaines personnes m’ont dit, que le soir, tu te promenais souvent autour de la maison de Bradel.
— Non ! C’est complètement faux, je l’aimais trop pour lui faire du mal, quand j’allais devant chez elle, je ne me cachais pas, je n’avais aucune raison de le faire. Elle le savait parce que de temps en temps, quand elle m’apercevait, elle me souriait, même si parfois, elle m’a repoussé, je savais que dans son cœur, j’avais une place importante. Je pense qu’elle avait peur de cet amour et je suis certain qu’elle s’est interdit de m’aimer. Pour le collier, j’ignorais complètement qu’il était dans le doudou, depuis la mort de Tara, je n’ai plus touché à la clé USB.
Il essuya ses larmes avec le revers de sa main, son visage devenait de plus en plus blanc, il commença à comprendre que Morel allait l’accuser de meurtre, il courut vers la chambre de son père, il eut juste le temps de fermer la porte à double tour, de prendre deux cartouches et de les introduire dans le fusil de son père. Morel arriva très vite avec ses hommes, il enfonça la porte d’un grand coup de pied, Jimmy perdu son sang-froid et tira un coup de feu en direction de Morel qui tomba à terre, blessé à l’épaule. Le gendarme Clément tira sur Jimmy, le garçon reçut la balle en plein cœur. Tous les habitants avaient été choqués d’apprendre la mort des deux enfants. Pour Tara, une marche blanche avait été organisée. Pour l’enterrement de Jimmy, il n’y avait que trois personnes, la mère, le père, Rudy. Les jours suivants, Christel tomba malade, son chagrin était trop fort, la nuit, en regardant les étoiles, elle appelait ses parents. « Aidez-moi, je vous en supplie, j’aurais tellement aimé vous avoir près de moi. » Elle ne leur lançait plus des bisous par la fenêtre, mais des larmes, qui inondaient le creux de ses mains. Les cauchemars étaient de plus en plus nombreux. Henriette ne supportait plus de voir sa petite fille malheureuse, elle décida de tout vendre pour l’emmener vivre au Canada, c’était le rêve des deux enfants, partir à l’étranger. Après avoir obtenu tous les papiers pour vivre au Québec, le moment des adieux était venu. Henriette et sa petite fille étaient chez la maman de Tara Pour une dernière fois, Christel regarda la chambre de sa meilleure amie. Pendant ce temps, les deux femmes discutaient, les yeux remplis de larmes. Christel attendait sa grand-mère, c’est à ce moment-là qu’elle aperçut sur le buffet de la salle de séjour, la copie du rapport d’autopsie.
— Madame Louise, je peux regarder le contenu du document, s’il vous plaît ?
— Je veux bien, mais j’ai peur que cela te fasse du mal ma chérie.
— Ne vous inquiétez pas, je sais de quelle façon Tara est morte, j’ai regardé le journal télévisé, j’ai pu suivre toute l’enquête.
Elle commença à lire, puis au bout d’un petit moment, elle leva la tête, elle se mit à trembler, elle était frappée de stupeur, une grande colère envahissait son corps, la haine qu’elle ressentait lui apportait un immense besoin de vengeance. Elle venait de découvrir l’identité de la personne qui avait provoqué la mort de Tara. Elle garda pour elle cette découverte, Henriette et Louise ne c’étaient aperçues de rien. Le lendemain Christel et sa grand-mère prenaient l’avion à destination du Canada. Plus de vingt-ans après ces faits divers, les gens qui avaient participé à la marche blanche, sont restés muets sur ce drame, ils ne voulaient surtout pas remuer la saleté. Un an après la mort de leur fille Monsieur et Madame Bradel ont fait construire un magnifique chalet. Certaines personnes racontent que Bradel aurait hérité d’une belle somme d’argent. Malheureusement, Louise décéda quatre ans plus tard d’un cancer. Son mari est resté seul, il n’a jamais voulu refaire sa vie avec une autre femme. Il lui arrivait parfois de louer une chambre de son chalet. C’était au début du printemps, une jeune femme se présenta chez Bradel. Elle était rousse, ses yeux noisette, sur son visage, elle avait des petites taches de rousseur, ses cheveux étaient frisés, elle était habillée comme une vieille fille. Elle appuya avec son index sur le bouton de la sonnette, en ouvrant la porte Bradel regarda par deux fois le visage, de cette femme.
— Bonjour, Madame, puis-je vous aider ?
— Bonjour, Monsieur, je suis Mademoiselle Juliette Trocart, j’ai appris qu’il était possible de louer une chambre dans votre magnifique chalet, je voudrais savoir si elle est libre en ce moment ?
— Vous avez de la chance, elle n’est pas occupée, puis-je savoir pour combien de temps ?
— C’est très difficile de vous répondre, j’arrive de Bretagne pour régler certaines affaires et je ne sais pas combien de temps cela va me prendre. Pour vous rassurer, je peux vous donner un mois de loyer d’avance.
— D’accord, j’accepte, si cela ne vous dérange pas, je ne veux pas de chèque, je préfère avoir de l’argent liquide. Je vais m’assurer que tout est bien en ordre et dans le courant de l’après-midi, la chambre sera à votre disposition. Ah ! Je voulais vous prévenir, le soir, il m’arrive de sortir et de revenir très tard dans la nuit, alors ne vous inquiétez pas, je me ferais discret.
Vers quinze heures quarante, Juliette entra dans la chambre, elle posa sa valise sur le lit. Les premiers jours, elle observait, elle notait, l’heure du départ et l’heure du retour de Bradel. L’homme était régulier dans ses allées et venues. Un jour, sachant qu’elle était seule, elle entra dans la chambre de son propriétaire. Elle commença à regarder dans la table de nuit, l’armoire, la commode. Dans le tiroir du bureau, il y avait, une interdiction bancaire, une lettre de mise en demeure. La jeune femme commençait à comprendre que Bradel se trouvait dans une situation plutôt inquiétante. Un soir, elle décida de le suivre. L’homme entra dans une maison, Juliette parvint à observer l’intérieur d’une pièce, ils étaient plusieurs assis autour d’une table ronde, ils s’apprêtaient à disputer une partie de poker. Cette nuit-là, personne n’a pu savoir ce qui s’était vraiment passé. Il était quatre heures du matin, quand le chalet de Bradel fut entièrement détruit par un incendie. La douleur de cet homme avait été tellement forte, qu’on le retrouva pendu, il s’était donné la mort avec la corde d’une balançoire qui se trouvait dans un jardin d’enfants. Quant à Juliette Trocart, elle avait disparu sans laisser aucune trace. Pour George Marchand, sa retraite se passait plutôt bien, il faisait des voyages, il allait souvent jouer des petites sommes d’argent dans les casinos, il rencontrait aussi des jeunes femmes qui étaient à la recherche d’un homme au grand cœur, avec surtout un gros portefeuille. Il aimait s’afficher avec ce genre de femmes. Souvent vers le milieu de la nuit, il disparaissait avec une d’entre elles. Un matin, alors qu’il était seul à prendre son petit-déjeuner sur la terrasse, une femme complètement effrayée arriva. C’était une brune aux cheveux longs, son chemisier était très ouvert, sa jupe était vraiment courte. Elle se jeta sur Marchand en criant :
— Aidez-moi ! Je vous en prie, un homme me suit, j’ai très peur, vous pouvez regarder s’il est toujours là.
Marchand posa son bol de café au lait sur la table, se leva pour aller voir. Après cinq minutes d’observation, il revint vers la belle inconnue en lui disant :
— Madame, j’espère vous tranquilliser, la rue est entièrement déserte, puis-je vous servir un verre d’eau ? Prenez donc cette chaise et asseyez-vous, le temps de vous calmer un peu.
— Je vous remercie, je vais m’asseoir, cela va me faire du bien, peut-être que je me suis affolée un peu trop vite. Mon pauvre Monsieur, par ma faute, votre café au lait va être froid, il faudrait vous dépêcher à le boire.
— Ah ! Il est juste comme je l’aime, heureusement pour moi, il était très chaud.
— Je vais vous laisser Monsieur, mille fois merci pour votre gentillesse.
— Voulez-vous que je vous ramène chez vous ? Vous préférez que j’appelle un taxi ?
— Non merci, ce n’est pas nécessaire, j’ai garé ma voiture dans la rue qui se trouve tout près de chez vous. J’ai trouvé le quartier tellement joli que je me suis arrêtée pour me promener, je pense que l’homme m’a aperçu, puis il m’a suivi, pour quelle raison je l’ignore complètement.
Marchand ne regardait pas le visage de cette femme qui était pourtant magnifique, il préférait lui regarder les jambes, qu’elle croisait et décroisait lentement. Soudain, elle se leva :
— Je suis désolé, j’ai oublié que j’avais un rendez-vous très important. Adieu ! Monsieur.
Elle s’éclipsa comme elle était apparue. Deux heures plus tard le téléphone de Rudy Marchant sonna. Rudy était devenu l’homme d’affaires que son père avait souhaité, il avait modernisé tous ses hôtels, sa clientèle était très importante. Il était célibataire, il préférait avoir des aventures sans lendemain. Il décrocha son téléphone.
— Allô ! Monsieur Rudy Marchand ?
— Oui, je vous écoute.
— Je suis le Docteur Glaireux, votre père m’a appelé, il ne se sentait pas bien, quand je suis arrivé, il était allongé sur le sol, j’ai fait tout mon possible pour le ranimer. Je suis désolé, votre père a fait un infarctus.
Rudy ne comprenait pas pourquoi son père avait eu cette crise cardiaque, il y a peu de temps, il avait passé un bilan de santé, les résultats des examens étaient plutôt satisfaisants, pour un homme de cet âge. Les funérailles avaient eu lieu trois jours plus tard, c’était un matin, il y avait un soleil magnifique. Pour certaines personnes, la mort de Marchand, les soulageaient, elles ne ressentaient plus cette peur que l’homme avait installé dans leur esprit. À la fin des funérailles, Rudy était resté seul devant le caveau, il avait envie de murmurer quelques mots d’adieu à son papa. Un mois plus tard Rudy se préparait pour aller inspecter ses hôtels, il le faisait tous les vendredis, il voulait que tout soit parfait pour le week-end. Ce jour-là, après avoir roulé pendant dix minutes, il aperçut une très jolie femme qui lui faisait des signes, elle avait garé son véhicule sur le côté de la route. Marchand s’arrêta.
— Bonjour Madame, puis-je vous aider ?
— Je suis en panne, pouvez-vous regarder ce qui se passe ?
— Je suis désolé, Madame, les moteurs ce n’est vraiment pas une grande passion, pour moi, ce que je peux vous proposer, c’est de vous ramener chez vous.
— Eh bien, j’accepte, mais je n’habite pas dans cette ville, je suis de passage à Arcachon, j’ai pris une chambre à l’hôtel « Beau Rivage » vous connaissez ?
— Oui ! Je suis le propriétaire de cet hôtel, je me présente, Monsieur Rudy Marchand. Je préviens mon garagiste pour qu’il vienne chercher votre voiture. Attendez ! Permettez-moi de vous ouvrir la portière, si le siège est trop prés, je peux vous le reculez.
— Non, c’est parfait, je m’appelle Alice Castel, je suis dans la chambre 21 qui se trouve du côté de la rue.
— Bon ! Je vais demander que l’on vous installe dans la chambre 12, vous aurez une magnifique vue sur le Bassin d’Arcachon, son prix sera exactement le même que la 21.
— Vous êtes très aimable et je vous en remercie, je suis heureuse que des hommes comme vous existent encore.
C’était une femme qui avait beaucoup de charme, elle était irrésistible, mais autour de cette beauté, il y avait du mystère. Quelques jours plus tard, après avoir profité de sa belle chambre, elle décida d’appeler la réception.
— Bonjour, je suis Madame Castel, puis-je parler à Monsieur Marchand s’il vous plaît ?
— Désolé ! Mais Monsieur ne se trouve pas à l’hôtel, il vient que le vendredi.
— J’ai besoin de lui parler, il faudrait qu’il passe me voir vendredi matin. Surtout que cela ne le dérange pas.
— Très bien, Madame, je l’informerais dès son arrivée.
Le vendredi matin, Rudy était devant la porte 12, il frappa trois petits coups.
— Entrez, la porte est ouverte.
Quand il entra dans la chambre, il fut émerveillé et surpris, les rayons du soleil passaient au travers de la chemise de nuit de Madame Castel laissant apparaître les magnifiques formes de son corps. Très vite, elle se dirigea vers la salle de bains pour mettre un peignoir.
— Bonjour, Madame, ma secrétaire m’a dit que vous vouliez me parler.
— Oui, il faut que je vous explique, j’ai un diplôme d’herboriste et je cherche un local pour m’installer, votre aide me serait très utile.
— Avec plaisir, j’ai beaucoup de relations, je peux aussi vous faire de la publicité dans mes hôtels, si cela peut vous rendre service.
— Ah ! En voilà, une bonne idée Monsieur Marchand, avec vous à mes côtés, je suis certaine de réussir. Je suis tellement heureuse que je voudrais vous remercier, j’ai très envie de vous préparer mon infusion magique. Alors, si vous êtes libre, je vous invite à venir ici vers seize heures. Je suis certaine de vous surprendre.
— J’accepte votre invitation, avec plaisir, c’est moi qui offre les gâteaux, d’accord ?
— Non, ce n’est pas nécessaire, je pense que mon infusion sera largement suffisante.
Rudy était tout excité, c’était pour lui une chance merveilleuse qui se présentait à lui, il voulait tellement séduire cette femme. Il se présenta à seize heures, avec une rose à la main.
— Félicitations, Monsieur Marchand, vous êtes réglé comme une horloge, en plus, vous arrivez avec une fleur dans la main, elle est magnifique, je vous en pris, installez-vous dans le fauteuil. Je vous présente la mallette qui contient toutes les tisanes que j’ai réalisées, elles peuvent vous soulager en quelques minutes. Voici celle que je vais vous préparer, c’est mon petit bijou.
— Madame Castel, vos sachets sont magnifiques, leurs couleurs de photos anciennes sont agréables à regarder, quand vous avez ouvert votre mallette, un délicieux parfum s’est répandu dans toute la chambre, j’avais l’impression de me promener dans un champ de fleurs.
— Merci, c’est gentil, j’ai toujours avec moi ma petite machine à infusion. C’est parfait ! Elle est prête, je vous laisse déguster ce breuvage, pendant ce temps, je range toutes mes affaires.
— Mon Dieu ! Quelle saveur exquise, c’est vraiment un régal.
— Surtout, Monsieur Marchand restez assis pendant un petit moment, car l’effet de l’infusion est instantané et il peut provoquer un léger vertige.
— Madame ! Je crois que j’ai une mauvaise réaction, je ressens dans les bras et les jambes une douleur, j’ai beaucoup de mal à bouger. Que se passe-t-il, ? C’est normal, ? La douleur est de plus en plus forte.
— Tu vas tout comprendre, Rudy, regarde-moi bien ! J’enlève ma perruque, je retire mes verres de contact de couleur bleue, tu me reconnais maintenant ?
— Oui ! Je me souviens de toi, Christel Kidal, mais pourquoi ce déguisement ? J’ai très mal, je ne peux plus bouger, il me faut une ambulance.
— Je vais t’expliquer ce qui va se passer, mon infusion est redoutable, elle s’appelle, « Une tisane pour l’enfer » Jusqu’à la fin, tu vas pouvoir parler, mais ton corps sera paralysé, pour finir, tu vas avoir une foudroyante crise cardiaque. Heureusement, pour toi, dans cette fiole se trouve l’antidote. Si jamais tu as envie de crier pour que quelqu’un vienne te porter secours, sous tes yeux, je vide la fiole. Je suis revenue pour que tu me racontes ce qui s’est vraiment passé avec Tara.
— Comment veux-tu que je te raconte, je n’étais pas avec Jimmy, c’est lui qui a tout fait, ce jour-là, il a complètement perdu la tête.
— Rudy, tu devrais faire attention, les minutes passent, je suis certaine que Jimmy n’a fait aucun mal à Tara, puisque c’est toi qui étais avec elle ce jour-là.
— Ma pauvre Christel, tu délires complètement, tu es folle. Ce jour-là, j’étais chez elle, son père l’a confirmé aux gendarmes.
— Écoute ce que je vais te dire, espèce de dégénéré. Quand la maman de Tara m’a permis de regarder le rapport d’autopsie, j’ai très vite compris que Tara t’accusait. Le légiste avait noté qu’elle avait les doigts croisés. C’était notre signe, à chaque fois que tu étais présent, on le faisait. Tu comprends sale ordure ? Maintenant, je prends la fiole, regarde bien ce que je fais, je retire le bouchon et je commence à faire tomber quelques gouttes.
— Arrête ! Tu as gagné, ce n’était pas ce pauvre Jimmy. Je voulais juste effrayer Tara et puis tout a basculé dans la tragédie.
— Mais, pourquoi ? Tu avais bien une raison ? Je veux que tu me dises toute la vérité.
— Ce jour-là, je m’étais installé derrière un arbre, dans la main, je tenais une seringue, il fallait que je fasse vite, j’étais vraiment en manque. Quand je me suis piqué le bras, j’ai aperçu Tara, j’ai compris qu’elle m’avait vu me droguer, j’ai voulu lui faire peur, je ne voulais pas que tout le monde soit au courant, si tu savais comme je regrette. Quand je suis parti, elle était vivante, l’orage a éclaté, je suis revenu vers elle, quand je me suis aperçu qu’elle ne respirait plus, j’ai ramassé la bouteille, le bout filtre de ma cigarette. Je ne voulais pas laisser de trace, j’ai caché ses vêtements sous un tas de feuilles, après j’ai paniqué, j’ai perdu mon sang-froid, je ne sais pour quelle raison j’ai pris son collier et je me suis enfui. Ensuite, j’ai tout raconté à mon père, il m’a demandé d’aller dans la chambre de Jimmy pour y déposer le collier, ce que j’ai fait, je connaissais la cachette dans son doudou.
— Te fatigue pas, Rudy, la suite, je la connais très bien, ton père a demandé au papa de Tara qu’il te fournisse un alibi, j’étais là quand il lui a donné son argent sale. À propos ! Ton père, lui non plus n’a pas bien supporté les gouttes de tisane que je lui ai versées dans son café. Pour celui de Tara, cette espèce d’ordure, j’ai préféré lui brûler son rêve. Quand il a accepté l’argent de ton père, j’ai pensé que cet homme vendait l’âme de sa fille.
— Christel ! Donne-moi la fiole, j’ai beaucoup de mal à respirer, j’ai très mal à la poitrine.
— Eh bien ! Prends-la Rudy, oh ! Pardon, j’oubliais que tu ne peux plus bouger, ce n’est pas grave, je vais boire son contenu à ta place, je suis certaine que l’eau qui se trouve à l’intérieur est excellente. À ta santé ! Rudy.
Quelques secondes plus tard, Rudy mourrait d’une crise cardiaque. Madame Castel aurait dit aux pompiers, qu’elle avait essayé de le ranimer avant de les appeler. Le lendemain Christel Kidal s’envola pour le Canada pour ne jamais plus revenir en France.
François Maillet.
 votre commentaire
votre commentaire
-
L'Oiseau bleu
Madame d'Aulnoy

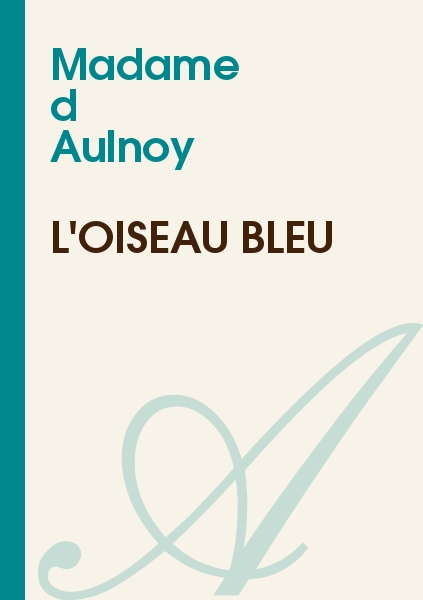
Il était une fois un roi fort riche en terres et en argent ; sa femme mourut, il en fut inconsolable. Il s’enferma huit jours entiers dans un petit cabinet, où il se cassait la tête contre les murs, tant il était affligé. On craignit qu’il ne se tuât : on mit des matelas entre la tapisserie et la muraille ; de sorte qu’il avait beau se frapper, il ne se faisait plus de mal. Tous ses sujets résolurent entre eux de l’aller voir et de lui dire ce qu’ils pourraient de plus propre à soulager sa tristesse. Les uns préparaient des discours graves et sérieux, d’autres d’agréables, et même de réjouissants ; mais cela ne faisait aucune impression sur son esprit : à peine entendait-il ce qu’on lui disait. Enfin, il se présenta devant lui une femme si couverte de crêpes noirs, de voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui pleurait et sanglotait si fort et si haut, qu’il en demeura surpris. Elle lui dit qu’elle n’entreprenait point comme les autres de diminuer sa douleur, quelle venait pour l’augmenter, parce que rien n’était plus juste que de pleurer une bonne femme ; que pour elle, qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son compte de pleurer tant qu’il lui resterait des yeux à la tête. Là-dessus elle redoubla ses cris, et le roi, à son exemple, se mit à hurler.
Il la reçut mieux que les autres ; il l’entretint des belles qualités de sa chère défunte, et elle renchérit celles de son cher défunt : ils causèrent tant et tant, qu’ils ne savaient plus que dire sur leur douleur. Quand la fine veuve vit la matière presque épuisée, elle leva un peu ses voiles, et le roi affligé se récréa la vue à regarder cette pauvre affligée, qui tournait et retournait fort à propos deux grands yeux bleus, bordés de longues paupières noires : son teint était assez fleuri.
Le roi la considéra avec beaucoup d’attention ; peu à peu il parla moins de sa femme, puis il n’en parla plus du tout. La veuve disait qu’elle voulait toujours pleurer son mari ; le roi la pria de ne point immortaliser son chagrin. Pour conclusion, l’on fut tout étonné qu’il l’épousât, et que le noir se changeât en vert et en couleur de rose : il suffit très souvent de connaître le faible des gens pour entrer dans leur cœur et pour en faire tout ce que l’on veut.
Le roi n’avait eu qu’une fille de son premier mariage, qui passait pour la huitième merveille du monde, on la nommait Florine, parce qu’elle ressemblait à Flore, tant elle était fraîche, jeune et belle. On ne lui voyait guère d’habits magnifiques ; elle aimait les robes de taffetas volant, avec quelques agrafes de pierreries et force guirlandes de fleurs, qui faisaient un effet admirable quand elles étaient placées dans ses beaux cheveux. Elle n’avait que quinze ans lorsque le roi se remaria.
La nouvelle reine envoya quérir sa fille, qui avait été nourrie chez sa marraine, la fée Soussio ; mais elle n’en était ni plus gracieuse ni plus belle : Soussio y avait voulu travailler et n’avait rien gagné ; elle ne laissait pas de l’aimer chèrement. On l’appelait Truitonne, car son visage avait autant de taches de rousseur qu’une truite ; ses cheveux noirs étaient si gras et si crasseux que l’on n’y pouvait toucher, sa peau jaune distillait de l’huile. La reine ne laissait pas de l’aimer à la folie ; elle ne parlait que de la charmante Truitonne, et, comme Florine avait toutes sortes d’avantages au-dessus d’elle, la reine s’en désespérait ; elle cherchait tous les moyens possibles de la mettre mal auprès du roi.
Il n’y avait point de jour que la reine et Truitonne ne fissent quelque pièce à Florine. La princesse, qui était douce et spirituelle , tâchait de se mettre au-dessus des mauvais procédés.
Le roi dit un jour à la reine que Florine et Truitonne étaient assez grandes pour être mariées, et qu’aussitôt qu’un prince viendrait à la cour, il fallait faire en sorte de lui en donner une des deux.
« Je prétends, répliqua la reine, que ma fille soit la première établie : elle est plus âgée que la vôtre, et, comme elle est mille fois plus aimable, il n’y a pas à balancer là-dessus. » Le roi, qui n’aimait point la dispute, lui dit qu’il le voulait bien et qu’il l’en faisait la maîtresse.
A quelque temps de là, on apprit que le roi Charmant devait arriver. Jamais prince n’avait porté plus loin la galanterie et la magnificence ; son esprit et sa personne n’avaient rien qui ne répondît à son nom. Quand la reine sut ces nouvelles, elle employa tous les brodeurs, tous les tailleurs et tous les ouvriers à faire des ajustements à Truitonne. Elle pria le roi que Florine n’eût rien de neuf, et, ayant gagné ses femmes, elle lui fit voler tous ses habits, toutes ses coiffures et toutes ses pierreries le jour même que Charmant arriva, de sorte que, lorsqu’elle se voulut parer, elle ne trouva pas un ruban. Elle vit bien d’où lui venait ce bon office. Elle envoya chez les marchands pour avoir des étoffes ; ils répondirent que la reine avait défendu qu’on lui en donnât. Elle demeura donc avec une petite robe fort crasseuse, et sa honte était si grande, qu’elle se mit dans le coin de la salle lorsque le roi Charmant arriva.
La reine le reçut avec de grandes cérémonies : elle lui présenta sa fille, plus brillante que le soleil et plus laide par toutes ses parures qu’elle ne l’était ordinairement. Le roi en détourna ses yeux : la reine voulait se persuader qu’elle lui plaisait trop et qu’il craignait de s’engager, de sorte qu’elle la faisait toujours mettre devant lui. Il demanda s’il n’y avait pas encore une autre princesse appelée Florine. « Oui, dit Truitonne en la montrant avec le doigt ; la voilà qui se cache, parce qu’elle n’est pas brave. »
Florine rougit, et devint si belle, si belle, que le roi Charmant demeura comme un homme ébloui. Il se leva promptement, et fit une profonde révérence à la princesse : « Madame, lui dit-il, votre incomparable beauté vous pare trop pour que vous ayez besoin d’aucun secours étranger.
— Seigneur, répliqua-t-elle, je vous avoue que je suis peu accoutumée à porter un habit aussi malpropre que l’est celui-ci ; et vous m’auriez fait plaisir de ne vous pas apercevoir de moi.
— Il serait impossible, s’écria Charmant, qu’une si merveilleuse princesse pût être en quelque lieu, et que l’on eût des yeux pour d’autres que pour elle.
— Ah ! dit la reine irritée, je passe bien mon temps à vous entendre. Croyez-moi, seigneur, Florine est déjà assez coquette, et elle n’a pas besoin qu’on lui dise tant de galanteries. »
Le roi Charmant démêla aussitôt les motifs qui faisaient ainsi parler la reine ; mais, comme il n’était pas de condition à se contraindre, il laissa paraître toute son admiration pour Florine, et l’entretint trois heures de suite.
La reine au désespoir, et Truitonne inconsolable de n’avoir pas la préférence sur la princesse, firent de grandes plaintes au roi et l’obligèrent de consentir que, pendant le séjour du roi Charmant, l’on enfermerait Florine dans une tour, où ils ne se verraient point. En effet, aussitôt qu’elle fut retournée dans sa chambre, quatre hommes masqués la portèrent au haut de la tour, et l’y laissèrent dans la dernière désolation ; car elle vit bien que l’on n’en usait ainsi que pour l’empêcher de plaire au roi qui lui plaisait déjà fort, et qu’elle aurait bien voulu pour époux.
Comme il ne savait pas les violences que l’on venait de faire à la princesse, il attendait l’heure de la revoir avec mille impatiences. Il voulut parler d’elle à ceux que le roi avait mis auprès de lui pour lui faire plus d’honneur ; mais, par l’ordre de la reine, ils lui dirent tout le mal qu’ils purent : qu’elle était coquette, inégale, de méchante humeur ; qu’elle tourmentait ses amis et ses domestiques, qu’on ne pouvait être plus malpropre, et qu’elle poussait si loin l’avarice, quelles aimait mieux être habillée comme une petite bergère, que d’acheter de riches étoffes de l’argent que lui donnait le roi son père. A tout ce détail, Charmant souffrait et se sentait des mouvements de colère qu’il avait bien de la peine à modérer. « Non, disait-il en lui-même, il est impossible que le Ciel ait mis une âme si mal faite dans le chef-d’œuvre de la nature.
Je conviens qu’elle n’était pas proprement mise quand je l’ai vue, mais la honte qu’elle en avait prouve assez qu’elle n’était point accoutumée à se voir ainsi. Quoi ! elle serait mauvaise avec cet air de modestie et de douceur qui enchante ? Ce n’est pas une chose qui me tombe sous le sens ; il m’est bien plus aisé de croire que c’est la reine qui la décrie ainsi : l’on n’est pas belle-mère pour rien ; et la princesse Truitonne est une si laide bête, qu’il ne serait point extraordinaire qu’elle portât envie à la plus parfaite de toutes les créatures. »
Pendant qu’il raisonnait là-dessus, des courtisans qui l’environnaient devinaient bien à son air qu’ils ne lui avaient pas fait plaisir de parler mal de Florine. Il y en eut un plus adroit que les autres, qui, changeant de ton et de langage pour connaître les sentiments du prince, se mit à dire des merveilles de la princesse. À ces mots il se réveilla comme d’un profond sommeil, il entra dans la conversation, la joie se répandit sur son visage. Amour, amour, que l’on te cache difficilement ! tu parais partout, sur les lèvres d’un amant, dans ses yeux, au son de sa voix ; lorsque l’on aime, le silence, la conversation, la joie ou la tristesse, tout parle de ce qu’on ressent.
La reine, impatiente de savoir si le roi Charmant était bien touché, envoya quérir ceux qu’elle avait mis dans sa confidence, et elle passa le reste de la nuit à les questionner. Tout ce qu’ils lui disaient ne servait qu’à confirmer l’opinion où elle était, que le roi aimait Florine. Mais que vous dirai-je de la mélancolie de cette pauvre princesse ? Elle était couchée par terre dans le donjon de cette horrible tour où les hommes masqués l’avaient emportée.
« Je serais moins à plaindre, disait-elle, si l’on m’avait mise ici avant que j’eusse vu cet aimable roi : l’idée que j’en conserve ne peut servir qu’à augmenter mes peines. Je ne dois pas douter que c’est pour m’empêcher de le voir davantage que la reine me traite si cruellement. Hélas ! que le peu de beauté dont le Ciel m’a pourvue coûtera cher à mon repos ! » Elle pleurait ensuite si amèrement, si amèrement que sa propre ennemie en aurait eu pitié si elle avait été témoin de ses douleurs.
C’est ainsi que la nuit se passa. La reine, qui voulait engager le roi Charmant par tous les témoignages qu’elle pourrait lui donner de son attention, lui envoya des habits d’une richesse et d’une magnificence sans pareille, faits à la mode du pays, et l’ordre des chevaliers d’Amour qu’elle avait obligé le roi d’instituer le jour de leurs noces. C’était un cœur d’or émaillé de couleur de feu, entouré de plusieurs flèches, et percé d’une, avec ces mots : Une seule me blesse. La reine avait fait tailler pour Charmant un cœur d’un rubis gros comme un œuf d’autruche ; chaque flèche était d’un seul diamant, longue comme le doigt, et la chaîne où ce cœur tenait était faite de perles, dont la plus petite pesait une livre : enfin, depuis que le monde est monde, il n’avait rien paru de tel.
Le roi, à cette vue, demeura si surpris qu’il fut quelque temps sans parler. On lui présenta en même temps un livre dont les feuilles étaient de vélin, avec des miniatures admirables, la couverture d’or, chargée de pierreries ; et les statuts de l’ordre des chevaliers d’Amour y étaient écrits d’un style fort tendre et fort galant. L’on dit au roi que la princesse qu’il avait vue le priait d’être son chevalier, et qu’elle lui envoyait ce présent.
À ces mots, il osa se flatter que c’était celle qu’il aimait.
« Quoi ! la belle princesse Florine, s’écria-t-il, pense à moi d’une manière si généreuse et si engageante ?
— Seigneur, lui dit-on, vous vous méprenez au nom, nous venons de la part de l’aimable Truitonne.
— C’est Truitonne qui me veut pour son chevalier ? dit le roi d’un air froid et sérieux : je suis fâché de ne pouvoir accepter cet honneur ; mais un souverain n’est pas assez maître de lui pour prendre les engagements qu’il voudrait. Je sais ceux d’un chevalier, je voudrais les remplir tous, et j’aime mieux ne pas recevoir la grâce qu’elle m’offre que de m’en rendre indigne. »
Il remit aussitôt le cœur, la chaîne et le livre dans la même corbeille ; puis il envoya tout chez la reine, qui pensa étouffer de rage avec sa fille, de la manière méprisante dont le roi étranger avait reçu une faveur si particulière.
Lorsqu’il put aller chez le roi et la reine, il se rendit dans leur appartement : il espérait que Florine y serait ; il regardait de tous côtés pour la voir. Dès qu’il entendait entrer quelqu’un dans la chambre, il tournait la tête brusquement vers la porte ; il paraissait inquiet et chagrin. La malicieuse reine devinait assez ce qui se passait dans son âme, mais elle n’en faisait pas semblant. Elle ne lui parlait que de parties de plaisir ; il lui répondait tout de travers. Enfin il demanda où était la princesse Florine.
« Seigneur, lui dit fièrement la reine, le roi son père a défendu qu’elle sorte de chez elle, jusqu’à ce que ma fille soit mariée.
— Et quelle raison, répliqua le roi, peut-on avoir de tenir cette belle personne prisonnière ?
— Je l’ignore, dit la reine ; et quand je le saurais, je pourrais me dispenser de vous le dire. »
Le roi se sentait dans une colère inconcevable ; il regardait Truitonne de travers, et songeait en lui-même que c’était à cause de ce petit monstre qu’on lui dérobait le plaisir de voir la princesse. Il quitta promptement la reine : sa présence lui causait trop de peine.
Quand il fut revenu dans sa chambre, il dit à un jeune prince qui l’avait accompagné, et qu’il aimait fort, de donner tout ce qu’on voudrait au monde pour gagner quelqu’une des femmes de la princesse, afin qu’il pût lui parler un moment. Ce prince trouva aisément des dames du palais qui entrèrent dans la confidence ; il y en eut une qui l’assura que le soir même Florine serait à une petite fenêtre basse qui répondait sur le jardin, et que par là elle pourrait lui parler, pourvu qu’il prît de grandes précautions afin qu’on ne le sût pas, « car, ajouta-t-elle, le roi et la reine sont si sévères, qu’ils me feraient mourir s’ils découvraient que j’eusse favorisé la passion de Charmant ».
Le prince, ravi d’avoir amené l’affaire jusque-là, lui promit tout ce qu’elle voulait, et courut faire sa cour au roi, en lui annonçant l’heure du rendez-vous. Mais la mauvaise confidente ne manqua pas d’aller avertir la reine de ce qui se passait et de prendre ses ordres.
Aussitôt elle pensa qu’il fallait envoyer sa fille à la petite fenêtre : elle l’instruisit bien ; et Truitonne ne manqua rien, quoiqu’elle fût naturellement une grande bête.
La nuit était si noire, qu’il aurait été impossible au roi de s’apercevoir de la tromperie qu’on lui faisait, quand même il n’aurait pas été aussi prévenu qu’il l’était de sorte qu’il s’approcha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables. Il dit à Truitonne tout ce qu’il aurait dit à Florine pour la persuader de sa passion. Truitonne, profitant de la conjoncture, lui dit qu’elle se trouvait la plus malheureuse personne du monde d’avoir une belle-mère si cruelle, et qu’elle aurait toujours à souffrir jusqu’à ce que sa fille fût mariée. Le roi l’assura que, si elle le voulait pour son époux, il serait ravi de partager avec elle sa couronne et son cœur. Là-dessus, il tira sa bague de son doigt ; et, la mettant au doigt de Truitonne, il ajouta que c’était un gage éternel de sa foi, et qu’elle n’avait qu’à prendre l’heure pour partir en diligence. Truitonne répondit le mieux qu’elle put à ses empressements. Il s’apercevait bien qu’elle ne disait rien qui vaille ; et cela lui aurait fait de la peine, s’il ne se fût persuadé que la crainte d’être surprise par la reine lui ôtait la liberté de son esprit. Il ne la quitta qu’à la condition de revenir le lendemain à pareille heure ce qu’elle lui promit de tout son cœur.
La reine ayant su l’heureux succès de cette entrevue, elle s’en promit tout. Et, en effet, le jour étant concerté, le roi vint la prendre dans une chaise volante, traînée par des grenouilles ailées : un enchanteur de ses amis lui avait fait ce présent.
La nuit était fort noire ; Truitonne sortit mystérieusement par une petite porte, et le roi, qui l’attendait, la reçut dans ses bras et lui jura cent fois une fidélité éternelle. Mais comme il n’était pas d’humeur à voler longtemps dans sa chaise volante sans épouser la princesse qu’il aimait, il lui demanda où elle voulait que les noces se fissent. Elle lui dit qu’elle avait pour marraine une fée qu’on appelait Soussio, qui était fort célèbre ; qu’elle était d’avis d’aller au château. Quoique le roi ne sût pas le chemin, il n’eut qu’à dire à ses grosses grenouilles de l’y conduire ; elles connaissaient la carte générale de l’univers et en peu de temps elles rendirent le roi et Truitonne chez Soussio. Le château était si bien éclairé, qu’en arrivant le roi aurait reconnu son erreur, si la princesse ne s’était soigneusement couverte de son voile. Elle demanda sa marraine ; elle lui parla en particulier, et lui conta comme quoi elle avait attrapé Charmant, et qu’elle la priait de l’apaiser. « Ah ! ma fille, dit la fée, la chose ne sera pas facile : il aime trop Florine ; je suis certaine qu’il va nous faire désespérer. »
Cependant le roi les attendait dans une salle dont les murs étaient de diamants, si clairs et si nets, qu’il vit au travers Soussio et Truitonne causer ensemble. Il croyait rêver. « Quoi ! disait-il, ai-je été trahi ? les démons ont-ils apporté cette ennemie de notre repos ? Vient-elle pour troubler mon mariage ? Ma chère Florine ne paraît point ! Son père l’a peut-être suivie ! »
Il pensait mille choses qui commençaient à le désoler. Mais ce fut bien pis quand elles entrèrent dans la salle et que Soussio lui dit d’un ton absolu :
« Roi Charmant, voici la princesse Truitonne, à laquelle vous avez donné votre foi ; elle est ma filleule, et je souhaite que vous l’épousiez tout à l’heure.
— Moi, s’écria-t-il, moi, j’épouserais ce petit monstre ! vous me croyez d’un naturel bien docile, quand vous me faites de telles propositions : sachez que je ne lui ai rien promis ; si elle dit autrement, elle en a…
— N’achevez pas, interrompit Soussio, et ne soyez jamais assez hardi pour me manquer de respect.
— Je consens, répliqua le roi, de vous respecter autant qu’une fée est respectable, pourvu que vous me rendiez ma princesse.
— Est-ce que je ne la suis pas, parjure ? dit Truitonne en lui montrant sa bague. À qui as-tu donné cet anneau pour gage de ta foi ? À qui as-tu parlé à la petite fenêtre, si ce n’est pas à moi ?
— Comment donc ! reprit-il, j’ai été déçu et trompé ? Non, non, je n’en serai point la dupe. Allons, allons, mes grenouilles, mes grenouilles, je veux partir tout à l’heure.
— Oh ! ce n’est pas une chose en votre pouvoir si je n’y consens », dit Soussio. Elle le toucha, et ses pieds s’attachèrent au parquet, comme si on les y avait cloués.
« Quand vous me lapideriez, lui dit le roi, quand vous m’écorcheriez, je ne serais point à une autre qu’à Florine ; j’y suis résolu, et vous pouvez après cela user de votre pouvoir à votre gré. »
Soussio employa la douceur, les menaces, les promesses, les prières. Truitonne pleura, cria, gémit, se fâcha, s’apaisa. Le roi ne disait pas un mot, et, les regardant toutes deux avec l’air du monde le plus indigné, il ne répondait rien à tous leurs verbiages.
Il se passa ainsi vingt jours et vingt nuits, sans qu’elles cessassent de parler, sans manger, sans dormir et sans s’asseoir. Enfin Soussio, à bout et fatiguée, dit au roi : « Eh bien, vous êtes un opiniâtre qui ne voulez pas entendre raison ; choisissez, ou d’être sept ans en pénitence, pour avoir donné votre parole sans la tenir, ou d’épouser ma filleule. »
Le roi, qui avait gardé un profond silence, s’écria tout d’un coup : « Faites de moi tout ce que vous voudrez, pourvu que je sois délivré de cette maussade.
— Maussade vous-même, dit Truitonne en colère : je vous trouve un plaisant roitelet, avec votre équipage marécageux, de venir jusqu’en mon pays pour me dire des injures et manquer à votre parole : si vous aviez quatre deniers d’honneur, en useriez-vous ainsi ?
— Voilà des reproches touchants, dit le roi d’un ton railleur. Voyez-vous, qu’on a tort de ne pas prendre une aussi belle personne pour sa femme !
— Non, non, elle ne le sera pas, s’écria Soussio en colère.
Tu n’as qu’à t’envoler par cette fenêtre, si tu veux, car tu seras sept ans Oiseau Bleu. »
En même temps le roi change de figure : ses bras se couvrent de plumes et forment des ailes ; ses jambes et ses pieds deviennent noirs et menus ; il lui croît des ongles crochus ; son corps s’apetisse, il est tout garni de longues plumes fines et mêlées de bleu céleste ; ses yeux s’arrondissent et brillent comme des soleils ; son nez n’est plus qu’un bec d’ivoire ; il s’élève sur sa tête une aigrette blanche, qui forme une couronne ; il chante à ravir, et parle de même. En cet état il jette un cri douloureux de se voir ainsi métamorphosé, et s’envole à tire-d’aile pour fuir le funeste palais de Soussio.
Dans la mélancolie qui l’accable, il voltige de branche en branche, et ne choisit que les arbres consacrés à l’amour ou à la tristesse, tantôt sur les myrtes, tantôt sur les cyprès ; il chante des airs pitoyables, où il déplore sa méchante fortune et celle de Florine. « En quel lieu ses ennemis l’ont-ils cachée ? disait-il. Qu’est devenue cette belle victime ? La barbarie de la reine la laisse-t-elle encore respirer ? Où la chercherai-je ? Suis-je condamné à passer sept ans sans elle ? Peut-être que pendant ce temps on la mariera, et que je perdrai pour jamais l’espérance qui soutient ma vie. » Ces différentes pensées affligeaient l’Oiseau Bleu à tel point, qu’il voulait se laisser mourir.
D’un autre côté, la fée Soussio renvoya Truitonne à la reine, qui était bien inquiète comment les noces se seraient passées. Mais quand elle vit sa fille, et qu’elle lui raconta tout ce qui venait d’arriver, elle se mit dans une colère terrible, dont le contrecoup retomba sur la pauvre Florine.
« Il faut, dit-elle, qu’elle se repente plus d’une fois d’avoir su plaire à Charmant. »
Elle monta dans la tour avec Truitonne, qu’elle avait parée de ses plus riches habits : elle portait une couronne de diamants sur sa tête, et trois filles des plus riches barons de l’État tenaient la queue de son manteau royal ; elle avait au pouce l’anneau du roi Charmant, que Florine remarqua le jour qu’ils parlèrent ensemble. Elle fut étrangement surprise de voir Truitonne dans un si pompeux appareil.
« Voilà ma fille qui vient vous apporter des présents de sa noce, dit la reine : le roi Charmant l’a épousée, il l’aime à la folie, il n’a jamais été de gens plus satisfaits. »
Aussitôt on étale devant la princesse des étoffes d’or et d’argent, des pierreries, des dentelles, des rubans, qui étaient dans de grandes corbeilles de filigrane d’or. En lui présentant toutes ces choses, Truitonne ne manquait pas de faire briller l’anneau du roi ; de sorte que la princesse Florine ne pouvait plus douter de son malheur. Elle s’écria, d’un air désespéré, qu’on ôtât de ses yeux tous ces présents si funestes ; qu’elle ne pouvait plus porter que du noir, ou plutôt qu’elle voulait présentement mourir. Elle s’évanouit ; et la cruelle reine, ravie d’avoir si bien réussi, ne permit pas qu’on la secourût : elle la laissa seule dans le plus déplorable état du monde, et alla conter malicieusement au roi que sa fille était si transportée de tendresse que rien n’égalait les extravagances qu’elle faisait ; qu’il fallait bien se donner de garde de la laisser sortir de la tour. Le roi lui dit qu’elle pouvait gouverner cette affaire à sa fantaisie et qu’il en serait toujours satisfait.
Lorsque la princesse revint de son évanouissement, et qu’elle réfléchit sur la conduite qu’on tenait avec elle, aux mauvais traitements qu’elle recevait de son indigne marâtre, et à l’espérance qu’elle perdait pour jamais d’épouser le roi Charmant, sa douleur devint si vive, qu’elle pleura toute la nuit ; en cet état elle se mit à sa fenêtre, où elle fit des regrets fort tendres et fort touchants. Quand le jour approcha, elle la ferma et continua de pleurer.
La nuit suivante, elle ouvrit la fenêtre, elle poussa de profonds soupirs et des sanglots, elle versa un torrent de larmes : le jour venu, elle se cacha dans sa chambre. Cependant le roi Charmant, ou pour mieux dire le bel Oiseau Bleu, ne cessait point de voltiger autour du palais ; il jugeait que sa chère princesse y était enfermée, et, si elle faisait de tristes plaintes, les siennes ne l’étaient pas moins. Il s’approchait des fenêtres le plus qu’il pouvait, pour regarder dans les chambres ; mais la crainte que Truitonne ne l’aperçût et ne se doutât que c’était lui, l’empêchait de faire ce qu’il aurait voulu. « Il y va de ma vie, disait-il en lui-même : si ces mauvaises découvraient où je suis, elles voudraient se venger ; il faudrait que je m’éloignasse, ou que je fusse exposé aux derniers dangers. » Ces raisons l’obligèrent à garder de grandes mesures, et d’ordinaire il ne chantait que la nuit.
Il y avait vis-à-vis de la fenêtre où Florine se mettait, un cyprès d’une hauteur prodigieuse : l’Oiseau Bleu vint s’y percher. Il y fut à peine, qu’il entendit une personne qui se plaignait : « Souffrirai-je encore longtemps ? disait-elle ; la mort ne viendra-t-elle point à mon secours ? Ceux qui la craignent ne la voient que trop tôt ; je la désire et la cruelle me fuit.
Ah ! barbare reine, que t’ai-je fait, pour me retenir dans une captivité si affreuse ? N’as-tu pas assez d’autres endroits pour me désoler ? Tu n’as qu’à me rendre témoin du bonheur que ton indigne fille goûte avec le roi Charmant ! »
L’Oiseau Bleu n’avait pas perdu un mot de cette plainte ; il en demeura bien surpris, et il attendit le jour avec la dernière impatience, pour voir la dame affligée ; mais avant qu’il vînt, elle avait fermé la fenêtre et s’était retirée.
L’oiseau curieux ne manqua pas de revenir la nuit suivante : il faisait clair de lune. Il vit une fille à la fenêtre de la tour, qui commençait ses regrets : « Fortune, disait-elle, toi qui me flattais de régner, toi qui m’avais rendu l’amour de mon père, que t’ai-je fait pour me plonger tout d’un coup dans les plus amères douleurs ? Est-ce dans un âge aussi tendre que le mien qu’on doit commencer à ressentir ton inconstance ? Reviens, barbare, s’il est possible ; je te demande, pour toutes faveurs, de terminer ma fatale destinée. »
L’Oiseau Bleu écoutait ; et plus il écoutait, plus il se persuadait que c’était son aimable princesse qui se plaignait. Il lui dit : « Adorable Florine, merveille de nos jours, pourquoi voulez-vous finir si promptement les vôtres ? vos maux ne sont point sans remède.
— Hé ! qui me parle, s’écria-t-elle, d’une manière si consolante ?
— Un roi malheureux, reprit l’Oiseau, qui vous aime et n’aimera jamais que vous.
— Un roi qui m’aime ! ajouta-t-elle : est-ce ici un piège que me tend mon ennemie ? Mais, au fond, qu’y gagnera-t-elle ? Si elle cherche à découvrir mes sentiments, je suis prête à lui en faire l’aveu.
— Non, ma princesse, répondit-il : l’amant qui vous parle n’est point capable de vous trahir. »
En achevant ces mots, il vola sur la fenêtre. Florine eut d’abord grande peur d’un oiseau si extraordinaire, qui parlait avec autant d’esprit que s’il avait été homme, quoiqu’il conservât le petit son de voix d’un rossignol ; mais la beauté de son plumage et ce qu’il lui dit la rassura.
« M’est-il permis de vous revoir, ma princesse ? s’écria-t-il. Puis-je goûter un bonheur si parfait sans mourir de joie ? Mais, hélas ! que cette joie est troublée par votre captivité et l’état où la méchante Soussio m’a réduit pour sept ans !
— Et qui êtes-vous, charmant Oiseau ? dit la princesse en le caressant.
— Vous avez dit mon nom, ajouta le roi, et vous feignez de ne pas me connaître.
— Quoi ! le plus grand roi du monde, quoi ! le roi Charmant, dit la princesse, serait le petit oiseau que je tiens ?
— Hélas ! belle Florine, il n’est que trop vrai, reprit-il ; et, si quelque chose m’en peut consoler, c’est que j’ai préféré cette peine à celle de renoncer à la passion que j’ai pour vous.
— Pour moi ! dit Florine. Ah ! ne cherchez point à me tromper ! Je sais, je sais que vous avez épousé Truitonne ; j’ai reconnu votre anneau à son doigt : je l’ai vue toute brillante des diamants que vous lui avez donnés. Elle est venue m’insulter dans ma triste prison ; chargée d’une riche couronne et d’un manteau royal qu’elle tenait de votre main pendant que j’étais chargée de chaînes et de fers.
— Vous avez vu Truitonne en cet équipage ? interrompit le roi ; sa mère et elle ont osé vous dire que ces joyaux venaient de moi ? 0 ciel ! est-il possible que j’entende des mensonges si affreux, et que je ne puisse m’en venger aussitôt que je le souhaite ? Sachez qu’elles ont voulu me décevoir, qu’abusant de votre nom, elles m’ont engagé d’enlever cette laide Truitonne ; mais, aussitôt que je connus mon erreur, je voulus l’abandonner, et je choisis enfin d’être Oiseau Bleu sept ans de suite, plutôt que de manquer à la fidélité que vous ai vouée. »
Florine avait un plaisir si sensible d’entendre parler son aimable amant, qu’elle ne se souvenait plus des malheurs de sa prison. Que ne lui dit-elle pas pour le consoler de sa triste aventure, et pour le persuader qu’elle ne ferait pas moins pour lui qu’il n’avait fait pour elle ? Le jour paraissait, la plupart des officiers étaient déjà levés, que l’Oiseau Bleu et la princesse parlaient encore ensemble. Ils se séparèrent avec mille peines, après s’être promis que toutes les nuits ils s’entretiendraient ainsi.
La joie de s’être trouvés était si extrême, qu’il n’est point de termes capables de l’exprimer ; chacun de son côté remerciait l’amour et la fortune. Cependant Florine s’inquiétait pour l’Oiseau Bleu : « Qui le garantira des chasseurs, disait-elle, ou de la serre aiguë de quelque aigle, ou de quelque vautour affamé, qui le mangerait avec autant d’appétit que si ce n’était pas un grand roi ? 0 ciel ! que deviendrais-je si ses plumes légères et fines, poussées par le vent, venaient jusque dans ma prison m’annoncer le désastre que je crains ? »Cette pensée empêcha que la pauvre princesse fermât les yeux : car, lorsque l’on aime, les illusions paraissent des vérités, et ce que l’on croyait impossible dans un autre temps semble aisé en celui-là, de sorte qu’elle passa le jour à pleurer, jusqu’à ce que l’heure fût venue de se mettre à sa fenêtre.
Le charmant Oiseau, caché dans le creux d’un arbre, avait été tout le jour occupé à penser à sa belle princesse. « Que je suis content, disait-il, de l’avoir retrouvée ! qu’elle est engageante ! que je sens vivement les bontés qu’elle me témoigne ! » Ce tendre amant comptait jusqu’aux moindres moments de la pénitence qui l’empêchait de l’épouser, et jamais on n’en a désiré la fin avec plus de passion. Comme il voulait faire à Florine toutes les galanteries dont il était capable, il vola jusqu’à la ville capitale de son royaume ; il alla à son palais, il entra dans son cabinet par une vitre qui était cassée ; il prit des pendants d’oreilles de diamants, si parfaits et si beaux qu’il n’y en avait point au monde qui en approchassent ; il les apporta le soir à Florine, et la pria de s’en parer. « J’y consentirais, lui dit-elle, si vous me voyiez le jour ; mais puisque je ne vous parle que la nuit, je ne les mettrai pas. » L’Oiseau lui promit de prendre si bien son temps, qu’il viendrait à la tour à l’heure qu’elle voudrait : aussitôt elle mit les pendants d’oreilles, et la nuit se passa à causer, comme s’était passée l’autre.
Le lendemain l’Oiseau Bleu retourna dans son royaume. Il alla à son palais ; il entra dans son cabinet par la vitre rompue, et il en apporta les plus riches bracelets que l’on eût encore vus : ils étaient d’une seule émeraude, taillés en facettes creuses par le milieu, pour y passer la main et le bras.
« Pensez-vous, lui dit la princesse, que mes sentiments pour vous aient besoin d’être cultivés par des présents ? Ah ! que vous me connaîtriez mal.
— Non, madame, répliquait-il, je ne crois pas que les bagatelles que je vous offre soient nécessaires pour me conserver votre tendresse ; mais la mienne serait blessée si je négligeais aucune occasion de vous marquer mon attention ; et, quand vous ne me voyez point, ces petits bijoux me rappellent à votre souvenir. »
Florine lui dit là-dessus mille choses obligeantes, auxquelles il répondit par mille autres qui ne l’étaient pas moins.
La nuit suivante, l’Oiseau amoureux ne manqua pas d’apporter à sa belle une montre d’une grandeur raisonnable, qui était dans une perle : l’excellence du travail surpassait celle de la matière.
« Il est inutile de me régaler d’une montre, dit-elle galamment ; quand vous êtes éloigné de moi, les heures me paraissent sans fin ; quand vous êtes avec moi, elles passent comme un songe : ainsi je ne puis leur donner une juste mesure.
— Hélas ! ma princesse, s’écria l’Oiseau Bleu, j’en ai la même opinion que vous, et je suis persuadé que je renchéris encore sur la délicatesse.
— Après ce que vous souffrez pour me conserver votre cœur, répliqua-t-elle, je suis en état de croire que vous avez porté l’amitié et l’estime aussi loin qu’elles peuvent aller. »
Dès que le jour paraissait, l’Oiseau volait dans le fond de son arbre, où des fruits lui servaient de nourriture. Quelquefois encore il chantait de beaux airs : sa voix ravissait les passants, ils l’entendaient et ne voyaient personne, aussi il était conclu que c’étaient des esprits. Cette opinion devint si commune, que l’on n’osait entrer dans le bois, on rapportait mille aventures fabuleuses qui s’y étaient passées, et la terreur générale fit la sûreté particulière de l’Oiseau Bleu.
Il ne se passait aucun jour sans qu’il fît un présent à Florine : tantôt un collier de perles, ou des bagues des plus brillantes et des mieux mises en œuvre, des attaches de diamants, des poinçons, des bouquets de pierreries qui imitaient la couleur des fleurs, des livres agréables, des médailles, enfin, elle avait un amas de richesses merveilleuses. Elle ne s’en parait jamais que la nuit pour plaire au roi, et le jour, n’ayant pas d’endroit où les mettre, elle les cachait soigneusement dans sa paillasse.
Deux années s’écoulèrent ainsi sans que Florine se plaignît une seule fois de sa captivité. Et comment s’en serait-elle plainte ? elle avait la satisfaction de parler toute la nuit à ce qu’elle aimait ; il ne s’est jamais tant dit de jolies choses. Bien qu’elle ne vît personne et que l’Oiseau passât le jour dans le creux d’un arbre, ils avaient mille nouveautés à se raconter : la matière était inépuisable, leur cœur et leur esprit fournissaient abondamment des sujets de conversation.
Cependant la malicieuse reine, qui la retenait si cruellement en prison, faisait d’inutiles efforts pour marier Truitonne. Elle envoyait des ambassadeurs la proposer à tous les princes dont elle connaissait le nom : dès qu’ils arrivaient, on les congédiait brusquement. « S’il s’agissait de la princesse Florine, vous seriez reçus avec joie, leur disait-on ; mais pour Truitonne, elle peut rester vestale sans que personne s’y oppose. » À ces nouvelles, sa mère et elle s’emportaient de colère contre l’innocente princesse qu’elles persécutaient : « Quoi ! malgré sa captivité, cette arrogante nous traversera ! disaient-elles. Quel moyen de lui pardonner les mauvais tours qu’elle nous fait ? Il faut qu’elle ait des correspondances secrètes dans les pays étrangers : c’est tout au moins une criminelle d’État ; traitons-la sur ce pied, et cherchons tous les moyens possibles de la convaincre. »
Elles finirent leur conseil si tard, qu’il était plus de minuit lorsqu’elles résolurent de monter dans la tour pour l’interroger. Elle était avec l’Oiseau Bleu à la fenêtre, parée de ses pierreries, coiffée de ses beaux cheveux, avec un soin qui n’était pas naturel aux personnes affligées ; sa chambre et son lit étaient jonchés de fleurs, et quelques pastilles d’Espagne qu’elle venait de brûler répandaient une odeur excellente. La reine écouta à la porte ; elle crut entendre chanter un air à deux parties : car Florine avait une voix presque céleste. En voici les paroles, qui lui parurent tendres :
Que notre sort est déplorable,
Et que nous souffrons de tourment
Pour nous aimer trop constamment !
Mais c’est en vain qu’on nous accable !
Malgré nos cruels ennemis,
Nos cœurs seront toujours unis.
Quelques soupirs finirent leur petit concert.
« Ah ! ma Truitonne, nous sommes trahies », s’écria la reine en ouvrant brusquement la porte, et se jetant dans la chambre.
Que devint Florine à cette vue ? Elle poussa promptement sa petite fenêtre, pour donner le temps à l’Oiseau royal de s’envoler. Elle était bien plus occupée de sa conservation que de la sienne propre ; mais il ne se sentit pas la force de s’éloigner : ses yeux perçants lui avaient découvert le péril auquel sa princesse était exposée.
Il avait vu la reine et Truitonne ; quelle affliction de n’être pas en état de défendre sa maîtresse ! Elles s’approchèrent d’elle comme des furies qui voulaient la dévorer.
« L’on sait vos intrigues contre l’État, s’écria la reine, ne pensez pas que votre rang vous sauve des châtiments que vous méritez.
— Et avec qui, madame ? répliqua la princesse. N’êtes-vous pas ma geôlière depuis deux ans ? Ai-je vu d’autres personnes que celles que vous m’avez envoyées ? »
Pendant qu’elle parlait, la reine et sa fille l’examinaient avec une surprise sans pareille, son admirable beauté et son extraordinaire parure les éblouissaient.
« Et d’où vous viennent, madame, dit la reine, ces pierreries qui brillent plus que le soleil ? Nous ferez-vous accroire qu’il y en a des mines dans cette tour ?
— Je les y ai trouvées, répliqua Florine ; c’est tout ce que j’en sais. »
La reine la regardait attentivement, pour pénétrer jusqu’au fond de son cœur ce qui s’y passait.
« Nous ne sommes pas vos dupes, dit-elle ; vous pensez nous en faire accroire ; mais, princesse, nous savons ce que vous faites depuis le matin jusqu’au soir. On vous a donné tous ces bijoux dans la seule vue de vous obliger à vendre le royaume de votre père.
— Je serais fort en état de le livrer ! répondit-elle avec un sourire dédaigneux : une princesse infortunée, qui languit dans les fers depuis si longtemps, peut beaucoup dans un complot de cette nature !
— Et pour qui donc, reprit la reine, êtes-vous coiffée comme une petite coquette, votre chambre pleine d’odeurs, et votre personne si magnifique, qu’au milieu de la cour vous seriez moins parée ?
— J’ai assez de loisir, dit la princesse ; il n’est pas extraordinaire que j’en donne quelques moments à m’habiller ; j’en passe tant d’autres à pleurer mes malheurs, que ceux-là ne sont pas à me reprocher.
— Çà, çà, voyons, dit la reine, si cette innocente personne n’a point quelque traité fait avec les ennemis. »
Elle chercha elle-même partout ; et venant à la paillasse, qu’elle fit vider, elle y trouva une si grande quantité de diamants, de perles, de rubis, d’émeraudes et de topazes, qu’elle ne savait d’où cela venait. Elle avait résolu de mettre en quelque lieu des papiers pour perdre la princesse ; dans le temps qu’on n’y prenait pas garde, elle en cacha dans la cheminée : mais par bonheur l’Oiseau Bleu était perché au-dessus, qui voyait mieux qu’un lynx, et qui écoutait tout. Il s’écria : « Prends garde à toi, Florine, voilà ton ennemie qui veut te faire une trahison. »
Cette voix si peu attendue épouvanta à tel point la reine, qu’elle n’osa faire ce qu’elle avait médité. « Vous voyez, madame, dit la princesse, que les esprits qui volent en l’air me sont favorables.
— Je crois, dit la reine outrée de colère, que les démons s’intéressent pour vous ; mais malgré eux votre père saura se faire justice.
— Plût au Ciel, s’écria Florine, n’avoir à craindre que la fureur de mon père ! Mais la vôtre, madame, est plus terrible. »
La reine la quitta, troublée de tout ce qu’elle venait de voir et d’entendre. Elle tint conseil sur ce qu’elle devait faire contre la princesse : on lui dit que, si quelque fée ou quelque enchanteur la prenaient sous leur protection, le vrai secret pour les irriter serait de lui faire de nouvelles peines, et qu’il serait mieux d’essayer de découvrir son intrigue. La reine approuva cette pensée ; elle envoya coucher dans sa chambre une jeune fille qui contrefaisait l’innocente : elle eut l’ordre de lui dire qu’on la mettait auprès d’elle pour la servir. Mais quelle apparence de donner dans un panneau si grossier ? La princesse la regarda comme une espionne, elle ne put ressentir une douleur plus violente. « Quoi ! je ne parlerais plus à cet Oiseau qui m’est si cher ! disait-elle. Il m’aidait à supporter mes malheurs, je soulageais les siens ; notre tendresse nous suffisait. Que va-t-il faire ? Que ferai-je moi-même ? » En pensant à toutes ces choses, elle versait des ruisseaux de larmes.
Elle n’osait plus se mettre à la petite fenêtre, quoiqu’elle entendît voltiger autour : elle mourait d’envie de lui ouvrir, mais elle craignait d’exposer la vie de ce cher amant. Elle passa un mois entier sans paraître ; l’Oiseau Bleu se désespérait : quelles plaintes ne faisait-il pas ! Comment vivre sans voir sa princesse ? Il n’avait jamais mieux ressenti les maux de l’absence et ceux de la métamorphose ; il cherchait inutilement des remèdes à l’une et à l’autre : après s’être creusé la tête, il ne trouvait rien qui le soulageât.
L’espionne de la princesse, qui veillait jour et nuit depuis un mois, se sentit si accablée de sommeil, qu’enfin elle s’endormit profondément. Florine s’en aperçut ; elle ouvrit sa petite fenêtre, et dit :
Oiseau Bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement.
Ce sont là ses propres paroles, auxquelles l’on n’a rien voulu changer. L’Oiseau les entendit si bien, qu’il vint promptement sur la fenêtre. Quelle joie de se revoir ! Qu’ils avaient de choses à se dire ! Les amitiés et les protestations de fidélité se renouvelèrent mille et mille fois : la princesse n’ayant pu s’empêcher de répandre des larmes, son amant s’attendrit beaucoup et la consola de son mieux. Enfin, l’heure de se quitter étant venue, sans que la geôlière se fût réveillée, ils se dirent l’adieu du monde le plus touchant. Le lendemain encore l’espionne s’endormit ; la princesse diligemment se mit à la fenêtre, puis elle dit comme la première fois :
Oiseau Bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement.
Aussitôt l’Oiseau vint, et la nuit se passa comme l’autre, sans bruit et sans éclat, dont nos amants étaient ravis : ils se flattaient que la surveillante prendrait tant de plaisir à dormir, qu’elle en ferait autant toutes les nuits. Effectivement, la troisième se passa encore très heureusement ; mais pour celle qui suivit, la dormeuse ayant entendu du bruit, elle écouta sans faire semblant de rien ; puis elle regarda de son mieux, et vit au clair de la lune le plus bel oiseau de l’univers qui parlait à la princesse, qui la caressait avec sa patte, qui la becquetait doucement ; enfin elle entendit plusieurs choses de leur conversation, et demeura très étonnée : car l’Oiseau parlait comme un amant, et la belle Florine lui répondait avec tendresse.
Le jour parut, ils se dirent adieu ; et, comme s’ils eussent eu un pressentiment de leur prochaine disgrâce, ils se quittèrent avec une peine extrême. La princesse se jeta sur son lit toute baignée de ses larmes, et le roi retourna dans le creux de son arbre. Sa geôlière courut chez la reine ; elle lui apprit tout ce qu’elle avait vu et entendu. La reine envoya quérir Truitonne et ses confidentes ; elles raisonnèrent longtemps ensemble, et conclurent que l’Oiseau Bleu était le roi Charmant. « Quel affront ! s’écria la reine, quel affront, ma Truitonne ! Cette insolente princesse, que je croyais si affligée, jouissait en repos des agréables conversations de notre ingrat ! Ah ! je me vengerai d’une manière si sanglante qu’il en sera parlé. » Truitonne la pria de n’y perdre pas un moment ; et, comme elle se croyait plus intéressée dans l’affaire que la reine, elle mourait de joie lorsqu’elle pensait à tout ce qu’on ferait pour désoler l’amant et la maîtresse.
La reine renvoya l’espionne dans la tour ; elle lui ordonna de ne témoigner ni soupçon, ni curiosité, et de paraître plus endormie qu’à l’ordinaire. Elle se coucha de bonne heure, elle ronfla de son mieux, et la pauvre princesse déçue, ouvrant la petite fenêtre, s’écria :
Oiseau Bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement.
Mais elle l’appela toute la nuit inutilement, il ne parut point : car la méchante reine avait fait attacher au cyprès des épées, des couteaux, des rasoirs, des poignards ; et, lorsqu’il vint à tire-d’aile s’abattre dessus, ces armes meurtrières lui coupèrent les pieds ; il tomba sur d’autres, qui lui coupèrent les ailes ; et enfin, tout percé, il se sauva avec mille peines jusqu’à son arbre, laissant une longue trace de sang.
Que n’étiez-vous là, belle princesse, pour soulager cet Oiseau royal ? Mais elle serait morte, si elle l’avait vu dans un état si déplorable. Il ne voulait prendre aucun soin de sa vie, persuadé que c’était Florine qui lui avait fait jouer ce mauvais tour. « Ah ! barbare, disait-il douloureusement, est-ce ainsi que tu paies la passion la plus pure et la plus tendre qui sera jamais ? Si tu voulais ma mort, que ne me la demandais-tu toi-même ? Elle m’aurait été chère de ta main. Je venais te trouver avec tant d’amour et de confiance ! Je souffrais pour toi, et je souffrais sans me plaindre ! Quoi ! tu m’as sacrifié à la plus cruelle des femmes !
Elle était notre ennemie commune ; tu viens de faire ta paix à mes dépens. C’est toi, Florine, c’est toi qui me poignardes ! Tu as emprunté la main de Truitonne, et tu l’as conduite jusque dans mon sein ! » Ces funestes idées l’accablèrent à un tel point qu’il résolut de mourir.
Mais son ami l’enchanteur, qui avait vu revenir chez lui les grenouilles volantes avec le chariot sans que le roi parût, se mit si en peine de ce qui pouvait lui être arrivé, qu’il parcourut huit fois toute la terre pour le chercher, sans qu’il lui fût possible de le trouver.
Il faisait son neuvième tour, lorsqu’il passa dans le bois où il était, et, suivant les règles qu’il s’était prescrites, il sonna du cor assez longtemps, et puis il cria cinq fois de toute sa force : « Roi Charmant, roi Charmant, où êtes-vous ? »
Le roi reconnut la voix de son meilleur ami :
« Approchez, lui dit-il, de cet arbre, et voyez le malheureux roi que vous chérissez, noyé dans son sang. »
L’enchanteur, tout surpris, regardait de tous côtés sans rien voir : « Je suis Oiseau Bleu », dit le roi d’une voix faible et languissante. A ces mots, l’enchanteur le trouva sans peine dans son petit nid. Un autre que lui aurait été étonné plus qu’il ne le fut ; mais il n’ignorait aucun tour de l’art nécromancien : il ne lui en coûta que quelques paroles pour arrêter le sang qui coulait encore ; et avec des herbes qu’il trouva dans le bois, et sur lesquelles il dit deux mots de grimoire, il guérit le roi aussi parfaitement que s’il n’avait pas été blessé.
Il le pria ensuite de lui apprendre par quelle aventure il était devenu Oiseau, et qui l’avait blessé si cruellement. Le roi contenta sa curiosité : il lui dit que c’était Florine qui avait décelé le mystère amoureux des visites secrètes qu’il lui rendait, et que, pour faire sa paix avec la reine, elle avait consenti à laisser garnir le cyprès de poignards et de rasoirs, par lesquels il avait été presque haché ; il se récria mille fois sur l’infidélité de cette princesse, et dit qu’il s’estimerait heureux d’être mort avant d’avoir connu son méchant cœur.
Le magicien se déchaîna contre elle et contre toutes les femmes ; il conseilla au roi de l’oublier. « Quel malheur serait le vôtre, lui dit-il, si vous étiez capable d’aimer plus longtemps cette ingrate ! Après ce qu’elle vient de vous faire, l’on en doit tout craindre. » L’Oiseau Bleu n’en put demeurer d’accord, il aimait encore trop chèrement Florine ; et l’enchanteur, qui connut ses sentiments malgré le soin qu’il prenait de les cacher, lui dit d’une manière agréable :
Accablé d’un cruel malheur,
En vain l’on parle et l’on raisonne,
On n’écoute que sa douleur,
Et point les conseils qu’on nous donne.
Il faut laisser faire le temps ;
Chaque chose a son point de vue ;
Et quand l’heure n’est pas venue,
On se tourmente vainement.
Le royal Oiseau en convint, et pria son ami de le porter chez lui et de le mettre dans une cage où il fût à couvert de la patte du chat et de toute arme meurtrière. « Mais, lui dit l’enchanteur, resterez-vous encore cinq ans dans un état si déplorable et si peu convenable à vos affaires et à votre dignité ? Car enfin, vous avez des ennemis qui soutiennent que vous êtes mort ; ils veulent envahir votre royaume : je crains bien que vous ne l’ayez perdu avant d’avoir recouvré votre première forme.
— Ne pourrais-je pas, répliqua-t-il, aller dans mon palais et gouverner tout comme je faisais ordinairement ?
— Oh ! s’écria son ami, la chose est difficile ! Tel qui veut obéir à un homme ne veut pas obéir à un perroquet ; tel vous craint étant roi, étant environné de grandeur et de faste, qui vous arrachera toutes les plumes, vous voyant un petit oiseau.
— Ah ! faiblesse humaine ! brillant extérieur ! s’écria le roi, encore que tu ne signifies rien pour le mérite et la vertu, tu ne laisses pas d’avoir des endroits décevants, dont on ne saurait presque se défendre ! Eh bien, continua-t-il, soyons philosophe, méprisons ce que nous ne pouvons obtenir : notre parti ne sera point le plus mauvais.
— Je ne me rends pas sitôt, dit le magicien, j’espère trouver quelques bons expédients. »
Florine, la triste Florine, désespérée de ne plus voir le roi, passait les jours et les nuits à la fenêtre, répétant sans cesse :
Oiseau Bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement.
La présence de son espionne ne l’en empêchait point ; son désespoir était tel, qu’elle ne ménageait plus rien.
« Qu’êtes-vous devenu, roi Charmant ? s’écria-t-elle. Nos communs ennemis vous ont-ils fait ressentir les cruels effets de leur rage ? Avez-vous été sacrifié à leurs fureurs ? Hélas ! hélas ! n’êtes-vous plus ? Ne dois-je plus vous voir ? ou, fatigué de mes malheurs, m’avez-vous abandonnée à la dureté de mon sort ? » Que de larmes, que de sanglots suivaient ces tendres plaintes ! Que les heures étaient devenues longues par l’absence d’un amant si aimable et si cher ! La princesse, abattue, malade, maigre et changée, pouvait à peine se soutenir ; elle était persuadée que tout ce qu’il y a de plus funeste était arrivé au roi.
La reine et Truitonne triomphaient ; la vengeance leur faisait plus de plaisir que l’offense ne leur avait fait de peine. Et, au fond, de quelle offense s’agissait-il ? Le roi Charmant n’avait pas voulu épouser un petit monstre qu’il avait mille sujets de haïr.
Cependant le père de Florine, qui devenait vieux, tomba malade et mourut. La fortune de la méchante reine et sa fille changea de face : elles étaient regardées comme des favorites qui avaient abusé de leur faveur, le peuple mutiné courut au palais demander la princesse Florine, la reconnaissant pour souveraine. La reine, irritée, voulut traiter l’affaire avec hauteur ; elle parut sur un balcon et menaça les mutins. En même temps la sédition devint générale ; on enfonce les portes de son appartement, on le pille, et on l’assomme à coups de pierres. Truitonne s’enfuit chez sa marraine la fée Soussio ; elle ne courait pas moins de dangers que sa mère.
Les grands du royaume s’assemblèrent promptement et montèrent à la tour, où la princesse était fort malade : elle ignorait la mort de son père et le supplice de son ennemie. Quand elle entendit tant de bruit, elle ne douta pas qu’on ne vînt la prendre pour la faire mourir ; elle n’en fut point effrayée : la vie lui était odieuse depuis qu’elle avait perdu l’Oiseau Bleu. Mais ses sujets s’étant jetés à ses pieds, lui apprirent le changement qui venait d’arriver à sa fortune ; elle n’en fut point émue. Ils la portèrent dans son palais et la couronnèrent. Les soins infinis que l’on prit de sa santé, et l’envie qu’elle avait d’aller chercher l’Oiseau Bleu, contribuèrent beaucoup à la rétablir, et lui donnèrent bientôt assez de force pour nommer un conseil, afin d’avoir soin de son royaume en son absence ; et puis elle prit pour des mille millions de pierreries, et elle partit une nuit toute seule, sans que personne sût où elle allait.
L’enchanteur qui prenait soin des affaires du roi Charmant, n’ayant pas assez de pouvoir pour détruire ce que Soussio avait fait, s’avisa de l’aller trouver et de lui proposer quelque accommodement en faveur duquel elle rendrait au roi sa figure naturelle : il prit les grenouilles et vola chez la fée, qui causait dans ce moment avec Truitonne. D’un enchanteur à une fée il n’y a que la main ; ils se connaissaient depuis cinq ou six cents ans, et dans cet espace de temps ils avaient été mille fois bien et mal ensemble. Elle le reçut très agréablement : « Que veut mon compère ? lui dit-elle (c’est ainsi qu’ils se nomment tous). Y a-t’il quelque chose pour son service qui dépende de moi ?
— Oui, ma commère, dit le magicien ; vous pouvez tout pour ma satisfaction ; il s’agit du meilleur de mes amis, d’un roi que vous avez rendu infortuné.
— Ah ! ah ! je vous entends, compère, s’écria Soussio ; j’en suis fâchée, mais il n’y a point de grâce à espérer pour lui, s’il ne veut épouser ma filleule ; la voilà belle et jolie, comme vous voyez : qu’il se consulte. »
L’enchanteur pensa demeurer muet, il la trouva laide ; cependant il ne pouvait se résoudre à s’en aller sans régler quelque chose avec elle, parce que le roi avait couru mille risques depuis qu’il était en cage. Le clou qui l’accrochait s’était rompu ; la cage était tombée, et Sa Majesté emplumée souffrit beaucoup de cette chute ; Minet, qui se trouvait dans la chambre lorsque cet accident arriva, lui donna un coup de griffe dans l’œil dont il pensa rester borgne. Une autre fois on avait oublié de lui donner à boire ; il allait le grand chemin d’avoir la pépie, quand on l’en garantit par quelques gouttes d’eau.
Un petit coquin de singe, s’étant échappé, attrapa ses plumes au travers des barreaux de sa cage, et il l’épargna aussi peu qu’il aurait fait un geai ou un merle. Le pire de tout cela, c’est qu’il était sur le point de perdre son royaume ; ses héritiers faisaient tous les jours des fourberies nouvelles pour prouver qu’il était mort. Enfin l’enchanteur conclut avec sa commère Soussio qu’elle mènerait Truitonne dans le palais du roi Charmant ; qu’elle y resterait quelques mois, pendant lesquels il prendrait sa résolution de l’épouser, et qu’elle lui rendrait sa figure ; quitte à reprendre celle d’oiseau, s’il ne voulait pas se marier.
La fée donna des habits tout d’or et d’argent à Truitonne, puis elle la fit monter en trousse derrière elle sur un dragon, et elles se rendirent au royaume de Charmant, qui venait d’y arriver avec son fidèle ami l’enchanteur. En trois coups de baguette il se vit le même qu’il avait été, beau, aimable, spirituel et magnifique ; mais il achetait bien cher le temps dont on diminuait sa pénitence : la seule pensée d’épouser Truitonne le faisait frémir. L’enchanteur lui disait les meilleures raisons qu’il pouvait, elles ne faisaient qu’une médiocre impression sur son esprit ; et il était moins occupé de la conduite de son royaume que des moyens de proroger le terme que Soussio lui avait donné pour épouser Truitonne.
Cependant la reine Florine, déguisée sous un habit de paysanne, avec ses cheveux épars et mêlés, qui cachaient son visage, un chapeau de paille sur la tête, un sac de toile sur son épaule, commença son voyage, tantôt à pied, tantôt à cheval, tantôt par mer, tantôt par terre : elle faisait toute la diligence possible ; mais, ne sachant où elle devait tourner ses pas, elle craignait toujours d’aller d’un côté pendant que son aimable roi serait de l’autre.
Un jour qu’elle s’était arrêtée au bord d’une fontaine dont l’eau argentée bondissait sur de petits cailloux, elle eut envie de se laver les pieds ; elle s’assit sur le gazon, elle releva ses blonds cheveux avec un ruban, et mit ses pieds dans le ruisseau : elle ressemblait à Diane qui se baigne au retour d’une chasse. Il passa dans cet endroit une petite vieille toute voûtée, appuyée sur un gros bâton ; elle s’arrêta, et lui dit :
« Que faites-vous là, ma belle fille ? vous êtes bien seule !
— Ma bonne mère, dit la reine, je ne laisse pas d’être en grande compagnie, car j’ai avec moi les chagrins, les inquiétudes et les déplaisirs. »
A ces mots, ses yeux se couvrirent de larmes.
« Quoi ! si jeune, vous pleurez, dit la bonne femme. Ah ! ma fille, ne vous affligez pas. Dites-moi ce que vous avez sincèrement, et j’espère vous soulager. »
La reine le voulut bien ; elle lui conta ses ennuis, la conduite que la fée Soussio avait tenue dans cette affaire, et enfin comme elle cherchait l’Oiseau Bleu.
La petite vieille se redresse, s’agence, change tout d’un coup de visage, paraît belle, jeune, habillée superbement ; et regardant la reine avec un sourire gracieux : « Incomparable Florine, lui dit-elle, le roi que vous cherchez n’est plus oiseau : ma sœur Soussio lui a rendu sa première figure, il est dans son royaume ; ne vous affligez point ; vous y arriverez, et vous viendrez à bout de votre dessein. Voici quatre œufs ; vous les casserez dans vos pressants besoins, et vous y trouverez des secours qui vous seront utiles. »
En achevant ces mots, elle disparut. Florine se sentit fort consolée de ce qu’elle venait d’entendre ; elle mit les œufs dans son sac, et tourna ses pas vers le royaume de Charmant.
Après avoir marché huit jours et huit nuits sans s’arrêter, elle arrive au pied d’une montagne prodigieuse par sa hauteur, toute d’ivoire, et si droite que l’on n’y pouvait mettre les pieds sans tomber. Elle fit mille tentatives inutiles ; elle glissait, elle se fatiguait, et, désespérée d’un obstacle si insurmontable, elle se coucha au pied de la montagne, résolue de s’y laisser mourir, quand elle se souvint des œufs que la fée lui avait donnés. Elle en prit un : « Voyons, dit-elle, si elle ne s’est point moquée de moi en me promettant les secours dont j’aurais besoin. » Dès qu’elle l’eut cassé, elle y trouva de petits crampons d’or, qu’elle mit à ses pieds et à ses mains. Quand elle les eut, elle monta la montagne d’ivoire sans aucune peine, car les crampons entraient dedans et l’empêchaient de glisser. Lorsqu’elle fut tout en haut, elle eut de nouvelles peines pour descendre : toute la vallée était d’une seule glace de miroir. Il y avait autour plus de soixante mille femmes qui s’y miraient avec un plaisir extrême, car ce miroir avait bien deux lieues de large et six de haut. Chacune s’y voyait selon ce qu’elle voulait être : la rouge y paraissait blonde, la brune avait les cheveux noirs, la vieille croyait être jeune, la jeune n’y vieillissait point ; enfin, tous les défauts y étaient si bien cachés, que l’on y venait des quatre coins du monde. Il y avait de quoi mourir de rire, de voir les grimaces et les minauderies que la plupart de ces coquettes faisaient. Cette circonstance n’y attirait pas moins d’hommes ; le miroir leur plaisait aussi.
Il faisait paraître aux uns de beaux cheveux, aux autres la taille plus haute et mieux prise, l’air martial, et meilleure mine. Les femmes, dont ils se moquaient, ne se moquaient pas moins d’eux ; de sorte que l’on appelait cette montagne de mille noms différents. Personne n’était jamais parvenu jusqu’au sommet ; et, quand on vit Florine, les dames poussèrent de longs cris de désespoir : « Où va cette malavisée ? disaient-elles. Sans doute qu’elle a assez d’esprit pour marcher sur notre glace ; du premier pas elle brisera tout. » Elles faisaient un bruit épouvantable.
La reine ne savait comment faire, car elle voyait un grand péril à descendre par là ; elle cassa un autre œuf, dont il sortit deux pigeons et un chariot, qui devint en même temps assez grand pour s’y placer commodément ; puis les pigeons descendirent doucement avec la reine, sans qu’il lui arrivât rien de fâcheux. Elle leur dit : « Mes petits amis, si vous vouliez me conduire jusqu’au lieu où le roi Charmant tient sa cour, vous n’obligeriez point une ingrate. » Les pigeons, civils et obéissants, ne s’arrêtèrent ni jour ni nuit qu’ils ne fussent arrivés aux portes de la ville. Florine descendit et leur donna à chacun un doux baiser plus estimable qu’une couronne.
Oh ! que le cœur lui battit en entrant ! elle se barbouilla le visage pour n’être point connue. Elle demanda aux passants où elle pouvait voir le roi. Quelques-uns se prirent à rire ! « Voir le roi ? lui dirent-ils ; oh ! que lui veux-tu, ma mie Souillon ? Va, va te décrasser, tu n’as pas les yeux assez bons pour voir un tel monarque. » La reine ne répondit rien : elle s’éloigna doucement et demanda encore à ceux qu’elle rencontra où elle se pourrait mettre pour voir le roi.
« Il doit venir demain au temple avec la princesse Truitonne lui dit-on ; car enfin il consent à l’épouser. »
Ciel ! quelle nouvelle ! Truitonne, l’indigne Truitonne sur le point d’épouser le roi ! Florine pensa mourir ; elle n’eut plus de force pour parler ni pour marcher : elle se mit sous une porte, assise sur des pierres, bien cachée de ses cheveux et de son chapeau de paille. « Infortunée que je suis ! disait-elle, je viens ici pour augmenter le triomphe de ma rivale et me rendre témoin de sa satisfaction ! C’était donc à cause d’elle que l’Oiseau Bleu cessa de me venir voir ! C’était pour ce petit monstre qu’il me faisait la plus cruelle de toutes les infidélités, pendant qu’abîmée dans la douleur je m’inquiétais pour la conservation de sa vie ! Le traître avait changé ; et, se souvenant moins de moi que s’il ne m’avait jamais vue, il me laissait le soin de m’affliger de sa trop longue absence, sans se soucier de la mienne. »
Quand on a beaucoup de chagrin, il est rare d’avoir bon appétit ; la reine chercha où se loger, et se coucha sans souper. Elle se leva avec le jour, elle courut au temple ; elle n’y entra qu’après avoir essuyé mille rebuffades des gardes et des soldats. Elle vit le trône du roi et celui de Truitonne, qu’on regardait déjà comme la reine. Quelle douleur pour une personne aussi tendre et aussi délicate que Florine ! Elle s’approcha du trône de sa rivale ; elle se tint debout, appuyée contre un pilier de marbre. Le roi vint le premier, plus beau et plus aimable qu’il eût été de sa vie. Truitonne parut ensuite, richement vêtue, et si laide, qu’elle en faisait peur. Elle regarda la reine en fronçant le sourcil.
« Qui es-tu, lui dit-elle, pour oser t’approcher de mon excellente figure, et si près de mon trône d’or ?
— Je me nomme Mie-Souillon, répondit-elle ; je viens de loin pour vous vendre des raretés. » Elle fouilla aussitôt dans son sac de toile ; elle en tira des bracelets d’émeraude que le roi Charmant lui avait donnés. « Ho ! ho ! dit Truitonne, voilà de jolies verrines ; en veux-tu une pièce de cinq sous ?
— Montrez-les, madame, aux connaisseurs, dit la reine, et puis nous ferons notre marché. »
Truitonne, qui aimait le roi plus tendrement qu’une telle bête n’en était capable, étant ravie de trouver des occasions de lui parler, s’avança jusqu’à son trône et lui montra les bracelets, le priant de lui dire son sentiment. A la vue de ces bracelets, il se souvint de ceux qu’il avait donnés à Florine ; il pâlit, il soupira, et fut longtemps sans répondre ; enfin, craignant qu’on ne s’aperçût de l’état où ses différentes pensées le réduisaient, il se fit un effort et lui répliqua :
« Ces bracelets valent, je crois, autant que mon royaume ; je pensais qu’il n’y en avait qu’une paire au monde, mais en voilà de semblables. »
Truitonne revint de son trône, où elle avait moins bonne mine qu’une huître à l’écaille ; elle demanda à la reine combien, sans surfaire, elle voulait de ces bracelets.
« Vous auriez trop de peine à me les payer, madame, dit-elle ; il vaut mieux vous proposer un autre marché. Si vous me voulez procurer de coucher une nuit dans le cabinet des Echos qui est au palais du roi, je vous donnerai mes émeraudes.
— Je le veux bien, Mie-Souillon », dit Truitonne en riant comme une perdue et montrant des, dents plus longues que les défenses d’un sanglier.
Le roi ne s’informa point d’où venaient ces bracelets, moins par indifférence pour celle qui les présentait (bien qu’elle ne fût guère propre à faire naître la curiosité), que par un éloignement invincible qu’il sentait pour Truitonne. Or, il est à propos qu’on sache que, pendant qu’il était Oiseau Bleu, il avait conté à la princesse qu’il y avait sous son appartement un cabinet, qu’on appelait le cabinet des Échos, qui était si ingénieusement fait, que tout ce qui s’y disait fort bas était entendu du roi lorsqu’il était couché dans sa chambre ; et, comme Florine voulait lui reprocher son infidélité, elle n’en avait point imaginé de meilleur moyen.
On la mena dans le cabinet par ordre de Truitonne : elle commença ses plaintes et ses regrets. « Le malheur dont je voulais douter n’est que trop certain, cruel Oiseau Bleu ! dit-elle ; tu m’as oubliée, tu aimes mon indigne rivale ! Les bracelets que j’ai reçus de ta déloyale main n’ont pu me rappeler à ton souvenir, tant j’en suis éloignée ! » Alors les sanglots interrompirent ses paroles, et, quand elle eut assez de forces pour parler, elle se plaignit encore et continua jusqu’au jour. Les valets de chambre l’avaient entendue toute la nuit gémir et soupirer : ils le dirent à Truitonne, qui lui demanda quel tintamarre elle avait fait.
La reine lui dit qu’elle dormait si bien, qu’ordinairement elle rêvait et qu’elle parlait très souvent haut. Pour le roi, il ne l’avait point entendue, par une fatalité étrange : c’est que, depuis qu’il avait aimé Florine, il ne pouvait plus dormir, et lorsqu’il se mettait au lit pour prendre quelque repos, on lui donnait de l’opium.
La reine passa une partie du jour dans une étrange inquiétude. « S’il m’a entendue, disait-elle, se peut-il une indifférence plus cruelle ? S’il ne m’a pas entendue, que ferai-je pour parvenir à me faire entendre ? » Il ne se trouvait plus de raretés extraordinaires, car des pierreries sont toujours belles ; mais il fallait quelque chose qui piquât le goût de Truitonne : elle eut recours à ses œufs. Elle en cassa un ; aussitôt il en sortit un petit carrosse d’acier poli, garni d’or de rapport : il était attelé de six souris vertes, conduites par un raton couleur de rose, et le postillon, qui était aussi de famille ratonnière, était gris de lin. Il y avait dans ce carrosse quatre marionnettes plus fringantes et plus spirituelles que toutes celles qui paraissent aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent ; elles faisaient des choses surprenantes, particulièrement deux petites Égyptiennes qui, pour danser la sarabande et les passe-pieds, ne l’auraient pas cédé à Léance.
La reine demeura ravie de ce nouveau chef-d’œuvre de l’art nécromancien ; elle ne dit mot jusqu’au soir, qui était l’heure que Truitonne allait à la promenade ; elle se mit dans une allée, faisant galoper ses souris, qui traînaient le carrosse, les ratons et les marionnettes. Cette nouveauté étonna si fort Truitonne, qu’elle s’écria deux ou trois fois :
« Mie-Souillon, Mie-Souillon, veux-tu cinq sous du carrosse et de ton attelage souriquois ?
— Demandez aux gens de lettres et aux docteurs de ce royaume, dit Florine, ce qu’une telle merveille peut valoir, et je m’en rapporterai à l’estimation du plus savant. »
Truitonne, qui était absolue en tout, lui répliqua : « Sans m’importuner plus longtemps de ta crasseuse présence, dis-m’en le prix.
— Dormir encore dans le cabinet des Échos, dit-elle, est tout ce que je demande.
— Va, pauvre bête, répliqua Truitonne, tu n’en seras pas refusée » ; et se tournant vers ses dames : « Voilà une sotte créature, dit-elle, de retirer si peu d’avantages de ses raretés. »
La nuit vint. Florine dit tout ce qu’elle put imaginer de plus tendre, et elle le dit aussi inutilement qu’elle l’avait déjà fait, parce que le roi ne manquait jamais de prendre son opium. Les valets de chambre disaient entre eux :
« Sans doute que cette paysanne est folle : qu’est-ce qu’elle raisonne toute la nuit ?
— Avec cela, disaient les autres, il ne laisse pas d’y avoir de l’esprit et de la passion dans ce qu’elle conte. »
Elle attendait impatiemment le jour, pour voir quel effet ses discours auraient produit. « Quoi ! ce barbare est devenu sourd à ma voix ! disait-elle. Il n’entend plus sa chère Florine ? Ah ! quelle faiblesse de l’aimer encore ! que je mérite bien les marques de mépris qu’il me donne ! »
Mais elle y pensait inutilement, elle ne pouvait se guérir de sa tendresse. Il n’y avait plus qu’un œuf dans son sac dont elle dût espérer du secours ; elle le cassa : il en sortit un pâté de six oiseaux qui étaient bardés, cuits et fort bien apprêtés ; avec cela ils chantaient merveilleusement bien, disaient la bonne aventure, et savaient mieux la médecine qu’Esculape. La reine resta charmée d’une chose si admirable ; elle alla avec son pâté parlant dans l’antichambre de Truitonne.
Comme elle attendait qu’elle passât, un des valets de chambre du roi s’approcha d’elle et lui dit :
« Ma Mie-Souillon, savez-vous bien que, si le roi ne prenait pas de l’opium pour dormir, vous l’étourdiriez assurément ? car vous jasez la nuit d’une manière surprenante. »
Florine ne s’étonna plus de ce qu’il ne l’avait pas entendue ; elle fouilla dans son sac et lui dit :
« Je crains si peu d’interrompre le repos du roi, que, si vous voulez ne point lui donner d’opium ce soir, en cas que je couche dans ce même cabinet, toutes ces perles et tous ces diamants seront pour vous. »
Le valet de chambre y consentit et lui en donna sa parole.
A quelques moments de là, Truitonne vint ; elle aperçut la reine avec son pâté, qui feignait de le vouloir manger : « Que fais-tu là, Mie-Souillon ? lui dit-elle.
— Madame, répliqua Florine, je mange des astrologues, des musiciens et des médecins. »
En même temps tous les oiseaux se mettent à chanter plus mélodieusement que des sirènes ; puis ils s’écrièrent : « Donnez la pièce blanche et nous vous dirons votre bonne aventure. » Un canard, qui dominait, dit plus haut que les autres : « Can, can, can, je suis médecin, je guéris de tous les maux et de toute sorte de folie, hormis de celle d’amour. »
Truitonne, plus surprise de tant de merveilles qu’elle l’eût été de ses jours, jura « Par la vertu-chou, voilà un excellent pâté ! je le veux avoir ; çà, çà, Mie-SouilIon, que t’en donnerai-je ?
— Le prix ordinaire, dit-elle : coucher dans le cabinet des Échos, et rien davantage.
— Tiens, dit généreusement Truitonne (car elle était de belle humeur par l’acquisition d’un tel pâté), tu en auras une pistole. »
Florine, plus contente qu’elle l’eût encore été, parce qu’elle espérait que le roi l’entendrait, se retira en la remerciant.
Dès que la nuit parut, elle se fit conduire dans le cabinet, souhaitant avec ardeur que le valet de chambre lui tînt parole, et qu’au lieu de donner de l’opium au roi il lui présentât quelque autre chose qui pût le tenir éveillé. Lorsqu’elle crut que chacun s’était endormi, elle commença ses plaintes ordinaires. « A combien de périls me suis-je exposée, disait-elle, pour te chercher, pendant que tu me fuis et que tu veux épouser Truitonne. Que t’ai-je donc fait, cruel, pour oublier tes serments ? Souviens-toi de ta métamorphose, de mes bontés, de nos tendres conversations. » Elle les répéta presque toutes, avec une mémoire qui prouvait assez que rien ne lui était plus cher que ce souvenir.
Le roi ne dormait point, et il entendait si distinctement la voix de Florine et toutes ses paroles, qu’il ne pouvait comprendre d’où elles venaient ; mais son cœur, pénétré de tendresse, lui rappela si vivement l’idée de son incomparable princesse qu’il sentit sa séparation avec la même douleur qu’au moment où les couteaux l’avaient blessé sur le cyprès. Il se mit à parler de son côté comme la reine avait fait du sien : « Ah ! princesse, dit-il, trop cruelle pour un amant qui vous adorait ! est-il possible que vous m’ayez sacrifié à nos communs ennemis ! »
Florine entendit ce qu’il disait, et ne manqua pas de lui répondre et de lui apprendre que, s’il voulait entretenir la Mie-Souillon, il serait éclairci de tous les mystères qu’il n’avait pu pénétrer jusqu’alors. À ces mots, le roi, impatient, appela un de ses valets de chambre et lui demanda s’il ne pouvait point trouver Mie-Souillon et l’amener. Le valet de chambre répliqua que rien n’était plus aisé, parce qu’elle couchait dans le cabinet des Échos.
Le roi ne savait qu’imaginer. Quel moyen de croire qu’une si grande reine que Florine fût déguisée en souillon ? Et quel moyen de croire que Mie-Souillon eût la voix de la reine et sût des secrets si particuliers, à moins que ce ne fût elle-même ? Dans cette incertitude il se leva, et, s’habillant avec précipitation, il descendit par un degré dérobé dans le cabinet des Échos, dont la reine avait ôté la clef, mais le roi en avait une qui ouvrait toutes les portes du palais.
Il la trouva avec une légère robe de taffetas blanc, qu’elle portait sous ses vilains habits ; ses beaux cheveux couvraient ses épaules ; elle était couchée sur un lit de repos, et une lampe un peu éloignée ne rendait qu’une lumière sombre. Le roi entra tout d’un coup ; et, son amour l’emportant sur son ressentiment, dès qu’il la reconnut il vint se jeter à ses pieds, il mouilla ses mains de ses larmes et pensa mourir de joie, de douleur et de mille pensées différentes qui lui passèrent en même temps dans l’esprit.
La reine ne demeura pas moins troublée ; son cœur se serra, elle pouvait à peine soupirer. Elle regardait fixement le roi sans lui rien dire ; et, quand elle eut la force de lui parler, elle n’eut pas celle de lui faire des reproches ; le plaisir de le revoir lui fit oublier pour quelque temps les sujets de plainte qu’elle croyait avoir. Enfin, ils s’éclaircirent, ils se justifièrent ; leur tendresse se réveilla ; et tout ce qui les embarrassait, c’était la fée Soussio.
Mais dans ce moment, l’enchanteur, qui aimait le roi, arriva avec une fée fameuse : c’était justement celle qui donna les quatre œufs à Florine. Après les premiers compliments, l’enchanteur et la fée déclarèrent que, leur pouvoir étant uni en faveur du roi et de la reine, Soussio ne pouvait rien contre eux, et qu’ainsi leur mariage ne recevrait aucun retardement.
Il est aisé de se figurer la joie de ces deux jeunes amants : dès qu’il fut jour, on la publia dans tout le palais, et chacun était ravi de voir Florine. Ces nouvelles allèrent jusqu’à Truitonne ; elle accourut chez le roi ; quelle surprise d’y trouver sa belle rivale ! Dès qu’elle voulut ouvrir la bouche pour lui dire des injures, l’enchanteur et la fée parurent, qui la métamorphosèrent en truie, afin qu’il lui restât au moins une partie de son nom et de son naturel grondeur.
Elle s’enfuit toujours grognant jusque dans la basse-cour, où de longs éclats de rire que l’on fit sur elle achevèrent de la désespérer.
Le roi Charmant et la reine Florine, délivrés d’une personne si odieuse, ne pensèrent plus qu’à la fête de leurs noces ; la galanterie et la magnificence y parurent également ; il est aisé de juger de leur félicité, après de si longs malheurs.
Quand Truitonne aspirait à l’hymen de Charmant,
Et que, sans avoir pu lui plaire,
Elle voulait former ce triste engagement
Que la mort seule peut défaire,
Qu’elle était imprudente, hélas !
Sans doute elle ignorait qu’un pareil mariage
Devient un funeste esclavage,
Si l’amour ne le forme pas.
Je trouve que Charmant fut sage.
A mon sens, il vaut beaucoup mieux
Être Oiseau Bleu, corbeau, devenir hibou même,
Que d’éprouver la peine extrême
D’avoir ce que l’on hait toujours devant les yeux,
En ces sortes d’hymens notre siècle est fertile :
Les hymens seraient plus heureux,
Si l’on trouvait encore quelque enchanteur habile
Qui voulût s’opposer à ces coupables nœuds,
Et ne jamais souffrir que l’hyménée unisse,
Par intérêt ou par caprice,
Deux cœurs infortunés, s’ils ne s’aiment tous deux.
 votre commentaire
votre commentaire
-





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 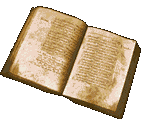
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot