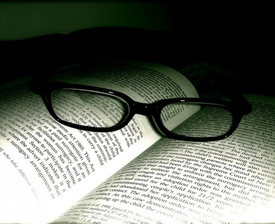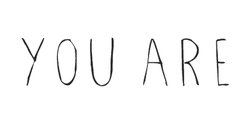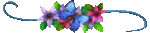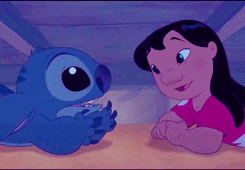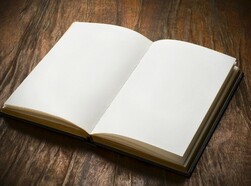-
DOCUMENTS ET ESSAIS
♥ Du contrat social ou Principes du droit politique
♥ Discours de la méthode (René Descartes)
♥ Apologie de Socrate (Platon)
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
-
Par Salomé ATTIA le 22 Décembre 2015 à 20:01
Apologie de Socrate
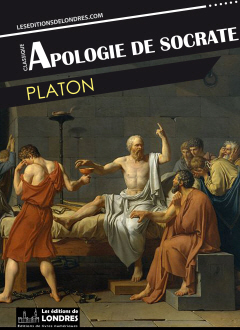
JE ne sais, Athéniens, quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous. Pour moi, en les entendant, peu s’en est fallu que je ne me méconnusse moi-même, tant ils ont parlé d’une manière persuasive ; et cependant, à parler franchement, ils n’ont pas dit un mot qui soit véritable.
Mais, parmi tous les mensonges qu’ils ont débités, ce qui m’a le plus surpris, c’est lorsqu’ils vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence ; car, de n’avoir pas craint la honte du démenti que je vais leur donner tout-à-l’heure, en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent, voilà ce qui m’a paru le comble de l’impudence, à moins qu’ils n’appellent éloquent celui qui dit la vérité. Si c’est là ce qu’ils veulent dire, j’avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière ; car, encore une fois, ils n’ont pas dit un mot qui soit véritable ; et de ma bouche vous entendrez la vérité toute entière, non pas, il est vrai, Athéniens, dans les discours étudiés, comme ceux de mes adversaires, et brillants de tous les artifices du langage, mais au contraire dans les termes qui se présenteront à moi les premiers ; en effet, j’ai la confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste. Ainsi que personne n’attende de moi autre chose. Vous sentez bien qu’il ne me siérait guère, à mon âge, de paraître devant vous comme un jeune homme qui s’exerce à bien parler. C’est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c’est que, si vous m’entendez employer pour ma défense le même langage dont j’ai coutume de me servir dans la place publique, aux comptoirs des banquiers, où vous m’avez souvent entendu, ou partout ailleurs, vous n’en soyez pas surpris, et ne vous emportiez pas contre moi ; car c’est aujourd’hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, à l’âge de plus de soixante-dix ans ; véritablement donc je suis étranger au langage qu’on parle ici. Eh bien ! de même que, si j’étais réellement un étranger, vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays, je vous conjure, et je ne crois pas vous faire une demande injuste, de me laisser maître de la forme de mon discours, bonne ou mauvaise, et de considérer seulement, mais avec attention, si ce que je dis est juste ou non : c’est en cela que consiste toute la vertu du juge ; celle de l’orateur est de dire la vérité.
D’abord, Athéniens, il faut que je réfute les premières accusations dont j’ai été l’objet, et mes premiers accusateurs ; ensuite les accusations récentes et les accusateurs qui viennent de s’élever contre moi. Car, Athéniens, j’ai beaucoup d’accusateurs auprès de vous, et depuis bien des années, qui n’avancent rien qui ne soit faux, et que pourtant je crains plus qu’Anytus[1] et ceux, qui se joignent à lui[2], bien que ceux-ci soient très redoutables ; mais les autres le sont encore beaucoup plus. Ce sont eux, Athéniens, qui, s’emparant de la plupart d’entre vous dès votre enfance, vous ont répété, et vous ont fait accroire qu’il y a un certain Socrate, homme savant, qui s’occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, et qui d’une mauvaise cause en sait faire une bonne. Ceux qui répandent ces bruits, voilà mes vrais accusateurs ; car, en les entendant, on se persuade que les hommes, livrés à de pareilles recherches, ne croient pas qu’il y ait des dieux. D’ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand nombre, et il y a déjà longtemps qu’ils travaillent à ce complot ; et puis, ils vous ont prévenus de cette opinion dans l’âge de la crédulité ; car alors vous étiez enfants pour la plupart, ou dans la première jeunesse : ils m’accusaient donc auprès de vous tout à leur aise, plaidant contre un homme qui ne se défend pas ; et ce qu’il y a de plus bizarre, c’est qu’il ne m’est pas permis de connaître, ni de nommer mes accusateurs, à l’exception d’un certain faiseur de comédies. Tous ceux qui, par envie et pour me décrier, vous ont persuadé ces faussetés, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, ont persuadé les autres, échappent à toute poursuite, et je ne puis ni les appeler devant vous, ni les réfuter ; de sorte que je me vois réduit à combattre des fantômes, et à me défendre sans que personne m’attaque. Ainsi mettez-vous dans l’esprit que j’ai affaire à deux sortes d’accusateurs, comme je viens de le dire ; les uns qui m’ont accusé depuis long-temps, les autres qui m’ont cité en dernier lieu ; et croyez, je vous prie, qu’il est nécessaire que je commence par répondre aux premiers ; car ce sont eux que vous avez d’abord écoutés, et ils ont fait plus d’impression sur vous que les autres.
Eh bien donc ! Athéniens, il faut se défendre, et tâcher d’arracher de vos esprits une calomnie qui y est déjà depuis long-temps, et cela en aussi peu d’instants. Je souhaite y réussir, s’il en peut résulter quelque bien pour vous et pour moi ; je souhaite que cette défense me serve ; mais je regarde la chose comme très difficile, et je ne m’abuse point à cet égard. Cependant qu’il arrive tout ce qu’il plaira aux dieux, il faut obéir à la loi, et se défendre.
Reprenons donc dans son principe l’accusation sur laquelle s’appuient mes calomniateurs, et qui a donné à Mélitus la confiance de me traduire devant le tribunal. Voyons ; que disent mes calomniateurs ? Car il faut mettre leur accusation dans les formes, et la lire comme si, elle était écrite, et le serment prêté[3] : Socrate est un homme dangereux qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, fait une bonne cause d’une mauvaise, et enseigne aux autres ces secrets pernicieux. Voilà l’accusation ; c’est ce que vous avez vu dans la comédie d’Aristophane, où l’on représente un certain Socrate, qui dit qu’il se promène dans les airs et autres semblables extravagances[4] sur des choses où je n’entends absolument rien ; et je ne dis pas cela pour déprécier ce genre de connaissances, s’il y a quelqu’un qui y soit habile (et que Mélitus n’aille pas me faire ici de nouvelles affaires) ; mais c’est qu’en effet, je ne me suis jamais mêlé de ces matières, et je puis en prendre à témoin la plupart d’entre vous. Je vous conjure donc tous tant que vous êtes avec qui j’ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre, je vous conjure de déclarer si vous m’avez jamais entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près ni de loin ; par là, vous jugerez des autres parties de l’accusation, où il n’y a pas un mot de vrai. Et si l’on vous dit que je me mêle d’enseigner, et que j’exige un salaire, c’est encore une fausseté. Ce n’est pas que je ne trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes, comme font Gorgias de Léontium[5], Prodicus de Céos[6], et Hippias d’Élis[7]. Ces illustres personnages parcourent toute la Grèce, attirant les jeunes gens qui pourraient, sans aucune dépense, s’attacher à tel de leurs concitoyens qu’il leur plairait de choisir ; ils savent leur persuader de laisser là leurs concitoyens, et de venir à eux : ceux-ci les paient bien, et leur ont encore beaucoup d’obligation. J’ai ouï dire aussi qu’il était arrivé ici un homme de Paros, qui est fort habile ; car m’étant trouvé l’autre jour chez un homme qui dépense plus en sophistes que tous nos autres, citoyens ensemble, Callias, fils d’Hipponicus[8], je m’avisai de lui dire, en parlant de ses deux fils : Callias, si, pour enfans, tu avais deux jeunes chevaux ou deux jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre entre les mains d’un habile homme, que nous paierions bien, afin qu’il les rendît aussi beaux et aussi bons qu’ils peuvent être, et qu’il leur donnât toutes les perfections de leur nature ? Et cet homme, ce serait probablement un cavalier ou un laboureur. Mais, puisque pour enfants tu as des hommes, à qui as-tu résolu de les confier ? Quel maître avons-nous en ce genre, pour les vertus de l’homme et du citoyen ? Je m’imagine qu’ayant des enfants, tu as dû penser à cela ? As-tu quelqu’un ? lui dis-je. Sans doute, me répondit-il. Et qui donc ? repris-je ; d’où est-il ? Combien prend-il ? C’est Évène[9], Socrate, me répondit Callias ; il est de Paros, et prend cinq mines[10]. Alors je félicitai Évène, s’il était vrai qu’il eût ce talent, et qu’il l’enseignât à si bon marché. Pour moi, j’avoue que je serais bien fier et bien glorieux, si j’avais cette habileté ; mais malheureusement je ne l’ai point, Athéniens.
Et ici quelqu’un de vous me dira sans doute : Mais, Socrate, que fais-tu donc ? Et d’où viennent ces calomnies que l’on a répandues contre toi ? Car si tu ne faisais rien de plus ou autrement que les autres, on n’aurait jamais tant parlé de toi. Dis-nous donc ce que c’est, afin que nous ne portions pas un jugement téméraire. Rien de plus juste assurément qu’un pareil langage ; et je vais tâcher de vous expliquer ce qui m’a fait tant de réputation et tant d’ennemis. Écoutez-moi ; quelques-uns de vous croiront peut-être que je ne parle pas sérieusement ; mais soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la vérité. En effet, Athéniens, la réputation que j’ai acquise vient d’une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse ? C’est peut-être une sagesse purement humaine ; et je cours grand risque de n’être sage que de celle-là, tandis que les hommes dont je viens de vous parler sont sages d’une sagesse bien plus qu’humaine. Je n’ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l’ai point ; et qui le prétend en impose et veut me calomnier. Mais je vous conjure, Athéniens, de ne pas vous émouvoir, si ce que je vais vous dire vous paraît d’une arrogance extrême ; car je ne vous dirai rien qui vienne de moi, et je ferai parler devant vous une autorité digne de votre confiance ; je vous donnerai de ma sagesse un témoin qui vous dira si elle est, et quelle elle est ; et ce témoin c’est le dieu de Delphes. Vous connaissez tous Chérephon, c’était mon ami d’enfance ; il l’était aussi de la plupart d’entre vous ; il fut exilé avec vous, et revint avec vous. Vous savez donc quel homme c’était que Chérephon[11], et quelle ardeur il mettait dans tout ce qu’il entreprenait. Un jour, étant allé à Delphes, il eut la hardiesse de demander à l’oracle (et je vous prie encore une fois de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire) ; il lui demanda s’il y avait au monde un homme plus sage que moi : la Pythie lui répondit qu’il n’y en avait aucun[12]. À défaut de Chérephon, qui est mort, son frère, qui est ici, pourra vous le certifier. Considérez bien, Athéniens, pourquoi je vous dis toutes ces choses, c’est uniquement pour vous faire voir d’où viennent les bruits qu’on a fait courir contre moi. Quand je sus la réponse de l’oracle, je me dis en moi-même : que veut dire le dieu ? Quel sens cachent ses paroles ? Car je sais bien qu’il n’y a en moi aucune sagesse, ni petite ni grande ; que veut-il donc dire, en me déclarant le plus sage des hommes ? Car enfin il ne ment point ; un dieu ne saurait mentir. Je fus long-temps dans une extrême perplexité sur le sens de l’oracle, jusqu’à ce qu’enfin, après bien des incertitudes, je pris le parti que vous allez entendre pour connaître l’intention du dieu. J’allai chez un de nos concitoyens, qui passe pour un des plus sages de la ville ; et j’espérais que là, mieux qu’ailleurs, je pourrais confondre l’oracle, et lui dire : tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui-ci est plus sage que moi. Examinant donc cet homme, dont je n’ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c’était un de nos plus grands politiques, et m’entretenant avec lui, je trouvai qu’il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu’il ne l’était point. Après cette découverte, je m’efforçai de lui faire voir qu’il n’était nullement ce qu’il croyait être ; et voilà déjà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient à notre conversation. Quand je l’eus quitté, je raisonnai ainsi en moi-même : je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux ; mais il y a cette différence que lui, il croit savoir, quoiqu’il ne sache rien ; et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela du moins je suis un peu plus sage, que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. De là, j’allai chez un autre, qui passait encore pour plus sage que le premier ; je trouvai la même chose, et je me fis là de nouveaux ennemis. Cependant je ne me rebutai point ; je sentais bien quelles haines j’assemblais sur moi ; j’en étais affligé, effrayé même. Malgré cela, je crus que je devais préférer à toutes choses la voix du dieu, et, pour en trouver le véritable sens, aller de porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de réputation ; et je vous jure[13], Athéniens, car il faut vous dire la vérité, que voici le résultat que me laissèrent mes recherches : Ceux qu’on vantait le plus me satisfirent le moins, et ceux dont on n’avait aucune opinion, je les trouvai beaucoup plus près de la sagesse. Mais il faut achever de vous raconter mes courses et les travaux que j’entrepris. Pour m’assurer de la vérité de l’oracle. Après les politiques, je m’adressai aux poètes tant à ceux qui font des tragédies, qu’aux poètes dithyrambiques et autres, ne doutant point que je ne prisse là sur le fait mon ignorance et leur supériorité. Prenant ceux de leurs ouvrages qui me paraissaient travaillés avec le plus de soin, je leur demandai ce qu’ils avaient voulu dire, désirant m’instruire dans leur entretien. J’ai honte, Athéniens, de vous dire la vérité ; mais il faut pourtant vous la dire. De tous ceux qui étaient là présents, il n’y en avait presque pas un qui ne fut capable de rendre compte de ces poèmes mieux que ceux qui les avaient faits. Je reconnus donc bientôt que ce n’est pas la raison qui, dirige le poète, mais une sorte d’inspiration naturelle, un enthousiasme semblable à celui qui transporte le prophète et le devin, qui disent tous de fort belles choses, mais sans rien comprendre, à ce qu’ils disent. Les poètes me parurent dans le même cas, et je m’aperçus en même temps qu’à cause de leur talent pour la poésie, ils se croyaient sur tout le reste les plus sages des hommes ; ce qu’ils n’étaient en aucune manière. Je les quittai donc, persuadé que j’étais au-dessus d’eux, par le même endroit qui m’avait mis au-dessus des politiques. Des poètes, je passai aux artistes. J’avais la conscience de n’entendre rien aux arts, et j’étais bien persuadé que les artistes possédaient mille secrets admirables, en quoi je ne me trompais point. Ils savaient bien des choses que j’ignorais, et en cela ils étaient beaucoup plus habiles que moi. Mais, Athéniens, les plus habiles me parurent tomber dans les mêmes défauts que les poètes ; il n’y en avait pas un qui, parce qu’il excellait dans son art, ne crut très-bien savoir les choses les plus importantes, et cette folle présomption gâtait leur habileté, de sorte que, me mettant à la place de l’oracle, et me demandant à moi-même lequel j’aimerais mieux ou d’être tel que je suis, sans leur habileté et aussi sans leur ignorance, ou d’avoir leurs avantages avec leurs défauts, je me répondis à moi-même et à l’oracle : J’aime mieux être comme je suis. Ce sont ces recherches, Athéniens, qui ont excité contre moi tant d’inimitiés dangereuses ; de là toutes les calomnies répandues sur mon compte, et ma réputation de sage ; car tous ceux qui m’entendent croient que je sais toutes les choses sur lesquelles je démasque l’ignorance des autres. Mais, Athéniens, la vérité est qu’Apollon seul est sage, et qu’il a voulu dire seulement, par son oracle, que toute la sagesse humaine n’est pas grand’chose, ou même qu’elle n’est rien ; et il est évident que l’oracle ne parle pas ici de moi, mais qu’il s’est servi de mon nom comme d’un exemple, et comme s’il eût dit à tous les hommes : Le plus sage d’entre vous, c’est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n’est rien. Convaincu de cette vérité, pour m’en assurer encore davantage, et pour obéir au dieu, je continue ces recherches, et vais examinant tous ceux de nos concitoyens et des étrangers, en qui j’espère trouver la vraie sagesse ; et quand je ne l’y trouve point, je sers d’interprète à l’oracle ; en leur faisant voir qu’ils ne sont point sages. Cela m’occupe si fort, que je n’ai pas eu le temps d’être un peu utile à la république, ni à ma famille, et mon dévouement au service du dieu m’a mis dans une gêne extrême. D’ailleurs beaucoup de jeunes gens, qui ont du loisir, et qui appartiennent à de riches familles, s’attachent à moi, et prennent un grand plaisir à voir de quelle manière j’éprouve les hommes ; eux-mêmes ensuite tâchent de m’imiter, et se mettent à éprouver ceux qu’ils rencontrent ; et je ne doute pas qu’ils ne trouvent une abondante moisson ; car il ne manque pas de gens qui croient tout savoir, quoiqu’ils ne sachent rien, ou très-peu de chose. Tous ceux qu’ils convainquent ainsi d’ignorance s’en prennent à moi, et non pas à eux, et vont disant qu’il y a un certain Socrate, qui est une vraie peste pour les jeunes gens ; et quand on leur demande ce que fait ce Socrate, ou ce qu’il enseigne, ils n’en savent rien ; mais, pour ne pas demeurer court, ils mettent en avant ces accusations banales qu’on fait ordinairement aux philosophes ; qu’il recherche ce qui se passe dans le ciel et sous la terre ; qu’il ne croit point aux dieux, et qu’il rend bonnes les plus mauvaises causes ; car ils n’osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le fait, et montre qu’ils font semblant de savoir, quoiqu’ils ne sachent rien. Intrigants, actifs et nombreux, parlant de moi d’après un plan concerté et avec une éloquence fort capable de séduire, ils vous ont depuis long-temps rempli les oreilles des bruits les plus perfides, et poursuivent sans relâche leur système de calomnie. Aujourd’hui ils me détachent Mélitus, Anytus et Lycon. Mélitus représente les poètes ; Anytus, les politiques et les artistes ; Lycon, les orateurs. C’est pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais comme un miracle, si, en aussi peu de temps, je pouvais détruire une calomnie qui a déjà de vieilles racines dans vos esprits.
Vous avez entendu, Athéniens, la vérité toute pure ; je ne vous cache et ne vous déguise rien, quoique je n’ignore pas que tout ce que je dis ne fait qu’envenimer la plaie ; et c’est cela même qui prouve que je dis la vérité, et que je ne me suis pas trompé sur la source de ces calomnies : et vous vous en convaincrez aisément, si vous voulez vous donner la peine d’approfondir cette affaire, ou maintenant ou plus tard.
Voilà contre mes premiers accusateurs une apologie suffisante ; venons présentement aux derniers, et tâchons de répondre à Mélitus, cet homme de bien, si attaché à sa patrie, à ce qu’il assure. Reprenons cette dernière accusation comme nous avons fait la première ; voici à-peu-près comme elle est conçue : Socrate est coupable, en ce qu’il corrompt les jeunes gens, ne reconnaît pas la religion de l’état, et met à la place des extravagances démoniaques[14]. Voilà l’accusation ; examinons-en tous les chefs l’un après l’autre.
Il dit que je suis coupable, en ce que je corromps les jeunes gens. Et moi, Athéniens, je dis que c’est Mélitus qui est coupable, en ce qu’il se fait un jeu des choses sérieuses, et, de gaité de cœur, appelle les gens en justice pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses dont il ne s’est jamais mis en peine ; et je m’en vais vous le prouver. Viens ici, Mélitus ; dis-moi : Y a-t-il rien que tu aies tant à cœur que de rendre les jeunes gens aussi vertueux qu’ils peuvent l’être ?
MÉLITUS.
Non, sans doute.
SOCRATE.
Eh bien donc, dis à nos juges qui est-ce qui est capable de rendre les jeunes gens meilleurs ; car il ne faut pas douter que tu ne le saches, puisque cela t’occupe si fort. En effet, puisque tu as découvert celui qui les corrompt, et que tu l’as dénoncé devant ce tribunal, il faut que tu dises qui est celui qui peut les rendre meilleurs. Parle, Mélitus… tu vois que tu es interdit, et ne sais que répondre : cela ne te semble-t-il pas honteux, et n’est-ce pas une preuve certaine que tu ne t’es jamais soucié de l’éducation de la jeunesse ? Mais, encore une fois, digne Mélitus, dis-nous qui peut rendre les jeunes gens meilleurs.
MÉLITUS.
Les lois.
SOCRATE.
Ce n’est pas là, excellent Mélitus, ce que je te demande. Je te demande qui est-ce ? Quel est l’homme ? Il est bien sûr que la première chose qu’il faut que cet homme sache, ce sont les lois.
MÉLITUS.
Ceux que tu vois ici, Socrate ; les juges.
SOCRATE.
Comment dis-tu, Mélitus ? Ces juges sont capables d’instruire les jeunes gens et de les rendre meilleurs ?
MÉLITUS.
Certainement.
SOCRATE.
Sont-ce tous ces juges, ou y en a-t-il parmi eux qui le puissent, et d’autres qui ne le puissent pas ?
MÉLITUS.
Tous.
SOCRATE.
À merveille, par Junon ; tu nous as trouvé un grand nombre de bons précepteurs. Mais poursuivons ; et tous ces citoyens qui nous écoutent peuvent-ils aussi rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas ?
MÉLITUS.
Ils le peuvent aussi.
SOCRATE.
Et les sénateurs ?
MÉLITUS.
Les sénateurs aussi.
SOCRATE.
Mais, mon cher Mélitus, tous ceux qui assistent aux assemblées du peuple ne pourraient-ils donc pas corrompre la jeunesse, ou sont-ils aussi tous capables de la rendre vertueuse ?
MÉLITUS.
Ils en sont tous capables.
SOCRATE.
Ainsi, selon toi, tous les Athéniens peuvent être utiles à la jeunesse, hors moi ; il n’y a que moi qui la corrompe : n’est-ce pas là ce que tu dis ?
MÉLITUS.
C’est cela même.
SOCRATE.
En vérité, il faut que j’aie bien du malheur ; mais continue de me répondre. Te paraît-il qu’il en soit de même des chevaux ? Tous les hommes peuvent-ils les rendre meilleurs, et n’y en a-t-il qu’un seul qui ait le secret de les gâter ? Ou est-ce tout le contraire ? N’y a-t-il qu’un seul homme, ou un bien petit nombre, savoir les écuyers, qui soient capables de les dresser ? Et les autres hommes, s’ils veulent les monter et s’en servir, ne les gâtent-ils pas ? N’en est-il pas de-même de tous les animaux ? Oui, sans doute, soit qu’Anytus et toi vous en conveniez ou que vous n’en conveniez point ; et, en vérité, ce serait un grand bonheur pour la jeunesse, qu’il n’y eût qu’un seul homme qui pût la corrompre, et que tous les autres pussent la rendre vertueuse. Mais tu as suffisamment prouvé, Mélitus, que l’éducation de la jeunesse ne t’a jamais fort inquiété ; et tes discours viennent de faire paraître clairement que tu ne t’es jamais occupé de la chose même pour laquelle tu me poursuis.
D’ailleurs, je t’en prie au nom de Jupiter, Mélitus, réponds à ceci : Lequel est le plus avantageux d’habiter avec des gens de bien, ou d’habiter avec des méchants ? Réponds-moi, mon ami, car je ne te demande rien de difficile. N’est-il pas vrai que les méchants font toujours quelque mal à ceux qui les fréquentent, et que les bons font toujours quelque bien à ceux qui vivent avec eux ?
MÉLITUS.
Sans doute.
SOCRATE.
Y a-t-il donc quelqu’un qui aime mieux recevoir du préjudice de la part de ceux qu’il fréquente, que d’en recevoir de l’utilité ? Réponds-moi, Mélitus ; car la loi ordonne de répondre. Y a-t-il quelqu’un qui aime mieux recevoir du mal que du bien ?
MÉLITUS.
Non, il n’y a personne.
SOCRATE.
Mais voyons, quand tu m’accuses de corrompre la jeunesse, et de la rendre plus méchante, dis-tu que je la corromps à dessein, ou sans le vouloir ?
MÉLITUS.
À dessein.
SOCRATE.
Quoi donc ! Mélitus, à ton âge, ta sagesse surpasse-t-elle de si loin la mienne à l’âge ou je suis parvenu, que tu saches fort bien que les méchants fassent toujours du mal à ceux qui les fréquentent et que les bons leur font du bien, et que moi je sois assez ignorant pour ne savoir pas qu’en rendant méchant quelqu’un de ceux qui ont avec moi un commerce habituel, je m’expose à en recevoir du mal, et pour ne pas laisser malgré cela de m’attirer ce mal, le voulant et le sachant ? En cela, Mélitus, je ne te crois point, et je ne pense pas qu’il y ait un homme au monde qui puisse te croire. Il faut de deux choses l’une, ou que je ne corrompe pas les jeunes gens, ou, si je les corromps, que ce soit malgré moi et sans le savoir : et, dans tous les cas, tu es un imposteur. Si c’est malgré moi que je corromps la jeunesse, la loi ne veut pas qu’on appelle en justice pour des fautes involontaires ; mais elle veut qu’on prenne en particulier ceux qui les commettent, et qu’on les instruise ; car il est bien sûr qu’étant instruit, je cesserai de faire ce que je fais malgré moi : mais tu t’en es bien gardé ; tu n’as pas voulu me voir et m’instruire, et tu me traduis devant ce tribunal, où la loi veut qu’on cite ceux qui ont mérité des punitions, et non pas ceux qui n’ont besoin que de remontrances. Ainsi, Athéniens, voilà une preuve bien évidente de ce que je vous disais, que Mélitus ne s’est jamais mis en peine de toutes ces choses-là, et qu’il n’y a jamais pensé. Cependant, voyons ; dis-nous comment je corromps les jeunes gens : n’est-ce pas, selon ta dénonciation écrite, en leur apprenant à ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la patrie, et en leur enseignant des extravagances sur les démons ? N’est-ce pas là ce que tu dis ?
MÉLITUS.
Précisément.
SOCRATE.
Mélitus, au nom de ces mêmes dieux dont il s’agit maintenant, explique-toi d’une manière un peu plus claire, et pour moi et pour ces juges ; car je ne comprends pas si tu m’accuses d’enseigner qu’il y a bien des dieux (et dans ce cas, si je crois qu’il y a des dieux, je ne suis donc pas entièrement athée, et ce n’est pas là en quoi je suis coupable), mais des dieux qui ne sont pas ceux de l’état : est-ce là de quoi tu m’accuses ? ou bien m’accuses-tu de n’admettre aucun dieu, et d’enseigner aux autres à n’en reconnaître aucun ?
MÉLITUS.
Je t’accuse de ne reconnaître aucun dieu.
SOCRATE.
O merveilleux Mélitus ! pourquoi dis-tu cela ? Quoi ! je ne crois pas, comme les autres hommes, que le soleil et la lune sont des dieux ?
MÉLITUS.
Non, par Jupiter, Athéniens, il ne le croit pas ; car il dit que le soleil est une pierre, et la lune une terre.
SOCRATE.
Tu crois accuser Anaxagore[15], mon cher Mélitus, et tu méprises assez nos juges, tu les crois assez ignorants, pour penser qu’ils ne savent pas que les livres d’Anaxagore de Clazomènes sont pleins de pareilles assertions. D’ailleurs, les jeunes gens viendraient-ils chercher auprès de moi avec tant d’empressement une doctrine qu’ils pourraient aller à tout moment entendre débiter à l’orchestre, pour une dragme tout au plus, et qui leur donnerait une belle occasion de se moquer de Socrate, s’il s’attribuait ainsi des opinions qui ne sont pas à lui, et qui sont si étranges et si absurdes ? Mais dis-moi, au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais aucun dieu.
MÉLITUS.
Oui, par Jupiter, tu n’en reconnais aucun.
SOCRATE.
En vérité, Mélitus, tu dis là des choses incroyables, et auxquelles toi-même, à ce qu’il me semble, tu ne crois pas. Pour moi, Athéniens, il me paraît que Mélitus est un impertinent, qui n’a intenté cette accusation que pour m’insulter, et par une audace de jeune homme ; il est venu ici pour me tenter, en proposant une énigme, et disant en lui-même : Voyons si Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra que je me moque, et que je dis des choses qui se contredisent, ou si je le tromperai, lui et tous les auditeurs. En effet, il paraît entièrement se contredire dans son accusation ; c’est comme s’il disait : Socrate est coupable en ce qu’il ne reconnaît pas de dieux, et en ce qu’il reconnaît des dieux ; vraiment c’est là se moquer. Suivez-moi, je vous en prie, Athéniens, et examinez avec moi en quoi je pense qu’il se contredit. Réponds, Mélitus ; et vous, juges, comme je vous en ai conjurés au commencement, souffrez que je parle ici à ma manière ordinaire. Dis, Mélitus ; y a-t-il quelqu’un dans le monde qui croie qu’il y ait des choses humaines, et qui ne croie pas qu’il y ait des hommes ?… Juges, ordonnez qu’il réponde et qu’il ne fasse pas tant de bruit. Y a-t-il quelqu’un qui croie qu’il y a des règles pour dresser les chevaux, et qu’il n’y a pas de chevaux ? des airs de flûte, et point de joueurs de flûte ?… Il n’y a personne, excellent Mélitus. C’est moi qui te le dis, puisque tu ne veux pas répondre, et qui le dis à toute l’assemblée. Mais réponds à ceci : Y a-t-il quelqu’un qui admette quelque chose relatif aux démons, et qui croie pourtant qu’il n’y a point de démons ?
MÉLITUS.
Non, sans doute.
SOCRATE.
Que tu m’obliges de répondre enfin, et à grand’peine, quand les juges t’y forcent ! Ainsi tu conviens que j’admets et que j’enseigne quelque chose sur les démons : que mon opinion, soit nouvelle, ou soit ancienne, toujours est-il, d’après toi-même, que j’admets quelque chose sur les démons ; et tu l’as juré dans ton accusation. Mais si j’admets quelque chose sur les démons, il faut nécessairement que j’admette des démons ; n’est-ce pas ?… Oui, sans doute ; car je prends ton silence pour un consentement. Or, ne regardons-nous pas les démons comme des dieux, ou des enfants des dieux ? En conviens-tu, oui ou non ?
MÉLITUS.
J’en conviens.
SOCRATE.
Et par conséquent, puisque j’admets des démons de ton propre aveu, et que les démons sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je disais, que tu viens nous proposer des énigmes, et te divertir à mes dépens, en disant que je n’admets point de dieux, et que pourtant j’admets des dieux, puisque j’admets des démons. Et si les démons sont enfants des dieux, enfants bâtards, à la vérité, puisqu’ils les ont eus de nymphes ou, dit-on aussi, de simples mortelles, qui pourrait croire qu’il y a des enfants des dieux, et qu’il n’y ait pas des dieux ? Cela serait aussi absurde que de croire qu’il y a des mulets nés de chevaux ou d’ânes, et qu’il n’y a ni ânes ni chevaux. Ainsi, Mélitus, il est impossible que tu ne m’aies intenté cette accusation pour m’éprouver, ou faute de prétexte légitime pour me citer devant ce tribunal ; car que tu persuades jamais à quelqu’un d’un peu de sens, que le même homme puisse croire qu’il y a des choses relatives aux démons et aux dieux, et pourtant qu’il n’y a ni démons, ni dieux, ni héros, c’est ce qui est entièrement impossible.
Mais je n’ai pas besoin d’une plus longue défense, Athéniens ; et ce que je viens de dire suffit, il me semble, pour faire voir que je ne suis point coupable, et que l’accusation de Mélitus est sans fondement. Et quant à ce que je vous disais au commencement, que j’ai contre moi de vives et nombreuses inimitiés, soyez bien persuadés qu’il en est ainsi ; et ce qui me perdra si je succombe, ce ne sera ni Mélitus ni Anytus, mais l’envie et la calomnie, qui ont déjà fait périr tant de gens de bien, et qui en feront encore périr tant d’autres ; car il ne faut pas espérer que ce fléau s’arrête à moi.
Mais quelqu’un me dira peut-être : N’as-tu pas honte, Socrate, de t’être attaché à une étude qui te met présentement en danger de mourir ? Je puis répondre avec raison à qui me ferait cette objection : Vous êtes dans l’erreur, si vous croyez qu’un homme, qui vaut quelque chose, doit considérer les chances de la mort ou de la vie, au lieu de chercher seulement, dans toutes ses démarches, si ce qu’il fait est juste ou injuste, et si c’est l’action d’un homme de bien ou d’un méchant. Ce seraient donc, suivant vous, des insensés que tous ces demi-dieux qui moururent au siège de Troie, et particulièrement le fils de Thétis, qui comptait le danger pour si peu de chose, en comparaison de la honte, que la déesse sa mère, qui le voyait dans l’impatience d’aller tuer Hector, lui ayant parlé à-peu-près en ces termes, si je m’en souviens : Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle, ton ami, en tuant Hector, tu mourras ; car
Ton trépas doit suivre celui d’Hector ;
lui, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche, sans venger ses amis :
Que je meure à l’instant,
s’écrie-t-il, pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle, et que je ne reste pas ici exposé au mépris,
Assis sur mes vaisseaux, fardeau inutile de la terre[16].
Est-ce là s’inquiéter du danger et de la mort ? Et en effet, Athéniens, c’est ainsi qu’il en doit être. Tout homme qui a choisi un poste, parce qu’il le jugeait le plus honorable, ou qui y a été placé par son chef, doit, à mon avis, y demeurer ferme, et ne considérer ni la mort, ni le péril, ni rien autre chose que l’honneur. Ce serait donc de ma part une étrange conduite, Athéniens, si, après avoir gardé fidèlement, comme un brave soldat, tous les postes où j’ai été mis par vos généraux, à Potidée, à Amphipolis et à Délium[17], et, après avoir souvent exposé ma vie, aujourd’hui que le dieu de Delphes m’ordonne, à ce que je crois, et comme je l’interprète moi-même, de passer mes jours dans l’étude de la philosophie, en m’examinant moi-même, et en examinant les autres, la peur de la mort, ou quelque autre danger, me faisait abandonner ce poste. Ce serait là une conduite bien étrange, et c’est alors vraiment qu’il faudrait me citer devant ce tribunal comme un impie qui ne reconnaît point de dieux, qui désobéit à l’oracle, qui craint la mort, qui se croit sage, et qui ne l’est pas ; car craindre la mort, Athéniens, ce n’est autre chose que se croire sage sans l’être ; car c’est croire connaître ce que l’on ne connaît point. En effet, personne ne connaît ce que c’est que la mort, et si elle n’est pas le plus grand de tous les biens pour l’homme. Cependant on la craint, comme si l’on savait certainement que c’est le plus grand de tous les maux. Or, n’est-ce pas l’ignorance la plus honteuse que de croire connaître ce que l’on ne connaît point ? Pour moi, c’est peut-être en cela que je suis différent de la plupart des hommes ; et si j’osais me dire plus sage qu’un autre en quelque chose, c’est en ce que, ne sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je ne crois pas non plus le savoir ; mais ce que je sais bien, c’est qu’être injuste, et désobéir à ce qui est meilleur que soi, dieu ou homme, est contraire au devoir et à l’honneur. Voilà le mal que je redoute et que je veux fuir, parce que je sais que c’est un mal, et non pas de prétendus maux qui peut-être sont des biens véritables : tellement que si vous me disiez présentement, malgré les instances d’Anytus qui vous a représentés ou qu’il ne fallait pas m’appeler devant ce tribunal, ou qu’après m’y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me faire mourir, par la raison, dit-il, que si j’échappais, vos fils, qui sont déjà si attachés à la doctrine de Socrate, seront bientôt corrompus sans ressource ; si vous me disiez : Socrate, nous rejetons l’avis d’Anytus, et nous te renvoyons absous ; mais c’est à condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées ; et si tu y retombes, et que tu sois découvert, tu mourras ; oui, si vous me renvoyiez à ces conditions, je vous répondrais sans balancer : Athéniens, je vous honore et je vous aime, mais j’obéirai plutôt au dieu qu’à vous ; et tant que je respirerai et que j’aurai un peu de force, je ne cesserai de m’appliquer à la philosophie, de vous donner des avertissements et des conseils, et de tenir à tous ceux que je rencontrerai mon langage ordinaire : ô mon ami ! comment, étant Athénien, de la plus grande ville et la plus renommée pour les lumières et la puissance, ne rougis-tu pas de ne penser qu’à amasser des richesses, à acquérir du crédit et des honneurs, sans t’occuper de la vérité et de la sagesse, de ton âme et de son perfectionnement ? Et si quelqu’un de vous prétend le contraire, et me soutient qu’il s’en occupe, je ne l’en croirai point sur sa parole, je ne le quitterai point ; mais je l’interrogerai, je l’examinerai, je le confondrai, et si je trouve qu’il ne soit pas vertueux, mais qu’il fasse semblant de l’être, je lui ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les plus précieuses, et d’en mettre tant à celles qui n’en ont aucun. Voilà de quelle manière je parlerai à tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près, et sachez que c’est là ce que le dieu m’ordonne, et je suis persuadé qu’il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la république que mon zèle à remplir l’ordre du dieu : car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu’avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l’âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n’est pas la richesse qui fait la vertu ; mais, au contraire, que c’est la vertu qui fait la richesse, et que c’est de là que naissent tous les autres biens publics et particuliers. Si, en parlant ainsi, je corromps la jeunesse, il faut que ces maximes soient un poison, car si on prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l’on vous en impose. Ainsi donc, je n’ai qu’à vous dire : Faites ce que demande Anytus, ou ne le faites pas ; renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas ; je ne ferai jamais autre chose, quand je devrais mourir mille fois… Ne murmurez pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je vous ai demandée, de m’écouter patiemment : cette patience, à mon avis, ne vous sera pas infructueuse. J’ai à vous dire beaucoup d’autres choses qui, peut-être, exciteront vos clameurs ; mais ne vous livrez pas à ces mouvements de colère. Soyez persuadés que, si vous me faites mourir, étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez plus de mal qu’à moi. En effet, ni Anytus ni Mélitus ne me feront aucun mal ; ils ne le peuvent, car je ne crois pas qu’il soit au pouvoir du méchant de nuire à l’homme de bien. Peut-être me feront-ils condamner à la mort ou à l’exil ou à la perte de mes droits de citoyen, et Anytus et les autres prennent sans doute cela pour de très grands maux ; mais moi je ne suis pas de leur avis ; à mon sens, le plus grand de tous les maux, c’est ce qu’Anytus fait aujourd’hui, d’entreprendre de faire périr un innocent.
Maintenant, Athéniens, ne croyez pas que ce soit pour l’amour de moi que je me défends, comme on pourrait le croire ; c’est pour l’amour de vous, de peur qu’en me condamnant, vous n’offensiez le dieu dans le présent qu’il vous a fait ; car si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville, la comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, comme à un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d’un éperon qui l’excite et l’aiguillonne. C’est ainsi que le dieu semble m’avoir choisi pour vous exciter et vous aiguillonner, pour gourmander chacun de vous, partout et toujours sans vous laisser aucune relâche. Un tel homme, Athéniens, sera difficile à retrouver, et, si vous voulez m’en croire, vous me laisserez la vie. Mais peut-être que, fâchés comme des gens qu’on éveille quand ils ont envie de s’endormir, vous me frapperez, et, obéissant aux insinuations d’Anytus, vous me ferez mourir sans scrupule ; et après vous retomberez pour toujours dans un sommeil léthargique, à moins que la divinité, prenant pitié de vous, ne vous envoie encore un homme qui me ressemble. Or, que ce soit elle-même qui m’ait donné à cette ville, c’est ce que vous pouvez aisément reconnaître à cette marque ; qu’il y a quelque chose de plus qu’humain à avoir négligé pendant tant d’années mes propres affaires, pour m’attacher aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier, comme un père ou un frère aîné pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu. Et si j’avais tiré quelque salaire de mes exhortations, ma conduite pourrait s’expliquer ; mais vous voyez que mes accusateurs mêmes, qui m’ont calomnié avec tant d’impudence, n’ont pourtant pas eu le front de me reprocher et d’essayer de prouver par témoins, que j’aie jamais exigé ni demandé le moindre salaire ; et je puis offrir de la vérité de ce que j’avance un assez bon témoin, à ce qu’il me semble : ma pauvreté.
Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n’aie jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple, pour donner mes conseils à la république. Ce qui m’en a empêché, Athéniens, c’est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque, dont vous m’avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus, pour plaisanter, a fait un chef d’accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s’est manifesté en moi dès mon enfance ; c’est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j’ai résolu ; car jamais elle ne m’exhorte à rien entreprendre : c’est elle qui s’est toujours opposée à moi, quand j’ai voulu me mêler des affaires de la république, et elle s’y est opposée fort à propos ; car sachez bien qu’il y a long-temps que je ne serais plus en vie, si je m’étais mêlé des affaires publiques, et je n’aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité. Non, quiconque voudra lutter franchement contre les passions d’un peuple, celui d’Athènes, ou tout autre peuple ; quiconque voudra empêcher qu’il ne se commette rien d’injuste ou d’illégal dans un état, ne le fera jamais impunément. Il faut de toute nécessité que celui qui veut combattre pour la justice, s’il veut vivre quelque temps, demeure simple particulier, et ne prenne aucune part au gouvernement. Je puis vous en donner des preuves incontestables, et ce ne seront pas des raisonnements, mais ce qui a bien plus d’autorité auprès de vous, des faits. Écoutez donc ce qui m’est arrivé, afin que vous sachiez bien que je sois incapable de céder à qui que ce soit contre le devoir, par crainte de la mort ; et que, ne voulant pas le faire, il est impossible que je ne périsse pas. Je vais vous dire des choses qui vous déplairont, et où vous trouverez peut-être la jactance des plaidoyers ordinaires : cependant je ne vous dirai rien qui ne soit vrai.
Vous savez, Athéniens, que je n’ai jamais exercé aucune magistrature, et que j’ai été seulement sénateur[18]. La tribu Antiochide, à laquelle j’appartiens[19], était justement de tour au Prytanée, lorsque, contre toutes les lois, vous vous opiniâtrâtes à faire simultanément[20] le procès aux dix généraux qui avaient négligé d’ensevelir les corps de ceux qui avaient péri au combat naval des Arginuses[21] ; injustice que vous reconnûtes, et dont vous vous repentîtes dans la suite. En cette occasion, je fus le seul des prytanes qui osai m’opposer à la violation des lois, et voter contre vous. Malgré les orateurs qui se préparaient à me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris, j’aimai mieux courir ce danger avec la loi et la justice, que de consentir avec vous à une si grande iniquité, par la crainte des chaînes ou de la mort[22]. Ce fait eut lieu pendant que le gouvernement démocratique subsistait encore. Quand vint l’oligarchie, les Trente me mandèrent moi cinquième au Tholos[23] et me donnèrent l’ordre d’amener de Salamine Léon le Salaminien, afin qu’on le fit mourir ; car ils donnaient de pareils ordres à beaucoup de personnes, pour compromettre le plus de monde qu’ils pourraient ; et alors je prouvai, non pas en paroles, mais par des effets, que je me souciais de la mort comme de rien, si vous me passez cette expression triviale, et que mon unique soin était de ne rien faire d’impie et d’injuste. Toute la puissance des Trente, si terrible alors, n’obtint rien de moi contre la justice. En sortant du Tholos, les quatre autres s’en allèrent à Salamine, et amenèrent Léon, et moi je me retirai dans ma maison ; et il ne faut pas douter que ma mort n’eût suivi ma désobéissance, si ce gouvernement n’eût été aboli bientôt après[24]. C’est ce que peuvent attester un grand nombre de témoins.
Pensez-vous donc que j’eusse vécu tant d’années, si je me fusse mêlé des affaires de la république, et qu’en homme de bien, j’eusse tout foulé aux pieds pour ne penser qu’à défendre la justice ? Il s’en faut bien, Athéniens ; ni moi ni aucun autre homme, ne l’aurions pu faire. Pendant tout le cours de ma vie, toutes les fois qu’il m’est arrivé de prendre part aux affaires publiques, vous me trouverez le même ; le même encore dans mes relations privées, ne cédant jamais rien à qui que ce soit contre la justice, non pas même à aucun de ces tyrans, que mes calomniateurs veulent faire passer pour mes disciples[25]. Je n’ai jamais été le maître de personne ; mais si quelqu’un, jeune ou vieux, a désiré s’entretenir avec moi, et voir comment je m’acquitte de ma mission, je n’ai refusé à personne cette satisfaction. Loin de parler quand on me paie, et de me taire quand on ne me donne rien, je laisse également le riche et le pauvre m’interroger ; ou, si on l’aime mieux, on répond à mes questions, et l’on entend ce que j’ai à dire. Si donc, parmi ceux qui me fréquentent, il s’en trouve qui deviennent honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni m’en louer ni m’en blâmer ; ce n’est pas moi qui en suis la cause, je n’ai jamais promis aucun enseignement, et je n’ai jamais rien enseigné ; et si quelqu’un prétend avoir appris ou entendu de moi en particulier autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, soyez persuadés que c’est une imposture. Vous savez maintenant pourquoi on aime à converser si long-temps avec moi : je vous ai dit la vérité toute pure ; c’est qu’on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages, et qui ne le sont point ; et, en effet, cela n’est pas désagréable. Et je n’agis ainsi, je vous le répète, que pour accomplir l’ordre que le dieu m’a donné par la voix des oracles, par celle des songes et par tous les moyens qu’aucune autre puissance céleste a jamais employés pour communiquer sa volonté à un mortel. Si ce que je vous dis n’était pas vrai, il vous serait aisé de me convaincre de mensonge ; car si je corrompais les jeunes gens, et que j’en eusse déjà corrompu, il faudrait que ceux qui, en avançant en âge, ont reconnu que je leur ai donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse, vinssent s’élever contre moi, et me faire punir ; et s’ils ne voulaient pas se charger eux-mêmes de ce rôle, ce serait le devoir des personnes de leur famille, comme leurs pères ou leurs frères ou leurs autres parents, de venir demander vengeance contre moi, si j’ai nui à ceux qui leur appartiennent ; et j’en vois plusieurs qui sont ici présents, comme Criton, qui est du même bourg que moi, et de mon âge, père de Critobule, que voici : Lysanias de Sphettios[26], avec son fils Eschine[27] ; Antiphon de Céphise[28] père d’Epigenès[29], et beaucoup d’autres dont les frères me fréquentaient, comme Nicostrate, fils de Zotide, et frère de Théodote. Il est vrai que Théodote est mort, et qu’ainsi il n’a plus besoin du secours de son frère. Je vois encore Parale, fils de Demodocus, et dont le frère était Théagès[30] ; Adimante, fils d’Ariston, avec son frère Platon ; Acéantodore, frère d’Apollodore, que je reconnais aussi[31], et beaucoup d’autres dont Mélitus aurait bien dû faire comparaître au moins un comme témoin dans sa cause. S’il n’y a pas pensé, il est encore temps ; je lui permets de le faire ; qu’il dise donc s’il le peut. Mais vous trouverez tout le contraire, Athéniens ; vous verrez qu’ils sont tout prêts à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu leurs enfants et leurs frères, s’il faut en croire Mélitus et Anytus ; car je ne veux pas faire valoir ici le témoignage de ceux que j’ai corrompus, ils pourraient avoir leur raison pour me défendre ; mais leurs parents, que je n’ai pas séduits, qui sont déjà avancés en âge, quelle autre raison peuvent-ils avoir de se déclarer pour moi, que mon bon droit et mon innocence, et leur persuasion que Mélitus est un imposteur, et que je dis la vérité ? Mais en voilà assez, Athéniens ; telles sont à-peu-près les raisons que je puis employer pour me défendre ; les autres seraient du même genre.
Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu’un parmi vous qui s’irritera contre moi, en se souvenant que, dans un péril beaucoup moins grand, il a conjuré et supplié les juges avec larmes, et que, pour exciter une plus grande compassion, il a fait paraître ses enfants, tous ses parents et tous ses amis ; au lieu que je ne fais rien de tout cela, quoique, selon toute apparence, je coure le plus grand danger. Peut-être que cette différence, se présentant à son esprit, l’aigrira contre moi, et que, dans le dépit que lui causera ma conduite, il donnera son suffrage avec colère. S’il y a ici quelqu’un qui soit dans ces sentiments, ce que je ne saurais croire, mais j’en fais la supposition, je pourrais lui dire avec raison : Mon ami, j’ai aussi des parents ; car pour me servir de l’expression d’Homère :
Je ne suis point né d’un chêne ou d’un rocher,[32]
mais d’un homme. Ainsi, Athéniens, j’ai des parents ; et pour des enfants, j’en ai trois, l’un déjà dans l’adolescence, les deux autres encore en bas âge ; et cependant je ne les ferai pas paraître ici pour vous engager à m’absoudre. Pourquoi ne le ferai-je pas ? Ce n’est ni par une opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris pour vous ; d’ailleurs, il ne s’agit pas ici de savoir si je regarde la mort avec intrépidité ou avec faiblesse ; mais pour mon honneur, pour le vôtre et celui de la république, il ne me paraît pas convenable d’employer ces sortes de moyens, à l’âge que j’ai, et avec ma réputation, vraie ou fausse, puisque enfin c’est une opinion généralement reçue que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire des hommes. En vérité, il serait honteux que ceux qui parmi vous se distinguent par la sagesse, le courage ou quelque autre vertu, ressemblassent à beaucoup de gens que j’ai vus, quoiqu’ils eussent toujours passé pour de grands personnages, faire pourtant des choses d’une bassesse étonnante quand on les jugeait, comme s’ils eussent cru qu’il leur arriverait un bien grand mal si vous les faisiez mourir, et qu’ils deviendraient immortels si vous daigniez-leur laisser la vie. De tels hommes déshonorent la patrie ; car ils donneraient lieu aux étrangers de penser que parmi les Athéniens, ceux qui ont le plus de vertu, et que tous les autres choisissent préférablement à eux-mêmes pour les élever aux emplois publics et aux dignités, ne diffèrent en rien des femmes ; et c’est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens, vous qui aimez la gloire ; et si nous voulions nous conduire ainsi, vous devriez ne pas le souffrir, et déclarer que celui qui a recours à ces scènes tragiques pour exciter la compassion, et qui par là vous couvre de ridicule, vous le condamnerez plutôt que celui qui attend tranquillement votre sentence. Mais sans parler de l’opinion, il me semble que la justice veut qu’on ne doive pas son salut à ses prières, qu’on ne supplie pas le juge, mais qu’on l’éclaire et qu’on le convainque ; car le juge ne siège pas ici pour sacrifier la justice au désir de plaire, mais pour la suivre religieusement : il a juré, non de faire grâce à qui bon lui semble, mais de juger suivant les lois. Il ne faut donc pas que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas vous y laisser accoutumer ; car les uns et les autres nous nous rendrions coupables envers les dieux. N’attendez donc point de moi, Athéniens, que j’aie recours auprès de vous à des choses que je ne crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j’y aie recours dans une occasion où je suis accusé d’impiété par Mélitus ; si je vous fléchissais par mes prières, et que je vous forçasse à violer votre serment, c’est alors que je vous enseignerais l’impiété, et en voulant me justifier, je prouverais contre moi-même que je ne crois point aux dieux. Mais il s’en faut bien, Athéniens, qu’il en soit ainsi. Je crois plus aux dieux qu’aucun de mes accusateurs ; et je vous abandonne avec confiance à vous et au dieu de Delphes le soin de prendre à mon égard le parti le meilleur et pour moi et pour vous.
[Ici les juges avant été aux voix, la majorité déclare que Socrate est coupable. Il reprend la parole :]
Le jugement que vous venez de prononcer, Athéniens, m’a peu ému, et par bien des raisons ; d’ailleurs je m’attendais à ce qui est arrivé. Ce qui me surprend bien plus, c’est le nombre des voix pour ou contre ; j’étais bien loin de m’attendre à être condamné à une si faible majorité ; car, à ce qu’il paraît, il n’aurait fallu que trois voix[33] de plus pour que je fusse absous. Je puis donc me flatter d’avoir échappé à Mélitus, et non-seulement je lui ai échappé, mais il est évident que si Anytus et Lycon ne se fussent levés pour m’accuser, il aurait été condamné à payer mille drachmes[34], comme n’ayant pas obtenu la cinquième partie des suffrages.
C’est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi, à la bonne heure ; et moi, de mon côté, Athéniens, à quelle peine me condamnerai-je[35] ? Je dois choisir ce qui m’est dû ; Et que m’est-il dû ? Quelle peine afflictive, ou quelle amende mérité-je, moi, qui me suis fait un principe de ne connaître aucun repos pendant toute ma vie, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d’empressement, les richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois militaires, les fonctions d’orateur et toutes les autres dignités ; moi, qui ne suis jamais entré dans aucune des conjurations et des cabales si fréquentes dans la république, me trouvant réellement trop honnête homme pour ne pas me perdre en prenant part à tout cela ; moi qui, laissant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous ni à moi, n’ai voulu d’autre occupation que celle de vous rendre à chacun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous individuellement à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement plutôt qu’à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sages ; à ne pas songer aux intérêts passagers de la patrie plutôt qu’à la patrie elle-même, et ainsi de tout le reste ? Athéniens, telle a été ma conduite ; que mérite-t-elle ? Une récompense, si vous voulez être justes, et même une récompense qui puisse me convenir. Or, qu’est-ce qui peut convenir à un homme pauvre, votre bienfaiteur, qui a besoin de loisir pour ne s’occuper qu’à vous donner des conseils utiles ? Il n’y a rien qui lui convienne plus, Athéniens, que d’être nourri dans le Prytanée ; et il le mérite bien plus que celui qui, aux jeux Olympiques, a remporté le prix de la course à cheval, ou de la course des chars à deux ou à quatre chevaux[36] ; car celui-ci ne vous rend heureux qu’en apparence : moi, je vous enseigne à l’être véritablement : celui-ci a de quoi vivre, et moi je n’ai rien. Si donc il me faut déclarer ce que je mérite, en bonne justice, je le déclare, c’est d’être nourri au Prytanée.
Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m’accuserez peut-être de la même arrogance qui me faisait condamner tout-à-l’heure les prières et les lamentations. Mais ce n’est nullement cela ; mon véritable motif est que j’ai la conscience de n’avoir jamais commis envers personne d’injustice volontaire ; mais je ne puis vous le persuader, car il n’y a que quelques instants que nous nous entretenons ensemble, tandis que vous auriez fini par me croire peut-être, si vous aviez, comme d’autres peuples, une loi qui, pour une condamnation à mort, exigeât un procès de plusieurs jours[37], au lieu qu’en si peu de temps, il est impossible de détruire des calomnies invétérées. Ayant donc la conscience que je n’ai jamais été injuste envers personne, je suis bien éloigné de vouloir l’être envers moi-même ; d’avouer que je mérite une punition, et de me condamner à quelque chose de semblable ; et cela dans quelle crainte ? Quoi ! pour éviter la peine que réclame contre moi Mélitus, et de laquelle j’ai déjà dit que je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j’irai choisir une peine que je sais très certainement être un mal, et je m’y condamnerai moi-même ! Choisirai-je les fers ? Mais pourquoi me faudrait-il passer ma vie en prison, esclave du pouvoir des Onze, qui se renouvelle toujours[38]? Une amende, et la prison jusqu’à ce que je l’aie payée ? Mais cela revient au même, car je n’ai pas de quoi la payer. Me condamnerai-je à l’exil ? Peut-être y consentiriez-vous. Mais il faudrait que l’amour de la vie m’eût bien aveuglé, Athéniens, pour que je pusse m’imaginer que, si vous, mes concitoyens, vous n’avez pu supporter ma manière d’être et mes discours, s’ils vous sont devenus tellement importuns et odieux qu’aujourd’hui vous voulez enfin vous en délivrer, d’autres n’auront pas de peine à les supporter. Il s’en faut de beaucoup, Athéniens. En vérité, ce serait une belle vie pour moi, vieux comme je suis, de quitter mon pays, d’aller errant de ville en ville, et de vivre comme un proscrit ! Car je sais que partout où j’irai, les jeunes gens viendront m’écouter comme ici ; si je les rebute, eux-mêmes me feront bannir par les hommes plus âgés ; et si je ne les rebute pas, leurs pères et leurs parents me banniront, à cause d’eux.
Mais me dira-t-on peut-être : Socrate, quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu pas te tenir en repos, et garder le silence ? Voilà ce qu’il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d’entre vous ; car si je dis que ce serait désobéir au dieu, et que par cette raison, il m’est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point, et prendrez cette réponse pour une plaisanterie ; et, d’un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de l’homme, c’est de s’entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m’avez entendu discourir, m’examinant et moi-même et les autres : car une vie sans examen n’est pas une vie ; si je vous dis cela, vous me croirez encore moins. Voilà pourtant la vérité, Athéniens ; mais il n’est pas aisé de vous en convaincre. Au reste, je ne suis point accoutumé à me juger digne de souffrir aucun mal. Si j’étais riche, je me condamnerais volontiers à une amende telle que je pourrais la payer, car cela ne me ferait aucun tort ; mais, dans la circonstance présente… car enfin je n’ai rien… à moins que vous ne consentiez à m’imposer seulement à ce que je suis en état de payer ; et je pourrais aller peut-être jusqu’à une mine d’argent ; c’est donc à cette somme que je me condamne. Mais Platon, que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne à trente mines, dont ils répondent. En conséquence, je m’y condamne ; et assurément je vous présente des cautions qui sont très solvables.
[Ici les juges vont aux voix pour l’application de la peine, et Socrate est condamné à mort. Il poursuit :]
POUR n’avoir pas eu la patience d’attendre un peu de temps, Athéniens, vous allez fournir un prétexte à ceux qui voudront diffamer la république ; ils diront que vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage ; car, pour aggraver votre honte, ils m’appelleront sage, quoique je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu de temps, la chose serait venue d’elle-même ; car voyez mon âge ; je suis déjà bien avancé dans la vie, et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m’ont condamné à mort ; c’est à ceux-là que je veux m’adresser encore. Peut-être pensez-vous que si j’avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver, je n’y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader ? Non, ce ne sont pas les paroles qui m’ont manqué, Athéniens, mais l’impudence : je succombe pour n’avoir pas voulu vous dire les choses que vous aimez tant à entendre ; pour n’avoir pas voulu me lamenter, pleurer et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumés. Mais le péril où j’étais ne m’a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d’un homme libre, et maintenant encore je ne me repens pas de m’être ainsi défendu ; j’aime beaucoup mieux mourir après m’être défendu comme je l’ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni dans les combats, il n’est permis ni à moi ni à aucun autre d’employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu’à la guerre il serait très facile de sauver sa vie, en jetant ses armes, et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent ; de même dans tous les dangers, on trouve mille expédients pour éviter la mort, quand on est décidé à tout dire et à tout faire. Eh ! ce n’est pas là ce qui est difficile, Athéniens, que d’éviter la mort ; mais il l’est beaucoup d’éviter le crime ; il court plus vite que la mort. C’est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux, tandis que le plus agile, le crime, s’est attaché à mes accusateurs, qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m’en vais donc subir la mort à laquelle vous m’avez condamné, et eux l’iniquité et l’infamie à laquelle la vérité les condamne. Pour moi, je m’en tiens à ma peine, et eux à la leur. En effet, peut-être est-ce ainsi que les choses devaient se passer, et, selon moi, tout est pour le mieux.
Après cela, ô vous qui m’avez condamné voici ce que j’ose vous prédire ; car je suis précisément dans les circonstances où les hommes lisent dans l’avenir, au moment de quitter la vie. Je vous dis donc que si vous me faites périr, vous en serez punis aussitôt après ma mort par une peine bien plus cruelle que celle à laquelle vous me condamnez ; en effet, vous ne me faites mourir que pour vous délivrer de l’importun fardeau de rendre compte de votre vie ; mais il vous arrivera tout le contraire, je vous le prédis. Il va s’élever contre vous un bien plus grand nombre de censeurs que je retenais sans que vous vous en aperçussiez ; censeurs d’autant plus difficiles, qu’ils sont plus jeunes, et vous n’en serez que plus irrités ; car si vous pensez qu’en tuant les gens, vous empêcherez qu’on vous reproche de mal vivre, vous vous trompez. Cette manière de se délivrer de ses censeurs n’est ni honnête ni possible : celle qui est en même temps et la plus honnête et la plus facile, c’est, au lieu de fermer la bouche aux autres, de se rendre meilleur soi-même. Voilà ce que j’avais à prédire à ceux qui m’ont condamné : il ne me reste qu’à prendre congé d’eux.
Mais pour vous, qui m’avez absous par vos suffrages, Athéniens, je m’entretiendrai volontiers avec vous sur ce qui vient de se passer, pendant que les magistrats[39] sont occupés, et qu’on ne me mène pas encore où je dois mourir. Arrêtez-vous donc quelques instants, et employons à converser ensemble le temps qu’on me laisse. Je veux vous raconter, comme à mes amis, une chose qui m’est arrivée aujourd’hui, et vous apprendre ce qu’elle signifie. Oui, juges (et en vous appelant ainsi, je vous donne le nom que vous méritez), il m’est arrivé aujourd’hui quelque chose d’extraordinaire. Cette inspiration prophétique qui n’a cessé de se faire entendre à moi dans tout le cours de ma vie, qui dans les moindres occasions n’a jamais manqué de me détourner de tout ce que j’allais faire de mal, aujourd’hui qu’il m’arrive ce que vous voyez, ce qu’on pourrait prendre, et ce qu’on prend en effet pour le plus grand de tous les maux, cette voix divine a gardé le silence ; elle ne m’a arrêté ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni quand je suis venu devant ce tribunal, ni tandis que je parlais, quand j’allais dire quelque chose. Cependant, dans beaucoup d’autres circonstances, elle vint m’interrompre au milieu de mon discours ; mais aujourd’hui elle ne s’est opposée à aucune de mes actions, à aucune de mes paroles : quelle en peut être la cause ? Je vais vous le dire ; c’est que ce qui m’arrive est, selon toute vraisemblance, un bien ; et nous nous trompons sans aucun doute, si nous pensons que la mort soit un mal. Une preuve évidente pour moi, c’est qu’infailliblement, si j’eusse dû mal faire aujourd’hui, le signe ordinaire m’en eût averti.
Voici encore quelques raisons d’espérer que la mort est un bien. Il faut qu’elle soit de deux choses l’une, ou l’anéantissement absolu, et la destruction de toute conscience, ou, comme on le dit, un simple changement, le passage de l’âme d’un lieu dans un autre. Si la mort est la privation de tout sentiment, un sommeil sans aucun songe, quel merveilleux avantage n’est-ce pas que de mourir ? Car, que quelqu’un choisisse une nuit ainsi passée dans un sommeil profond que n’aurait troublé aucun songe, et qu’il compare cette nuit avec toutes les nuits et avec tous les jours qui ont rempli le cours entier de sa vie ; qu’il réfléchisse, et qu’il dise en conscience combien dans sa vie il a eu de jours et de nuits plus heureuses et plus douces que celle-là ; je suis persuadé que non-seulement un simple particulier, mais que le grand roi lui-même en trouverait un bien petit nombre, et qu’il serait aisé de les compter. Si la mort est quelque chose de semblable ; je dis qu’elle n’est pas un mal ; car la durée tout entière ne paraît plus ainsi qu’une seule nuit. Mais si la mort est un passage de ce séjour dans un autre, et si ce qu’on dit est véritable, que là est le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus grand bien peut-on imaginer, mes juges ? Car enfin, si en arrivant aux enfers, échappés à ceux qui se prétendent ici-bas des juges, l’on y trouve les vrais juges, ceux qui passent pour y rendre la justice, Minos, Rhadamanthe, Éaque, Triptolème et tous ces autres demi-dieux qui ont été justes pendant leur vie, le voyage serait-il donc si malheureux ? Combien ne donnerait-on pas pour s’entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode, Homère ? Quant à moi, si cela est véritable, je veux mourir plusieurs fois. Oh ! pour moi surtout l’admirable passe-temps, de me trouver là avec Palamède[40], Ajax fils de Télamon, et tous ceux des temps anciens, qui sont morts victimes de condamnations injustes ! Quel agrément de comparer mes aventures avec les leurs ! Mais mon plus grand plaisir serait d’employer ma vie, là comme ici, à interroger et à examiner tous ces personnages pour distinguer ceux qui sont véritablement sages, et ceux qui croient l’être et ne le sont point. À quel prix ne voudrait-on pas, mes juges, examiner un peu celui qui mena contre Troie une si nombreuse armée[41], ou Ulysse[42] ou Sisyphe, et tant d’autres, hommes et femmes, avec lesquels ce serait une félicité inexprimable de converser et de vivre, en les observant et les examinant ? Là du moins on n’est pas condamné à mort pour cela ; car les habitants de cet heureux séjour, entre mille avantages qui mettent leur condition bien au-dessus de la nôtre, jouissent d’une vie immortelle, si du moins ce qu’on en dit est véritable.
C’est pourquoi, mes juges, soyez pleins d’espérance dans la mort, et ne pensez qu’à cette vérité, qu’il n’y a aucun mal pour l’homme de bien, ni pendant sa vie ni après sa mort, et que les dieux ne l’abandonnent jamais ; car ce qui m’arrive n’est point l’effet du hasard, et il est clair pour moi que mourir dès à présent, et être délivré des soucis de la vie, était ce qui me convenait le mieux ; aussi la voix céleste s’est tue aujourd’hui, et je n’ai aucun ressentiment contre mes accusateurs, ni contre ceux qui m’ont condamné, quoique leur intention n’ait pas été de me faire du bien, et qu’ils n’aient cherché qu’à me nuire ; en quoi j’aurais bien quelque raison de me plaindre d’eux. Je ne leur ferai qu’une seule prière. Lorsque mes enfants seront grands, si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose plus que la vertu, punissez-les, en les tourmentant comme je vous ai tourmentés ; et, s’ils se croient quelque chose, quoiqu’ils ne soient rien, faites-les rougir de leur insouciance et de leur présomption : c’est ainsi que je me suis conduit avec vous. Si vous faites cela, moi et mes enfants nous n’aurons qu’à nous louer de votre justice. Mais il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage ? Personne ne le sait, excepté Dieu.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 14 Novembre 2015 à 22:48
Indignez-vous
LIVRES - Indignez-vous (Stéphane Hessel) - Catégorie Documents et Essais
INDIGNEZ-VOUS de Stéphane Hessel
93 ans. C’est un peu la toute dernière étape. La fin n’est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : les années de résistance et le programme élaboré il y a soixante-six ans par le Conseil National de la Résistance ! C’est à Jean Moulin que nous devons, dans le cadre de ce Conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis, les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au seul chef qu’elle se reconnaissait : le général de Gaulle. De Londres où j’avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941, j’apprenais que ce Conseil avait mis au point un programme, l’avait adopté le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays1. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil National de la Résistance. A partir de 1945, après un drame atroce, c’est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la Résistance. Rappelons-le, c’est alors qu’est créée la Sécurité sociale comme la Résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait : « Un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens1
des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail » ; « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. » Les sources d’énergie, l’électricité et le gaz, les charbonnages, les grandes banques sont nationalisées. C’est ce que ce programme préconisait encore, « le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurance et des grandes banques » ; « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale,
impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ». L’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier, le juste partage des richesses créées par le monde du travail primer sur le pouvoir de l’argent. La Résistance propose « une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination
des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des États fascistes », et le
Gouvernement provisoire de la République s’en fait le relais. Une véritable démocratie a besoin d’une presse indépendante ; la Résistance le sait, l’exige, en défendant « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences étrangères. » C’est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse, dès 1944. Or, c’est bien ce qui est aujourd’hui en danger. La Résistance en appelait à « la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction la plus développée », sans
discrimination ; or, les réformes proposées en 2008 vont à l’encontre de ce projet. De jeunes enseignants, dont je soutiens l’action, ont été jusqu’à refuser de les appliquer et ils ont vu leurs salaires amputés en guise de punition. Ils se sont indignés, ont « désobéi », ont jugé ces réformes trop éloignées de l’idéal de l’école républicaine, trop au service d’une société de
2
l’argent et ne développant plus assez l’esprit créatif et critique. C’est tout le socle des conquêtes sociales de la Résistance qui est aujourd’hui remis en cause2. Le motif de la résistance, c’est l’indignation. On ose nous dire que l’État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l’Europe était ruinée ? Sinon parce que le pouvoir de l’argent, tellement combattu par la Résistance, n’a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l’État. Les banques désormais privatisées se montrent d’abord soucieuses de leurs dividendes, et des très haut salaires de leurs dirigeants, pas de l’intérêt général. L’écart entre les plus pauvres et les plus riches n’a jamais été aussi important ; et la course à l’argent, la compétition, autant encouragée. Le motif de base de la Résistance était l’indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre, l’héritage de la Résistance et ses idéaux. Nous leur disons : prenez le relais, indignezvous ! Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun d’entre vous, d’avoir votre motif d’indignation. C’est précieux. Quand quelque chose vous indigne comme j’ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l’histoire et le grand courant de l’histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948,
3
sont universels. Si vous rencontrez quelqu’un qui n’en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Deux visions de l’histoire Quand j’essaie de comprendre ce qui a causé le fascisme, qui a fait que nous ayons été envahis par lui et par Vichy, je me dis que les possédants, avec leur égoïsme, ont eu terriblement peur de la révolution bolchévique. Ils se sont laissés guider par leurs peurs. Mais si, aujourd’hui comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira, nous aurons le levain pour que la pâte lève. Certes, l’expérience d’un très vieux comme moi, né en 1917, se différencie de l’expérience des jeunes d’aujourd’hui. Je demande souvent à des professeurs de collège la possibilité d’intervenir auprès de leurs élèves, et je leur dis : vous n’avez pas les mêmes raisons évidentes de vous engager. Pour nous, résister, c’était ne pas accepter l’occupation allemande, la défaite. C’était relativement simple. Simple comme ce qui a suivi, la décolonisation. Puis la guerre d’Algérie. Il fallait que l’Algérie devienne indépendante, c’était évident. Quant à Staline, nous avons tous applaudi à la victoire de l’Armée rouge contre les nazis, en 1943. Mais déjà lorsque nous avions eu connaissance des grands procès staliniens de 1935, et même s’il fallait garder une oreille ouverte vers le communisme pour contrebalancer le capitalisme américain, la nécessité de s’opposer à cette forme insupportable de totalitarisme s’était imposée comme une évidence. Ma longue vie m’a donné une succession de raisons de m’indigner. Ces raisons sont nées moins d’une émotion que d’une volonté d’engagement. Le jeune normalien que j’étais a été très marqué par Sartre, un aîné condisciple. La Nausée, Le Mur, pas L ‘Être et le néant, ont été très importants dans la formation de ma pensée. Sartre nous a appris à nous dire : « Vous êtes responsables en tant qu’individus. » C’était un message libertaire. La responsabilité de l’homme qui ne peut s’en remettre ni à un pouvoir ni à un dieu. Au contraire, il faut
4
s’engager au nom de sa responsabilité de personne humaine. Quand je suis entré à l’École normale de la rue d’Ulm, à Paris, en 1939, j’y entrais comme fervent disciple du philosophe Hegel, et je suivais le séminaire de Maurice Merleau-Ponty. Son enseignement explorait l’expérience concrète, celle du corps et de ses relations avec le sens, grand singulier face au pluriel des sens. Mais mon optimisme naturel, qui veut que tout ce qui est souhaitable soit possible, me portait plutôt vers Hegel. L’hégélianisme interprète la longue histoire de l’humanité comme ayant un sens : c’est la liberté de l’homme progressant étape par étape. L’histoire est faite de chocs successifs, c’est la prise en compte de défis. L’histoire des sociétés progresse, et au bout, l’homme ayant atteint sa liberté complète, nous avons l’État démocratique dans sa forme idéale. Il existe bien sûr une autre conception de l’histoire. Les progrès faits par la liberté, la compétition, la course au « toujours plus », cela peut être vécu comme un ouragan destructeur. C’est ainsi que la représente un ami de mon père, l’homme qui a partagé avec lui la tâche de traduire en allemand À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust. C’est le philosophe allemand Walter Benjamin. Il avait tiré un message pessimiste d’un tableau du peintre suisse, Paul Klee, l’Angelus Novus, où la figure de l’ange ouvre les bras comme pour contenir et repousser une tempête qu’il identifie avec le progrès. Pour Benjamin qui se suicidera en septembre 1940 pour fuir le nazisme, le sens de l’histoire, c’est le cheminement irrésistible de catastrophe en catastrophe. L’indifférence : la pire des attitudes C’est vrai, les raisons de s’indigner peuvent paraître aujourd’hui moins nettes ou le monde trop complexe. Qui commande, qui décide ? Il n’est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n’avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C’est un vaste monde, dont
5
nous sentons bien qu’il est interdépendant. Nous vivons dans une inter connectivité comme jamais encore il n’en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes : cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez l’une des composantes
essentielles qui fait l’humain. Une des composantes indispensables : la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence. On peut déjà identifier deux grands nouveaux défis : 1. L’immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s’accroître. C’est une innovation des XX` et XXI` siècle. Les très pauvres dans le monde d’aujourd’hui gagnent à peine deux dollars par jour. On ne peut pas laisser cet écart se creuser encore. Ce constat seul doit susciter un engagement. 2. Les droits de l’homme et l’état de la planète. J’ai eu la chance après la Libération d’être associé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Organisation des Nations unies, le 10 décembre 1948, à Paris, au palais de Chaillot. C’est au titre de chef de cabinet de Henri Laugier, secrétaire général adjoint de l’ONU, et secrétaire de la Commission des Droits de l’homme que j’ai, avec d’autres, été amené à participer à la rédaction de cette déclaration. Je ne saurais oublier, dans son élaboration, le rôle de René Cassin, commissaire national à la Justice et à l’Éducation du gouvernement de la France libre, à Londres, en 1941, qui fut prix Nobel de la paix en 1968, ni celui de Pierre Mendès France au sein du Conseil économique et social à qui les textes que nous élaborions étaient soumis, avant d’être examinés par la Troisième commission de l’assemblée générale, en charge des questions sociales, humanitaires et culturelles. Elle comptait les cinquante-quatre États membres, à l’époque, des Nations unies, et j’en assurais le secrétariat. C’est à René Cassin que nous devons le terme de droits «
6universels » et non « internationaux » comme le proposaient nos amis anglo-saxons. Car là est bien l’enjeu au sortir de la seconde guerre mondiale : s’émanciper des menaces que le totalitarisme a fait peser sur l’humanité. Pour s’en émanciper, il faut obtenir que les États membres de l’ONU s’engagent à respecter ces droits universels. C’est une manière de déjouer l’argument de pleine souveraineté qu’un État peut faire valoir alors qu’il se livre à des crimes contre l’humanité sur son sol. Ce fut le cas d’Hitler qui s’estimait maître chez lui et autorisé à provoquer un génocide. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la révulsion universelle envers le nazisme, le fascisme, le totalitarisme, et même, par notre présence, à l’esprit de la Résistance. Je sentais qu’il fallait faire vite, ne pas être dupe de l’hypocrisie qu’il y avait dans l’adhésion proclamée par les vainqueurs à ces valeurs que tous n’avaient pas l’intention de promouvoir loyalement, mais que nous tentions de leur imposer 3. Je ne résiste pas à l’envie de citer l’article 15 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme : « Tout individu a droit à une nationalité » ; l’article 22 : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la Sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. » Et si cette déclaration a une portée déclarative, et non pas juridique, elle n’en a pas moins joué un rôle puissant depuis 1948 ; on a vu des peuples colonisés s’en saisir dans leur lutte d’indépendance ; elle a ensemencé les esprits dans leur combat pour la liberté. Je constate avec plaisir qu’au cours des dernières décennies se sont multipliés les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux comme Attac (Association pour la taxation des transactions
7
financières), la FIDH (Fédération internationale des Droits de l’homme), Amnesty… qui sont agissants et performants. Il est évident que pour être efficace aujourd’hui, il faut agir en réseau, profiter de tous les moyens modernes de communication. Aux jeunes, je dis : regardez autour de vous, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation — le traitement faits aux immigrés, aux sans-papiers, aux Roms. Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez ! Mon indignation à propos de la Palestine Aujourd’hui, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Ce conflit est la source même d’une indignation. Il faut absolument lire le rapport Richard Goldstone de septembre 2009 sur Gaza, dans lequel ce juge sud-africain, juif, qui se dit même sioniste, accuse l’armée israélienne d’avoir commis des « actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être, dans certaines circonstances, à des crimes contre l’humanité » pendant son opération « Plomb durci » qui a duré trois semaines. Je suis moi-même retourné à Gaza, en 2009, où j’ai pu entrer avec ma femme grâce à nos passeports diplomatiques afin d’étudier de visu ce que ce rapport disait. Les gens qui nous accompagnaient n’ont pas été autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza. Là et en Cisjordanie. Nous avons aussi visité les camps de réfugiés palestiniens mis en place dès 1948 par l’agence des Nations unies, l’UNRWA, où plus de trois millions de Palestiniens chassés de leurs terres par Israël attendent un retour de plus en plus problématique. Quant à Gaza, c’est une prison à ciel ouvert pour un million et demi de Palestiniens. Une prison où ils s’organisent pour survivre. Plus encore que les destructions matérielles comme celle de l’hôpital du Croissant rouge par « Plomb durci », c’est le comportement des Gazaouis, leur patriotisme, leur amour de la mer et des plages, leur constante préoccupation du bien-être de leurs enfants,
8
innombrables et rieurs, qui hantent notre mémoire. Nous avons été impressionnés par leur ingénieuse manière de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées. Nous les avons vu confectionner des briques faute de ciment pour reconstruire les milliers de maisons détruites par les chars. On nous a confirmé qu’il y avait eu mille quatre cents morts — femmes, enfants, vieillards inclus dans le camp palestinien — au cours de cette opération « Plomb durci » menée par l’armée israélienne, contre seulement cinquante blessés côté israélien. Je partage les conclusions du juge sud-africain. Que des Juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre, c’est insupportable. Hélas, l’histoire donne peu d’exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Je sais, le Hamas qui avait gagné les dernières élections législatives n’a pas pu éviter que des rockets soient envoyées sur les villes israéliennes en réponse à la situation d’isolement et de blocus dans laquelle se trouvent les Gazaouis. Je pense bien évidemment que le terrorisme est inacceptable, mais il faut reconnaître que lorsque l’on est occupé avec des moyens militaires infiniment supérieurs aux vôtres, la réaction populaire ne peut pas être que non-violente. Est-ce que ça sert le Hamas d’envoyer des rockets sur la ville de Sdérot ? La réponse est non. Ça ne sert pas sa cause, mais on peut expliquer ce geste par l’exaspération des Gazaouis. Dans la notion d’exaspération, il faut comprendre la violence comme une regrettable conclusion de situations inacceptables pour ceux qui les subissent. Alors, on peut se dire que le terrorisme est une forme d’exaspération. Et que cette exaspération est un terme négatif. Il ne faudrait pas ex-aspérer, il faudrait es-pérer. L’exaspération est un déni de l’espoir. Elle est compréhensible, je dirais presque qu’elle est naturelle, mais pour autant elle n’est pas acceptable. Parce qu’elle ne permet pas d’obtenir les résultats que peut éventuellement produire l’espérance.
9
La non-violence, le chemin que nous devons apprendre à suivre. Je suis convaincu que l’avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. C’est par cette voie que l’humanité devra franchir sa prochaine étape. Et là, je rejoins Sartre, on ne peut pas excuser les terroristes qui jettent des bombes, on peut les comprendre. Sartre écrit en 1947 : « Je reconnais que la violence sous quelque forme qu’elle se manifeste est un échec. Mais c’est un échec inévitable parce que nous sommes dans un univers de violence. Et s’il est vrai que le recours à la violence reste la violence qui risque de la perpétuer, il est vrai aussi c’est l’unique moyen de la faire cesser 4. » À quoi j’ajouterais que la non-violence est un moyen plus sûr de la faire cesser. On ne peut pas soutenir les terroristes comme Sartre l’a fait au nom de ce principe pendant la guerre d’Algérie, ou lors de l’attentat des jeux de Munich, en 1972, commis contre des athlètes israéliens. Ce n’est pas efficace et Sartre lui-même finira par s’interroger à la fin de sa vie sur le sens du terrorisme et à douter de sa raison d’être. Se dire « la violence n’est pas efficace », c’est bien plus important que de savoir si on doit condamner ou pas ceux qui s’y livrent. Le terrorisme n’est pas efficace. Dans la notion d’efficacité, il faut une espérance non-violente. S’il existe une espérance violente, c’est dans la poésie de Guillaume Apollinaire : « Que l’espérance est violente » ; pas en politique. Sartre, en mars 1980, à trois semaines de sa mort, déclarait : « Il faut essayer d’expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n’est qu’un moment dans le long développement historique, que l’espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l’espoir comme ma conception de l’avenir 5 Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l’espoir. Il faut lui préférer l’espérance, l’espérance de la non-violence. C’est le chemin que nous devons apprendre à suivre. Aussi bien du côté des
10
oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l’oppression ; c’est ce qui permettra de ne plus avoir de violence terroriste. C’est pourquoi il ne faut pas laisser s’accumuler trop de haine. Le message d’un Mandela, d’un Martin Luther King trouve toute sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des idéologies et le totalitarisme conquérant. C’est un message d’espoir dans la capacité des sociétés modernes à dépasser les conflits par une compréhension mutuelle et une patience vigilante. Pour y parvenir, il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu’en soit l’auteur, doit provoquer notre indignation. Il n’y a pas à transiger sur ces droits. Pour une insurrection pacifique J’ai noté — et je ne suis pas le seul — la réaction du gouvernement israélien confronté au fait que chaque vendredi les citoyens de Bil’id vont, sans jeter de pierres, sans utiliser la force, jusqu’au mur contre lequel ils protestent. Les autorités israéliennes ont qualifié cette marche de « terrorisme non-violent ». Pas mal… Il faut être israélien pour qualifier de terroriste la non-violence. Il faut surtout être embarrassé par l’efficacité de la non-violence qui tient à ce qu’elle suscite l’appui, la compréhension, le soutien de tous ceux qui dans le monde sont les adversaires de l’oppression. La pensée productiviste, portée par l’Occident, a entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec la fuite en avant du « toujours plus », dans le domaine financier mais aussi dans le domaine des sciences et des techniques. Il est grand temps que le souci d’éthique, de justice, d’équilibre durable devienne prévalent. Car les risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l’aventure humaine sur une planète qu’elle peut rendre inhabitable pour l’homme.
11
Mais il reste vrai que d’importants progrès ont été faits depuis 1948: la décolonisation, la fin de l’apartheid, la destruction de l’empire soviétique, la chute du Mur de Berlin. Par contre, les dix premières années du XXIe siècle ont été une période de recul. Ce recul, je l’explique en partie par la présidence américaine de George Bush, le 11 septembre, et les conséquences désastreuses qu’en ont tirées les Etats-Unis, comme cette intervention militaire en Irak. Nous avons eu cette crise économique, mais nous n’en avons pas davantage initié une nouvelle politique de développement. réchauffement De même, le sommet pas de Copenhague d’engager une contre le climatique n’a permis véritable politique pour la préservation de la planète. Nous sommes à un seuil, entre les horreurs de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes. Mais il faut espérer, il faut toujours espérer. La décennie précédente, celle des années 1990, avait été source de grands progrès. Les Nations unies ont su convoquer des conférences comme celles de Rio sur l’environnement, en 1992 ; celle de Pékin sur les femmes, en 1995 ; en septembre 2000, à l’initiative du secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les « Huit objectifs du millénaire pour le développement », par laquelle ils s’engagent notamment à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015. Mon grand regret, c’est que ni Obama ni l’Union européenne ne se soient encore manifestés avec ce qui devrait être leur apport pour une phase constructive, s’appuyant sur les valeurs fondamentales. Comment conclure cet appel à s’indigner ? En rappelant encore que, à l’occasion du soixantième anniversaire du Programme du Conseil national de la Résistance, nous disions le 8 mars 2004, nous vétérans des mouvements de Résistance et des forces combattantes de la France libre (1940-1945), que certes « le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et soeurs de la Résistance et des Nations unies contre la barbarie
12
fasciste. Mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est toujours intacte
6
».
Non, cette menace n’a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à « une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. » À ceux et celles qui feront le XXI’ siècle, nous disons avec notre affection : « CRÉER, C’EST RÉSISTER. RÉSISTER, C’EST CRÉER. »
13
NOTES 1 Créé clandestinement le 27 mai 1943, à Paris, par les représentants des huit grands mouvements de Résistance ; des deux grands syndicats d’avant-guerre : la CGT, la CFTC (confédération française des travailleurs chrétiens) ; et des six principaux partis politiques de la Troisième République dont le PC et la SFIO (les socialistes), le Conseil national de la Résistance (CNR) tint sa première réunion ce 27 mai, sous la présidence de Jean Moulin, délégué du général de Gaulle lequel voulait instaurer ce Conseil pour rendre plus efficace la lutte contre les nazis, renforcer sa propre légitimité face aux alliés. De Gaulle chargeait ce conseil d’élaborer un programme de gouvernement en prévision de la libération de la France. Ce programme fit l’objet de plusieurs va et vient entre le CNR et le gouvernement de la France libre, à la fois à Londres et à Alger, avant d’être adopté le 15 mars 1944, en assemblée plénière par le CNR. Ce programme est remis solennellement au Général de Gaulle par le CNR le 25 août 1944, à l’hôtel de Ville de Paris. Notons que l’ordonnance sur la presse est promulguée dès le 26 août. Et qu’un des principaux rédacteurs du programme fut Roger Ginsburger, fils d’un rabbin alsacien ; alors, sous le pseudonyme de Pierre Villon, il est secrétaire général du Front national de l’indépendance de la France, mouvement de résistance créé par le Parti communiste français, en 1941, et représente ce mouvement au sein du CNR et de son bureau permanent.
2 D’après une estimation syndicaliste, on est passé de 75 à 80% du revenu comme montant des retraites à environ 50%, ceci étant un ordre de grandeur. Jean-Paul Domin, maître de conférence en Économie à l’Université de Reims Champagne-Ardennes, en 2010, rédige pour l’Institut Européen du Salariat une note sur « L’assurance maladie complémentaire ». Il y révèle combien l’accès à une complémentaire de qualité est désormais un privilège dû à la position dans l’emploi, que les plus
14
fragiles renoncent à des soins faute d’assurances complémentaires et de l’importance du reste à payer ; que la source du problème est de n’avoir plus fait du salaire le support des droits sociaux — point central des ordonnances des 4 et 15 octobre 1945. Celles-ci promulguaient la Sécurité sociale et plaçaient sa gestion, sous la double autorité des représentants des travailleurs et de l’État. Depuis les réformes Juppé de 1995 prononcées par ordonnances, puis la loi Douste Blazy (docteur de formation), de 2004, c’est l’État seul qui gère la Sécurité sociale. C’est par exemple le chef de l’État qui nomme par décret le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Ce ne sont plus comme aux lendemains de la Libération, des syndicalistes qui en sont à la tête des caisses primaires départementales mais l’État, via les préfets. Les représentants des travailleurs n’y tiennent plus qu’un rôle de conseiller.
3 La Déclaration universelle des droits de l’homme fut adoptée le 10 décembre 1948, à Paris, par l’Assemblée générale des Nations unies par 48 États sur les 58 membres. Huit s’abstinrent : l’Afrique du Sud, à cause de l’apartheid que la déclaration condamnait de fait ; l’Arabie saoudite, du même, à cause de l’égalité hommes femmes ; l’Union soviétique (la Russie, la l’Ukraine, le Biélorussie), quant la à Pologne, eux que la la
Tchécoslovaquie,
Yougoslavie,
estimant
Déclaration n’allait pas assez loin dans la prise en compte des droits économiques et sociaux et sur la question des droits des minorités ; on note cependant que la Russie en particulier s’opposa à la proposition australienne de créer une Cour internationale des Droits de l’homme chargée d’examiner les pétitions adressées aux Nations unies ; il faut ici rappeler que l’article 8 de la Déclaration introduit le principe du recours individuel contre un État en cas de violation des droits fondamentaux ; ce principe allait trouver en Europe son application en 1998, avec la
15
création d’une Cour européenne des droits de l’homme permanente qui garantit ce droit de recours à plus de 800 millions d’Européens.
4 Sartre, J.-P., « Situation de l’écrivain en 1947 o, in Situations II, Paris, Gallimard, 1948.
5 Sartre, J.-P., « Maintenant l’espoir… (III) » in Le Nouvel Observateur, 24 mars 1980.
6 Les signataires de l’Appel du 8 mars 2004 sont : Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernant, Maurice Voutey.
16
POSTFACE Stéphane Hessel est né à Berlin, en 1917, d’un père juif écrivain, traducteur, Franz Hessel, et d’une mère peintre, mélomane, Helen Grund, écrivaine elle-même. Ses parents s’établissent à Paris en 1924, avec leurs deux enfants, Ulrich, l’aîné, et Stéphane. Grâce au milieu familial, tous deux fréquentent l’avant-garde parisienne, dont le dadaïste Marcel Duchamp et le sculpteur américain Alexandre Calder. Stéphane entre à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm en 1939, mais la guerre interrompt ses études. Naturalisé français depuis 1937, il est mobilisé et connaît la drôle de guerre, voit le maréchal Pétain brader la souveraineté française. En mai 1941, il rejoint la France libre du général de Gaulle, à Londres. Il travaille au Bureau de contre-espionnage, de renseignement et d’action (BCRA). Par une nuit de fin mars 1944, il est débarqué clandestinement en France sous le nom de code « Greco » avec pour mission d’entrer en contact avec les différents réseaux parisiens, de trouver de nouveaux lieux d’émission radio pour faire passer à Londres les renseignements recueillis, en vue du débarquement allié. Le 10 juillet 1944, il est arrêté à Paris par la Gestapo sur dénonciation : « On ne poursuit pas quelqu’un qui a parlé sous la torture », écrira-t-il dans un livre de mémoires, Danse avec le siècle, en 1997. Après des
interrogatoires sous la torture — l’épreuve de la baignoire notamment, mais il déstabilise ses tortionnaires en leur parlant allemand, sa langue natale — il est envoyé au camp de Buchenwald, en Allemagne, le 8 août 1944, donc à quelques jours de la libération de Paris. A la veille d’être pendu, il parvient in extremis à échanger son identité contre celle d’un français décédé du typhus dans le camp. Sous son nouveau nom, Michel Boitel, fraiseur de métier, il est transféré au camp de Rottleberode à proximité de l’usine de train d’atterrissage des bombardiers allemands, les Junker 52, mais heureusement — sa chance éternelle —, il est versé au service comptabilité. Il s’évade. Repris, il est déplacé au camp de
17
Dora où sont fabriquées les V-1 et V-2, ces fusées avec lesquelles les nazis espèrent encore gagner la guerre. Affecté à la compagnie disciplinaire, il s’évade à nouveau et cette fois pour de bon ; les troupes alliées se rapprochent de Dora. Enfin, il retrouve Paris, sa femme Vitia — la mère de ses trois enfants, deux garçons et une fille. Cette vie restituée, il fallait l’engager », écrit l’ancien de la France libre, dans ses mémoires. En 1946, après avoir réussi le concours d’entrée au ministère des Affaires étrangères, Stéphane Hessel devient diplomate. Son premier poste est aux Nations unies où, cette année-là, Henri Laugier, secrétaire général adjoint des Nations unies et secrétaire de la Commission des droits de l’homme, lui propose d’être son secrétaire de cabinet. C’est à ce titre que Stéphane Hessel rejoint la commission chargée d’élaborer ce qui sera la Déclaration universelle des Droits de l’homme. On considère que sur ses douze membres, six ont joué un rôle plus essentiel : Eleanor Roosevelt, la veuve du Président Roosevelt décédé en 1945, féministe engagée, elle préside la commission ; le docteur Chang (Chine de Tchang Kaïchek et non de Mao) : viceprésident de la commission, il affirma que la Déclaration ne devait pas être le reflet des seules idées occidentales ; Charles Habib Malik (Liban), rapporteur de la commission, souvent présenté comme la force motrice », avec Eleanor Roosevelt ; René Cassin (France), juriste et diplomate, président de la commission consultative des Droits de l’homme auprès du Quai d’Orsay ; on lui doit la rédaction de plusieurs articles et d’avoir su composer avec les craintes de certains États, y compris la France, de voir leur souveraineté coloniale menacée par cette déclaration — il avait une conception exigeante et interventionniste des Droits de l’homme ; John Peters Humphrey (Canada), avocat et diplomate, proche
collaborateur de Laugier, il écrivit la première ébauche, un document de 400 pages ; enfin Stéphane Hessel (France), diplomate, chef de cabinet du même Laugier, le plus jeune. On voit combien l’esprit de la France
18
libre souffla sur cette commission. La Déclaration est adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations unies au palais de Chaillot, à Paris. Avec l’afflux de nouveaux fonctionnaires, dont beaucoup convoitent un poste bien rémunéré, « isolant les marginaux en quête d’idéal » selon le propre commentaire d’Hessel dans ses mémoires, il quitte les Nations unies. Il est affecté par le ministère des Affaires Étrangères à la représentation de la France au sein d’institutions internationales, l’occasion de retrouver temporairement, à ce titre, New York et les Nations unies. Pendant la guerre d’Algérie, il milite en faveur de l’indépendance algérienne. En 1977, avec la complicité du secrétaire général de l’Élysée, Claude Brossolette, le fils de Pierre, chef autrefois du BCRA, il se voit proposer par le président Valéry Giscard d’Estaing le poste d’ambassadeur auprès des Nations unies, à Genève. Il ne cache pas que, de tous les hommes d’État français, celui dont il s’est senti le plus proche est Pierre Mendès France, connu à Londres à l’époque de la France libre et retrouvé aux Nations unies en 1946 à New York, où ce dernier représente la France au sein du Conseil économique et social. Il va devoir sa consécration comme diplomate à « cette modification dans le gouvernement de la France, écrit-il encore, que constitue l’arrivée de François Mitterrand à l’Élysée », en 1981. « Elle a fait d’un diplomate assez étroitement spécialisé dans la coopération multilatérale, arrivé à deux ans de sa retraite, un
ambassadeur de France. » Il adhère au parti socialiste. « Je me demande pourquoi ? Première réponse : le choc de l’année 1995. Je n’imaginais pas les Français assez imprudents pour porter Jacques Chirac à la présidence. » Disposant désormais d’un passeport diplomatique, il se rend avec sa nouvelle femme en 2008 et 2009 dans la bande de Gaza et à son retour témoigne sur la douloureuse existence des Gazaouis. « Je me suis toujours situé du côté des dissidents, déclare-t-il à la même époque. » C’est bien celui-là qui parle ici, à 93 ans. S. C.
19
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 14 Novembre 2015 à 22:29
Discours de la méthode
LIVRES - Discours de la méthode (René Descartes) - Catégorie Documents et Essais
Discours de la méthode
de René Descartes
Préface
POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ETCHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES
Si ce discours semble trop long pour être tout lu en une fois,on le pourra distinguer en six parties. Et, en la première, on trouvera diverses considérations touchant les sciences. En la seconde, les principales règles de la méthode que l’auteur a cherchée. En la 3, quelques-unes de celles de la morale qu’il a tirée de cette méthode. En la 4, les raisons par lesquelles il prouve l’existence de Dieu et de l’âme humaine, qui sont les fondements de sa métaphysique. En la 5, l’ordre des questions de physique qu’il a cherchées, et particulièrement l’explication du mouvement du cœur et de quelques autres difficultés qui appartiennent à la médecine, puis aussi la différence qui est entre notre âme et celle des bêtes. Et en la dernière, quelles choses il croit être requises pour aller plus avant en la recherche de la nature qu’il n’a été, et quelles raisons l’ont fait écrire.
Partie 1
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s’en éloignent.
Pour moi, je n’ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun; même j’ai souvent souhaité d’avoir la pensée ou la prompte, ou l’imagination aussi-nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, que quelques autres. Et je ne sache point de qualités que celles-ci, qui servent à la perfection de l’esprit : car pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les accidents, et non point entre les formes, ou natures, des individus d’une même espèce.
Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d’heur, de m’être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins,qui m’ont conduit à des considérations et des maximes, dont j’ai formé une méthode, par laquelle il me semble que j’ai moyen d’augmenter par degrés ma connaissance, et de l’élever peu à peu au plus haut point, auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d’atteindre. Car j’en ai déjà recueilli de tels fruits, qu’encore qu’aux jugements que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de ladéfiance, plutôt que vers celui de la présomption; et que,regardant d’un oeil de philosophe les diverses actions etentreprises de tous les hommes, il n’y en ait quasi aucune qui neme semble vaine et inutile; je ne laisse pas de recevoir uneextrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en larecherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pourl’avenir, que si, entre les occupations des hommes purement hommes,il y en a quelqu’une qui soit solidement bonne et importante, j’osecroire que c’est celle que j’ai choisie.
Toutefois il se peut faire que je me trompe, et ce n’estpeut-être qu’un peu de cuivre et de verre que je prends pour del’or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nousméprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements denos amis nous doivent être suspects, lorsqu’ils sont en notrefaveur. Mais je serai bien aise de faire voir, en ce discours,quels sont les chemins que j’ai suivis, et d’y représenter ma viecomme en un tableau, afin que chacun en puisse juger, etqu’apprenant du bruit commun les opinions qu’on en aura, ce soit unnouveau moyen de m’instruire, que j’ajouterai à ceux dont j’aicoutume de me servir.
Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode quechacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement defaire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne. Ceuxqui se mêlent de donner des préceptes, se doivent estimer plushabiles que ceux auxquels ils les donnent; et s’ils manquent en lamoindre chose, ils en sont blâmables. Mais, ne proposant cet écritque comme une histoire, ou, si vous l’aimez mieux, que comme unefable, en laquelle, parmi quelques exemples qu’on peut imiter, onen trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu’on aura raison dene pas suivre, j’espère qu’il sera utile à quelques-uns, sans êtrenuisible à personne, et que tous me sauront gré de mafranchise.
J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et parce qu’on mepersuadait que, par leur moyen, on pouvait acquérir uneconnaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie,j’avais un extrême désir de les apprendre. Mais, sitôt que j’eusachevé tout ce cours d’études, au bout duquel on a coutume d’êtrereçu au rang des doctes, je changeai entièrement d’opinion. Car jeme trouvais embarrassé de tant de doutes et d’erreurs, qu’il mesemblait n’avoir fait autre profit, en tâchant de m’instruire,sinon que j’avais découvert de plus en plus mon ignorance. Etnéanmoins j’étais en l’une des plus célèbres écoles de l’Europe, oùje pensais qu’il devait y avoir de savants hommes, s’il y en avaiten aucun endroit de la terre. J’y avais appris tout ce que lesautres y apprenaient; et même, ne m’étant pas contenté des sciencesqu’on nous enseignait, j’avais parcouru tous les livres, traitantde celles qu’on estime les plus curieuses et les plus rares, quiavaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais lesjugements que les autres faisaient de moi; et je ne voyais pointqu’on m’estimât inférieur à mes condisciples, bien qu’il y en eûtdéjà entre eux quelques-uns, qu’on destinait à remplir les placesde nos maîtres. Et enfin notre siècle me semblait aussifleurissant, et aussi fertile en bons esprits, qu’ait été aucun desprécédents. Ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moide tous les autres, et de penser qu’il n’y avait aucune doctrinedans le monde qui fût telle qu’on m’avait auparavant faitespérer.
Je ne laissais pas toutefois d’estimer les exercices, auxquelson s’occupe dans les écoles. je savais que les langues, qu’on yapprend, sont nécessaires pour l’intelligence des livres anciens;que la gentillesse des fables réveille l’esprit; que les actionsmémorables des histoires le relèvent, et qu’étant lues avecdiscrétion, elles aident à former le jugement; que la lecture detous les bons livres est comme une conversation avec les plushonnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, etmême une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrentque les meilleures de leurs pensées; que l’éloquence a des forceset des beautés incomparables; que la poésie a des délicatesses etdes douceurs très ravissantes; que les mathématiques ont desinventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant àcontenter les curieux, qu’à faciliter tous les arts et diminuer letravail des hommes; que les écrits qui traitent des mœurscontiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à lavertu qui sont fort utiles; que la théologie enseigne à gagner leciel; que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement detoutes choses, et se faire admirer des moins savants; que lajurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent deshonneurs et des richesses à ceux qui les cultivent; et enfin, qu’ilest bon de les avoir toutes examinées, même les plussuperstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur justevaleur et se garder d’en être trompé.
Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, etmême aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires,et à leurs fables. Car c’est quasi le même de converser avec ceuxdes autres siècles, que de voyager. Il est bon de savoir quelquechose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plussainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contrenos modes soit ridicule, et contre raison, ainsi qu’ont coutume defaire ceux qui n’ont rien vu. Mais lorsqu’on. emploie trop de tempsà voyager, on devient enfin étranger en son pays; et lorsqu’on esttrop curieux des choses qui se pratiquaient aux siècles passés, ondemeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent encelui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événementscomme possibles qui ne le sont point; et que même les histoires lesplus fidèles, si elles ne changent ni n’augmentent la valeur deschoses, pour les rendre plus dignes d’être lues, au moins enomettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustrescirconstances : d’où vient que le reste ne paraît pas tel qu’ilest, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu’ils entirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins denos romans, et à concevoir des desseins qui passent leursforces.
J’estimais fort l’éloquence, et j’étais amoureux de la poésie;mais je pensais que l’une et l’autre étaient des dons de l’esprit,plutôt que des fruits de l’étude. Ceux qui ont le raisonnement leplus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de lesrendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieuxpersuader ce qu’ils proposent, encore qu’ils ne parlassent que basbreton, et qu’ils n’eussent jamais appris de rhétorique. Et ceuxqui ont les inventions les plus agréables, et qui les saventexprimer avec le plus d’ornement et de douceur, ne laisseraient pasd’être les meilleurs poètes, encore que l’art poétique leur fûtinconnu.
Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de lacertitude et de l’évidence de leurs raisons; mais je ne remarquaispoint encore leur vrai usage, et, pensant qu’elles ne servaientqu’aux arts mécaniques, je m’étonnais de ce que, leurs fondementsétant si fermes et si solides, on n’avait rien bâti dessus de plusrelevé. Comme, au contraire, je comparais les écrits des ancienspaïens, qui traitent des mœurs, à des palais fort superbes et fortmagnifiques, qui n’étaient bâtis que sur du sable et sur de laboue. Ils élèvent fort haut les vertus, et les font paraîtreestimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde; mais ilsn’enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu’ilsappellent d’un si beau nom n’est qu’une insensibilité, ou unorgueil, ou un désespoir, ou un parricide.
Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’aucunautre, à gagner le ciel; mais ayant appris, comme chose trèsassurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorantsqu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent,sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettreà la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pourentreprendre de les examiner et y réussir, il était besoin d’avoirquelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plusqu’homme.
Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu’elle aété cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuisplusieurs siècles, et que néanmoins il ne s’y trouve encore aucunechose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse,je n’avais point assez de présomption pour espérer d’y rencontrermieux que les autres; et que, considérant combien il peut y avoirde diverses opinions, touchant une même matière, qui soientsoutenues par des gens doctes, sans qu’il y en puisse avoir jamaisplus d’une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux toutce qui n’était que vraisemblable.
Puis, pour les autres sciences, d’autant qu’elles empruntentleurs principes de la philosophie, je jugeais qu’on ne pouvaitavoir rien bâti, qui fût solide, sur des fondements si peu fermes.Et ni l’honneur, ni le gain qu’elles promettent, n’étaientsuffisants pour me convier à les apprendre; car je ne me sentaispoint, grâces à Dieu, de condition qui m’obligeât à faire un métierde la science, pour le soulagement de ma fortune; et quoique je nefisse pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisaisnéanmoins fort peu d’état de celle que je n’espérais point pouvoiracquérir qu’à faux titres. Et enfin, pour les mauvaises doctrines,je pensais déjà connaître assez ce qu’elles valaient, pour n’êtreplus sujet à être trompé, ni par les promesses d’un alchimiste, nipar les prédictions d’un astrologue, ni par les impostures d’unmagicien, ni par les artifices ou la vanterie d’aucun de ceux quifont profession de savoir plus qu’ils ne savent.
C’est pourquoi, sitôt que l’âge me permit de sortir de lasujétion de mes précepteurs, je quittai entièrement l’étude deslettres. Et me résolvant de ne chercher plus d’autre science, quecelle qui se pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grandlivre du monde, j’employai le reste de ma jeunesse à voyager, àvoir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverseshumeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, àm’éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune meproposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui seprésentaient, que j’en pusse tirer quelque profit. car il mesemblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité, dansles raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui luiimportent, et dont l’événement le doit punir bientôt après, s’il amal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans soncabinet, touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet,et qui ne lui sont d’autre conséquence, sinon que peut-être il entirera d’autant plus de vanité qu’elles seront plus éloignées dusens commun, à cause qu’il aura dû employer d’autant plus d’espritet d’artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j’avaistoujours un extrême désir d’apprendre à distinguer le vrai d’avecle faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assuranceen cette vie.
Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer lesmœurs des autres hommes, je n’y trouvais guère de quoi m’assurer,et que j’y remarquais quasi autant de diversité que j’avais faitauparavant entre les opinions des philosophes. En sorte que le plusgrand profit que j’en retirais était que, voyant plusieurs chosesqui, bien qu’elles nous semblent fort extravagantes et ridicules,ne laissent pas d’être communément reçues et approuvées pard’autres grands peuples, j’apprenais à ne rien croire tropfermement de ce qui ne m’avait été persuadé que par l’exemple etpar la coutume, et ainsi je me délivrais peu à peu de beaucoupd’erreurs, qui peuvent offusquer notre lumière naturelle, et nousrendre moins capables d’entendre raison. Mais après que j’eusemployé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et àtâcher d’acquérir quelque expérience, je pris un jour résolutiond’étudier aussi en moi-même, et d’employer toutes les forces de monesprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui meréussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamaiséloigné, ni de mon pays, ni de mes livres.
Partie 2
J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’ysont pas encore finies m’avait appelé; et comme je retournais ducouronnement de l’empereur vers l’armée, le commencement de l’hiverm’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui medivertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins nipassions qui me troublassent, je demeurais tout le jour enferméseul dans un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mespensées. Entre lesquelles, l’une des premières fut que je m’avisaide considérer que souvent il n’y a pas tant de perfection dans lesouvrages composés de plusieurs pièces, et faits de la main dedivers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsivoit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris etachevés ont coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés que ceuxque plusieurs ont tâché de raccommoder, en faisant servir devieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres fins. Ainsices anciennes cités, qui, n’ayant été au commencement que desbourgades, sont devenues, par succession de temps, de grandesvilles, sont ordinairement si mal compassées, au prix de ces placesrégulières qu’un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine,qu’encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on ytrouve souvent autant ou plus d’art qu’en ceux des autres;toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là unpetit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, ondirait que c’est plutôt la fortune, que la volonté de quelqueshommes usant de raison, qui les a ainsi disposés. Et si onconsidère qu’il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers,qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers,pour les faire servir à l’ornement du public, on connaîtra bienqu’il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d’autrui,de faire des choses fort accomplies. Ainsi je m’imaginai que lespeuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages, et ne s’étantcivilisés que peu à peu, n’ont fait leurs lois qu’à mesure quel’incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, nesauraient être si bien policés que ceux qui, dès le commencementqu’ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelqueprudent législateur. Comme il est bien certain que l’état de lavraie religion, dont Dieu seul a fait les ordonnances, doit êtreincomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parlerdes choses humaines, je crois que, si Sparte a été autrefois trèsflorissante, ce n’a pas été à cause de la bonté de chacune de seslois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges, etmême contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que, n’ayant étéinventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. Etainsi je pensai que les sciences des livres, au moins celles dontles raisons ne sont que probables, et qui n’ont aucunesdémonstrations, s’étant composées et grossies peu à peu desopinions de plusieurs diverses Personnes, ne sont point siapprochantes de la vérité que les simples raisonnements que peutfaire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui seprésentent. Et ainsi encore je pensai que, pour ce que nous avonstous été enfants avant que d’être hommes, et qu’il nous a fallulongtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, quiétaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les unsni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours lemeilleur, il est presque impossible que nos jugements soient sipurs, ni si solides qu’ils auraient été, si nous avions eu l’usageentier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nousn’eussions jamais été conduits que par elle.
Il est vrai que nous ne voyons point qu’on jette par terretoutes les maisons d’une ville, pour le seul dessein de les refaired’autre façon, et d’en rendre les rues plus belles; mais on voitbien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et quemême quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en dangerde tomber d’elles-mêmes, et que les fondements n’en sont pas bienfermes. A l’exemple de quoi je me persuadai, qu’il n’y auraitvéritablement point d’apparence qu’un particulier fît dessein deréformer un État, en y changeant tout dès les fondements, et en lerenversant pour le redresser; ni même aussi, de réformer le corpsdes sciences, ou l’ordre établi dans les écoles pour les enseigner;mais que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alorsen ma créance, je ne pouvais mieux faire que d’entreprendre, unebonne fois, de les en ôter, afin d’y en remettre par après, oud’autres meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les auraisajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que, par cemoyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je nebâtissais que sur de vieux fondements » et que je ne m’appuyasseque sur les principes que je m’étais laissé persuader en majeunesse, sans avoir jamais examiné s’ils étaient vrais. Car, bienque je remarquasse en ceci diverses difficultés, elles n’étaientpoint toutefois sans remède, ni comparables à celles qui setrouvent en la réformation des moindres choses qui touchent lepublic. Ces grands corps sont trop malaisés à relever, étantabattus, ou même à retenir, étant ébranlés, et leurs chutes nepeuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s’ilsen ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pourassurer que plusieurs en ont, l’usage les a sans doute fortadoucies; et même il en a évité ou corrigé insensiblement quantité,auxquelles en ne pourrait si bien pourvoir par prudence. Et enfin,elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leurchangement : en même façon que les grands chemins, qui tournoiententre des montagnes, deviennent peu à peu si unis et si commodes, àforce d’être fréquentés, qu’il est beaucoup meilleur de les suivreque d’entreprendre d’aller plus droit, en grimpant au-dessus desrochers, et descendant jusques au bas des précipices.
C’est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeursbrouillonnes et inquiètes, qui, n’étant appelées, ni par leurnaissance, ni par leur fortune, au maniement des affairespubliques, ne laissent pas d’y faire toujours, en idée, quelquenouvelle réformation. Et si je pensais qu’il y eût la moindre choseen cet écrit, par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, jeserais très marri de souffrir qu’il fût publié. Jamais mon desseinne s’est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes proprespensées, et de bâtir dans un fonds qui est tout à moi. Que si, monouvrage m’ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, cen’est pas, pour cela, que je veuille conseiller à personne del’imiter. Ceux que Dieu a mieux partagés de ses grâces aurontpeut-être des desseins plus relevés; mais je crains bien quecelui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. -a seulerésolution de se défaire de toutes les opinions qu’on a reçuesauparavant en sa créance n’est pas un exemple que chacun doivesuivre; et le monde n’est quasi composé que de deux sortesd’esprits auxquels il ne convient aucunement. A savoir, de ceuxqui, se croyant plus habiles qu’ils ne sont, ne se peuvent empêcherde précipiter leurs jugements, ni avoir assez de patience pourconduire par ordre toutes leurs pensées : d’où vient que, s’ilsavaient une fois pris la liberté de douter des principes qu’ils ontreçus, et de s’écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraienttenir le sentier qu’il faut prendre pour aller plus droit, etdemeureraient égarés toute leur vie. Puis, de ceux qui, ayant assezde raison, ou de modestie, pour juger qu’ils sont moins capables dedistinguer le vrai d’avec le faux, que quelques autres par lesquelsils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter desuivre les opinions de ces autres, qu’en chercher eux-mêmes demeilleures.
Et pour moi, j’aurais été sans doute du nombre de ces derniers,si je n’avais jamais eu qu’un seul maître, ou que je n’eusse pointsu les différences qui ont été de tout temps entre les opinions desplus doctes. Mais ayant appris, dès le collège, qu’on ne sauraitrien imaginer de si, étrange et si peu croyable, qu’il n’ait étédit
par quelqu’un des philosophes; et depuis, en voyageant, ayantreconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires auxnôtres, ne sont pas, pour cela, barbares ni sauvages, mais queplusieurs usent, autant ou plus que nous, de raison; et ayantconsidéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourridès son enfance entre des Français ou des Allemands, devientdifférent de ce qu’il serait, s’il avait toujours vécu entre desChinois ou des Cannibales ; et comment, jusques aux modes denos habits, la même chose qui nous a plu il « y » a dix ans, et quinous plaira peut-être encore avant dix ans, nous semble maintenantextravagante et ridicule : en sorte que c’est bien plus lacoutume et l’exemple qui nous persuadent, qu’aucune connaissancecertaine, et que néanmoins la pluralité des voix n’est pas unepreuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées àdécouvrir, à cause qu’il est bien plus vraisemblable qu’un hommeseul les ait rencontrées que tout un peuple : je ne pouvais choisirpersonne dont les opinions me semblassent devoir être préférées àcelles des autres, et je me trouvai comme contraint d’entreprendremoi-même de me conduire.
Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je merésolus d’aller si lentement, et d’user de tant de circonspectionen toutes choses, que, si je n’avançais que fort peu, je megarderais bien, au moins, de tomber. Même je ne voulus pointcommencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s’étaientpu glisser autrefois en ma créance sans y avoir été introduites parla raison, que je n’eusse auparavant employé assez de temps à fairele projet de l’ouvrage que j’entreprenais, et à chercher la vraieméthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dontmon esprit serait capable.
J’avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de laphilosophie, à la logique, et entre les mathématiques, à l’analysedes géomètres et à l’algèbre, trois arts ou sciences qui semblaientdevoir contribuer quelque chose à mon dessein. Mais, en lesexaminant, je pris garde que, pour la logique, ses syllogismes etla plupart de ses autres instructions servent plutôt à expliquer àautrui les choses qu’on sait ou même, comme l’art de Lulle, àparler, sans jugement, de celles qu’on ignore, qu’à les apprendre.Et bien qu’elle contienne, en effet, beaucoup de préceptes trèsvrais et très bons, il y en a toutefois tant d’autres, mêlés parmi,qui sont ou nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi malaiséde les en séparer, que de tirer une Diane ou une Minerve hors d’unbloc de marbre qui n’est point encore ébauché. Puis, pour l’analysedes anciens et l’algèbre des modernes, outre qu’elles ne s’étendentqu’à des matières fort abstraites, et qui ne semblent d’aucunusage, la première est toujours si astreinte à la considération desfigures, qu’elle ne peut exercer l’entendement sans fatiguerbeaucoup l’imagination; et on s’est tellement assujetti, en ladernière, à certaines règles et à certains chiffres, qu’onen a fait un art confus et obscur, qui embarrasse l’esprit, au lieud’une science qui le cultive. Ce qui fut cause que je pensai qu’ilfallait chercher quelque autre méthode, qui, comprenant lesavantages de ces trois, fût exempte de leurs défauts. Et comme lamultitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sortequ’un État est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort peu,elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grandnombre de préceptes dont la logique est composée, je crus quej’aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une fermeet constante résolution de ne manquer pas une seule fois à lesobserver.
Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie,que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire,d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de necomprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui seprésenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que jen’eusse aucune occasion de le mettre en doute.
Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais,en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requispour les mieux résoudre.
Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençantpar les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pourmonter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance desplus composés; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne seprécèdent point naturellement les uns les autres.
Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, etdes revues si générales, que je fusse assuré de ne rienomettre.
Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dontles géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir à leurs plusdifficiles démonstrations, m’avaient donné occasion de m’imaginerque toutes les choses, qui peuvent tomber sous la connaissance deshommes, s’entre-suivent en même façon et que, pourvu seulementqu’on s’abstienne d’en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit,et qu’on garde toujours l’ordre qu’il faut pour les déduire lesunes des autres, il n’y en peut avoir de si éloignées auxquellesenfin on ne parvienne, ni de si cachées qu’on ne découvre. Et je nefus pas beaucoup en peine de chercher par lesquelles il étaitbesoin de commencer : car je savais déjà que c’était par lesplus simples et les plus aisées à connaître; et considérantqu’entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans lessciences, il n’y a eu que les seuls mathématiciens qui ont putrouver quelques démonstrations, c’est-à-dire quelques raisonscertaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par lesmêmes qu’ils ont examinées; bien que je n’en espérasse aucune autreutilité, sinon qu’elles accoutumeraient mon esprit à se repaître devérités, et ne se contenter point de fausses raisons. Mais je n’euspas dessein, pour cela, de tâcher d’apprendre toutes ces sciencesparticulières, qu’on nomme communément mathématiques, et voyantqu’encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pasde s’accorder toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre choseque les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je pensaiqu’il valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions engénéral, et sans les supposer que dans les sujets qui serviraient àm’en rendre la connaissance plus aisée; même aussi sans les yastreindre aucunement, afin de les pouvoir d’autant mieux appliqueraprès à tous les autres auxquels elles conviendraient. Puis, ayantpris garde que, pour les connaître, j’aurais quelquefois besoin deles considérer chacune en particulier, et quelquefois seulement deles retenir, ou de les comprendre plusieurs ensemble, je pensaique, pour les considérer mieux en particulier, je les devaissupposer en des lignes, à cause que je ne trouvais rien de plussimple, ni que je pusse plus distinctement représenter à monimagination et à mes sens; mais que, pour les retenir, ou lescomprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les expliquassepar quelques chiffres, les plus courts qu’il serait possible, etque, par ce moyen, j’emprunterais tout le meilleur de l’analysegéométrique et de l’algèbre, et corrigerais tous les défauts del’une par l’autre.
Comme, en effet, j’ose dire que l’exacte observation de ce peude préceptes que j’avais choisis, me donna telle facilité à démêlertoutes les questions auxquelles ces deux sciences s’étendent, qu’endeux ou trois mois que j’employai à les examiner, ayant commencépar les plus simples et plus générales, et chaque vérité que jetrouvais étant une règle qui me servait après à en trouverd’autres, non seulement je vins à bout de plusieurs que j’avaisjugées autrefois très difficiles, mais il me sembla aussi, vers lafin, que je pouvais déterminer, en celles même que j’ignorais, parquels moyens, et jusques où, il était possible de les résoudre. Enquoi je ne vous paraîtrai peut-être pas être fort vain, si vousconsidérez que, n’y ayant qu’une vérité de chaque chose, quiconquela trouve en sait autant qu’on en peut savoir; et que, par exemple,un enfant instruit en l’arithmétique, ayant fait une additionsuivant ses règles, se peut assurer d’avoir trouvé, touchant lasomme qu’il examinait, tout ce que l’esprit humain saurait trouver.Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et àdénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu’on cherche,contient tout ce qui donne de la certitude aux règlesd’arithmétique.
Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que,par elle, j’étais assuré d’user en tout de ma raison, sinonparfaitement, au moins le mieux, qui fût en mon pouvoir; outre queje sentais, en la pratiquant, que mon esprit s’accoutumait peu àpeu à concevoir plus nettement et plus distinctement ses objets, etque, ne l’ayant point assujettie à aucune matière particulière, jeme promettais de l’appliquer aussi utilement aux difficultés desautres sciences, que j’avais fait à celles de l’algèbre. Non que,pour cela, j’osasse entreprendre d’abord d’examiner toutes cellesqui se présenteraient; car cela même eût été contraire à l’ordrequ’elle prescrit. Mais, ayant pris garde que leurs principesdevaient tous être empruntés de la philosophie, en laquelle je n’entrouvais point encore de certains, je pensai qu’il fallait, avanttout, que je tâchasse d’y en établir; et que, cela étant la chosedu monde la plus importante, et où la précipitation et laprévention étaient le plus à craindre, je ne devais pointentreprendre d’en venir à bout, que je n’eusse atteint un âge bienplus mûr que celui de vingt-trois ans, que j’avais alors; et que jen’eusse, auparavant, employé beaucoup de temps à m’y préparer, tanten déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions que j’yavais reçues avant ce temps-là, qu’en faisant amas de plusieursexpériences, pour être après la matière de mes raisonnements, et enm’exerçant toujours en la méthode que je m’étais prescrite, afin dem’y affermir de plus en plus.
Partie 3
Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de commencer à rebâtirle logis où on demeure, que de l’abattre, et de faire provision dematériaux et d’architectes, ou s’exercer soi-même à l’architecture,et outre cela d’en avoir soigneusement tracé le dessin; mais qu’ilfaut aussi s’être pourvu de quelque autre, où on puisse être logécommodément pendant le temps qu’on y travaillera; ainsi, afin queje ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que laraison m’obligerait de l’être en mes jugements, et que je nelaissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que jepourrais, je me formai une morale par provision, qui ne consistaitqu’en trois ou quatre maximes, dont je veux bien vous fairepart.
La première était d’obéir aux lois et aux coutumes de mon pays,retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait la grâced’être instruit dès mon enfance, et me gouvernant, en toute autrechose, suivant les opinions les plus modérées, et les pluséloignées de l’excès, qui fussent communément reçues en pratiquepar les mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre. Car,commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, àcause que je les voulais remettre toutes à l’examen, j’étais assuréde ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Etencore qu’il y en ait peut-être d’aussi bien sensés, parmi lesPerses ou les Chinois, que parmi nous, il me semblait que le plusutile était de me régler selon ceux avec lesquels j’aurais à vivre;et que, pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions,je devais plutôt prendre garde à ce qu’ils pratiquaient qu’à cequ’ils disaient; non seulement à cause qu’en la corruption de nosmœurs il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu’ils croient,mais aussi à cause que plusieurs l’ignorent eux-mêmes, car l’actionde la pensée par laquelle on croit une chose, étant différente decelle par laquelle on connaît qu’on la croit, elles sont souventl’une sans l’autre. Et entre plusieurs opinions également reçues,je ne choisissais que les plus modérées : tant à cause que ce sonttoujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablementles meilleures, tous excès ayant coutume d’être mauvais; commeaussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que jefaillisse, que si, ayant choisi l’un des extrêmes, c’eût étél’autre qu’il eût fallu suivre. Et, particulièrement, je mettaisentre les excès toutes les promesses par lesquelles on retranchequelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les loisqui, pour remédier à l’inconstance des esprits faibles, permettent,lorsqu’on a quelque bon dessein, ou même, pour la sûreté ducommerce, quelque dessein qui n’est qu’indifférent, qu’on fasse desvœux ou des contrats qui obligent à y persévérer; mais à cause queje ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en mêmeétat, et que, pour mon particulier, je me promettais deperfectionner de plus en plus mes jugements, et non point de lesrendre pires, j’eusse pensé commettre une grande faute contre lebon sens, si, parce que j’approuvais alors quelque chose, je mefusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu’elleaurait peut-être cessé de l’être, ou que j’aurais cessé del’estimer telle.
Ma seconde maxime était d’être le plus ferme et le plus résoluen mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moinsconstamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m’y seraisune fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitanten ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, nedoivent pas errer en tournoyant, tantôt d’un côté, tantôt d’unautre, ni encore moins s’arrêter en une place, mais marchertoujours le plus droit qu’ils peuvent vers un même côté, et ne lechanger point pour de faibles raisons, encore que ce n’aitpeut-être été au commencement que le hasard seul qui les aitdéterminés à le choisir : car, par ce moyen, s’ils ne vontjustement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelquepart, où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieud’une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souventaucun délai, c’est une vérité très certaine que, lorsqu’il n’estpas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nousdevons suivre les plus probables; et même, qu’encore que nous neremarquions point davantage de probabilité aux unes qu’aux autres,nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et lesconsidérer après, non plus comme douteuses, en tant qu’elles serapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines,à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle.Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirset les remords, qui ont coutume d’agiter les consciences de cesesprits faibles et chancelants, qui se laissent allerinconstamment : à pratiquer, comme bonnes, les choses qu’ilsjugent après être mauvaises.
Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincreque la fortune, et à changer mes désirs que l’ordre du monde; etgénéralement, de m’accoutumer à croire qu’il n’y a rien qui soitentièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu’aprèsque nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sontextérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard denous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait êtresuffisant pour m’empêcher de rien désirer à l’avenir que jen’acquisse, et ainsi pour me rendre content. Car notre volonté nese portant naturellement à désirer que les choses que notreentendement lui représente en quelque façon comme possibles, il estcertain que, si nous considérons tous les biens qui sont hors denous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n’aurons pasplus de regrets de manquer de ceux qui semblent être dus à notrenaissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nousavons de ne posséder pas les royaumes de la Chine ou du Mexique; etque faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désireronspas davantage d’être sains, étant malades, ou d’être libres, étanten prison, que nous faisons maintenant d’avoir des corps d’unematière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pourvoler comme les oiseaux. Mais j’avoue qu’il est besoin d’un longexercice, et d’une méditation souvent réitérée, pour s’accoutumer àregarder de ce biais toutes les choses; et je crois que c’estprincipalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes,qui ont pu autrefois se soustraire de l’empire de la fortune et,malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avecleurs dieux. Car, s’occupant sans cesse à considérer les bornes quileur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient siparfaitement que rien n’était en leur pouvoir que leurs pensées,que cela seul était suffisant pour les empêcher d’avoir aucuneaffection pour d’autres choses; et ils disposaient d’elles siabsolument, qu’ils avaient en cela quelque raison de s’estimer plusriches, et plus puissants, et plus libres, et plus heureux,qu’aucun des autres hommes qui, n’ayant point cette philosophie,tant favorisés de la nature et de la fortune qu’ils puissent être,ne disposent jamais ainsi de tout ce qu’ils veulent.
Enfin, pour conclusion de cette morale, je m’avisai de faire unerevue sur les diverses occupations qu’ont les hommes en cette vie,pour tâcher à faire choix de la meilleure; et sans que je veuillerien dire de celles des autres, je pensai que je ne pouvais mieuxque de continuer en celle-là même où je me trouvais, c’est-à-dire,que d’employer toute ma vie à cultiver ma raison, et m’avancer,autant que je pourrais, en la connaissance de la vérité, suivant laméthode que je m’étais prescrite. J’avais éprouvé de si extrêmescontentements, depuis que j’avais commencé à me servir de cetteméthode, que je ne croyais pas qu’on en pût recevoir de plus doux,ni de plus innocents, en cette vie; et découvrant tous les jourspar son moyen quelques vérités, qui me semblaient assezimportantes, et communément ignorées des autres hommes, lasatisfaction que j’en avais remplissait tellement mon esprit quetout le reste ne me touchait point. Outre que les trois maximesprécédentes n’étaient fondées que sur le dessein que j’avais decontinuer à m’instruire : car Dieu nous ayant donné à chacunquelque lumière pour discerner le vrai d’avec le faux, je n’eussepas cru me devoir contenter des opinions d’autrui un seul moment,si je ne me fusse proposé d’employer mon propre jugement à lesexaminer, lorsqu’il serait temps; et je n’eusse su m’exempter descrupule, en les suivant, si je n’eusse espéré de ne perdre pourcela aucune occasion d’en trouver de meilleures, en cas qu’il y eneût. Et enfin, je n’eusse su borner mes désirs, ni être content, sije n’eusse suivi un chemin par lequel, pensant être assuré del’acquisition de toutes les connaissances dont je serais capable,je le pensais être, par même moyen, de celle de tous les vraisbiens qui seraient jamais en mon pouvoir, d’autant que, notrevolonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que selonque notre entendement « la » lui représente bonne ou mauvaise,il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu’onpuisse pour faire aussi tout son mieux, c’est-à-dire pour acquérirtoutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu’on puisseacquérir; et lorsqu’on est certain que cela est, on ne sauraitmanquer d’être content.
Après m’être ainsi assuré de ces maximes, et les avoir mises àpart, avec les vérités de la foi, qui ont toujours été lespremières en ma créance, je jugeai que, pour tout le reste de mesopinions, je pouvais librement entreprendre de m’en défaire. Etd’autant que j’espérais en pouvoir mieux venir à bout, enconversant avec les hommes, qu’en demeurant plus longtemps renfermédans le poêle où j’avais eu toutes ces pensées, l’hiver n’était pasencore bien achevé que je me remis à voyager. Et en toutes les neufannées suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans lemonde, tâchant d’y être spectateur plutôt qu’acteur en toutes lescomédies qui s’y jouent; et faisant particulièrement réflexion, enchaque matière, sur ce qui la pouvait rendre suspecte, et nousdonner occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de monesprit toutes les erreurs qui s’y étaient pu glisser auparavant.Non que j’imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent quepour douter, et affectent d’être toujours irrésolus : car, aucontraire, tout mon dessein ne tendait qu’à m’assurer, et à rejeterla terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l’argile. Cequi me réussissait, ce me semble, assez bien, d’autant que, tâchantà découvrir la fausseté ou l’incertitude des propositions quej’examinais, non par de faibles conjectures, mais par desraisonnements clairs et assurés, je n’en rencontrais point de sidouteuses, que je n’en tirasse toujours quelque conclusion assezcertaine, quand ce n’eût été que cela même qu’elle ne contenaitrien de certain. Et comme, en abattant un vieux logis, on enréserve ordinairement les démolitions pour servir à en bâtir unnouveau, ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que jejugeais être mal fondées, je faisais diverses observations etacquérais plusieurs expériences, qui m’ont servi depuis à enétablir de plus certaines. Et, de plus, je continuais à m’exerceren la méthode que je m’étais prescrite; car, outre que j’avais soinde conduire généralement toutes mes pensées selon ses règles, je meréservais de temps en temps quelques heures, que j’employaisparticulièrement à la pratiquer en des difficultés de mathématique,ou même aussi en quelques autres que je pouvais rendre quasisemblables à celles des mathématiques, en les détachant de tous lesprincipes des autres sciences que je ne trouvais pas assez fermes,comme vous verrez que j’ai fait en plusieurs qui sont expliquées ence volume. Et ainsi, sans vivre d’autre façon, en apparence, queceux qui, n’ayant aucun emploi qu’à passer une vie douce etinnocente, s’étudient à séparer les plaisirs des vices, et qui,pour jouir de leur loisir sans s’ennuyer, usent de tous lesdivertissements qui sont honnêtes, je ne laissais pas de poursuivreen mon dessein, et de profiter en la connaissance de la vérité,peut-être plus que si je n’eusse fait que lire des livres, oufréquenter des gens de lettres.
Toutefois, ces neuf ans s’écoulèrent avant que j’eusse encorepris aucun parti, touchant les difficultés qui ont coutume d’êtredisputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondementsd’aucune philosophie plus certaine que la vulgaire. Et l’exemple deplusieurs excellents esprits, qui, en ayant eu ci-devant ledessein, me semblaient n’y avoir pas réussi, m’y faisait imaginertant de difficulté, que je n’eusse peut-être pas encore sitôt osél’entreprendre, si je n’eusse vu que quelques-uns faisaient déjàcourre le bruit que j’en étais venu à bout. je ne saurais pas diresur quoi ils fondaient cette opinion; et si j’y ai contribuéquelque chose par mes discours, ce doit avoir été en confessantplus ingénument ce que j’ignorais, que n’ont coutume de faire ceuxqui ont un peu étudié, et peut-être aussi en faisant voir lesraisons que j’avais de douter de beaucoup de choses que les autresestiment certaines, plutôt qu’en me vantant d’aucune doctrine. Maisayant le cœur assez bon pour ne vouloir point qu’on me prît pourautre que je n’étais, je pensai qu’il fallait que je tâchasse, partous moyens, a me rendre digne de la réputation qu’on me donnait;et il y a justement huit ans, que ce désir me fit résoudre àm’éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances,et à me retirer ici, en un pays où la longue durée de la guerre afait établir de tels ordres, que les armées qu’on y entretient nesemblent servir qu’à faire qu’on y jouisse des fruits de la paixavec d’autant plus de sûreté, et où parmi la foule d’un grandpeuple fort actif, et plus soigneux de ses propres affaires quecurieux de celles d’autrui, sans manquer d’aucune des commoditésqui sont dans les villes les plus fréquentées, j’ai pu vivre aussisolitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés.
Partie 4
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditationsque j’y ai faites; car elles sont si métaphysiques et si peucommunes, qu’elles ne seront peut-être pas au goût de tout lemonde. Et toutefois, afin qu’on puisse juger si les fondements quej’ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façoncontraint d’en parler. J’avais dès longtemps remarqué que, pour lesmœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu’on saitfort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables,ainsi qu’il a été dit ci-dessus; mais, parce qu’alors je désiraisvaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu’ilfallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, commeabsolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindredoute afin de voir s’il ne resterait point, après cela, quelquechose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, àcause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposerqu’il n’y avait aucune chose qui fût telle qu’ils nous la fontimaginer. Et parce qu’il y a des hommes qui se méprennent enraisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie,et y font des paralogismes, jugeant que j’étais sujet à faillir,autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisonsque j’avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin,considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étantéveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu’ily en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus defeindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées enl’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes.Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulaisainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement quemoi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cettevérité :je pense, donc je suis, était si ferme et siassurée, que toutes les plus extravagantes suppositions dessceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que jepouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de laphilosophie que je cherchais.
Puis, examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que jepouvais feindre que je n’avais aucun corps, et qu’il n’y avaitaucun monde, ni aucun lieu où je fusse; mais que je ne pouvais pasfeindre, pour cela, que je n’étais point; et qu’au contraire, decela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses,il suivait très évidemment et très certainement que j’étais; aulieu que, si j’eusse seulement cessé de penser, encore que tout lereste de ce que j’avais jamais imaginé eût été vrai, je n’avaisaucune raison de croire que j’eusse été : je connus de là quej’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est quede penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépendd’aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âmepar laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte ducorps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, etqu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout cequ’elle est.
Après cela, je considérai en général ce qui est requis à uneproposition pour être vraie et certaine; car, puisque je venaisd’en trouver une que je savais être telle, je pensai que je devaisaussi savoir en quoi consiste cette certitude. Et ayant remarquéqu’il n’y a rien du tout en ceci : je pense, donc je suis,qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois trèsclairement que, pour penser, il faut être : je jugeai que jepouvais prendre pour règle générale, que les choses que nousconcevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies;mais qu’il y a seulement quelque difficulté à bien remarquerquelles sont celles que nous concevons distinctement.
En suite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais, etque, par conséquent, mon être n’était pas tout parfait, car jevoyais clairement que c’était une plus grande perfection deconnaître que de douter, je m’avisai de chercher d’où j’avaisappris à penser à quelque chose de plus parfait que je n’étais; etje connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fûten effet plus parfaite. Pour ce qui est des pensées que j’avais deplusieurs autres choses hors de moi, comme du ciel, de la terre, dela lumière, de la chaleur, et de mille autres, je n’étais pointtant en peine de savoir d’où elles venaient, à cause que, neremarquant rien en elles qui me semblât les rendre supérieures àmoi, je pouvais croire que, si elles étaient vraies, c’étaient desdépendances de ma nature, en tant qu’elle avait quelque perfection;et si elles ne l’étaient pas, que je les tenais du néant,c’est-à-dire qu’elles étaient en moi, parce que j’avais du défaut.Mais ce ne pouvait être le même de l’idée d’un être plus parfaitque le mien : car, de la tenir du néant, c’était chosemanifestement impossible; et parce qu’il n’y a pas moins derépugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance dumoins parfait, qu’il y en a que de rien procède quelque chose, jene la pouvais tenir non plus de moi-même. De façon qu’il restaitqu’elle eût été mise en moi par une nature qui fût véritablementplus parfaite que je n’étais, et même qui eût en soi toutes lesperfections dont je pouvais avoir quelque idée, c’est-à-dire, pourm’expliquer en un mot, qui fût Dieu. A quoi j’ajoutai que, puisqueje connaissais quelques perfections que je n’avais point, jen’étais pas le seul être qui existât (j’userai, s’il vous plaît,ici librement des mots de l’École), mais qu’il fallait, denécessité, qu’il y en eût quelque autre plus parfait, duquel jedépendisse, et duquel j’eusse acquis tout ce que j’avais. Car, sij’eusse été seul et indépendant de tout autre, en sorte que j’eusseeu, de moi-même, tout ce peu que je participais de l’être parfait,j’eusse pu avoir de moi, par même raison, tout le surplus que jeconnaissais me manquer, et ainsi être moi-même infini, éternel,immuable, tout connaissant, tout-puissant, et enfin avoir toutesles perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. Car, suivantles raisonnements que je viens de faire, pour connaître la naturede Dieu, autant que la mienne en était capable, je n’avais qu’àconsidérer de toutes les choses dont je trouvais en moi quelqueidée, si c’était perfection, ou non, de les posséder, et j’étaisassuré qu’aucune de celles qui marquaient quelque imperfectionn’était en lui, mais que toutes les autres y étaient. Comme jevoyais que le doute, l’inconstance, la tristesse, et chosessemblables, n’y pouvaient être, vu que j’eusse été moi-même bienaise d’en être exempt. Puis, outre cela, j’avais des idées deplusieurs choses sensibles et corporelles : car, quoique jesupposasse que je rêvais, et que tout ce que je voyais ou imaginaisétait faux, je ne pouvais nier toutefois que les idées n’en fussentvéritablement en ma pensée; mais parce que j’avais déjà connu enmoi très clairement que la nature intelligente est distincte de lacorporelle, considérant que toute composition témoigne de ladépendance, et que la dépendance est manifestement un défaut, jejugeais de là, que ce ne pouvait être une perfection en Dieu d’êtrecomposé de ces deux natures, et que, par conséquent, il ne l’étaitpas; mais que, s’il y avait quelques corps dans le monde, ou bienquelques intelligences, ou autres natures, qui ne fussent pointtoutes parfaites, leur être devait dépendre de sa puissance, entelle sorte qu’elles ne pouvaient subsister sans lui un seulmoment.
Je voulus chercher, après cela, d’autres vérités, et m’étantproposé l’objet des géomètres, que je concevais comme un corpscontinu, ou un espace indéfiniment étendu en longueur, largeur ethauteur ou profondeur, divisible en diverses parties, qui pouvaientavoir diverses figures et grandeurs, et être mues ou transposées entoutes sortes, car les géomètres supposent tout cela du leur objet,je parcourus quelques-unes de leurs plus simples démonstrations. Etayant pris garde que cette grande certitude, que tout le monde leurattribue, n’est fondée que sur ce qu’on les conçoit évidemment,suivant la règle que j’ai tantôt dite, je pris garde aussi qu’iln’y avait rien du tout en elles qui m’assurât de l’existence deleur objet. Car, par exemple, je voyais bien que, supposant untriangle, il fallait que ses trois angles fussent égaux à deuxdroits; mais je ne voyais rien pour cela qui m’assurât qu’il y eûtau monde aucun triangle. Au lieu que, revenant à examiner l’idéeque j’avais d’un Être parfait, je trouvais que l’existence y étaitcomprise, en même façon qu’il est compris en celles d’un triangleque ses trois angles sont égaux à deux droits, ou en celle d’unesphère que toutes ses parties sont également distantes de soncentre, ou même encore plus évidemment; et que, par conséquent, ilest pour le moins aussi certain, que Dieu, qui est cet Êtreparfait, est ou existe, qu’aucune démonstration de géométrie lesaurait être.
Mais ce qui fait qu’il y en a plusieurs qui se persuadent qu’ily a de la difficulté à le connaître, et même aussi à connaître ceque c’est que leur âme, c’est qu’ils n’élèvent jamais leur espritau delà des choses sensibles, et qu’ils sont tellement accoutumés àne rien considérer qu’en l’imaginant, qui est une façon de penserparticulière pour les choses matérielles, que tout ce qui n’est pasimaginable leur semble n’être pas intelligible. Ce qui est assezmanifeste de ce que même les philosophes tiennent pour maxime, dansles écoles, qu’il n’y a rien dans l’entendement qui n’aitpremièrement été dans le sens, où toutefois il est certain que lesidées de Dieu et de l’âme n’ont jamais été. Et il me semble queceux qui veulent user de leur imagination, pour les comprendre,font tout de même que si, pour ouïr les sons, ou sentir les odeurs,ils se voulaient servir de leurs yeux : sinon qu’il y a encorecette différence, que le sens de la vue ne nous assure pas moins dela vérité de ses objets, que font ceux de l’odorat ou de l’ouïe; aulieu que ni notre imagination ni nos sens ne nous sauraient jamaisassurer d’aucune chose, si notre entendement n’y intervient.
Enfin, s’il y a encore des hommes qui ne soient pas assezpersuadés de l’existence de Dieu et de leur âme, par les raisonsque j’ai apportées, je veux bien -qu’ils sachent que toutes lesautres choses, dont ils se pensent peut-être plus assurés, commed’avoir un corps, et qu’il y a des astres et une terre, et chosessemblables, sont moins certaines. Car encore qu’on ait uneassurance morale de ces choses, qui est telle, qu’il semble qu’àmoins que d’être extravagant, on n’en peut douter, toutefois aussi,à moins que d’être déraisonnable, lorsqu’il est question d’unecertitude métaphysique, on ne peut nier que ce ne soit assez desujet, pour n’en être pas entièrement assuré, que d’avoir prisgarde qu’on peut, en même façon, s’imaginer, étant endormi, qu’on aun autre corps, et qu’on voit d’autres astres, et une autre terre,sans qu’il en soit rien. Car d’où sait-on que les pensées quiviennent en songe sont plutôt fausses que les autres, vu quesouvent elles ne sont pas moins vives et expresses ? Et queles meilleurs esprits y étudient tant qu’il leur plaira, je necrois pas qu’ils puissent donner aucune raison qui soit suffisantepour ôter ce doute, s’ils ne présupposent l’existence de Dieu. Car,premièrement, cela même que j’ai tantôt pris pour une règle, àsavoir que les choses que nous concevons très clairement et trèsdistinctement sont toutes vraies, n’est assuré qu’à cause que Dieuest ou existe, et qu’il est un être parfait, et que tout ce qui esten nous vient de lui. D’où il suit que nos idées ou notions, étantdes choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoielles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être quevraies. En sorte que, si nous en avons assez souvent quicontiennent de la fausseté, ce ne peut être que de celles qui ontquelque chose de confus et obscur, à cause qu’en cela ellesparticipent du néant, c’est-à-dire, qu’elles ne sont en nous ainsiconfuses, qu’à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Et ilest évident qu’il n’y a pas moins de répugnance que la fausseté oul’imperfection procède de Dieu, en tant que telle, qu’il y en a quela vérité ou la perfection procède du néant. Mais si nous nesavions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vientd’un être parfait et infini, pour claires et distinctes que fussentnos idées, nous n’aurions aucune raison qui nous assurât qu’elleseussent la perfection d’être vraies.
Or, après que la connaissance de Dieu et de l’âme nous a ainsirendus certains de cette règle, il est bien aisé à connaître queles rêveries que nous imaginons étant endormis ne doiventaucunement nous faire douter de la vérité des pensées que nousavons étant éveillés. Car, s’il arrivait, même en dormant, qu’oneût quelque idée fort distincte, comme, par exemple, qu’un géomètreinventât quelque nouvelle démonstration, son sommeil nel’empêcherait pas d’être vraie. Et pour l’erreur la plus ordinairede nos songes, qui consiste en ce qu’ils nous représentent diversobjets en même façon que font nos sens extérieurs, n’importe pasqu’elle nous donne occasion de nous défier de la vérité de tellesidées, à cause qu’elles peuvent aussi nous tromper assez souvent,sans que nous dormions : comme lorsque ceux qui ont la jaunissevoient tout de couleur jaune, ou que les astres ou autres corpsfort éloignes nous paraissent beaucoup plus petits qu’ils ne sont.Car enfin, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous nenous devons jamais laisser persuader qu’à. l’évidence de notreraison. Et il est à remarquer que je dis, de notre raison, et nonpoint, de notre imagination ni de nos sens. Comme, encore que nousvoyons le soleil très clairement, nous ne devons pas juger pourcela qu’il ne soit que de la grandeur que nous le voyons; et nouspouvons bien imaginer distinctement une tête de lion entée sur lecorps d’une chèvre, sans qu’il faille conclure, pour cela, qu’il yait au monde une chimère : car la raison ne nous dicte point que ceque nous voyons ou imaginons ainsi soit véritable. Mais elle nousdicte bien que toutes nos idées ou notions doivent avoir quelquefondement de vérité; car il ne serait pas possible que Dieu, quiest tout parfait et tout véritable, les eût mises en nous sanscela. Et parce que nos raisonnements ne sont jamais si évidents nisi entiers pendant le sommeil que pendant la veille, bien quequelquefois nos imaginations soient alors autant ou plus vives etexpresses, elle nous dicte aussi que nos pensées ne pouvant êtretoutes vraies, à cause que nous ne sommes pas tout parfaits, cequ’elles ont de vérité doit infailliblement se rencontrer en cellesque nous avons étant éveillés, plutôt qu’en nos songes.
Partie 5
Je serais bien aise de poursuivre, et de faire voir ici toute lachaîne des autres vérités que j’ai déduites de ces premières. Mais,à cause que, pour cet effet, il serait maintenant besoin que jeparlasse de plusieurs questions, qui sont en controverse entre lesdoctes, avec lesquels je ne désire point me brouiller, je croisqu’il sera mieux que je m’en abstienne, et que je dise seulement engénéral quelles elles sont, afin de laisser juger aux plus sagess’il serait utile que le public en fût plus particulièrementinformé. Je suis toujours demeuré ferme en la résolution quej’avais prise, de ne supposer aucun autre principe que celui dontje viens de me servir pour démontrer l’existence de Dieu et del’âme, et de ne recevoir aucune chose pour vraie, qui ne me semblâtplus claire et plus certaine que n’avaient fait auparavant lesdémonstrations des géomètres. Et néanmoins j’ose dire que, nonseulement j’ai trouvé moyen de me satisfaire en peu de temps,touchant toutes les principales difficultés dont on a coutume detraiter en la Philosophie, mais aussi que j’ai remarqué certaineslois, que Dieu a tellement établies en la nature, et dont il aimprimé de telles notions en nos âmes, qu’après y avoir fait assezde réflexion, nous ne saurions douter qu’elles ne soient exactementobservées, en tout ce qui est ou qui se fait dans le monde. Puis,en considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvertplusieurs vérités plus utiles et plus importantes que tout ce quej’avais appris auparavant, ou même espéré d’apprendre.
Mais parce que j’ai tâché d’en expliquer les principales dans untraité, que quelques considérations m’empêchent de publier, je neles saurais mieux faire connaître, qu’en disant ici sommairement cequ’il contient. J’ai eu dessein d’y comprendre tout ce que jepensais savoir, avant que de l’écrire, touchant la nature deschoses matérielles. Mais, tout de même que les peintres, ne pouvantégalement bien représenter dans un tableau plat toutes les diversesfaces d’un corps solide, en choisissent une des principales qu’ilsmettent seule vers le jour, et ombrageant les autres, ne les fontparaître qu’en tant qu’on les peut voir en la regardant : ainsi,craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j’avaisen la pensée, j’entrepris seulement d’y exposer bien amplement ceque je concevais de la lumière; puis, à son occasion, d’y ajouterquelque chose du soleil et des étoiles fixes, à cause qu’elle enprocède presque toute; des cieux, à cause qu’ils la transmettent;des planètes, des comètes et de la terre, à cause qu’elles la fontréfléchir; et en particulier de tous les corps qui sont sur laterre, à cause qu’ils sont ou colorés, ou transparents, oulumineux; et enfin de l’Homme, à cause qu’il en est le spectateur.Même, pour ombrager un peu toutes ces choses, et pouvoir dire pluslibrement ce que j’en jugeais, sans être obligé de suivre ni deréfuter les opinions qui sont reçues entre les doctes, je merésolus de laisser tout ce Monde ici à leurs disputes, et de parierseulement de ce qui arriverait dans un nouveau, si Dieu créaitmaintenant quelque part, dans les espaces imaginaires, assez dematière pour le composer, et qu’il agitât diversement et sans ordreles diverses parties de cette matière, en sorte qu’il en composâtun chaos aussi confus que les poètes en puissent feindre, et que,par après, il ne fît autre chose que prêter son concours ordinaireà la nature, et la laisser agir suivant les lois qu’il a établies.Ainsi, premièrement, je décrivis cette matière et tâchai de lareprésenter telle qu’il n’y a rien au monde ce Me semble, de plusclair ni plus intelligible, excepté ce qui a tantôt été dit de Dieuet de l’âme : car même je supposai, expressément, qu’il n’yavait en elle aucune de ces formes ou qualités dont on dispute dansles écoles, ni généralement aucune chose, dont la connaissance nefût si naturelle à nos âmes, qu’on ne pût pas même feindre del’ignorer. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de lanature; et, sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe quesur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à démontrer toutescelles dont on eût pu avoir quelque doute, et à faire voir qu’ellessont telles, qu’encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, iln’y en saurait avoir aucun où elles manquassent d’être observées.Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière dece chaos devait, en suite de ces lois, se disposer et s’arrangerd’une certaine façon qui la rendait semblable à nos cieux; comment,cependant, quelques-unes de ses parties devaient composer uneterre, et quelques-unes des planètes et des comètes, et quelquesautres un soleil et des étoiles fixes. Et ici, m’étendant sur lesujet de la lumière, j’expliquai bien au long quelle était cellequi se devait trouver dans le soleil et les étoiles, et comment delà elle traversait en un instant les immenses espaces des cieux, etcomment elle se réfléchissait des planètes et des comètes vers laterre. J’y ajoutai aussi plusieurs choses, touchant la substance,la situation, les mouvements et toutes les diverses qualités de cescieux et de ces astres; en sorte que je pensais en dire assez, pourfaire connaître qu’il ne se remarque rien en ceux de ce monde, quine dût, ou du moins qui ne pût, paraître tout semblable en ceux dumonde que je décrivais. De là je vins à parler particulièrement dela Terre: comment, encore que j’eusse expressément supposé que Dieun’avait mis aucune pesanteur en la matière dont elle étaitcomposée, toutes ses parties ne laissaient pas de tendre exactementvers son centre; comment, y ayant de l’eau et de l’air sur sasuperficie, la disposition des cieux et des astres, principalementde la lune, y devait causer un flux et reflux, qui fût semblable,en toutes ses circonstances, à celui qui se remarque dans nos mers;et outre cela un certain cours, tant de l’eau que de l’air, dulevant vers le couchant tel qu’on le remarque aussi entre lestropiques; comment les montagnes, les mers, les fontaines et lesrivières pouvaient naturellement s’y former, et les métaux y venirdans les mines, et les plantes y croître dans les campagnes etgénéralement tous les corps qu’on nomme mêlés ou composés s’yengendrer. Et entre autres choses, à cause qu’après les astres jene connais rien au monde que le feu qui produise de la lumière, jem’étudiai à faire entendre bien clairement tout ce qui appartient àsa nature, comment il se fait, comment il se nourrit; comment iln’a quelquefois que de la chaleur sans lumière, et quelquefois quede la lumière sans chaleur; comment il peut introduire diversescouleurs en divers corps, et diverses autres qualités; comment ilen fond quelques-uns, et en durcit d’autres; comment il les peutconsumer presque tous, ou convertir en cendres et en fumée; etenfin, comment de ces cendres, par la seule violence de son action,il forme du verre; car cette transmutation de cendres en verre mesemblant être aussi admirable qu’aucune autre qui se fasse -en lanature, je pris particulièrement plaisir à la décrire.
Toutefois, je ne voulais pas inférer, de toutes ces choses, quece monde ait été créé en la façon que je proposais; car il est bienplus vraisemblable que, dès le commencement, Dieu l’a rendu telqu’il devait être. Mais il est certain, et c’est une opinioncommunément reçue entre les théologiens, que l’action, par laquellemaintenant il le conserve, est toute la même que celle par laquelleil l’a créé; de façon qu’encore qu’il ne lui aurait point donné, aucommencement, d’autre forme que celle du chaos, pourvu qu’ayantétabli les lois de la nature, il lui prêtât son concours, pour agirainsi qu’elle a de coutume, on peut croire, sans faire tort aumiracle de la création, que par cela seul toutes les choses quiSont purement matérielles auraient pu, avec le temps, s’y rendretelles que nous les voyons à présent. Et leur nature est bien plusaisée à concevoir, lorsqu’on les voit naître peu à peu en cettesorte, que lorsqu’on ne les considère que toutes faites.
De la description des corps inanimés et des plantes, je passai àcelle des animaux et particulièrement à celle des hommes. Maisparce que je n’en avais pas encore assez de connaissance pour enparler du même style que du reste, c’est-à-dire en démontrant leseffets par les causes, et faisant voir de quelles semences, et enquelle façon, la nature les doit produire, je me contentai desupposer que Dieu formât le corps d’un homme, entièrement semblableà l’un des nôtres, tant en la figure extérieure de ses membresqu’en la conformation intérieure de ses organes, sans le composerd’autre matière que de celle que j’avais décrite, et sans mettre enlui, au commencement, aucune âme raisonnable, ni aucune autre chosepour y servir d’âme végétante ou sensitive sinon qu’il excitât enson cœur un de ces feux sans lumière, que j’avais déjà expliqués,et que je ne concevais point d’autre nature que celui qui échauffele foin, lorsqu’on l’a renfermé avant qu’il fût sec, ou qui faitbouillir les vins nouveaux, lorsqu’on les laisse cuver sur la râpe.Car, examinant les fonctions qui pouvaient en suite de cela être ence corps, j’y trouvais exactement toutes celles qui peuvent être ennous sans que nous y pensions, ni par conséquent que notre âme,c’est-à-dire cette partie distincte du corps dont il a été ditci-dessus que la nature n’est que de penser, y contribue, et quisont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sansraison nous ressemblent : sans que j’y en pusse pour cela trouveraucune de celles qui, étant dépendantes de la pensée, sont lesseules qui nous appartiennent en tant qu’hommes, au lieu que je lesy trouvais toutes par après, ayant supposé que Dieu créât une âmeraisonnable, et qu’il la joignît à ce corps en certaine façon queje décrivais.
Mais, afin qu’on puisse voir en quelle sorte j’y traitais cettematière, je veux mettre ici l’explication du mouvement du cœur etdes artères, qui, étant le premier et le plus général qu’on observedans les animaux, on jugera facilement de lui ce qu’on doit penserde tous les autres. Et afin qu’on ait moins de difficulté àentendre ce que j’en dirai, je voudrais que ceux qui ne sont pointversés dans l’anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci,de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui aitdes poumons, car il est en tous assez semblable à celui de l’homme,et qu’il se fissent montrer les deux chambres ou concavités qui ysont. Premièrement, celle qui est dans son côté droit, à laquellerépondent deux tuyaux fort larges : à savoir la veine cave, qui estle principal réceptacle du sang, et comme le tronc de l’arbre donttoutes les autres veines du corps sont les branches, et la veineartérieuse, qui a été ainsi mal nommée, parce que c’est en effetune artère, laquelle, prenant son origine du cœur, se divise, aprèsen être sortie, en plusieurs branches qui se vont répandre partoutdans les poumons. Puis, celle qui est dans son côté gauche, àlaquelle répondent en même façon deux tuyaux, qui sont autant ouplus larges que les précédents : à savoir l’artère veineuse, qui aété aussi mal nommée, à cause qu’elle n’est autre chose qu’uneveine, laquelle vient des poumons, où elle est divisée en plusieursbranches, entrelacées avec celles de la veine artérieuse, et cellesde ce conduit qu’on nomme le sifflet, par où entre l’air de larespiration; et la grande artère, qui, sortant du cœur, envoie sesbranches par tout le corps. Je voudrais aussi qu’on leur montrâtsoigneusement les onze petites peaux, qui, comme autant de petitesportes, ouvrent et ferment les quatre ouvertures qui sont en cesdeux concavités : à savoir, trois à l’entrée de la veine cave, oùelles sont tellement disposées, qu’elles ne peuvent aucunementempêcher que le sang qu’elle contient ne coule dans la concavitédroite du cœur, et toutefois empêchent exactement qu’il n’en puissesortir; trois à l’entrée de la veine artérieuse, qui, étantdisposées tout au contraire, permettent bien au sang, qui est danscette concavité, de passer dans les poumons, mais non pas à celuiqui est dans les poumons d’y retourner; et ainsi deux autres àl’entrée de l’artère veineuse, qui laissent couler le sang despoumons vers la concavité gauche du cœur, mais s’opposent à sonretour; et trois à l’entrée de la grande artère, qui lui permettentde sortir du cœur, mais l’empêchent d’y retourner. Et il n’estpoint besoin de chercher d’autre raison du nombre de ces peaux,sinon que l’ouverture de l’artère veineuse, étant en ovale à causedu lieu où elle se rencontre, peut être commodément fermée avecdeux, au lieu que les autres, étant rondes, le peuvent mieux êtreavec trois. De plus, je voudrais qu’on leur fît considérer que lagrande artère et la veine artérieuse sont d’une compositionbeaucoup plus dure et plus ferme que ne sont l’artère veineuse etla veine cave; et que ces deux dernières s’élargissent avant qued’entrer dans le cœur, et y font comme deux bourses, nommées lesoreilles du cœur, qui sont composées d’une chair semblable à lasienne; et qu’il y a toujours plus de chaleur dans le cœur qu’enaucun autre endroit du corps, et, enfin, que cette chaleur estcapable de faire que, s’il entre quelque goutte de sang en sesconcavités, elle s’enfle promptement et se dilate, ainsi que fontgénéralement toutes les liqueurs, lorsqu’on les laisse tombergoutte à goutte en quelque vaisseau qui est fort chaud.
Car, après cela, je n’ai besoin de dire autre chose pourexpliquer le mouvement du cœur, sinon que, lorsque ses concavitésne sont pas pleines de sang, il y en coule nécessairement de laveine cave dans la droite, et de l’artère veineuse dans la gauche;d’autant que ces deux vaisseaux en sont toujours pleins, et queleurs ouvertures, qui regardent vers le cœur, ne peuvent alors êtrebouchées; mais que, sitôt qu’il est entré ainsi deux gouttes desang, une en chacune de ses concavités, ces gouttes, qui ne peuventêtre que fort grosses, à cause que les ouvertures par où ellesentrent sont fort larges, et les vaisseaux d’où elles viennent fortpleins de sang, se raréfient et se dilatent, à cause de la chaleurqu’elles y trouvent, au moyen de quoi, faisant enfler tout le cœur,elles poussent et ferment les cinq petites portes qui sont auxentrées des deux vaisseaux d’où elles viennent, empêchant ainsiqu’il ne descende davantage de sang dans le cœur; et continuant àse raréfier de plus en plus, elles poussent et ouvrent les sixautres petites portes qui sont aux entrées des deux autresvaisseaux par où elles sortent, faisant enfler par ce moyen toutesles branches de la veine artérieuse et de la grande artère, quasiau même instant que le cœur; lequel, incontinent après, sedésenfle, comme font aussi ces artères, à cause que le sang qui yest entré s’y refroidit, et leurs six petites portes se referment,et les cinq de la veine cave et de l’artère veineuse se rouvrent,et donnent passage à deux autres gouttes de sang, qui font derechefenfler le cœur et les artères, tout de même que les précédentes. Etparce que le sang, qui entre ainsi dans le cœur, passe par ces deuxbourses qu’on nomme ses oreilles, de là vient que leur mouvementest contraire au sien, et qu’elles se désenflent lorsqu’il s’enfle.Au reste, afin que ceux qui ne connaissent pas la force desdémonstrations mathématiques, et ne sont pas accoutumés àdistinguer les vraies raisons des vraisemblables, ne se hasardentpas de nier ceci sans l’examiner, je les veux avertir que cemouvement, que je viens d’expliquer, suit aussi nécessairement dela seule disposition des organes qu’on peut voir à l’œil dans lecœur, et de la chaleur qu’on y peut sentir avec les doigts, et dela nature du sang qu’on peut connaître par expérience, que faitcelui d’une horloge, de la force, de la situation et de la figurede ses contrepoids et de ses roues.
Mais si on demande comment le sang des veines ne s’épuise point,en coulant ainsi continuellement dans le cœur, et comment lesartères n’en sont point trop remplies, puisque tout celui qui passepar le cœur s’y va rendre, je n’ai pas besoin d’y répondre autrechose que ce qui a déjà été écrit par un médecin d’Angleterre,auquel il faut donner la louange d’avoir rompu la glace en cetendroit, et d’être le premier qui a enseigné qu’il y a plusieurspetits passages aux extrémités des artères, par où le sang qu’ellesreçoivent du cœur entre dans les petites branches des veines, d’oùil se va rendre derechef vers le cœur, en sorte que son cours n’estautre chose qu’une circulation perpétuelle. Ce qu’il prouve fortbien, par l’expérience ordinaire des chirurgiens, qui ayant lié lebras médiocrement fort, au-dessus de l’endroit où ils ouvrent laveine, font que le sang en sort plus abondamment que s’ils nel’avaient point lié. Et il arriverait tout le contraire, s’ils leliaient au-dessous, entre la main et l’ouverture, ou bien qu’ils leliassent très fort au-dessus. Car il est manifeste que le lienmédiocrement serré, pouvant empêcher que le sang qui est déjà dansle bras ne retourne vers le cœur par les veines, n’empêche pas pourcela qu’il n’y en vienne toujours de nouveau par les artères, àcause qu’elles sont situées au-dessous des veines, et que leurspeaux, étant plus dures, sont moins aisées à presser, et aussi quele sang qui vient du cœur tend avec plus de force à passer parelles vers la main, qu’il ne fait à retourner de là vers le cœurpar les veines. Et, puisque ce sang sort du bras par l’ouverturequi est en l’une des veines, il doit nécessairement y avoirquelques passages au-dessous du lien, c’est-à-dire vers lesextrémités du bras, par où il y puisse venir des artères. Il prouveaussi fort bien ce qu’il dit du cours du sang, par certainespetites Peaux> qui sont tellement disposées en divers lieux lelong des veines, qu’elles ne lui permettent point d’y passer dumilieu du corps vers les extrémités, mais seulement de retournerdes extrémités vers le cœur; et, de plus, par l’expérience quimontre que tout celui qui est dans le corps en peut sortir en fortpeu de temps par une seule artère, lorsqu’elle est coupée, encoremême qu’elle fût étroitement liée fort proche du cœur, et coupéeentre lui et le lien, en sorte qu’on n’eût aucun sujet d’imaginerque le sang qui en sortirait vînt d’ailleurs.
Mais il y a plusieurs autres choses qui témoignent que la vraiecause de ce mouvement du sang est celle que j’ai dite. Comme,premièrement, la différence qu’on remarque entre celui qui sort desveines et celui qui sort des artères, ne peut procéder que de cequ’étant raréfié, et comme distillé, en passant par le cœur, il estplus subtil et plus vif et plus chaud incontinent après en êtresorti, c’est-à-dire, étant dans les artères, qu’il n’est un peudevant que d’y entrer, c’est-à-dire, étant dans les veines. Et, sion y prend garde, on trouvera que cette différence ne paraît bienque vers le cœur, et non point tant aux lieux qui en sont les pluséloignés. Puis la dureté des peaux, dont la veine artérieuse et lagrande artère sont composées, montre assez que le sang bat contreelles avec plus de force que contre les veines. Et pourquoi laconcavité gauche du cœur et la grande artère seraient-elles plusamples et plus larges que la concavité droite et la veineartérieuse ? Si ce n’était que le sang de l’artère veineuse,n’ayant été que dans les poumons depuis qu’il a passé par le cœur,est plus subtil et se raréfie plus fort et plus aisément que celuiqui vient immédiatement de la veine cave. Et qu’est-ce que lesmédecins peuvent deviner, en tâtant le pouls, s’ils ne savent que,selon que le sang change de nature, il peut être raréfié par lachaleur du cœur plus ou moins fort, et plus ou moins vitequ’auparavant ? Et si on examine comment cette chaleur secommunique aux autres membres, ne faut-il pas avouer que c’est parle moyen du sang, qui passant par le cœur s’y réchauffe, et serépand de là par tout le corps ? D’où vient que, si on ôte lesang de quelque partie, on en ôte par même moyen la chaleur; etencore que le cœur fût aussi ardent qu’un fer embrasé, il nesuffirait pas pour réchauffer les pieds et les mains tant qu’ilfait, s’il n’y envoyait continuellement de nouveau sang. Puis aussion connaît de là que le vrai usage de la respiration est d’apporterassez d’air frais dans le poumon, pour faire que le sang, qui yvient de la concavité droite du cœur, où il a été raréfié et commechangé en vapeurs, s’y épaississe et convertisse en sang derechef,avant que de retomber dans la gauche, sans quoi il ne pourrait êtrepropre à servir de nourriture au feu qui y est. Ce qui se confirme,parce qu’on voit que les animaux qui n’ont point de poumons n’ontaussi qu’une seule concavité dans le cœur, et que les enfants, quin’en peuvent user pendant qu’ils sont renfermés au ventre de leursmères, ont une ouverture par où il coule du sang de la veine caveen la concavité gauche du cœur, et un conduit par où il en vient dela veine artérieuse en la grande artère, sans passer par le poumon.Puis la coction, comment se ferait-elle en l’estomac, si le cœurn’y envoyait de la chaleur par les artères, et avec celaquelques-unes des plus coulantes parties du sang, qui aident àdissoudre les viandes qu’on y a mises ? Et l’action quiconvertit le suc de ces viandes en sang n’est-elle pas aisée àconnaître, si on considère qu’il se distille, en passant etrepassant par le cœur, peut-être par plus de cent ou deux centsfois en chaque jour ? Et qu’a-t-on besoin d’autre chose, pourexpliquer la nutrition, et la production des diverses humeurs quisont dans le corps, sinon de dire que la force, dont le sang en seraréfiant passe du cœur vers les extrémités des artères, fait quequelques-unes de ses parties s’arrêtent entre celles des membres oùelles se trouvent, et y prennent la place de quelques autresqu’elles en chassent; et que, selon la situation, ou la figure, oula petitesse des pores qu’elles rencontrent, les unes se vontrendre en certains lieux plutôt que les autres, en même façon quechacun peut avoir vu divers cribles qui, étant diversement percés,servent à séparer divers grains les uns des autres ? Et enfince qu’il y a de plus remarquable en tout ceci, c’est la générationdes esprits animaux, qui sont comme un vent très subtil, ou plutôtcomme une flamme très pure et très vive qui, montantcontinuellement en grande abondance du cœur dans le cerveau, se varendre de là par les nerfs dans les muscles, et donne le mouvementà tous les membres; sans qu’il faille imaginer d’autre cause, quifasse que les parties du sang qui, étant les plus agitées et lesplus pénétrantes, sont les plus propres à composer ces esprits, sevont rendre plutôt vers le cerveau que vers ailleurs; sinon que lesartères, qui les y portent, sont celles qui viennent du cœur leplus en ligne droite de toutes, et que, selon les règles desmécaniques, qui sont les mêmes que celles de la nature, lorsqueplusieurs choses tendent ensemble à se mouvoir vers un même côté,où il n’y a pas assez de place pour toutes, ainsi que les partiesdu sang qui sortent de la concavité gauche du cœur tendent vers lecerveau, les plus faibles et moins agitées en doivent êtredétournées par les plus fortes, qui par ce moyen s’y vont rendreseules.
J’avais expliqué assez particulièrement toutes ces choses dansle traité que j’avais eu ci-devant dessein de publier. Et ensuitej’y avais montré quelle doit être la fabrique des nerfs et desmuscles du corps humain, pour faire que les esprits animaux, étantdedans, aient la force de mouvoir ses membres : ainsi qu’on voitque les têtes, un peu après être coupées, se remuent encore, etmordent la terre, nonobstant qu’elles ne soient plus animées; quelschangements se doivent faire dans le cerveau, pour causer laveille, et le sommeil, et les songes; comment la lumière, les sons,les odeurs, les goûts, la chaleur, et toutes les autres qualitésdes objets extérieurs y peuvent imprimer diverses idées parl’entremise des sens; comment la faim, la soif, et les autrespassions intérieures, y peuvent aussi envoyer les leurs; ce quidoit y être pris pour le sens commun, où ces idées sont reçues;pour la mémoire, qui les conserve; et pour la fantaisie, qui lespeut diversement changer et en composer de nouvelles, et par mêmemoyen, distribuant les esprits animaux dans les muscles, fairemouvoir les membres de ce corps en autant de diverses façons, etautant à propos des objets qui se présentent à ses sens, et despassions intérieures qui sont en lui, que les nôtres se puissentmouvoir, sans que la volonté les conduise. Ce qui ne sembleranullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates,ou machines mouvantes, l’industrie des hommes peut faire, sans yemployer que fort peu de pièces, à comparaison de la grandemultitude des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines,et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaqueanimal, considéreront ce corps comme une machine, qui, ayant étéfaite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée, et aen soi des mouvements plus admirables, qu’aucune de celles quipeuvent être inventées par les hommes.
Et je m’étais ici particulièrement arrêté à faire voir que, s’ily avait de telles machines, qui eussent les organes et la figured’un singe, ou de quelque autre animal sans raison, nous n’aurionsaucun moyen pour reconnaître qu’elles ne seraient pas en tout demême nature que ces animaux; au lieu que, s’il y en avait quieussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nosactions que moralement il serait possible, nous aurions toujoursdeux moyens très certains pour reconnaître qu’elles ne seraientpoint pour cela de vrais hommes. Dont le premier est que jamaiselles ne pourraient user de paroles, ni d’autres signes en lescomposant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées.Car on peut bien concevoir qu’une machine soit tellement faitequ’elle profère des paroles, et même qu’elle en profèrequelques-unes à propos des actions corporelles qui causerontquelque changement en ses organes : comme, si on la touche enquelque endroit, qu’elle demande ce qu’on lui veut dire; si en unautre, qu’elle crie qu’on lui fait mal, et choses semblables; maisnon pas qu’elle les arrange diversement, pour répondre au sens detout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plushébétés peuvent faire. Et le second est que, bien qu’elles fissentplusieurs choses aussi bien, ou peut-être mieux qu’aucun de nous,elles manqueraient infailliblement en quelques autres, parlesquelles on découvrirait qu’elles n’agiraient pas parconnaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes.Car, au lieu que la raison est un instrument universel, qui peutservir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin dequelque particulière disposition pour chaque action particulière;d’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez dedivers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrencesde la vie, de même façon que notre raison nous fait agir.
Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître ladifférence qui est entre les hommes et les bêtes. Car c’est unechose bien remarquable, qu’il n’y a point d’hommes si hébétés et sistupides, sans en excepter même les insensés, qu’ils ne soientcapables d’arranger ensemble diverses paroles, et d’en composer undiscours par lequel ils fassent entendre leurs pensées; et qu’aucontraire, il n’y a point d’autre animal, tant parlait et tantheureusement né qu’il puisse être, qui fasse le semblable. Ce quin’arrive pas de ce qu’ils ont faute d’organes, car on voit que lespies et les, perroquets peuvent proférer des paroles ainsi quenous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c’est-à-direen témoignant qu’ils pensent ce qu’ils disent; au lieu que leshommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes quiservent aux autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ontcoutume d’inventer d’eux-mêmes quelques signes, par lesquels ils sefont entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisird’apprendre leur langue. Et ceci ne témoigne pas seulement que lesbêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu’elles n’en ontpoint du tout. Car on voit qu’il n’en faut que fort peu pour savoirparler; et d’autant qu’on remarque de. l’inégalité entre lesanimaux d’une même espèce, aussi bien qu’entre les hommes, et queles uns sont plus aisés à dresser que les autres, il n’est pascroyable qu’un singe ou un perroquet, qui serait des plus parfaitsde son espèce, n’égalât en cela un enfant des plus stupides, ou dumoins un enfant qui aurait le cerveau troublé, si leur âme n’étaitd’une nature du tout différente de la nôtre. Et on ne doit pasconfondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignentles passions, et peuvent être imités par des machines aussi bienque par les animaux; ni penser, comme quelques anciens, que lesbêtes parlent, bien que nous n’entendions pas leur langage : cars’il était vrai, puisqu’elles ont plusieurs organes qui serapportent aux nôtres, elles pourraient aussi bien se faireentendre à nous qu’à leurs semblables. C’est aussi une chose fortremarquable que, bien qu’il y ait plusieurs animaux qui témoignentplus d’industrie que nous en quelques-unes de leurs actions, onvoit toutefois que les mêmes n’en témoignent point du tout enbeaucoup d’autres : de façon que ce qu’ils font mieux que nous neprouve pas qu’ils ont de l’esprit; car, à ce compte, ils enauraient plus qu’aucun de nous et feraient mieux en toute chose;mais plutôt qu’ils n’en ont point, et que c’est la Nature qui agiten eux, selon la disposition de leurs organes : ainsi qu’on voitqu’une horloge, qui n’est composée que de roues et de ressorts,peut compter les heures, et mesurer le temps, plus justement quenous avec toute notre prudence.
J’avais décrit, après cela, l’âme raisonnable, et fait voirqu’elle ne peut aucunement être tirée de la puissance de lamatière, ainsi que les autres choses dont j’avais parlé, maisqu’elle doit expressément être créée; et comment il ne suffit pasqu’elle soit logée dans le corps humain, ainsi qu’un pilote en sonnavire, sinon peut-être pour mouvoir ses membres, mais qu’il estbesoin qu’elle soit jointe et unie plus étroitement avec lui pouravoir, outre cela, des sentiments et des appétits semblables auxnôtres, et ainsi composer un vrai homme. Au reste, je me suis iciun peu étendu sur le sujet de l’âme, à cause qu’il est des plusimportants; car, après l’erreur de ceux qui nient Dieu, laquelle jepense avoir ci-dessus assez réfutée, il n’y en a point qui éloigneplutôt les esprits faibles du droit chemin de la vertu, qued’imaginer que l’âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, etque, par conséquent, nous n’avons rien à craindre, ni à espérer,après cette vie, non plus que les mouches et les fourmis; au lieuque, lorsqu’on sait combien elles diffèrent, on comprend beaucoupmieux les raisons, qui prouvent que la nôtre est d’une natureentièrement indépendante du corps et, par conséquent, qu’elle n’estpoint sujette à mourir avec lui; puis, d’autant qu’on ne voit pointd’autres causes qui la détruisent, on est naturellement porté àjuger de là qu’elle est immortelle.
Partie 6
Or, il y a maintenant trois ans que j’étais parvenu à la fin dutraité qui contient toutes ces choses, et que je commençais à lerevoir, afin de le mettre entre les mains d’un imprimeur, lorsquej’appris que des personnes, à qui je défère et dont l’autorité nepeut guère moins sur mes actions que ma propre raison sur mespensées, avaient désapprouvé une opinion de physique, publiée unpeu auparavant par quelque autre, de laquelle je ne veux pas direque je fusse, mais bien que je n’y avais rien remarqué, avant leurcensure, que je pusse imaginer être préjudiciable ni à la religionni à l’État, ni, par conséquent, qui m’eût empêché de l’écrire, sila raison me l’eût persuadée, et que cela me fit craindre qu’il nes’en trouvât tout de même quelqu’une entre les miennes, en laquelleje me fusse mépris, nonobstant le grand soin que j’ai toujours eude n’en point recevoir de nouvelles en ma créance, dont je n’eussedes démonstrations très certaines, et de n’en point écrire quipussent tourner au désavantage de personne. Ce qui a été suffisantpour m’obliger à changer la résolution que j’avais eue de lespublier. Car, encore que les raisons, pour lesquelles je l’avaisprise auparavant, fussent très fortes, mon inclination, qui m’atoujours fait haïr le métier de faire des livres, m’en fitincontinent trouver assez d’autres pour m’en excuser. Et cesraisons de part et d’autre sont telles, que non seulement j’ai iciquelque intérêt de les dire, mais peut-être aussi que le publie ena de les avoir.
Je n’ai jamais fait beaucoup d’état des choses qui venaient demon esprit, et pendant que je n’ai recueilli d’autres fruits de laméthode dont je me sers, sinon que je me suis satisfait, touchantquelques difficultés qui appartiennent aux sciences spéculatives,ou bien que j’ai tâché de régler mes mœurs par les raisons qu’ellem’enseignait, je n’ai point cru être obligé d’en rien écrire. Car,pour ce qui touche les mœurs, chacun abonde si fort en son sens,qu’il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes, s’ilétait permis à d’autres qu’à ceux que Dieu a établis poursouverains sur ses peuples, ou bien auxquels il a donné assez degrâce et de zèle pour être prophètes, d’entreprendre d’y rienchanger; et bien que mes spéculations me plussent fort, j’ai cruque les autres en avaient aussi qui leur plaisaient peut-êtredavantage. Mais, sitôt que j’ai eu acquis quelques notionsgénérales touchant la physique, et que, commençant à les éprouveren diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusques oùelles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principesdont on s’est servi jusques à présent, j’ai cru que je ne pouvaisles tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nousoblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général detous les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible deparvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, etqu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dansles écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle,connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, desastres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent,aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nosartisans, nous les pourrions employer en même façon à tous lesusages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre commemaîtres et possesseurs de la Nature. Ce qui n’est pas seulement àdésirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraientqu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et detoutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussipour la conservation de la santé, laquelle est sans doute lepremier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie;car même l’esprit dépend si fort du tempérament, et de ladisposition des organes du corps que, s’il est possible de trouverquelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plushabiles qu’ils n’ont été jusques ici, je crois que c’est dans lamédecine qu’on doit le chercher. Il est vrai que celle qui estmaintenant en usage contient peu de choses dont l’utilité soit siremarquable; mais, sans que j’aie aucun dessein de la mépriser, jem’assure qu’il n’y a personne, même de ceux qui en font profession,qui n’avoue que tout ce qu’on y sait n’est presque rien, acomparaison de ce qui reste à y savoir, et qu’on se pourraitexempter d’une infinité de maladies, tant du corps que de l’esprit,et même aussi peut-être de l’affaiblissement de la vieillesse, sion avait assez de connaissance de leurs causes, et de tous lesremèdes dont la Nature nous a pourvus. Or, ayant dessein d’employertoute ma vie à la recherche d’une science si nécessaire, et ayantrencontré un chemin qui me semble tel qu’on doit infailliblement latrouver, en le suivant, si ce n’est qu’on en soit empêché, ou parla brièveté de la vie, ou par le défaut des expériences, je jugeaisqu’il n’y avait point de meilleur remède contre ces deuxempêchements que de communiquer fidèlement au public tout le peuque j’aurais trouvé, et de convier les bons esprits à tâcher depasser plus outre, en contribuant, chacun selon son inclination etson pouvoir, aux expériences qu’il faudrait faire, et communiquantaussi au public toutes les choses qu’ils apprendraient, afin queles derniers commençant où les précédents auraient achevé, etainsi, joignant les vies et les travaux de plusieurs, nousallassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun enparticulier ne saurait faire.
Même je remarquais, touchant les expériences, qu’elles sontd’autant plus nécessaires qu’on est plus avancé en connaissance.Car, pour le commencement, il vaut mieux ne se servir que de cellesqui se présentent d’elles-mêmes a nos Sens, et que nous ne saurionsignorer, pourvu que nous y fassions tant soit peu de réflexion, qued’en chercher de plus rares et étudiées : dont la raison est queces plus rares trompent souvent, lorsqu’on ne sait pas encore lescauses des plus communes, et que les circonstances dont ellesdépendent sont quasi toujours si particulières et si petites, qu’ilest très malaisé de les remarquer. Mais l’ordre que j’ai tenu enceci a été tel. Premièrement, j’ai tâché de trouver en général lesprincipes, ou premières causes, de tout ce qui est, ou qui peutêtre, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieuseul, qui l’a créé, ni les tirer d’ailleurs que de certainessemences de vérités qui sont naturellement en nos âmes. Après cela,j’ai examiné quels étaient les premiers et plus ordinaires effetsqu’on pouvait déduire de ces causes : et il me semble que, par là,j’ai trouvé des cieux, des astres, une Terre, et même, sur laterre, de l’eau, de l’air, du feu, des minéraux, et quelques autrestelles choses qui sont les plus communes de toutes et les plussimples, et par conséquent les plus aisées à connaître. Puis,lorsque j’ai voulu descendre à celles qui étaient plusparticulières, il s’en est tant présenté à moi de diverses, que jen’ai pas cru qu’il fût possible à l’esprit humain de distinguer lesformes ou espèces de corps qui sont sur la terre d’une infinitéd’autres qui pourraient y être, si c’eût été le vouloir de Dieu deles y mettre, ni, par conséquent, de les rapporter à notre usage,si ce n’est qu’on vienne au-devant des causes par les effets, etqu’on se serve de plusieurs expériences particulières. En suite dequoi, repassant mon esprit sur tous les objets qui s’étaient jamaisprésentés à mes sens, j’ose bien dire que je n’y ai remarqué aucunechose que je ne pusse assez commodément expliquer par les principesque j’avais trouvés. Mais il faut aussi que j’avoue que lapuissance de la Nature est si ample et si vaste, et que cesprincipes sont si simples et si généraux, que je ne remarque quasiplus aucun effet particulier, que d’abord je ne connaisse qu’ilpeut en être déduit en plusieurs diverses façons, et que ma plusgrande difficulté est d’ordinaire de trouver en laquelle de cesfaçons il en dépend. Car à cela je ne sais point d’autre expédient,que de chercher derechef quelques expériences, qui soient telles,que leur événement ne soit pas le même, si c’est en l’une de cesfaçons qu’on doit l’expliquer, que si c’est en l’autre. Au reste,j’en suis maintenant là, que je vois, ce me semble, assez bien dequel biais on se doit prendre à faire la plupart de celles quipeuvent servir à cet effet; mais je vois aussi qu’elles sonttelles, et en si grand nombre, que ni mes mains, ni mon revenu,bien que j’en eusse mille fois plus que je n’en ai, ne sauraientsuffire pour toutes; en sorte que, selon que j’aurai désormais lacommodité d’en faire plus ou moins, j’avancerai aussi plus ou moinsen la connaissance de la Nature. Ce que je me promettais de faireconnaître, par le traité que j’avais écrit, et d’y montrer siclairement l’utilité que le public en peut recevoir, quej’obligerais tous ceux qui désirent en général le bien des hommes,c’est-à-dire tous ceux qui sont en effet vertueux, et non point parfaux semblant, ni seulement par opinion, tant à me communiquercelles qu’ils ont déjà faites, qu’à m’aider en la recherche decelles qui restent à faire.
Mais j’ai eu, depuis ce temps-là, d’autres raisons qui m’ontfait changer d’opinion, et penser que je devais véritablementcontinuer d’écrire toutes les choses que je jugerais de quelqueimportance, à mesure que j’en découvrirais la vérité, et y apporterle même soin que si je les voulais faire imprimer : tant afind’avoir d’autant plus d’occasion de les bien examiner, comme sansdoute on regarde toujours de plus près à ce qu’on croit devoir êtrevu par plusieurs, qu’à ce qu’on ne fait que pour soi-même, etsouvent les choses qui m’ont semblé vraies lorsque j’ai commencé àles concevoir, m’ont paru fausses lorsque je les ai voulu mettresur le papier; qu’afin de ne perdre aucune occasion de profiter aupublic, si j’en suis capable, et que, si mes écrits valent quelquechose, ceux qui les auront après ma mort en puissent user ainsiqu’il sera le plus à propos; mais que je ne devais aucunementconsentir qu’ils fussent publiés pendant ma vie, afin que ni lesoppositions et controverses, auxquelles ils seraient peut-êtresujets, ni même la réputation telle quelle, qu’ils me pourraientacquérir, ne me donnassent aucune occasion de perdre le temps quej’ai dessein d’employer à m’instruire. Car, bien qu’il soit vraique chaque homme est obligé de procurer, autant qu’il est en lui,le bien des autres, et que c’est proprement ne valoir rien que den’être utile à personne, toutefois il est vrai aussi que nos soinsse doivent étendre plus loin que le temps présent, et qu’il est bond’omettre les choses qui apporteraient peut-être quelque profit àceux qui vivent, lorsque c’est à dessein d’en faire d’autres qui enapportent davantage à nos neveux. Comme, en effet, je veux bienqu’on sache que le peu que j’ai appris jusqu’ici n’est presquerien, à comparaison de ce que j’ignore, et que je ne désespère pasde pouvoir apprendre; car c’est quasi le même de ceux quidécouvrent peu à peu la vérité dans les sciences, que de ceux qui,commençant à devenir riches, ont moins de peine à faire de grandesacquisitions, qu’ils n’ont eu auparavant, étant plus pauvres, à enfaire de beaucoup moindres. Ou bien on peut les comparer aux chefsd’armée, dont les forces ont coutume de croître à proportion deleurs victoires, et qui ont besoin de plus de conduite, pour semaintenir après la perte d’une bataille, qu’ils n’ont, aprèsl’avoir gagnée, à prendre des villes et des provinces. Car c’estvéritablement donner des batailles, que de tâcher à vaincre toutesles difficultés et les erreurs qui nous empêchent de parvenir à laconnaissance de la vérité, et c’est en perdre une, que de recevoirquelque fausse opinion touchant une matière un peu générale etimportante; il faut, après, beaucoup plus d’adresse, pour seremettre au même état qu’on était auparavant, qu’il ne faut à fairede grands progrès, lorsqu’on a déjà des principes qui sont assurés.Pour moi, si j’ai ci-devant trouvé quelques vérités dans lessciences (et j’espère que les choses qui sont contenues en cevolume feront juger que j’en ai trouvé quelques-unes), je puis direque ce ne sont que des suites et des dépendances de cinq ou sixprincipales difficultés que j’ai surmontées, et que je compte pourautant de batailles où j’ai eu l’heur de mon côté. Même je necraindrai pas de dire que je pense n’avoir plus besoin d’en gagnerque deux ou trois autres semblables pour venir entièrement à boutde mes desseins; et que mon âge n’est point si avancé que, selon lecours ordinaire de la Nature, je ne puisse encore avoir assez deloisir pour cet effet. Mais je crois être d’autant plus obligé àménager le temps qui me reste, que j’ai plus d’espérance de lepouvoir bien employer; et j’aurais sans doute plusieurs occasionsde le perdre, si je publiais les fondements de ma Physique. Car,encore qu’ils soient presque tous si évidents, qu’il ne faut queles entendre pour les croire, et qu’il n’y en ait aucun, dont je nepense pouvoir donner des démonstrations, toutefois, à cause qu’ilest impossible qu’ils soient accordants avec toutes les diversesopinions des autres hommes, je prévois que je serais souventdiverti par les oppositions qu’ils feraient naître.
On peut dire que ces oppositions seraient utiles, tant afin deme faire connaître mes fautes, qu’afin que, si j’avais quelquechose de bon, les autres en eussent par ce moyen plusd’intelligence, et, comme plusieurs peuvent plus voir qu’un hommeseul, que commençant dès maintenant à s’en servir, ils m’aidassentaussi de leurs inventions. Mais, encore que je me reconnaisseextrêmement sujet à faillir, et que je ne me fie quasi jamais auxpremières pensées qui me viennent, toutefois l’expérience que j’aides objections qu’on me peut faire m’empêche d’en espérer aucunprofit : car j’ai déjà souvent éprouvé les jugements, tant de ceuxque j’ai tenus pour mes amis, que de quelques autres à qui jepensais être indifférent, et même aussi de quelques-uns dont jesavais que la malignité et l’envie tâcheraient assez à découvrir ceque l’affection cacherait à mes amis; mais il est rarement arrivéqu’on m’ait objecté quelque chose que je n’eusse point du toutprévue, si ce n’est qu’elle fût fort éloignée de mon sujet; ensorte que je n’ai quasi jamais rencontré aucun censeur de mesopinions, qui ne me semblât ou moins rigoureux, ou moins équitableque moi-même. Et je n’ai jamais remarqué non plus que, par le moyendes disputes qui se pratiquent dans les écoles, on ait découvertaucune vérité qu’on ignorât auparavant; car, pendant que chacuntâche de vaincre, on s’exerce bien plus à faire valoir lavraisemblance, qu’à peser les raisons de part et d’autre; et ceuxqui ont été longtemps bons avocats ne sont pas pour cela, paraprès, meilleurs juges.
Pour l’utilité que les autres recevraient de la communication demes pensées, elle ne pourrait aussi être fort grande, d’autant queje ne les ai point encore conduites si loin, qu’il ne soit besoind’y ajouter beaucoup de choses avant que de les appliquer àl’usage. Et je pense pouvoir dire, sans vanité, que, s’il y aquelqu’un qui en soit capable, ce doit être plutôt moi qu’aucunautre: non pas qu’il ne puisse y avoir au monde plusieurs espritsincomparablement meilleurs que le mien; mais pour ce qu’on nesaurait si bien concevoir une chose, et la rendre sienne, lorsqu’onl’apprend de quelque autre, que lorsqu’on l’invente soi-même. Cequi est si véritable, en cette matière, que, bien que j’aie souventexpliqué quelques-unes de mes opinions à des personnes de très bonesprit, et qui, pendant que je leur parlais, semblaient lesentendre fort distinctement, toutefois, lorsqu’ils les ont redites,j’ai remarqué qu’ils. les ont changées presque toujours en tellesorte que je ne les pouvais plus avouer pour miennes. A l’occasionde quoi je suis bien aise de prier ici nos neveux de ne croirejamais que les choses qu’on leur dira viennent de moi, lorsque jene les aurai point moi-même divulguées. Et je ne m’étonneaucunement des extravagances qu’on attribue à tous ces anciensPhilosophes, dont nous n’avons point les écrits, ni ne juge pas,pour cela, que leurs pensées aient été fort déraisonnables, vuqu’ils étaient des meilleurs esprits de leurs temps, mais seulementqu’on nous les a mal rapportées, Comme on voit aussi que presquejamais il n’est arrivé qu’aucun de leurs sectateurs les aitsurpassés; et je m’assure que les plus passionnés de ceux quisuivent maintenant Aristote se croiraient heureux, s’ils avaientautant de connaissance de la nature qu’il a en eu, encore même quece fût à condition qu’ils n’en auraient jamais davantage. Ils sontcomme le lierre, qui ne tend point à monter plus haut que lesarbres qui le soutiennent, et même souvent qui redescend, aprèsqu’il est parvenu jusques à leur faîte; car il me semble aussi queceux-la redescendent, c’est-à-dire se rendent en quelque façonmoins savants que s’ils s’abstenaient d’étudier, lesquels, noncontents de savoir tout ce qui est, intelligiblement expliqué dansleur auteur, veulent, outre cela, y trouver la solution deplusieurs difficultés, dont il ne dit rien et auxquelles il n’apeut-être jamais pensé. Toutefois, leur façon de philosopher estfort commode, pour ceux qui n’ont que des esprits fort médiocres;car l’obscurité des distinctions et des principes dont ils seservent est cause qu’ils peuvent parler de toutes choses aussihardiment que s’ils les savaient, et soutenir tout ce qu’ils endisent contre les plus subtils et les plus habiles sans qu’on aitmoyen de les convaincre. En quoi ils me semblent pareils à unaveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit,l’aurait fait venir dans le fond de quelque cave fort obscure; etje puis dire que ceux-ci ont intérêt que je m’abstienne de publierles principes de la philosophie dont je me sers: car étant trèssimples et très évidents, comme ils sont, je ferais quasi le même,en les publiant, que si j’ouvrais quelques fenêtres, et faisaisentrer du jour dans cette cave, où ils sont descendus pour sebattre. Mais même les meilleurs esprits n’ont pas occasion desouhaiter de les connaître : car, s’ils veulent savoir parler detoutes choses et acquérir la réputation d’être doctes, ils yparviendront plus aisément en se contentant de la vraisemblance,qui peut être trouvée sans grande peine en toutes sortes dematières, qu’en cherchant la vérité, qui ne se découvre que peu àpeu en quelques-unes, et qui, lorsqu’il est question de parler desautres, oblige à confesser franchement qu’on les ignore. Que s’ilspréfèrent la connaissance de quelque peu de vérités à la vanité deparaître n’ignorer rien, comme sans doute elle est bien préférable,et qu’ils veuillent suivre un dessein semblable au mien, ils n’ontpas besoin, pour cela, que je leur dise rien davantage que ce quej’ai dit en ce discours. Car, s’ils sont capables de passer plusoutre que je n’ai fait, ils le seront aussi, à plus forte raison,de trouver d’eux-mêmes tout ce que je pense avoir trouvé. D’autantque, n’ayant jamais rien examiné que par ordre, il est certain quece qui me reste encore à découvrir, est de soi plus difficile etplus caché que ce que j’ai pu ci-devant rencontrer, et ils auraientbien moins de plaisir à l’apprendre de moi que d’eux-mêmes; outreque l’habitude qu’ils acquerront, en cherchant premièrement deschoses faciles, et passant peu à peu par degrés à d’autres plusdifficiles, leur servira plus que toutes mes instructions nesauraient faire. Comme, pour moi, je me persuade que, si on m’eûtenseigné, dès ma jeunesse, toutes les vérités dont j’ai cherchédepuis les démonstrations, et que je n’eusse eu aucune peine à lesapprendre, je n’en aurais peut-être jamais su aucunes autres, et dumoins que jamais je n’aurais acquis l’habitude et la facilité, queje pense avoir, d’en trouver toujours de nouvelles, à mesure que jem’applique à les chercher. Et en un mot, s’il y a au monde quelqueouvrage qui ne puisse être si bien achevé par aucun autre que parle même qui l’a commencé, c’est celui auquel je travaille.
Il est vrai que, pour ce qui est des expériences qui peuvent yservir, un homme seul ne saurait suffire à les faire toutes; maisil n’y saurait aussi employer utilement d’autres mains que lessiennes, sinon celles des artisans, ou telles gens qu’il pourraitpayer, et à qui l’espérance du gain, qui est un moyen trèsefficace, ferait faire exactement toutes les choses qu’il leurprescrirait. Car, pour les volontaires, qui, par curiosité ou désird’apprendre, s’offriraient peut-être de lui aider, outre qu’ils ontpour l’ordinaire plus de promesses que d’effet, et qu’ils ne fontque de belles propositions dont aucune jamais ne réussit, ilsvoudraient infailliblement être payés par l’explication de quelquesdifficultés, ou du moins par des compliments et des entretiensinutiles, qui ne lui sauraient coûter si peu de son temps qu’il n’yperdît. Et pour les expériences que les autres ont déjà faites,quand bien même ils les lui voudraient communiquer, ce que ceux quiles nomment des secrets ne feraient jamais, elles sont, pour laplupart, composées de tant de circonstances, ou d’ingrédientssuperflus, qu’il lui serait très malaisé d’en déchiffrer la vérité;outre qu’il les trouverait presque toutes si mai expliquées, oumême si fausses, à cause que ceux qui les ont faites se sontefforcés de les faire paraître conformes à leurs principes, que,S’il y en avait quelques-unes qui lui servissent, elles nepourraient derechef valoir le temps qu’il lui faudrait employer àles choisir. De façon que, s’il y avait au monde quelqu’un, qu’onsût assurément être capable de trouver les plus grandes choses etles plus utiles au public qui puissent être, et que, pour cettecause, les autres hommes s’efforçassent, par tous moyens, del’aider à venir à bout de ses desseins, je ne vois pas qu’ilspussent autre chose pour lui, sinon fournir aux frais desexpériences dont il aurait besoin et, du reste, empêcher que sonloisir ne lui fût ôté par l’importunité de personne. Mais, outreque je ne présume pas tant de moi-même, que de vouloir rienpromettre d’extraordinaire, ni ne me repais point de pensées sivaines, que de m’imaginer que le public se doive beaucoupintéresser en mes desseins, je n’ai pas aussi l’âme si basse, queje voulusse accepter de qui que ce fût aucune faveur, qu’on pûtcroire que je n’aurais pas méritée.
Toutes ces considérations jointes ensemble furent cause, il y atrois ans, que je ne voulus point divulguer le traité que j’avaisentre les mains, et même que je fus en résolution de n’en fairevoir aucun autre, pendant ma vie, qui fût si général, ni duquel onpût entendre les fondements de ma Physique. Mais il y a eu depuisderechef deux autres raisons, qui m’ont obligé à mettre iciquelques essais particuliers, et à rendre au public quelque comptede mes actions et de mes desseins. La première est que, si j’ymanquais, plusieurs, qui ont su l’intention que j’avais eueci-devant de faire imprimer quelques écrits, pourraient s’imaginerque les causes pour lesquelles je m’en abstiens seraient plus à mondésavantage qu’elles ne sont. Car, bien que je n’aime pas la gloirepar excès, ou même, si je l’ose dire, que je la haïsse, en tant queje la juge contraire au repos, lequel j’estime sur toutes choses,toutefois aussi je n’ai jamais tâché de cacher mes actions commedes crimes, ni n’ai usé de beaucoup de précautions pour êtreinconnu; tant à cause que j’eusse cru me faire tort, qu’à cause quecela m’aurait donne quelque espèce d’inquiétude, qui eût derechefété contraire au parfait repos d’esprit que je cherche. Et parceque, m’étant toujours ainsi tenu indifférent entre le soin d’êtreconnu ou ne l’être pas, je n’ai pu empêcher que je n’acquissequelque sorte de réputation, j’ai pensé que je devais faire monmieux pour m’exempter au moins de l’avoir mauvaise. L’autre raison,qui m’a obligé à écrire ceci, est que, voyant tous les jours deplus en plus le retardement que souffre le dessein que j’ai dem’instruire, à cause d’une infinité d’expériences dont j’ai besoin,et qu’il est impossible que je fasse sans l’aide d’autrui, bien queje ne me flatte pas tant que d’espérer que le public prenne grandepart en mes intérêts, toutefois je ne veux pas aussi me défaillirtant à moi-même, que de donner sujet a ceux qui me survivront de mereprocher quelque jour, que j’eusse pu leur laisser plusieurschoses beaucoup meilleures que je n’aurai fait, si je n’eusse pointtrop négligé de leur faire entendre en quoi ils pouvaientcontribuer à mes desseins.
Et j’ai pensé qu’il m’était aisé de choisir quelques matièresqui, sans être sujettes à beaucoup de controverses, ni m’obliger àdéclarer davantage de mes principes que je ne désire, nelaisseraient Pas de faire voir assez clairement ce que je puis, oune puis pas, dans les sciences. En quoi je ne saurais dire si j’airéussi, et je ne veux point prévenir les jugements de personne, enparlant moi-même de mes écrits; mais je serai bien aise qu’on lesexamine, et afin qu’on en ait d’autant plus d’occasion, je supplietous ceux qui auront quelques objections à y faire de prendre lapeine de les envoyer à mon libraire, par lequel en étant averti, jetâcherai d’y joindre ma réponse en même temps ; et par cemoyen les lecteurs, voyant ensemble l’un et l’autre, jugerontd’autant plus aisément de la vérité. Car je ne promets pas d’yfaire jamais de longues réponses, mais seulement d’avouer mesfautes fort franchement, si je les connais, ou bien, si je ne lespuis apercevoir, de dire simplement ce que je croirai être requispour la défense des choses que j’ai écrites, sans y ajouterl’explication d’aucune nouvelle matière afin de ne me pas engagersans fin de l’une en l’autre.
Que si quelques-unes de celles dont j’ai parlé, au commencementde la Dioptrique et des Météores, choquent d’abord, à cause que jeles nomme des suppositions, et que je ne semble pas avoir envie deles prouver, qu’on ait la patience de lire le tout avec attention,et j’espère qu’on s’en trouvera satisfait. Car il me semble que lesraisons s’y entre-suivent en telle sorte que, comme les dernièressont démontrées par les premières, qui sont leurs causes, cespremières le sont réciproquement par les dernières, qui sont leurseffets. Et on ne doit pas imaginer que je commette en ceci la fauteque les logiciens nomment un cercle; car l’expérience rendant laplupart de ces effets très certains, les causes dont je les déduisne servent pas tant à les prouver qu’à les expliquer; mais, tout aucontraire, ce sont elles qui sont prouvées par eux. Et je ne les ainommées des suppositions, qu’afin qu’on sache que je pense lespouvoir déduire de ces premières vérités que j’ai ci-dessusexpliquées, mais que j’ai voulu expressément ne le pas faire, pourempêcher que certains esprits, qui s’imaginent qu’ils savent en unjour tout ce qu’un autre a pensé en vingt années, sitôt qu’il leuren a seulement dit deux ou trois mots, et qui sont d’autant plussujets à faillir, et moins capables de la vérité, qu’ils sont pluspénétrants et plus vifs, ne puissent de là prendre occasion debâtir quelque philosophie extravagante sur ce qu’ils croiront êtremes principes, et qu’on m’en attribue la faute. Car, pour lesopinions, qui sont toutes miennes, je ne les excuse point commenouvelles, d’autant que, si on en considère bien les raisons, jem’assure qu’on les trouvera si simples et si conformes au senscommun, qu’elles sembleront moins extraordinaires, et moinsétranges, qu’aucunes autres qu’on puisse avoir sur mêmes sujets. Etje ne me vante point d’être le premier inventeur d’aucunes, maisbien, que je ne les ai jamais reçues, ni parce Welles avaient étédites par d’autres, ni parce qu’elles ne l’avaient point été, maisseulement parce que la raison me les a persuadées.
Que si les artisans ne peuvent si tôt exécuter l’invention quiest expliquée en la Dioptrique, je ne crois pas qu’on puisse dire,pour cela, qu’elle soit mauvaise : car, d’autant qu’il faut del’adresse et de l’habitude, pour faire et pour ajuster les machinesque j’ai décrites, sans qu’il y manque aucune circonstance, je nem’étonnerais pas moins, s’ils rencontraient du premier coup, que siquelqu’un pouvait apprendre, en un jour, à jouer du luthexcellemment, par cela seul qu’on lui aurait donné de la tablaturequi serait bonne. Et si j’écris en français, qui est la langue demon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes précepteurs,c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leurraison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceuxqui ne croient qu’aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent lebon sens avec l’étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges,ils ne seront point, je m’assure, si partiaux pour le latin, qu’ilsrefusent d’entendre mes raisons, parce que je les explique enlangue vulgaire.
Au reste, je ne veux point parler ici, en particulier, desprogrès que j’ai espérance de faire à l’avenir dans les sciences,ni m’engager envers le public d’aucune promesse que je ne sois pasassuré d’accomplir; mais je dirai seulement que j’ai résolu den’employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu’à tâcherd’acquérir quelque connaissance de la Nature, qui soit telle qu’onen puisse tirer des règles pour la médecine, plus assurées quecelles qu’on a eues jusques à présent, et que mon inclinationm’éloigne si fort de toute sorte d’autres desseins, principalementde ceux qui ne sauraient être utiles aux uns qu’en nuisant auxautres, que, si quelques occasions me contraignaient de m’yemployer, je ne crois point que je fusse capable d’y réussir. Dequoi je fais ici une déclaration, que je sais bien ne pouvoirservir à me rendre considérable dans le monde, mais aussi n’ai-jeaucunement envie de l’être; et je me tiendrai toujours plus obligéà ceux par la faveur desquels je jouirai sans empêchement de monloisir, que je ne ferais à ceux qui m’offriraient les plushonorables emplois de la terre.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 14 Novembre 2015 à 22:25
Du contrat social ou Principes du droit politique
LIVRES - Du contrat social ou Principes du droit politique (Jean-Jacque Rousseau) - Catégorie Essais
de Jean-Jacques Rousseau
Avertissement Ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu’on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m’a paru le moins indigne d’être offert au public. Le reste n’est déjà plus. Partie 1 Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. Je tâcherai d’allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées. J’entre en matière sans prouver l’importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. Né citoyen d’un État libre, et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de m’en instruire : heureux, toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d’aimer celui de mon pays ! Chapitre 1 Sujet de ce premier livre L’homme est né libre, et partout il est dans les fers, Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore.Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et l’effet qui en dérive, je dirais : « Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug,et qu’il le secoue, il fait encore mieux : car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter ». Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d’en venir là, je dois établir ce que je viens d’avancer.Chapitre 2 Des premières sociétés
La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle,est celle de la famille : encore les enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout.Les enfants, exempts de l’obéissance qu’ils devaient au père ;le père, exempt des soins qu’il devait aux enfants, rentrent tous également dans l’indépendance. S’ils continuent de rester unis, ce n’est plus naturellement, c’est volontairement ; et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation,ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même ; et sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc, si l’on veut, le premier modèle des sociétés politiques : le chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants ; et tous, étant nés égaux et libres,n’aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que, dans la famille, l’amour du père pour ses enfants le paye des soins qu’il leur rend ; et que, dans l’État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n’a pas pour ses peuples. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés : il cite l’esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d’établir toujours le droit par le fait (a). On pourrait employer une méthode plus conséquente,mais non plus favorable aux tyrans. Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient à une centaine d’hommes, ou si cette centaine d’hommes appartient au genre humain : et il paraît, dans tout son livre, pencher pour le premier avis : c’est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voilà l’espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef, qui le garde pour le dévorer. Comme un pâtre est d’une nature supérieure à celle de son troupeau, les pasteurs d’hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d’une nature supérieure à celle de leurs peuples. Ainsi raisonnait,au rapport de Philon, l’empereur Caligula, concluant assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux, ou que les peuples étaient des bêtes. Le raisonnement de ce Caligula revient à celui de Hobbes et de Grotius. Aristote, avant eux tous, avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l’esclavage et les autres pour la domination. Aristote avait raison ; mais il prenait l’effet pour la cause. Tout homme né dans l’esclavage naît pour l’esclavage, rien n’est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers,jusqu’au désir d’en sortir ; ils aiment leur servitude comme les compagnons d’Ulysse aimaient leur abrutissement (b). S’il y adonc, des esclaves par nature, c’est parce qu’il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Je n’ai rien dit du roi Adam, ni de, l’empereur Noé, père de trois grands monarques qui se partagèrent l’univers, comme firent les enfants de Saturne, qu’on a cru reconnaître en eux. J’espère qu’on me saura gré de cette modération ; car, descendant directement de l’un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si, par la vérification des titres, je ne me trouverais point le légitime roi du genre humain ? Quoi qu’il en soit, on ne peut disconvenir qu’Adam. n’ait été souverain du monde, comme Robinson de son île, tant qu’il en fut le seul habitant, et ce qu’il y avait de commode dans cet empire était que le monarque, assuré sur son trône, n’avait à craindre ni rébellion,ni guerres, ni conspirateurs.
Chapitre 3 Du droit du plus fortLe plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable ; car, sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause : toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement ; et, puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse ? S’il faut obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir ; et si l’on n’est plus forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : Cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu ; je réponds qu’il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l’avoue ; mais toute maladie en vient aussi : est-ce à dire qu’il soit défendu d’appeler le médecin ? Qu’un brigand me surprenne au coin d’un bois, non seulement il faut par force donner sa bourse ; mais, quand je pourrais la soustraire,suis-je en conscience obligé de la donner ? Car, enfin, le pistolet qu’il tient est une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours.
Chapitre 4 De l’esclavagePuisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d’un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait -il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d’un roi ? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d’explication ;mais tenons-nous-en à celui d’aliéner. Aliéner, c’est donner ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d’un autre ne se donne pas ; il se vend tout au moins pour sa subsistance : mais un peuple, pourquoi se vend-il ? Bien loin qu’un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d’eux ; et, selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu’on prendra aussi leur bien ? Je ne vois pas ce qu’il leur reste à conserver. On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile ; soit : mais qu’y gagnent-ils, si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne feraient leurs dissensions ? Qu’y gagnent-ils, si cette tranquillité même est une de leurs misères ? On vit tranquille aussi dans les cachots : en est-ce assez pour s’y trouver bien ? Les Grecs enfermés dans l’antre du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vînt d’être dévorés. Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ; un tel acte est illégitime et nul,par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens.Dire la même chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous ; la folie ne fait pas droit. Quand chacun pourrait s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes et libres ; leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Avant qu’ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature, et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire fût légitime, qu’à chaque génération le peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejeter : mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire. Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger ? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n’entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte ? Car, quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient et que,son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ? Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d’esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté ; convention d’autant plus légitime qu’elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l’état de guerre. Par cela seul, que les hommes, vivant dans leur primitive indépendance, n’ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l’état de paix ni l’état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis.C’est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre ; et l’état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d’homme à homme ne peut exister ni dans l’état de nature, où il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social, où tout est sous l’autorité des lois. Les combats particuliers, les duels, les rencontres, sont des actes qui ne constituent point un état ; et à l’égard des guerres privées, autorisées par les Établissements de Louis IX, roide France, et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde, s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel et à toute bonne politise. La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens (a), mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis que d’autres États, et non pas des hommes,attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport. Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu’à leurs sujets. L’étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue, ou détient les sujets, sans déclarer la guerre au prince, n’est pas un ennemi, c’est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s’empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l’État ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l’on n’a plus de droit sur leur vie. Quelquefois, on peut tuer l’État sans tuer un seul de ses membres : or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes ; mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison. A l’égard du droit de conquête, il n’a d’autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu’il n’a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n’a le droit de tuer l’ennemi que quand on ne peut le faire esclave ; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer : c’est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie,sur laquelle on n’a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d’esclavage, et le droit d’esclavage sur le droit de vie et de mort, n’est-il pas clair qu’on tombe dans le cercle vicieux ? En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu’un esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis, n’est tenu à rien du tout envers son maître, qu’à lui obéir autant qu’il y est forcé.En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce : au lieu de le tuer sans fruit, il l’a tué utilement. Loin donc qu’il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l’état de guerre subsiste entre eux comme auparavant,leur relation même en est l’effet ; et l’usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention ; soit : mais cette convention, loin de détruire l’état de guerre, en suppose la continuité. Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclave et droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement.Soit d’un homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé : « Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant qu’il me plaira. »
Chapitre 5 Qu’il faut toujours remonter à une première conventionQuand j’accorderais tout ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fauteurs du despotisme n’en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu’ils puissent être, je ne vois là qu’un maître et des esclaves, je n’y vois point un peuple et son chef : c’est, si l’on veut, une agrégation, mais non pas une association ; il n’y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n’est toujours qu’un particulier ; son intérêt, séparé de celui des autres, n’est toujours qu’un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, -son empire, après lui, reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres, après que le feu l’a consumé. Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius,un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil ; il suppose une délibération publique.Avant donc que d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi,il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple est un peuple ; car cet acte, étant nécessairement antérieur à l’autre, est le vrai fondement de la société. En effet, s’il n’y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l’élection ne fût unanime, l’obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? et d’où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix qui n’en veulent point ? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un, établissement de convention et suppose, au moins une fois, l’unanimité.
Chapitre 6 Du pacte socialJe suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent, parleur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périrait s’il ne changeait de manière d’être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces,mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs ; mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu’il se doit ? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s’énoncer en ces termes : « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé,et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu’à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits, et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses, bien entendues, se réduisent toutes à une seule -savoir, l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l’aliénation se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut l’être, et nul associé n’a plus rien à réclamer : car, s’il restait quelques droits aux particuliers,comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge,prétendrait bientôt l’être en tous ; l’état de nature subsisterait, et l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne ; et comme il n’y a pas un associé sur lequel on n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes suivants :« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ;et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix,lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité (a), et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple,et s’appellent en particulier citoyens, comme participant à l’autorité souveraine, et sujets, comme soumis aux lois de l’État.Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.
Chapitre 7 Du souverainOn voit, par cette formule, que l’acte d’association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l’État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ;car il y a bien de la différence entre s’obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d’eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même et que, par conséquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une Ici qu’il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d’un particulier contractant avec soi-même ;par où l’on voit qu’il n’y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s’engager envers autrui, en ce qui ne déroge point à ce contrat ; car, à l’égard de l’étranger, il devient un être simple, un individu. Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son être que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s’obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d’aliéner quelque portion de lui-même, ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l’acte par lequel il existe, serait s’anéantir ; et qui n’est rien ne produit rien. Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps, encore moins offenser le corps sans que les membres s’en ressentent. Ainsi le devoir et l’intérêt obligent également les deux parties contractantes à s’entraider mutuellement ; et les mêmes hommes doivent chercher à réunir, sous ce double rapport, tous les avantages qui en dépendent. Or, le souverain, n’étant formé que des particuliers qui le composent, n’a ni ne peut avoir d’intérêt contraire au leur ;par conséquent, la puissance souveraine n’a nul besoin de les sujets, parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres ; et nous verrons ci-après qu’il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être. Mais il n’en est pas ainsi des sujets envers le souverain,auquel, malgré l’intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements, s’il ne trouvait des moyens de s’assurer de leur.fidélité. En effet, chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme citoyen ; son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l’intérêt commun ; son existence absolue, et naturellement indépendante, peut lui faire envisager ce qu’il doit à la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement ne sera onéreux pour lui ; et regardant la personne morale qui constitue l’État comme un être de raison, parce que ce n’est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet ; injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. Afin donc que ce pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement, qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera à être libre, car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle, condition qui fait l’artifice et le Jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels, sans cela, seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.
Chapitre 8 De l’état civilCe passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que,la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et de consulter sa raison amant d’écoute, ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses. idées s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer ; ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale ; et la possession, qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété, qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale qui seule rend l’homme vraiment maître de lui ; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. Mais je n’en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet.
Chapitre 9 Du domaine réelChaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu’elle se forme, tel qu’il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu’il possède font partie. Ce n’est pas que,par cet acte, la possession change de nature en changeant de mains,et devienne propriété dans celles du souverain ; mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d’un particulier, la possession publique est aussi, dans le fait,plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au moins pour les étrangers : car l’État, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs biens, par le contrat social, qui, dans l’État, sert de base à tous les droits, mais il ne l’est, à l’égard des autres puissances, que par le droit de premier occupant, qu’il tient des particuliers. Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu’après l’établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire ; mais l’acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l’exclut de tout le reste. Sa par tétant faite, il doit s’y borner, et n’a plus aucun droit à la communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l’état de nature, est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce qui n’est pas à soi. En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes :premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne,secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister ; en troisième lieu, qu’on en prenne possession, non par une vainc cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui, à défaut de titres juridiques, doive être respecté d’autrui. En effet accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant, n’est-ce pas l’étendre aussi loin qu’il peut aller ?Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit ? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussitôt le maître ? Suffira-t-il d’avoir la force d’en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d’y jamais revenir ? Comment un homme ou un peuple peut-il s’emparer d’un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu’elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun ?Quand Nuñez Balbao prenait, sur le rivage, possession de la mer du Sud et de toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille. était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde ? Sur ce pied-là, ces cérémonies se multipliaient assez vainement ; et le roi catholique n’avait tout d’un coup qu’à prendre possession de tout l’univers, sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. On conçoit comment les terres des particuliers réunies et contiguës deviennent le territoire public, et comment le droit de souveraineté, s’étendant des sujets au terrain qu’ils occupent,devient à la fois réel et personnel ; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leurs forces mêmes les garants de leur fidélité ; avantage qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens monarques, qui, ne s’appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens,semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d’aujourd’hui s’appellent plus habilement rois de France, d’Espagne, d’Angleterre, etc. ; en tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d’en tenir les habitants. Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession,changer l’usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété. Alors, les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien publie, leurs droits étant respectés de tous les membres de l’État et maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu’ils ont donné : paradoxe qui s’explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fonds, comme on verra ci-après. Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s’unir avant que de rien posséder, et que, s’emparant ensuite d’un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu’ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous ; sans quoi il n’y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l’exercice de la souveraineté. Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout système social ; c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue, au contraire, une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.
Partie 2Chapitre 1 Que la souveraineté est inaliénable
La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis, est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ; car, si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social ;et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister. Or, c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Je dis donc que la souveraineté, n’étant que l’exercice de la volonté générale, ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain,qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant ;car la volonté particulière tend, par sa nature, aux préférences,et la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord, quand même il devrait toujours exister ; ce ne serait pas un effet de l’art, mais du hasard.Le souverain peut bien dire : « Je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou du moins ce qu’il dit vouloir » ; mais il ne peut pas dire : « Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore », puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître, il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. Ce n’est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain, libre de s’y opposer, ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s’expliquera plus au long.
Chapitre 2 Que la souveraineté est indivisiblePar la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible ; car la volonté est générale (a), ou elle ne l’est pas ; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi ; dans le second, ce n’est qu’une volonté particulière, ou un acte de magistrature ;c’est un décret tout au plus. Mais nos politiques Il ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet : ils la divisent en for-ce et en volonté, en puissance législative et en puissance,exécutive ; en droits d’impôt, de justice et de guerre ;en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger : tantôt ils confondent toutes ces parties, et tantôt ils les séparent. Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées ; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs ; puis,jetant en l’air tous ses membres l’un après l’autre, ils font retomber l’enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques ; après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Cette erreur vient de ne s’être pas fait des notions exactes de l’autorité souveraine, et d’avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n’en était que des émanations. Ainsi, par exemple,on a regardé l’acte de déclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté ; ce qui n’est pas puisque chacun de ces actes n’est point une loi, mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l’idée attachée au mot loi sera fixée. En suivant de même les autres divisions, on trouverait que,toutes les fois qu’on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe ; que les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l’exécution. On ne saurait dire combien ce défaut d’exactitude a jeté d’obscurité sur les décisions des auteurs en matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples sur les principes qu’ils avaient établis. Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s’enchevêtrent, s’embarrassent dans leurs sophismes, crainte d’en dire trop ou de n’en dire pas assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu’ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l’art possible. C’eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d’Angleterre Georges 1er. Mais,malheureusement, l’expulsion de Jacques II, qu’il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étaient levées, et ils eussent été toujours conséquents ; mais ils auraient tristement dit la vérité, et n’auraient fait leur cour qu’au peuple. Or, la vérité ne mène point à la fortune, et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.
Chapitre 3 Si la volonté générale peut errerIl s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique : mais il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors seulement qu’il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun ; l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières : mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent (a), reste pour somme des différences la volonté générale. Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l’État : on peut dire alors qu’il n’y a plus autant de votants que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté générale, et l’avis qui l’emporte n’est qu’un avis particulier. Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’État, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui (a) ; telle fut l’unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point.
Chapitre 4 Des bornes du pouvoir souverainSi l’État ou la cité n’est qu’une personne morale dont la vie consiste dans l’union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens ; et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté. Mais, outre la personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d’elle. Il s’agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain (b),et les devoirs qu’ont à remplir les premiers en qualité de sujets,du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d’hommes. On convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social,de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté ;mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance. Tous les services qu’un citoyen peut rendre à l’État, il les lui doit sitôt que le souverain les demande ; mais le souverain,de son côté, ne peut charger les sujets d’aucune chaîne inutile à la communauté : il ne peut pas même le vouloir ; car,sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels ; et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot, chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? Ce qui prouve que l’égalité de droit et la notion de justice qu’elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne, et par conséquent de la nature de l’homme ;que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence ; qu’elle doit partir de tous pour s’appliquer à tous ; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel et déterminé,parce qu’alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide. En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse : c’est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties, et le publie l’autre, mais où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l’une des parties, et qui par conséquent n’est pour l’autre qu’une volonté étrangère,particulière, portée en cette occasion à l’injustice et sujette à l’erreur. Ainsi, de même qu’une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale à son tour change de nature, ayant un objet particulier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l’un, imposait des peines à l’autre, et, par des multitudes de décrets particuliers, exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n’avait plus de volonté générale proprement dite ; il n’agissait plus comme souverain,mais comme magistrat. Ceci paraîtra contraire aux idées communes ; mais il faut me laisser le temps d’exposer les miennes. On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les unit ;car, dans cette institution, chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres ; accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux délibérations communes un caractère d’équité qu’on voit s’évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d’un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie. Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion ; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité, qu’ils s’engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, parla nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens ; en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres ; convention légitime, parce qu’elle a pour base le contrat social ; équitable, parce qu’elle est commune à tous ; utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général ; et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent’ à personne, mais seulement à leur propre volonté : et demander jusqu’où s’étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens,c’est demander jusqu’à quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d’eux. On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions ; de sorte que le souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors,l’affaire devenant particulière, son pouvoir n’est plus compétent. Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l’effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu’elle était auparavant, et qu’au lieu d’une aliénation ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une manière d’être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l’indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force, que d’autres pouvaient surmonter, contre un droit que l’union sociale rend invincible.Leur vie même, qu’ils ont dévouée à l’État, en est continuellement protégée ; et lorsqu’ils l’exposent pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont reçu de lui ? Que font-ils qu’ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l’état de nature, lorsque, livrant des combats inévitables,ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver ? Tous ont à combattre, au besoin, pour la patrie,il est vrai ; mais aussi nul n’a jamais à combattre pour soi.Ne gagne-t-on pas encore à courir, pour ce qui fait notre sûreté,une partie des risques qu’il faudrait courir pour nous-mêmes sitôt qu’elle nous serait ôtée ?
Chapitre 5 Du droit de vie et de mortOn demande comment les particuliers, n’ayant point droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre au souverain ce même droit qu’ils n’ont pas. Cette question ne paraît difficile à résoudre que parce qu’elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide ? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s’embarquant il n’ignorait pas le danger ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants.Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose ; et quand le prince lui adit : « Il est expédient à l’État que tu meures »,il doit mourir, puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État. La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue- c’est pour n’être pas la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient.Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu’à la garantir, et il n’est pas à présumer qu’aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. D’ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne ; il faut qu’un des deux périsse ; et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’État. Or, comme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n’est pas une personne morale, c’est un homme ;et c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. Mais, dira-t-on, la condamnation d’un criminel est un acte particulier. D’accord : aussi cette condamnation n’appartient-elle point au souverain ; c’est un droit qu’il peut conférer sans pouvoir l’exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la fois. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger. À l’égard du droit de faire grâce ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n’appartient qu’à celui qui est au-dessus du juge et de la loi,c’est-à-dire au souverain ; encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et les cas d’en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de grâces, mais parce qu’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit.Sous la république romaine, jamais le sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce ; le peuple même n’en faisait pas,quoiqu’il révoquât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que, bientôt les forfaits n’en auront plus besoin,et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume : laissons discuter ces questions à l’homme juste qui n’a point failli, et qui jamais n’eut lui-même besoin de grâce.
Chapitre 6 De la loiPar le pacte social, nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source ; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule ; mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. À considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tour est commun,je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis ; je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil, où tous les droits sont fixés par la loi. Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi ? Tant qu’on se contentera de n’attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre, et quand on aura dit ce que c’est qu’une loi de la nature, on n’en saura pas mieux ce que c’est qu’une loi de l’État. J’ai déjà dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans l’État ou hors de l’État. S’il est hors de l’État, une volonté qui lui est étrangère n’est point générale par rapport à lui ; et si cet objet est dans l’État, il en fait partie : alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, et le tout, moins cette même partie, est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est point le tout ; et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout ; mais deux parties inégales : d’où il suit que la volonté de l’une n’est point non plus générale par rapport à l’autre. Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme alors un rapport,c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi. Quand je dis que l’objet des lois est toujours général,j’entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière. Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privilèges, mais elle n’en peut donner nommément à personne ;la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être admis ; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale : en un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative. Sur cette idée, on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le prince est au-dessus des lois,puisqu’il est membre de l’État ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés. On voit encore que, la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi : ce qu’ordonne même le souverain sur un objet particulier n’est pas non plus une loi, mais un décret ; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature. J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain(a) : j’expliquerai ci-après ce que c’est que gouvernement. Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés ? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d’avance ? ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon,exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais, le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés.Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent ; le public veut le bien qu’il ne voit pas, Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison ; il faut apprendre à l’autre à connaître ce qu’il veut. Alors des lumières publiques résulte l’union de l’entendement et de la volonté dans le corps social ; de là l’exact concours des parties, et, enfin la plus grande force du tout. Voilà d’où naît la nécessité d’un législateur.
Chapitre 7 Du législateurPour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes, et qui n’en éprouvât aucune ; qui n’eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à fond ; dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin, qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre (a). Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Le même raisonnement que faisait Caligula quant au fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Règne. Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. « Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques. » Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons reçue de la nature. Il faut, en un mot,qu’il ôte à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite : en sorte que si chaque citoyen n’est rien, ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l’État. S’il doit l’être par son génie, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature, ce n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa constitution ; c’est une fonction particulière et supérieure qui n’a rien de commun avec l’empire humain ;car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes : autrement ces lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices ; jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement des leurs. Les républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage ;celle de Genève en fit autant et s’en trouva bien.(a) Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes l’autorité législative et le pouvoir souverain. Cependant les décemvirs eux-mêmes ne s’arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité.« Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils au peuple,ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des’ lois qui doivent faire votre bonheur. » Celui qui rédige les lois n’a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable, parce que, selon le pacte fondamental, il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu’après l’avoir soumise aux suffrages libres du peuple : j’ai déjà dit cela ; mais il n’est pas inutile de le répéter. Ainsi l’on trouve à la fois dans l’ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles ; une entreprise au-dessus de la force humaine, et, pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien. Autre difficulté qui mérite attention. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n’en sauraient être entendus. Or, il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée : chaque individu, ne goûtant d’autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pût devenir la cause ; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même ; et que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté, et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine (a). Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, ni d’en être cru quand il s’annonce pour être leur interprète. Le grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission.Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle,ou feindre un secret commerce avec quelque divinité,’ ou dresser un oiseau’ pour lui parler à l’oreille, ou trouver d’autres moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d’insensés -mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains prestiges forment un lien passager ; il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaïque, toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël, qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées ; et tandis que l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Il ne faut pas, de tout ceci, conclure avec Warburton, que la politique et la religion aient parmi nous un objet commun, mais que, dans l’origine des nations, l’une sert d’instrument à l’autre.
Chapitre 8 Du peupleComme, avant d’élever un grand édifice, l’architecte observe et sonde le sol pour voir s’il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois elles-mêmes,mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. C’est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyréniens, sachant que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l’égalité :c’est pour cela qu’on vit en Crète de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos n’avait discipliné qu’un peuple chargé de vices. Mille nations ont brillé sur la terre, qui n’auraient jamais pu souffrir de bonnes lois ; et celles même qui l’auraient pu n’ont eu, dans toute leur durée, qu’un temps fort court pour cela.La plupart des peuples, ainsi que des hommes, ne sont dociles que dans leur jeunesse ; ils deviennent incorrigibles envieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer ; le peuple ne peut pas même souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l’aspect du médecin. Ce n’est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font Sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l’horreur du passé tient heu d’oubli, et où l’État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquins, et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l’expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares ; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l’État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux fois pour le même peuple : car il peut se rendre libre tant qu’il n’est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir ; et, sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n’existe plus : il lui faut désormais un maître et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime : « On peut acquérir la liberté, mais en ne la recouvre jamais. » La jeunesse n’est pas l’enfance. Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de jeunesse ou, si l’on veut, de maturité,qu’il faut attendre avant de les soumettre à des lois : mais la maturité d’un peuple n’est pas toujours facile à connaître ; et si on la prévient, l’ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l’est pas au bout de dix siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment policés,parce qu’ils l’ont été trop tôt. Pierre avait le génie imitatif ; il n’avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu’il fit étaient bien,la plupart étaient déplacées. Il a vu que son peuple était barbare,il n’a point vu qu’il n’était pas mûr pour la police ; il a voulu civiliser quand il ne fallait que l’aguerrir. Il a d’abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes : il a empêché ses sujets de devenir jamais ce qu’ils pourraient être, en leur persuadant qu’ils étaient ce qu’ils ne sont pas. C’est ainsi qu’un précepteur français forme son élève pour briller au moment de son enfance, et puis n’être jamais rien. L’empire de Russie voudra subjuguer l’Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares, ses sujets ou ses voisins,deviendront ses maîtres et les nôtres, cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l’Europe travaillent de concert à l’accélérer.
Chapitre 9 SuiteComme la nature a donné des termes à la stature d’un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d’un État, des bornes à l’étendue qu’il peut avoir, afin qu’il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a, dans tout corps politique, un maximum de force qu’il ne saurait passer, et duquel souvent il s’éloigne à force de s’agrandir. Plus le lien social s’étend, plus il se relâche ; et en général un petit État est proportionnelle. ment plus fort qu’un grand. Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement,l’administration devient plus pénible dans les grandes distances,comme un poids devient plus lourd au bout d’un plus grand levier.Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient : car chaque ville a d’abord la sienne, que le peuple paye ; chaque district la sienne, encore payée par le peuple ; ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés, qu’il faut toujours payer plus cher à mesure qu’on monte, et toujours aux dépens du malheureux peuple ; enfin vient l’administration suprême, qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets : loin d’être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont bien moins que s’il n’y en avait qu’un seul au-dessus d’eux. Cependant à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires ; et quand il y faut recourir, l’État est toujours à la veille de sa ruine. Ce n’est pas tout : non seulement le gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés ;mais le peuple a moins d’affection pour ses chefs, qu’il ne voit jamais, pour la patrie, qui est à ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens, dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces ; diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Des lois différentes n’engendrent que trouble et confusion parmi des.peuples qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres, sont soumis à d’autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, les vices impunis, dans cette multitude d’hommes inconnus les uns aux autres, que le siège de l’administration suprême rassemble dans un même lieu. Les chefs, accablés d’affaires, ne voient rien par eux-mêmes ; des commis gouvernent l’État. Enfin les mesures qu’il faut prendre pour maintenir l’autorité générale, à laquelle tant d’officiers éloignés veulent se soustraire ou en imposer,absorbent tous les soins publics ; il n’en reste plus pour le bonheur du peuple, à peine en reste-t-il pour sa défense, au besoin ; et c’est ainsi qu’un corps trop grand pour sa constitution s’affaisse et périt écrasé sous son propre poids. D’un autre côté, l’État doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses qu’il ne manquera pas d’éprouver, et aux efforts qu’il sera contraint de faire pour se soutenir : car tous les peuples ont une espèce de force centrifuge, par laquelle ils agissent continuellement les uns contre les autres, et tendent à s’agrandir aux dépens de leurs voisins, comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles risquent d’être bientôt engloutis ; et nul ne peut guère se conserver qu’en se mettant avec tous dans une espèce d’équilibre qui rende la compression partout à peu près égale. On voit par là qu’il y a des raisons de s’étendre et des raisons de se resserrer ; et ce n’est pas le moindre talent du politique de trouver entre les unes et les autres la proportion la plus avantageuse à la conservation de l’État. On peut dire en général que les premières n’étant qu’extérieures et relatives,doivent être subordonnées aux autres, qui sont internes et absolues. Une saine et forte constitution est la première chose qu’il faut rechercher ; et l’on doit plus compter sur la vigueur qui naît d’un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des États tellement constitués, que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution même, et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s’agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité, qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l’inévitable moment de leur chute.
Chapitre 10 SuiteOn peut mesurer un corps politique de deux manières,savoir : par l’étendue du territoire, et par le nombre du peuple ; et il y a entre l’une et l’autre de ces mesures un rapport convenable pour donner à l’État sa véritable grandeur. Ce sont les hommes qui font l’État, et c’est le terrain qui nourrit les hommes : ce rapport est donc que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre en peut nourrir. C’est dans cette proportion. que se trouve le maximum d’un nombre donné de peuple ; car s’il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture insuffisante, le produit superflu ; c’est la cause prochaine des guerres défensives : s’il n’y en a pas assez, l’État se trouve pour le supplément à la discrétion de ses voisins ;c’est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n’a, par sa position, que l’alternative entre le commerce ou la guerre, est faible en lui-même ; il dépend de ses voisins, il,dépend des événements ; il n’a jamais qu’une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, ou il est subjugué et n’est rien. Il ne peut se conserver libre qu’à force de petitesse ou de grandeur. On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l’étendue de terre et le nombre d’hommes qui se suffisent l’un à l’autre, tant à cause des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain,dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions,dans l’influence des climats, que de celles qu’on remarque dans les tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont lie législateur peut espérer d’y concourir par ses établissements, de sorte qu’il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu’il voit, mais sur ce qu’il prévoit, ni s’arrêter autant à l’état actuel de la population qu’à celui où elle doit naturellement parvenir. Enfin, il y a mille occasions où les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu’on embrasse plus de terrain qu’il ne pariait nécessaire. Ainsi l’on s’étendra beaucoup dans un pays de montagnes, où les productions naturelles, savoir, les biais, les pâturages, demandent moins de travail, où l’expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les Plaines, et où un grand sol incliné ne donne qu’une petite base horizontale, la seule qu’il faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer,même dans des rochers et des sables presque stériles, parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre,que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu’on a d’ailleurs plus de facilité pour délivrer le pays, par les colonies, des habitants dont il est surchargé. À ces conditions pour instituer un peuple, il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles : c’est qu’on jouisse de l’abondance et de la paix ; car le temps où s’ordonne un État est, comme celui où se forme un bataillon, l’instant où le corps est le moins capable de résistance et le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation,où chacun s’occupe de son rang et non du péril. Qu’une guerre, une famine, une sédition survienne en ce temps de crise, l’État est infailliblement renversé. Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup de gouvernements établis durant ces orages ; mais alors ce sont ces gouvernements mêmes qui détruisent l’État. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l’effroi public, des lois destructives que le peuple n’adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l’institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l’œuvre du législateur d’avec celle du tyran. Quel peuple est donc propre à la législation ? Celui qui,se trouvant déjà lié par quelque union d’origine, d’intérêt ou de convention, n’a point encore porté le vrai joug des lois ;celui qui n’a ni coutumes, ni superstitions bien enracinées ;celui qui ne craint pas d’être accablé par une invasion subite ; qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins,peut résister seul à chacun d’eux, ou s’aider de l’un pour repousser l’autre ; celui dont chaque membre peut être connu de tous et où l’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut porter ; celui qui peut se passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut se passer(a) ; celui qui n’est ni riche ni pauvre, et peut se suffire à lui-même ; enfin celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation est moins ce qu’il faut établir que ce qu’il faut détruire ; et ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées : aussi voit-on peu d’États bien constitués. Il est encore en Europe un pays capable de législation ;c’est l’île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériteraient bien que quelque homme sage lui apprit à la conserver. J’ai quelque pressentiment qu’un jour cette petite île étonnera l’Europe.
Chapitre 11 Des divers systèmes de législationSi l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation,on trouvera qu’il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité : la liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l’État ;l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J’ai déjà dit ce que c’est que la liberté civile : à l’égard de l’égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes ; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois ; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un, autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre (b) : ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits,modération d’avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l’abus est inévitable,s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler ? C’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui naissent, tant de la situation locale que du caractère des habitants, et c’est sur ces rapports qu’il faut assigner à chaque peuple un système particulier d’institution, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même,mais pour l’État auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants ?tournez-vous du côté de l’industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles dans un bon terrain, manquez-vous d’habitants donnez tous vos soins à l’agriculture, qui multiplie les hommes, et chassez les arts, quine feraient qu’achever de dépeupler le pays en attroupant sur quelques points du territoire le peu d’habitants qu’il y a (a). Occupez-vous des rivages étendus et Commodes, couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation, vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que, des rochers presque inaccessibles ? Restez barbares et ichthyophages ; vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, et sûrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d’une manière particulière, et rend sa législation propre à lui seul. C’est ainsi qu’autrefois les Hébreux, et récemment les Arabes, ont eu pour principal objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L’auteur de l’Esprit des lois a montré dans des foules d’exemples par quel art le législateur dirige l’institution vers chacun de ces objets. Ce qui rend la constitution d’un État véritablement solide et durable, c’est quand les convenances sont tellement observées, que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire,qu’assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses que l’un tende à la servitude et l’autre à la liberté l’un aux richesses, l’autre à la population ; l’un à la paix, l’autre aux conquêtes :on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et l’État ne cessera d’être agité jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire.
Chapitre 12 Division des loisPour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer.Premièrement, l’action du corps entier agissant sur lui-même,c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’État ; et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après. Les lois qui règlent ce rapport partent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages ; car, s’il n’y a dans chaque État qu’une bonne manière de l’ordonner, le peuple qui l’a trouvée doit s’y tenir : mais si l’ordre établi est mauvais,pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l’empêchent d’être bon ? D’ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures ;car, s’il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui adroit de l’en empêcher ? La seconde relation est celle des membres entre eux, ou avec le corps entier ; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit. et au second aussi grand qu’il est possible ; en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la cité : ce qui se fait toujours par les mêmes moyens ; car il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres. C’est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme et la loi, savoir, celle de la désobéissance à la peine ; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui,dans le fond, sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de lois il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable constitution de l’État ; qui prend tous les Jours de nouvelles forces ; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s’éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opinion ; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres ; partie dont le grand législateur s’occupe en secret,tandis qu’il paraît se borner à des règlements particuliers, qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l’inébranlable clef. Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon sujet.
Partie 3Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tâchons de fixer le sens précis de ce mot qui n’a pas encore été fort bien expliqué.
Chapitre 1 Du gouvernement en généralJ’avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu posément, et que je ne sais pas l’art d’être clair pour qui ne veut pas être attentif. Toute action libre a deux causes qui concourent à la produire : l’une morale, savoir : la volonté qui détermine l’acte ; l’autre physique, savoir : la puissance qui l’exécute. Quand je marche vers un objet, il faut premièrement que j’y veuille aller ; en second lieu, que mes pieds m’y portent. Qu’un paralytique veuille courir, qu’un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront en place. Le corps politique a les mêmes, mobiles : on y distingue de même la force et la volonté ; celle-ci sous le nom de puissance législative, l’autre sous le nom de puissance exécutive. Rien ne s’y fait ou ne doit s’y faire sans leur concours. Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple,et ne peut appartenir qu’à lui. Il est aisé de voir, au contraire,par les principes ci-devant établis, que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine,parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois. Il faut donc à la force publique un agent propre qui la réunisse et la mette en œuvre selon les directions de la volonté générale,qui serve à la communication de l’État et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans l’homme l’union de l’âme et du corps. Voilà quelle est, dans l’État, la raison du gouvernement, confondu mal à propos avec le souverain,dont il n’est que le ministre. Qu’est-ce donc que le gouvernement ? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile que politique. Les membres de ce corps s’appellent magistrats ou rois,c’est-à-dire gouverneurs et le corps entier porte le nom de prince(a). Ainsi ceux qui prétendent que l’acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n’est point un contrat ont grande raison. Ce n’est absolument qu’une commission, un emploi, dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu’il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît. L’aliénation d’un tel droit, étant incompatible avec la nature du corps social, est contraire au but de l’association. J’appelle donc gouvernement ou suprême administration,l’exercice légitime de la puissance exécutive, et prince ou magistrat, l’homme ou le corps chargé de cette administration. C’est dans le gouvernement que se trouvent les forces intermédiaires, dont les rapports composent celui du tout au tout du souverain à l’État. On peut représenter ce dernier rapport par celui des extrêmes d’une proportion continue, dont la moyenne proportionnelle est le gouvernement. Le gouvernement reçoit du souverain les ordres qu’il donne au peuple ; et, pour que l’État soit dans un bon équilibre, il faut, tout compensé, qu’il y ait égalité entre le produit ou la puissance du gouvernement pris en lui-même, et le produit ou la puissance des citoyens, qui sont souverain d’un côté et sujets de l’autre. De plus, on ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre à l’instant la proportion. Si le souverain veut gouverner,ou si le magistrat veut donner des lois, ou si les sujets refusent d’obéir, le désordre succède à la règle, la force et la volonté n’agissent plus de concert, et l’État dissous tombe ainsi dans le despotisme ou dans l’anarchie. Enfin, comme il n’y a qu’une moyenne proportionnelle entre chaque rapport, il n’y a non plus qu’un bon gouvernement possible dans un État : mais, comme mille événements peuvent changer les rapports d’un peuple, non seulement différents gouvernements peuvent être bons à divers peuples, mais au même peuple en différents temps. Pour tâcher de donner une idée des divers rapports qui peuvent régner entre ces deux extrêmes, je prendrai pour exemple le nombre du peuple, comme un rapport plus facile à exprimer. Supposons que l’État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps ; mais chaque particulier, en qualité de sujet, est considéré comme individu : ainsi le souverain est au sujet comme dix mille est à un ; c’est-à-dire que chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix-millième partie de l’autorité souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes, l’état des sujets ne change pas,et chacun porte également tout l’empire des lois, tandis que son suffrage, réduit à un cent-millième, a dix fois moins d’influence dans leur rédaction. Alors, le sujet, restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D’où il suit que, plus l’État s’agrandit, plus la liberté diminue. Quand je dis que le rapport augmente, j’entends qu’il s’éloigne de l’égalité. Ainsi, plus le rapport est grand dans l’acception des géomètres, moins il y a de rapport dans l’acception commune :dans la première, le rapport, considéré selon la quantité, se mesure par l’exposant ; et dans l’autre, considéré selon l’identité, il s’estime par la similitude. Or, moins les volontés particulières se rapportent à la volonté générale, c’est-à-dire les mœurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. Donc le gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple est plus nombreux. D’un autre côté, l’agrandissement de l’État donnant aux dépositaires de l’autorité publique plus de tentations et de moyens d’abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement doit avoir de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement. Je ne parle pas ici d’une force absolue, mais de la force relative des diverses parties de l’État. Il suit de ce double rapport que la proportion continue entre le souverain, le prince et le peuple, n’est point une idée arbitraire,mais une conséquence nécessaire de la nature du corps politique. Il suit encore que l’un des extrêmes, savoir le peuple, comme sujet,étant fixe et représenté par l’unité, toutes les fois que la raison doublée augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue semblablement, et que par conséquent le moyen terme est changé. Ce qui fait voir qu’il n’y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu’il peut y avoir autant de gouvernements différents en nature que d’États différents en grandeur. Si, tournant ce système en ridicule, on disait que, pour trouver cette moyenne proportionnelle et former le corps du gouvernement,il ne faut, selon moi, que tirer la racine carrée du nombre du peuple, je répondrais que je ne prends ici ce nombre que pour un exemple ; que les rapports dont je parle ne se mesurent pas seulement par le nombre des hommes, mais en général par la quantité d’action, laquelle se combine par des multitudes de causes ;qu’au reste, si pour m’exprimer en moins de paroles, j’emprunte un moment des termes de géométrie, je n’ignore pas cependant que la précision géométrique n’a point lieu dans les quantités morales. Le gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le renferme est en grand. C’est une personne morale douée de certaines facultés, active comme le souverain, passive comme l’État, et qu’on peut décomposer en d’autres rapports semblables d’où naît par conséquent une nouvelle proportion une autre encore dans celle-ci,selon l’ordre des tribunaux, jusqu’à ce qu’on arrive à un moyen terme indivisible, c’est-à-dire à un seul chef ou magistrat suprême, qu’on peut se représenter, au milieu de cette progression,comme l’unité entre la série des fractions et celles des nombres. Sans nous embarrasser dans cette multiplication de termes,contentons-nous de considérer le gouvernement comme un nouveau corps dans l’État, distinct du peuple et du souverain, et intermédiaire entre l’un et l’autre. Il y a cette différence essentielle entre ces deux corps, que l’État existe par lui-même, et que le gouvernement n’existe que parle souverain. Ainsi la volonté dominante du prince n’est ou ne doit être que la volonté générale ou la loi ; sa force n’est que la force publique concentrée en lui : sitôt qu’il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher. S’il arrivait enfin que le prince eût une volonté particulière plus active que celle du souverain, et qu’il usât, pour obéir à cette volonté particulière, de la force publique qui est dans ses mains, en sorte qu’on eût, pour ainsi dire, deux souverains, l’un de droit et l’autre de fait, à l’instant l’union sociale s’évanouirait, et le corps politique serait dissous. Cependant, pour que le corps du gouvernement ait une existence,une vie réelle qui le distingue du corps de l’État ; pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier, une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à sa conservation. Cette existence particulière suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer, de résoudre,des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent au prince exclusivement, et qui rendent la condition du magistrat plus honorable à proportion qu’elle est plus pénible. Les difficultés sont dans la manière d’ordonner dans le tout, ce tout subalterne,de sorte qu’il n’altère point la constitution générale en affermissant la sienne ; qu’il distingue toujours sa force particulière, destinée à sa propre conservation, de la force publique, destinée à la conservation de l’État, et qu’en un mot il soit toujours prêt à sacrifier le gouvernement au peuple, et non le peuple au gouvernement. D’ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l’ouvrage d’un autre corps artificiel, et qu’il n’ait, en quelque sorte, qu’une vie empruntée et subordonnée, cela n’empêche pas qu’il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur ou de célérité,jouir, pour ainsi dire, d’une santé plus ou moins robuste. Enfin,sans s’éloigner directement du but de son institution, il peut s’en écarter plus ou moins, selon la manière dont il est constitué. C’est de toutes ces différences que naissent les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l’État, selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce même État est modifié. Car souvent le gouvernement le meilleur en soi deviendra le plus vicieux, si ses rapports ne sont altérés selon les défauts du corps politique auquel il appartient.
Chapitre 2 Du principe qui constitue les diverses formes de gouvernementPour exposer la cause générale de ces différences, il faut distinguer ici le principe et le gouvernement, comme j’ai distingué ci-devant l’État et le souverain. Le corps du magistrat peut être composé d’un plus grand ou moindre nombre de membres. Nous avons dit que le rapport du souverain aux sujets était d’autant plus grand que le peuple était plus nombreux ; et, par une évidente analogie, nous en pouvons dire autant du gouvernement à l’égard des magistrats. Or, la force totale du gouvernement, étant toujours celle de l’État, ne varie point : d’où il suit que plus il use de cette force sur ses propres membres, moins il lui en reste pour agir surtout le peuple. Donc, plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous à la mieux éclaircir. Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat trois volontés essentiellement différentes : premièrement, la volonté propre de l’individu, qui ne tend qu’à son avantage particulier ; secondement, la volonté commune des magistrats,qui se rapporte uniquement à l’avantage du prince, et qu’on peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement, et particulière par rapport à l’État, dont le gouvernement fait partie ; en troisième lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale, tant par rapport à l’État considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout. Dans une législation parfaite, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle ; la volonté de corps propre au gouvernement très subordonnée ; et par conséquent la volonté générale ou souveraine toujours dominante et la règle unique de toutes les autres. Selon l’ordre naturel, au contraire, ces différentes volontés deviennent plus actives à mesure qu’elles se concentrent. Ainsi la volonté générale est toujours la plus faible, la volonté de corps ale second rang, et là volonté particulière le premier de tous : de sorte que, dans le gouvernement, chaque membre est premièrement soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen ;gradation directement opposée à celle qu’exige l’ordre social. Cela posé, que tout le gouvernement soit entre les mains d’un seul homme, voilà la volonté particulière et la volonté de corps parfaitement réunies, et par conséquent celle-ci au plus haut degré d’intensité qu’elle puisse avoir. Or, comme c’est du degré de la volonté que dépend l’usage de la force, et que la force absolue du gouvernement ne varie point, il s’ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d’un seul. Au contraire, unissons le gouvernement à l’autorité législative ; faisons le prince du souverain, et de tous les citoyens autant de magistrats : alors la volonté de corps,confondue avec la volonté générale, n’aura pas plus d’activité qu’elle, et laissera la volonté particulière dans toute sa force.Ainsi le gouvernement, toujours avec la même force absolue, sera dans son minimum de force relative ou d’activité. Ces rapports sont incontestables, et d’autres considérations servent encore à les confirmer. On voit, par exemple, que chaque magistrat est plus actif dans son corps que chaque citoyen dans le sien, et que par conséquent la volonté particulière a beaucoup plus d’influence dans les actes du gouvernement que dans ceux du souverain ; car chaque magistrat est presque toujours chargé de quelque fonction du gouvernement ; au lieu que chaque citoyen pris à part n’a aucune fonction de la souveraineté.D’ailleurs, plus l’État s’étend, plus sa force réelle augmente,quoiqu’elle n’augmente pas en raison de son étendue : mais l’État restant le même, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n’en acquiert pas une plus grande force réelle, parce que cette force est celle de l’État, dont la mesure est toujours égale. Ainsi, la force relative ou l’activité du gouvernement diminue, sans que sa force absolue ou réelle puisse augmenter. Il est sûr encore que l’expédition des affaires devient plus lente à mesure que plus de gens en sont chargés ; qu’en donnant trop à la prudence ou ne donne pas assez à la fortune ; qu’on laisse échapper l’occasion, et qu’à force de délibérer on perd souvent le fruit de la délibération. Je viens de prouver que le gouvernement se relâche à mesure que les magistrats se multiplient ; et j’ai prouvé ci-devant que plus le peuple est nombreux, plus la force réprimante doit augmenter. D’où il suit que le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse du rapport des sujets au souverain ; c’est-à-dire que, plus l’État s’agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer ; tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l’augmentation du peuple. Au reste, je ne parle ici que de la force relative du gouvernement, et non de sa rectitude : car, au contraire, plus le magistrat est nombreux, plus la volonté de corps se rapproche de la volonté générale ; au lieu que, sous un magistrat unique,cette même volonté de corps n’est, comme je l’ai dit, qu’une volonté particulière. Ainsi, l’on perd d’un côté ce qu’on peut gagner de l’autre, et l’art du législateur est de savoir fixer le point où la force et la volonté du gouvernement, toujours en proportion réciproque, se combinent dans le rapport le plus avantageux à l’État.
Chapitre 3 Division des gouvernementsOn a vu dans le chapitre précédent pourquoi l’on distingue les diverses espèces ou formes de gouvernements par le nombre des membres qui les composent ; il reste à voir dans celui-ci comment se fait cette division. Le souverain peut, en premier lieu, commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple,en sorte qu’il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d’un petit nombre, en sorte qu’il y ait plus de simples citoyens que de magistrats ; et cette forme porte le nom d’aristocratie. Enfin il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d’un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir.Cette troisième forme est la plus commune, et s’appelle monarchie,ou gouvernement royal. On doit remarquer que toutes ces formes, ou du moins les deux premières, sont susceptibles de plus ou de moins, et ont même une assez grande latitude ; car la démocratie peut embrasser tout le peuple, ou se resserrer jusqu’à la moitié. L’aristocratie, à son tour, peut, de la moitié du peuple, se resserrer jusqu’au plus petit nombre indéterminément. La royauté même est susceptible de quelque partage. Sparte eut constamment deux rois par sa constitution ; et l’on a vu dans l’empire romain jusqu’à huit empereurs à la fois sans qu’on pût dire que l’empire fût divisé.Ainsi il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante, et l’on voit que, sous trois seules dénominations, le gouvernement est réellement susceptible d’autant de formes diverses que l’État a de citoyens. Il y a plus : ce même gouvernement pouvant, à certains égards, se subdiviser en d’autres parties, l’une administrée d’une manière et l’autre d’une autre, il peut résulter de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes, dont chacune est multipliable par toutes les formes simples. On a, de tout temps, beaucoup disputé sur la meilleure forme de gouvernement, sans considérer que chacune d’elles est la meilleure en certains cas, et la pire en d’autres. Si, dans les différents États, le nombre des magistrats suprêmes doit être en raison inverse de celui des citoyens, il s’ensuit qu’en général le gouvernement démocratique convient aux petits États, l’aristocratique aux médiocres, et le monarchique aux grands. Cette règle se tire immédiatement du principe. Mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions ?
Chapitre 4 De la démocratieCelui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée. Il semble donc qu’on ne saurait avoir une meilleure constitution que celle où le pouvoir exécutif est joint au législatif : mais c’est cela même qui rend ce gouvernement insuffisant à certains égards, parce que les choses qui doivent être distinguées ne le sont pas, et que le prince et le souverain, n’étant que la même personne, ne forment, pour ainsi dire, qu’un gouvernement sans gouvernement. Il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques, et l’abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du législateur, suite infaillible des vues particulières. Alors, l’État étant altéré dans sa substance, toute réforme devient impossible. Un peuple qui n’abuserait jamais du gouvernement n’abuserait pas non plus de l’indépendance ; un peuple qui gouvernerait toujours bien n’aurait pas besoin d’être gouverné. A prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de véritable démocratie, et il n’en existera jamais. Il est contre l’ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l’on voit aisément qu’il ne saurait établir pour cela des commissions, sans que la forme de l’administration change. En effet, je crois pouvoir poser en principe que, quand les fonctions du gouvernement sont partagées entre plusieurs tribunaux,les moins nombreux acquièrent tôt ou tard la plus grande autorité,ne fût-ce qu’à cause de la facilité d’expédier les affaires, qui les y amène naturellement. D’ailleurs, que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement ! Premièrement, un État très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres ; secondement, une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et de discussions épineuses ; ensuite beaucoup d’égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l’égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’autorité ; enfin peu ou point de luxe,car ou le luxe est l’effet des richesses, ou il les rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre,l’un par la possession, l’autre par la convoitise ; il vend la patrie à la mollesse, à la vanité ; il ôte à l’État tous ses citoyens pour les asservir les uns aux autres, et tous à l’opinion. Voilà pourquoi un auteur célèbre a donné la vertu pour principe à la république, car toutes ces conditions ne sauraient subsister sans la vertu ; mais, faute d’avoir fait les distinctions nécessaires, ce beau génie a manqué souvent de justesse,quelquefois de clarté, et n’a pas vu que l’autorité souveraine étant partout la même, le même principe doit avoir lieu dans tout État bien constitué, plus ou moins, il est vrai, selon la forme du gouvernement. Ajoutons qu’il n’y a pas de gouvernement si sujet, aux guerres civiles et aux agitations intestines que le démocratique ou populaire, parce qu’il n’y en a aucun qui tende si fortement et si continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être maintenu dans la sienne. C’est surtout dans cette constitution que le citoyen doit s’armer de force et de constance, et dire chaque jour de sa vie au fond de son cœur ce que disait un vertueux Palatin (a) dans la diète de Pologne : Malo periculosam libertatem quam quietumservitium. S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes.
Chapitre 5 De l’aristocratieNous avons ici deux personnes morales très distinctes, savoir,le gouvernement et le souverain ; et par conséquent deux volontés générales, l’une par rapport à tous les citoyens, l’autre seulement pour les membres de l’administration. Ainsi, bien que le gouvernement puisse régler sa police intérieure comme il lui plaît,il ne peut jamais parler au peuple qu’au nom du souverain,c’est-à-dire au nom du peuple même ; ce qu’il ne faut jamais oublier. Les premières sociétés se gouvernèrent aristocratiquement. Les chefs des familles délibéraient entre eux des affaires publiques.Les jeunes gens cédaient sans peine à l’autorité de l’expérience.De là les noms de prêtres, d’anciens, de sénat, de gérontes. Les sauvages de l’Amérique septentrionale se gouvernent encore ainsi de nos jours et sont très bien gouvernés. Mais, à mesure que l’inégalité d’institution l’emporta sur l’inégalité naturelle, la richesse ou la puissance (a) fut préférée à l’âge, et l’aristocratie devint élective. Enfin la puissance transmise avec les biens du père aux enfants, rendant les familles patriciennes, rendit le gouvernement héréditaire, et l’on vit des sénateurs de vingt ans. Il y a donc trois sortes d’aristocratie : naturelle,élective, héréditaire. La première ne convient qu’à des peuples simples ; la troisième est le pire de tous les gouvernements.La deuxième est le meilleur : c’est l’aristocratie proprement dite. Outre l’avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres ; car, dans le gouvernement populaire, tous les citoyens naissent magistrats ; mais celui-ci les borne à un petit nombre, et ils ne le deviennent que par élection (b) : moyen par lequel la probité, les lumières,l’expérience, et toutes les autres raisons de préférence et d’estime publique, sont autant de nouveaux garants qu’on sera sagement gouverné. De plus, les assemblées se font plus commodément ; les affaires se discutent mieux, s’expédient avec plus d’ordre et de diligence ; le crédit de l’État est mieux soutenu chez l’étranger par de vénérables sénateurs que par une multitude inconnue ou méprisée. En un mot, c’est l’ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, quand on est sûr qu’ils la gouverneront pour son profit, et non pour le leur. Il ne faut point multiplier en vain les ressorts, ni faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes choisis peuvent encore mieux. Mais il faut remarquer que l’intérêt de corps commence à moins diriger ici la force publique sur la règle de la volonté générale, et qu’une autre pente inévitable enlève aux lois une partie de la puissance exécutive. A l’égard des convenances particulières, il ne faut ni un État si petit, ni un peuple si simple et si droit, que l’exécution des lois suive immédiatement de la volonté publique, comme dans une bonne démocratie. Il ne faut pas non plus une si grande nation, que les chefs épars pour la gouverner puissent trancher du souverain chacun dans son département, et commencer par se rendre indépendants pour devenir enfin les maîtres. Mais si l’aristocratie exige quelques vertus de moins que le gouvernement populaire, elle en exige aussi d’autres qui lui sont propres, comme la modération dans les riches, et le contentement dans les pauvres ; car il semble qu’une égalité rigoureuse y serait déplacée ; elle ne fut pas même observée à Sparte. Au reste, si cette forme comporte une certaine inégalité de fortune, c’est bien pour qu’en général l’administration des affaires publiques soit confiée à ceux qui peuvent le mieux y donner tout leur temps, niais non pas, comme prétend Aristote, pour que les riches soient toujours préférés. Au contraire, il importe qu’un choix opposé apprenne quelquefois au peuple qu’il y a, dans le mérite des hommes, des raisons de préférence plus importantes que la richesse.
Chapitre 6 De la monarchieJusqu’ici nous avons considéré le prince comme une personne morale et collective, unie par la force des lois, et dépositaire dans l’État de la puissance exécutive. Nous avons maintenant à considérer cette puissance réunie entre les mains d’une personne naturelle, d’un homme réel, qui seul ait droit d’en disposer selon les lois. C’est ce qu’on appelle un monarque ou un roi. Tout au contraire des autres administrations où un être collectif représente un individu, dans celle-ci un individu représente un être collectif ; en sorte que l’unité morale qui constitue le prince est en même temps une unité physique, dans laquelle toutes les facultés que la loi réunit dans l’autre avec tant d’efforts se trouvent naturellement réunies. Ainsi la volonté du peuple, et la volonté du prince, et la force publique de l’État, et la force particulière du gouvernement, tout répond au même mobile, tous les ressorts de la machine sont dans la même main, tout marche au même but ; il n’y a point de mouvements opposés qui s’entre-détruisent, et l’on ne peut imaginer aucune sorte de constitution dans laquelle un moindre effort produise une action plus considérable. Archimède, assis tranquillement sur le rivage et tirant sans peine à flot un grand vaisseau, me représente un monarque habile, gouvernant de son cabinet ses vastes États, et faisant tout mouvoir en paraissant immobile. Mais s’il n’y a point de gouvernement qui ait plus de vigueur,il n’y en a point où la volonté particulière ait plus d’empire et domine plus aisément les autres : tout marche au même but, il est vrai ; mais ce but n’est point celui de la félicité publique, et la force même de l’administration tourne sans cesse au préjudice de l’État. Les rois veulent être absolus, et de loin on leur crie que le meilleur moyen de l’être est de se faire aimer de leurs peuples.Cette maxime est très belle, et même très vraie à certains égards : malheureusement, on s’en moquera toujours dans les cours. La puissance qui vient de l’amour des peuples est sans doute la plus grande ; mais elle est précaire et conditionnelle ; jamais les princes ne s’en contenteront. Les meilleurs rois veulent pouvoir être méchants s’il leur plait, sans cesser d’être les maîtres. Un sermonneur politique aura beau leur dire que, la force du peuple étant la leur, leur plus grand intérêt est que le peuple soit florissant, nombreux, redoutable ; ils savent très bien que cela n’est pas vrai. Leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable, et qu’il ne puisse jamais leur résister. J’avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l’intérêt du prince serait alors que le peuple fût puissant, afin que cette puissance étant sienne le rendît redoutable à ses voisins ; mais, comme cet intérêt n’est que secondaire et subordonné, et que les deux suppositions sont incompatibles, il est naturel que les princes donnent la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile.C’est ce que Samuel représentait fortement aux Hébreux : c’est ce que Machiavel a fait voir avec évidence. En feignant de donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains (a). Nous avons trouvé, par les rapports généraux, que la monarchie n’est convenable qu’aux grands États ; et nous le trouverons encore en l’examinant en elle-même. Plus l’administration publique est nombreuse, plus le rapport du prince aux sujets diminue et s’approche de l’égalité, en sorte que ce rapport est un ou l’égalité, même dans la démocratie. Ce même rapport augmente à mesure que le gouvernement se resserre. et il est dans son maximum quand le gouvernement est dans les mains d’un seul. Alors il se trouve une trop grande distance entre le prince et le peuple, et l’État manque de liaison. Pour la former, il faut donc des ordres intermédiaires, il faut des princes, des grands, de la noblesse pour les remplir. Or, rien de tout cela ne convient à un petit État, que ruinent tous ces degrés. Mais s’il est difficile qu’un grand État soit bien gouverné, il l’est beaucoup plus qu’il soit bien gouverné par un seul homme ; chacun sait ce qu’il arrive quand le roi se donne des substituts. Un défaut essentiel et inévitable, qui mettra toujours le gouvernement monarchique au-dessous du républicain, est que dans celui-ci la voix publique n’élève presque jamais aux premières places que des hommes éclairés et capables, qui les remplissent avec honneur ; au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies ne sont le plus souvent que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants, à qui les petits talents, qui font dans les cours parvenir aux grands places, ne servent qu’à montrer au public leur ineptie aussitôt qu’ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince ; et un homme d’un vrai mérite est presque aussi rare dans le ministère qu’un sot à la tête d’un gouvernement républicain. Aussi, quand,par quelque heureux hasard, un de ces hommes nés pour gouverner prend le timon des affaires dans une monarchie presque abîmée par ces tas de jolis régisseurs, on est tout surpris des ressources qu’il trouve, et cela fait époque dans un pays. Pour qu’un État monarchique pût être bien gouverné, il faudrait que sa grandeur ou son étendue fût mesurée aux facultés de celui qui gouverne. Il est plus aisé de conquérir que de régir. Avec un levier suffisant, d’un doigt l’on peut ébranler le monde ;mais pour le soutenir il faut les épaules d’Hercule. Pour peu qu’un État soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand,au contraire, il arrive que l’État est trop petit pour son chef, ce qui est très rare, il est encore mal gouverné, parce que le chef,suivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intérêts des peuples, et ne les rend pas moins malheureux par l’abus des talents qu’il a de trop qu’un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. Il faudrait, pour ainsi dire, qu’un royaume s’étendît ou se resserrât à chaque règne, selon la portée du prince ; au lieu que, les talents d’un sénat ayant des mesures plus fixes,l’État peut avoir des bornes constantes, et l’administration n’aller pas moins bien. Le plus sensible inconvénient du gouvernement d’un seul est le défaut de cette succession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre ; les élections laissent des intervalles dangereux ; elles sont orageuses ; et à moins que les citoyens ne soient d’un désintéressement, d’une intégrité que ce gouvernement ne compte guère, la brigue et la corruption s’en mêlent. Il est difficile que celui à qui l’État s’est vendu ne le vende pas à son tour, et ne se dédommage pas sur les faibles de l’argent que les puissants lui ont extorqué. Tôt ou tard tout devient vénal sous une pareille administration, et la paix, dont on jouit alors sous les rois, est pire que le désordre des interrègnes. Qu’a-t-on fait pour prévenir ces maux ? On a rendu les couronnes héréditaires dans certaines familles ; et l’on a établi un ordre de succession qui prévient toute dispute à la mort des rois ; c’est-à-dire que, substituant l’inconvénient des régences à celui des élections, on a préféré une apparente tranquillité à une administration sage, et qu’on a mieux aimé risquer d’avoir pour chefs des enfants, des monstres, des imbéciles, que d’avoir à disputer sur le choix des bons rois. On n’a pas considéré qu’en s’exposant ainsi aux risques de l’alternative, on met presque toutes les chances contre soi.C’était un mot très sensé que celui du jeune Denys à qui son père,en lui reprochant une action honteuse, disait : « T’en ai-je donné l’exemple ? Ah ! répondit le fils, votre père n’était pas roi. » Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. On prend beaucoup de peine, à ce qu’on dit, pour enseigner aux jeunes princes l’art de régner : il ne paraît pas que cette éducation leur profite. On ferait mieux de commencer par leur enseigner l’art d’obéir. Les plus grands rois qu’ait célébrés l’histoire n’ont point été élevés pour régner ; c’est une science qu’on ne possède jamais moins qu’après l’avoir trop apprise, et qu’on acquiert mieux en obéissant qu’en commandant. « Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarummalarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alioprincipe, aut volueris. » Une suite de ce défaut de cohérence est l’inconstance du gouvernement royal, qui, se réglant tantôt sur un plan et tantôt sur un autre, selon le caractère du prince qui règne ou des gens qui règnent pour lui, ne peut avoir longtemps un objet fixe ni une conduite conséquente ; variation qui rend toujours l’État flottant de maxime en maxime, de projet en projet, et qui n’a pas lieu dans les autres gouvernements, où le prince est toujours le même. Aussi voit-on qu’en général, s’il y a plus de ruse dans une cour, il y a plus de sagesse dans un sénat, et que les républiques vont à leurs fins par des vues plus constantes et mieux suivies ; au heu que chaque révolution dans le ministère en produit une dans l’État, la maxime commune à tous les ministres, et presque à tous les rois, étant de prendre en toute chose le contre-pied de leurs prédécesseurs. De cette même incohérence se tire encore la solution d’un sophisme très familier aux politiques royaux ; c’est non seulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique, et le prince au père de famille, erreur déjà réfutée,mais encore de donner libéralement à ce magistrat toutes les vertus dont il aurait besoin, et de supposer toujours que le prince est ce qu’il devrait être : supposition à l’aide de laquelle le gouvernement royal est évidemment préférable à tout autre, parce qu’il est incontestablement le plus fort et que, pour être aussi le meilleur, il ne lui manque qu’une volonté du corps plus conforme à la volonté générale. Mais si, selon Platon (a), le roi par nature est un personnage si rare, combien de fois la nature et la fortune concourront-elles à le couronner ? Et si l’éducation royale corrompt nécessairement ceux qui la reçoivent, que doit-on espérer d’une suite d’hommes élevés pour régner ? C’est donc bien vouloir s’abuser que de confondre le gouvernement royal avec celui d’un bon roi. Pour voir ce qu’est ce gouvernement en lui-même, il faut le considérer sous des princes bornés ou méchants ; car ils arriveront tels au trône, ou le trône les rendra tels. Ces difficultés n’ont pas échappé à nos auteurs ; mais ils n’en sont point embarrassés. Le remède est, disent-ils, d’obéir sans murmure ; Dieu donne les mauvais rois dans sa colère, et il faut les supporter comme des châtiments du ciel. Ce discours est édifiant, sans doute ; mais je ne sais s’il ne conviendrait pas mieux en chaire que dans un livre de politique. Que dire d’un médecin qui promet des miracles, et dont tout l’art est d’exhorter son malade à la patience ? On sait bien qu’il faut souffrir un mauvais gouvernement quand on l’a ; la question serait d’en trouver un bon.
Chapitre 7 Des gouvernements mixtesA proprement parler, il n’y a point de gouvernement simple. Il faut qu’un chef unique ait des magistrats subalternes ; il faut qu’un gouvernement populaire ait un chef. Ainsi, dans le partage de la puissance exécutive, il y a toujours gradation du.grand nombre au moindre, avec cette différence que tantôt le grand nombre dépend du petit, et tantôt le petit du grand. Quelquefois il y a partage égal, soit quand les parties constitutives sont dans une dépendance mutuelle, comme dans le gouvernement d’Angleterre ; soit quand l’autorité de chaque partie est indépendante, mais imparfaite, comme en Pologne. Cette dernière forme est mauvaise, parce qu’il n’y a point d’unité dans le gouvernement, et que l’État manque de liaison. Lequel vaut le mieux d’un gouvernement simple ou d’un gouvernement mixte ? Question fort agitée chez les politiques,et à laquelle il faut faire la même réponse que j’ai faite ci-devant sur toute forme de gouvernement. Le gouvernement simple est le, meilleur en soi, par cela seul qu’il est simple. Mais quand la puissance exécutive ne dépend pas assez de la législative, c’est-à-dire quand il y a plus de rapport du prince au souverain que du peuple au prince, il faut remédier à ce défaut de proportion en divisant le gouvernement ; car alors toutes ses parties n’ont pas moins d’autorité sur les sujets,et leur division les rend toutes ensemble moins fortes contre le souverain. On prévient encore le même inconvénient en établissant des magistrats intermédiaires qui, laissant le gouvernement en son entier, servent seulement à balancer les deux puissances et à maintenir leurs droits respectifs. Alors le gouvernement n’est pas mixte, il est tempéré. On peut remédier par des moyens semblables à l’inconvénient opposé et, quand le gouvernement est trop lâche, ériger des tribunaux pour le concentrer ; cela se pratique dans toutes les démocraties. Dans le premier cas, on divise le gouvernement pour l’affaiblir, et dans le second, pour le renforcer ; car les maximum de force et de faiblesse se trouvent également dans les gouvernements simples, au lieu que les formes mixtes donnent une force moyenne.
Chapitre 8 Que toute forme de gouvernement n’est pas propre à tout paysLa liberté, n’étant pas un fruit de tous les climats, n’est pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite ce principe établi par Montesquieu plus On en sent la vérité ; plus on le conteste, plus on donne occasion de l’établir par de nouvelles preuves. Dans tous les gouvernements du monde, la personne publique consomme et ne produit rien. D’où lui vient donc la substance consommée ? Du travail de ses membres. C’est le superflu des particuliers qui produit le nécessaire du public. D’où il suit que l’État civil ne peut subsister qu’autant que le travail des hommes rend au-delà de leurs besoins. Or, cet excédent n’est pas le même dans tous les pays du monde.Dans plusieurs il est considérable, dans d’autres médiocre, dans d’autres nul, dans d’autres négatif. Ce rapport dépend de la fertilité du climat, de la sorte de travail que la terre exige, de la nature de ses productions, de la force de ses habitants, de la plus ou moins grande consommation qui leur est nécessaire, et de plusieurs autres rapports semblables desquels il est composé. D’autre part, tous les gouvernements ne sont pas de même nature ; il y en a de plus ou moins dévorants ; et les différences sont fondées sur cet autre principe que, plus les contributions publiques s’éloignent de leur source, et plus elles sont onéreuses. Ce n’est pas sur la quantité des impositions qu’il faut mesurer cette charge, mais sur le chemin qu’elles ont à faire pour retourner dans les mains dont elles sont sorties. Quand cette circulation est prompte et bien établie, qu’on paye peu ou beaucoup, il n’importe, le peuple est toujours riche, et les finances vont toujours bien. Au contraire, quelque peu que le peuple donne, quand ce peu ne lui revient point, en donnant toujours, bientôt il s’épuise : l’État n’est jamais riche et le peuple est toujours gueux. Il suit de là que plus la distance du peuple au gouvernement augmente, et plus les tributs deviennent onéreux : ainsi, dans la démocratie’ le peuple est le moins chargé ; dans l’aristocratie, il l’est davantage ; dans la monarchie, il porte le plus grand poids. La monarchie ne convient donc qu’aux nations opulentes ; L’aristocratie, aux États médiocres en richesse ainsi qu’en grandeur ; la démocratie, aux États petits et pauvres. En effet, plus on y réfléchit, plus on trouve en ceci de différence entre les États libres rit les monarchiques. Dans les premiers, tout s’emploie à l’utilité commune ; dans les autres, les forces publiques et particulières sont réciproques ; et l’une s’augmente par l’affaiblissement de l’autre : enfin, au lieu de gouverner les sujets pour les rendre heureux, le despotisme les rend misérables pour les gouverner. Voilà donc, dans chaque climat, des causes naturelles sur lesquelles on peut assigner la forme de gouvernement à laquelle la force du climat l’entraîne, et dire même quelle espèce d’habitants il doit avoir. Les lieux ingrats et stériles, où le produit ne vaut pas le travail, doivent rester incultes et déserts, ou seulement peuplés de sauvages : les lieux où le travail des hommes ne rend exactement que le nécessaire doivent être habités par des peuples barbares ; toute politise y serait impossible ; les lieux où l’excès du produit sur le travail est médiocre conviennent aux peuples libres ; ceux où le terroir abondant et fertile donne beaucoup de produit pour peu de travail veulent être gouvernés monarchiquement, pour consumer par le luxe du prince l’excès du superflu des sujets ; car il vaut mieux que cet excès soit absorbé par le gouvernement que dissipé par les particuliers. Il y a des exceptions, je le sais ; mais ces exceptions mêmes confirment la règle, en ce qu’elles produisent tôt ou tard des révolutions qui ramènent les choses dans l’ordre de la nature. Distinguons toujours les lois générales des causes particulières qui peuvent en modifier l’effet. Quand tout le Midi serait couvert de républiques, et tout le Nord d’États despotiques, il n’en serait pas moins vrai que, par l’effet du climat, le despotisme convient aux pays chauds, la barbarie aux pays froids, et la bonne politie aux régions intermédiaires. Je vois encore qu’en accordant le principe, on pourra disputer sur l’application : on pourra dire qu’il y a des pays froids très fertiles, et des méridionaux très ingrats. Mais cette difficulté n’en est une que pour ceux qui n’examinent pas la chose dans tous ses rapports. Il faut, comme je l’ai déjà dit, compter sur des travaux, des forces, de la consommation, etc. Supposons que de deux terrains égaux l’un rapporte cinq et l’autre dix. Si les habitants du premier consomment quatre et ceux du dernier neuf, l’excès du premier produit sera un cinquième, et celui du second un dixième. Le rapport de ces deux excès étant donc inverse de celui des produits, le terrain qui ne produira que cinq donnera un superflu double de celui du terrain qui produira dix. Mais il n’est pas question d’un produit double, et je ne crois pas que personne ose mettre en général la fertilité des pays froids en égalité même avec celle des pays chauds. Toutefois supposons cette égalité ; laissons, si l’on veut, en balance l’Angleterre avec la Sicile, et la Pologne avec l’Égypte :plus au midi, nous aurons l’Afrique et les Indes ; plus au nord, nous n’aurons plus rien. Pour cette égalité de produit,quelle différence dans la culturel En Sicile, il ne faut que gratter la terre ; en Angleterre, que de soins pour la labourer ! Or, là où il faut plus de bras pour donner le même produit, le superflu doit être nécessairement moindre. Considérez, outre cela, que la même quantité d’hommes consomme beaucoup moins dans les pays chauds. Le climat demande qu’on y soit sobre pour se porter bien : les Européens qui veulent y vivre comme chez eux périssent tous de dysenterie et d’indigestion. « Nous sommes, dit Chardin, des bêtes carnassières, des loups, en comparaison des Asiatiques. Quelques-uns attribuent la sobriété des Persans à ce que leur pays est moins cultivé et moi, je crois au contraire que leur pays abonde moins en denrées parce qu’il en faut moins aux habitants. Si leur frugalité, continue-t-il, était un effet de la disette du pays, il n’y aurait que les pauvres qui mangeraient peu, au lieu que c’est généralement tout le monde ; et on mangerait plus ou moins en chaque province,selon la fertilité du pays, au lieu que la même sobriété se trouve par tout le royaume. Ils se louent fort de leur manière de vivre,disant qu’il ne faut que regarder leur teint pour reconnaître combien elle est plus excellente que celle des chrétiens. En effet,le teint des Persans est uni, ils ont la peau belle, fine et polie ; au lieu que le teint des Arméniens, leurs sujets, qui vivent à l’européenne, est rude, couperosé, et que leurs corps sont gros et pesants. » Plus on approche de la ligne, plus les peuples vivent de peu.Ils ne mangent presque pas de viande ; le riz, le maïs, le cuzcuz, le mil, la cassave, sont leurs aliments ordinaires. Il y a aux Indes des millions d’hommes dont la nourriture ne coûte pas un sou par jour. Nous voyons en Europe même des différences sensibles pour l’appétit entre les peuples du Nord et ceux du Midi. Un Espagnol vivra huit jours du dîner d’un Allemand. Dans les pays où les hommes sont plus voraces, le luxe se tourne aussi vers les choses de consommation : en Angleterre il se montre sur une table chargée de viandes ; en Italie on vous régale de sucre et de fleurs. Le luxe des vêtements offre encore de semblables différences.Dans les climats où les changements de saisons sont prompts et violents, on a des habits meilleurs et plus simples ; dans ceux où l’on ne s’habille que pour la parure, on y cherche plus d’éclat que d’utilité ; les habits eux-mêmes y sont un luxe. À Naples, vous verrez tous les jours se promener, au Pausilippe des hommes en veste dorée, et point de bas. C’est la même chose pour les bâtiments : on donne tout à la magnificence quand on n’a rien à craindre des injures de l’air. À Paris, à Londres, on veut être logé chaudement et commodément ; à Madrid, en a dessalons superbes, mais point de fenêtres qui ferment, et l’on couche dans des nids à rats. Les aliments sont beaucoup plus substantiels et succulents dans les pays chauds ; c’est une troisième différence qui ne peut manquer d’influer sur la seconde. Pourquoi mange-t-on tant de légumes en Italie ? Parce qu’ils y sont bons, nourrissants,d’excellent goût. En France, où ils ne sont nourris que d’eau, ils ne nourrissent point, et sont presque comptés pour rien sur les tables ; ils n’occupent pourtant pas moins de terrain et coûtent du moins autant de peine à cultiver. C’est une expérience faite que les blés de Barbarie, d’ailleurs inférieurs à ceux de France, rendent beaucoup plus en farine et que ceux de France, à leur tour, rendent plus que les blés du Nord. D’où l’on peut inférer qu’une gradation semblable s’observe généralement dans la même direction de la ligne au pôle. Or, n’est-ce pas un désavantage visible d’avoir dans un produit égal une moindre quantité d’aliments ? A toutes ces différentes considérations, j’en puis ajouter une qui en découle et qui les fortifie ; c’est que les pays chauds ont moins besoin d’habitants que les pays froids, et pourraient en nourrir davantage ; ce qui produit un double superflu toujours à l’avantage du despotisme. Plus le même nombre d’habitants occupe une grande surface, plus les révoltes deviennent difficiles, parce qu’on ne peut se concerter ni promptement ni secrètement, et qu’il est toujours facile au gouvernement d’éventer les projets et de couper les communications. Mais plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut usurper sur le souverain ; les chefs délibèrent aussi, sûrement dans leurs chambres que le prince dans son conseil, et la foule s’assemble aussitôt dans les places que les troupes dans leurs quartiers.L’avantage d’un gouvernement tyrannique est donc en ceci d’agir à grandes distances. À l’aide des points d’appui qu’il se donne, sa force augmente au loin comme celle des leviers (a). Celle du peuple, au contraire, n’agit que concentrée ; elle s’évapore et se perd en s’étendant, comme l’effet de la poudre éparse à terre, et qui ne prend feu que grain à grain. Les pays les moins peuplés sont ainsi les plus propres à la tyrannie ; les bêtes féroces ne règnent que dans les déserts.
Chapitre 9 Des signes d’un bon gouvernementQuand donc on demande absolument quel est le meilleur gouvernement, on fait une question insoluble comme indéterminée ; ou, si l’on veut, elle a autant de bonnes solutions qu’il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues et relatives des peuples. Mais si l’on demandait à quel signe on peut connaître qu’un peuple donné est bien ou mal gouverné, ce serait autre chose, et la question de fait pourrait se résoudre. Cependant on ne la résout point, parce que chacun veut la résoudre à sa manière. Les sujets vantent la tranquillité publique,les citoyens la liberté des particuliers ; l’un préfère la sûreté des possessions, et l’autre celle des personnes ; l’un veut que le meilleur gouvernement soit le plus sévère, l’autre soutient que c’est le plus doux ; celui-ci veut qu’on punisse les crimes, et celui-là qu’on les prévienne ; l’un trouve beau qu’on soit craint des voisins, l’autre aime mieux qu’on en soit ignoré ; l’un est content quand l’argent circule, l’autre exige que le peuple ait du pain. Quand même on conviendrait sur ces points et d’autres semblables, en serait-on plus avancé ? Les qualités morales manquant de mesure précise, fût-on d’accord sur le signe, comment l’être sur l’estimation ? Pour moi, je m’étonne toujours qu’on méconnaisse un signe aussi simple, ou qu’on ait la mauvaise foi de n’en pas convenir. Quelle est la fin de l’association politique ? C’est la conservation et la prospérité de ses membres. Et quel est le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent ? C’est leur nombre et leur population. N’allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disputé.Toute chose d’ailleurs égale, le gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur.Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est le pire.Calculateurs, c’est maintenant votre affaire ; comptez,mesurez, comparez (a).
Chapitre 10 De l’abus du gouvernement et de sa pente à dégénérerComme la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel contre la souveraineté. Plus cet effort augmente, plus la constitution s’altère ; et comme il n’y a point ici d’autre volonté de corps qui, résistant à celle du prince, fasse équilibre avec elle,il doit arriver tôt ou tard que le prince opprime enfin le souverain et rompe le traité social. C’est là le vice inhérent, et inévitable qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire, de même que la vieillesse et la mort détruisent enfin le corps de l’homme. Il y a deux voies générales par lesquelles un gouvernement dégénère : savoir, quand il se resserre, ou quand l’État se dissout. Le gouvernement se resserre quand il passe du grand nombre au petit, c’est-à-dire de la démocratie à l’aristocratie, et de l’aristocratie à la royauté. C’est là son inclinaison naturelle(a). S’il rétrogradait du petit nombre au grand, on pourrait dire qu’il se relâche mais ce progrès inverse est impossible. En effet, jamais le gouvernement ne change de forme que quand son ressort usé le laisse trop affaibli pour pouvoir conserver la sienne. Or, s’il se relâchait encore en s’étendant, sa force deviendrait tout à fait nulle, et il subsisterait encore moins. Il faut donc remonter et serrer le ressort à mesure qu’il cède ;autrement l’État qu’il soutient tomberait en ruine. Le cas de la dissolution de l’État peut arriver de deux manières. Premièrement, quand le prince n’administre plus l’État selon les lois, et qu’il usurpe le pouvoir souverain. Alors il se fait un changement remarquable ; c’est que, non pas le gouvernement,mais l’État se resserre ; je veux dire que le grand État se dissout, et qu’il s’en forme un autre dans celui-là, composé seulement des membres du gouvernement, et qui n’est plus rien au reste du peuple que son maître et son tyran. De sorte qu’à l’instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu ; et tous les simples citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés, mais non pas obligés d’obéir. Le même cas arrive aussi quand les membres du gouvernement usurpent séparément le pouvoir qu’ils ne doivent exercer qu’en corps ; ce qui n’est pas une moindre infraction des lois, et produit encore un plus grand désordre. Alors on a, pour ainsi dire,autant de princes que de magistrats ; et l’État, non moins divisé que le gouvernement, périt ou change de forme. Quand l’État se dissout, l’abus du gouvernement, quel qu’il soit, prend le nom commun d’anarchie. En distinguant, la démocratie dégénère en ochlocratie 1, l’aristocratie en oligarchie :j’ajouterais que la royauté dégénère en tyrannie, mais ce dernier mot est équivoque et demande explication. Dans le sens vulgaire, un tyran est un roi qui gouverne avec violence et sans égard à la justice et aux lois. Dans le sens précis, un tyran est un particulier qui s’arroge l’autorité royale sans y avoir droit. C’est ainsi que les Grecs entendaient ce mot de tyran ; ils le donnaient indifféremment aux bons et aux mauvais princes dont l’autorité n’était pas légitime (a). Ainsi tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes. Pour donner différents noms à différentes choses, j’appelle tyran l’usurpateur de l’autorité royale, et despote l’usurpateur du pouvoir souverain. Le tyran est celui qui s’ingère contre les lois à gouverner selon les lois ; le despote est celui qui se met au-dessus des lois mêmes. Ainsi le tyran peut n’être -pas despote,mais le despote est toujours tyran.
Chapitre 11 De la mort du corps politiqueTelle est la pente naturelle et inévitable des gouvernements les mieux constitués. Si Sparte et Rome ont péri, quel État peut espérer de durer toujours ? Si nous voulons former un établissement durable, ne songeons donc point à le rendre éternel.Pour réussir il ne faut pas tenter l’impossible, ni se flatter de donner à l’ouvrage des hommes une solidité que les choses humaines ne comportent pas. Le corps politique, aussi bien que le corps de l’homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction. Mais l’un et l’autre peut avoir une constitution plus ou moins robuste et propre à le conserver plus ou moins longtemps.La constitution de l’homme est l’ouvrage de la nature ; celle de l’État est l’ouvrage de l’art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d’eux de prolonger celle de l’État aussi loin qu’il est possible, en lui donnant la meilleure constitution qu’il puisse avoir. Le mieux constitué finira, mais plus tard qu’un autre, si nul accident imprévu n’amène sa perte avant le temps. Le principe de la vie politique est dans l’autorité souveraine.La puissance législative est le cœur de l’État, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie et l’individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit ; mais sitôt que le cœur a cessé ses fonctions, l’animal est mort. Ce n’est point par les lois que l’État subsiste, c’est par le pouvoir législatif. La loi d’hier n’oblige pas aujourd’hui :mais le consentement tacite est présumé du silence, et le souverain est censé confirmer incessamment les lois qu’il n’abroge pas,pouvant le faire. Tout ce qu’il a déclaré vouloir une fois, il le veut toujours, à moins qu’il ne le révoque. Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois ? C’est pour cela même. On doit croire qu’il n’y a que l’excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps ; si le souverain ne les eût reconnues constamment salutaires, il les eût mille fois révoquées. Voilà pourquoi, loin de s’affaiblir, les lois acquièrent sans cesse une force nouvelle dans tout État bien constitué ; le préjugé de l’antiquité les rend chaque jour plus vénérables : au heu que partout où les lois s’affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu’il n’y a plus de pouvoir législatif, et que l’État ne vit plus.
Chapitre 12 Comment se maintient l’autorité souveraineLe souverain, n’ayant d’autre force que la puissance législative, n’agit que par des lois ; et les lois n’étant que des actes authentiques de la volonté générale, le souverain ne saurait agir que quand le peuple est assemblé. Le peuple assemblé,dira-t-on, quelle chimère ! C’est une chimère aujourd’hui ; mais ce n’en était pas une il y a deux mille ans. Les hommes ont-ils changé de nature ? Les bornes du possible, dans les choses morales, sont moins étroites que nous ne pensons ; ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés, qui les rétrécissent. Les âmes basses ne croient point aux grands hommes : de vils esclaves sourient d’un air moqueur à ce mot de liberté. Par ce qui s’est fait, considérons ce qui peut se faire. Je ne parlerai pas des anciennes républiques de la Grèce ; mais la république romaine était, ce me semble, un grand État et la ville de Rome une grande ville. Le dernier cens donna dans Rome quatre cent mille citoyens portant armes, et le dernier dénombrement de l’empire plus de quatre millions de citoyens, sans compter les sujets, les étrangers, les femmes, les enfants, les esclaves. Quelle difficulté n’imaginerait-on pas d’assembler fréquemment le peuple immense de cette capitale et de ces environs !Cependant, il se passait peu de semaines que le peuple romain ne fût assemblé, et même plusieurs fois. Non seulement il exerçait les droits de la souveraineté, mais une partie de ceux du gouvernement.Il traitait certaines affaires, il jugeait certaines causes, et tout ce peuple était sur la place publique presque aussi souvent magistrat que citoyen. En remontant aux premiers temps des nations, on trouverait que la plupart des anciens gouvernements, même monarchiques, tels que ceux des Macédoniens et des Francs, avaient de semblables conseils.Quoi qu’il en soit, ce seul fait incontestable répond à toutes les difficultés : de l’existant au possible la conséquence me paraît bonne.
Chapitre 13 SuiteIl ne suffit pas que le peuple assemblé ait une fois fixé la constitution de l’État en donnant la sanction à un corps de lois’. il ne suffit pas qu’il ait établi un gouvernement perpétuel, ou qu’il ait pourvu une fois pour toutes à l’élection des magistrats ; outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu’il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu’au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu’il soit besoin pour cela d’aucune autre convocation formelle. Mais, hors de ces assemblées juridiques par leur seule date,toute assemblée du peuple qui n’aura pas été convoquée par les magistrats préposés à cet effet, et selon les formes prescrites,doit être tenue pour illégitime, et tout ce qui s’y fait pour nul,parce que l’ordre même de s’assembler doit émaner de la loi. Quant aux retours plus ou moins fréquents des assemblées légitimes, ils dépendent de tant de considérations qu’on ne saurait donner là-dessus de règles précises. Seulement, on peut dire en général que plus le gouvernement a de force, plus le souverain doit se montrer fréquemment. Ceci, me dira-t-on, peut-être bon pour une seule ville ;mais que faire quand l’État en comprend plusieurs ?Partagera-t-on l’autorité souveraine ? au bien doit-on la concentrer dans une seule ville et assujettir tout le reste ? Je réponds qu’on ne doit faire ni l’un ni l’autre. Premièrement,l’autorité souveraine est simple et une, et l’on ne peut la diviser sans la détruire, En second lieu, une ville, non plus qu’une nation., ne peut être légitimement sujette d’une autre, parce que l’essence du corps politique est dans l’accord de l’obéissance et de la liberté, et que ces mots de sujet et de souverain sont des corrélations identiques dont l’idée se réunit sous le seul mot de citoyen. Je réponds encore que c’est toujours un mal d’unir plusieurs villes en une seule cité et que, voulant faire cette union, l’on ne doit pas se flatter d’en éviter les inconvénients naturels. Il ne faut point objecter l’abus des grands États à celui qui n’en veut que de petits. Mais comment donner aux petits États assez de force pour résister aux grands ? comme jadis les villes grecques résistèrent au grand roi, et comme plus récemment la Hollande et la Suisse ont résisté à la maison d’Autriche. Toutefois, si l’on ne peut réduire l’État à de justes bornes, il reste encore une ressource ; c’est de n’y point souffrir de capitale, de faire siéger le gouvernement alternativement dans chaque ville, et d’y rassembler aussi tour à tour les états du pays. Peuplez également le territoire, étendez-y partout les mêmes droits, portez-y partout l’abondance et la vie ; c’est ainsi que l’État deviendra tout à la fois le plus fort et le mieux gouverné qu’il soit possible. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. À chaque palais que je vois élever dans la capitale, je crois voir mettre en masures tout un pays.
Chapitre 14 SuiteA l’instant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue, et la personne du dernier citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier magistrat, parce qu’ où se trouve le représenté il n’y a plus de représentants. La plupart des tumultes qui s’élevèrent à Rome dans les comices vinrent d’avoir ignoré ou négligé cette règle. Les consuls alors n’étaient que les présidents du peuple ; les tribuns de simples orateurs (a) : le sénat n’était rien du tout. Ces intervalles de suspension où le prince reconnaît ou doit reconnaître un supérieur actuel, lui ont toujours été redoutables ; et ces assemblées du peuple, qui sont l’égide du corps politique et le frein du gouvernement, ont été de tout temps l’horreur des chefs : aussi n’épargnent-ils jamais ni soins,ni objections, mi difficultés, ni promesses, pour en rebuter les citoyens. Quand ceux-ci sont avares, tâches, pusillanimes, plus amoureux du repos que de la liberté, ils ne tiennent pas longtemps contre les efforts redoublés du gouvernement : c’est ainsi que, la force résistante augmentant sans cesse, l’autorité souveraine s’évanouit à la fin, et que la plupart des cités tombent et périssent avant le temps. Mais entre l’autorité souveraine et le gouvernement arbitraire,il s’introduit quelquefois un pouvoir moyen dont il faut parler.
Chapitre 15 Des députés ou représentantsSitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des citoyens, et qu’ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? ils payent des troupes et restent chez eux ;faut-il aller au conseil ? ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d’argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie, et des représentants pour la vendre. C’est le tracas du commerce et des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse et l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave, il est inconnu dans la cité. Dans un pays vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras, et rien avec de l’argent ; loin de payer pour s’exempter de leurs devoirs, ils payeraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes. Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées, dans l’esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d’affaires privées, parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées ; sous un mauvais gouvernement, nul n’aime à faire un pas pour s’y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s’y fait, qu’on prévoit que la volonté générale n’y dominera pas, et qu’enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pires. Sitôt que quelqu’un dit des affaires de l’État : Que m’importe ? on doit compter que l’État est perdu. L’attiédissement de l’amour de la patrie, l’activité de l’intérêt privé, l’immensité des États, les conquêtes, l’abus du gouvernement, ont fait imaginer la voie des députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation. C’est ce qu’en certain pays on ose appeler le tiers état. Ainsi l’intérêt particulier de deux ordres est mis au premier et second rang ;l’intérêt public n’est qu’au troisième. La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point :elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi.Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde. L’idée des représentants est moderne : elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, et où le nom d’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques, et même dans les monarchies, jamais le peuple n’eut des représentants ; en ne connaissait pas ce mot-là. Il est très singulier qu’à Rome, où les tribuns étaient si sacrés, on n’ait pas même imaginé qu’ils pussent usurper les fonctions du peuple, et qu’au milieu d’une si grande multitude ils n’aient jamais tenté de passer de leur chef un seul plébiscite. Qu’on juge cependant de l’embarras que causait quelquefois la foule par ce qui arriva du temps des Gracques, où une partie des citoyens donnait son suffrage de dessus les toits. Où le droit et la liberté sont toutes choses, les inconvénients ne sont rien. Chez ce sage peuple tout était mis à sa juste mesure : il laissait faire à ses licteurs ce que ses tribuns n’eussent osé faire ; il ne craignait pas que ses licteurs voulussent le représenter. Pour expliquer cependant comment les tribuns le représentaient quelquefois, il suffit de concevoir comment le gouvernement représente le souverain. La loi n’étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que, dans la puissance législative,le peuple ne peut être représenté ; mais il peut et doit l’être dans la puissance exécutive, qui n’est que la force appliquée à la loi. Ceci fait voir qu’en examinant bien les choses on trouverait que très peu de nations ont des lois. Quoi qu’il en soit, il est sûr que les tribuns, n’ayant aucune partie du pouvoir exécutif, ne purent jamais représenter le peuple romain par les droits de leurs charges, mais seulement en usurpant sur ceux du sénat. Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même : il était sans cesse assemblé sur la place. Il habitait un climat doux ; il n’était point avide ; des esclaves faisaient ses travaux ; sa grande affaire était sa liberté. N’ayant plus les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vos climats plus durs vous donnent plus de besoins (a) : six mois de l’année la place publique n’est pas tenable ; vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air ; vous donnez plus à votre gain qu’à votre liberté, et vous craignez bien moins l’esclavage que la misère. – Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n’est point dans la nature a ses inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. Il y a telles positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves,mais vous l’êtes ; vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j’y trouve plus de lâcheté que d’humanité. Je n’entends point par tout cela qu’il faille avoir des esclaves, ni que le droit d’esclavage soit légitime, puisque j’ai prouvé le contraire : je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants,et pourquoi les peuples anciens n’en avaient pas. Quoi qu’il en soit, à l’instant qu’un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus. Tout bien examiné, je ne vois pas qu’il soit désormais possible au souverain de conserver parmi nous l’exercice de ses droits, si la cité n’est très petite. Mais si elle est très petite, elle sera subjuguée ? Non. Je ferai voir ci-après (a) comment on peut réunir la puissance extérieure d’un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d’un petit État.
Chapitre 16 Que l’institution du gouvernement n’est point un contratLe pouvoir législatif une fois bien établi il s’agit d’établir de même le pouvoir exécutif ; car ce dernier, qui n’opère que par des actes particuliers, n’étant pas de l’essence de l’autre, en est naturellement séparé. S’il était possible que le souverain,considéré comme tel, eût la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement confondus, qu’on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l’est pas ; et le corps politique, ainsi dénaturé, serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué. Les citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même. Or, c’est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le gouvernement. Plusieurs ont prétendu que l’acte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu’il se donne, contrat par lequel on stipulait entre les deux parties des conditions sous lesquelles l’une s’obligeait à commander et l’autre à obéir. On conviendra, je m’assure, que voilà une étrange manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable. Premièrement, l’autorité suprême ne peut pas plus se modifier que s’aliéner ; la limiter, c’est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur ;s’obliger d’obéir à un maître, c’est se remettre en pleine liberté. De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier ; d’où il suit que ce contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté, et que par conséquent il serait illégitime. On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à l’état civil : celui qui a la force en main étant toujours le maître de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l’acte d’un homme qui dirait à un autre : « Je vous donne tout mon bien, à condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira. » Il n’y a qu’un contrat dans l’État, c’est celui de l’association : celui-là seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fût une violation du premier.
Chapitre 17 De l’institution du gouvernementSous quelle idée faut-il donc concevoir l’acte par lequel le gouvernement est institué ? Je remarquerai d’abord que cet acte est complexe, ou composé de deux autres, savoir :l’établissement de la loi et l’exécution de la loi. Par le premier, le souverain statue qu’il y aura un corps de gouvernement établi sous telle ou telle forme ; et il est clair que cet acte est une loi. Par le second, le peuple nomme les chefs qui seront chargés du gouvernement établi. Or cette nomination, étant un acte particulier, n’est pas une seconde loi, mais seulement une suite de la première et une fonction du gouvernement. La difficulté est d’entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe, et comment le peuple, qui n’est que souverain ou sujet, peut devenir prince ou magistrat dans certaines circonstances. C’est encore ici que se découvre une de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence ; car celle-ci se fait par une conversion subite de la souveraineté en démocratie, en sorte que, sans aucun changement sensible, et seulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens, devenus magistrats,passent des actes généraux aux actes particuliers, et de la loi à l’exécution. Ce changement de relation n’est point une subtilité de spéculation sans exemple dans la pratique : il a lieu tous les jours dans le parlement d’Angleterre, où la chambre basse, en certaines occasions, se tourne en grand comité, pour mieux discuter les affaires, et devient ainsi simple commission, de cour souveraine qu’elle était l’instant précédent ; en telle sorte qu’elle se fait ensuite rapport à elle-même, comme chambre des communes, de ce qu’elle vient de régler en grand comité, et délibère de nouveau sous un titre de ce qu’elle a déjà résolu sous un autre. Tel est l’avantage propre au gouvernement démocratique, de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Après quoi ce gouvernement provisionnel reste en possession, si telle est la forme adoptée, ou établit au nom du souverain le gouvernement prescrit par la loi ; et tout se trouve ainsi dans la règle. Il n’est pas possible d’instituer le gouvernement d’aucune autre manière légitime et sans renoncer aux principes ci-devant établis.
Chapitre 18 Moyens de prévenir les usurpations du gouvernementDe ces éclaircissements il résulte, en confirmation du chapitre XVI, que l’acte qui institue le gouvernement n’est point un contrat, mais une loi ; que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers ; qu’il peut les établir et les destituer quand il lui plaît ; qu’il n’est point question pour eux de contracter,mais d’obéir ; et qu’en se chargeant des fonctions que l’État leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions. Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend : c’est une forme provisionnelle qu’il donne à l’administration, jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement. Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu’il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu’il devient incompatible avec le bien public : mais cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit ; et l’État n’est pas plus tenu de laisser l’autorité civile à ses chefs, que l’autorité militaire à ses généraux. Il est vrai encore qu’on ne saurait, en pareil cas, observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d’un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici surtout qu’il ne faut donner au cas odieux que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit ; et c’est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée ;car, en paraissant n’user que de us droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d’empêcher, sous le prétexte du repos publie, les assemblées destinées à rétablir le bon ordre ; de sorte qu’il se prévaut d’un silence qu’il empêche de rompre, ou des irrégularités qu’il fait commettre, pour supposer en sa faveur l’aveu de ceux que la crainte fait taire et pour punir ceux qui osent parler. C’est ainsi que les décemvirs, ayant d’abord été élus pour un an, puis continués pour une autre année, tentèrent de retenir à perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s’assembler ; et c’est par ce facile moyen que tous les gouvernements du monde, une fois revêtus de la force publique,usurpent tôt ou tard l’autorité souveraine. Les assemblées périodiques, dont j’ai parlé ci-devant, sont propres à prévenir ou différer ce malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle ; car alors le prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l’État. L’ouverture de ces assemblées, qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, et qui passent séparément par les suffrages. La première : « S’il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement. » La seconde : « S’il plaît au peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir, qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer,non pas même le pacte social ; car si tous les citoyens s’assemblaient pour rompre ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très légitimement rompu. Grotius pense même que chacun peut renoncer à l’État dont il est membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays (a). Or il serait absurde que tous les citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d’eux.
Partie 4Chapitre 1Que la volonté générale est indestructible
Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n’ont qu’une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l’État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses il n’a point d’intérêts embrouillés, contradictoires le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu. La paix, l’union, l’égalité, sont ennemies des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité : les leurres, les prétextes raffinés ne leur en imposent point, ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l’État sous un chêne et se conduire toujours sagement,peut-on s’empêcher de mépriser les raffinements des autres nations,qui se rendent illustres et misérables avec tant d’art et de mystère ? Un État ainsi gouverné a besoin de très peu de lois et, à mesure qu’il devient nécessaire d’en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, et il n’est question ni de brigues ni d’éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu’il sera sûr que les autres le feront comme lui. Ce qui trompe les raisonneurs, c’est que, ne voyant que des États mal constitués dès leur origine, ils sont frappés de l’impossibilité d’y maintenir une semblable police ; ils rient d’imaginer toutes les sottises qu’un fourbe adroit, un parleur insinuant pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell eût été nus aux son. nettes par le peuple de Berne, et le duc de Beaufort à la discipline par les Genevois. Mais quand le nœud social commence à se relâcher et l’État à s’affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l’intérêt commun s’altère et trouve des opposants : l’unanimité ne règne plus dans les voix ; la volonté générale n’est plus la volonté de tous ; il s’élève des contradictions, des débats ; et le meilleur avis ne passe point sans disputes. Enfin, quand l’État, près de sa ruine, ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil intérêt se pare effrontément du nom sacré du bien public, alors la volonté générale devient muette ; tous, guidés par des motifs secrets, n’opinent pas plus comme citoyens que si l’État n’eût jamais existé ; et l’on fait passer faussement sous le nom de lois des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérêt particulier. S’ensuit-il de là que la volonté générale soit anéantie ou corrompue ? Non : elle est toujours constante,inaltérable et pure ; mais elle est subordonnée à d’autres qui l’emportent sur elle. Chacun, détachant son intérêt de l’intérêt commun, voit bien qu’il ne peut l’en séparer tout à fait ;mais sa part du mal public ne lui paraît rien auprès du bien exclusif qu’il prétend s’approprier. Ce bien particulier excepté,il veut le bien général pour son propre intérêt, tout aussi fortement qu’aucun autre. Même en vendant son suffrage à prix d’argent, il n’éteint pas en lui la volonté générale, il l’élude.La faute qu’il commet est de changer l’état de la question et de répondre autre chose que ce qu’on lui demande ; en sorte qu’au lieu de dire, par un suffrage : « Il est avantageux à l’État »,il dit : « Il est avantageux à tel homme ou a tel parti que tel ou tel avis passe. » Ainsi la loi de l’ordre public dans les assemblées n’est pas tant d’y maintenir la volonté générale que de faire qu’elle soit toujours interrogée et qu’elle réponde toujours. J’aurais ici bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens ; et sur celui d’opiner, de proposer, de diviser,de discuter. que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu’à su membres ; mais cette importante matière demanderait un traité à part, et je ne puis tout dire dans celui-ci.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 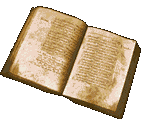
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot