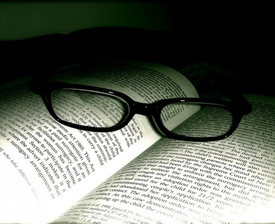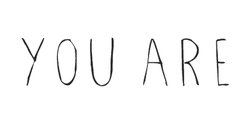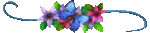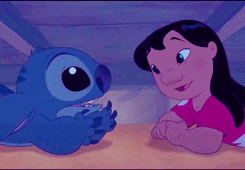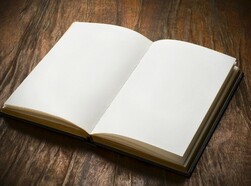-
Il était une fois, une petite fille de Village, la plus jolie qu'on eût su voir ; sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l'appelait le Petit Chaperon rouge.
Un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit :
Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa Mère-grand, qui demeurait dans un autre Village. En passant dans un bois elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il n'osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaient dans la Forêt. Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un Loup, lui dit : Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma Mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup. Oh ! oui, dit le Petit Chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du Village. Eh bien, dit le Loup, je veux l'aller voir aussi ; je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait.
Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup. Oh ! oui, dit le Petit Chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du Village. Eh bien, dit le Loup, je veux l'aller voir aussi ; je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait.
Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la Mère-grand ; il heurte : Toc, toc. Qui est là ? C'est votre fille le Petit Chaperon rouge (dit le Loup, en contrefaisant sa voix) qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. La bonne Mère-grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria : Tire la chevillette, la bobinette cherra.
Le Loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien ; car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la Mère-grand, en attendant le Petit Chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là ? Le Petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup eut peur d'abord, mais croyant que sa Mère-grand était enrhumée, répondit : C'est votre fille le Petit Chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix : Tire la chevillette, la bobinette cherra. Le Petit Chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le Loup, la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture : Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi. Le Petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : Ma mère-grand, que vous avez de grands bras ? C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ? C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles? C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ? C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ? C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, et la mangea.
Le Petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup eut peur d'abord, mais croyant que sa Mère-grand était enrhumée, répondit : C'est votre fille le Petit Chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix : Tire la chevillette, la bobinette cherra. Le Petit Chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le Loup, la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture : Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi. Le Petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : Ma mère-grand, que vous avez de grands bras ? C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ? C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles? C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ? C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ? C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, et la mangea. votre commentaire
votre commentaire
-
Il était une fois, un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept enfants tous Garçons. L'aîné n'avait que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le Bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps; mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et n'en faisait pas moins que deux à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit Poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant il était le plus fin, et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande, que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le Bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le coeur serré de douleur :
Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ; je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient.
Ah ! s'écria la Bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir, elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant ayant considéré quelle douleur ce leur serait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant. Le petit Poucet ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'ils parlaient d'affaires, il s'était levé doucement, et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se coucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin, et alla au bord d'un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit Poucet ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre.
Le Bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison; car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, ne craignez point, mes frères ; mon Père et ma Mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur Père et leur Mère.
Le petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison; car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, ne craignez point, mes frères ; mon Père et ma Mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur Père et leur Mère.
Dans le moment que le Bûcheron et la Bûcheronne arrivèrent chez eux, le Seigneur du Village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le Bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la Boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la Bûcheronne dit, hélas! où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre ; j'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette Forêt ? Hélas ! mon Dieu, les Loups les ont peut-être mangés! Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. Le Bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'ils s'en repentiraient et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le Bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens, qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La Bûcheronne était toute en pleurs: Hélas! où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants? Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendue, se mirent à crier tous ensemble : Nous voilà, nous voilà.Elle courut vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les embrassant, que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants ! vous êtes bien las, et vous avez bien faim; et toi Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau, et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à Table, et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au Père et à la Mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la Forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit Poucet, qui fit son compte de sortir d'affaire comme il avait déjà fait ; mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire, lorsque la Bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par miettes le long des chemins où ils passeraient ; il le serra donc dans sa poche.
Le Père et la Mère les menèrent dans l'endroit de la Forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux-fuyant et les laissèrent là. Le petit Poucet ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé ; mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette; les Oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la Forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent, qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de Loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os ; ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains.Le petit Poucet grimpa au haut d'un Arbre pour voir s'il ne découvrait rien ; ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la Forêt. Il descendit de l'arbre ; et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien; cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du Bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit, hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un Ogre qui mange les petits enfants ? Hélas ! Madame, lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères, que ferons-nous? Il est bien sûr que les Loups de la Forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit Monsieur qui nous mange ; peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'Ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu ; car il y avait un Mouton tout entier à la broche pour le souper de l'Ogre.
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte : c'était l'Ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'Ogredemanda d'abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le Mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce Veau que je viens d'habiller que vous sentez. Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'Ogre, en regardant sa femme de travers, et il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots, il se leva de Table, et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme !
Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi ; bien t'en prend d'être une vieille bête. Voilà du Gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois Ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours ici. Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon; mais ils avaient à faire au plus cruel de tous les Ogres, qui bien loin d'avoir de la pitié les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand Couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, lorsque sa femme lui dit : Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? n'aurez-vous pas assez de temps demain matin ? Tais-toi, reprit l'Ogre, ils en seront plus mortifiés.
Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme ; voilà un Veau, deux Moutons et la moitié d'un Cochon ! Tu as raison, dit l'Ogre ; donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'Ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses Amis. Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête, et l'obligea de s'aller coucher. L'Ogre avait sept filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites Ogressesavaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père ; mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes ; mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une Couronne d'or sur la tête.Il y avait dans la même Chambre un autre lit de la même grandeur, ce fut dans ce lit que la femme de l'Ogre mit coucher les sept garçons ; après quoi, elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit Poucet qui avait remarqué que les filles de l'Ogre avaient des Couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'Ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'Ogre, après leur avoir ôté leurs couronnes d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'Ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé ; car l'Ogres'étant éveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille ; il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand Couteau, allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles ; n'en faisons pas à deux fois. Il monta donc à tâtons à la Chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'Ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celles de tous ses frères. L'Ogre, qui sentit les Couronnes d'or vraiment, dit-il, j'allais faire là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop hier au soir Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets des garçons, ah ! les voilà, dit-il, nos gaillards !
Travaillons hardiment. En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses sept filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'Ogre, il réveilla ses frères, et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le Jardin, et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'Ogre s'étant éveillé dit à sa femme, va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir ; l'Ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habillât, et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir (car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareilles rencontres).
L'Ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. Ah ! qu'ai-je fait? s'écria-t-il, ils me le payeront, les malheureux, et tout à l'heure. Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir : Donne-moi vite mes bottes de sept lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper.Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Ils virent l'Ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit Poucet, qui vit un Rocher creux proche le lieu où ils étaient, y fit cacher ses six frères, et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'Ogre deviendrait.
 L'Ogre qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement (car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur homme), voulut se reposer, et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet en eut moins de peur, et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison, pendant que l'Ogre dormait bien fort, et qu'ils ne se missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil, et gagnèrent vite la maison. Le petit Poucet s'étant approché de l'Ogre, lui tira doucement ses bottes, et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges; mais comme elles étaient Fées, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'Ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'ils lui tenaient le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est, et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant sans en rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de sept lieues que voilà pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un affronteur. La bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet Ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants.
L'Ogre qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement (car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur homme), voulut se reposer, et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet en eut moins de peur, et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison, pendant que l'Ogre dormait bien fort, et qu'ils ne se missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil, et gagnèrent vite la maison. Le petit Poucet s'étant approché de l'Ogre, lui tira doucement ses bottes, et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges; mais comme elles étaient Fées, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'Ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'ils lui tenaient le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est, et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant sans en rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de sept lieues que voilà pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un affronteur. La bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet Ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants.
Le petit Poucet étant donc chargé de toutes les richesses de l'Ogres'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie.
Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance, et qui prétendent que le petit Poucet n'a jamais fait ce vol à l'Ogre ; qu'à la vérité, il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de sept lieues, parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du Bûcheron. Ils assurent que lorsque le petit Poucet eut chaussé les bottes de l'Ogre, il s'en alla à la Cour, où il savait qu'on était fort en peine d'une Armée qui était à deux cents lieues de là, et du succès d'une Bataille qu'on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le Roi, et lui dit que s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'Armée avant la fin du jour. Le Roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit Poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette première course l'ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu'il voulait ; car le Roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'Armée, et une infinité de Dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs Amants, et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leurs maris, mais elles le payaient si mal, et cela allait à si peu de chose, qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté-là. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier, et y avoir amassé beaucoup de bien, il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise. Il acheta des Offices de nouvelle création pour son père et pour ses frères ; et par là il les établit tous, et fit parfaitement bien sa cour en même temps.
 votre commentaire
votre commentaire
-
LE CHAT BOTTÉ
Un Meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que son Moulin, son âne, et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le Notaire, ni le Procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le Moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le Chat.
Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot : Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble ; pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le Chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux : Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un Sac, et me faire faire une paire de Bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le Maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse, pour prendre des Rats et des Souris, comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lasserons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelque jeune lapin, peu instruit encore des ruses de ce monde, vînt se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement ; un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat tirant aussitôt les cordons le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le Roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'Appartement de sa Majesté, où étant entré il fit une grande révérence au Roi, et lui dit : Voilà, Sire, un Lapin de garenne que Monsieur le Marquis de Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son Maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton Maître, répondit le Roi, que je le remercie, et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert ; et lorsque deux Perdrix y furent entrées, il tira les cordons, et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au Roi, comme il avait fait le Lapinde garenne. Le Roi reçut encore avec plaisir les deux Perdrix, et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant deux où trois mois à porter de temps en temps au Roi du Gibier de la chasse de son Maître. Un jour qu'il sut que le Roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle Princesse du monde, il dit à son Maître : Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite : vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Le Marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le Roi vint à passer et le Chat se mit à crier de toute sa force : Au secours, au secours, voilà Monsieur le Marquis de Carabas qui se noie ! À ce cri le Roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le Chat qui lui avait apporté tant de fois du Gibier, il ordonna à ses Gardes qu'on allât vite au secours de Monsieur le Marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre Marquis de la rivière, le Chat s'approcha du Carrosse, et dit au Roi que dans le temps que son Maître se baignait, il était venu des Voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié au voleur de toute sa force ; le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le Roi ordonna aussitôt aux Officiers de sa Garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour Monsieur le Marquis de Carabas. Le Roi lui fit mille caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il était beau, et bien fait de sa personne), la fille du Roi le trouva fort à son gré et le Comte de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux, et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le Roi voulut qu'il montât dans son Carrosse, et qu'il fût de la promenade. Le Chat ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des Paysans qui fauchaient un Pré, il leur dit : Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au Roi que le pré que vous fauchez appartient à Monsieur le Marquis de carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. Le Roi ne manqua pas à demander aux Faucheux à qui était ce Pré qu'ils fauchaient. C'est à Monsieur le Marquis de Carabas, dirent ils tous ensemble car la menace du Chat leur avait fait peur. Vous avez là un bel héritage, dit le Roi au Marquis de Carabas. Vous voyez, Sire, répondit le Marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître Chat, qui allait toujours devant, rencontra des Moissonneurs, et leur dit : Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à Monsieur le Marquis de carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. Le Roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à Monsieur le Marquis de Carabas, répondirent les Moissonneurs, et le Roi s'en réjouit encore avec le Marquis. Le Chat, qui allait devant le Carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait ; et le Roi était étonné des grands biens de Monsieur le Marquis de Carabas. Le maître Chat arriva enfin dans un beau Château dont le Maître était un Ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le Roi avait passé étaient de la dépendance de ce Château. Le Chat, qui eut soin de s'informer qui était cet Ogre, et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son Château, sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'Ogre le reçut aussi civilement que le peut un Ogre, et le fit reposer. On m'aassuré, dit le Chat, que vous aviez le don de vous changer en toute sorte d'Animaux, que vous pouviez par exemple, vous transformer en Lion, en Éléphant? Cela est vrai, répondit l'Ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir Lion. Le Chat fut si effrayé de voir un Lion devant lui, qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le Chat, ayant vu que l'Ogre avait quitté sa première forme, descendit, et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits Animaux, par exemple, de vous changer en un Rat, en une Souris ; je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible ? reprit l'Ogre, vous allez voir, et en même temps il se changea en une Souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le Chat ne l'eut pas plus tôt aperçue qu'il se jeta dessus, et la mangea. Cependant le Roi, qui vit en passant le beau Château de l'Ogre, voulut entrer dedans. Le Chat, qui entendit le bruit du Carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant, et dit au Roi : Votre Majesté soit la bienvenue dans ce Château de Monsieur le Marquis de Carabas. Comment, Monsieur le Marquis, s'écria le Roi, ce Château est encore à vous ! Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces Bâtiments qui l'environnent ; voyons les dedans, s'il vous plaît. Le Marquis donna la main à la jeune Princesse, et suivant le Roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande Salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'Ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer sachant que le Roi y était. Le Roi charmé des bonnes qualités de Monsieur le Marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu cinq ou six coups : Il ne tiendra qu'à vous, Monsieur le Marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le Marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le Roi ; et dès le même jour épousa la Princesse. Le Chat devint grand Seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.
MORALITE
Quelque grand que soit l'avantage
De jouir d'un riche héritage
Venant à nous de père en fils,
Aux jeunes gens pour l'ordinaire, L'industrie et le savoir-faire
Valent mieux que des biens acquis.
AUTRE MORALITE
Si le fils d'un Meunier avec tant de vitesse,
Gagne le coeur d'une Princesse,
Et s'en fait regarder avec des yeux mourants,
c'est que l'habit, la mine et la jeunesse,
Pour inspirer de la tendresse,
N'en sont pas des moyens toujours indifférents.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Barbe-Bleue
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderies et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue : cela le rendait si laid et si terrible, qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuît de devant lui.
Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues.
La Barbe bleue, pour faire connaissance, les mena, avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleures amies et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'étaient que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations : on ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres ; enfin tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme.
Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la Barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence; qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence ; qu'elle fit venir ses bonnes amies ; qu'elle les menât à la campagne, si elle voulait ; que partout elle fît bonne chère.
"Voilà, dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles ; voilà celles de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours ; voilà celles de mes coffres-forts où est mon or et mon argent ; celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clef-ci, c'est la clef du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas : ouvrez tout, allez partout ; mais, pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère."
Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse, et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur.
Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant, ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas.
Elle fut si pressée de sa curiosité, que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois.
Etant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante ; mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter : elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet.
D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang, se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs : c'était toutes les femmes que la Barbe bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre.
Elle pensa mourir de peur, et la clef du cabinet, qu'elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clef, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu ; mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois ; mais le sang ne s'en allait point : elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeura toujours du sang, car la clef était fée, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait : quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre.
La Barbe bleue revint de son voyage dès le soir-même, et dit qu'il avait reçu des lettres, dans le chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour.
Le lendemain, il lui redemanda les clefs ; et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante, qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé.
« D'où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n'est point avec les autres ?
- Il faut, dit-elle, que je l'aie laissée là-haut sur ma table.
- Ne manquez pas, dit la Barbe bleue, de me la donner tantôt.
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme :
« Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ?
- Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort.
- Vous n'en savez rien ! reprit la Barbe bleue ; je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet ! Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. »
Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant, et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir, de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était mais la Barbe bleue avait le coeur plus dur qu'un rocher.
« Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure.
- Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu.
- Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la Barbe bleue ; mais pas un moment davantage. »
Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa soeur, et lui dit
" Ma soeur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point : ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui ; et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. "
La soeur Anne monta sur le haut de la tour ; et la pauvre affligée lui criait de temps en temps :
" Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? "
Et la soeur Anne, lui répondait :
" Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie. "
Cependant, la Barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme :
" Descends vite ou je monterai là-haut."
"Encore un moment, s'il vous plaît ", lui répondait sa femme.
Et aussitôt elle criait tout bas :
"Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? "
Et la soeur Anne répondait : " Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie. "
- Descends donc vite, criait la Barbe bleue, ou je monterai là-haut.
- "Je m'en vais ", répondait la femme et puis elle criait :
« Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?
- Je vois, répondit la soeur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci ...
- Sont-ce mes frères ?
- Hélas ! non, ma soeur : c'est un troupeau de moutons ...
- Ne veux-tu pas descendre ? criait la Barbe bleue.
- Encore un moment », répondait sa femme, et puis elle criait :
« Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?
- Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté, mais ils sont bien loin encore.
- Dieu soit loué ! s'écria-t-elle un moment après, ce sont mes frères. je leur fais signe tant que je puis de se hâter. »
La Barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds tout épleurée et tout échevelée.
« Cela ne sert à rien, dit la Barbe bleue ; il faut mourir. »
Puis, la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre, levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir.
« Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu » et, levant son bras ...
Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe bleue s'arrêta tout court. On l'ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux cavaliers, qui mettant l'épée à la main, coururent droit à la Barbe bleue.
Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver ; mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères.
Il se trouva que la Barbe bleue n'avait point d'héritiers, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa soeur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps ; une autre partie à acheter des charges de capitaines à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe bleue.
MORALITE
La curiosité, malgré tous ses attraits,
Coûte souvent bien des regrets ;
On en voit, tous les jours, mille exemples paraître.
C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger ;
Dès qu'on le prend, il cesse d'être.
Et toujours il coûte trop cher.AUTRE MORALITE
Pour peu qu'on ait l'esprit sensé
Et que du monde on sache le grimoire,
On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du temps passé.
Il n'est plus d'époux si terrible,
Ni qui demande l'impossible,
Fût-il malcontent et jaloux.
Près de sa femme on le voit filer doux ;
Et, de quelque couleur que sa barbe puisse être,
On a peine à juger qui des deux est le maître. votre commentaire
votre commentaire
-
Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour ils se lamentaient : « Ah ! si seulement nous avions un enfant. » Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit : « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fillette. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais il invita aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume. Mais, comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée.
La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux : l'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix : « La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. » Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit : « Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adorée du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient.Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçonet parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lin avec application était assise dans une petite chambre.
« Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là ?
— Je file, dit la vieille en branlant la tête.
— Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ? » demanda la jeune fille.
Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit : elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vît plus rien, même pas le drapeau sur le toit.Dans le pays, la légende de la Belle au bois dormant — c'est ainsi que fut nommée la fille du roi — se répandait. De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles, comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés, sans pouvoir se détacher et mouraient là, d'une mort cruelle.
Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait, depuis cent ans, la merveilleuse fille d'un roi, appelée la Belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la haie d'épines ; mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors : « Je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la Belle au bois dormant. »
Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier, dans la cuisine, avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marmiton et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la Belle.
Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la Belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant. Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour, et la reine, et toute la cour. Et tout le monde se regardait avec de grands yeux.
Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient ; les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leur aile, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches, sur les murs, reprirent leur mouvement ; dans la cuisine, le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se remit à rissoler ; le cuisinier donna une gifle au marmiton, si fort que celui-ci en cria, et la bonne acheva de plumer la poule.
Le mariage du prince et de la Belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. votre commentaire
votre commentaire
-
 Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Grethel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme :
Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Grethel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme :
« Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants ? Nous n'avons plus rien à manger.
— Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés.
— Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela ! Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ! Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.
— Oh, fou ! rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourrions de faim tous les quatre ? »Elle n'eut de cesse qu'il acceptât ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Grethel pleura beaucoup et dit à son frère :
« C'en est fait de nous !
— Ne t'en fais pas, dit Hansel. Je trouverai un moyen de nous en tirer. »Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants : « Debout, paresseux ! Nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit : « Voici pour le repas de midi ; ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. »Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Grethel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit : « Maintenant, les enfants, ramassez du bois ! Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Grethel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit : « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. »Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Grethel se mit à pleurer et dit :
« Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ? » Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors, nous retrouverons notre chemin. »
Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Grethel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme :
« Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants ? Nous n'avons plus rien à manger.
— Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés.
— Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela ! Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ! Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.
— Oh, fou ! rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourrions de faim tous les quatre ? »Elle n'eut de cesse qu'il acceptât ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Grethel pleura beaucoup et dit à son frère :
« C'en est fait de nous !
— Ne t'en fais pas, dit Hansel. Je trouverai un moyen de nous en tirer. »Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants : « Debout, paresseux ! Nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit : « Voici pour le repas de midi ; ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. »Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Grethel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit : « Maintenant, les enfants, ramassez du bois ! Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Grethel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit : « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. »Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Grethel se mit à pleurer et dit :
« Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ? » Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors, nous retrouverons notre chemin. » Tôt le matin, la mère fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois. Parvenus dans la forêt, les parents laissèrent les enfants pour aller couper du bois. Le soir, Hansel et Grethel firent du feu, puis ils dormirent, et la soirée passa sans que personne ne revînt auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur, disant : « Attends que la lune se lève, Grethel, nous retrouverons le chemin de la maison. »Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais les deux enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent.Ils reprirent leur marche, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. À midi, ils virent un joli oiseau sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en approchèrent, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous régaler, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je vais manger un morceau du toit ; il a l'air d'être bon ! »Hansel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion, pour goûter. Grethel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Grethel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit : « Hé, chers enfants ! qui vous a conduits ici ? Entrez, venez chez moi ! Il ne vous sera fait aucun mal. »Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite deux petits lits. Hansel et Grethel s'y couchèrent. Ils se croyaient au paradis. Mais la gentillesse de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit la maison de pain que pour attirer les enfants. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête.Àl'aube, avant que les enfants ne se fussent éveillés, elle se leva. Elle attrapa Hansel, le conduisit dans une petite étable et l'y enferma. Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Grethel, la secoua pour la réveiller et lui dit : « Debout, paresseuse ! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. »
Tôt le matin, la mère fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois. Parvenus dans la forêt, les parents laissèrent les enfants pour aller couper du bois. Le soir, Hansel et Grethel firent du feu, puis ils dormirent, et la soirée passa sans que personne ne revînt auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur, disant : « Attends que la lune se lève, Grethel, nous retrouverons le chemin de la maison. »Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais les deux enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent.Ils reprirent leur marche, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. À midi, ils virent un joli oiseau sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en approchèrent, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous régaler, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je vais manger un morceau du toit ; il a l'air d'être bon ! »Hansel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion, pour goûter. Grethel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Grethel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit : « Hé, chers enfants ! qui vous a conduits ici ? Entrez, venez chez moi ! Il ne vous sera fait aucun mal. »Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite deux petits lits. Hansel et Grethel s'y couchèrent. Ils se croyaient au paradis. Mais la gentillesse de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit la maison de pain que pour attirer les enfants. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête.Àl'aube, avant que les enfants ne se fussent éveillés, elle se leva. Elle attrapa Hansel, le conduisit dans une petite étable et l'y enferma. Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Grethel, la secoua pour la réveiller et lui dit : « Debout, paresseuse ! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Grethel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'étable et disait : « Hansel, tends tes doigts que je voie si tu es déjà assez gras ».Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point. Quand quatre semaines furent passées, et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps.
Grethel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'étable et disait : « Hansel, tends tes doigts que je voie si tu es déjà assez gras ».Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point. Quand quatre semaines furent passées, et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps.
« Holà, Grethel, cria-t-elle, dépêche-toi d'apporter de l'eau ! Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et le mangerai. »De bon matin, Grethel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord faire la pâte, dit la sorcière. J'ai déjà fait chauffer le four et préparé ce qu'il faut. »
Elle poussa la pauvre Grethel vers le four, d'où sortaient de grandes flammes. « Faufile-toi dedans ! ordonna-t-elle, et vois s'il est assez chaud pour la cuisson. »
Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait, pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi. Mais Grethel devina son intention et dit : « Je ne sais comment faire. Comment entre-t-on dans ce four ?
— Petite oie, dit la sorcière, l'ouverture est assez grande, vois, je pourrais y entrer moi-même. » Et elle y passa la tête. Alors Grethel la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. Pendant que la sorcière brûlait, elle courut vers la petite étable et dit : « Hansel, nous sommes libres ! La vieille sorcière est morte ! » N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants.
Pendant que la sorcière brûlait, elle courut vers la petite étable et dit : « Hansel, nous sommes libres ! La vieille sorcière est morte ! » N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants.
« C'est encore mieux que mes petits cailloux ! » dit Hansel, en se remplissant les poches.
Et Grethel fit de même. « Maintenant, il nous faut partir, dit Hansel, si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. »Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Sa femme était morte entre-temps. Grethel secoua son tablier, et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches, par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple ; elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur ; elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendaient ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison : c'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame, et celles de mesdemoiselles ses filles ; elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête.
La pauvre fille souffrait tout avec patience, et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon ; cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtues très magnifiquement.Il arriva que le fils du roi donnât un bal, et qu'il priât toutes les personnes de qualité d'y venir : nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux ; nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui godronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait.
« Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre.
— Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire ; mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or, et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. »
On envoya quérir la bonne coiffeuse, pour dresser les cornettes à deux rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse : elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde, et s'offrit même à les coiffer ; ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elles lui disaient : « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?
— Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut.
— Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cucendron aller au bal. »
Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers ; mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin l'heureux jour arriva, elles partirent, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put ; lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer.Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien... je voudrais bien... » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit : « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?
— Hélas oui, dit Cendrillon en soupirant.
— Hé bien, seras-tu bonne fille ? dit sa marraine, je t'y ferai aller. »
Elle la mena dans sa chambre, et lui dit : « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle pût trouver, et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré.Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva six souris toutes en vie ; elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval ; ce qui fit un bel attelage de six chevaux, d'un beau gris de souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher : « Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelque rat dans la ratière, nous en ferons un cocher.
— Tu as raison, dit sa marraine, va voir. »
Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et une fois touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite elle lui dit : « Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Cendrillon ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en six laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tinrent attachés, comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie.La fée dit alors à Cendrillon : « Hé bien, voilà de quoi aller au bal, n'es-tu pas bien aise ?
— Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? »
Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries ; elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de vair, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi parée, elle monta en carrosse ; mais sa marraine lui recommanda avant toutes choses de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie.Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir ; il lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence, on cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus : « Ah, qu'elle est belle ! » Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne.
Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles, et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à considérer la princesse. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs, et leur fit mille honnêtetés : elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elles ne la connaissaient point.Alors qu'elles causaient ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts : elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait priée. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte ; Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir ! » leur dit-elle en bâillant, et se frottant les yeux, et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller ; elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elles s'étaient quittées. « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée : il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir ; elle nous a fait mille civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. »
Cendrillon ne se sentait pas de joie : elle leur demanda le nom de cette princesse ; mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit : « Elle était donc bien belle ? Ne pourrais-je point la voir ? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours.
— Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis ! Prêter mon habit à un vilain Cucendron comme cela : il faudrait que je fusse bien folle. »
Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur avait bien voulu lui prêter son habit.Le lendemain, les deux sœurs allèrent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et ne cessa de lui conter des douceurs ; la jeune demoiselle ne s'ennuyait point, et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé ; de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore onze heures : elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper ; elle laissa tomber une de ses pantoufles de vair, que le prince ramassa bien soigneusement.
Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissé tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse ; ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle.Quand ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait été ; elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de vair, la plus jolie du monde ; que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leur pied dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout.
Cendrillon qui les regardait, et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant : « Que je voie si elle ne me serait pas bonne ! » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied.Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elles lui avaient fait souffrir. Cendrillon les releva, et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était : il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria le jour même à deux grands seigneurs de la cour. votre commentaire
votre commentaire
-
Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit : « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre ! » Peu de temps après, une fille lui naquit ; elle était blanche comme neige, rose comme sang et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige.
Mais la reine mourut en lui donnant le jour.Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle ; mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait en disant : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondait : « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité.
Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses dix-sept ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit.Elle fit venir un chasseur et lui dit : « Emmène l'enfant dans la forêt ! je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. »
Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit : « Ô, cher chasseur, laisse-moi la vie ! Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. »
Le chasseur eut pitié d'elle et dit : « Sauve-toi, pauvre enfant ! » Mais il songeait : « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer ! » Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuves de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige.La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec sept petites assiettes et sept petites cuillères, sept petites fourchettes et sept petits couteaux, et aussi sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits alignés les uns à côté des autres et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Mais aucun des lits ne lui convenait ; l'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le septième, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit.Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'était sept nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs sept petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car rien n'était plus tel qu'ils l'avaient laissé.
Le premier dit : « Qui s'est assis sur ma petite chaise ? »
Le deuxième : « Qui a mangé dans ma petite assiette ? »
Le troisième : « Qui a pris de mon pain ? »
Le quatrième : « Qui a mangé de mes légumes ? »
Le cinquième : « Qui s'est servi de ma fourchette ? »
Le sixième : « Qui a coupé avec mon couteau ? »
Le septième : « Qui a bu dans mon gobelet ? »
Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. « Qui a touché à mon lit ? » dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria : « Dans le mien aussi quelqu'un s'est couché ! »
Mais le septième, quand il regarda son lit, y vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs sept petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige.
« Seigneur Dieu ! Seigneur Dieu ! s'écrièrent-ils ; que cette enfant est jolie ! » Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons, une heure avec chacun, et la nuit passa ainsi.Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les sept nains, elle s'effraya. Mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions : « Comment t'appelles-tu ?
— Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle.
— Comment es-tu venue jusqu'à nous ? »
Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent : « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien.
— D'accord, d'accord de tout mon cœur, » dit Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or ; le soir, ils s'en revenaient et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule ; les bons petits nains l'avaient mise en garde : « Méfie-toi de ta belle-mère ! Elle saura bientôt que tu es ici ; ne laisse entrer personne ! »La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais, par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. »
La reine en fut bouleversée ; elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos.
Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable.Ainsi déguisée, elle franchit les sept montagnes derrière lesquelles vivaient les sept nains. Elle frappa à la porte et dit : « J'ai du beau, du bon à vendre, à vendre ! » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit : « Bonjour, chère Madame, qu'avez-vous à vendre ?
— De la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle, des corselets de toutes les couleurs. Elle lui en montra un tressé de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme ! » se dit Blanche-Neige. Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corselet.
« Enfant ! dit la vieille. Comme tu t'y prends ! Viens, je vais te l'ajuster comme il faut ! » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle », dit la vieille en s'enfuyant.Le soir, peu de temps après, les sept nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie ! Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et, peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent : « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là ! »
La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Une nouvelle fois, le miroir avait répondu : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais, par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffer. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie.
« Eh bien ! dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais ! » Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme.Elle franchit ainsi les sept montagnes en direction de la maison des sept nains, frappa à la porte et cria : « Bonne marchandise à vendre ! » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit : « Passez votre chemin ! Je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque.
— Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. Je vais te peigner joliment. »
La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille ; à peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance.
« Et voilà ! dit la méchante femme, c'en est fait de toi, prodige de beauté ! » Et elle s'en alla.
Par bonheur, le soir arriva vite et les sept nains rentrèrent à la maison.Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne.
Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Comme la fois précédente, le miroir répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais, par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. »
Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure ! s'écria-t-elle, dussé-je en périr moi-même ! » Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait ; mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne.Ainsi transformée, elle franchit les sept montagnes pour aller chez les sept nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit : « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici ; les sept nains me l'ont interdit.
— D'accord ! répondit la paysanne. J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs ; mais je vais t'en offrir une.
— Non, dit Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit.
— Aurais-tu peur d'être empoisonnée ? demanda la vieille. Regarde : je partage la pomme en deux ; tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche. »
La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol.
La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit : « Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène ! Cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller ! » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir : Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? Celui-ci répondit enfin : « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver.Quand, au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Mais rien n'y fit : la chère enfant était morte et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les sept autour d'elle et pleurèrent trois jours durant. Puis ils se préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent : « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait la voir de tous les côtés, l'y installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne et l'un d'eux monta la garde auprès de lui.Longtemps Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Il arriva qu'un jour un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêtât à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne, et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains : « Laissez-moi le cercueil ; je vous en donnerai ce que vous voudrez. »
Mais les nains répondirent : « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit : « Alors donnez-le-moi pour rien ; car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige ; je veux lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. »
Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Puis après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante !« Seigneur, où suis-je ? demanda-t-elle.
— Auprès de moi, répondit le prince, plein d'allégresse. »
Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant : « Je t'aime plus que tout au monde ; viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur.
La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais la jeune souveraine est mille fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut si peur, si peur qu'elle en perdit la tête. votre commentaire
votre commentaire





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 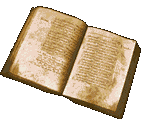
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot