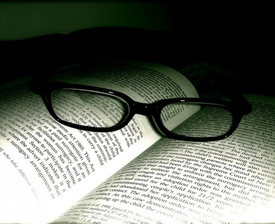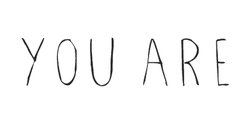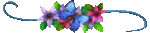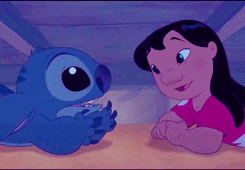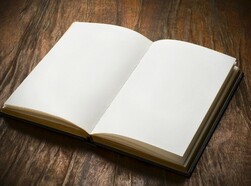-
Le Laboureur et ses enfants

Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor. votre commentaire
votre commentaire
-
Le Héron

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
Le Héron au long bec emmanché d'un long cou.
Il côtoyait une rivière.
L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours ;
Ma commère la carpe y faisait mille tours
Avec le brochet son compère.
Le Héron en eût fait aisément son profit :
Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre ;
Mais il crut mieux faire d'attendre
Qu'il eût un peu plus d'appétit.
Il vivait de régime, et mangeait à ses heures.
Après quelques moments l'appétit vint : l'oiseau
S'approchant du bord vit sur l'eau
Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures.
Le mets ne lui plut pas ; il s'attendait à mieux
Et montrait un goût dédaigneux
Comme le rat du bon Horace.
Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ?
La Tanche rebutée il trouva du goujon.
Du goujon ! c'est bien là le dîner d'un Héron !
J'ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise !
Il l'ouvrit pour bien moins : tout alla de façon
Qu'il ne vit plus aucun poisson.
La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise
De rencontrer un limaçon.
Ne soyons pas si difficiles :
Les plus accommodants ce sont les plus habiles :
On hasarde de perdre en voulant trop gagner,
Gardez-vous de rien dédaigner ;
Surtout quand vous avez à peu près votre compte.
Bien des gens y sont pris ; ce n'est pas aux Hérons
Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ;
Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. votre commentaire
votre commentaire
-
Le Corbeau et le Renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. votre commentaire
votre commentaire
-
Le Chêne et le Roseau

Le Chêne un jour dit au Roseau :
Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du Soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphir.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
— Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts. votre commentaire
votre commentaire
-
Le cancre
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur. votre commentaire
votre commentaire
-
La Laitière et le Pot au lait
Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple, et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l'argent,
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée ;
La chose allait à bien par son soin diligent.
Il m'est, disait-elle, facile,
D'élever des poulets autour de ma maison :
Le Renard sera bien habile,
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;
Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable :
J'aurai le revendant de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ;
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l'appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ?
Picrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous ?
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux :
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes :
Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi ;
On m'élit roi, mon peuple m'aime ;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ;
Je suis gros Jean comme devant. votre commentaire
votre commentaire
-
La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf
Une Grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ?
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,
Tout petit Prince a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages. votre commentaire
votre commentaire
-
La Cigale et la Fourmi
La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien !dansez maintenant. » votre commentaire
votre commentaire
-
Henri IV

Henri IV
de Luigi Pirandello
PERSONNAGES« HENRI IV ».
LA MARQUISE MATHILDE SPINA.
SA FILLE FRIDA.
LE JEUNE MARQUIS CARLO DI NOLLI.
LE BARON TITO BELCREDI.
LE DOCTEUR DIONISIO GENONI.
LES QUATRE PSEUDO-CONSEILLERS SECRETS :
1° ARIALD (Franco).
2° LANDOLF (Lolo).
3° ORDULF (Momo).
4° BERTHOLD (Fino).
LE VIEUX VALET DE CHAMBRE GIOVANNI.
DEUX HOMMES D’ARMES EN COSTUME.
De nos jours, en Ombrie, dans une villa isolée.
Henri IV a été représenté par laCompagnie Pitoeff pour la première fois au théâtre de Monte Carlole 3 janvier 1925, à Paris au théâtre des Artsle 23 février 1925 par M. Georges Pitoeff,Mme Mora Sylvère, Mme LudmillaPitoeff et MM. Peltier, Evseief, Jim Geralds,Hort, Penay, Ponty, Nauny, Mathis, Léonard.
ACTE PREMIER
Le salon d’une villa aménagé de façon à représenter ce que pouvait être la salle du trône du palais impérial de Goslar, au temps d’Henri IV. Mais, tranchant sur le mobilier ancien, deux tableaux modernes, deux portraits de grandeur naturelle, se détachent sur le mur du fond, placés à peu de hauteur du parquet, au-dessus d’un entablement de bois sculpté qui court le long du mur, large et saillant, de façon à ce qu’on puisse s’y asseoir comme sur une banquette. L’un de ces tableaux est à droite, l’autre à gauche du trône, qui interrompt l’entablement au milieu du mur, pour y insérer le siège impérial sous son baldaquin bas. Les deux tableaux représentent l’un, unhomme, l’autre, une femme, jeunes, chacun revêtu d’un travesti decarnaval : l’homme est déguisé en Henri IV, la femme enMathilde de Toscane. Portes à droite et à gauche.
Au lever du rideau, deux hommes d’armes,comme surpris en faute, bondissent de l’entablement où ils étaientétendus et vont s’immobiliser de part et d’autre du trône, avecleurs hallebardes. Peu après, par la seconde porte à droiteentrent : Ariald, Landolf, Ordulf et Berthold, jeunes genspayés par le marquis Carlo di Molli pour jouer le rôle de« conseillers secrets », seigneurs appartenant à lapetite noblesse et appelés à la cour de Henri IV. Ils revêtentle costume des chevaliers du XIe siècle. Le dernier,Berthold, de son vrai nom Fino, prend son service pour la premièrefois. Ses trois camarades lui donnent des détails tout en semoquant de lui. La scène sera jouée avec un grand brio.
LANDOLF, à Berthold, poursuivant sesexplications. – Et maintenant, voilà la salle dutrône !
ARIALD. – À Goslar !
ORDULF. – Ou, si tu préfères, au château duHartz !
ARIALD. – Ou encore, à Worms.
LANDOLF. – C’est selon l’épisode que nousreprésentons… La salle se déplace avec nous.
ORDULF. – De Saxe en Lombardie.
ARIALD. – Et de Lombardie…
LANDOLF. – Sur le Rhin !
UN DES HOMMES D’ARMES, sans bouger remuantseulement les lèvres. – Psst ! Psst !
ARIALD, se retournant à cet appel. –Qu’est-ce qu’il y a ?
PREMIER HOMME D’ARMES, toujours immobilecomme une statue, à mi-voix. – Il entre ou non ?
Il fait allusion à Henri IV.
ORDULF. – Non, non, il dort ; prenez vosaises.
DEUXIÈME HOMME D’ARMES, quittant saposition en même temps que le premier et allant de nouveaus’étendre sur l’entablement. – Eh, bon Dieu ! vous auriezpu le dire tout de suite !
PREMIER HOMME D’ARMES, s’approchantd’Ariald. – S’il vous plaît, vous n’auriez pas uneallumette ?
LANDOLF. – Hé là ! pas de pipesici !
PREMIER HOMME D’ARMES, tandis qu’Arialdlui tend une allumette enflammée. – Non, non, je vais fumerune cigarette…
Il allume et va s’étendre à sontour, en fumant, sur l’entablement.
BERTHOLD, qui observe la scène d’un airstupéfait et perplexe, promène son regard autour de la salle, puis,examinant son costume et celui de ses camarades. – Maispardon… cette salle… ces costumes… de quel Henri IVs’agit-il ? Je ne m’y retrouve pas du tout… D’Henri IV deFrance ou d’un autre ?
À cette question, Landolf, Ariald etOrdulf éclatent d’un rire bruyant.
LANDOLF, riant toujours et montrant dudoigt Berthold à ses camarades, qui continuent à rire, comme pourles inviter à se moquer encore de lui. – Henri IV deFrance !
ORDULF, de même. – Il croyait quec’était celui de France !
ARIALD. – C’est d’Henri IV d’Allemagnequ’il s’agit, mon cher… Dynastie des Saliens !
ORDULF. – Le grand empereurtragique !
LANDOLF. – L’homme de Canossa ! Nousmenons ici, jour après jour, la plus impitoyable des guerres, entrel’État et l’Église, comprends-tu ?
ORDULF. – L’Empire contre la Papauté !As-tu compris ?
ARIALD. – Les antipapes contre lespapes !
LANDOLF. – Les rois contre lesantirois !
ORDULF. – Et guerre au Saxon !
ARIALD. – Et guerre à tous les princesrebelles !
LANDOLF. – Guerre aux fils de l’Empereureux-mêmes !
BERTHOLD, sous cette avalanche, plongeantsa tête dans ses mains. – J’ai compris ! J’aicompris ! Voilà pourquoi je ne m’y retrouvais plus du tout,quand vous m’avez donné ce costume et m’avez fait entrer dans cettesalle ! Je me disais aussi : ce ne sont pourtant pas descostumes du XVIe siècle !
ARIALD. – Il n’y a pas plus de XVIesiècle que sur ma main !
ORDULF. – Nous sommes ici entre l’an 1000 etl’an 1100 !
LANDOLF. – Tu peux calculer toi-même :c’est aujourd’hui le 25 janvier 1071, nous sommes devantCanossa…
BERTHOLD, de plus en plus affolé. –Mais alors, bon Dieu ! je suis fichu !
ORDULF. – Ah ! ça… Si tu te croyais à lacour de France !
BERTHOLD. – Toute ma préparationhistorique…
LANDOLF. – Nous sommes, mon cher, plus âgés dequatre cents ans ! Tu nous fais l’effet d’un enfant aumaillot !
BERTHOLD, en colère. – Mais,sapristi, on aurait pu me dire qu’il s’agissait d’Henri IVd’Allemagne et non pas d’Henri IV de France ! Dans lesquinze jours qu’on m’a donnés pour ma préparation, j’ai peut-êtrelu cent bouquins !
ARIALD. – Mais pardon, ne savais-tu pas que cepauvre Tito représentait ici Adalbert de Brême ?
BERTHOLD. – Qu’est-ce que tu me chantes avecton Adalbert ? Je ne savais rien du tout !
LANDOLF. – Écoute : voici comment leschoses se sont passées : après la mort de Tito, le petitmarquis di Nolli…
BERTHOLD. – Précisément, c’est la faute dumarquis ! C’était à lui de me prévenir !…
ARIALD. – Mais il te croyait sans doute aucourant !…
LANDOLF. – Eh bien, voici : il ne voulaitpas remplacer Tito. Nous restions trois, le marquis trouvait quec’était suffisant. Mais Lui a commencé à crier :« Adalbert a été chassé ! » Ce pauvre Tito,comprends-tu, il ne le croyait pas mort. Il s’imaginait que lesévêques de Cologne et de Mayence, les rivaux de l’évêque Adalbert,l’avaient chassé de sa cour.
BERTHOLD, se prenant la tête à deuxmains. – Mais je ne sais pas le premier mot de toute cettehistoire, moi !
ORDULF. – Eh bien, alors, mon pauvre, te voilàfrais !
ARIALD. – Le malheur, c’est que nous ne savonspas nous-mêmes qui tu es !
BERTHOLD. – Vous ne savez pas quel rôle jedois jouer ?
ORDULF. – Hum ! Le rôle de« Berthold ».
BERTHOLD. – Mais Berthold, qui est-ce ?Pourquoi Berthold ?
LANDOLF, – Est-ce qu’on sait !Il s’est mis à crier : « Ils m’ont chasséAdalbert ! Alors qu’on m’amène Berthold ! Je veuxBerthold ! »
ARIALD. – Nous nous sommes regardés tous lestrois dans les yeux : qui diable était ce Berthold ?
ORDULF. – Voilà, mon cher, comment tu as ététransformé en Berthold.
LANDOLF. – Tu vas jouer ce rôle àravir !
BERTHOLD, révolté et faisant mine de s’enaller. – Oh ! mais je ne le jouerai pas ! Mercibeaucoup ! Je m’en vais ! Je m’en vais !
ARIALD, le retenant, aidé d’Ordulf, enriant. – Allons, calme-toi, calme-toi !
ORDULF. – Tu ne seras pas le Berthold stupidede la fable.
LANDOLF. – Tranquillise-toi : nous nesavons pas plus que toi qui nous sommes. Voici Hérold, voilàOrdulf, moi, je suis Landolf… Il nous a donné ces noms… Nous enavons pris l’habitude, mais qui sommes-nous ? Ce sont des nomsde l’époque… Berthold doit être aussi un nom de l’époque. Seul, lepauvre Tito jouait un rôle vraiment historique, celui de l’évêquede Brême. Et on aurait dit pour de bon un évêque ! Il étaitmagnifique, ce pauvre Tito !
ARIALD. – Dame ! il avait pu étudier sonrôle dans les livres, lui !
LANDOLF. – Il donnait des ordres à tout lemonde, même à Sa Majesté : il tranchait de tout, il s’érigeaiten mentor et en grand conseiller. Nous sommes aussi « desconseillers secrets », mais… c’est pour faire nombre.L’histoire dit qu’Henri IV était détesté par la hautearistocratie, parce qu’il s’était entouré de jeunes gens de lapetite noblesse.
ORDULF. – La petite noblesse, c’est nous.
LANDOLF. – Oui, nous sommes les petits vassauxdu roi : dévoués, un peu dissolus, boute-en-train surtout…
BERTHOLD. – Il faudra aussi que je soisboute-en-train ?
LANDOLF. – Mais oui, comme nous !
ORDULF. – Et je te préviens que ce n’est pasfacile !
LANDOLF. – Mais quel dommage ! Tu vois,le cadre est parfait : nous pourrions, avec ces costumes,figurer dans un de ces drames historiques qui ont tant de succèsaujourd’hui au théâtre. Et ce n’est pas la matière qui fait défaut.L’histoire d’Henri IV ne contient pas une tragédie, elle encontient dix… Nous quatre et ces deux malheureux-là (il montreles deux hommes d’armes) quand ils se tiennent immobiles aupied du trône, raides comme des piquets, nous sommes comme despersonnages qui n’ont pas rencontré un auteur, comme des acteurs àqui on ne donne pas de pièce à représenter… Comment dire ? Laforme existe, c’est le contenu qui manque ! Ah ! noussommes beaucoup moins favorisés que les véritables conseillersd’Henri IV ; eux, personne ne leur donnait de rôle àjouer. Ils ignoraient même qu’ils avaient un rôle à jouer !Ils le jouaient au naturel, sans le savoir… Pour eux, ce n’étaitpas un rôle, c’était la vie, leur vie. Ils faisaient leursaffaires aux dépens d’autrui : ils vendaient les investitures,touchaient des pots-de-vin, toute la lyre… Tandis que nous, nousvoilà habillés comme ils l’étaient, dans cet admirable cadreimpérial… Pour faire quoi ? Rien du tout… Nous sommes pareilsà six marionnettes accrochées au mur, qui attendent un montreur quise saisira d’elles, les mettra en mouvement et leur fera prononcerquelques phrases.
ARIALD. – Non, mon cher, pardon. Il nous fautrépondre dans le ton ! S’il te parle et que tu ne sois pasprêt à lui répondre comme il veut, tu es perdu !
LANDOLF. – Oui, c’est vrai, c’estvrai !
BERTHOLD. – Précisément ! Commentpourrais-je lui répondre dans le ton, moi, qui me suis préparé pourun Henri IV de France et qui me trouve, à présent, en faced’un Henri IV d’Allemagne ?
Landolf, Ordulf et Ariald recommencent àrire.
ARIALD. – Eh ! il faut te préparer sansretard !
ORDULF. – Ne t’inquiète pas ! Nous allonst’aider.
ARIALD. – Si tu savais tous les livres quenous avons à notre disposition ! Tu n’auras qu’à en feuilleterquelques-uns.
ORDULF. – Mais oui, pour prendre uneteinture…
ARIALD. – Regarde ! (Il le faittourner et lui montre, sur le mur du fond, le portrait de lamarquise Mathilde.) Voyons, celle-là, qui est-ce ?
BERTHOLD, regardant. – Quic’est ? Mais avant tout, quelqu’un qui n’est guère dans leton ! Deux tableaux modernes ici, au milieu de toutes cesantiquailles !
ARIALD. – Tu as parfaitement raison. Ils n’yétaient pas au début. Il y a deux niches derrière ces tableaux. Ondevait y placer deux statues, sculptées dans le style del’époque ; mais les niches sont restées vides et on les adissimulées sous les deux portraits que tu vois…
LANDOLF, l’interrompant etcontinuant. – … qui détonneraient tout à fait sic’étaient véritablement des tableaux.
BERTHOLD. – Comment, ce ne sont pas destableaux ?
LANDOLF. – Si, si, tu peux les toucher, cesont des toiles peintes, mais, pour lui (il montremystérieusement sa droite faisant allusion à Henri IV)qui ne les touche pas…
BERTHOLD. – Que sont-elles donc, pourlui ?
LANDOLF. – Simple interprétation de ma part…tu sais, mais, au fond, je la crois juste. Pour lui, eh bien !ce sont des images, des images comme… voyons… comme un miroir peutles offrir. Comprends-tu ? Celle ci (il montre le portraitd’Henri IV) le représente lui-même vivant, tel qu’il est,dans cette salle du trône, qui se présente, de son côté, tellequ’elle le doit, conforme au style et aux mœurs de l’époque. Dequoi t’étonnes-tu ? Si on te plaçait devant un miroir, ne t’yverrais-tu pas vivant et présent, bien que vêtu d’étoffesanciennes ? Eh bien, sur ce mur, c’est comme s’il y avait deuxmiroirs qui reflètent deux images vivantes d’un monde mort. Cemonde-là, en restant avec nous, tu le verras peu à peu reprendrevie lui aussi !
BERTHOLD. – Prenez garde que je ne veux pasdevenir fou dans cette maison !
ARIALD. – Tu ne deviendras pas fou ! Tut’amuseras !
BERTHOLD. – Mais, dites-moi, comment diableêtes-vous devenu tous les trois aussi savants ?
LANDOLF. – Eh, mon cher, on ne remonte pas dehuit cents ans en arrière dans l’histoire sans rapporter avec soiune petite expérience !
ARIALD. – Sois tranquille, tu verras comme enpeu de temps tu seras absorbé, toi aussi, par tout cela !
ORDULF. – Et comme nous, à cette école, tudeviendras savant à ton tour.
BERTHOLD. – Eh bien, aidez-moi sanstarder ! Donnez-moi tout de suite les renseignementsessentiels !
ARIALD. – Fie-toi à nous… Un peu l’un, un peul’autre !…
LANDOLF. – Nous t’attacherons toutes lesficelles qu’il faudra et nous ferons de toi la plus parfaite desmarionnettes, sois tranquille ! Et maintenant, viens…
Il le prend par le bras et l’entraîne versla sortie.
BERTHOLD, s’arrêtant et examinant leportrait. – Attendez ! Vous ne m’avez pas dit qui estcette femme. La femme de l’Empereur ?
ARIALD. – Non, la femme de l’Empereur, c’estBerthe de Suse, la sœur d’Amédée II de Savoie.
ORDULF. – Oui, et l’Empereur qui se pique derester aussi jeune que nous, ne peut plus la souffrir ; ilpense à la répudier.
LANDOLF. – La femme que tu vois sur ce tableauest son ennemie la plus féroce : c’est la marquise Mathilde deToscane.
BERTHOLD. – Ah ! je sais ! Celle quia donné l’hospitalité au pape…
LANDOLF. – Précisément, à Canossa !
ORDULF. – Au pape Grégoire VII
ARIALD. – Grégoire VII, notre bêtenoire ! Allons, viens !
Ils se dirigent tous les quatre vers laporte à droite, par où ils sont entrés, quand, par la porte àgauche, entre le vieux valet de chambre Giovanni, en frac.
GIOVANNI. – Eh ! psst !Franco ! Lolo !
ARIALD, s’arrêtant et se tournant verslui. – Qu’est-ce que c’est ?
BERTHOLD, étonné à la vue du valet enfrac. – Comment ? Lui, ici ?
LANDOLF. – Un homme du XXe siècleici ! Dehors !
Il court sur lui, le menaçant pour rireet, aidé d’Ariald et d’Ordulf, fait mine de le chasser.
ORDULF. – Émissaire de Grégoire VII, horsd’ici !
ARIALD. – Hors d’ici ! horsd’ici !
GIOVANNI, agacé, se défendant. –Laissez-moi tranquille !
ORDULF. – Non, tu n’as pas le droit de mettreles pieds dans cette salle !
ARIALD. – Hors d’ici ! horsd’ici !
LANDOLF, à Berthold. – C’est de lamagie pure, tu sais ! C’est un démon évoqué par le Sorcier deRome ! Vite, tire ton épée !
Il fait le geste de tirer l’épée, luiaussi.
GIOVANNI, criant. – Au nom duciel ! cessez de faire les fous avec moi ! Monsieur leMarquis vient d’arriver. Il est en compagnie…
LANDOLF, se frottant les mains. – Ah,ah ! très bien ! Est-ce qu’il y a des dames ?
ORDULF, de même. – Desvieilles ? des jeunes ?
GIOVANNI. – Il y a deux messieurs.
ARIALD. – Mais les dames, les dames, quisont-elles ?
GIOVANNI. – Madame la Marquise et safille.
LANDOLF, étonné. – Commentcela ?
ORDULF, de même. – Tu dis lamarquise ?
GIOVANNI. – La marquise, la marquise,parfaitement.
ARIALD. – Et les messieurs ?
GIOVANNI. – Connais pas.
ARIALD, à Berthold. – Ils apportentle contenu qui manquait à notre forme !
ORDULF. – Ce sont tous des émissaires deGrégoire VII ! Nous allons rire !
GIOVANNI. – Allez-vous me laisser parler à lafin ?
ARIALD. – Parle ! Parle !
GIOVANNI. – Je crois qu’un de ces messieursest un médecin !
LANDOLF. – Ah ! très bien ! Encoreun nouveau médecin !
ARIALD. – Bravo, Berthold ! Tu nousportes chance !
LANDOLF. – Tu vas voir comment nous allons lerecevoir, ce médecin !
BERTHOLD. – Mais je vais me trouver, dès monarrivée, dans un sacré embarras !
GIOVANNI. – Écoutez-moi bien ! Ilsveulent pénétrer dans cette salle.
LANDOLF, stupéfait et consterné. –Comment ! Elle, la marquise, ici ?
ARIALD. – En fait de contenu…
LANDOLF. – C’est une tragédie qui va sortir delà !
BERTHOLD, plein de curiosité. – Etpourquoi cela ? Pourquoi ?
ORDULF, indiquant le portrait. – Maisc’est que la marquise, c’est elle, comprends-tu ?
LANDOLF. – Sa fille est fiancée au petitmarquis di Nolli !
ARIALD. – Mais que viennent-ils faireici ? Peut-on le savoir ?
ORDULF. – S’il la voit, gare !
LANDOLF. – Va-t-il seulement lareconnaître ?
GIOVANNI. – S’il s’éveille, retenez-le dansson appartement.
ORDULF. – C’est facile à dire, maiscomment ?
ARIALD. – Tu sais bien comment ilest !
GIOVANNI. – Par la force, s’il le faut !Voilà les ordres qu’on m’a donnés. Vous n’avez qu’à exécuter !Allez, maintenant !
ARIALD. – Allons… Il est peut-être déjàréveillé !
ORDULF. – Allons ! allons !
LANDOLF, suivant ses camarades, àGiovanni. – Mais tu nous expliqueras tout à l’heure !
GIOVANNI, criant. – Fermez à doubletour par là-bas, et cachez la clé. (Indiquant l’autre porte àdroite.) L’autre porte aussi.
Landolf et Ordulf sortent par la secondeporte à droite.
GIOVANNI, aux deux hommes d’armes. –Allez-vous-en aussi ! Passez par là ! (Il montre lapremière porte à droite.) Refermez la porte et emportez laclé !
Les deux hommes d’armes sortent par lapremière porte à droite. Giovanni va vers la porte de gauche etintroduit donna Mathilde Spina, sa fille, la marquiseFrida, le docteur Dionisio Genoni, le baron Tito Belcredi, et lejeune marquis Carlo di Nolli qui, en sa qualité de maître demaison, entre le dernier. Donna Mathilde a environ quarante-cinqans. Elle est encore belle, bien qu’elle répare d’une façon tropvoyante les outrages du temps par un maquillage excessif, toutsavant qu’il soit, qui lui donne une tête farouche de Walkyrie. Cemaquillage prend un relief en contraste profond avec la boucheadmirablement belle et douloureuse. Veuve depuis de longues années,elle est devenue la maîtresse du baron Tito Belcredi, qu’enapparence personne, pas plus elle que les autres, n’a jamais prisau sérieux. Ce que Tito Belcredi est en réalité pour elle, lui seulle sait bien, et c’est pourquoi il peut rire si son amie éprouve lebesoin de faire semblant de l’ignorer, rire aussi pour répondre auxrires que les plaisanteries de la marquise à ses dépens provoquentchez les autres. Mince, précocement gris, un peu plus jeunequ’elle, il a une curieuse tête d’oiseau. Il serait plein devivacité si sa souple agilité (qui fait de lui un escrimeur trèsredouté), ne semblait enfermée dans le fourreau d’une paressesomnolente d’Arabe qu’exprime sa voix un peu nasale et traînante.Frida, la fille de la marquise, a dix-neuf ans. Grandie tristementdans l’ombre où sa mère, impérieuse et trop voyante, l’a tenue,elle est en outre blessée par la médisance facile que provoque samère et qui, désormais, nuit surtout à elle. Par bonheur, elle estdéjà fiancée au marquis Carlo di Nolli, jeune homme sérieux, trèsindulgent pour les autres, mais réservé et désireux d’égards ;il est pénétré du peu qu’il croit être et de sa valeur dans lemonde ; bien que, peut-être, il ne sache pas bien lui-même aufond ce qu’il vaut. D’autre part, il est accablé par le sentimentde toutes les responsabilités qu’il s’imagine peser sur lui :ah ! les autres sont bien heureux, ils peuvent rire ets’amuser, tandis que lui ne le peut pas ; il le voudrait bien,mais il a le sentiment qu’il n’en a pas le droit. Il est en granddeuil de sa mère. Le docteur Dionisio Genoni a un large facièsimpudique et rubicond de satyre ; des yeux saillants, unebarbiche en pointe, brillante comme de l’argent, de belles façons.Il est presque chauve. Tous entrent avec componction, presque aveccrainte ; ils examinent la salle avec curiosité, sauf di Molliqui la connaît déjà. Les premières répliques s’échangent à voixbasse.
Di Nolli, à Giovanni. – Tu as biendonné les ordres ?
GIOVANNI. – Monsieur le Marquis peut êtretranquille.
Il s’incline et sort.
BELCREDI. – Ah ! c’est magnifique !c’est magnifique !
LE DOCTEUR. – C’est remarquablementintéressant ! Le délire est systématisé à la perfection,jusque dans le cadre ! C’est vraiment magnifique !
DONNA MATHILDE, qui a cherché des yeux sonportrait, le découvrant et s’en approchant. – Ah ! levoilà ! (Elle se place à bonne distance pour le regarder,agitée par des sentiments divers.) Oui ! Oui !…Oh ! regardez… Mon Dieu !… (Elle appelle safille.) Frida, Frida !… Regarde !…
FRIDA. – C’est ton portrait !…
DONNA MATHILDE. – Mais non !… Regardebien… ce n’est pas moi, c’est toi qui es là !…
DI NOLLI. – N’est-ce pas ? Je vousl’avais dit !…
DONNA MATHILDE. – Je n’aurais jamais cru quece fut à ce point… (S’agitant comme si un frisson luiparcourait le dos.) Mon Dieu ! quelle impression !(Puis regardant sa fille.) Mais comment, Frida ?(Elle lui entoure la taille de son bras.) Viens un peu. Tune te vois pas en moi, dans ce portrait ?
FRIDA. – À dire vrai… heu…
DONNA MATHILDE. – Tu ne trouves pas ?…Est-il possible ?… (Se tournant vers Belcredi.)Regardez, Tito, et dites-le, dites-le vous-même !
BELCREDI, sans regarder. – Non, moi,je ne regarde pas ! Pour moi, a priori, c’estnon !
DONNA MATHILDE. – Quel imbécile ! Ilcroit me faire un compliment ! (Se tournant vers ledocteur.) Et vous, docteur, qu’est-ce que vous enpensez ?
Le docteur s’approche.
BELCREDI, tournant le dos et feignant dele rappeler. – Psst ! Non, docteur ! Je vous enprie ! ne répondez pas !
LE DOCTEUR, étonné et souriant. –Mais pourquoi ?
DONNA MATHILDE. – Ne l’écoutez pas !Approchez !… Il est insupportable !
FRIDA. – Il fait l’imbécile parvocation ! Vous le savez bien.
BELCREDI, au docteur, en le voyants’approcher. – Regardez vos pieds, docteur ! Regardez vospieds ! Vos pieds !
LE DOCTEUR. – Mes pieds ? Pourquoidonc ?
BELCREDI. – Vous avez des souliers ferrés.
LE DOCTEUR. – Moi ?
BELCREDI. – Oui, monsieur, et vous allezécraser quatre pieds de cristal.
LE DOCTEUR, riant fort. – Maisnon !… Y a-t-il vraiment lieu de faire tant d’histoires parcequ’une fille ressemble à sa mère…
BELCREDI. – Patatras ! la gaffe estfaite !
DONNA MATHILDE, exagérément en colère,marchant sur Belcredi. – Pourquoi patatras ? Qu’est-cequ’il y a ? Qu’a dit le docteur ?
LE DOCTEUR, avec candeur. – N’ai-jepas raison ?
BELCREDI, regardant la marquise. – Ildit qu’il n’y a pas lieu de s’étonner de cette ressemblance…Pourquoi donc marquez-vous tant de stupeur, je vous le demande, sila chose vous semble toute naturelle ?
DONNA MATHILDE, encore plus encolère. – Idiot ! Idiot ! Précisément, ce seraittout naturel, si c’était le portrait de ma fille. (Elle montrele tableau.) Mais ce portrait, c’est le mien, et y retrouverma fille, au lieu de m’y retrouver, moi, voilà ce qui a provoqué mastupeur. Et, je vous prie de la croire sincère… Je vous défends dela mettre en doute !
Après cette violente sortie, un moment desilence embarrassé.
FRIDA, à voix basse, avec ennui. –C’est toujours la même chose ! Pour un rien, unediscussion !…
BELCREDI, à voix basse également, commepour s’excuser. – Mais je n’ai rien mis en doute… J’aiseulement remarqué que, dès le début, tu ne partageais par lastupeur de ta mère. Si tu t’es étonnée de quelque chose, c’est queta ressemblance entre toi et ce portrait parût si frappante à tamère.
DONNA MATHILDE. – Naturellement ! Elle nepeut pas se reconnaître en moi telle que j’étais à son âge ;tandis que moi, je peux, dans ce portrait, me reconnaître en elletelle qu’elle est en ce moment.
LE DOCTEUR. – C’est parfaitement juste !Un portrait fixe pour toujours une minute. Cette minute lointainene rappelle rien à mademoiselle, tandis qu’elle peut rappeler àmadame la Marquise des gestes, des attitudes, des regards, dessourires, mille choses, enfin, qui ne sont pas peintes sur latoile.
DONNA MATHILDE. – Voilà, c’est exactementcela !
LE DOCTEUR, poursuivant, tourné verselle. – Et que tout naturellement vous retrouvez aujourd’huivivantes dans votre fille !
DONNA MATHILDE. – Il faut qu’il gâte lemoindre de mes abandons à un sentiment spontané, par simple besoinde m’irriter.
LE DOCTEUR, aveuglé par les lumières qu’ilvient de répandre, reprend sur un ton professoral, en s’adressant àBelcredi. – La ressemblance, mon cher Baron, est souvent unequestion « d’impondérables »…« d’impondérables », et c’est ainsi qu’on peut expliquerque…
BELCREDI, pour interrompre la leçon.– Quelqu’un pourrait trouver, mon cher docteur, une ressemblanceentre vous et moi !
Di NOLLI. – Je vous en prie, parlons d’autrechose ! (Il montre les deux portes à droite, pour indiquerqu’on peut être entendu.) Nous avons déjà perdu trop de tempsen route…
FRIDA. – Naturellement. (MontrantBelcredi.) Quand il est là…
DONNA MATHILDE, l’interrompant. –C’est pourquoi je ne voulais pas qu’il vînt !
BELCREDI. – Quelle ingratitude ! Pendantle voyage vous avez fait rire tout le monde à mes dépens !
Di Nolli. – Je t’en prie, Tito ! Laissonscela. Le docteur est ici. Ne perdons pas de temps. Tu sais combiencette consultation me tient à cœur.
LE DOCTEUR. – Voyons un peu… Essayons toutd’abord de bien préciser quelques points. Je vous demande pardon,madame la Marquise : comment votre portrait se trouve-t-ilici ? Vous lui en aviez fait cadeau à l’époque del’accident ?
DONNA MATHILDE. – Pas du tout. À quel titreaurais-je pu lui en faire cadeau ? J’avais l’âge de Frida, jen’étais même pas encore fiancée. J’ai cédé ce portrait sur lesvives instances de sa mère (elle montre di Nolli), troisou quatre ans après l’accident ?
LE DOCTEUR. – La mère de monsieur était sasœur ?
Il montre la porte à droite, faisantallusion à Henri IV.
Di NOLLI. – Oui, docteur, et notre visited’aujourd’hui est une dette sacrée envers ma mère, que j’ai perdueil y a un mois. Au lieu d’être ici, elle (il montre Frida)et moi, nous devrions être en voyage de noces…
LE DOCTEUR. – Et occupés à bien d’autressoins, j’entends bien !
Di NOLLI. – Ma mère est morte avec l’idée quela guérison de son frère adoré était prochaine.
LE DOCTEUR. – Et vous ne pouvez pas me diresur quels symptômes elle se fondait ?
Di NOLLI. – Peu de temps avant la mort de mamère, il lui avait tenu, paraît-il, un étrange discours.
LE DOCTEUR. – Un discours ? Ehmais !… il serait extrêmement utile, extrêmement, de leconnaître !
Di NOLLI. – Ce qu’il lui a dit, je l’ignore.Je sais que ma mère revint terriblement angoissée de cette dernièrevisite. Il semble qu’il lui ait témoigné une tendresseinaccoutumée. Comme s’il avait pressenti la fin prochaine de sasœur. Sur son lit de mort, elle m’a fait promettre de ne jamaisl’abandonner, de le faire examiner par d’autres médecins…
LE DOCTEUR. – Bon, très bien. Nous allonsvoir. Tout d’abord… vous le savez, souvent les plus petites causes…Ce portrait…
DONNA MATHILDE. – Ah ! je ne crois pas,docteur, qu’il faille lui accorder une importance excessive. Sij’ai été troublée en l’apercevant, c’est que je ne l’avais pas revudepuis de longues années.
LE DOCTEUR. – Je vous en prie… je vous enprie… de la méthode…
Di NOLLI. – Le portrait est là depuis unequinzaine d’années…
DONNA MATHILDE. – Davantage ! Plus dedix-huit ans !
LE DOCTEUR. – Voudriez-vous me faire la grâcede m’écouter ! Vous ne savez pas encore ce que je veux vousdemander ! Je compte beaucoup, mais beaucoup, sur ces deuxportraits, qui ont été exécutés, naturellement, avant cette fameuseet malheureuse cavalcade ?
DONNA MATHILDE. – Naturellement !
LE DOCTEUR. – À un moment, par conséquent, oùil avait toute sa raison… J’en viens à ma question… Est-ce lui quivous avait proposé de faire exécuter ces portraits ?
DONNA MATHILDE. – Mais, pas du tout,docteur ! La plupart de ceux qui prenaient part à la cavalcadese firent portraiturer pour en conserver un souvenir.
BELCREDI. – Je me suis fait peindre, moiaussi, en « Charles d’Anjou ».
DONNA MATHILDE. – Dès que les costumes furentprêts.
BELCREDI. – Voilà. On se proposait derassembler toutes ces toiles en souvenir, comme dans un musée, dansle salon de la villa où devait avoir lieu le bal masqué après lacavalcade, mais ensuite, chacun préféra conserver son portrait.
DONNA MATHILDE. – Et le mien, je vous l’aidéjà dit, je l’ai cédé plus tard, sans regret d’ailleurs, sur lesinstances de sa mère.
Elle montre de nouveau di Nolli.
LE DOCTEUR. – Vous ne savez pas si c’est luiqui l’a réclamé ?
DONNA MATHILDE. – Je l’ignore… Peut-être…C’est peut-être aussi sa sœur, pour seconder affectueusement…
LE DOCTEUR. – Autre chose, autre chose !L’idée de la cavalcade était-elle de lui ?
BELCREDI, lui coupant la parole. –Non, non ! elle était de moi, elle était de moi !
LE DOCTEUR. – Je vous en prie…
DONNA MATHILDE. – Ne l’écoutez pas, c’est cepauvre Belassi qui en avait eu l’idée.
BELCREDI. – Belassi, pas du tout !
DONNA MATHILDE, au docteur. – Lecomte Belassi qui mourut deux ou trois mois plus tard…
BELCREDI. – Belassi n’était pas là quand…
DI NOLLI, ennuyé par la menace d’unenouvelle discussion.
– Pardon, docteur, est-ilvraiment nécessaire d’établir qui eut l’idée première de lacavalcade ?
LE DOCTEUR. – Eh oui ! cela pourraitm’être utile…
BELCREDI. – L’idée était de moi !Pourquoi me la disputer ? Je n’ai pas tant à m’en glorifier,étant donné les suites qu’elle a eues ! C’était, docteur, jeme le rappelle très bien, au cercle, un soir, début novembre. Jefeuilletais une revue illustrée allemande. (Je regardais simplementles images, bien entendu, – je ne sais pas l’allemand.) Une de cesgravures représentait l’Empereur, dans je ne sais quelle villeuniversitaire, où il avait été étudiant.
LE DOCTEUR. – Bonn, sans doute.
BELCREDI. – Bonn, c’est possible. Il était àcheval, revêtu d’un de ces étranges costumes des vieillesassociations goliardiques d’Allemagne. Un cortège d’étudiantsnobles le suivait à cheval aussi et en costumes. Cette gravure medonna l’idée de la cavalcade. Il faut que vous sachiez qu’aucercle, nous songions à organiser une grande fête travestie pour lecarnaval. Je proposai cette cavalcade historique : historiquesi l’on veut : « babélique », plutôt. Chacun de nousdevait choisir un personnage à représenter, pris dans un siècle oudans un autre : un roi, un empereur ou un prince, avec sa dameà côté de lui, reine ou impératrice, à cheval. Les chevauxcaparaçonnés, bien entendu, à la mode de l’époque. La propositionfut acceptée.
DONNA MATHILDE. – Moi, c’est Belassi quim’avait invitée.
BELCREDI. – S’il vous a dit que l’idée étaitde lui, il se l’est indûment appropriée. Il n’était même pas aucercle, je vous le répète, le soir où je fis ma proposition. Lui(il fait allusion à Henri IV) n’y était pasdavantage, du reste !
LE DOCTEUR. – Et il fixa son choix sur lepersonnage d’Henri IV ?
DONNA MATHILDE. – Oui, parce qu’à cause de monnom, et sans beaucoup réfléchir, j’avais déclaré que je medéguiserais en marquise Mathilde de Toscane.
LE DOCTEUR. – Je vous avoue que je ne vois pasbien le rapport…
DONNA Mathilde. – Je ne le voyais pas nonplus, tout d’abord, mais à mes questions, il répondit qu’il seraitalors à mes pieds comme Henri IV à Canossa. Je connaissaisbien l’affaire de Canossa, mais j’en ignorais les détails, etj’éprouvai une curieuse impression, en relisant mon histoire pourpréparer mon rôle, à me trouver l’amie fidèle et zélée du papeGrégoire VII, en lutte féroce contre l’Empire. Mais je comprisaussi pourquoi, mon choix s’étant fixé sur Mathilde, implacableennemie de l’Empereur, il avait voulu figurer à mes côtés danscette cavalcade, sous le costume d’Henri IV.
LE DOCTEUR. – Ah ! C’est que sansdoute… ?
BELCREDI. – Vous avez deviné, docteur… Il luifaisait, à cette époque, une cour acharnée, et elle,naturellement…
DONNA MATHILDE, piquée, avec feu. –Naturellement ! Oui, naturellement ! et surtout à cetteépoque : « naturellement » !
BELCREDI, la désignant. – Elle nepouvait pas le souffrir !
DONNA MATHILDE. – C’est faux ! Il nem’était pas antipathique ! Au contraire ! Mais, pour moi,il a toujours suffi que quelqu’un veuille se faire prendre ausérieux…
BELCREDI, continuant la phrase. –Pour que vous tiriez de là aussitôt une preuve éclatante de sastupidité !
DONNA MATHILDE. – Non, mon cher ! Dumoins pas cette fois-là. Vous êtes stupide, lui ne l’était pas…
BELCREDI. – Du moins je n’ai jamais essayé deme faire prendre au sérieux !
DONNA MATHILDE. – Je le sais bien ! Maisavec lui, il n’y avait pas à plaisanter. (Sur un autre ton, setournant vers le docteur.) Il arrive aux femmes, mon cherdocteur, entre mille disgrâces, de rencontrer parfois un regardchargé de la promesse contenue, intense d’un sentimentéternel ! (Elle éclate d’un rire aigu.) Rien de plusdrôle ! Ah ! si les hommes se voyaient avec ce« sentiment éternel » dans le regard… Je n’ai jamais pum’empêcher d’en rire ! et surtout à cette époque-là !…Mais je dois l’avouer : je le peux bien aujourd’hui, aprèsvingt ans et plus… Je me mis à rire de lui comme des autres, maisce fut surtout parce que j’en avais peur. On aurait pu avoirconfiance dans une promesse de ces yeux-là. Mais ç’aurait ététerriblement dangereux.
LE DOCTEUR, avec un vif intérêt,concentrant son attention. – Ah ! voilà ! voilà unechose que j’aimerais beaucoup savoir ! Très dangereux,pourquoi ?
DONNA MATHILDE, avec légèreté. –Précisément parce qu’il n’était pas comme les autres ! etétant donné que je suis, moi aussi… je suis… je peux le dire…, jesuis un peu…, et même plus qu’un peu… Je suis (elle cherche uneparole modeste), oui, tout à fait incapable de supporter…voilà, incapable de supporter tout ce qui est compassé, pesant,artificiel ! Mais j’étais si jeune alors, vouscomprenez ? Jeune fille, je rongeais mon frein, mais pourrépondre à cet amour-là, il m’aurait fallu un courage que je ne mesentais pas. Et alors j’ai ri de lui comme des autres. J’en avaisdu remords. J’enrageai contre moi, plus tard, en me rendant compteque mon rire ne faisait qu’un avec celui de tout le monde, de tousles imbéciles qui se moquaient de lui.
BELCREDI. – Oui, à peu près comme on se moquede moi.
DONNA MATHILDE. – Vous, vous faites rire àcause de votre manie de toujours vous ravaler ! Tandis quelui, c’était tout le contraire ! Vous, d’abord, on vous rit aunez !
BELCREDI. – Mieux vaut qu’on vous rie au nezque dans le dos.
LE DOCTEUR. – Voulez-vous que nous revenions ànos moutons ! Il était donc, à ce que je crois comprendre,déjà un peu exalté ?
BELCREDI. – Oui, mais d’une façon siparticulière, docteur !
LE DOCTEUR. – Expliquez-vous !
BELCREDI. – Voilà, il était exalté… mais àfroid…
DONNA MATHILDE. – Mais non, pas à froid !Il était un peu étrange, certainement, mais parce qu’il débordaitde vitalité ; c’était… un poète !
BELCREDI. – Je ne prétends pas qu’il simulait,l’exaltation. Non, tout au contraire ; souvent, il s’exaltaitvéritablement. Mais je peux vous assurer, docteur,qu’instantanément il se voyait lui-même, en proie à son exaltation,il en prenait conscience et il se mettait à contempler cetteexaltation comme un spectacle. Cela devait lui arriver jusque dansses mouvements les plus spontanés. Je suis certain qu’il ensouffrait : il entrait parfois contre lui-même dans des ragesdu plus haut comique !
LE DOCTEUR. – Ah ! vraiment !
DONNA MATHILDE. – Oui, c’est exact !
BELCREDI, au docteur Genoni. – Il ensouffrait, parce que ce dédoublement, cette lucidité immédiatel’exilait de ses sentiments les plus profonds, les lui rendaitétrangers… Ses sentiments lui paraissaient aussitôt – non pas fauxpuisqu’ils étaient sincères – mais des choses, auxquelles ilfallait donner sans retard une valeur… comment dire ? lavaleur d’un acte intellectuel, pour remplacer la chaleur desincérité qu’il sentait se retirer de lui. Et alors il improvisait,il exagérait, il s’exaltait pour s’étourdir et ne plus sevoir… C’est ce qui le faisait paraître inconstant, léger et,disons le mot, parfois même ridicule.
LE DOCTEUR. – Dites-moi un peu… était-ilinsociable ?
BELCREDI. – Mais pas le moins du monde !Il adorait mettre en scène des tableaux vivants, organiser desballets, des représentations de bienfaisance… Il se qualifiaitd’amateur en riant, mais c’était un acteur tout à faitremarquable !
Di NOLLI. – Sa folie a fait de lui un acteurmagnifique et terrible !…
BELCREDI. – Et dès le premier instant…Figurez-vous qu’aussitôt après son accident, après sa chute decheval…
LE DOCTEUR. – Il était tombé sur la nuque,n’est-ce pas ?
DONNA MATHILDE. – Quelle horreur ! Ilétait à côté de moi ! Je le vis étendu entre les pattes ducheval, qui s’était brusquement cabré…
BELCREDI. – Tout d’abord, nous n’imaginionspas qu’il se fût fait grand mal. La cavalcade s’arrêta. Il y eut unpeu de désordre, on voulait savoir ce qui était arrivé ; maisdéjà on l’avait relevé et transporté dans la villa.
DONNA MATHILDE. – Il n’avait rien, vous savez,pas la moindre blessure ! pas une goutte de sang !
BELCREDI. – On le croyait simplementévanoui…
DONNA MATHILDE. – Et quand deux heuresaprès…
BELCREDI. – Oui, quand il reparut dans lesalon de la villa – c’est à cela que je faisais allusion…
DONNA MATHILDE. – Si vous aviez vu sonvisage ! J’en fus tout de suite frappée !
BELCREDI. – Mais non, ne dites pas ça !Personne ne s’aperçut de rien. Comprenez-vous, docteur ?
DONNA MATHILDE. – Naturellement ! Vousétiez tous comme des fous !
BELCREDI. – Chacun jouait son rôle, c’étaitune vraie tour de Babel !
DONNA MATHILDE. – Imaginez, docteur,l’épouvante quand on comprit qu’il jouait son rôlesérieusement ?
LE DOCTEUR. – Comment, il était làaussi ?
BELCREDI. – Mais oui ! Il nous avaitrejoints. Nous imaginions qu’il était déjà rétabli et qu’il jouaitson rôle, lui aussi, comme nous tous… mieux que nous… parce que, jevous l’ai dit, c’était un acteur de premier ordre ! En sommenous imaginions qu’il plaisantait comme nous !
DONNA MATHILDE. – On commença à se moquer delui.
BELCREDI. – Et alors… il était armé (comme unroi devait l’être). Il dégaina et se précipita sur deux ou troisdes invités. Ce fut un moment de terreur !
DONNA MATHILDE. – Je n’oublierai jamais cettescène ! Ces visages grimés, fardés, décomposés en présencesoudain de ce masque terrible qui n’était plus un masque, qui étaitla Folie !
BELCREDI. – Oui, c’était Henri IV,Henri IV en personne, dans une crise de fureur !
DONNA MATHILDE. – Cette mascarade, l’obsessionde cette mascarade, dut avoir une influence sur lui. Depuis plusd’un mois, il ne pensait qu’à ça. Il était toujours obsédé par toutce qu’il faisait !
BELCREDI. – Vous n’imaginez pas les étudesqu’il avait faites pour préparer son personnage ! Il étaitdescendu jusqu’aux plus infimes détails !…
LE DOCTEUR. – Rien de plus facile àcomprendre ! Ce qui était une obsession momentanée devint idéefixe. La chute, le choc contre la nuque ayant troublé le cerveau,l’obsession s’est fixée, perpétuée… Deux cas peuvent seprésenter : devenir idiot, ou devenir fou…
BELCREDI, à Frida et à Di Nolli. –Vous voyez ça d’ici, hein ! les enfants ! (À DiNolli.) Toi, tu avais quatre ou cinq ans. (À Frida.)Ta mère dit que tu as pris sa place dans ce portrait, mais quandelle posait pour lui elle ne pensait même pas à te mettre au monde.Moi, j’ai les cheveux gris à présent, mais lui, regardez (ilmontre le portrait) – pan ! un coup sur la nuque, et iln’a plus bougé… – Henri IV.
LE DOCTEUR, plongé dans ses réflexions,levant les mains à hauteur de son visage comme pour réclamerl’attention de ses auditeurs ; il se prépare à donner uneexplication scientifique. – Eh bien, mesdames et messieurs,voici exactement…
La première porte à droite, – laplus proche de la rampe, – s’ouvre tout à coup et Berthold entre enscène, le visage décomposé.
BERTHOLD, sur le ton de quelqu’un qui nepeut plus se contenir. – Pardon ! Pardon !Excusez-moi !…
Il s’arrête en voyant l’embarras que sonapparition a suscité dans le groupe.
FRIDA, avec un cri d’épouvante, cherchantà se cacher. – Ah ! mon Dieu ! le voilà !
DONNA MATHILDE, reculant, épouvantée, unbras levé, pour ne pas le voir. – C’est lui ! C’estlui !
Di NOLLI. – Mais non ! Mais non ! Ducalme !
LE DOCTEUR, étonné. – Mais quiest-ce, alors ?
BELCREDI. – C’est quelque survivant de notremascarade !
Di NOLLI. – C’est un des quatre jeunes gensque nous avons ici pour servir sa folie.
BERTHOLD. – Je vous demande pardon, monsieurle Marquis…
Di NOLLI. – Il n’y a pas de pardon !J’avais donné ordre de fermer les portes à clé, et personne nedevait entrer ici !
BERTHOLD. – Oui, monsieur ! Mais je n’ytiens plus et je vous demande la permission de m’enaller !
Di NOLLI. – Ah ! vous êtes le nouveau…Vous êtes entré en service ce matin ?
BERTHOLD. – Oui, monsieur, et je n’y tiensdéjà plus !…
DONNA MATHILDE, consternée, à DiNolli. – Mais, il n’est donc pas aussi tranquille que vousnous le disiez ?
BERTHOLD. – Non, non, madame ! Il nes’agit pas de lui, ce sont mes trois camarades ! Vous parliezde servir cette folie, monsieur le Marquis ? Il s’agit bien deça : ce sont eux trois les véritables fous ! Moi quientre ici pour la première fois, monsieur le Marquis, au lieu dem’aider…
Landolf et Ariald entrent par la mêmeporte, à droite, en hâte, avec anxiété, mais s’arrêtent sur leseuil sans oser s’avancer.
LANDOLF. – Oh !… pardon…
ARIALD. – Monsieur le Marquis…
Di NOLLI. – Allons, entrez ! Mais qu’ya-t-il enfin ? Que faites-vous ?
FRIDA. – Ah ! mon Dieu ! Je mesauve, je me sauve ! J’ai trop peur !
Elle se dirige vers la porte àgauche.
Di NOLLI, la retenant. – Mais non,Frida !
LANDOLF. – Monsieur le Marquis, c’est cetimbécile…
Il montre Berthold.
BERTHOLD, protestant. – Ah !non, merci ! Je ne continuerai pas à me prêter à cejeu-là ! Je m’en vais ! Je m’en vais !
LANDOLF. – Comment, tu t’en vas ?
ARIALD. – Il a tout gâté, monsieur le Marquis,en se sauvant par ici !
LANDOLF. – Oui, Il est entré enfureur ! Nous ne pouvons plus le retenir dans sachambre ! Il a donné l’ordre qu’on l’arrête et il veut, sansretard, « le juger » dans la salle du trône ! Quefaut-il que nous fassions ?
Di NOLLI. – Mais fermez ! Fermezdonc ! Allez fermer cette porte !
Landolf va fermer la porte.
ARIALD. – Ordulf tout seul ne va pas pouvoirle retenir…
LANDOLF. – Monsieur le Marquis, si l’onpouvait tout de suite lui annoncer votre visite pour détourner lecours de ses idées ?… Ces messieurs et dames ont peut-êtredéjà décidé sous quels habits ils se présenteraient à lui…
Di NOLLI. – Nous avons pensé à tout. (Audocteur.) Docteur, croyez-vous pouvoir le visiter tout desuite ?
FRIDA. – Pas moi, pas moi, Carlo ! Je meretire, et toi aussi, maman, je t’en supplie ! viens avec moi,viens avec moi !…
LE DOCTEUR. – Je… Je veux bien. Mais,dites-moi, il n’est pas armé ?
Di NOLLI. – Il n’est pas armé, docteur, iln’est pas armé ! (À Frida). Voyons, Frida, c’estenfantin ! C’est toi qui as voulu venir…
FRIDA. – Non, je proteste ! C’est mamanqui a voulu venir !
DONNA MATHILDE. – Mais moi, je suis prête à levoir. En somme, que faudra-t-il faire ?
BELCREDI. – Est-ce qu’il est vraimentnécessaire de nous déguiser ?
LANDOLF. – C’est indispensable, indispensable,messieurs ! Il y voit clair, par malheur… (Montrant soncostume.) Et s’il vous apercevait, monsieur, dans vosvêtements d’aujourd’hui !
ARIALD. – Il croirait à un travestissementdiabolique.
Di NOLLI. – Nous lui ferions l’effet d’êtredéguisés, comme ils nous font, eux ! l’effet del’être !
LANDOLF. – Cela ne serait rien, monsieur leMarquis, s’il ne s’imaginait que c’est par ordre de son plus mortelennemi.
BELCREDI. – Le PapeGrégoire VII ?
LANDOLF. – Précisément ! Il le traite depaïen !
BELCREDI. – Le Pape ? Ce n’est pasmal !
LANDOLF. – Oui, monsieur, il dit qu’ilévoquait les morts ! Il l’accuse de toutes sortes dediableries ! Il en a une peur effroyable.
LE DOCTEUR. – C’est le délire de lapersécution.
ARIALD. – Il aurait une crise !…
Di NOLLI, à Belcredi. – Ta présencen’est pas nécessaire… Nous pouvons passer à côté : il suffitque le docteur le voie.
LE DOCTEUR. – Heu… heu !… Je veux bien,mais moi tout seul ?
DI NOLLI, montrant les trois jeunesgens. – Ils seront avec vous.
LE DOCTEUR. – Heu… heu… Si madame la Marquise…peut-être…
DONNA MATHILDE. – Mais oui, je veux y êtreaussi ! Je veux le revoir !
FRIDA. – Mais pourquoi, maman ? Je t’enprie, viens avec nous !
DONNA MATHILDE, impérieuse, –Laisse-moi !… Je suis venue exprès ! (ÀLandolf.) Je serai « Adélaïde », la mère.
LANDOLF. – Ce sera parfait ! La mère del’Impératrice Berthe, parfait ! Il suffira que madame secoiffe de la couronne ducale et revête un manteau qui la couvriratout entière. (À Ariald.) Va, va, Ariald !
ARIALD. – Minute !… (Montrant ledocteur.) Et monsieur ?
LE DOCTEUR. – Ah ! oui… Vous avez parlé,je crois, d’un évêque… l’évêque Hugues de Cluny.
ARIALD. – Monsieur veut parler de l’abbé deCluny ? Ce sera parfait. Hugues de Cluny.
LANDOLF. – Il est déjà venu ici trèssouvent…
LE DOCTEUR, stupéfait. –Comment : venu ici ?
LANDOLF. – Ne craignez rien. Je veux dire quece déguisement n’était pas compliqué…
ARIALD. – On l’a employé plusieurs foisdéjà.
LE DOCTEUR. – Mais…
LANDOLF. – Il n’y a pas de danger qu’il s’ensouvienne. Il fait plus attention au vêtement qu’à la personne.
DONNA MATHILDE. – C’est parfait pour moi,cela.
Di NOLLI. – Allons-nous-en, Frida !laissons-les ! Viens avec nous, Tito !
BELCREDI. – Ah ! mais non !(Montrant la marquise.) Si elle reste, je reste aussi.
DONNA MATHILDE. – Je n’ai pas besoin devous !
BELCREDI. – Je ne dis pas le contraire… Maismoi aussi, j’aurai plaisir à le revoir. N’en ai-je pas ledroit ?
LANDOLF. – Oui, il vaut peut-être mieux quevous soyez trois.
ARIALD. – Alors, monsieur ?
BELCREDI. – Eh bien ! mais trouvez-moi unautre de ces travestis bon marché.
LANDOLF, à Ariald. – Mais oui :en moine de Cluny.
BELCREDI. – En moine de Cluny ? C’estcomment ?
LANDOLF. – Un froc de bénédictin de l’abbayede Cluny. Vous figurerez la suite de Monseigneur. (ÀAriald.) Allons, va ! (À Berthold.) Et toi aussiva-t’en ! et qu’on ne te revoie pas d’aujourd’hui !(Il les rappelle au moment où ils sortent.)Attendez ! (À Berthold.) Toi, apporte ici lesvêtements qu’Ariald va te donner ! (À Ariald.) Ettoi, va tout de suite annoncer la visite de la « duchesseAdélaïde » et de Monseigneur « Hugues de Cluny ».C’est compris ?
Ariald et Berthold sortent par la premièreporte à droite.
Di NOLLI. – Alors, nous vous laissons.
Il sort avec Frida par la porte àgauche.
LE DOCTEUR, à Landolf. – Dites-moi unpeu… Vous croyez vraiment qu’il aura plaisir à voir l’évêque Huguesde Cluny ?
LANDOLF. – Mais certainement ! Soyeztranquille. Monseigneur a toujours été reçu ici avec le plus grandrespect. Et vous aussi, madame la Marquise, vous pouvez êtretranquille. Il n’a jamais oublié que c’est grâce à vous deux qu’ila pu, à moitié mort de froid, après quarante-huit heures d’attentedans la neige, être admis au château de Canossa, en présence deGrégoire VII, qui ne voulait pas le recevoir. Il le dit biensouvent…
BELCREDI. – Et moi, s’il vous plaît ?
LANDOLF. – Vous, vous vous tiendrezrespectueusement à l’écart…
DONNA MATHILDE irritée, avecnervosité. – Vous feriez mieux de vous en aller !
BELCREDI, bas, avec colère. – Vousvoilà bien émue…
DONNA MATHILDE, avec fierté. – Jesuis comme il me plaît… Laissez-moi en paix !
Berthold entre avec lestravestissements.
LANDOLF, le voyant entrer. –Ah ! voici les costumes ! C’est le manteau pour madame laMarquise.
DONNA MATHILDE. – Attendez, j’enlève monchapeau.
Elle enlève son chapeau et le tend àBerthold.
LANDOLF. – Portez-le à côté. (À lamarquise, en faisant le geste de poser la couronne ducalesur sa tête.) Vous permettez ?
DONNA MATHILDE. – Mon Dieu ! Pas lemoindre miroir, ici ?
LANDOLF. – Il y en a un à côté. (Il montrela porte à gauche.) Si madame la Marquise veut passer parlà…
DONNA MATHILDE. – Oui, oui, cela vaudramieux ! Donnez, je reviens tout de suite.
Elle reprend son chapeau et sort, suiviede Berthold qui porte le manteau et la couronne. Pendant ce temps,le docteur et Belcredi revêtent seuls les robes debénédictins.
BELCREDI. – Devenir bénédictin, j’avoue que jene m’y attendais pas !… Cette folie me semble assezcoûteuse…
LE DOCTEUR. – Ce n’est pas la seule…
BELCREDI. – Il faut une fortune pour s’enpayer de semblables…
LANDOLF. – Nous avons ici une garde-robecomplète. Rien que des costumes de l’époque, exécutés à laperfection sur des modèles anciens. C’est moi qui en ai la charge.Je m’adresse à des tailleurs de théâtre spécialisés. Cela coûtegros.
Donna Mathilde rentre, revêtue du manteauet la couronne sur la tête.
BELCREDI, avec admiration. – Vousêtes magnifique ! Vraiment royale !
DONNA MATHILDE, regardant Belcredi etéclatant de rire. – Oh ! mon Dieu ! Non, sortezd’ici ! Vous êtes impossible ! Vous semblez une autruchehabillée en moine !
BELCREDI. – Et regardez le docteur !
LE DOCTEUR. – Évidemment… évidemment…
DONNA MATHILDE. – Mais non, le docteur estbeaucoup mieux… C’est vous, qui êtes à mourir de rire !
LE DOCTEUR, à Landolf. – Vous recevezdonc beaucoup dans cette maison ?
LANDOLF. – C’est selon. Parfois, il demandequ’on lui présente tel ou tel personnage, et alors il faut chercherdes gens qui se prêtent à la comédie. Il réclame même desfemmes…
DONNA MATHILDE, blessée et voulant lecacher. – Ah ! vraiment ! des femmesaussi ?
LANDOLF. – Autrefois surtout, oui, il enréclamait souvent.
BELCREDI, riant. – Ah ! Elle estbien bonne… En costume ? (Montrant la marquise.)Comme ça ?
LANDOLF. – Vous savez, on lui amenait desfemmes… de ces femmes qui…
BELCREDI. – Oui, des femmes faciles ! Jecomprends ! (Perfidement, à la marquise.) Prenezgarde, la chose peut devenir dangereuse pour vous !
La seconde porte à droite s’ouvre etAriald paraît. Il fait d’abord un signe pour obtenir le silence,puis il annonce solennellement :
ARIALD. – Sa Majesté l’Empereur !
Entrent les deux hommes d’armes, qui vontse poster au pied du trône ; puis, encadré par Ordulf et parAriald qui se tiennent respectueusement un peu en arrière,Henri IV. Il approche de la cinquantaine. Très pâle, déjàgrisonnant sur la nuque. Sur les tempes et, sur le haut de la tête,ses cheveux sont teints en blond, d’une façon puérile, trèsapparente. Son visage est d’une pâleur tragique, avec deux tachesde rouge sur les pommettes, pareilles à des joues de poupées. Cemaquillage est également très apparent. Henri IV revêt,par-dessus ses habits royaux, le sayon de poil de chèvre despénitents, comme à Canossa. Il a dans les yeux une fixité anxieusequi épouvante, en contraste avec son attitude qui s’efforced’exprimer l’humilité et le repentir, attitude qu’il accentued’autant plus qu’il éprouve l’injustice de son abaissement. Ordulfporte à deux mains la couronne royale, Ariald le sceptre avecl’Aigle et le globe surmonté de la croix.
HENRI IV, s’inclinant d’abord devantdonna Mathilde, puis devant le docteur. – Madame… Monseigneur…(Il regarde Belcredi et ébauche un salut, mais il l’interromptet, se tournant vers Landolf qui s’est approché, il lui demande àvoix basse, avec défiance :) C’est PierreDamien ?
LANDOLF. – Non, Majesté. C’est un moine deCluny, qui accompagne l’abbé.
HENRI IV (il recommence à considérerBelcredi avec une défiance croissante et, remarquant que celui-cise tourne avec embarras vers donna Mathilde et vers le docteur,comme pour les consulter du regard, il se redresse etcrie) : C’est Pierre Damien ! – Inutile, mon Père,de regarder la Duchesse ! (Se tournant vers donna Mathildecomme pour conjurer un danger.) Je vous jure, madame, je vousjure que mon âme est changée envers votre fille ! J’avoue ques’il (il montre Belcredi) n’était pas venu me l’interdireau nom du Pape Alexandre, je l’aurais répudiée ! Oui, il yavait quelqu’un qui favorisait cette répudiation : c’étaitl’évêque de Mayence, en échange de cent vingt domaines.(Regardant d’un air égaré Landolf.) Mais il ne faut pas,en ce moment, que je dise du mal des évêques. (Il s’approcheavec humilité de Belcredi.) Je vous suis reconnaissant,croyez-le je vous suis reconnaissant, aujourd’hui, Pierre Damien,de cette interdiction ! – Toute ma vie est un tissud’humiliations : – ma mère, Adalbert, Tribur, Goslar – etmaintenant ce sayon de poil de chèvre que vous me voyez là, sur ledos. (Changeant de ton brusquement, comme quelqu’un qui repasseson rôle, dans une parenthèse de ruse.) N’importe ! De laclarté dans les idées, de la perspicacité, une attitude ferme et dela patience quand la fortune est adverse ! (Se tournantvers les visiteurs avec une gravité convaincue.) Je saiscorriger les erreurs commises, et devant vous aussi, Pierre Damien,je m’humilie ! (Il s’incline profondément et reste courbédevant Belcredi, comme pris d’un soupçon oblique, qui grandit enlui et lui fait ajouter comme malgré lui, sur un tonmenaçant.) À condition, toutefois, que vous n’ayez pas répandule bruit infâme qu’Agnès, ma sainte mère, avait des rapportsinavouables avec l’évêque Henri d’Augsbourg.
BELCREDI (comme Henri IV reste encorecourbé en un geste de menace contre lui, porte ses mains à sapoitrine et nie.) Eh non ! ce n’est pas moi…
HENRI IV, se redressant. – Non,n’est-ce pas ? Quelle infamie ! (Il le dévisage unmoment et reprend.) Je ne vous en crois pas capable.(S’approchant du docteur et lui tirant un peu lamanche, avec un clin d’œil de ruse.) Ce sont« eux » ! Toujours les mêmes !Monseigneur !
ARIALD, bas, avec un soupir, comme poursuggérer une réponse au docteur. – Eh, oui, les évêquesravisseurs.
LE DOCTEUR, pour jouer son rôle, setournant vers Ariald. – Eh oui, ce sont eux…, toujours lesmêmes…
HENRI IV. – Rien ne leur a suffi ! –Un pauvre enfant, Monseigneur… Que fait-il ? Il passe sontemps à jouer – même quand (sans le savoir) il est roi. J’avais sixans, et ils me ravirent à ma mère, et ils se servirent de moi, quine savais rien, contre elle et contre la dynastie elle-même,profanant tout, et volant, volant, plus gloutons l’un quel’autre : Annon plus qu’Étienne, Étienne plusqu’Annon !
LANDOLF, à voix basse, persuasif, pour lerappeler à l’ordre. – Majesté…
HENRI IV, se tournant aussitôt.– Ah ! oui ! il ne faut pas, en ce moment, que je dise dumal des évêques… Mais cette infamie sur ma mère, Monseigneur, passeles bornes ! (Il regarde la marquise et s’attendrit.)Et je ne puis même pas la pleurer, madame… Je me tourne vers vous,qui devez avoir des entrailles de mère. Elle m’a rendu visite, il ya un mois environ. Elle venait de son couvent. On m’a dit qu’elleétait morte… (Une longue pause, lourde d’émotion. Il souritavec une grande tristesse.) Et je ne puis pas la pleurer…Puisque vous vous trouvez ici, et que je revêts ce sayon (ilmontre le sayon qu’il a sur le dos) cela veut dire que je n’aique vingt-six ans…
ARIALD. – Et que, par conséquent, votre mèreest encore vivante, Majesté…
ORDULF. – Toujours dans son couvent…
HENRI IV, se tournant pour lesregarder. – Oui… Je puis ajourner ma douleur à plus tard.(Montrant à la marquise, avec coquetterie, la teinture dont ila blondi ses cheveux.) Regardez : je suis encore blond…(Puis, plus bas, comme en confidence.) C’est pourvous ! – Moi, je n’en aurais pas besoin, mais les signesextérieurs ne sont pas inutiles ; ils jalonnent le temps. Vouscomprenez, Monseigneur ? (S’approchant de la marquise etregardant ses cheveux.) Mais je m’aperçois que vous aussi,Duchesse… (Il cligne de l’œil et fait de la main unsigne expressif.) Eh, vous êtes Italienne… (Comme pourdire : « hypocrite », mais sans ombre deressentiment ; au contraire avec une admirationmalicieuse.) Dieu me préserve d’en témoigner émerveillement oudégoût. – Velléités !… Nul ne veut admettre le pouvoir obscuret fatal qui limite notre volonté. Et pourtant, puisqu’on naît,puisqu’on meurt !… Naître, Monseigneur, est-ce que vous avezdemandé à naître ? Moi, non. Et entre ces deux hasards –naître et mourir – indépendants tous deux de notre volonté, combiend’autres choses encore que nous n’aurions pas voulues et auxquellesnous nous résignons à contre-cœur !
LE DOCTEUR, pour dire quelque chose, touten l’étudiant attentivement. – Eh oui,malheureusement !
HENRI IV. – Quand nous refusons de nousrésigner, les velléités apparaissent. Une femme qui veut être unhomme… un vieillard qui veut être jeune… Velléités, velléités,chimères ridicules, c’est certain. Mais réfléchissez, Monseigneur,toutes nos autres velléités ne sont pas moins ridicules, même quandelles ne débordent pas les limites du possible humain. Nul mensongepourtant, nulle fiction de notre part. Nous sommes, de bonne foi,immobilisés dans une noble idée de nous-mêmes. Vous, par exemple,Monseigneur, vous êtes là, vous ne bougez plus, vous vous agrippezà deux mains à votre saint vêtement, et vous ne prenez pas gardequ’il glisse de vos manches, qu’il coule de vos manches quelquechose, comme un serpent : c’est la vie ! Ah ! quellesurprise, quand, soudain, vous apercevez là, dressée devant vous,cette vie qui s’est échappée de vous-même. Quelle colère, quellerage contre vous-même ! Ou bien quels remords, oui, quelsremords !… Ah ! si vous saviez, j’ai trouvé devant moitant de remords !… Avec un visage qui était le mien, mais siaffreux que je ne pouvais le regarder en face… (Il s’approchede la marquise.) Cela ne vous est-il jamais arrivé,Madame ? Vous rappelez-vous vraiment avoir toujours été lamême ? Un jour, pourtant, Dieu… comment avez-vous pu fairecela… (Il la fixe d’une façon si aiguë qu’elle est près des’évanouir.) Oui, « cela », vous savez quoi… nousnous comprenons, oh ! soyez tranquille, je ne le dirai àpersonne ! Et vous, Pierre Damien, vous, l’ami de cethomme…
LANDOLF, bas. – Majesté…
HENRI IV, vite. – Non, non, jene prononcerai pas son nom ! Je sais qu’il le supportemal ! (Se tournant vers Belcredi, comme en aparté.)Quelle opinion ? quelle opinion aviez-vous de lui ?… Iln’en est pas moins vrai que nous nous obstinons tous dans l’idéeque nous nous faisons de nous-mêmes, tout comme, en vieillissant,nous teignons nos cheveux. Peu importe que la teinture de mescheveux ne puisse pas être pour vous une réalité, si du moins, pourmoi, elle est un tout petit peu réelle. – Vous, madame, vous neteignez certainement pas vos cheveux pour tromper les autres, nivous-même, mais simplement pour tromper un peu, un tout petit peu,votre image au miroir. Moi, je me teins pour rire. Vous, vous vousteignez pour de bon, mais vous avez beau le faire sérieusement,vous n’en êtes pas moins masquée, vous aussi, madame. Oh ! jene parle pas de la vénérable couronne qui ceint votre front… Jem’incline devant elle. Je ne parle pas de votre manteauducal ; je parle uniquement du souvenir de vos cheveux blondsque vous avez voulu fixer sur vous artificiellement, parce que vousvous complaisiez autrefois à être blonde… ou bien du souvenir devos cheveux bruns, si vous étiez brune. Ce souvenir, vous le fixezsur vous comme un masque pour retenir l’image de votre jeunesse quia fui. Pour vous, Pierre Damien, c’est le contraire : lesouvenir de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, renaîtaujourd’hui avec la figure des réalités passées, et vous avezl’impression, n’est-il pas vrai ? d’un cauchemar. Et pour moiaussi, c’est comme un rêve : tant de réalités inexplicables… àbien y repenser… Bah ! il n’y a rien là d’étonnant, PierreDamien ; demain, il en sera ainsi de notre vied’aujourd’hui ! (Se mettant soudain en colère et crispantses mains sur son sayon.) Ce sayon ! (Avec une joiepresque féroce, faisant le geste de l’arracher, tandis qu’Ariald,Landolf, Ordulf se précipitent, épouvantés, comme pour l’enempêcher.) Ah ! Dieu du ciel ! (Il recule et,enlevant son sayon, il leur crie.) Demain, à Bressanone,vingt-sept évêques allemands et lombards signeront avec moi ladestitution du pape Grégoire VII, qui n’est pas le SouverainPontife, mais qui n’est qu’un faux moine !
ORDULF et ses trois compagnons leconjurant de se taire. – Majesté, Majesté, au nom duSeigneur !
ARIALD, l’invitant par gestes à endosserde nouveau le sayon. – Prenez garde à ce que vousdites !
LANDOLF. – Monseigneur est ici avec laDuchesse pour intercéder en votre faveur !
Il fait des signes pressants au docteurpour l’inviter à dire sans tarder quelque chose.
LE DOCTEUR, égaré. – Effectivement,oui, nous sommes ici pour intercéder…
HENRI IV, pris d’un repentir subit,presque épouvanté, se laissant remettre par ses trois vassaux lesayon sur les épaules et le serrant contre lui de ses mainsconvulsées. – Pardon… Oh, oui… pardon, pardon,Monseigneur ; pardon, madame… Je sens, je vous le jure, jesens tout le poids de l’anathème ! (Il se courbe, plongesa tête dans ses mains, comme dans l’attente de quelque chose quiva l’écraser. Il reste un instant ainsi, puis, d’une voix toutedifférente, sans bouger, il dit tout bas en confidence à Landolf, àAriald et à Ordulf.) Je ne sais pourquoi, aujourd’hui, je neréussis pas à me montrer humble devant celui-là !
Il indique Belcredi.
LANDOLF, à voix basse. – Maispourquoi, Majesté, vous obstinez-vous à croire que c’est PierreDamien ? Ce n’est pas lui.
HENRI IV, regardant en dessous aveccrainte. – Ce n’est pas Pierre Damien ?
ARIALD. – Mais non, ce n’est qu’un pauvrepetit moine, Majesté !
HENRI IV, avec une exaspérationcontenue et douloureuse. – Personne ne peut mesurer la portéede ses actes, quand il agit par instinct… Vous, madame, vous pouvezpeut-être me comprendre mieux que les autres… Vous êtes femme etduchesse. Nous sommes à une heure solennelle et décisive. Jepourrais, sachez-le, en ce moment même où je vous parle, accepterl’appui des évêques lombards et m’emparer du Pontife enl’assiégeant ici, dans son château, courir à Rome, élire unantipape, tendre la main à l’alliance de Robert Guiscard. –Grégoire VII serait perdu ! Je résiste à cette tentationet, croyez-le, je suis sage. Je comprends mon époque et la majestéde cet homme qui sait être ce qu’il doit : un pape digne de cenom. Si vous riez de moi en me voyant ainsi humilié, vous êtesstupides, vous ne comprenez pas que la sagesse politique meconseille de revêtir aujourd’hui cet habit de pénitent. Je vous disque les rôles, demain, pourraient être intervertis ! Et queferiez-vous alors ? Ririez-vous, par hasard, d’un papeprisonnier ? – Non. – Nous serions quittes. – Je suis déguiséaujourd’hui en pénitent ; lui le serait demain en prisonnier.Mais malheur à qui ne sait pas porter son masque, que ce soit lemasque d’un roi ou celui d’un pape. – Peut-être est-il, en cemoment, un peu trop cruel : oui, sans doute. Pensez, madame,que Berthe, votre fille, envers qui, je vous le répète, mon âme estchangée (il se tourne brusquement vers Belcredi et lui crie auvisage, comme si Belcredi avait nié) changée, changée, à causede l’affection, du dévouement dont elle a su me donner les preuvesdans ce terrible moment ! (Il se tourne vers lamarquise.) Elle m’a accompagné à Canossa, madame ; elleest en bas, dans la cour ; elle a voulu me suivre, comme unemendiante ; elle est demi-morte de froid, après ces deux nuitspassées dehors, sous la neige ! Vous êtes sa mère ! Vosentrailles devraient tressaillir de pitié, et vous devriez vousunir à lui (il montre le docteur) pour implorer duSouverain Pontife notre pardon : qu’il nous reçoive !
DONNA MATHILDE, tremblante, avec un filetde voix. – Mais oui, oui, tout de suite…
LE DOCTEUR. – C’est ce que nous allonsfaire !
HENRI IV. – Autre chose encore !Autre chose ! (Il les fait approcher de lui et leur dittout bas, en grand secret.) Il ne suffit pas qu’il me reçoive.Vous savez qu’il peut tout. Je dis « tout ». Il peut mêmeévoquer les morts ! (Il se frappe la poitrine.) Mevoici ! Vous me voyez ! Aucun secret de sorcellerie nelui est inconnu. Eh bien, Monseigneur, madame, voilà ma vraiecondamnation. Regardez ! (Il montre son portrait pendu aumur, presque avec effroi.) Ne plus pouvoir me délivrer de cetensorcellement ! Me voici pénitent, et je le resterai !Je vous jure que tel je resterai tant qu’il ne m’aura pas reçu.Mais vous devriez, tous les deux, quand il aura levé monexcommunication, implorer autre chose du Pape : qu’il medétache de là. (Il montre de nouveau son portrait.) Qu’ilme laisse vivre ma pauvre vie, toute ma vie, dont j’ai été exclu…On ne peut pas toujours avoir vingt-six ans, madame ! Et jevous le demande aussi pour votre fille : pour que je puissel’aimer comme elle le mérite. (Vous avez vu les bonnes dispositionsoù je me trouve, attendri comme je le suis maintenant par sapitié.) Voilà, c’est cela qu’il faut lui demander. Mon sort estentre vos mains… (Il salue.) Madame !Monseigneur !
Et il se retire, en saluant, repasse laporte par où il est entré, les laissant tous dans la stupeur. Pourla marquise, elle est si profondément émue qu’à peine Henri IVdisparu, elle se laisse aller sur un siège, presqueévanouie.
Rideau.
ACTE DEUXIÈME
Une autre pièce de la villa, contiguë à lasalle du trône. Austère mobilier antique. Au fond, la porte duvestibule. À gauche, deux fenêtres qui donnent sur le jardin ;à droite une porte qui conduit à la salle du trône. Tard dansl’après-midi, le même jour.
Donna Mathilde, le docteur et TitoBelcredi sont en scène. Ils sont en train de causer, mais DonnaMathilde reste à l’écart, sombre, visiblement excédée par ce quedisent les deux interlocuteurs. Pourtant, elle ne peut s’empêcherde prêter l’oreille à leurs propos. Dans l’état d’agitation où ellese trouve, tout l’intéresse malgré elle, en l’empêchant de sereplier sur elle-même pour mûrir le projet plus fort qu’elle, quila tente. Les paroles des deux autres attirent son attention, carelle sent instinctivement le besoin d’être retenue à ce momentprécis.
BELCREDI. – Vous avez sans doute raison, moncher docteur, mais je vous ai fait part de mon impression.
LE DOCTEUR. – Je ne la conteste pas, mais jecrois que ce n’est qu’une simple impression…
BELCREDI. – Comment… Mais enfin, il a tout demême été jusqu’à dire la chose clairement ! (Se tournantvers la marquise.) N’est-ce pas, marquise ?
DONNA MATHILDE, se retournant. –Qu’est-ce qu’il a dit ? (Se refusant à approuverBelcredi.) Ah, oui… Mais ce n’est pas du tout pour la raisonque vous croyez.
LE DOCTEUR. – Il voulait parler des habits quenous endossions (il montre la marquise), du manteau demadame, de nos frocs de bénédictins. Tout cela était puéril.
DONNA MATHILDE, brusquement, se tournantavec colère. – Puéril ? Que dites-vous ?docteur ?
LE DOCTEUR. – Puéril, oui, dans un sens… Oui…Permettez, Marquise, que je vous explique… Puéril dans un sens,mais d’autre part beaucoup plus compliqué que vous ne pouvezl’imaginez.
DONNA MATHILDE. – Pour moi, c’est au contrairetout ce qu’il y a de plus clair.
LE DOCTEUR, avec le sourire de pitié del’homme compétent pour les profanes. – Eh ! oui !…Il faut connaître cette psychologie spéciale des fous qui fait –prenez-y garde – qu’un fou peut, sans aucun doute possible,s’apercevoir d’un déguisement, se rendre parfaitement compte quec’est un déguisement et pourtant, messieurs, y croire sans réserve,tout à fait comme les enfants pour qui un déguisement est à la foisun jeu et une réalité. Voilà pourquoi j’ai parlé de puérilité. Maisce qu’il y a d’autre part d’extrêmement compliqué, c’est qu’il aconscience, qu’il doit avoir parfaitement conscience d’être pourlui-même, devant lui-même, une image, cette image-là !
Il fait allusion au portrait de la salledu trône et fait signe vers sa gauche.
BELCREDI. – Il l’a dit !
LE DOCTEUR. – Parfaitement ! – Il est uneimage devant laquelle se sont présentées d’autres images : lesnôtres ; comprenez-vous ? Dans son délire, – délire aiguet extrêmement lucide, – il a pu remarquer tout de suite unedifférence entre son image et les nôtres. Il a pu remarquer qu’il yavait en nous, dans nos images, une simulation, et cela l’a mis endéfiance. La défiance des fous est sans cesse en éveil… Mais c’estlà tout. Notre jeu répondant au sien n’a pu lui sembler inspiré parla pitié, et son jeu nous a paru à nous d’autant plus tragique que,comme pour nous braver – comprenez-vous ? – poussé par sadéfiance, il a précisément voulu le dénoncer, comme un jeu ;mais oui, il a voulu nous faire croire qu’il jouait en seprésentant à nous avec un peu de teinture sur les cheveux et demaquillage sur les joues, et en nous disant qu’il se teignait,qu’il se fardait exprès, pour rire !
DONNA MATHILDE, éclatant. – Non, cen’est pas cela, docteur ! Ce n’est pas cela !
LE DOCTEUR. – Comment, pas cela ?
DONNA MATHILDE, prompte, avecénergie. – Je suis parfaitement sûre qu’il m’areconnue !
LE DOCTEUR. – Impossible… C’estimpossible…
BELCREDI, en même temps. – Allonsdonc !
DONNA MATHILDE, avec plus d’énergieencore, hors d’elle-même. – Il m’a reconnue, vousdis-je ! Quand il s’est approché de moi pour me parler, detout près, il m’a regardée dans les yeux, oui, il a plongé sonregard dans le mien, et il m’a reconnue !
BELCREDI. – Il parlait de votre fille…
DONNA MATHILDE. – Ce n’est pas vrai ! Ilparlait de moi ! de moi !
BELCREDI. – Oui, peut-être quand il aparlé…
DONNA MATHILDE, sans aucune pudeur. –De mes cheveux teints ! Vous n’avez pas remarqué qu’il aajouté tout de suite : « Ou bien le souvenir de voscheveux bruns, si vous étiez brune. » Il s’est rappeléparfaitement qu’à cette époque-là j’étais brune.
BELCREDI. – Allons donc ! Allonsdonc !
DONNA MATHILDE, sans l’écouter, setournant vers le docteur. – Mes cheveux, docteur, sontnaturellement bruns, comme ceux de ma fille, et voilà pourquoi ils’est mis à parler d’elle !
BELCREDI. – Mais il ne la connaît pas, votrefille ! Il ne l’a jamais vue !
DONNA MATHILDE. – Précisément ! Vous necomprenez rien ! Ma fille, pour lui, c’est moi, moi telle quej’étais à cette époque !
BELCREDI. – Oh ! mais son mal estcontagieux, vous êtes atteinte !
DONNA MATHILDE, bas, avec mépris. –Imbécile !
BELCREDI. – Permettez : avez-vous jamaisété sa femme ? Votre fille, dans son délire, est safemme : Berthe de Suse.
DONNA MATHILDE, – Mais parfaitement ! Jeme suis présentée à lui, non plus brune – comme il m’avait gardéedans son souvenir, – mais blonde, en disant que j’étais Adélaïde,la mère. Ma fille n’existe pas pour lui, il ne l’a jamais vue, vousl’avez dit vous-même. Comment pourrait-il donc savoir si elle estblonde ou brune ?
BELCREDI. – Il a parlé d’une femme brune engénéral, mon Dieu ! d’une femme quelconque – brune ou blonde –qui cherche à retenir le souvenir de sa jeunesse dans la couleur deses cheveux ! Et voilà qu’à votre habitude, vous vous mettez àimaginer je ne sais quoi ! Docteur, elle dit que je n’auraispas dû la suivre. C’est elle qui aurait mieux fait des’abstenir !
DONNA MATHILDE, un moment abattue par laremarque de Belcredi, réfléchit, puis se reprenant, mais avecquelque irritation, parce qu’elle est dans le doute. – Non…non… Il parlait de moi… Il a constamment parlé avec moi et demoi…
BELCREDI. – Ah ! çà, par exemple !Il ne m’a pas laissé souffler une minute, et vous prétendez qu’iln’a parlé que de vous ? C’était encore de vous qu’il parlaitquand il s’adressait à Pierre Damien !
DONNA MATHILDE, avec défi, bannissanttoute retenue. – Et pourquoi pas ? – Sauriez-vous me direpourquoi, dès le premier instant, il a senti de l’aversion pourvous et rien que pour vous ?
La demande sera faite sur un tel ton quela réponse explicite devrait être : « Parcequ’il a compris que vous êtes mon amant ! » –Belcredi le comprend si bien qu’il reste interdit, sansrépondre.
LE DOCTEUR. – Je vous demande pardon, mais laraison pourrait bien être dans ce fait qu’on lui avait annoncé lavisite de la duchesse Adélaïde et de l’abbé de Cluny. En voyant unetierce personne, qu’on ne lui avait pas annoncée, sa méfiance s’esttout de suite…
BELCREDI. – Parfaitement ! C’est saméfiance qui lui a fait voir en moi un ennemi : PierreDamien ! – Mais elle s’est mis dans la tête qu’il l’areconnue…
DONNA MATHILDE. – Il n’y a pas de doute… Sesyeux me l’ont dit, docteur… Il y a des regards qui ne trompentpas !… Ce ne fut peut-être que l’espace d’une seconde !Que voulez-vous que je vous dise ?
LE DOCTEUR. – C’est… c’est bienpossible : un éclair de lucidité…
DONNA MATHILDE. – Peut-être… Et alors, sesparoles m’ont paru pleines du regret de ma jeunesse et de lasienne, lui qui, depuis cet horrible accident, vit enfermé sous cemasque qu’il n’a jamais pu quitter, et qu’il veut quitteraujourd’hui, – il l’a dit expressément !
BELCREDI. – Oui ! Pour pouvoir aimervotre fille. Ou vous-même – comme vous vous l’imaginez, – parce quevotre pitié l’a attendri.
DONNA MATHILDE. – Ma pitié pour lui estinfinie…
BELCREDI. – Cela se voit, Marquise ! Elleest si grande qu’un thaumaturge en attendrait sans nul doute unmiracle.
LE DOCTEUR. – Permettez… Je ne fais pas demiracles ; je suis un médecin, et non un thaumaturge. J’aiprêté la plus grande attention à tout ce qu’il a dit, et je vousrépète que l’élasticité analogique, qui est la marque de toutdélire spécifique, me paraît chez lui très… comment dire ?très relâchée. Je m’explique : les éléments de son délire neforment plus un tout solide. J’ai l’impression qu’il a de la peineà se maintenir dans le personnage qu’il a revêtu, et cela à causede brusques appels qui l’arrachent – symptôme très réconfortant –qui l’arrachent, non pas à un état d’apathie naissante, mais à unétat d’acceptation et d’accommodation pour le plonger dans un étatde réflexion mélancolique… qui témoigne vraiment d’une activitécérébrale considérable. Je le répète, c’est un symptôme trèsréconfortant. Eh bien, si grâce au moyen violent que nous avonspréparé…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lafenêtre, du ton d’un malade qui geint. – Mais comment cetteautomobile n’est-elle pas encore de retour ? Il y a plus detrois heures et demie…
LE DOCTEUR. – Vous dites ?
DONNA MATHILDE. – Cette automobile, docteur…Il y a plus de trois heures et demie qu’elle est partie !
LE DOCTEUR, tirant sa montre de sa pocheet la consultant – Il y a même plus de quatreheures !
DONNA MATHILDE. – Ils pourraient être icidepuis une demi-heure au moins !… mais c’est commetoujours…
BELCREDI. – Ils n’ont peut-être pas retrouvéla robe…
DONNA MATHILDE. – C’est impossible… Je leur aiindiqué, avec toutes les précisions nécessaires, où était enferméecette robe ! (Elle est très impatiente.) Mais, Frida…Où est Frida ?…
BELCREDI, se penchant à la fenêtre. –Peut-être au jardin, avec Carlo.
LE DOCTEUR. – Il doit la persuader de dominersa peur…
BELCREDI. – Mais elle n’a pas peur,docteur ; ne croyez pas cela ! Elle s’ennuie…
DONNA MATHILDE. – Faites-moi le plaisir de nepas la supplier ! Je sais comment elle est faite !
LE DOCTEUR. – Attendons patiemment. Nous n’enavons plus pour longtemps, et il faut que la chose ait lieu denuit… Il suffira d’un moment. Si nous parvenons à l’ébranler, àrompre d’un coup, par ce choc violent, le fil déjà usé qui lerattache encore à sa folie, en lui rendant ce qu’il demandelui-même (vous l’avez entendu : « On ne peut pas toujoursavoir vingt-six ans, Madame ! »), oui, en le libérant decet emprisonnement auquel il se sent condamné : en somme, sinous obtenons qu’il retrouve d’un coup la conscience de ladurée…
BELCREDI. – Il sera guéri !(Ironiquement, une syllabe après l’autre.) Nous allonsl’arracher à son image !
LE DOCTEUR. – Nous pouvons tout au moinsespérer le remettre en marche, comme une montre qui s’est arrêtée àune certaine heure. Nous serons là, avec nos montres à la main, etnous attendrons que l’heure fatale sonne de nouveau. Nous donneronsun bon coup, comme cela, et espérons qu’il se remettra à marquerles heures de sa vie, après ce long arrêt.
À ce moment, le marquis Carlo di Nollientre par le fond.
DONNA MATHILDE. – Ah ! Carlo… EtFrida ? Où est-elle passée ?
Di NOLLI. – Elle vient tout de suite.
LE DOCTEUR. – L’automobile estarrivée ?
Di NOLLI. – Mais oui.
DONNA MATHILDE. – Ah oui ? Et ils ontapporté la robe ?
Di NOLLI. – La robe est là depuis un grandmoment.
LE DOCTEUR. – Alors, c’est parfait !
DONNA MATHILDE, frémissante. – Oùest-elle ? Où est-elle ?
Di NOLLI, haussant les épaules et sourianttristement, comme quelqu’un qui joue mal volontiers un rôle dansune farce hors de saison. – Mais vous allez la voir… (Ilmontre l’entrée.) La voici…
Berthold se présente sur le seuil de laporte du fond, et annonce solennellement :
BERTHOLD. – Son Altesse la marquise Mathildede Canossa !
Frida entre magnifiquement belle. Ellea revêtu le vieux déguisement de sa mère, et elle prêtevie à l’image peinte dans la salle du trône.
FRIDA, s’approchant de Berthold, quis’incline, avec une hauteur méprisante. – De Toscane, deToscane, je vous prie ! Canossa est un de mes châteaux.
BELCREDI, avec admiration. – Maisregardez donc ! Ce n’est plus elle !
DONNA MATHILDE. – Ce n’est plus elle !…C’est moi… Vous voyez… Oh ! mon Dieu !… Arrête,Frida !… Vous la voyez ! C’est mon portrait…vivant !
LE DOCTEUR. – Oui, oui… C’est parfait !Parfait ! C’est le portrait même !
BELCREDI. – Il n’y a pas à dire… C’estvraiment le portrait ! Ah, quel type !
FRIDA. – Ne me faites pas rire !J’éclate, vous savez !… Quelle taille mince tu avais,maman ! J’ai failli étouffer en m’agrafant !
DONNA MATHILDE, à bout de nerfs,arrangeant les plis de la robe. – Viens un peu… Ne bouge plus…Ces plis… Tu es vraiment si serrée ?
FRIDA. – J’étouffe ! Dépêchons, je vousen prie…
LE DOCTEUR. – Mais il faut attendre lanuit…
FRIDA. – Je n’y tiens déjà plus… Je nerésisterai jamais jusqu’à ce soir !
DONNA MATHILDE. – Mais pourquoi t’es-tuhabillée si tôt ?
FRIDA. – Eh ! quand j’ai vu cetterobe ! La tentation ! Irrésistible…
DONNA MATHILDE. – Tu aurais au moins pum’appeler ! Je t’aurais aidée… Ce bliaud est tout froissé, monDieu !…
FRIDA. – Je l’ai bien vu, maman. Mais ce sontdes plis si invétérés… Il ne serait pas possible de les fairedisparaître…
LE DOCTEUR. – Peu importe, Marquise !L’illusion est parfaite. (S’approchant et invitant la marquiseà se placer devant sa fille, sans toutefois la cacher.) Vouspermettez ? Vous vous placerez comme cela… oui, a une certainedistance… un peu plus en avant…
BELCREDI. – Pour bien donner la conscience dela durée…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lui, dubout des lèvres. – Vingt ans passés ! Un vrai désastre,hein ?
BELCREDI. – N’exagérons rien !
LE DOCTEUR, très embarrassé, pour rompreles chiens. – Non, non ! Ce que j’en disais, c’était pourl’habit… c’était pour voir…
BELCREDI, riant. – Mais entre cesdeux robes, Docteur, ce n’est pas vingt ans, c’est huit cents ansqu’il y a ! Un véritable abîme ! Vous voulez vraiment luifaire sauter huit cents ans d’un coup ? (Montrant d’abordFrida, puis la marquise.) Pensez-y bien, messieurs ; jeparle sérieusement : pour nous, il s’agit de vingt ans, dedeux robes et d’une mascarade. Mais si vraiment, comme vous ledisiez, Docteur, le temps s’est arrêté pour lui, en lui et autourde lui, s’il vit (montrant Frida) avec elle, il y a huitsiècles, le vertige du saut que vous allez lui imposer sera tel quequand il retombera au milieu de nous… (Le docteur du doigt faitsigne que non.) Vous dites que non ?
LE DOCTEUR. – Pas du tout. La vie, mon cherBaron, se réajuste ! Dans le cas présent, notre vie reprendraaussitôt sa réalité, pour lui comme pour nous, et elle lui rendraaussitôt l’équilibre, en lui arrachant d’un coup son illusion et enlui découvrant que ces huit cents années furent à peinevingt ! Il en sera comme de certains trucs, comme, parexemple, du saut dans le vide des initiations maçonniques ;cela semble un monde et, au bout du compte on a descendu une marched’escalier.
BELCREDI. – Oh ! quelle découverte !Mais parfaitement ! – Regardez Frida et la marquise,docteur ! – Qui est le plus en avance ? – C’est nous,docteur, nous les vieux ! Nos cadets se croient en avance surnous, ils se trompent : nous sommes plus avancés qu’eux,puisque le temps est plus à nous qu’à eux.
LE DOCTEUR. – Oui, si le passé ne nouséloignait pas !
BELCREDI. – Mais pas du tout ! Nouséloigner de quoi ? (Il montre Frida et di Nolli.) Euxont encore à faire ce que nous avons déjà fait, docteur : ilsont à vieillir, en refaisant à peu près les mêmes sottises quenous… L’illusion, c’est de croire qu’on quitte la vie par une portequi se trouve en avant de nous ! C’est faux ! Dès notrenaissance, nous commençons à mourir ; celui qui a commencé lepremier à vivre est le plus jeune de tous. Le plus jeune des hommesc’est le père Adam ! Regardez (il montreFrida) : La marquise Mathilde de Toscane est de huitsiècles plus jeune que nous tous.
Il s’incline profondément devantelle.
Di NOLLI. – Je t’en prie, je t’en prie,Tito : ne plaisantons pas.
BELCREDI. – Où as-tu vu que jeplaisantais…
Di NOLLI. – Mais oui, depuis que nous sommesarrivés…
BELCREDI. – Comment ! J’ai été jusqu’àm’habiller en bénédictin. »
Di NOLLI. – En fait de chose sérieuse…
BELCREDI. – Si la chose a été sérieuse pourles autres comme en ce moment, par exemple, pour Frida, pourquoi nel’aurait-elle pas été pour moi ?… (Se tournant vers ledocteur.) Je vous jure, docteur, que je ne comprends pasencore ce que vous voulez faire.
LE DOCTEUR, ennuyé. – Mais vous leverrez bien ! Je ne vous demande qu’un peu de crédit… Lamarquise n’est pas encore habillée comme elle doit l’être…
BELCREDI. – Ah ! elle doit aussi sedéguiser…
LE DOCTEUR. – Mais naturellement ! Elleva mettre une robe pareille à celle-ci, qui se trouve dans lagarde-robe du château, pour les jours où il souhaite la présence dela marquise Mathilde de Canossa…
FRIDA, qui cause bas avec di Molli,s’apercevant de l’erreur du docteur. – De Toscane ! DeToscane !
LE DOCTEUR. – C’est la même chose !
BELCREDI. – Ah ! je comprends ! Ilva se trouver en présence de deux Mathildes ?…
LE DOCTEUR. – Précisément. De deux, etalors…
FRIDA, l’appelant à l’écart. – Venezm’expliquer, Docteur.
LE DOCTEUR. – Je suis à vous !
Il s’approche des deux jeunes gens et leurdonne des explications.
BELCREDI, bas, à donna Mathilde. –Vous voulez donc…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lui,impassible. – Quoi ?
BELCREDI. – Vous lui portez vraiment tantd’intérêt ! Au point de vous prêter à cette comédie ?C’est énorme pour une femme !
DONNA MATHILDE. – Pour une femmequelconque !
BELCREDI. – Mais non, ma chère, pourtoutes ! C’est une abnégation…
DONNA MATHILDE. – Je le lui doisbien !
BELCREDI. – Mais ne mentez donc pas !Vous savez bien que vous ne vous abaissez pas !
DONNA MATHILDE. – Pourquoi parlez-vousd’abnégation, alors ?
BELCREDI. – Vous ne vous avilirez pas aux yeuxdes autres, mais vous vous avilirez assez pour m’offenser,moi !
DONNA MATHILDE. – Il s’agit bien de vous en cemoment !
Di NOLLI, s’avançant. – Bien, bien,voici donc comment nous ferons… (S’adressant à Berthold.)Vous, allez m’appeler un de vos trois camarades !
BERTHOLD. – Tout de suite !
Il sort par le fond.
DONNA MATHILDE. – Mais il faut d’abord quenous prenions congé de lui !
Di NOLLI. – Précisément ! Je le faisappeler pour préparer votre départ. (À Belcredi.) Toi, tupeux t’en dispenser : reste ici !
BELCREDI, hochant la tête avecironie. – Mais oui, je m’en dispense… je m’en dispense trèsvolontiers…
Di NOLLI. – Il vaut mieux ne pas éveillerencore sa défiance, comprends-tu ?
BELCREDI. – Mais oui ! Je suis unequantité négligeable !
LE DOCTEUR. – Il faut lui donner la certitudeabsolue que nous quittons le château.
Landolf, suivi de Berthold, entre par laporte à droite.
LANDOLF. – Je vous demande pardon !
Di NOLLI. – Entrez ! Entrez ! C’estbien vous Lolo, n’est-ce pas ?
LANDOLF. – Lolo ou Landolf, auchoix !
Di NOLLI, – Bien. Écoutez : Le docteur etmadame la Marquise vont prendre congé tout de suite.
LANDOLF. – Rien de plus facile. Il suffira dedire qu’ils ont obtenu sa grâce et que le Pape consent à lerecevoir. Il est là-bas, dans sa chambre, en train de gémir. Il serepent de tout ce qu’il a dit, et il est désespéré à l’idée qu’iln’obtiendra pas sa grâce. Si vous voulez bien me suivre et prendrela peine de remettre les habits que vous portiez tout àl’heure…
LE DOCTEUR. – Nous vous suivons…
LANDOLF. – J’y pense. Je me permets de voussuggérer une chose ; c’est d’ajouter que la marquise Mathildede Toscane, a comme vous, réclamé sa grâce au SouverainPontife.
DONNA MATHILDE. – Ah ! Vous voyez bienqu’il m’a reconnue !
LANDOLF. – Je vous demande pardon. Ce n’estpas pour cela : c’est qu’il redoute terriblement l’aversion dela marquise, qui a accueilli le Pape dans son château. C’est unechose étrange… Dans l’histoire, que je sache (mais ces messieurs etdames le savent certainement mieux que moi) il n’est pas dit dutout, n’est-ce pas, qu’Henri IV aimât secrètement la marquisede Toscane ?
DONNA MATHILDE, promptement. – Non,pas du tout ! Il n’y a rien de cela ! C’est même tout lecontraire !
LANDOLF. – C’est bien ce qui me semblait maislui dit qu’il l’a aimée – il ne cesse de le répéter… Et il redouteaujourd’hui que la colère de la marquise, à cause de cet amoursecret, n’agisse contre lui sur l’esprit du Souverain Pontife.
BELCREDI. – Et il faut lui faire comprendreque cette aversion n’existe plus !
LANDOLF. – C’est cela !Parfaitement !
DONNA MATHILDE, à Landolf. – C’esttrès bien ! Oui. (À Belcredi.) L’histoire ditprécisément, vous l’ignorez peut-être, que le Pape consentit à lerecevoir sur les prières de la marquise Mathilde et de l’abbé deCluny. Et je vous dirai même, mon cher Belcredi, qu’au moment de lacavalcade – je pensais me servir de ce fait pour lui prouver que jen’étais pas son ennemi autant qu’il se l’imaginait.
BELCREDI. – Mais alors, c’est parfait, machère marquise ! Vous n’avez qu’à vous conformer àl’histoire !…
LANDOLF. – Madame pourrait très bien éviter undouble déguisement et se présenter tout de suite, avec monseigneur(il montre le docteur), vêtue en marquise de Toscane.
LE DOCTEUR, promptement, avec force.– Non, non ! Pas cela, je vous en prie ! Cela démoliraittout mon plan ! L’impression que doit provoquer laconfrontation doit être brusque, foudroyante. Non, non, marquise,venez avec moi : vous vous présenterez encore à lui enduchesse Adélaïde, mère de l’impératrice, et nous prendrons congé.Il est avant tout nécessaire qu’il croie que nous avons quitté ceslieux. Allons, ne perdons plus de temps : nous avons encoremille choses à préparer.
Le docteur, donna Mathilde et Landolfsortent par la porte à droite.
FRIDA. – Voilà que je recommence à avoirpeur…
Di NOLLI. – Encore, Frida ?
FRIDA. – Il aurait mieux valu que je le vissetout à l’heure…
Di NOLLI. – Je t’assure qu’il n’y a vraimentpas de quoi avoir peur !…
FRIDA. – Il n’est pas fou furieux, c’estsûr ?
Di NOLLI. – Mais non, c’est le fou le plustranquille qui soit.
BELCREDI, avec une ironique affectationsentimentale. – Un fou mélancolique !… Tu n’as donc pasentendu ! Il est fou de toi.
FRIDA. – Merci beaucoup ! C’estprécisément ce qui m’effraie !
BELCREDI. – Il ne cherchera pas à te faire demal…
Di NOLLI. – Ce sera l’affaire d’uninstant…
FRIDA. – Oui, mais me trouver dansl’obscurité ! avec lui…
Di NOLLI. – Il ne s’agit que d’une minute… etpuis, ne serai-je pas près de toi. Tout le monde restera derrièreles portes, aux aguets, prêt à accourir. Dès qu’il verra ta mèredevant lui, comprends-tu ? ton rôle sera terminé…
BELCREDI. – Voulez-vous savoir quelle est macrainte à moi : c’est qu’on ne donne un coup d’épée dansl’eau.
Di NOLLI. – Ne recommence pas ! Le remèdeme paraît efficace !
FRIDA. – À moi aussi, à moi aussi ! Je lesens rien qu’à la façon dont je frémis déjà moi-même !
BELCREDI. – Mais les fous, mes chers amis –(malheureusement ils l’ignorent) – possèdent un bonheur dont nousavons tort de ne pas tenir compte…
Di Nolli, agacé. – Qu’est-ce que tunous chantes avec leur bonheur ?
BELCREDI, avec force. – Ils neraisonnent pas !
Di Nolli, l’interrompant avecimpatience. – Mais le raisonnement n’a rien à voirlà-dedans !
BELCREDI. – Comment ! N’est-ce pas unraisonnement qu’il devrait faire – selon nous – en la voyant(il montre Frida) et en voyant sa mère ? Ceraisonnement, nous l’avons nous-mêmes construit d’avance.
Di NOLLI. – Pas du tout ! Il ne s’agitpas d’un raisonnement ! Nous lui présentons, comme le dit ledocteur, une double image de la fiction où il s’est enfermé.
BELCREDI, avec éclat, brusquement. –Écoute : je n’ai jamais compris pourquoi ces gens-là prennentleur doctorat en médecine !
Di NOLLI, ne comprenant pas. – Quidonc ?
BELCREDI. – Les aliénistes.
Di NOLLI. – Et quel doctorat veux-tu qu’ilsprennent ?
FRIDA. – Puisqu’ils sont médecinsaliénistes ?
BELCREDI. – Précisément… Ils devraient prendreleur doctorat en droit ! Chez eux, tout est purbavardage ! Mieux un psychiatre sait parler, meilleur ilest ! « L’élasticité analogique », « laconscience de la durée » ! Et par-dessus le marché, ilsont le toupet de dire qu’ils ne font pas de miracles… Maisprécisément, ce sont des miracles qu’il faudrait ! Ah !ils savent bien que plus ils disent qu’ils ne sont pas sorciers,plus les gens les prennent au sérieux. Ils ne font pas de miracles,et ils retombent toujours sur leurs pattes ! C’estadmirable !
BERTHOLD, qui guettait derrière la portede droite, regardant par le trou de la serrure. – Lesvoilà ! Les voilà ! Ils se dirigent de ce côté…
Di NOLLI. – Vraiment ?
BERTHOLD. – Il a l’air de vouloir lesreconduire… Oui, oui, le voilà, le voilà !
Di NOLLI. – Retirons-nous ! (Setournant vers Berthold, avant de sortir.) Vous, restezici !
BERTHOLD. – Je dois rester ici ?
Sans lui répondre, Di Molli, Frida etBelcredi s’enfuient par la porte du fond, laissantBerthold hésitant et interdit. La porte à droite s’ouvre :Landolf entre le premier, et s’incline aussitôt. Entrent ensuitedonna Mathilde, avec le manteau et la couronne ducale, comme aupremier acte, et le docteur, revêtu du froc d’abbé de Cluny,encadrant Henri IV en habit royal. Entrent enfin Ordulf etAriald.
HENRI IV, continuant le discoursqu’on suppose commencé dans la salle du trône. – Je vousdemande donc comment je pourrais être fourbe, si l’on me croitentêté…
LE DOCTEUR. – Non, non, pas entêté dutout !
HENRI IV, souriant aveccomplaisance. – Selon vous, je serais donc vraimentfourbe ?
LE DOCTEUR. – Non, non, ni fourbe, nientêté !
HENRI IV, s’arrête et s’écrie sur leton d’un homme qui veut faire remarquer avec bienveillance, maisaussi avec ironie, que les deux choses ne sont pas possibles.– Monseigneur, si l’entêtement n’est pas un vice qui puisse allerde pair avec la fourberie, j’espérais qu’en me refusantl’entêtement, vous voudriez bien m’accorder au moins un peu defourberie. Elle m’est très nécessaire, je vous assure ! Maissi vous voulez la garder tout entière pour vous…
LE DOCTEUR. – Comment ? Je vous faisl’effet d’être fourbe ?
HENRI IV. – Non, Monseigneur ! Quedites-vous là ? Mais vous ai-je moi-même produit aujourd’huil’impression d’être entêté ? (Coupant court et seretournant vers donna Mathilde.) Vous permettez que je dise,avant de prendre congé, un mot en particulier à madame laduchesse ? (Il la conduit à l’écart et luidemande anxieusement, en grand secret.) Votre fille vousest-elle vraiment chère ?
DONNA MATHILDE, éperdue. – Mais oui,certainement…
HENRI IV. – Et vous voulez que jecompense, de tout mon amour, de tout mon dévouement, les gravestorts que j’ai envers elle ? Du moins ne croyez pas, je vousen supplie, aux débauches dont m’accusent mes ennemis ?
DONNA MATHILDE. – Mais non : je n’y croispas, je n’y ai jamais cru…
HENRI IV. – Alors, vous voulezbien ?
DONNA MATHILDE. – Quoi donc ?
HENRI IV. – Que je recommence à aimervotre fille ? (Il la regarde et ajoute aussitôt, d’un tonmystérieux d’avertissement et d’épouvante à la fois.) Ehbien ! cessez d’être l’amie, oui, ne soyez plus l’amie de lamarquise de Toscane !
DONNA MATHILDE. – Je vous assure, pourtant,qu’elle a prié, qu’elle a conjuré autant que nous pour obtenirvotre grâce…
HENRI IV, aussitôt, bas,frémissant. – Ne me dites pas cela ! Ne voyez-vous pas,madame, l’effet que cela me produit ?
DONNA MATHILDE, le regardant, puis toutbas, comme en confidence. – Vous l’aimez encore ?
HENRI IV, éperdu. –Encore ? Vous dites encore ? Comment lesavez-vous ?… Personne ne le sait ! Personne ne doit lesavoir !
DONNA MATHILDE. – Mais elle le sait peut-être,si elle a tant imploré en votre faveur !
HENRI IV la considère une minute,puis dit. – Et vous aimez votre fille ? (Brève pause.Il se tourne vers le docteur, sur un ton plaisant.) Ah !Monseigneur, c’est étrange, je n’ai su que j’étais marié quelongtemps après – bien tard, bien tard… Aujourd’hui même, je suismarié, je le suis sans aucun doute… Eh bien, je puis vous jurer queje n’y pense presque jamais. C’est un gros péché de ma part, maisje n’ai pas le sentiment de l’existence de ma femme ; je ne lasens pas dans mon cœur. Ce qui est le plus étonnant, c’est que samère non plus ne la sent pas dans son cœur ! Avouez-le,madame, vous vous souciez bien peu d’elle ! (Il se tournevers le docteur, avec exaspération.) Elle me parle del’autre ! de Mathilde ! (S’excitant toujoursdavantage.) Et avec une insistance, une insistance que je neparviens pas à m’expliquer.
LANDOLF, humblement. – C’estpeut-être pour vous enlever, Majesté, une opinion fausse que vousavez pu concevoir sur la marquise de Toscane. (Comme confus des’être permis cette remarque.) Je veux dire, bien entendu, ence qui concerne la minute présente…
HENRI IV. – Tu soutiens, toi aussi,qu’elle a été mon amie ?
LANDOLF. – Oui, Majesté, en ce moment, elleest votre amie !
DONNA MATHILDE. – Oui, c’est exact, elle…
HENRI IV. – Je comprends ce que celasignifie. Vous ne croyez pas que je l’aime. Je comprends. Jecomprends. Personne ne l’a jamais cru, personne ne l’a jamaissoupçonné. Cela vaut mieux ainsi. C’est assez. Assez. (Il coupecourt et se tourne vers le docteur, le visage changé.) Vousavez vu, Monseigneur ? les conditions qu’a mises le Pape pourlever son excommunication n’ont rien, exactement rien à voir avecles raisons pour lesquelles il m’avait excommunié ! Dites auPape Grégoire que nous nous reverrons à Bressanone. Et vous,madame, si vous avez la chance de rencontrer votre fille dans lacour du château de votre amie la marquise, que vousdirais-je ? Faites-la monter ; nous verrons s’il me serapossible de la garder comme épouse et comme impératrice. Jusqu’ici,combien se sont présentées à moi en m’assurant qu’elles étaientbien Berthe de Suse, mon épouse, que j’ai quelquefois désirée – (iln’y avait pas de honte à cela : puisqu’il s’agissait de mafemme légitime !) Mais je ne sais pourquoi en m’affirmantqu’elles étaient bien Berthe, qu’elles étaient bien de Suse, elleséclataient de rire ! (Sur un ton de confidence.) Vouscomprenez, madame, – au lit – moi sans vêtements – elles, mon Dieu,elles aussi sans vêtements… l’homme et la femme… c’estnaturel !… On ne pense plus à ce qu’on est quand on est nu. Onsuspend son habit, il reste là comme un fantôme ! (Sur unautre ton, en confidence, au docteur.) Pour moi, Monseigneur,je pense que les fantômes, en général, ne sont au fond rien autrechose que de petites combinaisons manquées de l’esprit : desimages que nous n’avons pas réussi à contenir dans le royaume dusommeil, et qui nous apparaissent parfois à l’état de veille, enplein jour, pour nous faire peur. Ah ! si vous saviez ma peur,la nuit, quand je vois apparaître en désordre toutes ces images –qui rient, qui tombent de cheval. – Parfois, le sang qui bat dansmes artères me terrifie, comme dans le silence de la nuit, un bruitassourdi de pas dans des chambres lointaines… Mais c’est assez, jevous ai trop retenus. Je vous salue, madame, Monseigneur, mesrespects. (Au seuil de la porte du fond, jusqu’où il les aaccompagnés, il prend congé d’eux, qui s’inclinent. Donna Mathildeet le docteur sortent. Il referme la porte et se retourne aussitôt,complètement changé.) Ah ! les bouffons ! lesbouffons ! les bouffons ! C’était un clavier decouleurs ! Je n’avais qu’à l’effleurer, et elle devenaitblanche, rouge, jaune, verte… Et cet autre : Pierre Damien. –Ah ! ah ! c’était parfait ! Je l’ai écrasé ! Iln’a pas osé reparaître devant moi ! (Tout cela sera ditavec une frénésie joyeuse et jaillissante en marchant de long enlarge, en tournant la tête de tous côtés, jusqu’au moment où ilaperçoit Berthold, plus qu’étonné, épouvanté par ce changementsoudain. Il s’arrête devant lui, et le montrant aux trois autres,qui restent éperdus de stupéfaction.) Mais regardez donc cetimbécile, qui me regarde la bouche ouverte… (Il lesecoue.) Tu ne comprends donc pas ? Tu ne vois donc pascomment je les traite, comment je les désarticule, comment je lesoblige à paraître devant moi, ces pantins demi-mortsd’épouvante ! Ce qui les terrifie, c’est uniquementceci : que je leur arrache leur masque et que je m’aperçois deleur déguisement : comme si ce n’était pas moi qui les avaiscontraints à se déguiser pour le plaisir que j’ai de faire lefou !
LANDOLF, ARIALD et ORDULF, bouleversés, seregardant entre eux. – Comment ? Que dit-il ? Maisalors…
HENRI IV, se tournant brusquement, enentendant leurs cris, impérieusement. – Je suis excédé !J’en ai assez ! Finissons-en ! (Soudain, comme si, eny repensant, il n’arrivait pas à y croire.) Quelleimpudence ! Se présenter devant moi, aujourd’hui, avec sonamant auprès d’elle… – Et ils se donnaient des airs de pitié, ilssemblaient vouloir épargner la colère à un pauvre homme déjà horsdu monde, hors du temps, hors de la vie ! Un fou ! Oui,un peu de pitié pour un pauvre fou… S’il ne l’était pas, fou, cethomme n’aurait pas toléré d’être ainsi tyrannisé ! Ilsprétendent bien, eux, tous les jours, à toutes les minutes, que lesautres soient comme ils le veulent ! Ils ne considèrent pascela comme de la tyrannie : oh, non, pas le moins dumonde ! C’est leur façon de penser, leur façon de voir, desentir : chacun a la sienne ! Vous avez aussi la vôtrecertainement. Mais je voudrais bien savoir quelle elle peutêtre ! Celle des bêtes de troupeau, misérable, changeante,incertaine !… Et eux, ils en profitent : ils vous fontsubir et accepter leur façon de voir ; ils vous font sentir etvoir comme eux, ou, tout au moins, ils s’en donnentl’illusion ! Car, enfin, que parviennent-ils à imposer ?Des mots ! des mots que chacun comprend et répète à sa façon…C’est pourtant ainsi que se forme ce qu’on appelle l’opinioncourante ! Ah ! malheur à celui qui, un beau jour, setrouve marqué d’un de ces mots que chacun répète ! Le mot« fou », par exemple, ou encore, que sais-je, le mot« imbécile » ! Mais dites-moi, peut-on rester calmeà l’idée que quelqu’un s’acharne à persuader aux autres que vousêtes tel qu’il vous voit, lui, à vous graver dans l’esprit desautres, conforme au jugement qu’il a porté sur vous ?« Un fou » « Un fou » ! – Je ne parle pasd’aujourd’hui, où je fais semblant de l’être ! Mais avant machute de cheval, avant ce choc sur ma tête… (Il s’arrêtebrusquement, en remarquant l’agitation des quatre hommes.)Vous vous regardez dans les yeux ? (Il imite les marquesde leur étonnement.) Quelle révélation, n’est-ce pas ? Lesuis-je ou ne le suis-je pas ? – Eh oui, je suis fou (ildevient terrible.) Mais alors, pardieu, à genoux, àgenoux ! (Il les force à s’agenouiller tous, l’un aprèsl’autre.) Je vous l’ordonne : tous a genoux devantmoi ! – Comme cela ! Et touchez trois fois la terre dufront ! Allons ! Devant les fous, tout le monde doit êtreà genoux ! (Il regarde les quatre hommes agenouillés etsent brusquement sa féroce gaieté s’évaporer, il s’enindigne.) Allons ! Bêtes de troupeau, relevez-vous !– Vous m’avez obéi ? Alors que vous pouviez me passer lacamisole de force !… Écraser quelqu’un sous le poids d’un mot,cela se fait comme rien, comme on écraserait une mouche !Toute la vie est écrasée sous le poids des mots ! Le poids desmorts ! Regardez moi : pouvez-vous croire sérieusementqu’Henri IV vit encore ? Et pourtant, je parle et je vouscommande, à vous qui êtes vivants. C’est moi qui vous veuxainsi ! Cela vous semble une plaisanterie, que les mortscontinuent à dominer la vie ? – Ici, oui, c’est uneplaisanterie : mais, sortez d’ici, allez dans le monde desvivants. Le jour paraît. Le temps s’étale devant vous. C’estl’aube. – Ce jour qui naît, vous dites-vous, nous allons le créernous-mêmes ? – Ah oui ! Vous-mêmes ! – Et toutes lestraditions ! Et toutes les habitudes ! – Vous vous mettezà parler ? – C’est pour répéter toutes les phrases quitoujours se sont dites ! – Vous croyez vivre ? – Vousremâchez la vie des morts ! (Il se campe devant Berthold,complètement abasourdi.) Tu ne comprends rien à tout cela,toi, n’est-ce pas ? Comment t’appelles-tu ?
BERTHOLD. – Moi… Berthold…
HENRI IV. – Imbécile ! Nous sommesici entre nous : Comment t’appelles-tu ?
BERTHOLD. – Vr… Vraiment… Je m’appelleFino…
HENRI IV, remarquant le gested’avertissement des trois autres, et se tournant aussitôt vers euxpour les faire taire. – Fino ?
BERTHOLD. – Fino Pagliuca, oui, monsieur.
HENRI IV, se tournant vers lesautres. – Vous, je sais vos noms ! Je vous ai tant defois entendu vous appeler ! (À Landolf.) Toi, tut’appelles Lolo ?
LANDOLF. – Oui, monsieur… (Avecjoie.) Oh, mon Dieu… Mais alors ?
HENRI IV, brusquement. – Quoidonc ?
LANDOLF, pâlissant. – Je disais…
HENRI IV. – Oui, tu disais : alorsil n’est plus fou ? Mais non ! Ne le voyez-vouspas ? – Nous nous amusons aux dépens de ceux qui nous croientfous. (À Ariald.) Je sais que tu t’appelles Franco… (ÀOrdulf.) Et toi, attends un peu…
ORDULF. – Momo !
HENRI IV. – Oui, Momo ! Ehbien ! Qu’en pensez-vous ?
LANDOLF. – Mais alors… Mon Dieu…
HENRI IV. – Non, rien n’est changé !Rions à gorge déployée !… Mais entre nous. (Il rit.)Ah, ah, ah, ah, ah !
LANDOLF, ARIALD, ORDULF, se regardant,incertains, pris entre leur joie et leur surprise. – Il estguéri ! Est-il possible ?
HENRI IV. – Chut, chut ! (ÀBerthold.) Tu ne ris pas ? Tu es encore offensé ? Ilne faut pas ! Je ne parlais pas pour toi, tu sais ? –C’est tout le monde, comprends-tu ? C’est tout le monde qui aintérêt à faire croire que certains hommes sont fous, afin depouvoir sans remords les enfermer. Et sais-tu pourquoi ? C’estparce que quand ces hommes-là se mettent à parler, ils cassenttout. Les conventions volent en éclats. Moi, par exemple, qui suisun de ces hommes, que vais-je dire de ces gens qui viennent de s’enaller ? Que la femme est une putain, son compagnon un salaudet que le troisième est un imposteur… Personne ne croira que c’estvrai ! Et on décide que je suis fou ; mais tout le mondem’écoute pourtant avec épouvante… Ah ! Je voudrais bien savoirpourquoi cette épouvante, puisque ce que je dis n’est pas vrai. –On ne peut pas croire ce que racontent les fous ! – Etcependant, regardez-les tous qui m’écoutent les yeux élargisd’épouvante. – Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, toi, dis-lemoi ? Tu vois, je suis calme.
BERTHOLD. – Mais parce que… ils croientpeut-être…
HENRI IV. – Que c’est vrai ! Non,mon cher… Non, mon cher… regarde-moi bien dans les yeux. Je ne dispas que ce soit vrai, sois tranquille ! – Rien n’estvrai ! – Mais regarde-moi bien dans les yeux !(Réponds : Pourquoi écoute-t-on les fous avec épouvante !Mais regarde-moi donc dans les yeux !)
BERTHOLD. – Oui, monsieur…
HENRI IV. – Tu vois bien ! Tu voisbien ! Toi aussi ! Tes yeux sont remplisd’épouvante ! Parce que de nouveau tu me crois fou (et lesfous, on les écoute toujours avec terreur !) – Voilà lapreuve ! Voilà la preuve !
Il rit.
LANDOLF, au nom des autres, prenantcourage, avec exaspération. – Mais quelle preuve ?
HENRI IV. – Que les fousterrifient ! En ce moment, vous me croyez fou de nouveau etvous m’écoutez avec épouvante ? – Et pourtant, il y alongtemps que vous êtes habitués à ma folie ! Vous avez cruque j’étais fou ! – Est-ce vrai ou non ? Alors pourquoicette épouvante ? (Il les regarde, ils sontatterrés.) Vous voyez bien ? Vous sentez que ce désarroipeut aller jusqu’à la terreur, jusqu’à la sensation que la terrevous manque sous les pieds et qu’on n’a plus d’air àrespirer ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que, meschers amis : se trouver devant un fou, savez-vous bien ce quecela signifie ? – Cela veut dire : se trouver devantquelqu’un qui ébranle jusque dans leurs assises toutes les chosesque nous avons construites en nous, autour de nous, la logique, lalogique de toutes nos constructions ! – Il n’y a rien à yfaire ! Les fous construisent sans logique ; comme ilssont heureux, hein ! Ou bien avec une logique à eux, légèrecomme une plume ! Ah ! Quelle mobilité ! Quellemobilité ! Aujourd’hui, d’une façon ; demain, d’uneautre ! Qui sait comment ? Vous employez toute votreforce à vous fixer, et eux, ils s’abandonnent. Quellemobilité ! Quelle mobilité ! – Vous dites :« Cela ne peut pas être ! » – Pour eux, tout peutêtre. – Vous dites : cette chose n’est pas vraie ?Pourquoi ? – Parce qu’elle ne semble vraie ni à toi, ni à toi,ni à toi, (il indique trois d’entre eux) ni à cent milleautres. Eh, mes chers amis, il faudrait examiner ce qui semble vraià ces cent mille autres qu’on n’appelle pas fous, voir lesspectacles que donne leur accord, fruits de leur logique !Fine fleur de logique ! Étant enfant, la lune, dans le puits,me semblait vraie. Et combien d’autres choses encore me semblaientvraies ! Je croyais à tout ce qu’on me disait et j’étaisheureux ! Malheur, oui, malheur, si vous ne vous cramponnezpas de toutes vos forces à ce qui vous semble vrai aujourd’hui, àce qui vous semblera vrai demain, même si c’est le contraire de cequi hier vous sembla vrai ! Malheur si vous allez comme moi,jusqu’au fond de cette chose terrible qui, elle, rend fou : setrouver à côté d’un autre être, regarder ses yeux, – comme un jourj’ai regardé certains yeux, – et se sentir pareil à un mendiantdevant une porte qui jamais ne s’ouvrira pour le laisser passer.Celui qui entrera, ce ne sera jamais vous, avec l’univers que vousportez en vous, tel que vous le voyez et le touchez. Ce seraquelqu’un d’inconnu de vous, conforme à celui que cet autre être,dans son univers impénétrable, croit voir et toucher en vous.(Longue pause. L’ombre commence à s’épaissir dans la salle,accroissant l’impression d’effroi et de consternation dont cesquatre hommes déguisés sont envahis, et qui les éloignent toujoursdavantage de ce grand homme masqué, qui demeure plongé dans lacontemplation de l’effroyable misère qui n’est pas seulement lasienne propre, mais celle de tous les hommes. Il se secoue, cherchedu regard les quatre hommes qu’il n’a plus l’impression d’avoirautour de lui, et dit.) La nuit s’est faite ici.
ORDULF, aussitôt s’avançant. –Faut-il aller chercher la lampe ?
HENRI IV. – La lampe, ah !oui !… Vous croyez donc que j’ignore qu’à peine le dos tournéavec ma lampe à huile, pour aller me coucher, vous allumiez pourvous la lumière électrique, ici, et dans la salle du trône ? –Je faisais semblant de ne pas m’en apercevoir…
ORDULF. – Ah ! – Voulez-vous alorsque…
HENRI IV. – Non, elle m’aveuglerait. – Jeveux ma lampe.
ORDULF. – Elle doit être préparée déjàderrière la porte.
Il va à la porte du fond, l’ouvre, fait unpas au dehors et revient aussitôt avec une lampe ancienne, decelles qu’on porte par un anneau.
HENRI IV. – Très bien, un peu de lumière.Asseyez-vous, tout autour de la table. Mais non, pas commecela ! Prenez de belles attitudes… Pleines d’aisance… (ÀBerthold.) Toi, comme ceci… (Il lui donne une attitude,puis à Landolf) Toi, comme cela… (Il lui donne uneattitude.) C’est parfait… (Il s’assied en faced’eux.) Moi, ici… (Tournant la tête vers la fenêtre.)Il faudrait pouvoir commander à la lune un beau rayon, biendécoratif… Ah ! Comme elle nous sert, la lune, comme elle nousest utile, comme elle m’est chère ! Souvent je passe desheures à la regarder de ma fenêtre. Qui pourrait croire, à lacontempler, qu’elle sait que huit cents ans se sont écoulés, etqu’assis à ma fenêtre, je ne puis vraiment être Henri IV entrain de regarder la lune comme le premier venu ! Je laregarde : c’est pour échapper à cette impression de désert quiest partout ici, où la folie a habité, où divaguer est la chosespontanée, la chose habituelle et sérieuse – qui a le droit, undroit parfaitement logique à l’existence – comme n’importe quelleautre réalité, dont la vanité trompeuse ne s’est pas encoredévoilée. Mais regardez, regardez donc ce magnifique tableaunocturne : l’Empereur entouré de ses fidèles conseillers… Nevous plaît-il pas, ce tableau ?
LANDOLF, bas à Ariald, comme pour éviterde rompre l’enchantement. – Tu comprends ? Si on avait suque ce n’était pas vrai…
HENRI IV. – Vrai, quoi donc ?
LANDOLF, hésitant comme pours’excuser. – C’est simplement que… ce matin… je lui disais(il montre Berthold,) comme il prenait pour la premièrefois le service : quel dommage qu’avec ces vêtements, qu’avecune garde-robe aussi belle… et avec une salle pareille…
Il montre la salle du trône.
HENRI IV. – Eh bien ? Tu disaisqu’il était dommage que ?…
LANDOLF. – Je disais que nous ne savionspas…
HENRI IV. – Que vous représentiez pourrien, pour rire, toute cette comédie ?
LANDOLF. – Oui, nous imaginions que…
ARIALD, pour lui venir en aide. –Oui… nous imaginions que c’était pour de bon…
HENRI IV. – Comment ? N’est-ce paspour de bon ?
LANDOLF. – Eh ! Puisque vous ditesque ?…
HENRI IV. – Je dis que vous êtes desimbéciles ! Cette illusion, vous deviez l’entretenir pourvous-mêmes, et non pas seulement pour m’en donner lacomédie à moi et aux quelques visiteurs que nous avions ; vousauriez dû la vivre de la façon la plus naturelle, tous les jours,même quand personne n’était là. (Prenant Berthold parle bras.) Comprends-tu, la vivre pour toi. Tu pouvaist’enclore dans cette fiction, y manger, y dormir et t’y gratter ledos quand il te démangeait ! (Se tournant vers lesautres.) Vous auriez dû vous sentir vivre, vivre vraiment,dans l’histoire du XIe siècle, à la cour de votreEmpereur Henri IV ! (Il saisit Ordulf par lebras.) Toi, Ordulf, un Ordulf vivant dans le château deGoslar ! Quand, le matin, tu t’éveillais et sautais de tonlit, ce n’était pas pour sortir de ton rêve, c’était pour y entrer,en revêtant ces braies et ces tuniques. Oui, pour entrer dans cerêve qui n’aurait plus été un rêve, car tu l’aurais vécu, tul’aurais constamment senti, tu l’aurais bu avec l’air que turespirais, mais, tout en sachant bien que c’était un rêve, afin demieux savourer le bonheur privilégié qui vous était donné de nerien faire d’autre ici que de vivre ce rêve, si loin de nous etcependant présent ! Ah ! Du fond du passé lointain oùnous sommes, de ce XIe siècle, si plein de couleurs etpourtant sépulcral, contempler huit cents ans plus tard les hommesdu XXe siècle en train de se débattre dans l’inquiétudeet le tourment pour savoir ce qui va advenir d’eux, comment sedénoueront les événements qui les agitent et les angoissent. Tandisque vous, au contraire, vous étiez déjà bien tranquilles, dansl’histoire ! avec moi !
LANDOLF. – Ah ! comme c’estvrai !
HENRI IV. – Dans l’histoire où tout estdécidé ! Où tout est fixé !
ORDULF. – Voilà, voilà !
HENRI IV. – Ah ! Ma vie peut êtrelamentable ; elle peut être traversée d’horreurs, de luttes,de douleurs ; c’est déjà de l’histoire ; rien n’y changeplus, rien n’y peut plus changer. Comprenez-vous ? Tout y estfixé pour toujours. Et vous pouviez vous étaler dans cette vie enadmirant comme les effets suivent leurs causes, avec obéissance, enparfaite logique et en contemplant le déroulement précis etcohérent de tous les faits dans leurs moindres détails. La joie del’histoire, cette joie qui est si grande !
LANDOLF. – Ah ! Que c’est beau ! Quec’est beau !
HENRI IV. – C’était beau, mais c’estfini ! À présent que vous connaissez mon secret, je ne pourraiplus continuer ! (Il prend la lampe pour aller secoucher.) Et, d’ailleurs, vous non plus, puisque vous n’enaviez pas démêlé jusqu’ici les raisons ! Moi, j’en ai àprésent la nausée ! (Avec une violente ragecontenue.) Par le Ciel ! Elle se repentira d’être venueici ! Elle s’était déguisée en belle-mère… et lui en moine… etils amenaient avec eux un médecin pour me faire examiner… Ilsespéraient peut-être me guérir… Quels bouffons ! Je veux medonner le plaisir d’en gifler au moins un : Lui ! C’estun escrimeur fameux ? Il m’embrochera… Nous verrons bien, nousverrons bien… (On frappe à la porte du fond.) Qui valà ?
LA VOIX DE GIOVANNI. – Deo Gratias !
ARIALD, riant à l’idée d’une bonne farcequ’on pourrait encore faire. – C’est Giovanni, c’est Giovanni,qui vient, comme tous les soirs, faire le moine !
ORDULF, de même, se frottant lesmains. – Oui, oui, laissons faire !
HENRI IV. – Pourquoi te moquer d’unpauvre vieux qui agit par affection pour moi ?
LANDOLF, à Ordulf. – Tout doit êtrecomme si c’était vrai ! N’as-tu pas compris ?
HENRI IV. – Précisément ! Comme sic’était vrai ! C’est à cette seule condition que la véritén’est pas une plaisanterie ! (Il va ouvrir la portelui-même et fait entrer Giovanni, habillé en franciscain, avec unrouleau de parchemin sous le bras.) Entrez, entrez, monPère ! (Prenant un ton de gravité tragique et de sombreressentiment.) Tous les documents de ma vie et de mon règnequi m’étaient favorables ont été détruits, de propos délibéré, parmes ennemis : Seul a échappé à la destruction le récit de mavie écrit par un pauvre frère qui m’est dévoué, et vous voudriez enrire ? (Il se tourne affectueusement vers Giovanni etl’invite à prendre place devant la table.) Asseyez-vous, monPère, asseyez-vous, la lampe près de vous. (Il pose à côté delui la lampe qu’il tenait encore à la main.) Écrivez,écrivez.
GIOVANNI, étalant le rouleau de parcheminet se disposant à écrire sous la dictée. – Je suis à vosordres, Majesté !
HENRI IV, dictant. – Le décretde paix lancé de Mayence servait les pauvres et les bonnes gens. Ilnuisait aux méchants et aux riches. (Le rideau commence àbaisser.) Il apportait aux premiers le bien-être, la famine etla misère aux autres…
Rideau.
ACTE TROISIÈME
La salle du trône, plongée dans l’obscurité.Dans l’ombre on distingue à peine le mur du fond. Les deuxportraits ont été enlevés et dans les niches qui étaient derrière,ont pris place, dans l’attitude précise des deux portraits, Frida,déguisée en Marquise de Toscane, comme on l’a vue au second acte,et Carlo di Nolli, déguisé en Henri IV.
Au lever du rideau, la scène reste vide uncourt instant. La porte à gauche s’ouvre et Henri IV, portantla lampe par l’anneau pénètre dans la salle. Il se retourne pourparler aux quatre jeunes gens, qu’on suppose dans la salle à côté,avec Giovanni, comme à la fin du second acte.
HENRI IV. – Non : restez,restez ; je me déshabillerai seul. Bonne nuit.
Il referme la porte et se dirige, plein detristesse et de lassitude, vers la seconde porte à droite, quiconduit dans ses appartements.
FRIDA, quand il a dépassé le trône,murmure, du haut de sa niche, d’une voix éteinte par la peur.– Henri…
HENRI IV, s’arrêtant à cette voix,comme s’il avait reçu par traîtrise un coup de couteau dans le dos,se tourne avec épouvante vers le mur du fond et fait le gesteinstinctif de se protéger le visage avec son bras. – Quim’appelle ?
Ce n’est pas une question, c’est uneexclamation qui jaillit dans un frisson de terreur et n’attendaucune réponse de l’obscurité et du silence terrible de la salle,qui vient brusquement de s’emplir pour lui de la terreur d’êtrevraiment fou.
FRIDA, devant ce geste, s’épouvante, non moinsterrifiée de la comédie qu’elle a consenti à jouer, puis répète unpeu plus fort. – Henri…
Elle penche un peu la tête hors de saniche, vers l’autre niche, tout en essayant de continuer à jouer lerôle qu’on lui a confié.
Henri IV pousse un hurlement, laissetomber la lampe, entoure sa tête de ses bras et veuts’enfuir.
FRIDA, sautant de sa niche sur lesoubassement et criant comme si elle était devenue folle. –Henri… Henri… J’ai peur… J’ai peur…
Di Nolli saute à son tour sur lesoubassement, de là à terre, et court vers Frida, qui continue àcrier nerveusement et qui est sur le point de s’évanouir. À cemoment entrent, par la porte à gauche et par la première porte àdroite, le docteur, donna Mathilde habillée elle aussi en marquisede Toscane, Tito Belcredi, Landolf, Berthold, Giovanni. L’un de cesderniers donne la lumière dans la salle, une lumière étrange,provenant de petites lampes cachées dans le plafond, de manière àce que le haut de la scène seul soit vivement éclairé. Sans sepréoccuper de Henri IV, qui continue à regarder, stupéfait decette irruption inattendue, après la minute de terreur dont toutesa personne frémit encore, tous les autres accourent pour souteniret réconforter Frida toute tremblante, qui gémit et se débat dansles bras de son fiancé. Ils parlent tous ensemble.
DI NOLLI. – Non, non, Frida… Je suis là… Jesuis auprès de toi !
LE DOCTEUR. – Arrêtez ! L’expérience estinutile…
DONNA MATHILDE. – Il est guéri, Frida !Tu vois ! Il est guéri !
DI NOLLI, stupéfait. –Guéri ?
BELCREDI. – C’était pour rire !Calme-toi !
FRIDA. – Non ! J’ai peur ! j’aipeur !
DONNA MATHILDE. – Mais de quoi ?Regarde-le ! Ce n’était pas vrai ! Ce n’était pasvrai !
DI NOLLI. – Ce n’était pas vrai ? Quedites-vous ? Il serait guéri ?
LE DOCTEUR. – Il paraît !… Quant àmoi…
BELCREDI, montrant les quatre jeunesgens. – Mais oui ! Ils viennent de nous ledire !
DONNA MATHILDE. – Oui, il est guéri depuislongtemps ! Il le leur a avoué !
Di Nolli, maintenant plus indignéqu’étonné. – Mais ! Comment cela, puisque, jusqu’à tout àl’heure…
BELCREDI. – Il donnait la comédie pour semoquer de toi et de nous aussi qui, en toute bonne foi…
Di Nolli. – Est-ce possible ? Il seserait moqué de sa sœur jusqu’à sa mort ?
HENRI IV, qui est resté à guetter levisage des uns et des autres, crispé sous les accusations, laréprobation pour ce que tous jugent une farce cruelle, désormaispercée à jour. Ses yeux traversés d’éclairs témoignent qu’il méditeune vengeance, que la colère qui s’agite en lui ne lui laisse pasdémêler encore avec précision. À ces dernières paroles, blessé, ilse redresse avec l’idée claire de tenir pour vraie la fiction qu’onavait insidieusement préparée pour lui, et il crie à sonneveu. – Continue ! Continue !
Di NOLLI, interdit. – Continuer, quoidonc ?
HENRI IV. – Ce n’est pas seulement« ta » sœur qui est morte !
Di Nolli. – Ma sœur ? Je parle de latienne, que tu as obligée jusqu’à la fin à se présenter là, devanttoi, comme si elle était ta mère, Agnès !
HENRI IV. – N’était-ce pas« ta » mère ?
Di NOLLI. – Mais oui, c’était ma mère,précisément, ma mère !
HENRI IV. – Mais elle est morte pour moi« vieux et lointain », ta mère ! Toi, tu viens dedescendre frais comme une rose de là ! (Il montre la niched’où Di Nolli a sauté.) Et qu’en sais-tu si je ne l’ai paspleurée longtemps, longtemps, en secret, malgré cethabit ?
DONNA MATHILDE, consternée, regardant lesautres. – Que dit-il ?
LE DOCTEUR, très impressionné,l’observant. – Doucement, doucement, je vous ensupplie !
HENRI IV. – Ce que je dis ? Quand jedemande à tous si Agnès n’était pas la mère d’Henri IV ?(Il se tourne vers Frida, comme si elle était véritablement lamarquise de Toscane.) Vous, marquise, vous devriez le savoir,il me semble !
FRIDA, encore épouvantée, se pressantdavantage contre di Nolli. – Non, moi non !non !
LE DOCTEUR. – Le délire le reprend… Doucement,je vous en prie !
BELCREDI, indigné. – Mais non,docteur ! Ce n’est pas le délire ! Il recommence à jouerla comédie !
HENRI IV, reprenant. – Moi. Vousavez vidé ces deux niches-là ; lui se présente devant moi enHenri IV.
BELCREDI. – Mais finissons-en avec cetteplaisanterie !
HENRI IV. – Qui parle deplaisanterie ?
LE DOCTEUR, à Belcredi, avec force. –Ne le provoquez pas, pour l’amour de Dieu !
BELCREDI, sans prêter d’attention auxparoles du docteur, plus fort, montrant les quatre jeunesgens. – Ce sont eux qui l’ont dit ! Eux !Eux !
HENRI IV, se tournant vers eux.– Vous avez parlé de plaisanterie ?
LANDOLF, timide, embarrassé. – Non…nous avons dit que vous étiez guéri !
BELCREDI. – Allons, cela suffit ! (Àdonna Mathilde.) Ne vous semble-t-il pas que ce spectacle(il montre di Nolli) marquise, et votre déguisement,deviennent d’une puérilité insupportable ?
DONNA MATHILDE. – Mais taisez-vous donc !Qu’importent ces habits, s’il est vraiment guéri ?
HENRI IV. – Guéri, oui ! Je suisguéri ! (À Belcredi.) Mais ce n’est pas pour en finirtout de suite, comme tu le crois ! (Il se jette surlui.) Sais-tu bien que, depuis vingt ans, personne n’a jamaisosé paraître devant moi comme toi et ce monsieur ?
Il montre le docteur.
BELCREDI. – Mais oui, je le sais ! Et cematin, j’étais venu déguisé…
HENRI IV. – En moine, oui !
BELCREDI. – Et tu m’as pris pour PierreDamien ! Et je n’ai pas ri, précisément parce que jecroyais…
HENRI IV. – Que j’étais fou ! Et turis maintenant en la voyant vêtue de la sorte, parce que je suisguéri ? Tu pourrais pourtant penser, qu’à mes yeux, à présent,ce costume… (Il s’interrompt avec un éclat d’indignation.)Ah ! (Il se tourne vers le docteur.) Vous êtesmédecin ?
LE DOCTEUR. – Mais oui…
HENRI IV. – Et vous l’aviez habilléeaussi en marquise de Toscane ? pour me préparer unecontre-plaisanterie ?…
DONNA MATHILDE, aussitôt, avec feu. –Non, non ! Que dites-vous là ! Nous l’avons fait pourvous ! Je l’ai fait pour vous !
LE DOCTEUR. – Pour essayer, pour essayer, nesachant plus…
HENRI IV, l’interrompant avecnetteté. – J’ai compris. C’est pour lui que je parle decontre-plaisanterie (il montre Belcredi), puisqu’il croitque je plaisante…
BELCREDI. – Mais naturellement, voyons !puisque tu nous dis toi-même que tu es guéri !
HENRI IV. – Laisse-moi parler !(Au docteur.) Savez-vous, docteur, que vous avez risqué derefaire pour un moment la nuit dans mon cerveau ? Que diable,faire parler des portraits ! Les faire sortir de leursniches…
LE DOCTEUR. – Mais nous sommes accourus toutde suite, vous avez vu, dès que nous avons su…
HENRI IV. – Oui… (Il contemple Fridaet di Nolli, puis la marquise, et enfin regarde son proprehabit.) L’idée était très belle… Deux couples… Très bien, trèsbien, docteur : pour un fou… (Il fait un léger signe de lamain, dans la direction de Belcredi.) Il trouve à présent quec’est une mascarade hors de saison ? (Il le regarde.)Je n’ai plus qu’à enlever mon déguisement et à m’en aller d’iciavec toi, n’est-ce pas ?
BELCREDI. – Avec moi ! Avec noustous !
HENRI IV. – Et pour aller où ? Aucercle, en frac et en cravate blanche ? Ou chez la marquise,en ta compagnie ?
BELCREDI. – Mais pour aller où tuvoudras ! Tu préférerais donc rester encore ici, à perpétuerdans la solitude ce qui fut la malheureuse plaisanterie d’un jourde carnaval ? Il est vraiment incroyable, incroyable que tuaies fait cela, après ta guérison.
HENRI IV. – Eh ! mais c’est qu’aprèsma chute de cheval, sur la tête, je suis vraiment resté fou pendantje ne sais combien de temps…
LE DOCTEUR. – Ah ! c’est cela !c’est cela ! Et pendant longtemps ?
HENRI IV, rapidement, audocteur. – Oui, docteur, longtemps. Douze ans environ, si jecalcule bien. (Il se retourne et s’adresse à nouveau àBelcredi.) Et ne plus rien voir, mon cher, de tout ce quiétait arrivé depuis ce jour de carnaval ; de tout ce qui a eulieu pour vous, mais non pour moi ; n’avoir pas vu les choseschanger, mes amis me trahir, ma place prise par d’autres… parexemple… que sais-je ! supposons dans le cœur de la femmeaimée ; n’avoir plus su qui mourait, qui disparaissait… toutcela, ça n’a pas été une plaisanterie pour moi, comme tul’imagines !
BELCREDI. – Mais non, je ne dis pascela ! Je parlais d’après ta guérison !…
HENRI IV. – Ah oui ! Après ? Unbeau jour… (Il s’arrête et se tourne vers le docteur.) Uncas très intéressant, docteur ! étudiez-moi, étudiez-moibien ! (Il frémit en parlant.) Un jour, Dieu saitcomment, mon mal… (Il se touche le front.) Oui… guérit. Jerouvre les yeux peu à peu, et tout d’abord je ne sais pas si jedors ou si je veille ; mais oui, je suis éveillé ; jetouche vraiment cette chose, cette autre ; je recommence àvoir clairement… Ah ! – comme il le dit – (il montreBelcredi) quitter alors, quitter ce masque, ce vêtement,s’évader de ce cauchemar ! Ouvrons les fenêtres :respirons la vie ! Sortons, sortons ! Courons !(Sa fougue tombe d’un coup.) Mais où ? Pour fairequoi ? Pour que tout le monde me montre du doigt, parderrière, m’appelle Henri IV, et non pas comme on le faisaitici, mais dans la vie, bras dessus, bras dessous, avec toi, parmiles bons amis d’autrefois ?
BELCREDI. – Mais non ! Que dis-tu ?Pourquoi ?
DONNA MATHILDE. – Mais pas le moins du monde.Qui en aurait eu le courage ? Ç’avait été un si grandmalheur !
HENRI IV. – Mais non, tout le monde metrouvait déjà fou auparavant ! (À Belcredi.) Et tu lesais bien, toi qui t’acharnais plus que les autres contre moi,quand on essayait de me défendre !
BELCREDI. – Mais c’était pour rire !
HENRI IV. – Regarde mescheveux !
Il lui montre ses cheveux gris sur lanuque.
BELCREDI. – Mais les miens sont grisaussi !
HENRI IV. – Oui, mais avec cettedifférence que les miens ont grisonné ici, comprends-tu ? Cesont les cheveux d’Henri IV ! Et je ne m’en étais pasaperçu ! Je m’en suis aperçu un beau jour, quand j’ai rouvertles yeux, j’en suis resté épouvanté ! J’ai compris tout desuite que ce n’était pas mes cheveux seulement, mais que toutdevait être devenu gris, que tout avait croulé, que tout étaitfini, et que je serais arrivé avec une faim de loup à un banquetdéjà desservi.
BELCREDI. – Naturellement, les autres…
HENRI IV, promptement. – Je lesais bien, les autres ne pouvaient attendre ma guérison, surtoutceux qui, derrière moi, avaient éperonné jusqu’au sang le chevalque je montais…
Di NOLLI, impressionné. – Comment,comment ?
HENRI IV. – Oui, traîtreusement, pour lefaire ruer et me faire tomber !
DONNA MATHILDE, avec horreur. – Maisj’ignorais cela ! Je l’apprends maintenant !
HENRI IV. – Sans doute était-ce aussipour rire !
DONNA MATHILDE. – Mais qui a fait cela ?Qui était derrière notre couple ?
HENRI IV. – Peu importe ! Derrièrenous, il y avait tous ceux qui ont continué à banqueter et qui nem’auraient donné que des restes, marquise, les restes d’unecompassion maigre ou molle, les restes de leur assiette sale, avecquelques arêtes de remords attachées au fond. Merci ! (Setournant brusquement vers le docteur.) Et alors, docteur,voyez si le fait n’est pas vraiment nouveau dans les annales de lafolie ! – j’ai préféré rester fou ! – Je trouvais icitout préparé, tout disposé pour ce délice d’un nouveau genre, ledélice de vivre ma folie, – avec la conscience la plus lucide – etde me venger ainsi de la brutalité d’un caillou qui m’avait dérangéle cerveau ! Ma solitude – la pauvreté et le vide de lasolitude – qui m’apparut quand je rouvris les yeux – j’ai voulu larevêtir tout de suite de toutes les couleurs, de toutes lessplendeurs de ce jour d’un carnaval passé avec vous. (Ilregarde donna Mathilde et puis montre Frida.) Vous, là,marquise, et où vous avez triomphé ! – Obliger tous ceux quise présentaient à moi à continuer du même pas que moi, à suivrecette fameuse mascarade qui fut pour vous, – non pas pour moi – uneplaisanterie d’un jour ! Faire qu’elle devînt à jamais, nonpas une plaisanterie, mais une réalité, la réalité d’une folievéritable : tout n’était que masques ici, et la salle du trôneet mes quatre conseillers secrets, qui, bien entendu, m’onttrahi ! (Il se tourne vers eux.) Je voudrais biensavoir ce que vous avez gagné à révéler que j’étais guéri. – Si jesuis guéri ! On ne va plus avoir besoin de vos services etvous serez congédiés ! – Faire une confidence à quelqu’un…voilà qui est vraiment fou ! – Ah, mais à mon tour de vousaccuser ! – Vous ne savez pas ?
– Ils croyaient pouvoir continuer cetteplaisanterie avec moi, à vos dépens !
Il éclate de rire ; les autres, saufdonna Mathilde, rient aussi, mais d’un rire gêné.
BELCREDI, à Di Nolli. – Tu entends…ce n’est pas mal…
Di NOLLI, aux quatre jeunes gens. –Vous ?
HENRI IV. – Il faut le leurpardonner ! Cet habit (il montre l’habit dont il estrevêtu), cet habit qui pour moi est la caricature évidente etconsciente de cette autre mascarade continuelle dont nous sommes, àtoutes les minutes, les pantins involontaires (il montreBelcredi) quand, sans le savoir, nous nous déguisons en ce quenous imaginons être, – cet habit, leur habit, excusez-les, ils nele confondent pas encore avec leur personne même. (Il se tournede nouveau vers Belcredi.) Tu sais, on en prend facilementl’habitude, et on parcourt une salle de ce genre avec un naturelparfait, comme un héros de tragédie. (Il traverse lasalle.) Regardez, docteur ! – Je me rappelle un prêtre –il était certainement irlandais – admirablement beau. Il dormait ausoleil, un jour de novembre, les bras appuyés au dossier d’un banc,dans un jardin public : plongé dans les délices dorées decette tiédeur qui, pour lui, homme du Nord, devait paraître presqueestivale. On pouvait être sûr qu’à cet instant, il ne se savaitplus prêtre, il ne savait plus où il était. Il rêvait ! À quoirêvait-il ? Qui le sait ? – Un gamin passe ; ilavait arraché une fleur avec toute sa tige. En passant, ilchatouilla le cou de ce prêtre endormi. – Je vis cet homme ouvrirdes yeux rieurs et toute sa bouche s’épanouissait du rire heureuxde son rêve : il avait tout oublié. Mais je puis vous assurerqu’en un clin d’œil, il reprit la raideur exigée par sa robeecclésiastique, et que ses yeux retrouvèrent la gravité que vousavez déjà vue dans les miens ; c’est que les prêtres irlandaisdéfendent le sérieux de leur foi catholique avec le même zèle quej’apporte à défendre les droits sacro-saints de la monarchiehéréditaire. – Je suis guéri, messieurs, parce que je saisparfaitement que je fais le fou dans ce château, et je le faispourtant, dans un calme complet ! – Le malheur, pour vous,c’est que comme le prêtre irlandais vous vivez notre folie dansl’agitation et l’inquiétude, sans la connaître, sans même lavoir.
BELCREDI. – Nous allons conclure que noussommes fous… c’est nous, maintenant, qui sommes les fous !
HENRI IV, éclatant, mais cherchant àse contenir. – Mais si vous n’aviez pas été fous, toi et elleaussi (il montre la marquise) seriez-vous venus chezmoi ?
BELCREDI. – À te dire le vrai, j’y suis venuen croyant que le fou c’était toi.
HENRI IV, promptement, avec force,montrant la marquise. – Et elle ?
BELCREDI. – Ah ! elle, je ne sais pas…Elle a l’air pétrifié par tout ce que tu dis… ensorcelé par tafolie « consciente » ! (Il se tourne verselle.) Habillée comme vous l’êtes, marquise, vous pourriezdemeurer ici pour la vivre, cette folie…
DONNA MATHILDE. – Vous êtes uninsolent !
HENRI IV, conciliant. – Non,marquise, il dit que le prodige – ce qui est à ses yeux est unprodige – serait accompli, si vous restiez ici, – en marquise deToscane. Et vous savez bien que vous ne pourriez être mon amie, quevous pourriez tout au plus m’accorder, comme à Canossa, un peu depitié…
BELCREDI. – Un peu, tu peux direbeaucoup ! Elle l’a avoué.
HENRI IV, à la marquise,continuant. – Et même, admettons-le, un peu de remords…
BELCREDI. – Du remords aussi ! Elle l’aavoué également.
DONNA MATHILDE, éclatant. – Ne voustairez-vous pas !
HENRI IV, l’apaisant. – Nefaites pas attention à ce qu’il dit ! N’y faites pasattention ! Il continue ses provocations. Et pourtant ledocteur l’a averti de ne pas me provoquer. (Se tournant versBelcredi.) Mais pourquoi veux-tu que je sois encore troublépar ce qui est advenu entre nous ; par le rôle que tu as jouédans mes malheurs avec elle ? (Il montre la marquise, setourne vers elle, lui montrant Belcredi.) Par le rôle qu’iljoue dans votre vie ! Ma vie est ici ! Ce n’est pas lavôtre ! – Votre vie qui vous a conduite à la vieillesse, moije ne l’ai pas vécue ! – (À donna Mathilde.) C’étaitcela que vous vouliez me dire, me démontrer par votre sacrifice, envous habillant comme vous l’avez fait, sur le conseil dudocteur ? Oh, c’était très bien conçu, je vous l’ai déjà dit,docteur : – « Ceux que nous étions alors, et ceux quenous sommes aujourd’hui. » Mais je ne suis pas un fou selonles règles, docteur ! Je sais bien que celui-ci (il montredi Nolli) ne peut pas être moi, puisque je suis moi-mêmeHenri IV depuis vingt ans, ici, comprenez-vous ? Immobilesous ce masque éternel ! Ces vingt ans (il montre lamarquise) elle les a vécus ; elle en a joui pour devenir– regardez-la – méconnaissable à mes yeux : je ne puis plus lareconnaître, car je la vois toujours ainsi (il montre Frida ets’approche d’elle.) – Pour moi, elle est toujours ainsi… Vousme faites l’effet d’enfants que je pourrais épouvanter. (ÀFrida.) Et toi, tu t’es vraiment épouvantée, mon enfant, decette plaisanterie qu’on t’avait persuadée de faire, sanscomprendre que, pour moi, elle ne pouvait pas être la plaisanteriequ’ils croyaient, mais ce terrible prodige : mon rêve qui viten toi plus que jamais ! Tu étais une image pendue aumur ; ils ont fait de toi un être vivant – tu es à moi !tu es à moi ! à moi de droit ! (Il la saisit dans sesbras en riant comme un fou ; tous crient affolés, mais quandils accourent pour arracher Frida de ses bras, il devient terribleet crie aux quatre jeunes gens :) Retenez-les !Retenez-les ! Je vous ordonne de les retenir !
Les quatre jeunes gens, étourdis, commesous l’effet d’un sortilège, essaient, avec des gestes mécaniques,de retenir di Nolli, le docteur et Belcredi.
BELCREDI, se libérant et se précipitantsur Henri IV. – Laisse-la ! laisse-la ! Tu n’espas fou !
HENRI IV, d’un geste d’une rapiditéfoudroyante, tirant l’épée de Landolf, qui est à côté de lui.– Je ne suis pas fou ? Voilà pour toi !
Il le blesse au ventre. Hurlements dedouleur. On accourt pour soutenir Belcredi. Cris confus.
DI NOLLI. – Tu es blessé ?
BERTHOLD. – Il est blessé ! Il estblessé !
LE DOCTEUR. – Je vous avaisprévenus !
FRIDA. – Oh ! mon Dieu !
DI NOLLI. – Frida, viens ici !
DONNA MATHILDE. – Il est fou ! Il estfou !
DI NOLLI. – Tenez-le bien !
BELCREDI, pendant qu’on le transporte dansla pièce à côté, par la porte de gauche, protestefarouchement. – Non, tu n’es pas fou ! Il n’est pasfou ! Il n’est pas fou !
Sortie générale par la porte à gauche.Cris confus qui se prolongent dans la pièce à côté. Tout à coup, uncri plus aigu de donna Mathilde domine le tumulte, suivi d’unsilence.
HENRI IV, qui est resté sur la scène,entre Landolf, Ariald et Ordulf, les yeux fixes, accablé par la viequi est née de sa fiction et qui, en un instant, l’a poussé aucrime.
– Maintenant oui… par forme… (Il lesrassemble autour de lui, comme pour être protégé.) Tous venezprès de moi, nous allons demeurer ici ensemble, ensemble ici, etpour toujours…
Rideau.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le Vampire

Le Vampire
de John Williams Polidori
La superstition qui sert de fondement à ce conte est universelle dans l’Orient. Elle est commune chez les Arabes ; cependant elle ne se répandit chez les Grecs qu’après l’établissement du christianisme, et elle n’a pris la forme dont elle est revêtue que depuis la séparation des églises grecque et latine. Ce fut alors qu’on commença à croire que le cadavre d’un latin ne pouvait pas se corrompre, s’il était inhumé en terre grecque, et à mesure que cette croyance s’étendit, elle donna naissance aux histoires épouvantables de morts qui sortaient de leurs tombeaux, et suçaient le sang des jeunes filles distinguées par leur beauté. Elle pénétra dans l’Ouest avec quelques variations ; on croyait en Hongrie, en Pologne, en Autriche,en Bohême, que les vampires pompaient pendant la nuit une certaine quantité du sang de leurs victimes, qui maigrissaient à vue d’œil,perdaient leurs forces et périssaient de consomption, tandis que ces buveurs de sang humain s’engraissaient, et que leurs veines se distendaient à un tel point, que le sang s’écoulait par toutes les issues de leurs corps, et même par tous leurs pores.
Le journal de Londres de mars 1733 contient unrécit curieux et croyable d’un cas particulier devampirisme qu’on prétend être arrivé à Madreygea en Hongrie. Lecommandant en chef et les magistrats de cette place affirmèrentpositivement et d’une voix unanime, après une exacte information,qu’environ cinq ans auparavant, un certain Heyduke, nommé ArnoldPaul, s’était plaint qu’à Cassovia, sur les frontières de la Servieturque, il avait été tourmenté par un vampire, mais qu’il avaitéchappé à sa rage en mangeant un peu de terre qu’il avait prise surle tombeau du vampire, et en se frottant lui-même de son sang.Cependant cette précaution ne l’empêcha pas de devenir vampire àson tour ; car, vingt ou trente jours après sa mort et sonenterrement, plusieurs personnes se plaignirent d’avoir ététourmentées par lui ; on déposa même que quatre personnesavaient été privées de la vie par ses attaques ; pour prévenirde nouveaux malheurs, les habitants, ayant consulté leurHadagai [1], exhumèrent le cadavre et letrouvèrent (comme on le suppose dans tous les cas de vampirisme)frais et sans aucunes traces de corruption ; sa bouche, sonnez et ses oreilles étaient teints d’un sang pur et vermeil. Cettepreuve était convaincante ; on eut recours un remèdeaccoutumé. Le corps d’Arnold fut percé d’un pieu, et l’on assureque, pendant cette opération, il poussa un cri terrible, comme s’ileût été vivant. Ensuite on lui coupa la tête qu’on brûla avec soncorps, et on jeta ses cendres dans son tombeau. Les mêmes mesuresfurent adoptées à l’égard des corps de ceux qui avaient périvictimes du vampire, de peur qu’elles ne le devinssent à leur touret ne tourmentassent les vivants.
On rapporte ici ce conte absurde, parce que,plus que tout autre, il nous a semblé propre à éclaircir le sujetqui nous occupe. Dans plusieurs parties de la Grèce, on considèrele vampirisme comme une punition qui poursuit, après sa mort, celuiqui s’est rendu coupable de quelque grand crime durant sa vie. Ilest condamné à tourmenter de préférence par ses visites infernalesles personnes qu’il aimait le plus, celles à qui il était uni parles liens du sang et de la tendresse. C’est à cela que faitallusion un passage du Giaour :
But first on earth, as Vampire sent, etc.
« Mais d’abord envoyé sur ta terre commeun vampire, ton corps s’élancera de sa tombe ; effroi du lieude ta naissance, tu iras sucer le sang de toute ta famille ;et dans l’ombre de la nuit tu tariras les sources de la vie dansles veines de ta fille, de ta sœur et de ton épouse. Pour comblerl’horreur de ce festin barbare qui doit rassasier ton cadavrevivant, tes victimes reconnaîtront leur père avant d’expirer ;elles te maudiront et tu les maudiras. Tes filles périront comme lafleur passagère ; mais une de ces infortunées à qui ton crimesera fatal, la plus jeune, celle que tu aimais le mieux,t’appellera du doux nom de père. En vain ce nom brisera toncœur ; tu seras forcé d’accomplir ta tâche impie, tu verrasses belles couleurs s’effacer de ses joues, la dernière étincellede ses yeux s’éteindre, et sa prunelle d’azur se ternir en jetantsur toi un dernier regard ; alors ta main barbare arracherales tresses de ses blonds cheveux ; une de ses boucles t’eûtparu autrefois le gage de la plus tendre affection, mais maintenantelle sera pour toi un souvenir de son cruel supplice ! Tonsang le plus pur souillera tes lèvres frémissantes et tes dentsagitées d’un tremblement convulsif. Rentre dans ton sombresépulcre, partage les festins des Goules et des Afrites, jusqu’à ceque ces monstres fuient avec horreur un spectre plus barbarequ’eux ! »
Southey a aussi introduit dans son beau poèmede Thalaza, une jeune Arabe, Oneiza, qui, devenue vampire,était sortie du tombeau pour tourmenter son amant chéri ; maison ne peut supposer que ce fût une punition de ses crimes, car elleest représentée dans tout le poème comme un modèle d’innocence etde pureté. Le véridique Tournefort raconte longuement dans sesvoyages des cas étonnants de vampirisme dont il prétend être letémoin oculaire. Calmet, dans son grand ouvrage sur le vampirisme,en rapportant de nombreuses anecdotes qui en expliquent les effets,a donné plusieurs dissertations savantes où il prouve que cetteerreur est aussi répandue chez les peuples barbares que chez lesnations civilisées.
On pourrait ajouter plusieurs notes aussicurieuses qu’intéressantes sur cette superstition horrible etsingulière ; mais elles dépasseraient les bornes d’unavant-propos. On remarquera en finissant, que quoique le nom deVampire soit le plus généralement reçu, il a d’autres synonymesdont on se sert dans les différentes parties du monde, commeVroucolacha, Vardoulacha, Goule,Broucoloka, etc.
************
Au milieu des cercles de la haute société quele retour de l’hiver réunit à Londres, on voyait un seigneur aussiremarquable par ses singularités que par son rang distingué.Spectateur impassible de la gaîté qui l’environnait, il semblait nepouvoir la partager. Si la beauté, par un doux sourire, fixait uninstant son attention, un seul de ses regards la glaçait aussitôtet remplissait d’effroi ces cœurs où la légèreté avait établi sontrône. La source de la terreur qu’il inspirait était inconnue auxpersonnes qui en éprouvaient les effets ; quelques-uns lacherchaient dans ses yeux gris et ternes, qui ne pénétraient pasjusqu’au fond du cœur, mais dont la fixité laissait tomber unregard sombre dont on ne pouvait supporter le poids. Cessingularités le faisaient inviter dans toutes les maisons :tout le monde souhaitait de le voir. Les personnes accoutumées auxsensations fortes, et qui éprouvaient le poids de l’ennui, étaientcharmées d’avoir en leur présence un objet de distraction qui pûtattirer leur attention. Malgré la pâleur mortelle de son visage quene coloraient jamais ni l’aimable incarnat de la pudeur, ni larougeur d’une vive émotion, la beauté de ses traits fit naître àplusieurs femmes coquettes le dessein de le captiver ou d’obtenirde lui au moins quelques marques de ce qu’on appelle affection.Lady Mercer, qui depuis son mariage avait souvent donné prise à lamalignité par la légèreté de sa conduite, se mit sur les rangs, etemploya tous les moyens pour en être remarquée. Ce fut envain : lorsqu’elle se tenait devant lui, quoique ses yeuxfussent en apparence fixés sur elle, ils semblaient ne pasl’apercevoir. On se moqua de son impudence et elle renonça à sesprétentions. Si telle fut sa conduite envers cette femme galante,ce n’est pas qu’il se montrait indifférent aux attraits du beausexe ; mais la réserve avec laquelle il parlait à une épousevertueuse et à une jeune fille innocente laissait croire qu’ilprofessait pour elles un profond respect. Cependant son langagepassait pour séduisant ; et soit que ces avantages fissentsurmonter la crainte qu’il inspirait, soit que sa haine apparentepour le vice le fit rechercher, on le voyait aussi souvent dans lasociété des femmes qui sont l’honneur de leur sexe par leurs vertusdomestiques, que parmi celles qui se déshonorent par leursdérèglements.
À peu près dans le même temps arriva à Londresun jeune homme nommé Aubrey ; orphelin dès son enfance, ilétait demeuré avec une seule sœur, en possession de grands biens.Abandonné à lui-même par ses tuteurs, qui bornant leur mission àconserver sa fortune, avaient laissé le soin de son éducation à desmercenaires, il s’appliqua bien plus à cultiver son imagination queson jugement. Il était rempli de ces sentiments romanesquesd’honneur et de probité qui causent si souvent la ruine des jeunesgens sans expérience. Il croyait que la vertu régnait dans tous lescœurs et que la Providence n’avait laissé le vice dans le monde quepour donner à la scène un effet plus pittoresque, comme dans lesromans. Il ne voyait d’autres misères dans la vie des gens de lacampagne que d’être vêtus d’habits grossiers, qui cependantpréservaient autant du froid que des vêtements plus somptueux, etavaient en outre l’avantage de fournir des sujets piquants à lapeinture par leurs plis irréguliers et leurs couleurs variées. Ilprit, en un mot, les rêves des poètes pour les réalités de la vie.Il était bien fait, libre et opulent : à ces titres, il se vitentouré, dès son entrée dans le monde, par la plupart des mères quis’efforçaient d’attirer ses regards sur leurs filles. Celles-ci parleur maintien composé lorsqu’il s’approchait d’elles, et par leursregards attentifs lorsqu’il ouvrait les lèvres, lui firentconcevoir une haute opinion de ses talents et de son mérite.Attaché comme il était au roman de ses heures solitaires, il futétonné de ne trouver qu’illusion dans les peintures séduisantescontenues dans les ouvrages dont il avait fait son étude. Trouvantquelque compensation dans sa vanité flattée, il était prèsd’abandonner ses rêves, lorsqu’il rencontra l’être extraordinaireque nous avons dépeint plus haut.
Il se plut à l’observer ; mais il lui futimpossible de se former une idée distincte du caractère d’un hommeentièrement absorbé en lui-même, et qui ne donnait d’autre signe deses rapports avec les objets extérieurs qu’en évitant leur contact.Son imagination, entraînée par tout ce qui flattait son penchantpour les idées extravagantes, ne lui permit pas d’observerfroidement le personnage qu’il avait sous les yeux, mais elle formabientôt le héros d’un roman. Aubrey fit connaissance avec lordRuthven, lui témoigna beaucoup d’égards, et parvint enfin à êtretoujours remarqué de lui. Peu à peu, il appris que les affaires desa seigneurie étaient embarrassées, et qu’il se disposait àvoyager. Désireux de connaître à fond ce caractère singulier quiavait jusqu’alors excité sa curiosité sans la satisfaire, Aubreyfit entendre à ses tuteurs que le temps était venu de commencer cesvoyages, qui depuis tant de générations ont été jugés nécessairespour faire avancer à grands pas les jeunes gens dans la carrière duvice. Ils apprennent à écouter sans rougir le récit des intriguesscandaleuses, qu’on raconte avec vanité où dont on fait le sujet deses plaisanteries, selon qu’on a mis plus ou moins d’habileté à lesconduire. Les tuteurs d’Aubrey consentirent à ses désirs. Il fitpart aussitôt de ses intentions à lord Ruthven et fut surpris derecevoir de lui sa proposition de l’accompagner. Flatté d’une tellemarque d’estime de la part de celui qui paraissait n’avoir rien decommun avec les autres hommes, il accepta avec empressement, etdans peu de jours ils eurent traversé le détroit.
Jusque-là, Aubrey n’avait pas eu l’occasiond’étudier le caractère de lord Ruthven, et maintenant même, quoiquela plupart des actions de sa seigneurie fussent exposées à sesregards, il avait de l’embarras à se former un jugement exact de saconduite. Son compagnon de voyage poussait la libéralité jusqu’à laprofusion ; le fainéant, le vagabond, le mendiant recevaientde sa main au-delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire leursbesoins présents. Mais Aubrey ne put s’empêcher de remarquer qu’ilne répandait jamais ses aumônes sur la vertu malheureuse : illa renvoyait toujours avec dureté. Au contraire, lorsqu’un vildébauché venait lui demander quelque chose, non pour subvenir à sesbesoins, mais pour s’enfoncer davantage dans le bourbier de soniniquité, il recevait un don considérable. Aubrey n’attribuaitcette distinction qu’à la plus grande importunité du vice quil’emporte sur la timidité de la vertu indigente. Cependant lesrésultats de la charité de sa seigneurie firent une vive impressionsur son esprit : ceux qui en éprouvaient les effetspérissaient sur l’échafaud ou tombaient dans la plus affreusemisère, comme si une malédiction y était attachée.
À Bruxelles et dans toutes les villes où ilsséjournèrent, Aubrey fut surpris de la vivacité avec laquelle soncompagnon de voyage se jetait dans le centre de tous les vices à lamode. Il fréquentait assidûment les maisons de jeu ; ilpariait, et gagnait toujours, excepté lorsque son adversaire étaitun filou reconnu, et alors il perdait plus que ce qu’il avaitgagné ; mais ni la perte ni le gain n’imprimaient le plusléger changement sur son visage impassible. Cependant lorsqu’ilétait aux prises avec un imprudent jeune homme ou un malheureuxpère de famille, il sortait de sa concentration habituelle ;ses yeux brillaient avec plus d’éclat que ceux du chat cruel quijoue avec la souris expirante. En quittant une ville, il y laissaitle jeune homme, arraché à la société dont il faisait l’ornement,maudissant, dans la solitude, le destin qui l’avait livré à cetesprit malfaisant, tandis que plus d’un père de famille, le cœurdéchiré par les regards éloquents de ses enfants mourant de faim,n’avait pas même une obole à leur offrir pour satisfaire leursbesoins, au lieu d’une fortune naguère considérable. Ruthvenn’emportait aucun argent de la table de jeu ; il perdaitaussitôt, avec celui qui avait déjà ruiné plusieurs joueurs, cet orqu’il venait d’arracher aux mains d’un malheureux. Ces succèssupposaient un certain degré d’habileté, qui toutefois ne pouvaitrésister à la finesse d’un filou expérimenté. Aubrey se proposaitsouvent de faire des représentations à son ami, et de l’engager àse priver d’un plaisir qui causait la ruine de tous, sans luiapporter aucun profit. Il différait toujours dans l’espérance queson ami lui donnerait l’occasion de lui parler à cœur ouvert. Cetteoccasion ne se présentait jamais : lord Ruthven, au fond de savoiture, ou parcourant les paysages les plus pittoresques, étaittoujours le même : ses yeux parlaient moins que ses lèvres.C’était vainement qu’Aubrey cherchait à pénétrer dans le cœur del’objet de sa curiosité ; il ne pouvait découvrir un mystèreque son imagination exaltée commençait à croire surnaturel.
Ils arrivèrent bientôt à Rome, où Aubreyperdit quelque temps son compagnon de voyage. Il le laissa dans lasociété d’une comtesse italienne, tandis que lui visitait lesmonuments et les antiquités de l’ancienne métropole de l’univers.Pendant qu’il se livrait à ces recherches, il reçut des lettres deLondres qu’il ouvrit avec une vive impatience : la premièreétait de sa sœur, elle ne lui parlait que de leur affectionmutuelle ; les autres qui étaient de ses tuteurs le frappèrentd’étonnement. Si l’imagination d’Aubrey s’était jamais forméel’idée que le génie du mal animait lord Ruthven, elle étaitconfirmée dans cette croyance par les lettres qu’il venait de lire.Ses tuteurs le pressaient de se séparer d’un ami dont le caractèreétait profondément dépravé, et que ses talents pour la séduction nerendaient que plus dangereux à la société. On avait découvert queson mépris pour une femme adultère était loin d’avoir pour cause lahaine de ses vices, mais qu’il voulait jouir du plaisir barbare deprécipiter sa victime et la complice de son crime, du faîte de lavertu dans le bourbier de l’infamie et de la dégradation. En unmot, toutes les femmes dont il avait recherché la société, enapparence pour rendre hommage à leur vertu, avaient, depuis sondépart, jeté le masque de la pudeur, et ne rougissaient pasd’exposer aux regards du public la laideur de leurs vices.
Aubrey se détermina à quitter un homme dont lecaractère, sous quelque point de vue qu’il l’eût considéré, ne luiavait jamais rien montré de consolant. Il résolut de chercherquelque prétexte plausible pour se séparer de lui, en se proposantd’ici là de le surveiller de plus près, et de ne laisser aucune deses actions sans la remarquer. Il se fit présenter dans la sociétéque Ruthven fréquentait, et s’aperçut bientôt que le lord cherchaità séduire la fille de la comtesse. En Italie, les jeunes personnesparaissent peu dans le monde avant leur mariage. Il était doncobligé de dresser en secret ses batteries, mais les yeux d’Aubreyle suivaient dans toutes ses démarches et découvrirent bientôtqu’un rendez-vous était donné, dont le résultat devait être laperte d’une jeune fille aussi innocente qu’inconsidérée. Sansperdre de temps, Aubrey se présente à lord Ruthven, lui demandebrusquement quelles sont ses intentions envers cette demoiselle, etlui annonce qu’il a appris qu’il devait avoir cette nuit même uneentrevue avec elle. Lord Ruthven répond que ses intentions sont lesmêmes que celles de tout autre en pareille occasion. Aubrey lepresse et veut savoir s’il songe au mariage. Ruthven se tait etlaisse échapper un sourire ironique. Aubrey se retire et faitsavoir par un billet à sa seigneurie qu’il renonce à l’accompagnerdans le reste de ses voyages. Il ordonne à son domestique dechercher d’autres appartements et court apprendre à la comtessetout ce qu’il savait non seulement sur la conduite de sa fille,mais encore sur le caractère de milord. On mit obstacle aurendez-vous. Le lendemain, lord Ruthven se contenta d’envoyer sondomestique à Aubrey pour lui faire savoir qu’il adhéraitentièrement à ses projets de séparation ; mais il ne laissapercer aucun soupçon sur la part que son ancien ami avait eue dansle dérangement de ses projets.
Après avoir quitté Rome, Aubrey dirigea sespas vers la Grèce, et arriva bientôt à Athènes, après avoirtraversé la péninsule. Il s’y logea dans la maison d’un grec.Bientôt il s’occupa à rechercher les souvenirs d’une anciennegloire sur ces monuments qui, honteux de ne raconter qu’à desesclaves les exploits d’hommes libres, semblaient se cacher dans laterre ou se voiler de lichens variés. Sous te même toit que luivivait une jeune fille si belle, si délicate, qu’un peintrel’aurait choisie pour modèle, s’il avait voulu retracer sur latoile l’image des houris que Mahomet promet au fidèlecroyant ; seulement ses yeux décelaient bien plus d’esprit quene peuvent en avoir ces beautés à qui le prophète refuse une âme.Soit qu’elle dansât dans la plaine, ou qu’elle courût sur lepenchant des montagnes, elle surpassait la gazelle en grâces et enlégèreté. Ianthe accompagnait Aubrey dans ses recherches desmonuments antiques, et souvent le jeune antiquaire était bienexcusable d’oublier en la voyant une ruine qu’il regardaitauparavant comme de la dernière importance pour interpréter unpassage de Pausanias.
Pourquoi s’efforcer de décrire ce que tout lemonde sent, mais que personne ne saurait exprimer ? C’étaientl’innocence, la jeunesse, et la beauté, que n’avaient flétris niles salons ni les bals d’apparat. Tandis qu’Aubrey dessinait lesruines dont il voulait conserver le souvenir, elle se tenait auprèsde lui et observait les effets magiques du pinceau qui retraçaitles scènes du lieu de sa naissance. Tantôt elle lui représentaitles danses de sa patrie, tantôt elle lui dépeignait avecl’enthousiasme de la jeunesse, la pompe d’une noce dont elle avaitété témoin dans son enfance, tantôt, faisant tomber la conversationsur un sujet qui paraissait plus vivement frapper le jeune homme,elle lui répétait tous les contes surnaturels de sa nourrice. Lefeu et la ferme croyance qui animait sa narration excitaientl’attention d’Aubrey. Souvent, tandis qu’elle lui racontaitl’histoire d’un vampire qui avait passé plusieurs années au milieude ses parents et de ses amis les plus chers, et était forcé pourprolonger son existence de quelques mois, de dévorer chaque annéeune femme qu’il aimait, son sang se glaçait dans ses veines,quoiqu’il s’efforçât de rire de ces contes horribles etchimériques. Mais Ianthe lui citait le nom de plusieurs vieillardsqui avaient découvert un vampire vivant au milieu d’eux, aprèsqu’un grand nombre de leurs parents et de leurs enfants eurent ététrouvés morts avec les signes de la voracité de ces monstres.Affligée de son incrédulité, elle le suppliait d’ajouter foi à sonrécit, car on avait remarqué, disait-elle, que ceux qui avaient osémettre en doute l’existence des vampires en avaient trouvé despreuves si terribles qu’ils avaient été forcés de l’avouer, avec ladouleur la plus profonde. Elle lui dépeignit la figure de cesmonstres, telle que la tradition la lui avait montrée, et l’horreurd’Aubrey fut à son comble, lorsque cette peinture lui rappelaexactement les traits de lord Ruthven ; il persista cependantà vouloir lui persuader que ses craintes étaient imaginaires, maisen même temps il était frappé de ce que tout semblait se réunirpour lui faire croire au pouvoir surnaturel de lord Ruthven.
Aubrey s’attachait de plus en plus àIanthe ; son cœur était touché de son innocence quicontrastait si fort avec l’affectation des femmes au milieudesquelles il avait cherché à réaliser ses rêves romanesques. Iltrouvait ridicule la pensée de l’union d’un jeune Anglais avec unegrecque sans éducation, et cependant son amour pour Iantheaugmentait chaque jour. Quelquefois il essayait de se séparerd’elle pour quelque temps ; il se proposait d’aller à larecherche de quelques débris de l’antiquité, résolu de revenirlorsqu’il aurait atteint le but de sa course ; mais lorsqu’ily était parvenu, il ne pouvait fixer son attention sur tes ruinesqui l’environnaient, tant son esprit conservait l’image de cellequi semblait seule en droit d’occuper ses pensées. Ianthe ignoraitl’amour qu’elle avait fait naître ; l’innocence de sesamusements avait toujours le même caractère enfantin. Elleparaissait toujours se séparer d’Aubrey avec répugnance ; maisc’était seulement parce qu’elle ne pouvait pas visiter les lieuxqu’elle aimait à fréquenter, pendant que celui qui l’accompagnaitétait occupé à découvrir ou à dessiner quelque ruine qui avaitéchappé à la main destructive du temps. Elle en avait appelé autémoignage de ses parents au sujet des Vampires, et tous deuxavaient affirmé leur existence en pâlissant d’horreur à ce seulnom. Peu de temps après, Aubrey résolut de faire une de sesexcursions qui ne devait le retenir que quelques heures ;lorsqu’ils apprirent le lieu où il dirigeait ses pas, ils lesupplièrent de revenir avant la nuit, car il serait obligé depasser par un bois où. aucune considération n’aurait pu retenir unGrec après le coucher du soleil. Ils lui dépeignirent ce lieu commele rendez-vous des vampires pour leurs orgies nocturnes, et luiprédirent les plus affreux malheurs, s’il osait s’y aventurer aprèsla fin du jour. Aubrey fit peu de cas de leurs représentations etsouriait de leur frayeur ; mais lorsqu’il les vit trembler àla pensée qu’il osait se moquer de cette puissance infernale etterrible, dont le nom seul les glaçait de terreur, il garda lesilence.
Le lendemain matin, lorsqu’il se préparait àpartir seul pour son excursion, Aubrey fut surpris de laconsternation répandue sur tous les traits de ses hôtes et appritavec étonnement que ses railleries sur la croyance de ces monstresaffreux étaient seules la cause de leur terreur. Au moment de sondépart Ianthe s’approcha de lui, et le supplia avec instance d’êtrede retour avant que la nuit eût rendu à ces êtres horriblesl’exercice de leur pouvoir. Il le promit. Cependant ses recherchesl’occupèrent à un tel point qu’il ne s’aperçut pas que le jourétait à son déclin, et qu’il ne remarqua pas un de ces nuagesnoirs, qui, dans ces climats brûlants, couvrent bientôt toutl’horizon de leur masse épouvantable et déchargent leur rage surles campagne désolées. Il monta à cheval, résolu de regagner par lavitesse de sa course le temps qu’il avait perdu ; mais ilétait trop tard. On connaît à peine le crépuscule dans les climatsméridionaux ; la nuit commença immédiatement après le coucherdu soleil. Avant qu’il eût fait beaucoup de chemin, l’orage éclatadans toute sa furie ; les tonnerres répétés avec fracas parles échos d’alentour faisaient entendre un roulement continuel, lapluie qui tombait par torrents eut bientôt percé le feuillage souslequel il avait cherché un asile ; les éclairs semblaientéclater à ses pieds. Tout d’un coup son cheval épouvanté l’emportarapidement au travers de la forêt, et ne s’arrêta que lorsqu’il futharassé de fatigue. Aubrey découvrit à la lueur des éclairs unechaumière qui s’élevait au-dessus des broussailles quil’environnaient. Il descendit de cheval et s’y dirigea, espérant ytrouver un guide qui le ramenât à la ville, ou un asile contre lesfureurs de la tempête. Comme il s’en approchait, le tonnerre, encessant un moment de gronder, lui permit d’entendre les cris d’unefemme mêlés aux éclats étouffés d’un rire insultant ; maisrappelé à lui par le fracas de la foudre qui éclatait sur sa tête,il force la porte de la chaumière. Il se trouve dans une obscuritéprofonde ; cependant le son des mêmes voix guide encore sespas. On paraît ne pas s’apercevoir de son entrée, quoiqu’il appelleà grands cris ; en s’avançant, il heurte un homme qui lesaisit, et une voix s’écrie : se rira-t-on encore demoi ? Un éclat de rire succède à ses paroles, il se sentalors fortement serré par une force plus qu’humaine ; résolude vendre chèrement sa vie, il oppose de la résistance ; maisc’est en vain, il est bientôt violemment renversé. Son ennemi seprécipitant sur lui, et appuyant son genou sur sa poitrine, portaitdéjà ses mains à sa gorge, lorsque la clarté de plusieurs torches,pénétrant par l’ouverture qui donnait passage à la lumière du jour,le force d’abandonner sa victime, il se lève aussitôt, et s’élancedans la forêt. On entendit le froissement des branches qu’ilheurtait dans sa fuite, et il disparut. La tempête étant apaisée,Aubrey, incapable de mouvement, parvint à se faire entendre ;les gens qui étaient au dehors entrèrent ; la lueur de leurstorches éclaira les murailles nues et le chaume du toit noirci pardes flocons de suie. À la prière d’Aubrey, ils cherchèrent la femmedont les cris l’avaient attiré. Il demeura de nouveau dans lesténèbres ; mais quelle fut son horreur, lorsqu’il reconnutdans un cadavre qu’on apporta auprès de lui la belle compagne deses courses ! Il ferma les yeux, espérant que ce n’était qu’unfantôme créé par son imagination troublée ; mais, lorsqu’illes rouvrit, il aperçut le même corps étendu à son côté ; seslèvres et ses joues étaient également décolorées ; mais lecalme de son visage la rendait aussi intéressante que lorsqu’ellejouissait de la vie. Sou cou et son sein étaient couverts de sanget sa gorge portait les marques des dents qui avaient ouvert saveine. À cette vue, les Grecs, saisis d’horreur, s’écrièrent à lafois : Elle est victime d’un vampire ! On fit àla hâte un brancard. Aubrey y fut déposé à côté de celle qui avaitété tant de fois l’objet de ses rêves. Visions brillantes etfugitives évanouies avec la fleur d’Ianthe ! Il ne pouvaitdémêler ses pensées, son esprit était engourdi et semblait craindrede former une réflexion ; il tenait à la main, presque sans lesavoir, un poignard d’une forme extraordinaire qu’on avait trouvédans la cabane. Ils rencontrèrent bientôt différentes troupes quela mère d’Ianthe avait envoyées à la recherche de sa fille, dèsqu’elle s’était aperçue de son absence. Leurs cris lamentables àl’approche de la ville, apprirent aux parents qu’il était arrivéune catastrophe terrible. Il serait impossible de peindre leurdésespoir ; mais lorsqu’ils reconnurent la cause de la mort deleur fille, ils regardèrent tour à tour son corps inanimé etAubrey. Ils furent inconsolables et moururent tous les deux dedouleur.
Aubrey fut mis au lit ; une fièvreviolente le saisit. Il fut souvent dans le délire ; dans cesintervalles, il prononçait le nom de Ruthven et d’Ianthe ; parune étrange combinaison d’idées, il semblait supplier son ancienami d’épargner l’objet de son amour. D’autres fois, il l’accablaitd’imprécations, et le maudissait comme l’assassin de la jeunefille. Lord Ruthven arriva à Athènes à cette époque, et, on ne saitpar quel motif, dès qu’il apprit l’état d’Aubrey, il vint habiterla même maison que lui, et le soigna constamment. Lorsqu’Aubreysortit du délire, l’aspect d’un homme dont les traits luiprésentaient l’image d’un vampire, le frappa de terreur, maisRuthven, par ses douces paroles, par son repentir de la faute quiavait causé leur séparation, et encore plus par ses attentions, soninquiétude et ses soins assidus, lui rendit bientôt sa présenceagréable. Il paraissait tout à fait changé : ce n’était pluscet être apathique qui avait tant étonné Aubrey. Mais à mesure quecelui-ci recouvra la santé, le lord revint peu à peu à son anciencaractère et Aubrey n’aperçut dans ses traits d’autre différenceque le sourire d’une joie maligne qui venait quelquefois se jouersur ses lèvres, tandis que son regard était fixé sur lui ;Aubrey n’en connaissait pas le motif, mais ce sourire étaitfréquent. Sur la fin de la convalescence du malade, lord Ruthvenparut uniquement occupé, tantôt à considérer les vagues de cettemer qu’aucune marée n’agite, amoncelées par la bise, tantôt àobserver la course de ces globes qui roulent, comme notre monde,autour du soleil immobile ; il semblait vouloir éviter tousles regards.
Ce coup terrible avait beaucoup affaibli lesforces morales d’Aubrey ; et cette vivacité d’imagination quile distinguait autrefois semblait l’avoir abandonné pour jamais. Lesilence et la solitude avaient autant de charmes pour lui que pourlord Ruthven. Mais cette solitude qu’il aimait tant, il ne pouvaitpas la trouver aux environs d’Athènes ; s’il la cherchait aumilieu des ruines qu’il fréquentait autrefois, l’image d’Ianthe setenait auprès de lui ; s’il la cherchait dans la foret, il lavoyait encore errant au milieu des taillis, courant d’un piedléger, ou occupée à cueillir la modeste violette, puis tout d’uncoup elle lui montrait, en se retournant, son visage couvert d’unepâleur mortelle et sa gorge ensanglantée, tandis qu’un souriremélancolique errait sur ses lèvres décolorées. Il résolut de fuirune contrée où tout lui rappelait des souvenirs amers. Il proposa àlord Ruthven, à qui il se sentait uni par les liens de lareconnaissance, de parcourir ces contrées de la Grèce que personnen’avait encore visitées. Ils voyagèrent dans toutes les directions,n’oubliant aucun lieu célèbre et s’arrêtant devant tous les débrisqui rappelaient un illustre souvenir. Cependant ils paraissaientoccupés de tout autre chose que des objets qu’ils avaient sous lesyeux. Ils entendaient beaucoup parler de brigands, mais ilscommençaient à faire peu de cas de ces bruits, en attribuantl’invention aux habitants qui avaient intérêt à exciter ainsi lagénérosité de ceux qu’ils protégeraient contre ces prétendusdangers. Négligeant les avis des gens du pays, ils voyagèrent unefois avec un petit nombre de gardes qu’ils avaient pris plutôt pourleur servir de guides que pour les défendre. Au moment où ilsentraient dans un défilé étroit, dans le fond duquel roulait untorrent, dont le lit était encombré d’énormes masses de rocs quis’étaient détachées des précipices voisins, ils recommencèrent à serepentir de leur confiance ; car à peine toute leur troupe futengagée dans cet étroit passage, qu’ils entendirent le sifflementdes balles au-dessus de leurs têtes, et un instant après les échosrépétèrent le bruit de plusieurs coups de feu. Aussitôt leursgardes les abandonnèrent, et coururent se placer derrière desrochers, prêts à faire feu du côté d’où les coups étaient partis.Lord Ruthven et Aubrey, imitant leur exemple, se réfugièrent unmoment à l’abri d’un roc avancé, mais bientôt, honteux de se cacherainsi devant un ennemi dont les cris insultants les défiaientd’avancer, se voyant d’abord exposés à une mort presque certaine,si quelques brigands grimpaient sur les rochers au-dessus d’eux etles prenaient par derrière, ils résolurent d’aller à leurrencontre. À peine eurent-ils dépassé le roc qui les protégeait,que lord Ruthven reçut une balle dans l’épaule qui le renversa.Aubrey courut pour le secourir, et ne songeant pas a son proprepéril, il fut surpris de se voir entouré par les brigands. Lesgardes avaient mis bas les armes, dès que lord Ruthven avait étéblessé.
Par la promesse l’une grande récompense,Aubrey engagea les brigands à transporter son ami blessé dans unechaumière voisine. Il convint avec eux d’une rançon, et ne fut plustroublé par leur présence ; ils se contentèrent de garderl’entrée, jusqu’au retour de leur camarade, qui était allé toucherla somme promise avec un ordre d’Aubrey. Les forces de lord Ruthvens’affaissèrent rapidement ; deux jours après, la gangrène semit à sa blessure ; et la mort semblait s’avancer à grandspas. Sa conduite et son extérieur étaient toujours les mêmes. Ilparaissait aussi insensible à sa douleur qu’aux objets quil’environnaient. Cependant vers la fin du jour son esprit parutfort agité ; ses yeux se fixaient souvent sur Aubrey, qui luiprodiguait ses soins avec la plus grande sollicitude. –« Secourez-moi ! vous le pouvez… Sauvez… je ne dis pas mavie ; rien ne peut la sauver ; je ne la regrette pas plusque le jour qui vient de finir ; mais sauvez mon honneur,l’honneur de votre ami. » – « Comment ? quevoulez-vous dire ? Je ferai tout pour vous », réponditAubrey. – « Je demande bien peu de chose… la vie m’abandonne…je ne puis tout vous expliquer… Mais si vous gardez le silence surce que vous savez de moi, mon honneur sera sans tache… et sipendant quelque temps on ignorait ma mort en Angleterre… et… mavie. » – « Tout le monde l’ignorera. » –« Jurez » cria le mourant en se levant avec force,« jurez par tout ce que votre âme révère, par tout ce qu’ellecraint, jurez que d’un an et un jour, vous ne ferez connaître àaucun être vivant mes crimes et ma mort, quoi qu’il puisse arriver,quoi que vous puissiez voir ! » Ses yeux étincelantssemblaient sortir de leur orbite. « Je le jure », ditAubrey. Lord Ruthven retomba sur son oreiller avec un rire affreuxet il ne respirait plus.
Aubrey se retira pour se reposer, mais il neput dormir ; tous les événements qui avaient marqué sesrelations avec cet homme se retraçaient à son esprit ; il nesavait pourquoi, lorsqu’il se rappelait son serment, un frissonglacé courait dans ses veines, comme s’il eût été agité par unhorrible pressentiment. Il se leva de grand matin, et au moment oùil entrait dans le lieu où il avait laissé le cadavre, il rencontraun des voleurs qui lui dit que, conformément à la promesse qu’ilsavaient faite à sa seigneurie, lui et ses camarades avaienttransporté son corps au sommet d’une montagne ; il ne trouvaaucune trace du corps ni de ses vêtements, quoique les voleurs luijurassent qu’ils l’avaient déposé sur le même rocher qu’ilsindiquaient. Mille conjectures se présentèrent à son esprit, maisil retourna enfin, convaincu qu’on avait enseveli le cadavre aprèsl’avoir dépouillé de ce qui le couvrait.
Lassé d’un pays où il avait éprouvé desmalheurs si terribles, et où tout conspirait à rendre plus profondela mélancolie que des idées superstitieuses avaient fait naîtredans soit âme, il résolut de fuir et arriva bientôt à Smyrne.Tandis qu’il attendait un vaisseau qui devait le transporter àOtrante ou à Naples, il s’occupa à mettre en ordre quelques effetsqui avaient appartenu à lord Ruthven. Entre autres objets il trouvaune cassette qui contenait plusieurs armes offensives plus ou moinspropres à assurer la mort de la victime qui en était frappée ;il y avait plusieurs poignards et sabres orientaux. Pendant qu’ilexaminait leurs formes curieuses, quelle fut sa surprise derencontrer un fourreau dont les ornements étaient du même goût queceux du poignard trouvé dans la fatale cabane ! Ilfrissonna : pour mettre un terme à son incertitude, il courutchercher cette arme et découvrit avec horreur qu’elle s’adaptaitparfaitement avec le fourreau qu’il tenait dans la main. Ses yeuxn’avaient pas besoin d’autres preuves ; il ne pouvait sedétacher du poignard. Aubrey aurait voulu récuser le témoignage desa vue ; mais la forme particulière de l’arme, les ornementsde la poignée pareils à ceux du fourreau, détruisaient tous lesdoutes ; bien plus, l’un et l’autre étaient tachés desang.
Il quitta Smyrne et, en retournent dans sapatrie, il passa à Rome, où il s’informa de la jeune personne, quelord Ruthven avait cherché à séduire. Ses parents étaient dans ladétresse ; ils avaient perdu toute leur fortune, et on n’avaitplus entendu parler de leur fille depuis le départ du lord.L’esprit d’Aubrey était accablé de tant d’horreurs : ilcraignait qu’elle n’eût été la victime du meurtrier d’Ianthe !Toujours plongé dans une sombre rêverie, il ne semblait en sortirque pour presser les postillons, comme si la rapidité de sa courseeût dû sauver la vie à quelqu’un qui lui était cher. Enfin ilarriva bientôt à Calais ; un vent qui paraissait seconder savolonté le conduisit en peu d’heures sur les rivages del’Angleterre ! Il courut à la maison de ses pères, et oubliapour un moment, au milieu des embrassements de sa sœur, le souvenirdu passé. Ses caresses enfantines avaient autrefois gagné sonaffection, et aujourd’hui qu’elle était embellie des charmes et desgrâces de son sexe, sa société était devenue encore plus précieuseà son frère.
Miss Aubrey n’avait pas ces dehors quiséduisent et qui attirent les regards et les applaudissements dansles cercles et les assemblées. Elle ne possédait pas cette légèretébrillante qui n’existe que dans les salons. Son œil bleu nerespirait pas la vivacité d’un esprit enjoué ; mais on voyaits’y peindre cette douce mélancolie que le malheur n’a pas faitnaître, mais qui révèle une âme soupirant après un meilleur monde.Sa démarche n’était pas légère comme celle de la beauté quipoursuit un papillon ou un objet qui l’éblouit par le vif éclat deses couleurs ; elle était calme et réfléchie. Lorsqu’elleétait seule, le sourire de la joie ne venait jamais luire sur sonvisage ; mais quand son frère lui exprimait son affection,quand il oubliait auprès d’elle les chagrins qui troublaient sonrepos, qui aurait préféré à son sourire celui d’une beautévoluptueuse ? Tous ses traits peignaient alors les sentimentsqui étaient naturels à son âme. Elle n’avait que dix-huit ans, etn’avait pas encore paru dans la société, ses tuteurs ayant penséqu’il convenait d’attendre le retour de son frère, qui serait sonprotecteur. On avait décidé que la première assemblée à la courserait l’époque de son entrée dans le monde. Aubrey aurait préférédemeurer dans la maison pour se livrer sans réserve à samélancolie. Il ne pouvait pas prendre un grand intérêt à toutes lesfrivolités de ces réunions, lui qui avait été tourmenté par tousles événements dont il avait été le témoin ; mais il résolutde sacrifier ses goûts à l’intérêt de sa sœur. Ils arrivèrent àLondres et se préparèrent à paraître le lendemain à l’assemblée quidevait avoir lieu à la cour.
La réunion était nombreuse ; il n’y avaitpas eu de réception à la cour depuis longtemps, et tous ceux quiétaient jaloux de se réchauffer au sourire de la royauté y étaientaccourus. Aubrey s’y rendit avec sa sœur. Il se tenait dans uncoin, inattentif à tout ce qui se passait autour de lui, et serappelant avec une douleur amère que c’était dans ce lieu même,qu’il avait vu lord Ruthven pour la première fois, tout à coup ilse sent saisi par le bras, et une voix qu’il reconnut trop bienretentit à son oreille : Souviens-toi de tonserment ! Il osait à peine se retourner, redoutant devoir un spectre qui l’aurait anéanti, lorsqu’il aperçoit, àquelques pas de lui, le même personnage qui avait attiré sonattention dans ce lieu même, lors de sa première entrée dans lemonde. Il ne peut en détourner ses yeux ; mais bientôt sesjambes fléchissent sous le poids de son corps, il est forcé deprendre le bras d’un ami pour se soutenir, se fait jour à traversla foule, se jette dans sa voiture et rentre chez lui. Il sepromène dans sa chambre à pas précipités ; il couvre sa têtede ses mains, comme s’il voulait empêcher que d’autres pensées nejaillissent de son cerveau troublé. Lord Ruthven encore devant lui…le poignard… son serment… tout se réunit pour bouleverser sesidées. Il se croit en proie à un songe affreux… un mort rappelé àla vie ! Il pense que son imagination seule a présenté à sesregards le fantôme de celui dont le souvenir le poursuit sanscesse. Toute autre supposition serait-elle possible ? Ilretourne dans la société ; mais à peine veut-il faire quelquesquestions sur lord Ruthven, que son nom expire sur ses lèvres, etil ne peut rien apprendre. Quelque temps après il conduit sa sœurdans la société d’un de ses proches parents. Il la laisse auprèsd’une dame respectable, et se retire à l’écart pour se livrer auxsouvenirs qui le dévorent. S’apercevant enfin que plusieurspersonnes se retiraient, il sort de sa rêverie et entre dans lasalle voisine ; il y trouve sa sœur entourée d’un groupenombreux, engagé dans une conversation animée ; il veuts’ouvrir un passage jusqu’à elle, lorsqu’une personne, qu’il priaitde se retirer un peu, se retourne et lui montre ces traits qu’ilabhorrait. Aussitôt Aubrey s’élance, saisit sa sœur par le bras, etl’entraîne d’un pas rapide ; à la porte de la rue, il se voitarrêté par la foule des domestiques qui attendaient leursmaîtres ; tandis qu’il passe au milieu d’eux, il entend encorecette voix trop connue lui répéter tout bas : Souviens-toide ton serment ! Il n’ose pas retourner ; mais ilentraîne plus vivement sa sœur et arrive enfin dans sa maison.
Aubrey fut sur le point de perdre l’esprit. Siautrefois le seul souvenir du monstre occupait son imagination,combien plus terrible devait être cette pensée, aujourd’hui qu’ilavait acquis la certitude de son retour à la vie ! Il recevaitles soins de sa sœur sans en apercevoir : c’était en vainqu’elle lui demandait la cause de son brusque départ. Il ne luirépondait que par quelques mots entrecoupés qui la glaçaientd’effroi. Plus il réfléchissait, plus son esprit s’égarait. Sonserment faisait son désespoir ; devait-il laisser le monstrechercher librement une nouvelle victime ? devait-il le laisserdévorer ce qu’il avait de plus cher, sans prévenir les effets d’unerage, qui pouvait être assouvie sur sa propre sœur ? Maisquand il violerait son serment ; quand il dévoilerait sessoupçons, qui ajouterait foi à son récit ? Il pensa que samain devait délivrer le monde d’un tel fléau ; mais,hélas ! il se souvint que le monstre se riait de la mort.Pendant quelques jours, il demeura dans cet état enfermé dans sachambre ; ne voyant personne, et ne mangeant que ce que sasœur lui apportait, en le conjurant, les armes aux yeux, desoutenir sa vie par pitié pour elle. Enfin, ne pouvant plussupporter le silence et a solitude, il quitta sa maison, et erra derue en rue, pour fuir le fantôme qui le poursuivait. Ses vêtementsétaient négligés, et il était exposé aussi souvent aux ardeurs dusoleil qu’à la fraîcheur des nuits. D’abord il rentrait chez luichaque soir : mais bientôt il se couchait là où la fatigue leforçait à s’arrêter. Sa sœur, craignant pour sa sûreté, le faisaitsuivre par ses domestiques ; il se dérobait à eux aussi viteque la pensée. Cependant sa conduite changea tout d’un coup. Frappéde l’idée que son absence laissait ses amis exposés à la fureurd’un monstre qu’ils ne connaissaient pas, il résolut de rentrerdans la société pour surveiller de près lord Ruthven, et ledémasquer malgré son serment, aux yeux de tous ceux qui vivraientdans son intimité. Mais lorsqu’il entrait dans un salon, ses yeuxétaient hagards, il regardait avec un air soupçonneux ; sonagitation intérieure perçait tellement au dehors que sa sœur futenfin obligée de le prier d’éviter une société qui l’affectait sipéniblement. Ses conseils furent inutiles ; alors ses tuteurs,craignant que sa raison ne s’altérât, crurent qu’il était tempsd’employer l’autorité que les parents d’Aubrey leur avaientconfiée.
Voulant lui épargner les accidents et lessouffrances auxquels il était chaque jour exposé dans ses coursesvagabondes, et dérober aux yeux du public les marques de ce qu’ilsprenaient pour de la folie, ils engagèrent un médecin à demeurerdans sa maison et à lui donner des soins assidus. Il parut à peines’apercevoir de sa présence, tant était profonde la préoccupationde son esprit Le désordre de ses idées s’accrut à un tel point,qu’on fut obligé de le renfermer dans sa chambre. Il demeuraitplusieurs jours de suite dans un état de stupeur, d’où rien nepouvait le faire sortir ; sa maigreur était excessive :ses yeux avaient un éclat vitreux. La présence de sa sœur avaitseule le pouvoir d’exciter en lui quelques signes de souvenir etd’affection. Alors il s’avançait brusquement vers elle, lui prenaitles mains, jetait sur elle des regards qui la faisaient trembler,et s’écriait : « Ah ! ne le touche pas ! au nomde l’amitié qui nous unit, ne t’approche pas de lui ! »En vain elle lui demandait de qui il voulait parler, il nerépondait que ces mots : « C’est vrai ! ce n’est quetrop vrai ! » et il retombait dans le même étatd’insensibilité. Plusieurs mois se passèrent ainsi ;cependant, à mesure que l’année s’écoulait, ses momentsd’aliénation devinrent moins fréquents ; sa sombre mélancolieparut s’éclaircir par degrés. Ses tuteurs observèrent qu’ilcomptait sur ses doigts un nombre déterminé, et qu’alors ilsouriait.
Le temps avait fui, et l’on était arrivé audernier jour de l’année lorsqu’un des tuteurs d’Aubrey entra danssa chambre, et s’entretint avec le médecin du malheur qui retenaitson pupille dans une situation si déplorable, au moment où sa sœurétait à la veille de se marier. Aussitôt l’attention d’Aubreys’éveilla, il demanda avec inquiétude quel homme elle devaitépouser. Ravis de cette marque d’un retour à la raison qu’ilsn’osaient espérer, ils lui nommèrent le comte de Marsden. Aubreyparut charmé d’entendre le nom de ce jeune homme, qu’il croyaitavoir connu dans la société, et il les étonna en leur exprimant ledésir d’assister aux noces et en demandant à voir sa sœur. Ils nerépondirent rien, mais quelques moments après, sa sœur fut auprèsde lui. Il était encore sensible à son aimable sourire ; il lapressait sur son sein, l’embrassait avec transport. Miss Aubreyversait des larmes de joie en voyant son frère renaître à la santéet aux sentiments de l’amitié fraternelle. Il se mit à lui parleravec son ancienne chaleur et à la féliciter de son mariage avec unhomme si distingué par son rang et ses bonnes qualités ; toutà coup il aperçoit un médaillon suspendu sur sa poitrine, ill’ouvre, et quelle est sa surprise en reconnaissant les traits dumonstre qui avait en tant d’influence sur sa destinée. Il saisit leportrait avec fureur et le foule aux pieds. Sa sœur lui demandepour quel sujet il traite ainsi l’image de son futur époux ;il la regarde et ne l’entend pas… il lui prend les mains ; sonregard est frénétique. « Jure-moi, s’écrie-t-il, jure-moi dene jamais t’unir à ce monstre ; c’est lui… » Il ne peutachever… il croit entendre cette voix connue qui lui rappelle sonserment ; il se retourne soudain, croyant que lord Ruthvenétait derrière lui ; mais il ne voit personne ; sestuteurs et le médecin qui avaient tout entendu accourent, etpensant que c’était un nouvel accès de folie, ils le séparent demiss Aubrey qu’ils engagent à se retirer. Il tombe à genoux, il lessupplie de différer d’un jour le mariage. Ils prennent ses prièrespour une nouvelle preuve de démence, tachent de le calmer et seretirent.
Lord Ruthven s’était présenté chez Aubrey lelendemain de l’assemblée qui avait eu lieu à la cour ; mais onrefusa de le voir comme toutes les autres personnes. Lorsqu’ilapprit la maladie d’Aubrey, il comprit facilement qu’il en était lacause ; mais lorsqu’il sut que son esprit était aliéné, sajoie fut si excessive qu’il put à peine la cacher aux personnes quilui avaient donné cette nouvelle. Il s’empressa de se faireintroduire dans la maison de son ancien ami, et par des soinsassidus, et l’affection qu’il feignait de porter à son frère, ilparvint à se faire aimer de miss Aubrey. Qui pouvait résister aupouvoir de cet homme ? Il racontait avec éloquence les dangersqu’il avait courus. Il se peignait comme un être qui n’avait desympathie sur la terre qu’avec celle à qui il s’adressait. Il luidisait qu’il n’avait connu le prix de la vie, que depuis qu’ilavait eu le bonheur d’entendre les sons touchants de sa voix ;en un mot, il sut si bien mettre en usage cet art funeste dont leserpent se servit le premier, qu’il réussit à gagner son affection.Le titre de la branche aînée lui étant échu, il avait obtenu uneambassade importante, qui lui servit d’excuse pour hâter sonmariage. Malgré l’état déplorable du frère de sa future, il devaitpartir le lendemain pour le continent.
Aubrey, laissé seul par le médecin et sontuteur, tâcha de gagner les domestiques, mais ce fut en vain. Ildemanda des plumes et du papier, on lui en apporta ; ilécrivit une lettre à sa sœur, où il la conjurait, si elle avait àcœur sa félicité, son propre honneur, celui des auteurs de sesjours, qui voyaient en elle l’espérance de leur maison, de retarderde quelques heures un mariage qui devait être la source desmalheurs les plus terribles. Les domestiques promirent de la luiremettre ; mais ils la donnèrent au médecin qui ne voulut pastroubler l’esprit de miss Aubrey par ce qu’il regardait comme lesrêves d’un insensé. La nuit se passa sans que les habitants de lamaison se livrassent au repos. On concevra plus facilement qu’on nepourrait le décrire l’horreur que ces préparatifs inspiraient aumalheureux Aubrey. Le matin arriva, et le fracas des carrosses vintfrapper ses oreilles. Aubrey fut dans un accès de frénésie. Lacuriosité des domestiques l’emporta sur leur vigilance ; ilss’éloignèrent les uns après les autres, le laissant sous la garded’une vieille femme. Il saisit cette occasion, s’élance d’un sautvers la porte et se trouve en un instant au milieu de l’appartementoù tout le monde était rassemblé. Lord Ruthven l’aperçoit lepremier ; il s’en approche aussitôt, le saisit par le brasavec force, et l’entraîne hors du selon, muet de rage. Lorsqu’ilssont sur l’escalier, lord Ruthven lui dit tout bas :« Souviens-toi de ton serment, et sache que ta sœurest déshonorée, si elle n’est pas aujourd’hui mon épouse. Lesfemmes sont fragiles ! » Il dit et le pousse dans lesmains des domestiques qui, rappelés par la vieille femme, étaient àsa recherche. Aubrey ne pouvait plus se soutenir ; sa rage,forcée de se concentrer, causa la rupture d’un vaisseausanguin : on le porta dans son lit. Sa sœur ne sut point cequi venait de se passer ; elle n’était pas dans le salonlorsqu’il y entra et le médecin ne voulut pas l’affliger par cespectacle. Le mariage fut célébré et les nouveaux époux quittèrentLondres.
La faiblesse d’Aubrey augmenta ;l’effusion abondante du sang produisit les symptômes d’une mortprochaine. Il fit appeler ses tuteurs et lorsque minuit eut sonné,il leur raconta avec calme ce que le lecteur vient de lire, etaussitôt il expira.
On vola au secours de miss Aubrey, maislorsqu’on arriva, il était trop tard : Lord Ruthven avaitdisparu et le sang de la sœur d’Aubrey avait éteint la soif d’un Vampire.
 votre commentaire
votre commentaire





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 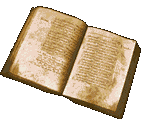
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot