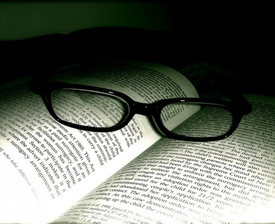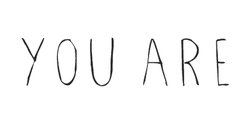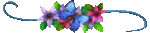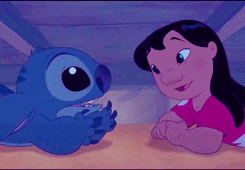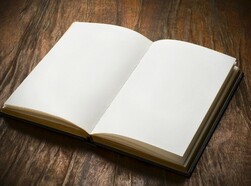-
ROMANS HISTORIQUES

♥ Jean Antoine de Baïf, ce méconnu (Frédéric Fabri)
♥ Les Princesses d'amour : courtisanes japonaises (Judith Gautier)
♥ La Louve Normande (Alfgard du Cotentin)
♥ Pilas ou l'amour sacrifié (Mahboul Ghorba)
♥ L'Odyssée (Homère)
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
-
Par Salomé ATTIA le 23 Décembre 2015 à 20:43
L'Odyssée
Homère

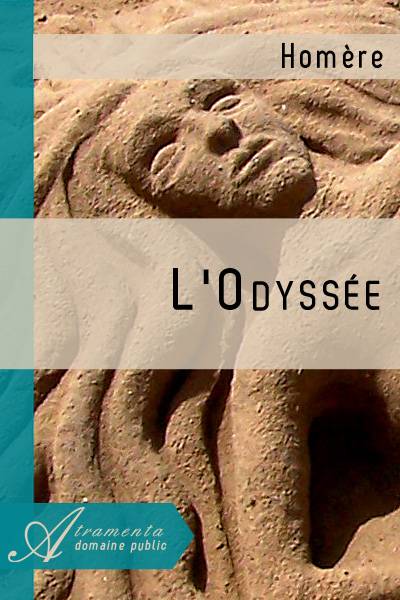
Chant 1
Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu’il eut renversé la citadelle sacrée de Troiè. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit ; et, dans son cœur, il endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons Mais il ne les sauva point, contre son désir ; et ils périrent par leur impiété, les insensés ! ayant mangé les bœufs de Hèlios Hypérionade. Et ce dernier leur ravit l’heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus. Tous ceux qui avaient évité la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans leurs demeures ; mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa femme, et la vénérable Nymphe Kalypsô, la très-noble déesse, le retenait dans ses grottes creuses, le désirant pour mari. Et quand le temps vint, après le déroulement des années, où les Dieux voulurent qu’il revît sa demeure en Ithakè, même alors il devait subir des combats au milieu des siens. Et tous les Dieux le prenaient en pitié, excepté Poseidaôn, qui était toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu’à ce qu’il fût rentré dans son pays.
Et Poseidaôn était allé chez les Aithiopiens qui habitent au loin et sont partagés en deux peuples, dont l’un regarde du côté de Hypériôn, au couchant, et l’autre au levant. Et le Dieu y était allé pour une hécatombe de taureaux et d’agneaux. Et comme il se réjouissait, assis à ce repas, les autres Dieux étaient réunis dans la demeure royale de Zeus Olympien.
Et le Père des hommes et des Dieux commença de leur parler, se rappelant dans son cœur l’irréprochable Aigisthos que l’illustre Orestès Agamemnonide avait tué. Se souvenant de cela, il dit ces paroles aux Immortels :
– Ah ! combien les hommes accusent les Dieux ! Ils disent que leurs maux viennent de nous, et, seuls, ils aggravent leur destinée par leur démence. Maintenant, voici qu’Aigisthos, contre le destin, a épousé la femme de l’Atréide et a tué ce dernier, sachant quelle serait sa mort terrible ; car nous l’avions prévenu par Herméias, le vigilant tueur d’Argos, de ne point tuer Agamemnôn et de ne point désirer sa femme, de peur que l’Atréide Orestès se vengeât, ayant grandi et désirant revoir son pays. Herméias parla ainsi, mais son conseil salutaire n’a point persuadé l’esprit d’Aigisthos, et, maintenant, celui-ci a tout expié d’un coup.
Et Athènè, la Déesse aux yeux clairs, lui répondit :
– Ô notre Père, Kronide, le plus haut des Rois ! celui-ci du moins a été frappé d’une mort juste. Qu’il meure ainsi celui qui agira de même ! Mais mon cœur est déchiré au souvenir du brave Odysseus, le malheureux ! qui souffre depuis longtemps loin des siens, dans une île, au milieu de la mer, et où en est le centre. Et, dans cette île plantée d’arbres, habite une Déesse, la fille dangereuse d’Atlas, lui qui connaît les profondeurs de la mer, et qui porte les hautes colonnes dressées entre la terre et l’Ouranos.
Et sa fille retient ce malheureux qui se lamente et qu’elle flatte toujours de molles et douces paroles, afin qu’il oublie Ithakè ; mais il désire revoir la fumée de son pays et souhaite de mourir. Et ton cœur n’est point touché, Olympien, par les sacrifices qu’Odysseus accomplissait pour toi auprès des nefs Argiennes, devant la grande Troiè. Zeus, pourquoi donc es-tu si irrité contre lui ?
Et Zeus qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi :
– Mon enfant, quelle parole s’est échappée d’entre tes dents ? Comment pourrais-je oublier le divin Odysseus, qui, par l’intelligence, est au-dessus de tous les hommes, et qui offrait le plus de sacrifices aux Dieux qui vivent toujours et qui habitent le large Ouranos ? Mais Poseidaôn qui entoure la terre est constamment irrité à cause du Kyklôps qu’Odysseus a aveuglé, Polyphèmos tel qu’un Dieu, le plus fort des Kyklôpes. La Nymphe Thoôsa, fille de Phorkyn, maître de la mer sauvage, l’enfanta, s’étant unie à Poseidaôn dans ses grottes creuses. C’est pour cela que Poseidaôn qui secoue la terre, ne tuant point Odysseus, le contraint d’errer loin de son pays. Mais nous, qui sommes ici, assurons son retour ; et Poseidaôn oubliera sa colère, car il ne pourra rien, seul, contre tous les dieux immortels.
Et la Déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Ô notre Père, Kronide, le plus haut des Rois ! s’il plaît aux Dieux heureux que le sage Odysseus retourne en sa demeure, envoyons le Messager Herméias, tueur d’Argos, dans l’île Ogygiè, afin qu’il avertisse la Nymphe à la belle chevelure que nous avons résolu le retour d’Odysseus à l’âme forte et patiente.
Et moi j’irai à Ithakè, et j’exciterai son fils et lui inspirerai la force, ayant réuni l’agora des Akhaiens chevelus, de chasser tous les Prétendants qui égorgent ses brebis nombreuses et ses bœufs aux jambes torses et aux cornes recourbées. Et je l’enverrai à Spartè et dans la sablonneuse Pylos, afin qu’il s’informe du retour de son père bien-aimé, et qu’il soit très honoré parmi les hommes.
Ayant ainsi parlé, elle attacha à ses pieds de belles sandales ambroisiennes, dorées, qui la portaient sur la mer et sur l’immense terre comme le souffle du vent. Et elle prit une forte lance, armée d’un airain aigu, lourde, grande et solide, avec laquelle elle dompte la foule des hommes héroïques contre qui, fille d’un père puissant, elle est irritée. Et, s’étant élancée du faite de l’Olympos, elle descendit au milieu du peuple d’Ithakè, dans le vestibule d’Odysseus, au seuil de la cour, avec la lance d’airain en main, et semblable à un étranger, au chef des Taphiens, à Mentès.
Et elle vit les prétendants insolents qui jouaient aux jetons devant les portes, assis sur la peau des bœufs qu’ils avaient tués eux-mêmes.
Et des hérauts et des serviteurs s’empressaient autour d’eux ; et les uns mêlaient l’eau et le vin dans les kratères ; et les autres lavaient les tables avec les éponges poreuses ; et, les ayant dressées, partageaient les viandes abondantes. Et, le premier de tous, le divin Tèlémakhos vit Athènè. Et il était assis parmi les prétendants, le cœur triste, voyant en esprit son brave père revenir soudain, chasser les prétendants hors de ses demeures, ressaisir sa puissance et régir ses biens.
Or, songeant à cela, assis parmi eux, il vit Athènè : et il alla dans le vestibule, indigné qu’un étranger restât longtemps debout à la porte. Et il s’approcha, lui prit la main droite, reçut la lance d’airain et dit ces paroles ailées :
– Salut, Étranger. Tu nous seras ami, et, après le repas, tu nous diras ce qu’il te faut.
Ayant ainsi parlé, il le conduisit, et Pallas Athènè le suivit. Et lorsqu’ils furent entrés dans la haute demeure, il appuya la lance contre une longue colonne, dans un arsenal luisant où étaient déjà rangées beaucoup d’autres lances d’Odysseus à l’âme ferme et patiente. Et il fit asseoir Athènè, ayant mis un beau tapis bien travaillé sur le thrône, et, sous ses pieds, un escabeau. Pour lui-même il plaça auprès d’elle un siège sculpté, loin des prétendants, afin que l’étranger ne souffert point du repas tumultueux, au milieu de convives injurieux, et afin de l’interroger sur son père absent.
Et une servante versa, pour les ablutions, de l’eau dans un bassin d’argent, d’une belle aiguière d’or ; et elle dressa auprès d’eux une table luisante. Puis, une intendante vénérable apporta du pain et couvrit la table de mets nombreux et réservés ; et un découpeur servit les plats de viandes diverses et leur offrit des coupes d’or ; et un héraut leur servait souvent du vin.
Et les prétendants insolents entrèrent. Ils s’assirent en ordre sur des sièges et sur des thrônes : et des hérauts versaient de l’eau sur leurs mains ; et les servantes entassaient le pain dans les corbeilles, et les jeunes hommes emplissaient de vin les kratères. Puis, les prétendants mirent la main sur les mets ; et, quand leur faim et leur soif furent assouvies, ils désirèrent autre chose, la danse et le chant, ornements des repas. Et un héraut mit une très belle kithare aux mains de Phèmios, qui chantait là contre son gré. Et il joua de la kithare et commença de bien chanter.
Mais Tèlémakhos dit à Athènè aux yeux clairs, en penchant la tête, afin que les autres ne pussent entendre :
– Cher Étranger, seras-tu irrité de mes paroles ? La kithare et le chant plaisent aisément à ceux-ci, car ils mangent impunément le bien d’autrui, la richesse d’un homme dont les ossements blanchis pourrissent à la pluie, quelque part, sur la terre ferme ou dans les flots de la mer qui les roule.
Certes, s’ils le voyaient de retour à Ithakè, tous préféreraient des pieds rapides à l’abondance de l’or et aux riches vêtements ! Mais il est mort, subissant une mauvaise destinée ; et il ne nous reste plus d’espérance, quand même un des habitants de la terre nous annoncerait son retour, car ce jour n’arrivera jamais.
Mais parle-moi, et réponds sincèrement. Qui es-tu, et de quelle race ? Où est ta ville et quels sont tes parents ? Sur quelle nef es-tu venu ? Quels matelots t’ont conduit à Ithakè, et qui sont-ils ? Car je ne pense pas que tu sois venu à pied. Et dis-moi vrai, afin que je sache : viens-tu pour la première fois, ou bien es-tu un hôte de mon père ? Car beaucoup d’hommes connaissent notre demeure, et Odysseus aussi visitait les hommes.
Et la Déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Je te dirai des choses sincères. Je me vante d’être Mentès, fils du brave Ankhialos, et je commande aux Taphiens, amis des avirons. Et voici que j’ai abordé ici avec une nef et des compagnons, voguant sur la noire mer vers des hommes qui parlent une langue étrangère, vers Témésè, où je vais chercher de l’airain et où je porte du fer luisant. Et ma nef s’est arrêtée là, près de la campagne, en dehors de la ville, dans le port Rhéitrôs, sous le Néios couvert de bois. Et nous nous honorons d’être unis par l’hospitalité, dès l’origine, et de père en fils.
Tu peux aller interroger sur ceci le vieux Laertès, car on dit qu’il ne vient plus à la ville, mais qu’il souffre dans une campagne éloignée, seul avec une vieille femme qui lui sert à manger et à boire, quand il s’est fatigué à parcourir sa terre fertile plantée de vignes. Et je suis venu, parce qu’on disait que ton père était de retour ; mais les Dieux entravent sa route. Car le divin Odysseus n’est point encore mort sur la terre ; et il vit, retenu en quelque lieu de la vaste mer, dans une île entourée des flots ; et des hommes rudes et farouches, ses maîtres, le retiennent par la force.
Mais, aujourd’hui, je te prédirai ce que les immortels m’inspirent et ce qui s’accomplira, bien que je ne sois point un divinateur et que j’ignore les augures. Certes, il ne restera point longtemps loin de la chère terre natale, même étant chargé de liens de fer. Et il trouvera les moyens de revenir, car il est fertile en ruses. Mais parle, et dis-moi sincèrement si tu es le vrai fils d’Odysseus lui-même. Tu lui ressembles étrangement par la tête et la beauté des yeux. Car nous nous sommes rencontrés souvent, avant son départ pour Troiè, où allèrent aussi, sur leurs nefs creuses, les autres chefs Argiens. Depuis ce temps je n’ai plus vu Odysseus, et il ne m’a plus vu.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Étranger, je te dirai des choses très sincères. Ma mère dit que je suis fils d’Odysseus, mais moi, je n’en sais rien, car nul ne sait par lui-même qui est son père.
Que ne suis-je plutôt le fils de quelque homme heureux qui dût vieillir sur ses domaines ! Et maintenant, on le dit, c’est du plus malheureux des hommes mortels que je suis né, et c’est ce que tu m’as demandé.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Les dieux ne t’ont point fait sortir d’une race sans gloire dans la postérité, puisque Pènélopéia t’a enfanté tel que te voilà. Mais parle, et réponds-moi sincèrement. Quel est ce repas ? Pourquoi cette assemblée ? En avais-tu besoin ? Est-ce un festin ou une noce ? Car ceci n’est point payé en commun, tant ces convives mangent avec insolence et arrogance dans cette demeure ! Tout homme, d’un esprit sensé du moins, s’indignerait de te voir au milieu de ces choses honteuses.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Étranger, puisque tu m’interroges sur ceci, cette demeure fut autrefois riche et honorée, tant que le héros habita le pays ; mais, aujourd’hui, les dieux, source de nos maux, en ont décidé autrement, et ils ont fait de lui le plus ignoré d’entre tous les hommes. Et je ne le pleurerais point ainsi, même le sachant mort, s’il avait été frappé avec ses compagnons, parmi le peuple des Troiens, ou s’il était mort entre des mains amies, après la guerre. Alors les Panakhaiens lui eussent bâti un tombeau, et il eût légué à son fils une grande gloire dans la postérité.
Mais, aujourd’hui, les Harpyes l’ont enlevé obscurément, et il est mort, et nul n’a rien su, ni rien appris de lui, et il ne m’a laissé que les douleurs et les lamentations.
Mais je ne gémis point uniquement sur lui, et les Dieux m’ont envoyé d’autres peines amères. Tous ceux qui commandent aux îles, à Doulikios, à Samè, à Zakyntos couverte de bois, et ceux qui commandent dans la rude Ithakè, tous recherchent ma mère et épuisent ma demeure. Et ma mère ne peut refuser des noces odieuses ni mettre fin à ceci ; et ces hommes épuisent ma demeure en mangeant, et ils me perdront bientôt aussi.
Et, pleine de pitié, Pallas Athènè lui répondit :
– Ah ! sans doute, tu as grand besoin d’Odysseus qui mettrait la main sur ces prétendants injurieux ! Car s’il survenait et se tenait debout sur le seuil de la porte, avec le casque et le bouclier et deux piques, tel que je le vis pour la première fois buvant et se réjouissant dans notre demeure, à son retour d’Ephyrè, d’auprès d’Illos Merméridaïde ; – car Odysseus était allé chercher là, sur une nef rapide, un poison mortel, pour y tremper ses flèches armées d’une pointe d’airain ; et Illos ne voulut point le lui donner, redoutant les dieux qui vivent éternellement, mais mon père, qui l’aimait beaucoup, le lui donna ; – si donc Odysseus, tel que je le vis, survenait au milieu des prétendants, leur destinée serait brève et leurs noces seraient amères !
Mais il appartient aux dieux de décider s’il reviendra, ou non, les punir dans sa demeure. Je t’exhorte donc à chercher comment tu pourras les chasser d’ici.
Maintenant, écoute, et souviens-toi de mes paroles. Demain, ayant réuni l’agora des héros Akhaiens, parle-leur, et prends les dieux à témoin. Contrains les prétendants de se retirer chez eux. Que ta mère, si elle désire d’autres noces, retourne dans la demeure de son père qui a une grande puissance. Ses proches la marieront et lui donneront une aussi grande dot qu’il convient à une fille bien-aimée. Et je te conseillerai sagement, si tu veux m’en croire. Arme ta meilleure nef de vingt rameurs, et va t’informer de ton père parti depuis si longtemps, afin que quelqu’un des hommes t’en parle, ou que tu entendes un de ces bruits de Zeus qui dispense le mieux la gloire aux hommes.
Rends-toi d’abord à Pylos et interroge le divin Nestôr ; puis à Spartè, auprès du blond Ménélaos, qui est revenu le dernier des Akhaiens cuirassés d’airain. Si tu apprends que ton père est vivant et revient, attends encore une année, malgré ta douleur ; mais si tu apprends qu’il est mort, ayant cessé d’exister, reviens dans la chère terre natale, pour lui élever un tombeau et célébrer de grandes funérailles comme il convient, et donner ta mère à un mari. Puis, lorsque tu auras fait et achevé tout cela, songe, de l’esprit et du cœur, à tuer les prétendants dans ta demeure, par ruse ou par force. Il ne faut plus te livrer aux choses enfantines, car tu n’en as plus l’âge.
Ne sais-tu pas de quelle gloire s’est couvert le divin Orestès parmi les hommes, en tuant le meurtrier de son père illustre, Aigisthos aux ruses perfides ? Toi aussi, ami, que voilà grand et beau, sois brave, afin que les hommes futurs te louent. Je vais redescendre vers ma nef rapide et mes compagnons qui s’irritent sans doute de m’attendre. Souviens-toi, et ne néglige point mes paroles.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Étranger, tu m’as parlé en ami, comme un père à son fils, et je n’oublierai jamais tes paroles. Mais reste, bien que tu sois pressé, afin que t’étant baigné et ayant charmé ton cœur, tu retournes vers ta nef, plein de joie, avec un présent riche et précieux qui te viendra de moi et sera tel que des amis en offrent à leurs hôtes.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Ne me retiens plus, il faut que je parte. Quand je reviendrai, tu me donneras ce présent que ton cœur me destine, afin que je l’emporte dans ma demeure. Qu’il soit fort beau, et que je puisse t’en offrir un semblable.
Et Athènè aux yeux clairs, ayant ainsi parlé, s’envola et disparut comme un oiseau ; mais elle lui laissa au cœur la force et l’audace et le souvenir plus vif de son père.
Et lui, le cœur plein de crainte, pensa dans son esprit que c’était un Dieu. Puis, le divin jeune homme s’approcha des Prétendants. Et l’Aoide très illustre chantait, et ils étaient assis, l’écoutant en silence. Et il chantait le retour fatal des Akhaiens, que Pallas Athènè leur avait infligé au sortir de Troiè. Et, de la haute chambre, la fille d’Ikarios, la sage Pènélopéia, entendit ce chant divin, et elle descendit l’escalier élevé, non pas seule, mais suivie de deux servantes. Et quand la divine femme fut auprès des prétendants, elle resta debout contre la porte, sur le seuil de la salle solidement construite, avec un beau voile sur les joues, et les honnêtes servantes se tenaient à ses côtés. Et elle pleura et dit à l’Aoide divin :
– Phèmios, tu sais d’autres chants par lesquels les Aoides célèbrent les actions des hommes et des Dieux. Assis au milieu de ceux-ci, chante-leur une de ces choses, tandis qu’ils boivent du vin en silence ; mais cesse ce triste chant qui déchire mon cœur dans ma poitrine, puisque je suis la proie d’un deuil que je ne puis oublier. Car je pleure une tête bien aimée, et je garde le souvenir
éternel de l’homme dont la gloire emplit Hellas et Argos.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Ma mère, pourquoi défends-tu que ce doux Aoide nous réjouisse, comme son esprit le lui inspire ? Les Aoides ne sont responsables de rien, et Zeus dispense ses dons aux poètes comme il lui plaît.
Il ne faut point t’indigner contre celui-ci parce qu’il chante la sombre destinée des Danaens, car les hommes chantent toujours les choses les plus récentes. Aie donc la force d’âme d’écouter.
Odysseus n’a point perdu seul, à Troiè, le jour du retour, et beaucoup d’autres y sont morts aussi. Rentre dans ta demeure ; continue tes travaux à l’aide de la toile et du fuseau, et remets tes servantes à leur tâche. La parole appartient aux hommes, et surtout à moi qui commande ici.
Étonnée, Pènélopéia s’en retourna chez elle, emportant dans son cœur les sages paroles de son fils. Remontée dans les hautes chambres, avec ses femmes, elle pleura Odysseus, son cher mari, jusqu’à ce que Athènè aux yeux clairs eût répandu un doux sommeil sur ses paupières.
Et les prétendants firent un grand bruit dans la sombre demeure, et tous désiraient partager son lit. Et le sage Tèlémakhos commença de leur parler :
– Prétendants de ma mère, qui avez une insolence arrogante, maintenant réjouissons-nous, mangeons et ne poussons point de clameurs, car il est bien et convenable d’écouter un tel Aoide qui est semblable aux Dieux par sa voix ; mais, dès l’aube, rendons-nous tous à l’agora, afin que je vous déclare nettement que vous ayez tous à sortir d’ici. Faites d’autres repas, mangez vos biens en vous recevant tour à tour dans vos demeures ; mais s’il vous paraît meilleur de dévorer impunément la subsistance d’un seul homme, dévorez-la.
Moi, je supplierai les Dieux qui vivent toujours, afin que Zeus ordonne que votre action soit punie, et vous périrez peut-être sans vengeance dans cette demeure.
Il parla ainsi, et tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient que Tèlémakhos parlât avec cette audace. Et Antinoos, fils d’Eupeithès, lui répondit :
– Tèlémakhos, certes, les Dieux mêmes t’enseignent à parler haut et avec audace ; mais puisse le Kroniôn ne point te faire roi dans Ithakè entourée des flots, bien qu’elle soit ton héritage par ta naissance !
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Antinoos, quand tu t’irriterais contre moi à cause de mes paroles, je voudrais être roi par la volonté de Zeus. Penses-tu qu’il soit mauvais de l’être parmi les hommes ? Il n’est point malheureux de régner. On possède une riche demeure, et on est honoré. Mais beaucoup d’autres rois Akhaiens, jeunes et vieux, sont dans Ithakè entourée des flots. Qu’un d’entre eux règne, puisque le divin Odysseus est mort. Moi, du moins, je serai le maître de la demeure et des esclaves que le divin Odysseus a conquis pour moi.
Et Eurymakhos, fils de Polybos, lui répondit :
– Tèlémakhos, il appartient aux Dieux de décider quel sera l’Akhaien qui régnera dans Ithakè entourée des flots.
Pour toi, possède tes biens et commande en ta demeure, et que nul ne te dépouille jamais par violence et contre ton gré, tant que Ithakè sera habitée. Mais je veux, ami, t’interroger sur cet étranger. D’où est-il ? De quelle terre se vante-t-il de sortir ? Où est sa famille ? Où est son pays ? Apporte-t-il quelque nouvelle du retour de ton père ? Est-il venu réclamer une dette ? Il est parti promptement et n’a point daigné se faire connaître. Son aspect, d’ailleurs, n’est point celui d’un misérable.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Eurymakhos, certes, mon père ne reviendra plus, et je n’en croirais pas la nouvelle, s’il m’en venait ; et je ne me soucie point des prédictions que ma mère demande au divinateur qu’elle a appelé dans cette demeure. Mais cet hôte de mes pères est de Taphos ; et il se vante d’être Mentès, fils du brave Ankhialos, et il commande aux Taphiens, amis des avirons.
Et Tèlémakhos parla ainsi ; mais, dans son cœur, il avait reconnu la déesse immortelle. Donc, les prétendants, se livrant aux danses et au chant, se réjouissaient en attendant le soir, et comme ils se réjouissaient, la nuit survint. Alors, désirant dormir, chacun d’eux rentra dans sa demeure.
Et Tèlémakhos monta dans la chambre haute qui avait été construite pour lui dans une belle cour, et d’où l’on voyait de tous côtés.
Et il se coucha, l’esprit plein de pensées. Et la sage Eurykléia portait des flambeaux allumés et elle était fille d’Ops Peisènôride, et Laertès l’avait achetée, dans sa première jeunesse, et payée du prix de vingt bœufs, et il l’honorait dans sa demeure, autant qu’une chaste épouse ; mais il ne s’était point uni à elle, pour éviter la colère de sa femme. Elle portait des flambeaux allumés auprès de Tèlémakhos, étant celle qui l’aimait le plus, l’ayant nourri et élevé depuis son enfance. Elle ouvrit les portes de la chambre solidement construite. Et il s’assit sur le lit, ôta sa molle tunique et la remit entre les mains de la vieille femme aux sages conseils. Elle plia et arrangea la tunique avec soin et la suspendit à un clou auprès du lit sculpté. Puis, sortant de la chambre, elle attira la porte par un anneau d’argent dans lequel elle poussa le verrou à l’aide d’une courroie. Et Tèlémakhos, couvert d’une toison de brebis, médita, pendant toute la nuit, le voyage que Athènè lui avait conseillé.Chant 2
Quand Eôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, le cher fils d’Odysseus quitta son lit. Et il se vêtit, et il suspendit une épée à ses épaules, et il attacha de belles sandales à ses pieds brillants, et, semblable à un dieu, il se hâta de sortir de sa chambre. Aussitôt, il ordonna aux hérauts à la voix éclatante de convoquer les Akhaiens chevelus à l’agora. Et ils les convoquèrent, et ceux-ci se réunirent rapidement. Et quand ils furent réunis, Tèlémakhos se rendit à l’agora, tenant à la main une lance d’airain. Et il n’était point seul, mais deux chiens rapides le suivaient. Et Pallas avait répandu sur lui une grâce divine, et les peuples l’admiraient tandis qu’il s’avançait. Et il s’assit sur le siège de son père, que les vieillards lui cédèrent.
Et, aussitôt parmi eux, le héros Aigyptios parla le premier. Il était courbé par la vieillesse et il savait beaucoup de choses. Et son fils bien-aimé, le brave Antiphos, était parti, sur les nefs creuses, avec le divin Odysseus, pour Ilios, nourrice de beaux chevaux ; mais le féroce Kyklôps l’avait tué dans sa caverne creuse, et en avait fait son dernier repas. Il lui restait trois autres fils, et un d’entre eux, Eurynomos, était parmi les prétendants. Les deux autres s’occupaient assidûment des biens paternels. Mais Aigyptios gémissait et se lamentait, n’oubliant point Antiphos. Et il parla ainsi en pleurant, et il dit :
– Écoutez maintenant, Ithakèsiens, ce que je vais dire.
Nous n’avons jamais réuni l’agora, et nous ne nous y sommes point assis depuis que le divin Odysseus est parti sur ses nefs creuses. Qui nous rassemble ici aujourd’hui ? Quelle nécessité le presse ? Est-ce quelqu’un d’entre les jeunes hommes ou d’entre les vieillards ? A-t-il reçu quelque nouvelle de l’armée, et veut-il nous dire hautement ce qu’il a entendu le premier ? Ou désire-t-il parler de choses qui intéressent tout le peuple ? Il me semble plein de justice. Que Zeus soit propice à son dessein, quel qu’il soit.
Il parla ainsi, et le cher fils d’Odysseus se réjouit de cette louange, et il ne resta pas plus longtemps assis, dans son désir de parler. Et il se leva au milieu de l’agora, et le sage héraut Peisènôr lui mit le sceptre en main. Et, se tournant vers Aigyptios, il lui dit :
– Ô vieillard, il n’est pas loin, et, dès maintenant, tu peux le voir, celui qui a convoqué le peuple, car une grande douleur m’accable. Je n’ai reçu aucune nouvelle de l’armée que je puisse vous rapporter hautement après l’avoir apprise le premier, et je n’ai rien à dire qui intéresse tout le peuple ; mais j’ai à parler de mes propres intérêts et du double malheur tombé sur ma demeure ; car, d’une part, j’ai perdu mon père irréprochable, qui autrefois vous commandait, et qui, pour vous aussi, était doux comme un père ; et, d’un autre côté, voici maintenant, – et c’est un mal pire qui détruira bientôt ma demeure et dévorera tous mes biens, – que des prétendants assiègent ma mère contre sa volonté.
Et ce sont les fils bien-aimés des meilleurs d’entre ceux qui siègent ici. Et ils ne veulent point se rendre dans la demeure d’Ikarios, père de Pènélopéia, qui dotera sa fille et la donnera à qui lui plaira davantage. Et ils envahissent tous les jours notre demeure, tuant mes bœufs, mes brebis et mes chèvres grasses, et ils en font des repas magnifiques, et ils boivent mon vin noir effrontément et dévorent tout. Il n’y a point ici un homme tel qu’Odysseus qui puisse repousser cette ruine loin de ma demeure, et je ne puis rien, moi qui suis inhabile et sans force guerrière. Certes, je le ferais si j’en avais la force, car ils commettent des actions intolérables, et ma maison périt honteusement.
Indignez-vous donc, vous-mêmes. Craignez les peuples voisins qui habitent autour d’Ithakè, et la colère des dieux qui puniront ces actions iniques. Je vous supplie, par Zeus Olympien, ou par Thémis qui réunit ou qui disperse les agoras des hommes, venez à mon aide, amis, et laissez-moi subir au moins ma douleur dans la solitude. Si jamais mon irréprochable père Odysseus a opprimé les Akhaiens aux belles knèmides, et si, pour venger leurs maux, vous les excitez contre moi, consumez plutôt vous-mêmes mes biens et mes richesses ; car, alors, peut-être verrions-nous le jour de l’expiation. Nous pourrions enfin nous entendre devant tous, expliquant les choses jusqu’à ce qu’elles soient résolues.
Il parla ainsi, irrité, et il jeta son sceptre contre terre en versant des larmes, et le peuple fut rempli de compassion, et tous restaient dans le silence, et nul n’osait répondre aux paroles irritées de Tèlémakhos.
Et Antinoos seul, lui répondant, parla ainsi :
– Tèlémakhos, agorète orgueilleux et plein de colère, tu as parlé en nous outrageant, et tu veux nous couvrir d’une tache honteuse. Les prétendants Akhaiens ne t’ont rien fait. C’est plutôt ta mère, qui, certes, médite mille ruses. Voici déjà la troisième année, et bientôt la quatrième, qu’elle se joue du cœur des Akhaiens. Elle les fait tous espérer, promet à chacun, envoie des messages et médite des desseins contraires. Enfin, elle a ourdi une autre ruse dans son esprit. Elle a tissé dans ses demeures une grande toile, large et fine, et nous a dit :
– Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Odysseus est mort, cessez de hâter mes noces jusqu’à ce que j’aie achevé, pour que mes fils ne restent pas inutiles, ce linceul du héros Laertès, quand la Moire mauvaise de la mort inexorable l’aura saisi, afin qu’aucune des femmes Akhaiennes ne puisse me reprocher, devant tout le peuple, qu’un homme qui a possédé tant de biens ait été enseveli sans linceul.
Elle parla ainsi, et notre cœur généreux fut aussitôt persuadé. Et, alors, pendant le jour, elle tissait la grande toile, et, pendant la nuit, ayant allumé les torches, elle la défaisait. Ainsi, trois ans, elle cacha sa ruse et trompa les Akhaiens ; mais quand vint la quatrième année, et quand les saisons recommencèrent, une de ses femmes, sachant bien sa ruse, nous la dit.
Et nous la trouvâmes défaisant sa belle toile. Mais, contre sa volonté, elle fut contrainte de l’achever. Et c’est ainsi que les prétendants te répondent, afin que tu le saches dans ton esprit, et que tous les Akhaiens le sachent aussi. Renvoie ta mère et ordonne-lui de se marier à celui que son père choisira et qui lui plaira à elle-même. Si elle a abusé si longtemps les fils des Akhaiens, c’est qu’elle songe, dans son cœur, à tous les dons que lui a faits Athènè, à sa science des travaux habiles, à son esprit profond, à ses ruses. Certes, nous n’avons jamais entendu dire rien de semblable des Akhaiennes aux belles chevelures, qui vécurent autrefois parmi les femmes anciennes, Tyrô, Alkmènè et Mykènè aux beaux cheveux. Nulle d’entre elles n’avait des arts égaux à ceux de Pènélopéia ; mais elle n’en use pas avec droiture. Donc, les prétendants consumeront tes troupeaux et tes richesses tant qu’elle gardera le même esprit que les dieux mettent maintenant dans sa poitrine. À la vérité, elle remportera une grande gloire, mais il ne t’en restera que le regret de tes biens dissipés ; car nous ne retournerons point à nos travaux, et nous n’irons point en quelque autre lieu, avant qu’elle ait épousé celui des Akhaiens qu’elle choisira.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Antinoos, je ne puis renvoyer de ma demeure, contre son gré, celle qui m’a enfanté et qui m’a nourri. Mon père vit encore quelque part sur la terre, ou bien il est mort, et il me sera dur de rendre de nombreuses richesses à Ikarios, si je renvoie ma mère.
J’ai déjà subi beaucoup de maux à cause de mon père, et les dieux m’en enverront d’autres après que ma mère, en quittant ma demeure, aura supplié les odieuses Érinnyes, et ce sont les hommes qui la vengeront. Et c’est pourquoi je ne prononcerai point une telle parole. Si votre cœur s’en indigne, sortez de ma demeure, songez à d’autres repas, mangez vos propres biens en des festins réciproques. Mais s’il vous semble meilleur et plus équitable de dévorer impunément la subsistance d’un seul homme, faites ! Moi, j’invoquerai les dieux éternels. Et si jamais Zeus permet qu’un juste retour vous châtie, vous périrez sans vengeance dans ma demeure.
Tèlémakhos parla ainsi, et Zeus qui regarde au loin fit voler du haut sommet d’un mont deux aigles qui s’enlevèrent au souffle du vent, et, côte à côte, étendirent leurs ailes. Et quand ils furent parvenus au-dessus de l’agora bruyante, secouant leurs plumes épaisses, ils en couvrirent toutes les têtes, en signe de mort. Et, de leurs serres, se déchirant la tête et le cou, ils s’envolèrent sur la droite à travers les demeures et la ville des Ithakèsiens. Et ceux-ci, stupéfaits, voyant de leurs yeux ces aigles, cherchaient dans leur esprit ce qu’ils présageaient. Et le vieux héros Halithersès Mastoride leur parla. Et il l’emportait sur ses égaux en âge pour expliquer les augures et les destinées. Et, très-sage, il parla ainsi au milieu de tous :
– Écoutez maintenant, Ithakèsiens, ce que je vais dire. Ce signe s’adresse plus particulièrement aux prétendants.
Un grand danger est suspendu sur eux, car Odysseus ne restera pas longtemps encore loin de ses amis ; mais voici qu’il est quelque part près d’ici et qu’il prépare aux prétendants la Kèr et le carnage. Et il arrivera malheur à beaucoup parmi ceux qui habitent l’illustre Ithakè. Voyons donc, dès maintenant, comment nous éloignerons les Prétendants, à moins qu’ils se retirent d’eux-mêmes, et ceci leur serait plus salutaire. Je ne suis point, en effet, un divinateur inexpérimenté, mais bien instruit ; car je pense qu’elles vont s’accomplir les choses que j’ai prédites à Odysseus quand les Argiens partirent pour Ilios, et que le subtil Odysseus les commandait. Je dis qu’après avoir subi une foule de maux et perdu tous ses compagnons, il reviendrait dans sa demeure vers la vingtième année. Et voici que ces choses s’accomplissent.
Et Eurymakhos, fils de Polybos, lui répondit :
– Ô Vieillard, va dans ta maison faire des prédictions à tes enfants, de peur qu’il leur arrive malheur dans l’avenir ; mais ici je suis de beaucoup meilleur divinateur que toi. De nombreux oiseaux volent sous les rayons de Hèlios, et tous ne sont pas propres aux augures. Certes, Odysseus est mort au loin, et plût aux dieux que tu fusses mort comme lui ! Tu ne proférerais pas tant de prédictions vaines, et tu n’exciterais pas ainsi Tèlémakhos déjà irrité, avec l’espoir sans doute qu’il t’offrira un présent dans sa maison.
Mais je te le dis, et ceci s’accomplira : Si, le trompant par ta science ancienne et tes paroles, tu pousses ce jeune homme à la colère, tu lui seras surtout funeste ; car tu ne pourras rien contre nous ; et nous t’infligerons, ô vieillard, une amende que tu déploreras dans ton cœur, la supportant avec peine ; et ta douleur sera accablante.
Moi, je conseillerai à Tèlémakhos d’ordonner que sa mère retourne chez Ikarios, afin que les siens célèbrent ses noces et lui fassent une dot illustre, telle qu’il convient d’en faire à une fille bien-aimée. Je ne pense pas qu’avant cela les fils des Akhaiens restent en repos et renoncent à l’épouser ; car nous ne craignons personne, ni, certes, Tèlémakhos, bien qu’il parle beaucoup ; et nous n’avons nul souci, ô Vieillard, de tes vaines prédictions, et tu ne nous en seras que plus odieux. Les biens de Tèlémakhos seront de nouveau consumés, et ce sera ainsi tant que Pènélopéia retiendra les Akhaiens par l’espoir de ses noces. Et, en effet, c’est à cause de sa vertu que nous attendons de jour en jour, en nous la disputant, et que nous n’irons point chercher ailleurs d’autres épouses.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Eurymakhos, et tous, tant que vous êtes, illustres prétendants, je ne vous supplierai ni ne vous parlerai plus longtemps. Les dieux et tous les Akhaiens savent maintenant ces choses.
Mais donnez-moi promptement une nef rapide et vingt compagnons qui fendent avec moi les chemins de la mer. J’irai à Spartè et dans la sablonneuse Pylos m’informer du retour de mon père depuis longtemps absent. Ou quelqu’un d’entre les hommes m’en parlera, ou j’entendrai la renommée de Zeus qui porte le plus loin la gloire des hommes. Si j’entends dire que mon père est vivant et revient, j’attendrai encore une année, bien qu’affligé. Si j’entends dire qu’il est mort et ne doit plus reparaître, je reviendrai dans la chère terre de la patrie, je lui élèverai un tombeau, je célébrerai d’illustres funérailles, telles qu’il convient, et je donnerai ma mère à un mari.
Ayant ainsi parlé, il s’assit. Et au milieu d’eux se leva Mentôr, qui était le compagnon de l’irréprochable Odysseus. Et celui-ci, comme il partait, lui confia toute sa maison, lui remit ses biens en garde et voulut qu’on obéisse au vieillard. Et, au milieu d’eux, plein de sagesse, il parla et dit :
– Écoutez-moi maintenant, Ithakèsiens, quoi que je dise. Craignez qu’un roi porte-sceptre ne soit plus jamais ni bienveillant, ni doux, et qu’il ne médite plus de bonnes actions dans son esprit, mais qu’il soit cruel désormais et veuille l’iniquité, puisque nul ne se souvient du divin Odysseus parmi les peuples auxquels il commandait aussi doux qu’un père. Je ne reproche point aux prétendants orgueilleux de commettre des actions violentes dans un esprit inique, car ils jouent leurs têtes en consumant la demeure d’Odysseus qu’ils pensent ne plus revoir.
Maintenant, c’est contre tout le peuple que je m’irrite, contre vous qui restez assis en foule et qui n’osez point parler, ni réprimer les prétendants peu nombreux, bien que vous soyez une multitude.
Et l’Euènoride Leiôkritos lui répondit :
– Mentôr, injurieux et stupide, qu’as-tu dit ? Tu nous exhortes à nous retirer ! Certes, il serait difficile de chasser violemment du festin tant de jeunes hommes. Même si l’Ithakèsien Odysseus, survenant lui-même, songeait dans son esprit à chasser les illustres prétendants assis au festin dans sa demeure, certes, sa femme, bien qu’elle le désire ardemment, ne se réjouirait point alors de le revoir, car il rencontrerait une mort honteuse, s’il combattait contre un si grand nombre. Tu n’as donc point bien parlé. Allons ! dispersons-nous, et que chacun retourne à ses travaux. Mentôr et Halithersès prépareront le voyage de Tèlémakhos, puisqu’ils sont dès sa naissance ses amis paternels. Mais je pense qu’il restera longtemps ici, écoutant des nouvelles dans Ithakè, et qu’il n’accomplira point son dessein.
Ayant ainsi parlé, il rompit aussitôt l’agora, et ils se dispersèrent, et chacun retourna vers sa demeure. Et les prétendants se rendirent à la maison du divin Odysseus.
Et Tèlémakhos s’éloigna sur le rivage de la mer, et, plongeant ses mains dans la blanche mer, il supplia Athènè :
– Entends-moi, déesse qui es venue hier dans ma demeure, et qui m’as ordonné d’aller sur une nef, à travers la mer sombre, m’informer de mon père depuis longtemps absent. Et voici que les Akhaiens m’en empêchent, et surtout les orgueilleux prétendants.
Il parla ainsi en priant, et Athènè parut auprès de lui, semblable à Mentôr par l’aspect et par la voix, et elle lui dit ces paroles ailées :
– Tèlemakhos, tu ne seras ni un lâche, ni un insensé, si l’excellent esprit de ton père est en toi, tel qu’il le possédait pour parler et pour agir, et ton voyage ne sera ni inutile, ni imparfait. Si tu n’étais le fils d’Odysseus et de Pènélopéia, je n’espérerais pas que tu pusses accomplir ce que tu entreprends, car peu de fils sont semblables à leur père. La plupart sont moindres, peu son meilleurs que leurs parents. Mais tu ne seras ni un lâche, ni un insensé, puisque l’intelligence d’Odysseus est restée en toi, et tu dois espérer accomplir ton dessein. C’est pourquoi oublie les projets et les résolutions des prétendants insensés, car ils ne sont ni prudents, ni équitables, et ils ne songent point à la mort et à la kèr noire qui vont les faire périr tous en un seul jour. Ne tarde donc pas plus longtemps à faire ce que tu as résolu. Moi qui suis le compagnon de ton père, je te préparerai une nef rapide et je t’accompagnerai.
Mais retourne à ta demeure te mêler aux prétendants.
Apprête nos vivres ; enferme le vin dans les amphores, et, dans les outres épaisses, la farine, moelle des hommes. Moi, je te réunirai des compagnons volontaires parmi le peuple. Il y a beaucoup de nefs, neuves et vieilles, dans Ithakè entourée des flots. Je choisirai la meilleure de toutes, et nous la conduirons, bien armée, sur la mer vaste.
Ainsi parla Athènè, fille de Zeus ; et Tèlémakhos ne tarda pas plus longtemps, dès qu’il eut entendu la voix de la Déesse. Et, le cœur triste, il se hâta de retourner dans sa demeure. Et il trouva les prétendants orgueilleux dépouillant les chèvres et faisant rôtir les porcs gras dans la cour. Et Antinoos, en riant, vint au-devant de Tèlémakhos ; et, lui prenant la main, il lui parla ainsi :
– Tèlémakhos, agorète orgueilleux et plein de colère, qu’il n’y ait plus dans ton cœur ni soucis, ni mauvais desseins. Mange et bois en paix comme auparavant. Les Akhaiens agiront pour toi. Ils choisiront une nef et des rameurs, afin que tu ailles promptement à la divine Pylos t’informer de ton illustre père.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Antinoos, il ne m’est plus permis de m’asseoir au festin et de me réjouir en paix avec vous, orgueilleux ! N’est-ce pas assez, prétendants, que vous ayez déjà dévoré mes meilleures richesses, tandis que j’étais enfant ?
Maintenant, je suis plus grand, et j’ai écouté les conseils des autres hommes, et la colère a grandi dans mon cœur. Je tenterai donc de vous apporter la kèr fatale, soit en allant à Pylos, soit ici, par le peuple. Certes, je partirai, et mon voyage ne sera point inutile. J’irai sur une nef louée, puisque je n’ai moi-même ni nef, ni rameurs, et qu’il vous a plu de m’en réduire là.
Ayant parlé, il arracha vivement sa main de la main d’Antinoos. Et les Prétendants préparaient le repas dans la maison. Et ces jeunes hommes orgueilleux poursuivaient Tèlémakhos de paroles outrageantes et railleuses :
– Certes, voici que Tèlémakhos médite notre destruction, soit qu’il ramène des alliés de la sablonneuse Pylos, soit qu’il en ramène de Spartè. Il le désire du moins avec ardeur. Peut-être aussi veut-il aller dans la fertile terre d’Ephyrè, afin d’en rapporter des poisons mortels qu’il jettera dans nos kratères pour nous tuer tous.
Et un autre de ces jeunes hommes orgueilleux disait :
– Qui sait si, une fois parti sur sa nef creuse, il ne périra pas loin des siens, ayant erré comme Odysseus ? Il nous donnerait ainsi un plus grand travail. Nous aurions à partager ses biens, et nous donnerions cette demeure à sa mère et à celui qu’elle épouserait.
Ils parlaient ainsi. Et Tèlémakhos monta dans la haute chambre de son père, où étaient amoncelés l’or et l’airain, et les vêtements dans les coffres, et l’huile abondante et parfumée. Et là aussi étaient des muids de vieux vin doux. Et ils étaient rangés contre le mur, enfermant la boisson pure et divine réservée à Odysseus quand il reviendrait dans sa patrie, après avoir subi beaucoup de maux. Et les portes étaient bien fermées au double verrou, et une femme les surveillait nuit et jour avec une active vigilance ; et c’était Eurykléia, fille d’Ops Peisènôride. Et Tèlémakhos, l’ayant appelée dans la chambre, lui dit :
– Nourrice, puise dans les amphores le plus doux de ces vins parfumés que tu conserves dans l’attente d’un homme très-malheureux, du divin Odysseus, s’il revient jamais, ayant évité la kèr et la mort. Emplis douze vases et ferme-les de leurs couvercles. Verse de la farine dans des outres bien cousues, et qu’il y en ait vingt mesures. Que tu le saches seule, et réunis toutes ces provisions, je les prendrai à la nuit, quand ma mère sera retirée dans sa chambre, désirant son lit. Je vais à Spartè et à la sablonneuse Pylos pour m’informer du retour de mon père bien-aimé.
Il parla ainsi, et sa chère nourrice Eurykléia gémit, et, se lamentant, elle dit ces paroles ailées :
– Pourquoi, cher enfant, as-tu cette pensée ? Tu veux aller à travers tant de pays, ô fils unique et bien-aimé ?
Mais le divin Odysseus est mort, loin de la terre de la patrie, chez un peuple inconnu. Et les prétendants te tendront aussitôt des pièges, et tu périras par ruse, et ils partageront tes biens. Reste donc ici auprès des tiens ! Il ne faut pas que tu subisses des maux et que tu erres sur la mer indomptée.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Rassure-toi, nourrice ; ce dessein n’est point sans l’avis d’un dieu. Mais jure que tu ne diras rien à ma chère mère avant onze ou douze jours, à moins qu’elle me demande ou qu’elle sache que je suis parti, de peur qu’en pleurant elle blesse son beau corps.
Il parla ainsi, et la vieille femme jura le grand serment des dieux. Et, après avoir juré et accompli les formes du serment, elle puisa aussitôt le vin dans les amphores et versa la farine dans les outres bien cousues.
Et Tèlémakhos, entrant dans sa demeure, se mêla aux Prétendants. Alors la déesse Athènè aux yeux clairs songea à d’autres soins. Et, semblable à Tèlémakhos, elle marcha par la ville, parlant aux hommes qu’elle avait choisis et leur ordonnant de se réunir à la nuit sur une nef rapide. Elle avait demandé cette nef rapide à Noèmôn, le cher fils de Phronios, et celui-ci la lui avait confiée très-volontiers. Et Hèlios tomba, et tous les chemins se couvrirent d’ombre. Alors Athènè lança à la mer la nef rapide et y déposa les agrès ordinaires aux nefs bien pontées.
Puis, elle la plaça à l’extrémité du port. Et, autour de la nef, se réunirent tous les excellents compagnons, et la déesse exhortait chacun d’eux.
Alors la déesse Athènè aux yeux clairs songea à d’autres soins. Se hâtant d’aller à la demeure du divin Odysseus, elle y répandit le doux sommeil sur les Prétendants. Elle les troubla tandis qu’ils buvaient, et fit tomber les coupes de leurs mains. Et ils s’empressaient de retourner par la ville pour se coucher, et, à peine étaient-ils couchés, le sommeil ferma leurs paupières. Et la Déesse Athènè aux yeux clairs, ayant appelé Tèlémakhos hors de la maison, lui parla ainsi, ayant pris l’aspect et la voix de Mentôr :
– Tèlémakhos, déjà tes compagnons aux belles knèmides sont assis, l’aviron aux mains, prêts à servir ton ardeur. Allons, et ne tardons pas plus longtemps à faire route.
Ayant ainsi parlé, Pallas Athènè le précéda aussitôt, et il suivit en hâte les pas de la déesse ; et, parvenus à la mer et à la nef, ils trouvèrent leurs compagnons chevelus sur le rivage. Et le divin Tèlémakhos leur dit :
– Venez, amis. Emportons les provisions qui sont préparées dans ma demeure. Ma mère et ses femmes ignorent tout. Ma nourrice seule est instruite.
Ayant ainsi parlé, il les précéda et ils le suivirent. Et ils transportèrent les provisions dans la nef bien pontée, ainsi que le leur avait ordonné le cher fils d’Odysseus. Et Tèlémakhos monta dans la nef, conduit par Athènè qui s’assit à la poupe. Et auprès d’elle s’assit Tèlémakhos. Et ses compagnons détachèrent le câble et se rangèrent sur les bancs de rameurs. Et Athènè aux yeux clairs fit souffler un vent favorable, Zéphyros, qui les poussait en résonnant sur la mer sombre. Puis, Tèlémakhos ordonna à ses compagnons de dresser le mât, et ils lui obéirent. Et ils dressèrent le mât de sapin sur sa base creuse et ils le fixèrent avec des câbles. Puis, ils déployèrent les voiles blanches retenues par des courroies, et le vent les gonfla par le milieu. Et le flot pourpré résonnait le long de la carène de la nef qui marchait et courait sur la mer, faisant sa route. Puis, ayant lié la mâture sur la nef rapide et noire, ils se levèrent debout, avec des kratères pleins de vin, faisant des libations aux Dieux éternels et surtout à la fille aux yeux clairs de Zeus. Et, toute la nuit, jusqu’au jour, la Déesse fit route avec eux.Chant 3
Hèlios, quittant son beau lac, monta dans l’Ouranos d’airain, afin de porter la lumière aux immortels et aux hommes mortels sur la terre féconde. Et ils arrivèrent à Pylos, la citadelle bien bâtie de Nèleus. Et les Pyliens, sur le rivage de la mer, faisaient des sacrifices de taureaux entièrement noirs à Poseidaôn aux cheveux bleus. Et il y avait neuf rangs de sièges, et sur chaque rang cinq cents hommes étaient assis, et devant chaque rang il y avait neuf taureaux égorgés. Et ils goûtaient les entrailles et ils brûlaient les cuisses pour le dieu, quand ceux d’Ithakè entrèrent dans le port, serrèrent les voiles de la nef égale, et, l’ayant amarrée, en sortirent. Et Tèlémakhos sortit aussi de la nef, conduit par Athènè. Et, lui parlant la première, la déesse Athènè aux yeux clairs lui dit :
– Tèlémakhos, il ne te convient plus d’être timide, maintenant que tu as traversé la mer pour l’amour de ton père, afin de t’informer quelle terre le renferme, et quelle a été sa destinée. Allons ! va droit au dompteur de chevaux Nestôr, et voyons quelle pensée il cache dans sa poitrine. Supplie-le de te dire la vérité. Il ne mentira pas, car il est plein de sagesse.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Mentôr, comment l’aborder et comment le saluer ? Je n’ai point l’expérience des sages discours, et un jeune homme a quelque honte d’interroger un vieillard.
Et Athènè, la déesse aux yeux clairs, lui répondit :
– Tèlémakhos, tu y songeras dans ton esprit, ou un dieu te l’inspirera, car je ne pense pas que tu sois né et que tu aies été élevé sans la bienveillance des dieux.
Ayant ainsi parlé, Pallas Athènè le précéda rapidement et il suivit aussitôt la déesse. Et ils parvinrent à l’assemblée où siégeaient les hommes Pyliens. Là était assis Nestôr avec ses fils, et, tout autour, leurs compagnons préparaient le repas, faisaient rôtir les viandes et les embrochaient. Et dès qu’ils eurent vu les étrangers, ils vinrent tous à eux, les accueillant du geste, et ils les firent asseoir. Et le Nestôride Peisistratos, s’approchant le premier, les prit l’un et l’autre par la main et leur fit place au repas, sur des peaux moelleuses qui couvraient le sable marin, auprès de son frère Thrasymèdès et de son père. Puis, il leur offrit des portions d’entrailles, versa du vin dans une coupe d’or, et, la présentant à Pallas Athènè, fille de Zeus tempétueux, il lui dit :
– Maintenant, ô mon hôte, supplie le roi Poseidaôn. Ce festin auquel vous venez tous deux prendre part est à lui. Après avoir fait des libations et imploré le dieu, comme il convient, donne cette coupe de vin doux à ton compagnon, afin qu’il fasse à son tour des libations. Je pense qu’il supplie aussi les immortels. Tous les hommes ont besoin des dieux. Mais il est plus jeune que toi et semble être de mon âge, c’est pourquoi je te donne d’abord cette coupe d’or.
Ayant ainsi parlé, il lui mit aux mains la coupe de vin doux, et Athènè se réjouit de la sagesse et de l’équité du jeune homme, parce qu’il lui avait offert d’abord la coupe d’or. Et aussitôt elle supplia le roi Poseidaôn :
– Entends-moi, Poseidaôn qui contient la terre ! Ne nous refuse pas, à nous qui t’en supplions, d’accomplir notre dessein. Glorifie d’abord Nestôr et ses fils, et sois aussi favorable à tous les Pyliens en récompense de cette illustre hécatombe. Fais, enfin, que Tèlémakhos et moi nous retournions, ayant accompli l’œuvre pour laquelle nous sommes venus sur une nef noire et rapide.
Elle pria ainsi, exauçant elle-même ses vœux. Et elle donna la belle coupe ronde à Tèlémakhos, et le cher fils d’Odysseus supplia aussi le dieu. Et dès que les Pyliens eurent rôti les chairs supérieures, ils les retirèrent du feu, et, les distribuant par portions, ils célébrèrent le festin splendide. Et dès qu’ils eurent assouvi le besoin de boire et de manger, le cavalier Gérennien Nestôr leur parla ainsi :
– Maintenant, nous pouvons demander qui sont nos hôtes, puisqu’ils sont rassasiés de nourriture.
Ô nos hôtes, qui êtes-vous ? Naviguez-vous pour quelque trafic, ou bien, à l’aventure, comme des pirates qui, jouant leur vie, portent le malheur aux étrangers ?
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit avec assurance, car Athènè avait mis la fermeté dans son cœur, afin qu’il s’informât de son père absent et qu’une grande gloire lui fût acquise par là parmi les hommes :
– Ô Nestôr Nèlèiade, grande gloire des Akhaiens, tu demandes d’où nous sommes, et je puis te le dire. Nous venons d’Ithakè, sous le Nèios, pour un intérêt privé, et non public, que je t’apprendrai. Je cherche à entendre parler de l’immense gloire de mon père, le divin et patient Odysseus qui, autrefois, dit-on, combattant avec toi, a renversé la ville des Troiens. Nous avons su dans quel lieu chacun de ceux qui combattaient contre les Troiens a subi la mort cruelle ; mais le Kroniôn, au seul Odysseus, a fait une mort ignorée ; et aucun ne peut dire où il a péri, s’il a été dompté sur la terre ferme par des hommes ennemis, ou dans la mer, sous les écumes d’Amphitrite. C’est pour lui que je viens, à tes genoux, te demander de me dire, si tu le veux, quelle a été sa mort cruelle, soit que tu l’aies vue de tes yeux, soit que tu l’aies apprise de quelque voyageur ; car sa mère l’a enfanté pour être très malheureux. Ne me flatte point d’espérances vaines, par compassion ; mais parle-moi ouvertement, je t’en supplie, si jamais mon père, l’excellent Odysseus, soit par ses paroles, soit par ses actions, a tenu les promesses qu’il t’avait faites, chez le peuple des Troiens, où vous, Akhaiens, avez subi tant de maux. Souviens-t’en maintenant, et dis-moi la vérité.
Et le cavalier Gérennien Nestôr lui répondit :
– Ô ami, tu me fais souvenir des maux que nous, fils indomptables des Akhaiens, nous avons subis chez le peuple Troien, soit en poursuivant notre proie, sur nos nefs, à travers la mer sombre, et conduits par Akhilleus, soit en combattant autour de la grande ville du roi Priamos, là où tant de guerriers excellents ont été tués. C’est là que gisent le brave Aias, et Akhilleus, et Patroklos semblable aux dieux par la sagesse, et mon fils bien-aimé Antilokhos, robuste et irréprochable, habile à la course et courageux combattant. Et nous avons subi bien d’autres maux, et nul, parmi les hommes mortels, ne pourrait les raconter tous. Et tu pourrais rester ici et m’interroger pendant cinq ou six ans, que tu retournerais, plein de tristesse, dans la terre de la patrie, avant de connaître tous les maux subis par les divins Akhaiens. Et, pendant neuf ans, nous avons assiégé Troiè par mille ruses, et le Kroniôn ne nous donna la victoire qu’avec peine. Là, nul n’égala jamais le divin Odysseus par la sagesse, car ton père l’emportait sur tous par ses ruses sans nombre, si vraiment tu es son fils.
Mais l’admiration me saisit en te regardant. Tes paroles sont semblables aux siennes, et on ne te croirait pas si jeune, tant tu sais parler comme lui. Là-bas, jamais le divin Odysseus et moi, dans l’agora ou dans le conseil, nous n’avons parlé différemment ; et nous donnions aux Akhaiens les meilleurs avis, ayant le même esprit et la même sagesse.
Enfin, après avoir renversé la haute citadelle de Priamos, nous partîmes sur nos nefs, et un dieu dispersa les Akhaiens. Déjà Zeus, sans doute, préparait, dans son esprit, un triste retour aux Akhaiens ; car tous n’étaient point prudents et justes, et une destinée terrible était réservée à beaucoup d’entre eux, à cause de la colère d’Athènè aux yeux clairs qui a un père effrayant, et qui jeta la discorde entre les deux Atréides. Et ceux-ci avaient convoqué tous les Akhaiens à l’agora, sans raison et contre l’usage, au coucher de Hèlios, et les fils des Akhaiens y vinrent, alourdis par le vin, et les Atréides leur expliquèrent pourquoi ils avaient convoqué le peuple. Alors Ménélaos leur ordonna de songer au retour sur le vaste dos de la mer ; mais cela ne plut point à Agamemnôn, qui voulait retenir le peuple et sacrifier de saintes hécatombes, afin d’apaiser la violente colère d’Athènè. Et l’insensé ne savait pas qu’il ne pourrait l’apaiser, car l’esprit des Dieux éternels ne change point aussi vite. Et tandis que les Atréides, debout, se disputaient avec d’âpres paroles, tous les Akhaiens aux belles knèmides se levèrent, dans une grande clameur, pleins de résolutions contraires.
Et nous dormîmes pendant la nuit, méditant un dessein fatal, car Zeus préparait notre plus grand malheur. Et, au matin, traînant nos nefs à la mer divine, nous y déposâmes notre butin et les femmes aux ceintures dénouées. Et la moitié de l’armée resta auprès du Roi Atréide Agamemnôn ; et nous, partant sur nos nefs, nous naviguions.
Un dieu apaisa la mer où vivent les monstres, et, parvenus promptement à Ténédos, nous fîmes des sacrifices aux dieux, désirant revoir nos demeures. Mais Zeus irrité, nous refusant un prompt retour, excita de nouveau une fatale dissension. Et quelques-uns, remontant sur leurs nefs à double rang d’avirons, et parmi eux était le roi Odysseus plein de prudence, retournèrent vers l’Atréide Agamemnôn, afin de lui complaire.
Pour moi, ayant réuni les nefs qui me suivaient, je pris la fuite, car je savais quels malheurs préparait le dieu. Et le brave fils de Tydeus, excitant ses compagnons, prit aussi la fuite ; et le blond Ménélaos nous rejoignit plus tard à Lesbos, où nous délibérions sur la route à suivre. Irions-nous par le nord de l’âpre Khios, ou vers l’île Psyriè, en la laissant à notre gauche, ou par le sud de Khios, vers Mimas battue des vents ? Ayant supplié Zeus de nous montrer un signe, il nous le montra et nous ordonna de traverser le milieu de la mer d’Euboia, afin d’éviter notre perte. Et un vent sonore commença de souffler ; et nos nefs, ayant parcouru rapidement les chemins poissonneux, arrivèrent dans la nuit à Géraistos ; et là, après avoir traversé la grande mer, nous brûlâmes pour Poseidaôn de nombreuses cuisses de taureaux.
Le quatrième jour, les nefs égales et les compagnons du dompteur de chevaux Tydéide Diomèdès s’arrêtèrent dans Argos, mais je continuai ma route vers Pylos, et le vent ne cessa pas depuis qu’un dieu lui avait permis de souffler.
C’est ainsi que je suis arrivé, cher fils, ne sachant point quels sont ceux d’entre les Akhaiens qui se sont sauvés ou qui ont péri. Mais ce que j’ai appris, tranquille dans mes demeures, il est juste que tu en sois instruit, et je ne te le cacherai point. On dit que l’illustre fils du magnanime Akhilleus a ramené en sûreté les Myrmidones habiles à manier la lance. Philoktètès, l’illustre fils de Paian, a aussi ramené les siens, et Idoméneus a reconduit dans la Krètè ceux de ses compagnons qui ont échappé à la guerre, et la mer ne lui en a ravi aucun. Tu as entendu parler de l’Atréide, bien qu’habitant au loin ; et tu sais comment il revint, et comment Aigisthos lui infligea une mort lamentable. Mais le meurtrier est mort misérablement, tant il est bon qu’un homme laisse un fils qui le venge. Et Orestès a tiré vengeance d’Aigisthos qui avait tué son illustre père. Et toi, ami, que je vois si beau et si grand, sois brave, afin qu’on parle bien de toi parmi les hommes futurs.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ô Nestôr Nèlèiade, grande gloire des Akhaiens, certes, Orestès a tiré une juste vengeance, et tous les Akhaiens l’en glorifient, et les hommes futurs l’en glorifieront. Plût aux dieux que j’eusse la force de faire expier aux prétendants les maux qu’ils me font et l’opprobre dont ils me couvrent. Mais les dieux ne nous ont point destinés à être honorés, mon père et moi, et, maintenant, il me faut tout subir avec patience.
Et le cavalier Gérennien Nestôr lui répondit :
– Ô ami, ce que tu me dis m’a été rapporté, que de nombreux prétendants, à cause de ta mère, t’opprimaient dans ta demeure. Mais, dis-moi, souffres-tu ces maux sans résistance, ou bien les peuples, obéissant à l’oracle d’un dieu, t’ont-ils pris en haine ! Qui sait si Odysseus ne châtiera pas un jour leur iniquité violente, seul, ou aidé de tous les Akhaiens ? Qu’Athènè aux yeux clairs puisse t’aimer autant qu’elle aimait le glorieux Odysseus, chez le peuple des Troiens, où, nous, Akhaiens, nous avons subi tant de maux ! Non, je n’ai jamais vu les Dieux aimer aussi manifestement un homme que Pallas Athènè aimait Odysseus. Si elle voulait t’aimer ainsi et te protéger, chacun des prétendants oublierait bientôt ses désirs de noces !
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ô vieillard, je ne pense pas que ceci arrive jamais. Les grandes choses que tu prévois me troublent et me jettent dans la stupeur. Elles tromperaient mes espérances, même si les dieux le voulaient.
Alors, Athènè, la déesse aux yeux clairs, lui répondit :
– Tèlémakhos, quelle parole s’est échappée d’entre tes dents ! Un dieu peut aisément sauver un homme, même de loin.
J’aimerais mieux, après avoir subi de nombreuses douleurs, revoir le jour du retour et revenir dans ma demeure, plutôt que de périr à mon arrivée, comme Agamemnôn par la perfidie d’Aigisthos et de Klytaimnestrè. Cependant, les dieux eux-mêmes ne peuvent éloigner de l’homme qu’ils aiment la mort commune à tous, quand la Moire fatale de la rude mort doit les saisir.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Mentôr, n’en parlons pas plus longtemps, malgré notre tristesse. Odysseus ne reviendra jamais, et déjà les dieux immortels lui ont infligé la mort et la noire kèr. Maintenant, je veux interroger Nestôr, car il l’emporte sur tous par l’intelligence et par la justice. Ô Nestôr Nèlèiade, dis-moi la vérité ; comment a péri l’Atréide Agamemnôn qui commandait au loin ? Quelle mort lui préparait le perfide Aigisthos ? Certes, il a tué un homme qui lui était bien supérieur. Où était Ménélaos ? Non dans l’Argos Akhaïque, sans doute ; et il errait au loin parmi les hommes, et Aigisthos, en son absence, a commis le meurtre.
Et le cavalier Gérennien Nestôr lui répondit :
– Certes, mon enfant, je te dirai la vérité sur ces choses, et tu les sauras, telles qu’elles sont arrivées. Si le blond Ménélaos Atréide, à son retour de Troiè, avait trouvé, dans ses demeures, Aigisthos vivant, sans doute celui-ci eût péri, et n’eût point été enseveli, et les chiens et les oiseaux carnassiers l’eussent mangé, gisant dans la plaine, loin d’Argos ; et aucune Akhaienne ne l’eût pleuré, car il avait commis un grand crime.
En effet, tandis que nous subissions devant Ilios des combats sans nombre, lui, tranquille en une retraite, dans Argos nourrice de chevaux, séduisait par ses paroles l’épouse Agamemnonienne. Et certes, la divine Klytaimnestrè repoussa d’abord cette action indigne, car elle obéissait à ses bonnes pensées ; et auprès d’elle était un Aoide à qui l’Atréide, en partant pour Troiè, avait confié la garde de l’Épouse.
Mais quand la moire des dieux eut décidé que l’Aoide mourrait, on jeta celui-ci dans une île déserte et on l’y abandonna pour être déchiré par les oiseaux carnassiers. Alors, ayant tous deux les mêmes désirs, Aigisthos conduisit Klytaimnestrè dans sa demeure. Et il brûla de nombreuses cuisses sur les autels des dieux, et il y suspendit de nombreux ornements et des vêtements d’or, parce qu’il avait accompli le grand dessein qu’il n’eût jamais osé espérer dans son âme. Et nous naviguions loin de Troiè, l’Atréide et moi, ayant l’un pour l’autre la même amitié. Mais, comme nous arrivions à Sounios, sacré promontoire des Athènaiens, Phoibos Apollôn tua soudainement de ses douces flèches le pilote de Ménélaos, Phrontis Onètoride, au moment où il tenait le gouvernail de la nef qui marchait. Et c’était le plus habile de tous les hommes à gouverner une nef, aussi souvent que soufflaient les tempêtes. Et Ménélaos, bien que pressé de continuer sa course, s’arrêta en ce lieu pour ensevelir son compagnon et célébrer ses funérailles.
Puis, reprenant son chemin à travers la mer sombre, sur ses nefs creuses, il atteignit le promontoire Maléien. Alors Zeus à la grande voix, s’opposant à sa marche, répandit le souffle des vents sonores qui soulevèrent les grands flots pareils à des montagnes. Et les nefs se séparèrent, et une partie fut poussée en Krètè, où habitent les Kydônes, sur les rives du Iardanos. Mais il y a, sur les côtes de Gortyna, une roche escarpée et plate qui sort de la mer sombre. Là, le Notos pousse les grands flots vers Phaistos, à la gauche du promontoire ; et cette roche, très petite, rompt les grands flots. C’est là qu’ils vinrent, et les hommes évitèrent à peine la mort ; et les flots fracassèrent les nefs contre les rochers, et le vent et la mer poussèrent cinq nefs aux proues bleues vers le fleuve Aigyptos.
Et Ménélaos, amassant beaucoup de richesses et d’or, errait parmi les hommes qui parlent une langue étrangère. Pendant ce temps, Aigisthos accomplissait dans ses demeures son lamentable dessein, en tuant l’Atréide et en soumettant son peuple. Et il commanda sept années dans la riche Mykènè. Et, dans la huitième année, le divin Orestès revint d’Athéna, et il tua le meurtrier de son père, le perfide Aigisthos, qui avait tué son illustre père.
Et, quand il l’eut tué, il offrit aux Argiens le repas funéraire de sa malheureuse mère et du lâche Aigisthos. Et ce jour-là, arriva le brave Ménélaos, apportant autant de richesses que sa nef en pouvait contenir.
Mais toi, ami, ne reste pas plus longtemps éloigné de ta maison, ayant ainsi laissé dans tes demeures tant d’hommes orgueilleux, de peur qu’ils consument tes biens et se partagent tes richesses, car tu aurais fait un voyage inutile. Je t’exhorte cependant à te rendre auprès de Ménélaos. Il est récemment arrivé de pays étrangers, d’où il n’espérait jamais revenir ; et les tempêtes l’ont poussé à travers la grande mer que les oiseaux ne pourraient traverser dans l’espace d’une année, tant elle est vaste et horrible. Va maintenant avec ta nef et tes compagnons ; ou, si tu veux aller par terre, je te donnerai un char et des chevaux, et mes fils te conduiront dans la divine Lakédaimôn où est le blond Ménélaos, afin que tu le pries de te dire la vérité. Et il ne te dira pas de mensonges, car il est très-sage.
Il parla ainsi, et Hèlios descendit, et les ténèbres arrivèrent.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui dit :
– Vieillard, tu as parlé convenablement. Mais tranchez les langues des victimes, et mêlez le vin, afin que nous fassions des libations à Poseidaôn et aux autres immortels. Puis, nous songerons à notre lit, car voici l’heure. Déjà la lumière est sous l’horizon, et il ne convient pas de rester plus longtemps au festin des dieux ; mais il faut nous retirer.
La fille de Zeus parla ainsi, et tous obéirent à ses paroles. Et les hérauts leur versèrent de l’eau sur les mains, et les jeunes hommes couronnèrent les kratères de vin et les distribuèrent entre tous à pleines coupes.
Et ils jetèrent les langues dans le feu. Et ils firent, debout, des libations ; et, après avoir fait des libations et bu autant que leur cœur le désirait, alors, Athènè et Tèlémakhos voulurent tous deux retourner à leur nef creuse.
Mais, aussitôt, Nestôr les retint et leur dit :
– Que Zeus et tous les autres dieux immortels me préservent de vous laisser retourner vers votre nef rapide, en me quittant, comme si j’étais un homme pauvre qui n’a dans sa maison ni vêtements ni tapis, afin que ses hôtes y puissent dormir mollement ! Certes, je possède beaucoup de vêtements et de beaux tapis. Et jamais le cher fils du héros Odysseus ne passera la nuit dans sa nef tant que je vivrai, et tant que mes enfants habiteront ma maison royale et y recevront les étrangers qui viennent dans ma demeure.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Tu as bien parlé, cher vieillard. Il convient que tu persuades Tèlémakhos, afin que tout soit pour le mieux. Il te suivra donc pour dormir dans ta demeure, et je retournerai vers notre nef noire pour donner des ordres à nos compagnons, car je me glorifie d’être le plus âgé d’entre eux. Ce sont des jeunes hommes, du même âge que le magnanime Tèlémakhos, et ils l’ont suivi par amitié. Je dormirai dans la nef noire et creuse, et, dès le matin, j’irai vers les magnanimes Kaukônes, pour une somme qui m’est due et qui n’est pas médiocre.
Quand Tèlémakhos sera dans ta demeure, envoie-le sur le char, avec ton fils, et donne-lui tes chevaux les plus rapides et les plus vigoureux.
Ayant ainsi parlé, Athènè aux yeux clairs disparut semblable à un aigle, et la stupeur saisit tous ceux qui la virent. Et le vieillard, l’ayant vue de ses yeux, fut plein d’admiration, et il prit la main de Tèlémakhos et il lui dit ces paroles :
– Ô ami, tu ne seras ni faible ni lâche, puisque les dieux eux-mêmes te conduisent, bien que tu sois si jeune. C’est là un des habitants des demeures Olympiennes, la fille de Zeus, la dévastatrice Tritogénéia, qui honorait ton père excellent entre tous les Argiens. C’est pourquoi, ô reine, sois-moi favorable ! Donne-nous une grande gloire, à moi, à mes fils et à ma vénérable épouse, et je te sacrifierai une génisse d’un an, au front large, indomptée, et que nul autre n’a soumise au joug ; et je te la sacrifierai après avoir répandu de l’or sur ses cornes.
Il parla ainsi, et Pallas-Athènè l’entendit.
Et le cavalier Gérennien Nestôr, en tête de ses fils et de ses gendres, retourna vers sa belle demeure. Et quand ils furent arrivés à l’illustre demeure du roi, ils s’assirent en ordre sur des gradins et sur des thrônes. Et le vieillard mêla pour eux un kratère de vin doux, âgé de onze ans, dont une servante ôta le couvercle.
Et le vieillard, ayant mêlé le vin dans le kratère, supplia Athènè, faisant des libations à la fille de Zeus tempétueux. Et chacun d’eux, ayant fait des libations et bu autant que son cœur le désirait, retourna dans sa demeure pour y dormir. Et le cavalier Gérennien Nestôr fit coucher Tèlémakhos, le cher fils du divin Odysseus, en un lit sculpté, sous le portique sonore, auprès du brave Peisistratos, le plus jeune des fils de la maison royale. Et lui-même s’endormit au fond de sa haute demeure, là où l’épouse lui avait préparé un lit.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, le cavalier Gérennien Nestôr se leva de son lit. Puis, étant sorti, il s’assit sur les pierres polies, blanches et brillantes comme de l’huile, qui étaient devant les hautes portes, et sur lesquelles s’asseyait autrefois Nèleus semblable aux dieux par la sagesse. Mais celui-ci, dompté par la Kèr, était descendu chez Aidés. Et, maintenant, le Gérennien Nestôr, rempart des Akhaiens, s’asseyait à sa place, tenant le sceptre. Et ses fils, sortant des chambres nuptiales, se réunirent autour de lui : Ekhéphrôn, et Stratios, et Perseus, et Arètos, et le divin Thrasymèdès. Et le héros Peisistratos vint le sixième. Et ils firent approcher Tèlémakhos semblable à un dieu, et le cavalier Gérennien Nestôr commença de leur parler :
– Mes chers enfants, satisfaites promptement mon désir, afin que je me rende favorable, avant tous les dieux, Athènè qui s’est montrée ouvertement à moi au festin sacré de Poseidaôn.
Que l’un de vous aille dans la campagne chercher une génisse que le bouvier amènera, et qu’il revienne à la hâte. Un autre se rendra à la nef noire du magnanime Tèlémakhos, et il amènera tous ses compagnons, et il n’en laissera que deux. Un autre ordonnera au fondeur d’or Laerkeus de venir répandre de l’or sur les cornes de la génisse ; et les autres resteront auprès de moi. Ordonnez aux servantes de préparer un festin sacré dans la demeure, et d’apporter des sièges, du bois et de l’eau pure.
Il parla ainsi, et tous lui obéirent. La génisse vint de la campagne, et les compagnons du magnanime Tèlémakhos vinrent de la nef égale et rapide. Et l’ouvrier vint, portant dans ses mains les instruments de son art, l’enclume, le maillet et la tenaille, avec lesquels il travaillait l’or. Et Athènè vint aussi, pour jouir du sacrifice. Et le vieux cavalier Nestôr donna de l’or, et l’ouvrier le répandit et le fixa sur les cornes de la génisse, afin que la déesse se réjouît en voyant cet ornement. Stratios et le divin Ekhéphrôn amenèrent la génisse par les cornes, et Arètos apporta, de la chambre nuptiale, dans un bassin fleuri, de l’eau pour leurs mains, et une servante apporta les orges dans une corbeille. Et le brave Thrasymèdès se tenait prêt à tuer la génisse, avec une hache tranchante à la main, et Perseus tenait un vase pour recevoir le sang. Alors, le vieux cavalier Nestôr répandit l’eau et les orges, et supplia Athènè, en jetant d’abord dans le feu quelques poils arrachés de la tête.
Et, après qu’ils eurent prié et répandu les orges, aussitôt, le noble Thrasymèdès, fils de Nestôr, frappa, et il trancha d’un coup de hache les muscles du cou ; et les forces de la génisse furent rompues. Et les filles, les belles-filles et la vénérable épouse de Nestôr, Eurydikè, l’aînée des filles de Klyménos, hurlèrent toutes.
Puis, relevant la génisse qui était largement étendue, ils la soutinrent, et Peisistratos, chef des hommes, l’égorgea. Et un sang noir s’échappa de sa gorge, et le souffle abandonna ses os. Aussitôt ils la divisèrent. Les cuisses furent coupées, selon le rite, et recouvertes de graisse des deux côtés. Puis, on déposa, par-dessus, les entrailles saignantes. Et le vieillard les brûlait sur du bois, faisant des libations de vin rouge. Et les jeunes hommes tenaient en mains des broches à cinq pointes. Les cuisses étant consumées, ils goûtèrent les entrailles ; puis, divisant les chairs avec soin, ils les embrochèrent et les rôtirent, tenant en mains les broches aiguës.
Pendant ce temps, la belle Polykastè, la plus jeune des filles de Nestôr Nèlèiade, baigna Tèlémakhos et, après l’avoir baigné et parfumé d’une huile grasse, elle le revêtit d’une tunique et d’un beau manteau. Et il sortit du bain, semblable par sa beauté aux Immortels. Et le prince des peuples vint s’asseoir auprès de Nestôr.
Les autres, ayant rôti les chairs, les retirèrent du feu et s’assirent au festin. Et les plus illustres, se levant, versaient du vin dans les coupes d’or. Et quand ils eurent assouvi la soif et la faim, le cavalier Gérennien Nestôr commença de parler au milieu d’eux :
– Mes enfants, donnez promptement à Tèlémakhos des chevaux au beau poil, et liez-les au char, afin qu’il fasse son voyage.
Il parla ainsi, et, l’ayant entendu, ils lui obéirent aussitôt. Et ils lièrent promptement au char deux chevaux rapides. Et la servante intendante y déposa du pain et du vin et tous les mets dont se nourrissent les rois élevés par Zeus. Et Tèlémakhos monta dans le beau char, et, auprès de lui, le Nestoride Peisistratos, chef des hommes, monta aussi et prit les rênes en mains. Puis, il fouetta les chevaux, et ceux-ci s’élancèrent avec ardeur dans la plaine, laissant derrière eux la ville escarpée de Pylos. Et, tout le jour, ils secouèrent le joug qui les retenait des deux côtés.
Alors, Hèlios tomba, et les chemins s’emplirent d’ombre. Et ils arrivèrent à Phèra, dans la demeure de Diokleus, fils d’Orthilokhos que l’Alphéios engendra. Là, ils passèrent la nuit, et Diokleus leur fit les dons de l’hospitalité.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, ils attelèrent les chevaux et montèrent sur le beau char, et ils sortirent du vestibule et du portique sonore.
Et Peisistratos fouetta les chevaux, qui s’élancèrent ardemment dans la plaine fertile. Et ils achevèrent leur route, tant les chevaux rapides couraient avec vigueur. Et Hèlios tomba de nouveau, et les chemins s’emplirent d’ombre.Chant 4
Et ils parvinrent à la vaste et creuse Lakédaimôn. Et ils se dirigèrent vers la demeure du glorieux Ménélaos, qu’ils trouvèrent célébrant dans sa demeure, au milieu de nombreux convives, les noces de son fils et de sa fille irréprochable qu’il envoyait au fils du belliqueux Akhilleus. Dès longtemps, devant Troiè, il l’avait promise et fiancée, et les dieux accomplissaient leurs noces, et Ménélaos l’envoyait, avec un char et des chevaux, vers l’illustre ville des Myrmidones, auxquels commandait le fils d’Akhilleus.
Et il mariait une Spartiate, fille d’Alektôr, à son fils, le robuste Mégapenthès, que, dans sa vieillesse, il avait eu d’une captive. Car les dieux n’avaient plus accordé d’enfants à Hélènè depuis qu’elle avait enfanté sa fille gracieuse, Hermionè, semblable à Aphroditè d’or.
Et les voisins et les compagnons du glorieux Ménélaos étaient assis au festin, dans la haute et grande demeure ; et ils se réjouissaient, et un Aoide divin chantait au milieu d’eux, en jouant de la flûte, et deux danseurs bondissaient au milieu d’eux, aux sons du chant.
Et le héros Tèlémakhos et l’illustre fils de Nestôr s’arrêtèrent, eux et leurs chevaux, dans le vestibule de la maison. Et le serviteur familier du glorieux Ménélaos, Etéôneus, accourant et les ayant vus, alla rapidement les annoncer dans les demeures du prince des peuples. Et, se tenant debout auprès de lui, il dit ces paroles ailées :
– Ménélaos, nourri par Zeus, voici deux étrangers qui semblent être de la race du grand Zeus. Dis-moi s’il faut dételer leurs chevaux rapides, ou s’il faut les renvoyer vers quelqu’autre qui les reçoive.
Et le blond Ménélaos lui répondit en gémissant :
– Étéôneus Boèthoide, tu n’étais pas insensé avant ce moment, et voici que tu prononces comme un enfant des paroles sans raison. Nous avons souvent reçu, en grand nombre, les présents de l’hospitalité chez des hommes étrangers, avant de revenir ici. Que Zeus nous affranchisse de nouvelles misères dans l’avenir ! Mais délie les chevaux de nos hôtes et conduis-les eux-mêmes à ce festin.
Il parla ainsi, et Etéôneus sortit à la hâte des demeures, et il ordonna aux autres serviteurs fidèles de le suivre. Et ils délièrent les chevaux suant sous le joug, et ils les attachèrent aux crèches, en plaçant devant eux l’orge blanche et l’épeautre mêlés. Et ils appuyèrent le char contre le mur poli. Puis, ils conduisirent les étrangers dans la demeure divine.
Et ceux-ci regardaient, admirant la demeure du roi nourrisson de Zeus. Et la splendeur de la maison du glorieux Ménélaos était semblable à celle de Hèlios et de Sélénè. Et quand ils furent rassasiés de regarder, ils entrèrent, pour se laver, dans des baignoires polies. Et après que les servantes les eurent lavés et parfumés d’huile, et revêtus de tuniques et de manteaux moelleux, ils s’assirent sur des thrônes auprès de l’Atréide Ménélaos.
Et une servante, pour laver leurs mains, versa de l’eau, d’une belle aiguière d’or, dans un bassin d’argent ; et elle dressa devant eux une table polie ; et la vénérable intendante, pleine de bienveillance, y déposa du pain et des mets nombreux. Et le découpeur leur offrit les plateaux couverts de viandes différentes, et il posa devant eux des coupes d’or. Et le blond Ménélaos, leur donnant la main droite, leur dit :
– Mangez et réjouissez-vous. Quand vous serez rassasiés de nourriture, nous vous demanderons qui vous êtes parmi les hommes. Certes, la race de vos aïeux n’a point failli, et vous êtes d’une race de rois porte-sceptres nourris par Zeus, car jamais des lâches n’ont enfanté de tels fils.
Il parla ainsi, et, saisissant de ses mains le dos gras d’une génisse, honneur qu’on lui avait fait à lui-même, il le plaça devant eux. Et ceux-ci étendirent les mains vers les mets offerts. Et quand ils eurent assouvi le besoin de manger et de boire, Tèlémakhos dit au fils de Nestôr, en approchant la tête de la sienne, afin de n’être point entendu :
– Vois, Nestoride, très-cher à mon cœur, la splendeur de l’airain et la maison sonore, et l’or, et l’émail, et l’argent et l’ivoire. Sans doute, telle est la demeure de l’olympien Zeus, tant ces richesses sont nombreuses. L’admiration me saisit en les regardant.
Et le blond Ménélaos, ayant compris ce qu’il disait, leur adressa ces paroles ailées :
– Chers enfants, aucun vivant ne peut lutter contre Zeus, car ses demeures et ses richesses sont immortelles. Il y a des hommes plus ou moins riches que moi ; mais j’ai subi bien des maux, et j’ai erré sur mes nefs pendant huit années, avant de revenir. Et j’ai vu Kypros et la Phoinikè, et les Aigyptiens, et les Aithiopiens, et les Sidônes, et les Érembes, et la Libyè où les agneaux sont cornus et où les brebis mettent bas trois fois par an. Là, ni le roi ni le berger ne manquent de fromage, de viandes et de lait doux, car ils peuvent traire le lait pendant toute l’année. Et tandis que j’errais en beaucoup de pays, amassant des richesses, un homme tuait traîtreusement mon frère, aidé par la ruse d’une femme perfide. Et je règne, plein de tristesse malgré mes richesses. Mais vous devez avoir appris ces choses de vos pères, quels qu’ils soient. Et j’ai subi des maux nombreux, et j’ai détruit une ville bien peuplée qui renfermait des trésors précieux. Plût aux dieux que j’en eusse trois fois moins dans mes demeures, et qu’ils fussent encore vivants les héros qui ont péri devant la grande Troiè, loin d’Argos où paissent les beaux chevaux ! Et je pleure et je gémis sur eux tous. Souvent, assis dans mes demeures, je me plais à m’attrister en me souvenant, et tantôt je cesse de gémir, car la lassitude du deuil arrive promptement.
Mais, bien qu’attristé, je les regrette moins tous ensemble qu’un seul d’entre eux, dont le souvenir interrompt mon sommeil et chasse ma faim ; car Odysseus a supporté plus de travaux que tous les Akhaiens.
Et d’autres douleurs lui étaient réservées dans l’avenir ; et une tristesse incurable me saisit à cause de lui qui est depuis si longtemps absent. Et nous ne savons s’il est vivant ou mort ; et le vieux Laertès le pleure, et la sage Pènélopéia, et Tèlémakhos qu’il laissa tout enfant dans ses demeures.
Il parla ainsi, et il donna à Tèlémakhos le désir de pleurer à cause de son père ; et, entendant parler de son père, il se couvrit les yeux de son manteau pourpré, avec ses deux mains, et il répandit des larmes hors de ses paupières. Et Ménélaos le reconnut, et il délibéra dans son esprit et dans son cœur s’il le laisserait se souvenir le premier de son père, ou s’il l’interrogerait en lui disant ce qu’il pensait.
Pendant qu’il délibérait ainsi dans son esprit et dans son cœur, Hélénè sortit de la haute chambre nuptiale parfumée, semblable à Artémis qui porte un arc d’or. Aussitôt Adrestè lui présenta un beau siège, Alkippè apporta un tapis de laine moelleuse, et Phylô lui offrit une corbeille d’argent que lui avait donnée Alkandrè, femme de Polybos, qui habitait dans Thèbè Aigyptienne, où de nombreuses richesses étaient renfermées dans les demeures. Et Polybos donna à Ménélaos deux baignoires d’argent, et deux trépieds, et dix talents d’or ; et Alkandrè avait aussi offert de beaux présents à Hélénè : Une quenouille d’or et une corbeille d’argent massif dont la bordure était d’or. Et la servante Phylô la lui apporta, pleine de fil préparé, et, par-dessus, la quenouille chargée de laine violette.
Hélénè s’assit, avec un escabeau sous les pieds, et aussitôt elle interrogea ainsi son époux :
– Savons-nous, divin Ménélaos, qui sont ces hommes qui se glorifient d’être entrés dans notre demeure ? Mentirai-je ou dirai-je la vérité ? Mon esprit me l’ordonne. Je ne pense pas avoir jamais vu rien de plus ressemblant, soit un homme, soit une femme ; et l’admiration me saisit tandis que je regarde ce jeune homme, tant il est semblable au fils du magnanime Odysseus, à Tèlémakhos qu’il laissa tout enfant dans sa demeure, quand pour moi, chienne, les Akhaiens vinrent à Troiè, portant la guerre audacieuse.
Et le blond Ménélaos, lui répondant, parla ainsi ;
– Je reconnais comme toi, femme, que ce sont là les pieds, les mains, l’éclair des yeux, la tête et les cheveux d’Odysseus. Et voici que je me souvenais de lui et que je me rappelais combien de misères il avait patiemment subies pour moi. Mais ce jeune homme répand de ses paupières des larmes amères, couvrant ses yeux de son manteau pourpré.
Et le Nestoride Peisistratos lui répondit :
Atréide Ménélaos, nourri par Zeus, prince des peuples, certes, il est le fils de celui que tu dis. Mais il est sage, et il pense qu’il ne serait pas convenable, dès son arrivée, de prononcer des paroles téméraires devant toi dont nous écoutons la voix comme celle d’un dieu.
Le cavalier Gérennien Nestôr m’a ordonné de l’accompagner. Et il désire te voir, afin que tu le conseilles ou que tu l’aides ; car il subit beaucoup de maux, à cause de son père absent, dans sa demeure où il a peu de défenseurs. Cette destinée est faite à Tèlémakhos, et son père est absent, et il n’a personne, parmi son peuple, qui puisse détourner de lui les calamités.
Et le blond Ménélaos, lui répondant, parla ainsi :
– Ô dieux ! certes, le fils d’un homme que j’aime est entré dans ma demeure, d’un héros qui, pour ma cause, a subi tant de combats. J’avais résolu de l’honorer entre tous les Akhaiens, si l’olympien Zeus qui tonne au loin nous eût donné de revenir sur la mer et sur nos nefs rapides. Et je lui aurais élevé une ville dans Argos, et je lui aurais bâti une demeure ; et il aurait transporté d’Ithakè ses richesses et sa famille et tout son peuple dans une des villes où je commande et qui aurait été quittée par ceux qui l’habitent. Et, souvent, nous nous fussions visités tour à tour, nous aimant et nous charmant jusqu’à ce que la noire nuée de la mort nous eût enveloppés. Mais, sans doute, un dieu nous a envié cette destinée, puisque, le retenant seul et malheureux, il lui refuse le retour.
Il parla ainsi, et il excita chez tous le désir de pleurer. Et l’Argienne Hélénè, fille de Zeus, pleurait ; et Tèlémakhos pleurait aussi, et l’Atréide Ménélaos ; et le fils de Nestôr avait les yeux pleins de larmes, et il se souvenait dans son esprit de l’irréprochable Antilokhos que l’illustre fils de la splendide Éôs avait tué et, se souvenant, il dit en paroles ailées :
– Atréide, souvent le vieillard Nestôr m’a dit, quand nous nous souvenions de toi dans ses demeures, et quand nous nous entretenions, que tu l’emportais sur tous par ta sagesse. C’est pourquoi, maintenant, écoute-moi. Je ne me plais point à pleurer après le repas ; mais nous verserons des larmes quand Éôs née au matin reviendra. Il faut pleurer ceux qui ont subi leur destinée. C’est là, certes, la seule récompense des misérables mortels de couper pour eux sa chevelure et de mouiller ses joues de larmes. Mon frère aussi est mort, et il n’était pas le moins brave des Argiens, tu le sais. Je n’en ai pas été témoin, et je ne l’ai point vu, mais on dit qu’Antilokhos l’emportait sur tous, quand il courait et quand il combattait.
Et le blond Ménélaos lui répondit :
– Ô cher, tu parles comme un homme sage et plus âgé que toi parlerait et agirait, comme le fils d’un sage père. On reconnaît facilement l’illustre race d’un homme que le Kroniôn a honoré, qu’il a bien marié et qui est bien né. C’est ainsi qu’il a accordé tous les jours à Nestôr de vieillir en paix dans sa demeure, au milieu de fils sages et qui excellent par la lance. Mais retenons les pleurs qui viennent de nous échapper. Souvenons-nous de notre repas et versons de l’eau sur nos mains. Tèlémakhos et moi, demain matin, nous parlerons et nous nous entretiendrons.
Il parla ainsi, et Asphaliôn, fidèle serviteur de l’illustre Ménélaos, versa de l’eau sur leurs mains, et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux.
Et alors Hélénè, fille de Zeus, eut une autre pensée, et, aussitôt, elle versa dans le vin qu’ils buvaient un baume, le népenthès, qui donne l’oubli des maux. Celui qui aurait bu ce mélange ne pourrait plus répandre des larmes de tout un jour, même si sa mère et son père étaient morts, même si on tuait devant lui par l’airain son frère ou son fils bien-aimé, et s’il le voyait de ses yeux. Et la fille de Zeus possédait cette liqueur excellente que lui avait donnée Polydamna, femme de Thôs, en Aigyptiè, terre fertile qui produit beaucoup de baumes, les uns salutaires et les autres mortels. Là tous les médecins sont les plus habiles d’entre les hommes, et ils sont de la race de Paièôn. Après l’avoir préparé, Hélénè ordonna de verser le vin, et elle parla ainsi :
– Atréide Ménélaos, nourrisson de Zeus, certes, ceux-ci sont fils d’hommes braves, mais Zeus dispense comme il le veut le bien et le mal, car il peut tout. C’est pourquoi, maintenant, mangeons, assis dans nos demeures, et charmons-nous par nos paroles. Je vous dirai des choses qui vous plairont. Cependant, je ne pourrai raconter, ni même rappeler tous les combats du patient Odysseus, tant cet homme brave a fait et supporté de travaux chez le peuple des Troiens, là où les Akhaiens ont été accablés de misères. Se couvrant lui-même de plaies honteuses, les épaules enveloppées de vils haillons et semblable à un esclave, il entra dans la vaste ville des guerriers ennemis, s’étant fait tel qu’un mendiant, et bien différent de ce qu’il était auprès des nefs des Akhaiens.
C’est ainsi qu’il entra dans la ville des Troiens, inconnu de tous. Seule, je le reconnus et je l’interrogeais mais il me répondit avec ruse. Puis, je le baignai et je le parfumais d’huile, et je le couvris de vêtements, et je jurais un grand serment, promettant de ne point révéler Odysseus aux Troiens avant qu’il fût retourné aux nefs rapides et aux tentes. Et alors il me découvrit tous les projets des Akhaiens. Et, après avoir tué avec le long airain un grand nombre de Troiens, il retourna vers les Argiens, leur rapportant beaucoup de secrets. Et les Troiennes gémissaient lamentablement ; mais mon esprit se réjouissait, car déjà j’avais dans mon cœur le désir de retourner vers ma demeure, et je pleurais sur la mauvaise destinée qu’Aphroditè m’avait faite, quand elle me conduisit, en me trompant, loin de la chère terre de la patrie, et de ma fille, et de la chambre nuptiale, et d’un mari qui n’est privé d’aucun don, ni d’intelligence, ni de beauté.
Et le blond Ménélaos, lui répondant, parla ainsi :
– Tu as dit toutes ces choses, femme, comme il convient. Certes, j’ai connu la pensée et la sagesse de beaucoup de héros, et j’ai parcouru beaucoup de pays, mais je n’ai jamais vu de mes yeux un cœur tel que celui du patient Odysseus, ni ce que ce vaillant homme fit et affronta dans le cheval bien travaillé où nous étions tous entrés, nous, les princes des Argiens, afin de porter le meurtre et la kèr aux Troiens.
Et tu vins là, et sans doute un dieu te l’ordonna qui voulut accorder la gloire aux Troiens, et Dèiphobos semblable à un dieu te suivait. Et tu fis trois fois le tour de l’embûche creuse, en la frappant ; et tu nommais les princes des Danaens en imitant la voix des femmes de tous les Argiens ; et nous, moi, Diomèdès et le divin Odysseus, assis au milieu, nous écoutions ta voix. Et Diomèdès et moi nous voulions sortir impétueusement plutôt que d’écouter de l’intérieur, mais Odysseus nous arrêta et nous retint malgré notre désir. Et les autres fils des Akhaiens restaient muets, et Antiklos, seul, voulut te répondre : mais Odysseus lui comprima la bouche de ses mains robustes, et il sauva tous les Akhaiens ; et il le contint ainsi jusqu’à ce que Pallas Athènè t’eût éloignée.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Atréide Ménélaos, nourrisson de Zeus, prince des peuples, cela est triste, mais ces actions n’ont point éloigné de lui la mauvaise mort, et même si son cœur eût été de fer. Mais conduis-nous à nos lits, afin que nous jouissions du doux sommeil.
Il parla ainsi, et l’Argienne Hélénè ordonna aux servantes de préparer les lits sous le portique, d’amasser des vêtements beaux et pourprés, de les couvrir de tapis et de recouvrir ceux-ci de laines épaisses. Et les servantes sortirent des demeures, portant des torches dans leurs mains, et elles étendirent les lits, et un héraut conduisit les hôtes.
Et le héros Tèlémakhos et l’illustre fils de Nestôr s’endormirent sous le portique de la maison. Et l’Atréide s’endormit au fond de la haute demeure, et Hélénè au large péplos, la plus belle des femmes, se coucha auprès de lui.
Mais quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, le brave Ménélaos se leva de son lit, mit ses vêtements, suspendit une épée aiguë autour de ses épaules et attacha de belles sandales à ses pieds luisants. Et, semblable à un dieu, sortant de la chambre nuptiale, il s’assit auprès de Tèlémakhos et il lui parla :
– Héros Tèlémakhos, quelle nécessité t’a poussé vers la divine Lakédaimôn, sur le large dos de la mer ? Est-ce un intérêt public ou privé ? Dis-le-moi avec vérité.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Atréide Ménélaos, nourrisson de Zeus, prince des peuples, je viens afin que tu me dises quelque chose de mon père. Ma maison est ruinée, mes riches travaux périssent. Ma demeure est pleine d’hommes ennemis qui égorgent mes brebis grasses et mes bœufs aux pieds flexibles et aux fronts sinueux. Ce sont les prétendants de ma mère, et ils ont une grande insolence. C’est pourquoi, maintenant, je viens à tes genoux, afin que, me parlant de la mort lamentable de mon père, tu me dises si tu l’as vue de tes yeux, ou si tu l’as apprise d’un voyageur. Certes, une mère malheureuse l’a enfanté.
Ne me trompe point pour me consoler, et par pitié ; mais raconte-moi franchement tout ce que tu as vu. Je t’en supplie, si jamais mon père, le brave Odysseus, par la parole ou par l’action, a tenu ce qu’il avait promis, chez le peuple des Troiens, où les Akhaiens ont subi tant de misères, souviens-t’en et dis-moi la vérité.
Et, avec un profond soupir, le blond Ménélaos lui répondit :
– Ô dieux ! certes, des lâches veulent coucher dans le lit d’un brave ! Ainsi une biche a déposé dans le repaire d’un lion robuste ses faons nouveau-nés et qui tètent, tandis qu’elle va paître sur les hauteurs ou dans les vallées herbues ; et voici que le lion, rentrant dans son repaire, tue misérablement tous les faons. Ainsi Odysseus leur fera subir une mort misérable. Plaise au père Zeus, à Athènè, à Apollôn, qu’Odysseus se mêle aux Prétendants tel qu’il était dans Lesbos bien bâtie, quand se levant pour lutter contre le Philomèléide, il le terrassa rudement. Tous les Akhaiens s’en réjouirent. La vie des Prétendants serait brève et leurs noces seraient amères ! Mais les choses que tu me demandes en me suppliant, je te les dirai sans te rien cacher, telles que me les a dites le Vieillard véridique de la mer. Je te les dirai toutes et je ne te cacherai rien.
Malgré mon désir du retour, les dieux me retinrent en Aigyptiè, parce que je ne leur avais point offert les hécatombes qui leur étaient dues. Les Dieux, en effet, ne veulent point que nous oubliions leurs commandements.
Et il y a une île, au milieu de la mer onduleuse, devant l’Aigyptiè, et on la nomme Pharos, et elle est éloignée d’autant d’espace qu’une nef creuse, que le vent sonore pousse en poupe, peut en franchir en un jour entier. Et dans cette île il y a un port excellent d’où, après avoir puisé une eau profonde, on traîne à la mer les nefs égales. Là, les dieux me retinrent vingt jours, et les vents marins ne soufflèrent point qui mènent les nefs sur le large dos de la mer. Et mes vivres étaient déjà épuisés, et l’esprit de mes hommes était abattu, quand une déesse me regarda et me prit en pitié, la fille du Vieillard de la mer, de l’illustre Prôteus, Eidothéè. Et je touchai son âme, et elle vint au-devant de moi tandis que j’étais seul, loin de mes compagnons qui, sans cesse, erraient autour de l’île, pêchant à l’aide des hameçons recourbés, car la faim tourmentait leur ventre. Et, se tenant près de moi, elle parla ainsi :
– Tu es grandement insensé, ô étranger, ou tu as perdu l’esprit, ou tu restes ici volontiers et tu te plais à souffrir, car, certes, voici longtemps que tu es retenu dans l’île, et tu ne peux trouver aucune fin à cela, et le cœur de tes compagnons s’épuise.
Elle parla ainsi, et, lui répondant aussitôt, je dis :
– Je te dirai avec vérité, qui que tu sois entre les déesses, que je ne reste point volontairement ici ; mais je dois avoir offensé les Immortels qui habitent le large Ouranos.
Dis-moi donc, car les dieux savent tout, quel est celui des immortels qui me retarde en route et qui s’oppose à ce que je retourne en fendant la mer poissonneuse.
Je parlais ainsi, et, aussitôt, l’illustre déesse me répondit :
– Ô étranger, je te répondrai avec vérité. C’est ici qu’habite le véridique Vieillard de la mer, l’immortel Prôteus Aigyptien qui connaît les profondeurs de toute la mer et qui est esclave de Poseidaôn. On dit qu’il est mon père et qu’il m’a engendrée. Si tu peux le saisir par ruse, il te dira ta route et comment tu retourneras à travers la mer poissonneuse ; et, de plus, il te dira, ô enfant de Zeus, si tu le veux, ce qui est arrivé dans tes demeures, le bien et le mal, pendant ton absence et ta route longue et difficile.
Elle parla ainsi, et, aussitôt, je lui répondis :
– Maintenant, explique-moi les ruses du Vieillard, de peur que, me voyant, il me prévienne et m’échappe, car un dieu est difficile à dompter pour un homme mortel.
Je parlais ainsi, et, aussitôt, l’illustre déesse me répondit :
– Ô étranger, je te répondrai avec vérité. Quand Hèlios atteint le milieu de l’Ouranos, alors le véridique Vieillard marin sort de la mer, sous le souffle de Zéphyros, et couvert d’une brume épaisse. Étant sorti, il s’endort sous les grottes creuses.
Autour de lui, les phoques sans pieds de la belle Halosydnè, sortant aussi de la blanche mer, s’endorment, innombrables, exhalant l’âcre odeur de la mer profonde. Je te conduirai là, au lever de la lumière, et je t’y placerai comme il convient, et tu choisiras trois de tes compagnons parmi les plus braves qui sont sur tes nefs aux bancs de rameurs. Maintenant, je te dirai toutes les ruses du Vieillard.
D’abord il comptera et il examinera les phoques ; puis, les ayant séparés par cinq, il se couchera au milieu d’eux comme un berger au milieu d’un troupeau de brebis. Dès que vous le verrez presque endormi, alors souvenez-vous de votre courage et de votre force, et retenez-le malgré son désir de vous échapper, et ses efforts. Il se fera semblable à toutes les choses qui sont sur la terre, aux reptiles, à l’eau, au feu ardent ; mais retenez-le vigoureusement et serrez-le plus fort. Mais quand il t’interrogera lui-même et que tu le verras tel qu’il était endormi, n’use plus de violence et lâche le Vieillard. Puis, ô Héros, demande-lui quel dieu t’afflige, et il te dira comment retourner à travers la mer poissonneuse.
Elle parla ainsi et sauta dans la mer agitée. Et je retournai vers mes nefs, là où elles étaient tirées sur la plage, et mon cœur agitait de nombreuses pensées tandis que j’allais. Puis, étant arrivé à ma nef et à la mer, nous préparâmes le repas, et la nuit divine survint, et alors nous nous endormîmes sur le rivage de la mer.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, je marchais vers le rivage de la mer large, en suppliant les dieux ; et je conduisais trois de mes compagnons, me confiant le plus dans leur courage. Pendant ce temps, la déesse, étant sortie du large sein de la mer, en apporta quatre peaux de phoques récemment écorchés, et elle prépara une ruse contre son père. Et elle s’était assise, nous attendant, après avoir creusé des lits dans le sable marin. Et nous vînmes auprès d’elle. Et elle nous plaça et couvrit chacun de nous d’une peau. C’était une embuscade très dure, car l’odeur affreuse des phoques nourris dans la mer nous affligeait cruellement. Qui peut en effet coucher auprès d’un monstre marin ? Mais la déesse nous servit très utilement, et elle mit dans les narines de chacun de nous l’ambroisie au doux parfum qui chassa l’odeur des bêtes marines. Et nous attendîmes, d’un esprit patient, toute la durée du matin. Enfin, les phoques sortirent, innombrables, de la mer, et vinrent se coucher en ordre le long du rivage. Et, vers midi, le Vieillard sortit de la mer, rejoignit les phoques gras, les compta, et nous les premiers parmi eux, ne se doutant point de la ruse ; puis, il se coucha lui-même. Aussitôt, avec des cris, nous nous jetâmes sur lui en l’entourant de nos bras ; mais le Vieillard n’oublia pas ses ruses adroites, et il se changea d’abord en un lion à longue crinière, puis en dragon, en panthère, en grand sanglier, en eau, en arbre au vaste feuillage. Et nous le tenions avec vigueur et d’un cœur ferme ; mais quand le Vieillard plein de ruses se vit réduit, alors il m’interrogea et il me dit :
– Qui d’entre les dieux, fils d’Atreus, t’a instruit, afin que tu me saisisses malgré moi ? Que désires-tu ?
Il parla ainsi, et, lui répondant, je lui dis :
– Tu le sais, Vieillard. Pourquoi me tromper en m’interrogeant ? Depuis longtemps déjà je suis retenu dans cette île, et je ne puis trouver fin à cela, et mon cœur s’épuise. Dis-moi donc, car les dieux savent tout, quel est celui des immortels qui me détourne de ma route et qui m’empêche de retourner à travers la mer poissonneuse ?
Je parlai ainsi, et lui, me répondant, dit :
– Avant tout, tu devais sacrifier à Zeus et aux autres dieux, afin d’arriver très promptement dans ta patrie, en naviguant sur la noire mer. Ta destinée n’est point de revoir tes amis ni de regagner ta demeure bien construite et la terre de la patrie, avant que tu ne sois retourné vers les eaux du fleuve Aigyptos tombé de Zeus, et que tu n’aies offert de sacrées hécatombes aux dieux immortels qui habitent le large Ouranos. Alors les dieux t’accorderont la route que tu désires.
Il parla ainsi, et, aussitôt, mon cher cœur se brisa parce qu’il m’ordonnait de retourner en Aigyptiè, à travers la noire mer, par un chemin long et difficile. Mais, lui répondant, je parlai ainsi :
– Je ferai toutes ces choses, Vieillard, ainsi que tu me le recommandes ; mais dis-moi, et réponds avec vérité, s’ils sont revenus sains et saufs avec leurs nefs tous les Akhaiens que Nestôr et moi nous avions laissés en partant de Troiè, ou si quelqu’un d’entre eux a péri d’une mort soudaine, dans sa nef, ou dans les bras de ses amis, après la guerre ?
Je parlai ainsi, et, me répondant, il dit :
– Atréide, ne m’interroge point, car il ne te convient pas de connaître ma pensée, et je ne pense pas que tu restes longtemps sans pleurer, après avoir tout entendu. Beaucoup d’Akhaiens ont été domptés, beaucoup sont vivants. Tu as vu toi-même les choses de la guerre. Deux chefs des Akhaiens cuirassés d’airain ont péri au retour ; un troisième est vivant et retenu au milieu de la mer large. Aias a été dompté sur sa nef aux longs avirons. Poseidaôn le conduisit d’abord vers les grandes roches de Gyras et le sauva de la mer ; et sans doute il eût évité la mort, bien que haï d’Athènè, s’il n’eût dit une parole impie et s’il n’eût commis une action mauvaise. Il dit que, malgré les dieux, il échapperait aux grands flots de la mer. Et Poseidaôn entendit cette parole orgueilleuse, et, aussitôt, de sa main robuste saisissant le trident, il frappa la roche de Gyras et la fendit en deux ; et une partie resta debout, et l’autre, sur laquelle Aias s’était réfugié, tomba et l’emporta dans la grande mer onduleuse. C’est ainsi qu’il périt, ayant bu l’eau salée.
Ton frère évita la mort et il s’échappa sur sa nef creuse, et la vénérable Hèrè le sauva ; mais à peine avait-il vu le haut cap des Maléiens, qu’une tempête, l’ayant saisi, l’emporta, gémissant, à l’extrémité du pays où Thyestès habitait autrefois, et où habitait alors le Thyestade Aigisthos. Là, le retour paraissait sans danger, et les dieux firent changer les vents et regagnèrent leurs demeures. Et Agamemnôn, joyeux, descendit sur la terre de la patrie, et il la baisait, et il versait des larmes abondantes parce qu’il l’avait revue avec joie. Mais une sentinelle le vit du haut d’un rocher où le traître Aigisthos l’avait placée, lui ayant promis en récompense deux talents d’or. Et, de là, elle veillait depuis toute une année, de peur que l’Atréide arrivât en secret et se souvint de sa force et de son courage. Et elle se hâta d’aller l’annoncer, dans ses demeures, au prince des peuples. Aussitôt Aigisthos médita une embûche rusée, et il choisit, parmi le peuple, vingt hommes très braves, et il les plaça en embuscade, et, d’un autre côté, il ordonna de préparer un repas. Et lui-même il invita, méditant de honteuses actions, le prince des peuples Agamemnôn à le suivre avec ses chevaux et ses chars. Et il mena ainsi à la mort l’Atréide imprudent, et il le tua pendant le repas, comme on égorge un bœuf à l’étable. Et aucun des compagnons d’Agamemnôn ne fut sauvé, ni même ceux d’Aigisthos ; et tous furent égorgés dans la demeure royale.
Il parla ainsi, et ma chère âme fut brisée aussitôt, et je pleurais couché sur le sable, et mon cœur ne voulait plus vivre ni voir la lumière de Hèlios.
Mais, après que je me fus rassasié de pleurer, le véridique Vieillard de la mer me dit :
– Ne pleure point davantage, ni plus longtemps, sans agir, fils d’Atreus, car il n’y a en cela nul remède ; mais tente plutôt très promptement de regagner la terre de la patrie. Ou tu saisiras Aigisthos encore vivant, ou Orestès, te prévenant, l’aura tué, et tu seras présent au repas funèbre.
Il parla ainsi, et, dans ma poitrine, mon cœur et mon esprit généreux, quoique tristes, se réjouirent de nouveau, et je lui dis ces paroles ailées :
– Je connais maintenant la destinée de ceux-ci mais nomme-moi le troisième, celui qui, vivant ou mort, est retenu au milieu de la mer large. Je veux le connaître, quoique plein de tristesse.
Je parlai ainsi, et, me répondant, il dit :
– C’est le fils de Laertès qui avait ses demeures dans Ithakè. Je l’ai vu versant des larmes abondantes dans l’île et dans les demeures de la nymphe Kalypsô qui le retient de force ; et il ne peut regagner la terre de la patrie. Il n’a plus en effet de nefs armées d’avirons ni de compagnons qui puissent le reconduire sur le large dos de la mer. Pour toi, ô divin Ménélaos, ta destinée n’est point de subir la Moire et la mort dans Argos nourrice de chevaux ; mais les dieux t’enverront dans la prairie Élysienne, aux bornes de la terre, là où est le blond Rhadamanthos.
Là, il est très facile aux hommes de vivre. Ni neige, ni longs hivers, ni pluie ; mais toujours le Fleuve Okéanos envoie les douces haleines de Zéphyros, afin de rafraîchir les hommes. Et ce sera ta destinée, parce que tu possèdes Hélénè et que tu es gendre de Zeus.
– Il parla ainsi, et il plongea dans la mer écumeuse. Et je retournai vers mes nefs avec mes divins compagnons. Et mon cœur agitait de nombreuses pensées tandis que je marchais. Étant arrivés à ma nef et à la mer, nous préparâmes le repas, et la nuit solitaire survint, et nous nous endormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, nous traînâmes nos nefs à la mer divine. Puis, dressant les mâts et déployant les voiles des nefs égales, mes compagnons s’assirent sur les bancs de rameurs, et tous, assis en ordre, frappèrent de leurs avirons la mer écumeuse. Et j’arrêtai de nouveau mes nefs dans le fleuve Aigyptos tombé de Zeus, et je sacrifiais de saintes hécatombes. Et, après avoir apaisé la colère des dieux qui vivent toujours, j’élevai un tombeau à Agamemnôn, afin que sa gloire se répandît au loin. Ayant accompli ces choses, je retournai, et les dieux m’envoyèrent un vent propice et me ramenèrent promptement dans la chère patrie. Maintenant, reste dans mes demeures jusqu’au onzième ou au douzième jour ; et, alors, je te renverrai dignement, et je te ferai des présents splendides, trois chevaux et un beau char ; et je te donnerai aussi une belle coupe afin que tu fasses des libations aux dieux immortels et que tu te souviennes toujours de moi.
Et le sage Tèlémakhos lui répondit :
– Atréide, ne me retiens pas ici plus longtemps. Certes, je consumerais toute une année assis auprès de toi, que je n’aurais le regret ni de ma demeure, ni de mes parents, tant je suis profondément charmé de tes paroles et de tes discours ; mais déjà je suis un souci pour mes compagnons dans la divine Pylos, et tu me retiens longtemps ici. Mais que le don, quel qu’il soit, que tu désires me faire, puisse être emporté et conservé. Je ne conduirai point de chevaux dans Ithakè, et je te les laisserai ici dans l’abondance. Car tu possèdes de vastes plaines où croissent abondamment le lotos, le souchet et le froment, et l’avoine et l’orge. Dans Itakhè il n’y a ni routes pour les chars, ni prairies ; elle nourrit plutôt les chèvres que les chevaux et plaît mieux aux premières. Aucune des îles qui s’inclinent à la mer n’est grande, ni munie de prairies, et Ithakè par-dessus toutes.
Il parla ainsi, et le brave Ménélaos rit, et il lui prit la main, et il lui dit :
– Tu es d’un bon sang, cher enfant, puisque tu parles ainsi. Je changerai ce présent, car je le puis. Parmi tous les trésors qui sont dans ma demeure je te donnerai le plus beau et le plus précieux. Je te donnerai un beau kratère tout en argent et dont les bords sont ornés d’or. C’est l’ouvrage de Hèphaistos, et le héros illustre, roi des Sidônes, quand il me reçut dans sa demeure, à mon retour, me le donna ; et je veux te le donner.
Et ils se parlaient ainsi, et les convives revinrent dans la demeure du roi divin. Et ils amenaient des brebis, et ils apportaient le vin qui donne la vigueur ; et les épouses aux belles bandelettes apportaient le pain. Et ils préparaient ainsi le repas dans la demeure.
Mais les prétendants, devant la demeure d’Odysseus, se plaisaient à lancer les disques à courroies de peau de chèvre sur le pavé orné où ils déployaient d’habitude leur insolence. Antinoos et Eurymakhos semblable à un Dieu y étaient assis, et c’étaient les chefs des prétendants et les plus braves d’entre eux. Et Noèmôn, fils de Phronios, s’approchant d’eux, dit à Antinoos :
– Antinoos, savons-nous, ou non, quand Tèlémakhos revient de la sablonneuse Pylos ? Il est parti, emmenant ma nef dont j’ai besoin pour aller dans la grande Élis, où j’ai douze cavales et de patients mulets encore indomptés dont je voudrais mettre quelques-uns sous le joug.
Il parla ainsi, et tous restèrent stupéfaits, car ils ne pensaient pas que Tèlémakhos fût parti pour la Nèléienne Pylos, mais ils croyaient qu’il était dans les champs, auprès des brebis ou du berger. Et, aussitôt, Antinoos, fils d’Eupeithès, lui dit :
– Dis-moi avec vérité quand il est parti, et quels jeunes hommes choisis dans Ithakè l’ont suivi. Sont-ce des mercenaires ou ses esclaves ?
Ils ont donc pu faire ce voyage ! Dis-moi ceci avec vérité, afin que je sache s’il t’a pris ta nef noire par force et contre ton gré, ou si, t’ayant persuadé par ses paroles, tu la lui as donnée volontairement.
Et le fils de Phronios, Noèmôn, lui répondit :
– Je la lui ai donnée volontairement. Comment aurais-je fait autrement ? Quand un tel homme, ayant tant de soucis, adresse une demande, il est difficile de refuser. Les jeunes hommes qui l’ont suivi sont des nôtres et les premiers du peuple, et j’ai reconnu que leur chef était Mentôr, ou un dieu qui est tout semblable à lui ; car j’admire ceci : j’ai vu le divin Mentôr, hier, au matin, et cependant il était parti sur la nef pour Pylos !
Ayant ainsi parlé, il regagna la demeure de son père. Et l’esprit généreux des deux hommes fut troublé. Et les prétendants s’assirent ensemble, se reposant de leurs jeux. Et le fils d’Eupeithès, Antinoos, leur parla ainsi, plein de tristesse, et une noire colère emplissait son cœur, et ses yeux étaient comme des feux flambants :
– Ô dieux ! voici une grande action orgueilleusement accomplie, ce départ de Tèlémakhos ! Nous disions qu’il n’en serait rien, et cet enfant est parti témérairement, malgré nous, et il a traîné une nef à la mer, après avoir choisi les premiers parmi le peuple !
Il a commencé, et il nous réserve des calamités, à moins que Zeus ne rompe ses forces avant qu’il nous porte malheur. Mais donnez-moi promptement une nef rapide et vingt compagnons, afin que je lui tende une embuscade à son retour, dans le détroit d’Ithakè et de l’âpre Samos ; et, à cause de son père, il aura couru la mer pour sa propre ruine.
Il parla ainsi, et tous l’applaudirent et donnèrent des ordres, et aussitôt ils se levèrent pour entrer dans la demeure d’Odysseus.
Mais Pènélopéia ne fut pas longtemps sans connaître leurs paroles et ce qu’ils agitaient dans leur esprit, et le héraut Médôn, qui les avait entendus, le lui dit, étant au seuil de la cour, tandis qu’ils ourdissaient leur dessein à l’intérieur. Et il se hâta d’aller l’annoncer par les demeures à Pènélopéia. Et comme il paraissait sur le seuil, Pènélopéia lui dit :
– Héraut, pourquoi les illustres prétendants t’envoient-ils ? Est-ce pour dire aux servantes du divin Odysseus de cesser de travailler afin de préparer leur repas ? Si, du moins, ils ne me recherchaient point en mariage, s’ils ne s’entretenaient point ici ni ailleurs, si, enfin, ils prenaient ici leur dernier repas ! Vous qui vous êtes rassemblés pour consumer tous les biens et la richesse du sage Tèlémakhos, n’avez-vous jamais entendu dire par vos pères, quand vous étiez enfants, quel était Odysseus parmi vos parents ?
Il n’a jamais traité personne avec iniquité, ni parlé injurieusement en public, bien que ce soit le droit des rois divins de haïr l’un et d’aimer l’autre ; mais lui n’a jamais violenté un homme. Et votre mauvais esprit et vos indignes actions apparaissent, et vous n’avez nulle reconnaissance des bienfaits reçus.
Et Médôn plein de sagesse lui répondit :
Plût aux dieux, reine, que tu subisses maintenant tes pires malheurs ! mais les prétendants méditent un dessein plus pernicieux. Que le Kroniôn ne l’accomplisse pas ! Ils veulent tuer Tèlémakhos avec l’airain aigu, à son retour dans sa demeure ; car il est parti, afin de s’informer de son père, pour la sainte Pylos et la divine Lakédaimôn.
Il parla ainsi, et les genoux de Pènélopéia et son cher cœur furent brisés, et longtemps elle resta muette, et ses yeux s’emplirent de larmes, et sa tendre voix fut haletante, et, lui répondant, elle dit enfin :
– Héraut, pourquoi mon enfant est-il parti ? Où était la nécessité de monter sur les nefs rapides qui sont pour les hommes les chevaux de la mer et qui traversent les eaux immenses ? Veut-il que son nom même soit oublié parmi les hommes ?
Et Médôn plein de sagesse lui répondit
– Je ne sais si un dieu l’a poussé, ou s’il est allé de lui-même vers Pylos, afin de s’informer si son père revient ou s’il est mort.
Ayant ainsi parlé, il sortit de la demeure d’Odysseus. Et une douleur déchirante enveloppa l’âme de Pènélopéia, et elle ne put même s’asseoir sur ses sièges, quoiqu’ils fussent nombreux dans la maison ; mais elle s’assit sur le seuil de la belle chambre nuptiale, et elle gémit misérablement, et, de tous côtés, les servantes jeunes et vieilles, qui étaient dans la demeure, gémissaient aussi.
Et Pènélopéia leur dit en pleurant :
– Écoutez, amies ! les Olympiens m’ont accablée de maux entre toutes les femmes nées et nourries avec moi. J’ai perdu d’abord mon brave mari au cœur de lion, ayant toutes les vertus parmi les Danaens, illustre, et dont la gloire s’est répandue dans la grande Hellas et tout Argos ; et maintenant voici que les tempêtes ont emporté obscurément mon fils bien-aimé loin de ses demeures, sans que j’aie appris son départ ! Malheureuses ! aucune de vous n’a songé dans son esprit à me faire lever de mon lit, bien que sachant, certes, qu’il allait monter sur une nef creuse et noire. Si j’avais su qu’il se préparait à partir, ou il serait resté malgré son désir, ou il m’eût laissée morte dans cette demeure.
Mais qu’un serviteur appelle le vieillard Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand je vins ici, et qui cultive mon verger, afin qu’il aille dire promptement toutes ces choses à Laertès, et que celui-ci prenne une résolution dans son esprit, et vienne en deuil au milieu de ce peuple qui veut détruire sa race et celle du divin Odysseus.
Et la bonne nourrice Eurykléia lui répondit :
– Chère nymphe, tue-moi avec l’airain cruel ou garde-moi dans ta demeure ! Je ne te cacherai rien. Je savais tout, et je lui ai porté tout ce qu’il m’a demandé, du pain et du vin. Et il m’a fait jurer un grand serment que je ne te dirais rien avant le douzième jour, si tu ne le demandais pas, ou si tu ignorais son départ. Et il craignait qu’en pleurant tu blessasses ton beau corps. Mais baigne-toi et revêts de purs vêtements, et monte dans la haute chambre avec tes femmes. Là, supplie Athènè, fille de Zeus tempétueux, afin qu’elle sauve Tèlémakhos de la mort. N’afflige point un vieillard. Je ne pense point que la race de l’Arkeisiade soit haïe des dieux heureux. Mais Odysseus ou Tèlémakhos possèdera encore ces hautes demeures et ces champs fertiles.
Elle parla ainsi, et la douleur de Pènélopéia cessa, et ses larmes s’arrêtèrent. Elle se baigna, se couvrit de purs vêtements, et, montant dans la chambre haute avec ses femmes, elle répandit les orges sacrées d’une corbeille et supplia Athènè :
– Entends-moi, fille indomptée de Zeus tempétueux. Si jamais, dans ses demeures, le subtil Odysseus a brûlé pour toi les cuisses grasses des bœufs et des agneaux, souviens-t’en et garde-moi mon cher fils. Romps le mauvais dessein des insolents prétendants.
Elle parla ainsi en gémissant, et la déesse entendit sa prière.
Et les prétendants s’agitaient tumultueusement dans les salles déjà noires. Et chacun de ces jeunes hommes insolents disait :
– Déjà la reine, désirée par beaucoup, prépare, certes, nos noces, et elle ne sait pas que le meurtre de son fils est proche.
Chacun d’eux parlait ainsi, mais elle connaissait leurs desseins, et Antinoos leur dit :
– Insensés ! cessez tous ces paroles téméraires, de peur qu’on les répète à Pènélopéia ; mais levons-nous, et accomplissons en silence ce que nous avons tous approuvé dans notre esprit.
Il parla ainsi, et il choisit vingt hommes très braves qui se hâtèrent vers le rivage de la mer et la nef rapide. Et ils traînèrent d’abord la nef à la mer, établirent le mât et les voiles dans la nef noire, et lièrent comme il convenait les avirons avec des courroies.
Puis, ils tendirent les voiles blanches, et leurs braves serviteurs leur apportèrent des armes. Enfin, s’étant embarqués, ils poussèrent la nef au large et ils prirent leur repas, en attendant la venue de Hespéros.
Mais, dans la chambre haute, la sage Pènélopéia s’était couchée, n’ayant mangé ni bu, et se demandant dans son esprit si son irréprochable fils éviterait la mort, ou s’il serait dompté par les orgueilleux prétendants. Comme un lion entouré par une foule d’hommes s’agite, plein de crainte, dans le cercle perfide, de même le doux sommeil saisit Pènélopéia tandis qu’elle roulait en elle-même toutes ces pensées. Et elle s’endormit, et toutes ses peines disparurent.
Alors la déesse aux yeux clairs, Athènè, eut une autre pensée, et elle forma une image semblable à Iphthimè, à la fille du magnanime Ikarios, qu’Eumèlos qui habitait Phérè avait épousée. Et Athènè l’envoya dans la demeure du divin Odysseus, afin d’apaiser les peines et les larmes de Pènélopéia qui se lamentait et pleurait. Et l’image entra dans la chambre nuptiale le long de la courroie du verrou, et, se tenant au-dessus de sa tête, elle lui dit :
– Tu dors, Pènélopéia, affligée dans ton cher cœur ; mais les dieux qui vivent toujours ne veulent pas que tu pleures, ni que tu sois triste, car ton fils reviendra, n’ayant jamais offensé les dieux.
Et la sage Pènélopéia, doucement endormie aux portes des Songes, lui répondit :
– Ô sœur, pourquoi es-tu venue ici, où je ne t’avais encore jamais vue, tant la demeure est éloignée où tu habites ? Pourquoi m’ordonnes-tu d’apaiser les maux et les peines qui me tourmentent dans l’esprit et dans l’âme ? J’ai perdu d’abord mon brave mari au cœur de lion, ayant toutes les vertus parmi les Danaens, illustre, et dont la gloire s’est répandue dans la grande Hellas et tout Argos ; et, maintenant, voici que mon fils bien-aimé est parti sur une nef creuse, l’insensé ! sans expérience des travaux et des discours. Et je pleure sur lui plus que sur son père ; et je tremble, et je crains qu’il souffre chez le peuple vers lequel il est allé, ou sur la mer. De nombreux ennemis lui tendent des embûches et veulent le tuer avant qu’il revienne dans la terre de la patrie.
Et la vague image lui répondit :
– Prends courage, et ne redoute rien dans ton esprit. Il a une compagne telle que les autres hommes en souhaiteraient volontiers, car elle peut tout. C’est Pallas Athènè, et elle a compassion de tes gémissements, et, maintenant, elle m’envoie te le dire.
Et la sage Pènélopéia lui répondit :
– Si tu es déesse, et si tu as entendu la voix de la déesse, parle-moi du malheureux Odysseus. Vit-il encore quelque part, et voit-il la lumière de Hèlios, ou est-il mort et dans les demeures d’Aidès ?
Et la vague image lui répondit :
– Je ne te dirai rien de lui. Est-il vivant ou mort ?
Il ne faut point parler de vaines paroles.
En disant cela, elle s’évanouit le long du verrou dans un souffle de vent. Et la fille d’Ikarios se réveilla, et son cher cœur se réjouit parce qu’un songe véridique lui était survenu dans l’ombre de la nuit.
Et les prétendants naviguaient sur les routes humides, méditant dans leur esprit le meurtre cruel de Tèlémakhos. Et il y a une île au milieu de la mer pleine de rochers, entre Ithakè et l’âpre Samos, Astéris, qui n’est pas grande, mais où se trouvent pour les nefs des ports ayant une double issue. C’est là que s’arrêtèrent les Akhaiens embusqués.Chant 5
Eôs sortait du lit de l’illustre Tithôn, afin de porter la lumière aux Immortels et aux mortels. Et les dieux étaient assis en conseil, et au milieu d’eux était Zeus qui tonne dans les hauteurs et dont la puissance est la plus grande. Et Athènè leur rappelait les nombreuses traverses d’Odysseus. Et elle se souvenait de lui avec tristesse parce qu’il était retenu dans les demeures d’une Nymphe :
– Père Zeus, et vous, dieux heureux qui vivez toujours, craignez qu’un roi porte-sceptre ne soit plus jamais ni doux, ni clément, mais que, loin d’avoir des pensées équitables, il soit dur et injuste, si nul ne se souvient du divin Odysseus parmi ceux sur lesquels il a régné comme un père plein de douceur. Voici qu’il est étendu, subissant des peines cruelles, dans l’île et dans les demeures de la Nymphe Kalypsô qui le retient de force, et il ne peut retourner dans la terre de la patrie, car il n’a ni nefs armées d’avirons, ni compagnons, qui puissent le conduire sur le vaste dos de la mer. Et voici maintenant qu’on veut tuer son fils bien-aimé à son retour dans ses demeures, car il est parti, afin de s’informer de son père, pour la divine Pylos et l’illustre Lakédaimôn.
Et Zeus qui amasse les nuées lui répondit :
– Mon enfant, quelle parole s’est échappée d’entre tes dents ? N’as-tu point délibéré toi-même dans ton esprit pour qu’Odysseus revint et se vengeât ?
Conduis Tèlémakhos avec soin, car tu le peux, afin qu’il retourne sain et sauf dans la terre de la patrie, et les prétendants reviendront sur leur nef.
Il parla ainsi, et il dit à Herméias, son cher fils :
– Herméias, qui es le messager des dieux, va dire à la Nymphe aux beaux cheveux que nous avons résolu le retour d’Odysseus. Qu’elle le laisse partir. Sans qu’aucun dieu ou qu’aucun homme mortel le conduise, sur un radeau uni par des liens, seul, et subissant de nouvelles douleurs, il parviendra le vingtième jour à la fertile Skhériè, terre des Phaiakiens qui descendent des Dieux. Et les Phaiakiens, dans leur esprit, l’honoreront comme un dieu, et ils le renverront sur une nef dans la chère terre de la patrie, et ils lui donneront en abondance de l’airain, de l’or et des vêtements, de sorte qu’Odysseus n’en eût point rapporté autant de Troiè, s’il était revenu sain et sauf, ayant reçu sa part du butin. Ainsi sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie.
Il parla ainsi, et le messager-tueur d’Argos obéit. Et il attacha aussitôt à ses pieds de belles sandales, immortelles et d’or, qui le portaient, soit au-dessus de la mer, soit au-dessus de la terre immense, pareil au souffle du vent. Et il prit aussi la baguette à l’aide de laquelle il charme les yeux des hommes, ou il les réveille, quand il le veut.
Tenant cette baguette dans ses mains, le puissant Tueur d’Argos, s’envolant vers la Piériè, tomba de l’Aithèr sur la mer et s’élança, rasant les flots, semblable à la mouette qui, autour des larges golfes de la mer indomptée, chasse les poissons et plonge ses ailes robustes dans l’écume salée. Semblable à cet oiseau, Hermès rasait les flots innombrables.
Et, quand il fut arrivé à l’île lointaine, il passa de la mer bleue sur la terre, jusqu’à la vaste grotte que la nymphe aux beaux cheveux habitait, et où il la trouva. Et un grand feu brûlait au foyer, et l’odeur du cèdre et du thuia ardents parfumait toute l’île. Et la nymphe chantait d’une belle voix, tissant une toile avec une navette d’or. Et une forêt verdoyante environnait la grotte, l’aune, le peuplier et le cyprès odorant, où les oiseaux qui déploient leurs ailes faisaient leurs nids : les chouettes, les éperviers et les bavardes corneilles de mer qui s’inquiètent toujours des flots. Et une jeune vigne, dont les grappes mûrissaient, entourait la grotte, et quatre cours d’eau limpide, tantôt voisins, tantôt allant çà et là, faisaient verdir de molles prairies de violettes et d’aches. Même si un immortel s’en approchait, il admirerait et serait charmé dans son esprit. Et le puissant messager-tueur d’Argos s’arrêta et, ayant tout admiré dans son esprit, entra aussitôt dans la vaste grotte.
Et l’illustre déesse Kalypsô le reconnut, car les dieux immortels ne sont point inconnus les uns aux autres, même quand ils habitent, chacun, une demeure lointaine.
Et Hermès ne vit pas dans la grotte le magnanime Odysseus, car celui-ci pleurait, assis sur le rivage ; et, déchirant son cœur de sanglots et de gémissements, il regardait la mer agitée et versait des larmes. Mais l’illustre déesse Kalypsô interrogea Herméias, étant assise sur un thrône splendide :
– Pourquoi es-tu venu vers moi, Herméias à la baguette d’or, vénérable et cher, que je n’ai jamais vu ici ? Dis ce que tu désires. Mon cœur m’ordonne de te satisfaire, si je le puis et si cela est possible. Mais suis-moi, afin que je t’offre les mets hospitaliers.
Ayant ainsi parlé, la déesse dressa une table en la couvrant d’ambroisie et mêla le rouge nektar. Et le messager-tueur d’Argos but et mangea, et quand il eut achevé son repas et satisfait son âme, il dit à la déesse :
– Tu me demandes pourquoi un dieu vient vers toi, déesse ; je te répondrai avec vérité, comme tu le désires. Zeus m’a ordonné de venir, malgré moi, car qui parcourrait volontiers les immenses eaux salées où il n’y a aucune ville d’hommes mortels qui font des sacrifices aux dieux et leur offrent de saintes hécatombes ? Mais il n’est point permis à tout autre dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux. On dit qu’un homme est auprès de toi, le plus malheureux de tous les hommes qui ont combattu pendant neuf ans autour de la ville de Priamos, et qui l’ayant saccagée dans la dixième année, montèrent sur leurs nefs pour le retour.
Et ils offensèrent Athènè, qui souleva contre eux le vent, les grands flots et le malheur. Et tous les braves compagnons d’Odysseus périrent, et il fut lui-même jeté ici par le vent et les flots. Maintenant, Zeus t’ordonne de le renvoyer très promptement, car sa destinée n’est point de mourir loin de ses amis, mais de les revoir et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie.
Il parla ainsi, et l’illustre déesse Kalypsô frémit, et, lui répondant, elle dit en paroles ailées :
– Vous êtes injustes, ô dieux, et les plus jaloux des autres dieux, et vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les hommes qu’elles choisissent pour leurs chers maris. Ainsi, quand Éôs aux doigts rosés enleva Oriôn, vous fûtes jaloux d’elle, ô dieux qui vivez toujours, jusqu’à ce que la chaste Artémis au thrône d’or eût tué Oriôn de ses douces flèches, dans Ortygiè ; ainsi, quand Dèmètèr aux beaux cheveux, cédant à son âme, s’unit d’amour à Iasiôn sur une terre récemment labourée, Zeus, l’ayant su aussitôt, le tua en le frappant de la blanche foudre ; ainsi, maintenant, vous m’enviez, ô dieux, parce que je garde auprès de moi un homme mortel que j’ai sauvé et recueilli seul sur sa carène, après que Zeus eut fendu d’un jet de foudre sa nef rapide au milieu de la mer sombre. Tous ses braves compagnons avaient péri, et le vent et les flots l’avaient poussé ici. Et je l’aimai et je le recueillis, et je me promettais de le rendre immortel et de le mettre pour toujours à l’abri de la vieillesse.
Mais il n’est point permis à tout autre dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux. Puisqu’il veut qu’Odysseus soit de nouveau errant sur la mer agitée, soit ; mais je ne le renverrai point moi-même, car je n’ai ni nefs armées d’avirons, ni compagnons qui le reconduisent sur le vaste dos de la mer. Je lui révélerai volontiers et ne lui cacherai point ce qu’il faut faire pour qu’il parvienne sain et sauf dans la terre de la patrie.
Et le messager tueur d’Argos lui répondit aussitôt :
– Renvoie-le dès maintenant, afin d’éviter la colère de Zeus, et de peur qu’il s’enflamme contre toi à l’avenir.
Ayant ainsi parlé, le puissant Tueur d’Argos s’envola, et la vénérable nymphe, après avoir reçu les ordres de Zeus, alla vers le magnanime Odysseus. Et elle le trouva assis sur le rivage, et jamais ses yeux ne tarissaient de larmes, et sa douce vie se consumait à gémir dans le désir du retour, car la nymphe n’était point aimée de lui. Certes, pendant la nuit, il dormait contre sa volonté dans la grotte creuse, sans désir, auprès de celle qui le désirait ; mais, le jour, assis sur les rochers et sur les rivages, il déchirait son cœur par les larmes, les gémissements et les douleurs, et il regardait la mer indomptée en versant des larmes.
Et l’illustre déesse, s’approchant, lui dit :
– Malheureux, ne te lamente pas plus longtemps ici, et ne consume point ta vie, car je vais te renvoyer promptement. Va ! fais un large radeau avec de grands arbres tranchés par l’airain, et pose par-dessus un banc très élevé, afin qu’il te porte sur la mer sombre. Et j’y placerai moi-même du pain, de l’eau et du vin rouge qui satisferont ta faim, et je te donnerai des vêtements, et je t’enverrai un vent propice afin que tu parviennes sain et sauf dans la terre de la patrie, si les dieux le veulent ainsi qui habitent le large Ouranos et qui sont plus puissants que moi par l’intelligence et la sagesse.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus frémit et il lui dit en paroles ailées :
– Certes, tu as une autre pensée, déesse, que celle de mon départ, puisque tu m’ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux de la mer, difficiles et effrayantes, et que traversent à peine les nefs égales et rapides se réjouissant du souffle de Zeus. Je ne monterai point, comme tu le veux, sur un radeau, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne prépares point mon malheur et ma perte.
Il parla ainsi, et l’illustre déesse Kalypsô rit, et elle le caressa de la main, et elle lui répondit :
– Certes, tu es menteur et rusé, puisque tu as pensé et parlé ainsi. Que Gaia le sache, et le large Ouranos supérieur, et l’eau souterraine de Styx, ce qui est le plus grand et le plus terrible serment des dieux heureux, que je ne prépare ni ton malheur, ni ta perte.
Je t’ai offert et conseillé ce que je tenterais pour moi-même, si la nécessité m’y contraignait. Mon esprit est équitable, et je n’ai point dans ma poitrine un cœur de fer, mais compatissant.
Ayant ainsi parlé, l’illustre déesse le précéda promptement, et il allait sur les traces de la déesse. Et tous deux parvinrent à la grotte creuse. Et il s’assit sur le thrône d’où s’était levé Herméias et la Nymphe plaça devant lui les choses que les hommes mortels ont coutume de manger et de boire. Elle-même s’assit auprès du divin Odysseus, et les servantes placèrent devant elle l’ambroisie et le nektar. Et tous deux étendirent les mains vers les mets placés devant eux ; et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, l’illustre déesse Kalypsô commença de parler :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, ainsi, tu veux donc retourner dans ta demeure et dans la chère terre de la patrie ? Cependant, reçois mon salut. Si tu savais dans ton esprit combien de maux il est dans ta destinée de subir avant d’arriver à la terre de la patrie, certes, tu resterais ici avec moi, dans cette demeure, et tu serais immortel, bien que tu désires revoir ta femme que tu regrettes tous les jours. Et certes, je me glorifie de ne lui être inférieure ni par la beauté, ni par l’esprit, car les mortelles ne peuvent lutter de beauté avec les immortelles.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Vénérable déesse, ne t’irrite point pour cela contre moi. Je sais en effet que la sage Pènélopéia t’est bien inférieure en beauté et majesté. Elle est mortelle, et tu ne connaîtras point la vieillesse ; et, cependant, je veux et je désire tous les jours revoir le moment du retour et regagner ma demeure. Si quelque dieu m’accable encore de maux sur la sombre mer, je les subirai avec un cœur patient. J’ai déjà beaucoup souffert sur les flots et dans la guerre ; que de nouvelles misères m’arrivent, s’il le faut.
Il parla ainsi, et Hèlios tomba et les ténèbres survinrent ; et tous deux, se retirant dans le fond de la grotte creuse, se charmèrent par l’amour, couchés ensemble. Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, aussitôt Odysseus revêtit sa tunique et son manteau, et la nymphe se couvrit d’une grande robe blanche, légère et gracieuse ; et elle mit autour de ses reins une belle ceinture d’or, et, sur sa tête, un voile. Enfin, préparant le départ du magnanime Odysseus, elle lui donna une grande hache d’airain, bien en main, à deux tranchants et au beau manche fait de bois d’olivier. Et elle lui donna ensuite une doloire aiguisée. Et elle le conduisit à l’extrémité de l’île où croissaient de grands arbres, des aunes, des peupliers et des pins qui atteignaient l’Ouranos, et dont le bois sec flotterait plus légèrement. Et, lui ayant montré le lieu où les grands arbres croissaient, l’illustre déesse Kalypsô retourna dans sa demeure.
Et aussitôt Odysseus trancha les arbres et fit promptement son travail.
Et il en abattit vingt qu’il ébrancha, équarrit et aligna au cordeau. Pendant ce temps l’illustre déesse Kalypsô apporta des tarières ; et il perça les bois et les unit entre eux, les liant avec des chevilles et des cordes. Aussi grande est la cale d’une nef de charge que construit un excellent ouvrier, aussi grand était le radeau construit par Odysseus. Et il éleva un pont qu’il fit avec des ais épais ; et il tailla un mât auquel il attacha l’antenne. Puis il fit le gouvernail, qu’il munit de claies de saule afin qu’il résistât au choc des flots ; puis il amassa un grand lest. Pendant ce temps, l’illustre déesse Kalypsô apporta de la toile pour faire les voiles, et il les fit habilement et il les lia aux antennes avec des cordes. Puis il conduisit le radeau à la mer large, à l’aide de leviers. Et le quatrième jour tout le travail était achevé ; et le cinquième jour la divine Kalypsô le renvoya de l’île, l’ayant baigné et couvert de vêtements parfumés. Et la déesse mit sur le radeau une outre de vin noir, puis une outre plus grande pleine d’eau, puis elle lui donna, dans un sac de cuir, une grande quantité de vivres fortifiants, et elle lui envoya un vent doux et propice.
Et le divin Odysseus, joyeux, déploya ses voiles au vent propice ; et, s’étant assis à la barre, il gouvernait habilement, sans que le sommeil fermât ses paupières. Et il contemplait les Plèiades, et le Bouvier qui se couchait, et l’Ourse qu’on nomme le Chariot, et qui tourne en place en regardant Oriôn, et, seule, ne touche point les eaux de l’Okéanos. L’illustre déesse Kalypsô lui avait ordonné de naviguer en la laissant toujours à gauche.
Et, pendant dix-sept jours, il fit route sur la mer, et, le dix-huitième, apparurent les monts boisés de la terre des Phaiakiens. Et cette terre était proche, et elle lui apparaissait comme un bouclier sur la mer sombre.
Et le puissant qui ébranle la terre revenait du pays des Aithiopiens, et du haut des montagnes des Solymes, il vit de loin Odysseus traversant la mer ; et son cœur s’échauffa violemment, et secouant la tête, il dit dans son esprit :
– Ô dieux ! les immortels ont décidé autrement d’Odysseus tandis que j’étais chez les Aithiopiens. Voici qu’il approche de la terre des Phaiakiens, où sa destinée est qu’il rompe la longue chaîne de misères qui l’accablent. Mais je pense qu’il va en subir encore.
Ayant ainsi parlé, il amassa les nuées et souleva la mer. Et il saisit de ses mains son trident et il déchaîna la tempête de tous les vents. Et il enveloppa de nuages la terre et la mer, et la nuit se rua de l’Ouranos. Et l’Euros et le Notos soufflèrent, et le violent Zéphyros et l’impétueux Boréas, soulevant de grandes lames. Et les genoux d’Odysseus et son cher cœur furent brisés, et il dit avec tristesse dans son esprit magnanime :
– Ah ! malheureux que je suis ! Que va-t-il m’arriver ? Je le crains, la déesse ne m’a point trompé quand elle m’a dit que je subirais des maux nombreux sur la mer, avant de parvenir à la terre de la patrie.
Certes, voici que ses paroles s’accomplissent. De quelles nuées Zeus couronne le large Ouranos ! La mer est soulevée, les tempêtes de tous les vents sont déchaînées, et voici ma ruine suprême. Trois et quatre fois heureux les Danaens qui sont morts autrefois, devant la grande Troiè, pour plaire aux Atréides ! Plût aux dieux que j’eusse subi ma destinée et que je fusse mort le jour où les Troiens m’assiégeaient de leurs lances d’airain autour du cadavre d’Akhilleus ! Alors on eût accompli mes funérailles, et les Akhaiens eussent célébré ma gloire. Maintenant ma destinée est de subir une mort obscure !
Il parla ainsi, et une grande lame, se ruant sur lui, effrayante, renversa le radeau. Et Odysseus en fut enlevé, et le gouvernail fut arraché de ses mains ; et la tempête horrible des vents confondus brisa le mât par le milieu ; et l’antenne et la voile furent emportées à la mer ; et Odysseus resta longtemps sous l’eau, ne pouvant émerger de suite, à cause de l’impétuosité de la mer. Et il reparut enfin, et les vêtements que la divine Kalypsô lui avait donnés étaient alourdis, et il vomit l’eau salée, et l’écume ruisselait de sa tête. Mais, bien qu’affligé, il n’oublia point le radeau, et, nageant avec vigueur à travers les flots, il le ressaisit, et, se sauvant de la mort, il s’assit. Et les grandes lames impétueuses emportaient le radeau çà et là. De même que l’automnal Boréas chasse par les plaines les feuilles desséchées, de même les vents chassaient çà et là le radeau sur la mer.
Tantôt l’Euros le cédait à Zéphyros afin que celui-ci l’entraînât, tantôt le Notos le cédait à Boréas.
Et la fille de Kadmos, Inô aux beaux talons, qui autrefois était mortelle, le vit. Maintenant elle se nomme Leukothéè et partage les honneurs des dieux dans les flots de la mer. Et elle prit en pitié Odysseus errant et accablé de douleurs. Et elle émergea de l’abîme, semblable à un plongeon, et, se posant sur le radeau, elle dit à Odysseus
– Malheureux ! pourquoi Poseidaôn qui ébranle la terre est-il si cruellement irrité contre toi, qu’il t’accable de tant de maux ? Mais il ne te perdra pas, bien qu’il le veuille. Fais ce que je vais te dire, car tu ne me sembles pas manquer de sagesse. Ayant rejeté tes vêtements, abandonne le radeau aux vents et nage de tes bras jusqu’à la terre des Phaiakiens, où tu dois être sauvé. Prends cette bandelette immortelle, étends-la sur ta poitrine et ne crains plus ni la douleur, ni la mort. Dès que tu auras saisi le rivage de tes mains, tu la rejetteras au loin dans la sombre mer en te détournant.
La déesse, ayant ainsi parlé, lui donna la bandelette puis elle se replongea dans la mer tumultueuse, semblable à un plongeon, et le flot noir la recouvrit. Mais le patient et divin Odysseus hésitait, et il dit, en gémissant, dans son esprit magnanime :
– Hélas ! je crains qu’un des immortels ourdisse une ruse contre moi en m’ordonnant de me jeter hors du radeau ; mais je ne lui obéirai pas aisément, car cette terre est encore très éloignée où elle dit que je dois échapper à la mort ; mais je ferai ceci, et il me semble que c’est le plus sage : aussi longtemps que ces pièces de bois seront unies par leurs liens, je resterai ici et je subirai mon mal patiemment, et dès que la mer aura rompu le radeau, je nagerai, car je ne pourrai rien faire de mieux.
Tandis qu’il pensait ainsi dans son esprit et dans son cœur, Poseidaôn qui ébranle la terre souleva une lame immense, effrayante, lourde et haute, et il la jeta sur Odysseus. De même que le vent qui souffle avec violence disperse un monceau de pailles sèches qu’il emporte çà et là, de même la mer dispersa les longues poutres, et Odysseus monta sur une d’entre elles comme sur un cheval qu’on dirige. Et il dépouilla les vêtements que la divine Kalypsô lui avait donnés, et il étendit aussitôt sur sa poitrine la bandelette de Leukothéè ; puis, s’allongeant sur la mer, il étendit les bras, plein du désir de nager. Et le puissant qui ébranle la terre le vit, et secouant la tête, il dit dans son esprit :
– Va ! subis encore mille maux, errant sur la mer, jusqu’à ce que tu abordes ces hommes nourris par Zeus ; mais j’espère que tu ne te riras plus de mes châtiments.
Ayant ainsi parlé, il poussa ses chevaux aux belles crinières et parvint à Aigas, où sont ses demeures illustres.
Mais Athènè, la fille de Zeus, eut d’autres pensées. Elle rompit le cours des vents, et elle leur ordonna de cesser et de s’endormir. Et elle excita, seul, le rapide Boréas, et elle refréna les flots, jusqu’à ce que le divin Odysseus, ayant évité la kèr et la mort, se fût mêlé aux Phaiakiens habiles aux travaux de la mer.
Et, pendant deux nuits et deux jours, Odysseus erra par les flots sombres, et son cœur vit souvent la mort ; mais quand Éôs aux beaux cheveux amena le troisième jour, le vent s’apaisa, et la sérénité tranquille se fit ; et, se soulevant sur la mer, et regardant avec ardeur, il vit la terre toute proche. De même qu’à des fils est rendue la vie désirée d’un père qui, en proie à un dieu contraire, a longtemps subi de grandes douleurs, mais que les dieux ont enfin délivré de son mal, de même la terre et les bois apparurent joyeusement à Odysseus. Et il nageait s’efforçant de fouler de ses pieds cette terre. Mais, comme il n’en était éloigné que de la portée de la voix, il entendit le son de la mer contre les rochers. Et les vastes flots se brisaient, effrayants, contre la côte aride, et tout était enveloppé de l’écume de la mer. Et il n’y avait là ni ports, ni abris pour les nefs, et le rivage était hérissé d’écueils et de rochers. Alors, les genoux et le cher cœur d’Odysseus furent brisés, et, gémissant, il dit dans son esprit magnanime :
– Hélas ! Zeus m’a accordé de voir une terre inespérée, et je suis arrivé ici, après avoir sillonné les eaux, et je ne sais comment sortir de la mer profonde.
Les rochers aigus se dressent, les flots impétueux écument de tous côtés et la côte est escarpée. La profonde mer est proche, et je ne puis appuyer mes pieds nulle part, ni échapper à mes misères, et peut-être le grand flot va-t-il me jeter contre ces roches, et tous mes efforts seront vains. Si je nage encore, afin de trouver ailleurs une plage heurtée par les eaux, ou un port, je crains que la tempête me saisisse de nouveau et me rejette, malgré mes gémissements, dans la haute mer poissonneuse ; ou même qu’un dieu me livre à un monstre marin, de ceux que l’illustre Amphitritè nourrit en grand nombre. Je sais, en effet, combien l’illustre qui ébranle la terre est irrité contre moi.
Tandis qu’il délibérait ainsi dans son esprit et dans son cœur, une vaste lame le porta vers l’âpre rivage, et il y eût déchiré sa peau et brisé ses os, si Athènè, la déesse aux yeux clairs, ne l’eût inspiré. Emporté en avant, de ses deux mains il saisit la roche et il l’embrassa en gémissant jusqu’à ce que le flot immense se fût déroulé, et il se sauva ainsi ; mais le reflux, se ruant sur lui, le frappa et le remporta en mer. De même que les petites pierres restent, en grand nombre, attachées aux articulations creuses du polypode arraché de son abri, de même la peau de ses mains vigoureuses s’était déchirée au rocher, et le flot vaste le recouvrit. Là, enfin, le malheureux Odysseus eût péri malgré la destinée, si Athènè, la déesse aux yeux clairs, ne l’eût inspiré sagement. Il revint sur l’eau, et, traversant les lames qui le poussaient à la côte, il nagea, examinant la terre et cherchant s’il trouverait quelque part une plage heurtée par les flots, ou un port.
Et quand il fut arrivé, en nageant, à l’embouchure d’un fleuve au beau cours, il vit que cet endroit était excellent et mis à l’abri du vent par des roches égales. Et il examina le cours du fleuve, et, dans son esprit, il dit en suppliant :
– Entends-moi, ô roi, qui que tu sois ! Je viens à toi en te suppliant avec ardeur, et fuyant hors de la mer la colère de Poseidaôn. Celui qui vient errant est vénérable aux dieux immortels et aux hommes. Tel je suis maintenant en abordant ton cours, car je t’approche après avoir subi de nombreuses misères. Prends pitié, ô roi ! Je me glorifie d’être ton suppliant.
Il parla ainsi, et le fleuve s’apaisa, arrêtant son cours et les flots ; et il se fit tranquille devant Odysseus, et il le recueillit à son embouchure. Et les genoux et les bras vigoureux du Laertiade étaient rompus, et son cher cœur était accablé par la mer. Tout son corps était gonflé, et l’eau salée remplissait sa bouche et ses narines. Sans haleine et sans voix, il gisait sans force, et une violente fatigue l’accablait. Mais, ayant respiré et recouvré l’esprit, il détacha la bandelette de la déesse et la jeta dans le fleuve, qui l’emporta à la mer, où Inô la saisit aussitôt de ses chères mains. Alors Odysseus, s’éloignant du fleuve, se coucha dans les joncs. Et il baisa la terre et dit en gémissant dans son esprit magnanime :
– Hélas ! que va-t-il m’arriver et que vais-je souffrir, si je passe la nuit dangereuse dans le fleuve ?
Je crains que la mauvaise fraîcheur et la rosée du matin achèvent d’affaiblir mon âme. Le fleuve souffle en effet, au matin, un air froid. Si je montais sur la hauteur, vers ce bois ombragé, je m’endormirais sous les arbustes épais, et le doux sommeil me saisirait, à moins que le froid et la fatigue s’y opposent. Mais je crains d’être la proie des bêtes fauves.
Ayant ainsi délibéré, il vit que ceci était pour le mieux, et il se hâta vers la forêt qui se trouvait sur la hauteur, près de la côte. Et il aperçut deux arbustes entrelacés, dont l’un était un olivier sauvage et l’autre un olivier. Et là, ni la violence humide des vents, ni Hèlios étincelant de rayons, ni la pluie ne pénétrait, tant les rameaux entrelacés étaient touffus. Et Odysseus s’y coucha, après avoir amassé un large lit de feuilles, et si abondant, que deux ou trois hommes s’y seraient blottis par le temps d’hiver le plus rude. Et le patient et divin Odysseus, joyeux de voir ce lit, se coucha au milieu, en se couvrant de l’abondance des feuilles. De même qu’un berger, à l’extrémité d’une terre où il n’a aucun voisin, recouvre ses tisons de cendre noire et conserve ainsi le germe du feu, afin de ne point aller le chercher ailleurs ; de même Odysseus était caché sous les feuilles, et Athènè répandit le sommeil sur ses yeux et ferma ses paupières, pour qu’il se reposât promptement de ses rudes travaux.Chant 6
Ainsi dormait là le patient et divin Odysseus, dompté par le sommeil et par la fatigue, tandis qu’Athènè se rendait à la ville et parmi le peuple des hommes Phaiakiens qui habitaient autrefois la grande Hypériè, auprès des kyklôpes insolents qui les opprimaient, étant beaucoup plus forts qu’eux. Et Nausithoos, semblable à un dieu, les emmena de là et les établit dans l’île de Skhériè, loin des autres hommes. Et il bâtit un mur autour de la ville, éleva des demeures, construisit les temples des dieux et partagea les champs. Mais, déjà, dompté par la kèr, il était descendu chez Aidés. Et maintenant régnait Alkinoos, instruit dans la sagesse par les dieux. Et Athènè, la déesse aux yeux clairs, se rendait à sa demeure, méditant le retour du magnanime Odysseus. Et elle entra promptement dans la chambre ornée où dormait la jeune vierge semblable aux Immortelles par la grâce et la beauté, Nausikaa, fille du magnanime Alkinoos. Et deux servantes, belles comme les Kharites, se tenaient des deux côtés du seuil, et les portes brillantes étaient fermées.
Athènè, comme un souffle du vent, approcha du lit de la jeune vierge, et, se tenant au-dessus de sa tête, lui parla, semblable à la fille de l’illustre marin Dymas, laquelle était du même âge qu’elle, et qu’elle aimait. Semblable à cette jeune fille, Athènè aux yeux clairs parla ainsi :
– Nausikaa, pourquoi ta mère t’a-t-elle enfantée si négligente ? En effet, tes belles robes gisent négligées, et tes noces approchent où il te faudra revêtir les plus belles et en offrir à ceux qui te conduiront.
La bonne renommée, parmi les hommes, vient des beaux vêtements, et le père et la mère vénérable s’en réjouissent. Allons donc laver tes robes, au premier lever du jour, et je te suivrai et t’aiderai, afin que nous finissions promptement, car tu ne seras plus longtemps vierge. Déjà les premiers du peuple te recherchent, parmi tous les Phaiakiens d’où sort ta race. Allons ! demande à ton illustre père, dès le matin, qu’il fasse préparer les mulets et le char qui porteront les ceintures, les péplos et les belles couvertures. Il est mieux que tu montes aussi sur le char que d’aller à pied, car les lavoirs sont très éloignés de la ville.
Ayant ainsi parlé, Athènè aux yeux clairs retourna dans l’Olympos, où sont toujours, dit-on, les solides demeures des dieux, que le vent n’ébranle point, où la pluie ne coule point, dont la neige n’approche point, mais où la sérénité vole sans nuage et qu’enveloppe une splendeur éclatante dans laquelle les dieux heureux se réjouissent sans cesse. C’est là que remonta la déesse aux yeux clairs, après qu’elle eut parlé à la jeune vierge.
Et aussitôt la brillante Éôs se leva et réveilla Nausikaa au beau péplos, qui admira le songe qu’elle avait eu. Et elle se hâta d’aller par les demeures, afin de prévenir ses parents, son cher père et sa mère, qu’elle trouva dans l’intérieur. Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine ; et son père sortait avec les rois illustres, pour se rendre au conseil où l’appelaient les nobles Phaiakiens.
Et, s’arrêtant près de son cher père, elle lui dit :
– Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé, afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ? Il te convient, en effet, à toi qui t’assieds au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as cinq fils dans ta maison royale ; deux sont mariés, et trois sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés.
Elle parla ainsi, n’osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :
– Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé propre à porter une charge.
Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug et les lièrent au char. Et Nausikaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les déposa dans le char. Et sa mère enfermait d’excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d’or une huile liquide, afin qu’elle se parfumât avec ses femmes.
Et Nausikaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets afin qu’ils courussent ; et ceux-ci, faisant un grand bruit, s’élancèrent, emportant les vêtements et Nausikaa, mais non pas seule, car les autres femmes allaient avec elle.
Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l’année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu’ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu’elles plongèrent dans l’eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s’étant elles-mêmes baignées et parfumées d’huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios.
Après que Nausikaa et ses servantes eurent mangé, elles jouèrent à la balle, ayant dénoué les bandelettes de leur tête. Et Nausikaa aux beaux bras commença une mélopée. Ainsi Artémis marche sur les montagnes, joyeuse de ses flèches, et, sur le Tèygétos escarpé ou l’Érymanthos, se réjouit des sangliers et des cerfs rapides. Et les nymphes agrestes, filles de Zeus tempétueux, jouent avec elle, et Lètô se réjouit dans son cœur.
Artémis les dépasse toutes de la tête et du front, et on la reconnaît facilement, bien qu’elles soient toutes belles. Ainsi la jeune vierge brillait au milieu de ses femmes.
Mais quand il fallut plier les beaux vêtements, atteler les mulets et retourner vers la demeure, alors Athènè, la déesse aux yeux clairs, eut d’autres pensées, et elle voulut qu’Odysseus se réveillât et vît la vierge aux beaux yeux, et qu’elle le conduisît à la ville des Phaiakiens. Alors, la jeune reine jeta une balle à l’une de ses femmes, et la balle s’égara et tomba dans le fleuve profond. Et toutes poussèrent de hautes clameurs, et le divin Odysseus s’éveilla. Et, s’asseyant, il délibéra dans son esprit et dans son cœur :
– Hélas ! à quels hommes appartient cette terre où je suis venu ? Sont-ils injurieux, sauvages, injustes, ou hospitaliers, et leur esprit craint-il les dieux ? J’ai entendu des clameurs de jeunes filles. Est-ce la voix des nymphes qui habitent le sommet des montagnes et les sources des fleuves et les marais herbus, ou suis-je près d’entendre la voix des hommes ? Je m’en assurerai et je verrai.
Ayant ainsi parlé, le divin Odysseus sortit du milieu des arbustes, et il arracha de sa main vigoureuse un rameau épais afin de voiler sa nudité sous les feuilles. Et il se hâta, comme un lion des montagnes, confiant dans ses forces, marche à travers les pluies et les vents. Ses yeux luisent ardemment, et il se jette sur les bœufs, les brebis ou les cerfs sauvages, car son ventre le pousse à attaquer les troupeaux et à pénétrer dans leur solide demeure.
Ainsi Odysseus parut au milieu des jeunes filles aux beaux cheveux, tout nu qu’il était, car la nécessité l’y contraignait. Et il leur apparut horrible et souillé par l’écume de la mer, et elles s’enfuirent, çà et là, sur les hauteurs du rivage. Et, seule, la fille d’Alkinoos resta, car Athènè avait mis l’audace dans son cœur et chassé la crainte de ses membres. Elle resta donc seule en face d’Odysseus.
Et celui-ci délibérait, ne sachant s’il supplierait la vierge aux beaux yeux, en saisissant ses genoux, ou s’il la prierait de loin, avec des paroles flatteuses, de lui donner des vêtements et de lui montrer la ville. Et il vit qu’il valait mieux la supplier de loin par des paroles flatteuses, de peur que, s’il saisissait ses genoux, la s’irritât dans son esprit. Et, aussitôt, il lui adressa la vierge ce discours flatteur et adroit :
– Je te supplie, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle ! si tu es déesse, de celles qui habitent le large Ouranos, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus, par la beauté, la stature et la grâce ; si tu es une des mortelles qui habitent sur la terre, trois fois heureux ton père et ta mère vénérable ! trois fois heureux tes frères ! Sans doute leur âme est pleine de joie devant ta grâce, quand ils te voient te mêler aux chœurs dansants ! Mais plus heureux entre tous celui qui, te comblant de présents d’hyménée, te conduira dans sa demeure ! Jamais, en effet, je n’ai vu de mes yeux un homme aussi beau, ni une femme aussi belle, et je suis saisi d’admiration. Une fois, à Dèlos, devant l’autel d’Apollôn, je vis une jeune tige de palmier.
J’étais allé là, en effet, et un peuple nombreux m’accompagnait dans ce voyage qui devait me porter malheur. Et, en voyant ce palmier, je restai longtemps stupéfait dans l’âme qu’un arbre aussi beau fût sorti de terre. Ainsi je t’admire, Ô femme, et je suis stupéfait, et je tremble de saisir tes genoux, car je suis en proie à une grande douleur. Hier, après vingt jours, je me suis enfin échappé de la sombre mer. Pendant ce temps-là, les flots et les rapides tempêtes m’ont entraîné de l’île d’Ogygiè, et voici qu’un dieu m’a poussé ici, afin que j’y subisse encore peut-être d’autres maux, car je ne pense pas en avoir vu la fin, et les dieux vont sans doute m’en accabler de nouveau. Mais, ô reine, aie pitié de moi, car c’est vers toi, la première, que je suis venu, après avoir subi tant de misères. Je ne connais aucun des hommes qui habitent cette ville et cette terre. Montre-moi la ville et donne moi quelque lambeau pour me couvrir, si tu as apporté ici quelque enveloppe de vêtements. Que les dieux t’accordent autant de choses que tu en désires : un mari, une famille et une heureuse concorde ; car rien n’est plus désirable et meilleur que la concorde à l’aide de laquelle on gouverne sa famille. Le mari et l’épouse accablent ainsi leurs ennemis de douleurs et leurs amis de joie, et eux-mêmes sont heureux.
Et Nausikaa aux bras blancs lui répondit :
– Étranger, car, certes, tu n’es semblable ni à un lâche, ni à un insensé, Zeus Olympien dispense la richesse aux hommes, aux bons et aux méchants, à chacun, comme il veut.
C’est lui qui t’a fait cette destinée, et il faut la subir patiemment. Maintenant, étant venu vers notre terre et notre ville, tu ne manqueras ni de vêtements, ni d’aucune autre des choses qui conviennent à un malheureux qui vient en suppliant. Et je te montrerai la ville et je te dirai le nom de notre peuple. Les Phaiakiens habitent cette ville et cette terre, et moi, je suis la fille du magnanime Alkinoos, qui est le premier parmi les Phaiakiens par le pouvoir et la puissance.
Elle parla ainsi et commanda à ses servantes aux belles chevelures :
– Venez près de moi, servantes. Où fuyez-vous pour avoir vu cet homme ? Pensez-vous que ce soit quelque ennemi ? Il n’y a point d’homme vivant, et il ne peut en être un seul qui porte la guerre sur la terre des Phaiakiens, car nous sommes très chers aux dieux immortels, et nous habitons aux extrémités de la mer onduleuse, et nous n’avons aucun commerce avec les autres hommes. Mais si quelque malheureux errant vient ici, il nous faut le secourir, car les hôtes et les mendiants viennent de Zeus, et le don, même modique, qu’on leur fait, lui est agréable. C’est pourquoi, servantes, donnez à notre hôte à manger et à boire, et lavez-le dans le fleuve, à l’abri du vent.
Elle parla ainsi, et les servantes s’arrêtèrent et s’exhortèrent l’une l’autre, et elles conduisirent Odysseus à l’abri du vent, comme l’avait ordonné Nausikaa, fille du magnanime Alkinoos, et elles placèrent auprès de lui des vêtements, un manteau et une tunique, et elles lui donnèrent l’huile liquide dans la fiole d’or, et elles lui commandèrent de se laver dans le courant du fleuve. Mais alors le divin Odysseus leur dit :
– Servantes, éloignez-vous un peu, afin que je lave l’écume de mes épaules et que je me parfume d’huile, car il y a longtemps que mon corps manque d’onction. Je ne me laverai point devant vous, car je crains, par respect, de me montrer nu au milieu de jeunes filles aux beaux cheveux.
Il parla ainsi, et, se retirant, elles rapportèrent ces paroles à la vierge Nausikaa.
Et le divin Odysseus lava dans le fleuve l’écume salée qui couvrait son dos, ses flancs et ses épaules ; et il purifia sa tête des souillures de la mer indomptée. Et, après s’être entièrement baigné et parfumé d’huile, il se couvrit des vêtements que la jeune vierge lui avait donnés. Et Athènè, fille de Zeus, le fit paraître plus grand et fit tomber de sa tête sa chevelure bouclée semblable aux fleurs d’hyacinthe. De même un habile ouvrier qui répand de l’or sur de l’argent, et que Hèphaistos et Pallas Athènè ont instruit, achève de brillantes œuvres avec un art accompli, de même Athènè répandit la grâce sur sa tête et sur ses épaules.
Et il s’assit ensuite à l’écart, sur le rivage de la mer, resplendissant de beauté et de grâce. Et la vierge, l’admirant, dit à ses servantes aux beaux cheveux :
– Écoutez-moi, servantes aux bras blancs, afin que je dise quelque chose. Ce n’est pas malgré tous les dieux qui habitent l’Olympos que cet homme divin est venu chez les Phaiakiens. Il me semblait d’abord méprisable, et maintenant il est semblable aux dieux qui habitent le large Ouranos. Plût aux dieux qu’un tel homme fût nommé mon mari, qu’il habitât ici et qu’il lui plût d’y rester ! Mais, vous, servantes, offrez à notre hôte à boire et à manger.
Elle parla ainsi, et les servantes l’entendirent et lui obéirent ; et elles offrirent à Odysseus à boire et à manger. Et le divin Odysseus buvait et mangeait avec voracité, car il y avait longtemps qu’il n’avait pris de nourriture. Mais Nausikaa aux bras blancs eut d’autres pensées ; elle posa les vêtements pliés dans le char, y monta après avoir attelé les mulets aux sabots massifs, et, exhortant Odysseus, elle lui dit :
– Lève-toi, étranger, afin d’aller à la ville et que je te conduise à la demeure de mon père prudent, où je pense que tu verras les premiers d’entre les Phaiakiens. Mais fais ce que je vais te dire, car tu me sembles plein de sagesse :
aussi longtemps que nous irons à travers les champs et les travaux des hommes, marche rapidement avec les servantes, derrière les mulets et le char, et, moi, je montrerai le chemin ; mais quand nous serons arrivés à la ville, qu’environnent de hautes tours et que partage en deux un beau port dont l’entrée est étroite, où sont conduites les nefs, chacune à une station sûre, et devant lequel est le beau temple de Poseidaôn dans l’agora pavée de grandes pierres taillées ; – et là aussi sont les armements des noires nefs, les cordages et les antennes et les avirons qu’on polit, car les arcs et les carquois n’occupent point les Phaiakiens, mais seulement les mâts, et les avirons des nefs, et les nefs égales sur lesquelles ils traversent joyeux la mer pleine d’écume ; – évite alors leurs amères paroles, de peur qu’un d’entre eux me blâme en arrière, car ils sont très insolents, et que le plus méchant, nous rencontrant, dise peut-être : – Quel est cet étranger grand et beau qui suit Nausikaa ? Où l’a-t-elle trouvé ? Certes, il sera son mari. Peut-être l’a-t-elle reçu avec bienveillance, comme il errait hors de sa nef conduite par des hommes étrangers, car aucuns n’habitent près d’ici ; ou peut-être encore un dieu qu’elle a supplié ardemment est-il descendu de l’Ouranos, et elle le possédera tous les jours. Elle a bien fait d’aller au-devant d’un mari étranger, car, certes, elle dédaigne les Phaiakiens illustres et nombreux qui la recherchent ! – Ils parleraient ainsi, et leurs paroles seraient honteuses pour moi. Je blâmerais moi-même celle qui, à l’insu de son cher père et de sa mère, irait seule parmi les hommes avant le jour des noces.
Écoute donc mes paroles, étranger, afin d’obtenir de mon père des compagnons et un prompt retour. Nous trouverons auprès du chemin un beau bois de peupliers consacré à Athènè. Une source en coule et une prairie l’entoure, et là sont le verger de mon père et ses jardins florissants, éloignés de la ville d’une portée de voix. Il faudra t’arrêter là quelque temps, jusqu’à ce que nous soyons arrivées à la ville et à la maison de mon père. Dès que tu penseras que nous y sommes parvenues, alors, marche vers la ville des Phaiakiens et cherche les demeures de mon père, le magnanime Alkinoos. Elles sont faciles à reconnaître, et un enfant pourrait y conduire ; car aucune des maisons des Phaiakiens n’est telle que la demeure du héros Alkinoos. Quand tu seras entré dans la cour, traverse promptement la maison royale afin d’arriver jusqu’à ma mère. Elle est assise à son foyer, à la splendeur du feu, filant une laine pourprée admirable à voir. Elle est appuyée contre une colonne et ses servantes sont assises autour d’elle. Et, à côté d’elle, est le thrône de mon père, où il s’assied, pour boire du vin, semblable à un immortel. En passant devant lui, embrasse les genoux de ma mère, afin que, joyeux, tu voies promptement le jour du retour, même quand tu serais très loin de ta demeure. En effet, si ma mère t’est bienveillante dans son âme, tu peux espérer revoir tes amis, et rentrer dans ta demeure bien bâtie et dans la terre de la patrie.
Ayant ainsi parlé, elle frappa les mulets du fouet brillant, et les mulets, quittant rapidement les bords du fleuve, couraient avec ardeur et en trépignant.
Et Nausikaa les guidait avec art des rênes et du fouet, de façon que les servantes et Odysseus suivissent à pied. Et Hèlios tomba, et ils parvinrent au bois sacré d’Athènè, où le divin Odysseus s’arrêta. Et, aussitôt, il supplia la fille du magnanime Zeus :
– Entends-moi, fille indomptée de Zeus tempêtueux ! Exauce-moi maintenant, puisque tu ne m’as point secouru quand l’illustre qui entoure la terre m’accablait. Accorde-moi d’être le bien venu chez les Phaiakiens, et qu’ils aient pitié.
Il parla ainsi en suppliant, et Pallas Athènè l’entendit, mais elle ne lui apparut point, respectant le frère de son père ; car il devait être violemment irrité contre le divin Odysseus jusqu’à ce que celui-ci fût arrivé dans la terre de la patrie.Chant 7
Tandis que le patient et divin Odysseus suppliait ainsi Athènè, la vigueur des mulets emportait la jeune vierge vers la ville. Et quand elle fut arrivée aux illustres demeures de son père, elle s’arrêta dans le vestibule ; et, de tous côtés, ses frères, semblables aux immortels, s’empressèrent autour d’elle, et ils détachèrent les mulets du char, et ils portèrent les vêtements dans la demeure. Puis la vierge rentra dans sa chambre où la vieille servante épirote Eurymédousa alluma du feu. Des nefs à deux rangs d’avirons l’avaient autrefois amenée du pays des épirotes, et on l’avait donnée en récompense à Alkinoos, parce qu’il commandait à tous les Phaiakiens et que le peuple l’écoutait comme un dieu. Elle avait allaité Nausikaa aux bras blancs dans la maison royale, et elle allumait son feu et elle préparait son repas.
Et, alors, Odysseus se leva pour aller à la ville, et Athènè, pleine de bienveillance pour lui, l’enveloppa d’un épais brouillard, de peur qu’un des Phaiakiens insolents, le rencontrant, l’outrageât par ses paroles et lui demandât qui il était. Mais, quand il fut entré dans la belle ville, alors Athènè, la déesse aux yeux clairs, sous la figure d’une jeune vierge portant une urne, s’arrêta devant lui, et le divin Odysseus l’interrogea :
– Ô mon enfant, ne pourrais-tu me montrer la demeure du héros Alkinoos qui commande parmi les hommes de ce pays ? Je viens ici, d’une terre lointaine et étrangère, comme un hôte, ayant subi beaucoup de maux, et je ne connais aucun des hommes qui habitent cette ville et cette terre.
Et la déesse aux yeux clairs, Athènè, lui répondit :
– Hôte vénérable, je te montrerai la demeure que tu me demandes, car elle est auprès de celle de mon père irréprochable. Mais viens en silence, et je t’indiquerai le chemin. Ne parle point et n’interroge aucun de ces hommes, car ils n’aiment point les étrangers et ils ne reçoivent point avec amitié quiconque vient de loin. Confiants dans leurs nefs légères et rapides, ils traversent les grandes eaux, et celui qui ébranle la terre leur a donné des nefs rapides comme l’aile des oiseaux et comme la pensée.
Ayant ainsi parlé, Pallas Athènè le précéda promptement, et il marcha derrière la déesse, et les illustres navigateurs Phaiakiens ne le virent point tandis qu’il traversait la ville au milieu d’eux, car Athènè, la vénérable déesse aux beaux cheveux, ne le permettait point, ayant enveloppé Odysseus d’un épais brouillard, dans sa bienveillance pour lui. Et Odysseus admirait le port, les nefs égales, l’agora des héros et les longues murailles fortifiées de hauts pieux, admirables à voir. Et, quand ils furent arrivés à l’illustre demeure du roi, Athènè, la déesse aux yeux clairs, lui parla d’abord :
– Voici, hôte, mon père, la demeure que tu m’as demandé de te montrer. Tu trouveras les rois, nourrissons de Zeus, prenant leur repas. Entre, et ne crains rien dans ton âme. D’où qu’il vienne, l’homme courageux est celui qui accomplit le mieux tout ce qu’il fait. Va d’abord à la reine, dans la maison royale. Son nom est Arètè, et elle le mérite, et elle descend des mêmes parents qui ont engendré le roi Alkinoos. Poseidaôn qui ébranle la terre engendra Nausithoos que conçut Périboia, la plus belle des femmes et la plus jeune fille du magnanime Eurymédôn qui commanda autrefois aux fiers géants. Mais il perdit son peuple impie et périt lui-même. Poseidaôn s’unit à Périboia, et il engendra le magnanime Nausithoos qui commanda aux Phaiakiens. Et Nausithoos engendra Rhèxènôr et Alkinoos. Apollôn à l’arc d’argent frappa le premier qui venait de se marier dans la maison royale et qui ne laissa point de fils, mais une fille unique, Arètè, qu’épousa Alkinoos. Et il l’a honorée plus que ne sont honorées toutes les autres femmes qui, sur la terre, gouvernent leur maison sous la puissance de leurs maris. Et elle est honorée par ses chers enfants non moins que par Alkinoos, ainsi que par les peuples, qui la regardent comme une déesse et qui recueillent ses paroles quand elle marche par la ville. Elle ne manque jamais de bonnes pensées dans son esprit, et elle leur est bienveillante, et elle apaise leurs différends. Si elle t’est favorable dans son âme, tu peux espérer revoir tes amis et rentrer dans ta haute demeure et dans la terre de la patrie.
Ayant ainsi parlé, Athènè aux yeux clairs s’envola sur la mer indomptée, et elle abandonna l’aimable Skhériè, et elle arriva à Marathôn, et, étant parvenue dans Athéna aux larges rues, elle entra dans la forte demeure d’Erekhtheus.
Et Odysseus se dirigea vers l’illustre maison d’Alkinoos, et il s’arrêta, l’âme pleine de pensées, avant de fouler le pavé d’airain. En effet, la haute demeure du magnanime Alkinoos resplendissait comme Hèlios ou Sélènè. De solides murs d’airain, des deux côtés du seuil, enfermaient la cour intérieure, et leur pinacle était d’émail. Et des portes d’or fermaient la solide demeure, et les poteaux des portes étaient d’argent sur le seuil d’airain argenté, et, au-dessus, il y avait une corniche d’or, et, des deux côtés, il y avait des chiens d’or et d’argent que Hèphaistos avait faits très habilement, afin qu’ils gardassent la maison du magnanime Alkinoos, étant immortels et ne devant point vieillir. Dans la cour, autour du mur, des deux côtés, étaient des thrônes solides, rangés jusqu’à l’entrée intérieure et recouverts de légers péplos, ouvrage des femmes. Là, siégeaient les princes des Phaiakiens, mangeant et buvant toute l’année. Et des figures de jeunes hommes, en or, se dressaient sur de beaux autels, portant aux mains des torches flambantes qui éclairaient pendant la nuit les convives dans la demeure. Et cinquante servantes habitaient la maison, et les unes broyaient sous la meule le grain mûr, et les autres, assises, tissaient les toiles et tournaient la quenouille agitée comme les feuilles du haut peuplier, et une huile liquide distillait de la trame des tissus. Autant les Phaiakiens étaient les plus habiles de tous les hommes pour voguer en mer sur une nef rapide, autant leurs femmes l’emportaient pour travailler les toiles, et Athènè leur avait accordé d’accomplir de très beaux et très habiles ouvrages. Et, au-delà de la cour, auprès des portes, il y avait un grand jardin de quatre arpents, entouré de tous côtés par une haie. Là, croissaient de grands arbres florissants qui produisaient, les uns la poire et la grenade, les autres les belles oranges, les douces figues et les vertes olives. Et jamais ces fruits ne manquaient ni ne cessaient, et ils duraient tout l’hiver et tout l’été, et Zéphyros, en soufflant, faisait croître les uns et mûrir les autres ; la poire succédait à la poire, la pomme mûrissait après la pomme, et la grappe après la grappe, et la figue après la figue. Là, sur la vigne fructueuse, le raisin séchait, sous l’ardeur de Hèlios, en un lieu découvert, et, là, il était cueilli et foulé ; et, parmi les grappes, les unes perdaient leurs fleurs tandis que d’autres mûrissaient. Et à la suite du jardin, il y avait un verger qui produisait abondamment toute l’année. Et il y avait deux sources, dont l’une courait à travers tout le jardin, tandis que l’autre jaillissait sous le seuil de la cour, devant la haute demeure, et les citoyens venaient y puiser de l’eau. Et tels étaient les splendides présents des dieux dans la demeure d’Alkinoos.
Tandis que le patient et divin Odysseus suppliait ainsi Athènè, la vigueur des mulets emportait la jeune vierge vers la ville. Et quand elle fut arrivée aux illustres demeures de son père, elle s’arrêta dans le vestibule ; et, de tous côtés, ses frères, semblables aux immortels, s’empressèrent autour d’elle, et ils détachèrent les mulets du char, et ils portèrent les vêtements dans la demeure. Puis la vierge rentra dans sa chambre où la vieille servante épirote Eurymédousa alluma du feu. Des nefs à deux rangs d’avirons l’avaient autrefois amenée du pays des épirotes, et on l’avait donnée en récompense à Alkinoos, parce qu’il commandait à tous les Phaiakiens et que le peuple l’écoutait comme un dieu. Elle avait allaité Nausikaa aux bras blancs dans la maison royale, et elle allumait son feu et elle préparait son repas.
Et, alors, Odysseus se leva pour aller à la ville, et Athènè, pleine de bienveillance pour lui, l’enveloppa d’un épais brouillard, de peur qu’un des Phaiakiens insolents, le rencontrant, l’outrageât par ses paroles et lui demandât qui il était. Mais, quand il fut entré dans la belle ville, alors Athènè, la déesse aux yeux clairs, sous la figure d’une jeune vierge portant une urne, s’arrêta devant lui, et le divin Odysseus l’interrogea :
– Ô mon enfant, ne pourrais-tu me montrer la demeure du héros Alkinoos qui commande parmi les hommes de ce pays ? Je viens ici, d’une terre lointaine et étrangère, comme un hôte, ayant subi beaucoup de maux, et je ne connais aucun des hommes qui habitent cette ville et cette terre.
Et la déesse aux yeux clairs, Athènè, lui répondit :
– Hôte vénérable, je te montrerai la demeure que tu me demandes, car elle est auprès de celle de mon père irréprochable. Mais viens en silence, et je t’indiquerai le chemin. Ne parle point et n’interroge aucun de ces hommes, car ils n’aiment point les étrangers et ils ne reçoivent point avec amitié quiconque vient de loin. Confiants dans leurs nefs légères et rapides, ils traversent les grandes eaux, et celui qui ébranle la terre leur a donné des nefs rapides comme l’aile des oiseaux et comme la pensée.
Ayant ainsi parlé, Pallas Athènè le précéda promptement, et il marcha derrière la déesse, et les illustres navigateurs Phaiakiens ne le virent point tandis qu’il traversait la ville au milieu d’eux, car Athènè, la vénérable déesse aux beaux cheveux, ne le permettait point, ayant enveloppé Odysseus d’un épais brouillard, dans sa bienveillance pour lui. Et Odysseus admirait le port, les nefs égales, l’agora des héros et les longues murailles fortifiées de hauts pieux, admirables à voir. Et, quand ils furent arrivés à l’illustre demeure du roi, Athènè, la déesse aux yeux clairs, lui parla d’abord :
– Voici, hôte, mon père, la demeure que tu m’as demandé de te montrer. Tu trouveras les rois, nourrissons de Zeus, prenant leur repas. Entre, et ne crains rien dans ton âme. D’où qu’il vienne, l’homme courageux est celui qui accomplit le mieux tout ce qu’il fait.
Va d’abord à la reine, dans la maison royale. Son nom est Arètè, et elle le mérite, et elle descend des mêmes parents qui ont engendré le roi Alkinoos. Poseidaôn qui ébranle la terre engendra Nausithoos que conçut Périboia, la plus belle des femmes et la plus jeune fille du magnanime Eurymédôn qui commanda autrefois aux fiers géants. Mais il perdit son peuple impie et périt lui-même. Poseidaôn s’unit à Périboia, et il engendra le magnanime Nausithoos qui commanda aux Phaiakiens. Et Nausithoos engendra Rhèxènôr et Alkinoos. Apollôn à l’arc d’argent frappa le premier qui venait de se marier dans la maison royale et qui ne laissa point de fils, mais une fille unique, Arètè, qu’épousa Alkinoos. Et il l’a honorée plus que ne sont honorées toutes les autres femmes qui, sur la terre, gouvernent leur maison sous la puissance de leurs maris. Et elle est honorée par ses chers enfants non moins que par Alkinoos, ainsi que par les peuples, qui la regardent comme une déesse et qui recueillent ses paroles quand elle marche par la ville. Elle ne manque jamais de bonnes pensées dans son esprit, et elle leur est bienveillante, et elle apaise leurs différends. Si elle t’est favorable dans son âme, tu peux espérer revoir tes amis et rentrer dans ta haute demeure et dans la terre de la patrie.
Ayant ainsi parlé, Athènè aux yeux clairs s’envola sur la mer indomptée, et elle abandonna l’aimable Skhériè, et elle arriva à Marathôn, et, étant parvenue dans Athéna aux larges rues, elle entra dans la forte demeure d’Erekhtheus.
Et Odysseus se dirigea vers l’illustre maison d’Alkinoos, et il s’arrêta, l’âme pleine de pensées, avant de fouler le pavé d’airain. En effet, la haute demeure du magnanime Alkinoos resplendissait comme Hèlios ou Sélènè. De solides murs d’airain, des deux côtés du seuil, enfermaient la cour intérieure, et leur pinacle était d’émail. Et des portes d’or fermaient la solide demeure, et les poteaux des portes étaient d’argent sur le seuil d’airain argenté, et, au-dessus, il y avait une corniche d’or, et, des deux côtés, il y avait des chiens d’or et d’argent que Hèphaistos avait faits très habilement, afin qu’ils gardassent la maison du magnanime Alkinoos, étant immortels et ne devant point vieillir. Dans la cour, autour du mur, des deux côtés, étaient des thrônes solides, rangés jusqu’à l’entrée intérieure et recouverts de légers péplos, ouvrage des femmes. Là, siégeaient les princes des Phaiakiens, mangeant et buvant toute l’année. Et des figures de jeunes hommes, en or, se dressaient sur de beaux autels, portant aux mains des torches flambantes qui éclairaient pendant la nuit les convives dans la demeure. Et cinquante servantes habitaient la maison, et les unes broyaient sous la meule le grain mûr, et les autres, assises, tissaient les toiles et tournaient la quenouille agitée comme les feuilles du haut peuplier, et une huile liquide distillait de la trame des tissus. Autant les Phaiakiens étaient les plus habiles de tous les hommes pour voguer en mer sur une nef rapide, autant leurs femmes l’emportaient pour travailler les toiles, et Athènè leur avait accordé d’accomplir de très beaux et très habiles ouvrages.
Et, au-delà de la cour, auprès des portes, il y avait un grand jardin de quatre arpents, entouré de tous côtés par une haie. Là, croissaient de grands arbres florissants qui produisaient, les uns la poire et la grenade, les autres les belles oranges, les douces figues et les vertes olives. Et jamais ces fruits ne manquaient ni ne cessaient, et ils duraient tout l’hiver et tout l’été, et Zéphyros, en soufflant, faisait croître les uns et mûrir les autres ; la poire succédait à la poire, la pomme mûrissait après la pomme, et la grappe après la grappe, et la figue après la figue. Là, sur la vigne fructueuse, le raisin séchait, sous l’ardeur de Hèlios, en un lieu découvert, et, là, il était cueilli et foulé ; et, parmi les grappes, les unes perdaient leurs fleurs tandis que d’autres mûrissaient. Et à la suite du jardin, il y avait un verger qui produisait abondamment toute l’année. Et il y avait deux sources, dont l’une courait à travers tout le jardin, tandis que l’autre jaillissait sous le seuil de la cour, devant la haute demeure, et les citoyens venaient y puiser de l’eau. Et tels étaient les splendides présents des dieux dans la demeure d’Alkinoos.
Le patient et divin Odysseus, s’étant arrêté, admira toutes ces choses, et, quand il les eut admirées, il passa rapidement le seuil de la demeure. Et il trouva les princes et les chefs des Phaiakiens faisant des libations au vigilant tueur d’Argos, car ils finissaient par lui, quand ils songeaient à gagner leurs lits. Et le divin et patient Odysseus, traversa la demeure, enveloppé de l’épais brouillard que Pallas Athènè avait répandu autour de lui, et il parvint à Arètè et au roi Alkinoos.
Et Odysseus entoura de ses bras les genoux d’Arètè, et le brouillard divin tomba. Et, à sa vue, tous restèrent muets dans la demeure, et ils l’admiraient. Mais Odysseus fit cette prière :
– Arètè, fille du divin Rhèxènôr, je viens à tes genoux, et vers ton mari et vers ses convives, après avoir beaucoup souffert. Que les dieux leur accordent de vivre heureusement, et de laisser à leurs enfants les biens qui sont dans leurs demeures et les récompenses que le peuple leur a données ! Mais préparez mon retour, afin que j’arrive promptement dans ma patrie, car il y a longtemps que je subis de nombreuses misères, loin de mes amis.
Ayant ainsi parlé, il s’assit dans les cendres du foyer, devant le feu, et tous restaient muets.
Enfin, le vieux héros Ekhénèos parla ainsi. C’était le plus âgé de tous les Phaiakiens, et il savait beaucoup de choses anciennes, et il l’emportait sur tous par son éloquence. Plein de sagesse, il parla ainsi au milieu de tous :
– Alkinoos, il n’est ni bon, ni convenable pour toi, que ton hôte soit assis dans les cendres du foyer. Tes convives attendent tous ta décision. Mais hâte-toi ; fais asseoir ton hôte sur un thrône orné de clous d’argent, et commande aux hérauts de verser du vin, afin que nous fassions des libations à Zeus foudroyant qui accompagne les suppliants vénérables.
Pendant ce temps, l’économe offrira à ton hôte les mets qui sont dans la demeure.
Dès que la force sacrée d’Alkinoos eut entendu ces paroles, il prit par la main le sage et subtil Odysseus, et il le fit lever du foyer, et il le fit asseoir sur un thrône brillant d’où s’était retiré son fils, le brave Laodamas, qui siégeait à côté de lui et qu’il aimait le plus. Une servante versa de l’eau d’une belle aiguière d’or dans un bassin d’argent, pour qu’il lavât ses mains, et elle dressa devant lui une table polie. Et la vénérable économe, gracieuse pour tous, apporta le pain et de nombreux mets. Et le sage et divin Odysseus buvait et mangeait. Alors Alkinoos dit à un héraut :
– Pontonoos, mêle le vin dans le kratère et distribue-le à tous dans la demeure, afin que nous fassions des libations à Zeus foudroyant qui accompagne les suppliants vénérables.
Il parla ainsi, et Pontonoos mêla le doux vin, et il le distribua en goûtant d’abord à toutes les coupes. Et ils firent des libations, et ils burent autant que leur âme le désirait, et Alkinoos leur parla ainsi :
– Écoutez-moi, princes et chefs des Phaiakiens, afin que je dise ce que mon cœur m’inspire dans ma poitrine. Maintenant que le repas est achevé, allez dormir dans vos demeures.
Demain matin, ayant convoqué les vieillards, nous exercerons l’hospitalité envers notre hôte dans ma maison, et nous ferons de justes sacrifices aux dieux ; puis nous songerons au retour de notre hôte, afin que, sans peine et sans douleur, et par nos soins, il arrive plein de joie dans la terre de sa patrie, quand même elle serait très lointaine. Et il ne subira plus ni maux, ni misères, jusqu’à ce qu’il ait foulé sa terre natale. Là, il subira ensuite la destinée que les lourdes Moires lui ont filée dès l’instant où sa mère l’enfanta. Qui sait s’il n’est pas un des immortels descendu de l’Ouranos ? Les dieux auraient ainsi médité quelque autre dessein ; car ils se sont souvent, en effet, manifestés à nous, quand nous leur avons offert d’illustres hécatombes, et ils se sont assis à nos repas, auprès de nous et comme nous ; et si un voyageur Phaiakien les rencontre seul sur sa route, ils ne se cachent point de lui, car nous sommes leurs parents, de même que les kyklôpes et la race sauvage des géants.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Alkinoos, que d’autres pensées soient dans ton esprit. Je ne suis point semblable aux immortels qui habitent le large Ouranos ni par l’aspect, ni par la démarche ; mais je ressemble aux hommes mortels, de ceux que vous savez être le plus accablés de misères. C’est à ceux-ci que je suis semblable par mes maux. Et les douleurs infinies que je pourrais raconter, certes, je les ai toutes souffertes par la volonté des dieux.
Mais laissez-moi prendre mon repas malgré ma tristesse ; car il n’est rien de pire qu’un ventre affamé, et il ne se laisse pas oublier par l’homme le plus affligé et dont l’esprit est le plus tourmenté d’inquiétudes. Ainsi, j’ai dans l’âme un grand deuil, et la faim et la soif m’ordonnent de manger et de boire et de me rassasier, quelques maux que j’aie subis. Mais hâtez-vous, dès qu’Eôs reparaîtra, de me renvoyer, malheureux que je suis, dans ma patrie, afin qu’après avoir tant souffert, la vie ne me quitte pas sans que j’aie revu mes biens, mes serviteurs et ma haute demeure !
Il parla ainsi, et tous l’applaudirent, et ils s’exhortaient à reconduire leur hôte, parce qu’il avait parlé convenablement. Puis, ayant fait des libations et bu autant que leur âme le désirait, ils allèrent dormir, chacun dans sa demeure. Mais le divin Odysseus resta, et, auprès de lui, Arètè et le divin Alkinoos s’assirent, et les servantes emportèrent les vases du repas. Et Arètè aux bras blancs parla la première, ayant reconnu le manteau, la tunique, les beaux vêtements qu’elle avait faits elle-même avec ses femmes. Et elle dit à Odysseus ces paroles ailées :
– Mon hôte, je t’interrogerai la première. Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Qui t’a donné ces vêtements ? Ne dis-tu pas qu’errant sur la mer, tu es venu ici ?
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Il me serait difficile, reine, de raconter de suite tous les maux dont les dieux Ouraniens m’ont accablé ; mais je te dirai ce que tu me demandes d’abord. Il y a au milieu de la mer une île, Ogygiè, qu’habite Kalypsô, déesse dangereuse, aux beaux cheveux, fille rusée d’Atlas ; et aucun des Dieux ni des hommes mortels n’habite avec elle. Un daimôn m’y conduisit seul, malheureux que j’étais ! car Zeus, d’un coup de la blanche foudre, avait fendu en deux ma nef rapide au milieu de la noire mer où tous mes braves compagnons périrent. Et moi, serrant de mes bras la carène de ma nef au double rang d’avirons, je fus emporté pendant neuf jours, et, dans la dixième nuit noire, les dieux me poussèrent dans l’île Ogygiè, où habitait Kalypsô, la déesse dangereuse aux beaux cheveux. Et elle m’accueillit avec bienveillance, et elle me nourrit, et elle me disait qu’elle me rendrait immortel et qu’elle m’affranchirait pour toujours de la vieillesse ; mais elle ne put persuader mon cœur dans ma poitrine.
Et je passai là sept années, et je mouillais de mes larmes les vêtements immortels que m’avait donnés Kalypsô. Mais quand vint la huitième année, alors elle me pressa elle-même de m’en retourner, soit par ordre de Zeus, soit que son cœur eût changé. Elle me renvoya sur un radeau lié de cordes, et elle me donna beaucoup de pain et de vin, et elle me couvrit de vêtements divins, et elle me suscita un vent propice et doux. Je naviguais pendant dix-sept jours, faisant ma route sur la mer, et, le dix-huitième jour, les montagnes ombragées de votre terre m’apparurent, et mon cher cœur fut joyeux.
Malheureux ! j’allais être accablé de nouvelles et nombreuses misères que devait m’envoyer Poseidaôn qui ébranle la terre.
Et il excita les vents, qui m’arrêtèrent en chemin ; et il souleva la mer immense, et il voulut que les flots, tandis que je gémissais, accablassent le radeau, que la tempête dispersa ; et je nageai, fendant les eaux, jusqu’à ce que le vent et le flot m’eurent porté à terre, où la mer me jeta d’abord contre de grands rochers, puis me porta en un lieu plus favorable ; car je nageai de nouveau jusqu’au fleuve, à un endroit accessible, libre de rochers et à l’abri du vent. Et je raffermis mon esprit, et la nuit divine arriva. Puis, étant sorti du fleuve tombé de Zeus, je me couchai sous les arbustes, où j’amassai des feuilles, et un dieu m’envoya un profond sommeil. Là, bien qu’affligé dans mon cher cœur, je dormis toute la nuit jusqu’au matin et tout le jour. Et Hèlios tombait, et le doux sommeil me quitta. Et j’entendis les servantes de ta fille qui jouaient sur le rivage, et je la vis elle-même, au milieu de toutes, semblable aux immortelles. Je la suppliais, et elle montra une sagesse excellente bien supérieure à celle qu’on peut espérer d’une jeune fille, car la jeunesse, en effet, est toujours imprudente. Et elle me donna aussitôt de la nourriture et du vin rouge, et elle me fit baigner dans le fleuve, et elle me donna des vêtements. Je t’ai dit toute la vérité, malgré mon affliction.
Et Alkinoos, lui répondant, lui dit :
– Mon hôte, certes, ma fille n’a point agi convenablement, puisqu’elle ne t’a point conduit, avec ses servantes, dans ma demeure, car tu l’avais suppliée la première.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Héros, ne blâme point, à cause de moi, la jeune vierge irréprochable. Elle m’a ordonné de la suivre avec ses femmes, mais je ne l’ai point voulu, craignant de t’irriter si tu avais vu cela ; car nous, race des hommes, sommes soupçonneux sur la terre.
Et Alkinoos, lui répondant, dit :
– Mon hôte, mon cher cœur n’a point coutume de s’irriter sans raison dans ma poitrine, et les choses équitables sont toujours les plus puissantes sur moi. Plaise au père Zeus, à Athènè, à Apollôn, que, tel que tu es, et sentant en toutes choses comme moi, tu veuilles rester, épouser ma fille, être appelé mon gendre ! Je te donnerais une demeure et des biens, si tu voulais rester. Mais aucun des Phaiakiens ne te retiendra malgré toi, car ceci ne serait point agréable au père Zeus. Afin que tu le saches bien, demain je déciderai ton retour.
Jusque-là, dors, dompté par le sommeil ; et mes hommes profiteront du temps paisible, afin que tu parviennes dans ta patrie et dans ta demeure, ou partout où il te plaira d’aller, même par-delà l’Euboiè, que ceux de notre peuple qui l’ont vue disent la plus lointaine des terres, quand ils y conduisirent le blond Rhadamanthos, pour visiter Tityos, le fils de Gaia.
Ils y allèrent et en revinrent en un seul jour. Tu sauras par toi-même combien mes nefs et mes jeunes hommes sont habiles à frapper la mer de leurs avirons.
Il parla ainsi, et le subtil et divin Odysseus, plein de joie, fit cette supplication :
– Père Zeus ! qu’il te plaise qu’Alkinoos accomplisse ce qu’il promet, et que sa gloire soit immortelle sur la terre féconde si je rentre dans ma patrie !
Et tandis qu’ils se parlaient ainsi, Arètè ordonna aux servantes aux bras blancs de dresser un lit sous le portique, d’y mettre plusieurs couvertures pourprées, et d’étendre par-dessus des tapis et des manteaux laineux. Et les servantes sortirent de la demeure en portant des torches flambantes ; et elles dressèrent un beau lit à la hâte, et, s’approchant d’Odysseus, elles lui dirent :
– Lève-toi, notre hôte, et va dormir : ton lit est préparé.
Elles parlèrent ainsi, et il lui sembla doux de dormir. Et ainsi le divin et patient Odysseus s’endormit dans un lit profond, sous le portique sonore. Et Alkinoos dormait aussi au fond de sa haute demeure. Et, auprès de lui, la Reine, ayant préparé le lit, se coucha.Chant 8
Quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, la force sacrée d’Alkinoos se leva de son lit, et le dévastateur de citadelles, le divin et subtil Odysseus se leva aussi ; et la Force sacrée d’Alkinoos le conduisit à l’agora des Phaiakiens, auprès des nefs. Et, dès leur arrivée, ils s’assirent l’un près de l’autre sur des pierres polies. Et Pallas Athènè parcourait la ville, sous la figure d’un héraut prudent d’Alkinoos ; et, méditant le retour du magnanime Odysseus, elle abordait chaque homme et lui disait :
– Princes et chefs des Phaiakiens, allez à l’agora, afin d’entendre l’étranger qui est arrivé récemment dans la demeure du sage Alkinoos, après avoir erré sur la mer. Il est semblable aux immortels.
Ayant parlé ainsi, elle excitait l’esprit de chacun, et bientôt l’agora et les sièges furent pleins d’hommes rassemblés ; et ils admiraient le fils prudent de Laertès, car Athènè avait répandu une grâce divine sur sa tête et sur ses épaules, et l’avait rendu plus grand et plus majestueux, afin qu’il parût plus agréable, plus fier et plus vénérable aux Phaiakiens et qu’il accomplît toutes les choses par lesquelles ils voudraient l’éprouver. Et, après que tous se furent réunis, Alkinoos leur parla ainsi :
– Écoutez-moi, princes et chefs des Phaiakiens, afin que je dise ce que mon cœur m’inspire dans ma poitrine. Je ne sais qui est cet étranger errant qui est venu dans ma demeure, soit du milieu des hommes qui sont du côté d’Éôs, soit de ceux qui habitent du côté de Hespéros.
Il nous demande d’aider à son prompt retour. Nous le reconduirons, comme cela est déjà arrivé pour d’autres ; car aucun homme entré dans ma demeure n’a jamais pleuré longtemps ici, désirant son retour. Allons ! tirons à la mer divine une nef noire et neuve, et que cinquante-deux jeunes hommes soient choisis dans le peuple parmi les meilleurs de tous. Liez donc à leurs bancs les avirons de la nef, et préparons promptement dans ma demeure un repas que je vous offre. Les jeunes hommes accompliront mes ordres, et vous tous, rois porteurs de sceptres, venez dans ma belle demeure, afin que nous honorions notre hôte dans la maison royale. Que nul ne refuse, et appelez le divin aoide Dèmodokos, car un dieu lui a donné le chant admirable qui charme, quand son âme le pousse à chanter.
Ayant ainsi parlé, il marcha devant, et les porteurs de sceptres le suivaient, et un héraut courut vers le divin aoide. Et cinquante-deux jeunes hommes, choisis dans le peuple, allèrent, comme Alkinoos l’avait ordonné, sur le rivage de la mer indomptée. Étant arrivés à la mer et à la nef, ils traînèrent la noire nef à la mer profonde, dressèrent le mât, préparèrent les voiles, lièrent les avirons avec des courroies, et, faisant tout comme il convenait, étendirent les blanches voiles et poussèrent la nef au large. Puis, ils se rendirent à la grande demeure du sage Alkinoos. Et le portique, et la salle, et la demeure étaient pleins d’hommes rassemblés, et les jeunes hommes et les vieillards étaient nombreux.
Et Alkinoos tua pour eux douze brebis, huit porcs aux blanches dents et deux bœufs aux pieds flexibles. Et ils les écorchèrent, et ils préparèrent le repas agréable.
Et le héraut vint, conduisant le divin aoide. La Muse l’aimait plus que tous, et elle lui avait donné de connaître le bien et le mal, et, l’ayant privé des yeux, elle lui avait accordé le chant admirable. Le héraut plaça pour lui, au milieu des convives, un thrône aux clous d’argent, appuyé contre une longue colonne ; et, au-dessus de sa tête, il suspendit la kithare sonore, et il lui montra comment il pourrait la prendre. Puis, il dressa devant lui une belle table et il y mit une corbeille et une coupe de vin, afin qu’il bût autant de fois que son âme le voudrait. Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux.
Après qu’ils eurent assouvi leur faim et leur soif, la Muse excita l’aoide à célébrer la gloire des hommes par un chant dont la renommée était parvenue jusqu’au large Ourancs. Et c’était la querelle d’Odysseus et du Pèléide Akhilleus, quand ils se querellèrent autrefois en paroles violentes dans un repas offert aux dieux. Et le roi des hommes, Agamemnôn, se réjouissait dans son âme parce que les premiers d’entre les Akhaiens se querellaient. En effet, la prédiction s’accomplissait que lui avait faite Phoibos Apollôn, quand, dans la divine Pythô, il avait passé le seuil de pierre pour interroger l’oracle ; et alors se préparaient les maux des Troiens et des Danaens, par la volonté du grand Zeus.
Et l’illustre aoide chantait ces choses, mais Odysseus ayant saisi de ses mains robustes son grand manteau pourpré, l’attira sur sa tête et en couvrit sa belle face, et il avait honte de verser des larmes devant les Phaiakiens. Mais quand le divin aoide cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer, et il écartait son manteau, et, prenant une coupe ronde, il faisait des libations aux dieux. Puis, quand les princes des Phaiakiens excitaient l’aoide à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses paroles, de nouveau Odysseus pleurait, la tête cachée. Il se cachait de tous en versant des larmes ; mais Alkinoos le vit, seul, étant assis auprès de lui, et il l’entendit gémir, et aussitôt il dit aux Phaiakiens habiles à manier les avirons :
– Écoutez-moi, princes et chefs des Phaiakiens. Déjà nous avons satisfait notre âme par ce repas et par les sons de la kithare qui sont la joie des repas. Maintenant, sortons, et livrons-nous à tous les jeux, afin que notre hôte raconte à ses amis, quand il sera retourné dans sa patrie, combien nous l’emportons sur les autres hommes au combat des poings, à la lutte, au saut et à la course.
Ayant ainsi parlé, il marcha le premier et tous le suivirent. Et le héraut suspendit la kithare sonore à la colonne, et, prenant Dèmodokos par la main, il le conduisit hors des demeures, par le même chemin qu’avaient pris les princes des Phaiakiens afin d’admirer les jeux. Et ils allèrent à l’agora, et une foule innombrable suivait.
Puis, beaucoup de robustes jeunes hommes se levèrent, Akronéôs, Okyalos, Élatreus, Nauteus, Prymneus, Ankhialos, Érethmeus, Ponteus, Prôteus, Thoôn, Anabèsinéôs, Amphialos, fils de Polinéos Tektonide, et Euryalos semblable au tueur d’hommes Arès, et Naubolidès qui l’emportait par la force et la beauté sur tous les Phaiakiens, après l’irréprochable Laodamas. Et les trois fils de l’irréprochable Alkinoos se levèrent aussi, Laodamas, Halios et le divin Klytonèos.
Et ils combattirent d’abord à la course, et ils s’élancèrent des barrières, et, tous ensemble, ils volaient rapidement, soulevant la poussière de la plaine. Mais celui qui les devançait de plus loin était l’irréprochable Klytonèos. Autant les mules qui achèvent un sillon ont franchi d’espace, autant il les précédait, les laissant en arrière, quand il revint devant le peuple. Et d’autres engagèrent le combat de la lutte, et dans ce combat Euryalos l’emporta sur les plus vigoureux. Et Amphialos fut vainqueur en sautant le mieux, et Élatreus fut le plus fort au disque, et Laodamas, l’illustre fils d’Alkinoos, au combat des poings. Mais, après qu’ils eurent charmé leur âme par ces combats, Laodamas, fils d’Alkinoos, parla ainsi :
– Allons, amis, demandons à notre hôte s’il sait aussi combattre. Certes, il ne semble point sans courage.
Il a des cuisses et des bras et un cou très vigoureux, et il est encore jeune, bien qu’il ait été affaibli par beaucoup de malheurs ; car je pense qu’il n’est rien de pire que la mer pour épuiser un homme, quelque vigoureux qu’il soit.
Et Euryalos lui répondit :
– Laodamas, tu as bien parlé. Maintenant, va, provoque-le, et rapporte-lui nos paroles.
Et l’illustre fils d’Alkinoos, ayant écouté ceci, s’arrêta au milieu de l’arène et dit à Odysseus :
– Allons, hôte, mon père, viens tenter nos jeux, si tu y es exercé comme il convient que tu le sois. Il n’y a point de plus grande gloire pour les hommes que celle d’être brave par les pieds et par les bras. Viens donc, et chasse la tristesse de ton âme. Ton retour n’en subira pas un long retard, car déjà ta nef est traînée à la mer et tes compagnons sont prêts à partir.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Laodamas, pourquoi me provoques-tu à combattre ? Les douleurs remplissent mon âme plus que le désir des jeux. J’ai déjà subi beaucoup de maux et supporté beaucoup de travaux, et maintenant, assis dans votre agora, j’implore mon retour, priant le roi et tout le peuple.
Et Euryalos, lui répondant, l’outragea ouvertement :
– Tu parais, mon hôte, ignorer tous les jeux où s’exercent les hommes, et tu ressembles à un chef de matelots marchands qui, sur une nef de charge, n’a souci que de gain et de provisions, plutôt qu’à un athlète.
Et le subtil Odysseus, avec un sombre regard, lui dit :
– Mon hôte, tu n’as point parlé convenablement, et tu ressembles à un homme insolent. Les dieux ne dispensent point également leurs dons à tous les hommes, la beauté, la prudence ou l’éloquence. Souvent un homme n’a point de beauté, mais un dieu l’orne par la parole, et tous sont charmés devant lui, car il parle avec assurance et une douce modestie, et il domine l’agora, et, quand il marche par la ville, on le regarde comme un dieu. Un autre est semblable aux dieux par sa beauté, mais il ne lui a point été accordé de bien parler. Ainsi, tu es beau, et un dieu ne t’aurait point formé autrement, mais tu manques d’intelligence, et, comme tu as mal parlé, tu as irrité mon cœur dans ma chère poitrine. Je n’ignore point ces combats, ainsi que tu le dis. J’étais entre les premiers, quand je me confiais dans ma jeunesse et dans la vigueur de mes bras. Maintenant, je suis accablé de misères et de douleurs, ayant subi de nombreux combats parmi les hommes ou en traversant les flots dangereux. Mais, bien que j’aie beaucoup souffert, je tenterai ces jeux, car ta parole m’a mordu, et tu m’as irrité par ce discours.
Il parla ainsi, et, sans rejeter son manteau, s’élançant impétueusement, il saisit une pierre plus grande, plus épaisse, plus lourde que celle dont les Phaiakiens avaient coutume de se servir dans les jeux, et, l’ayant fait tourbillonner, il la jeta d’une main vigoureuse. Et la pierre rugit, et tous les Phaiakiens habiles à manier les avirons courbèrent la tête sous l’impétuosité de la pierre qui vola bien au-delà des marques de tous les autres. Et Athènè accourut promptement, et, posant une marque, elle dit, ayant pris la figure d’un homme :
– Même un aveugle, mon hôte, pourrait reconnaître ta marque en la touchant, car elle n’est point mêlée à la foule des autres, mais elle est bien au-delà. Aie donc confiance, car aucun des Phaiakiens n’atteindra là, loin de te dépasser.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus fut joyeux, et il se réjouissait d’avoir dans l’agora un compagnon bienveillant. Et il dit avec plus de douceur aux Phaiakiens :
– Maintenant, jeunes hommes, atteignez cette pierre. Je pense que je vais bientôt en jeter une autre aussi loin, et même au-delà. Mon âme et mon cœur m’excitent à tenter tous les autres combats. Que chacun de vous se fasse ce péril, car vous m’avez grandement irrité. Au ceste, à la lutte, à la course, je ne refuse aucun des Phaiakiens, sauf le seul Laodamas. Il est mon hôte. Qui pourrait combattre un ami ?
L’insensé seul et l’homme de nulle valeur le disputent à leur hôte dans les jeux, au milieu d’un peuple étranger, et ils s’avilissent ainsi. Mais je n’en récuse ni n’en repousse aucun autre. Je n’ignore aucun des combats qui se livrent parmi les hommes. Je sais surtout tendre un arc récemment poli, et le premier j’atteindrais un guerrier lançant des traits dans la foule des hommes ennemis, même quand de nombreux compagnons l’entoureraient et tendraient l’arc contre moi. Le seul Philoktètès l’emportait sur moi par son arc, chez le peuple des Troiens, toutes les fois que les Akhaiens lançaient des flèches. Mais je pense être maintenant le plus habile de tous les mortels qui se nourrissent de pain sur la terre. Certes, je ne voudrais point lutter contre les anciens héros, ni contre Héraklès, ni contre Eurytos l’Oikhalien, car ils luttaient, comme archers, même avec les dieux. Le grand Eurytos mourut tout jeune, et il ne vieillit point dans ses demeures. En effet, Apollôn irrité le tua, parce qu’il l’avait provoqué au combat de l’arc. Je lance la pique aussi bien qu’un autre lance une flèche. Seulement, je crains qu’un des Phaiakiens me surpasse à la course, ayant été affaibli par beaucoup de fatigues au milieu des flots, car je ne possédais pas une grande quantité de vivres dans ma nef, et mes chers genoux sont rompus.
Il parla ainsi, et tous restèrent muets, et le seul Alkinoos lui répondit :
– Mon hôte, tes paroles me plaisent. Ta force veut prouver la vertu qui te suit partout, étant irrité, car cet homme t’a défié ; mais aucun n’oserait douter de ton courage, si du moins il n’a point perdu le jugement. Maintenant, comprends bien ce que je vais dire, afin que tu parles favorablement de nos héros quand tu prendras tes repas dans tes demeures, auprès de ta femme et de tes enfants, et que tu te souviennes de notre vertu et des travaux dans lesquels Zeus nous a donné d’exceller dès le temps de nos ancêtres. Nous ne sommes point les plus forts au ceste, ni des lutteurs irréprochables, mais nous courons rapidement et nous excellons sur les nefs. Les repas nous sont chers, et la kithare et les danses, et les vêtements renouvelés, les bains chauds et les lits. Allons ! vous qui êtes les meilleurs danseurs Phaiakiens, dansez, afin que notre hôte, de retour dans sa demeure, dise à ses amis combien nous l’emportons sur tous les autres hommes dans la science de la mer, par la légèreté des pieds, à la danse et par le chant. Que quelqu’un apporte aussitôt à Dèmodokos sa kithare sonore qui est restée dans nos demeures.
Alkinoos semblable à un dieu parla ainsi, et un héraut se leva pour rapporter la kithare harmonieuse de la maison royale. Et les neuf chefs des jeux, élus par le sort, se levèrent, car c’étaient les régulateurs de chaque chose dans les jeux. Et ils aplanirent la place du chœur, et ils disposèrent un large espace. Et le héraut revint, apportant la kithare sonore à Dèmodokos ; et celui-ci se mit au milieu, et autour de lui se tenaient les jeunes adolescents habiles à danser.
Et ils frappaient de leurs pieds le chœur divin, et Odysseus admirait la rapidité de leurs pieds, et il s’en étonnait dans son âme.
Mais l’aoide commença de chanter admirablement l’amour d’Arès et d’Aphroditè à la belle couronne, et comment ils s’unirent dans la demeure de Hèphaistos. Arès fit de nombreux présents, et il déshonora le lit du roi Hèphaistos. Aussitôt Hèlios, qui les avait vus s’unir, vint l’annoncer à Hèphaistos, qui entendit là une cruelle parole. Puis, méditant profondément sa vengeance, il se hâta d’aller à sa forge, et, dressant une grande enclume, il forgea des liens qui ne pouvaient être ni rompus, ni dénoués. Ayant achevé cette trame pleine de ruse, il se rendit dans la chambre nuptiale où se trouvait son cher lit. Et il suspendit de tous côtés, en cercle, ces liens qui tombaient des poutres autour du lit comme les toiles de l’araignée, et que nul ne pouvait voir, pas même les dieux heureux. Ce fut ainsi qu’il ourdit sa ruse. Et, après avoir enveloppé le lit, il feignit d’aller à Lemnos, ville bien bâtie, celle de toutes qu’il aimait le mieux sur la terre. Arès au frein d’or le surveillait, et quand il vit partir l’illustre ouvrier Hèphaistos, il se hâta, dans son désir d’Aphroditè à la belle couronne, de se rendre à la demeure de l’illustre Hèphaistos. Et Aphroditè, revenant de voir son tout-puissant père Zeus, était assise. Et Arès entra dans la demeure, et il lui prit la main, et il lui dit :
– Allons, chère, dormir sur notre lit. Hèphaistos n’est plus ici ; il est allé à Lemnos, chez les Sintiens au langage barbare.
Il parla ainsi, et il sembla doux à la déesse de lui céder, et ils montèrent sur le lit pour y dormir, et, aussitôt, les liens habilement disposés par le subtil Hèphaistos les enveloppèrent. Et ils ne pouvaient ni mouvoir leurs membres, ni se lever, et ils reconnurent alors qu’ils ne pouvaient fuir. Et l’illustre boiteux des deux pieds approcha, car il était revenu avant d’arriver à la terre de Lemnos, Hèlios ayant veillé pour lui et l’ayant averti.
Et il rentra dans sa demeure, affligé en sa chère poitrine. Il s’arrêta sous le vestibule, et une violente colère le saisit, et il cria horriblement, et il fit que tous les dieux l’entendirent :
– Père Zeus, et vous, dieux heureux qui vivez toujours, venez voir des choses honteuses et intolérables. Moi qui suis boiteux, la fille de Zeus, Aphroditè, me déshonore, et elle aime le pernicieux Arès parce qu’il est beau et qu’il ne boite pas. Si je suis laid, certes, je n’en suis pas cause, mais la faute en est à mon père et à ma mère qui n’auraient pas dû m’engendrer. Voyez comme ils sont couchés unis par l’amour. Certes, en les voyant sur ce lit, je suis plein de douleur, mais je ne pense pas qu’ils tentent d’y dormir encore, bien qu’ils s’aiment beaucoup ; et ils ne pourront s’unir, et mon piège et mes liens les retiendront jusqu’à ce que son père m’ait rendu toute la dot que je lui ai livrée à cause de sa fille aux yeux de chien, parce qu’elle était belle.
Il parla ainsi, et tous les dieux se rassemblèrent dans la demeure d’airain. Poseidaôn qui entoure la terre vint, et le très utile Herméias vint aussi, puis le royal archer Apollôn. Les déesses, par pudeur, restèrent seules dans leurs demeures. Et les dieux qui dispensent les biens étaient debout dans le vestibule. Et un rire immense s’éleva parmi les dieux heureux quand ils virent l’ouvrage du prudent Hèphaistos ; et, en le regardant, ils disaient entre eux :
– Les actions mauvaises ne valent pas la vertu. Le plus lent a atteint le rapide. Voici que Hèphaistos, bien que boiteux, a saisi, par sa science Arès, qui est le plus rapide de tous les dieux qui habitent l’Olympos, et c’est pourquoi il se fera payer une amende.
Ils se parlaient ainsi entre eux. Et le roi Apollôn, fils de Zeus, dit à Herméias :
– Messager Herméias, fils de Zeus, qui dispense les biens, certes, tu voudrais sans doute être enveloppé de ces liens indestructibles, afin de coucher dans ce lit, auprès d’Aphroditè d’or ?
Et le messager Herméias lui répondit aussitôt :
– Plût aux dieux, ô royal archer Apollôn, que cela arrivât, et que je fusse enveloppé de liens trois fois plus inextricables, et que tous les dieux et les déesses le vissent, pourvu que je fusse couché auprès d’Aphroditè d’or !
Il parla, ainsi, et le rire des dieux immortels éclata. Mais Poseidaôn ne riait pas, et il suppliait l’illustre Hèphaistos de délivrer Arès, et il lui disait ces paroles ailées :
– Délivre-le, et je te promets qu’il te satisfera, ainsi que tu le désires, et comme il convient entre dieux immortels.
Et l’illustre ouvrier Hèphaistos lui répondit :
– Poseidaôn qui entoures la terre, ne me demande point cela. Les cautions des mauvais sont mauvaises. Comment pourrais-je te contraindre, parmi les dieux immortels, si Arès échappait à sa dette et à mes liens ?
Et Poseidaôn qui ébranle la terre lui répondit :
– Hèphaistos, si Arès, reniant sa dette, prend la fuite, je te la payerai moi-même.
Et l’illustre boiteux des deux pieds lui répondit :
– Il ne convient point que je refuse ta parole, et cela ne sera point.
Ayant ainsi parlé, la force de Hèphaistos rompit les liens. Et tous deux, libres des liens inextricables, s’envolèrent aussitôt, Arès dans la Thrèkè, et Aphroditè qui aime les sourires dans Kypros, à Paphos où sont ses bois sacrés et ses autels parfumés.
Là, les Kharites la baignèrent et la parfumèrent d’une huile ambroisienne, comme il convient aux dieux immortels, et elles la revêtirent de vêtements précieux, admirables à voir.
Ainsi chantait l’illustre aoide, et, dans son esprit, Odysseus se réjouissait de l’entendre, ainsi que tous les Phaiakiens habiles à manier les longs avirons des nefs.
Et Alkinoos ordonna à Halios et à Laodamas de danser seuls, car nul ne pouvait lutter avec eux. Et ceux-ci prirent dans leurs mains une belle boule pourprée que le sage Polybos avait faite pour eux. Et l’un, courbé en arrière, la jetait vers les sombres nuées, et l’autre la recevait avant qu’elle eût touché la terre devant lui. Après avoir ainsi admirablement joué de la boule, ils dansèrent alternativement sur la terre féconde ; et tous les jeunes hommes, debout dans l’agora, applaudirent, et un grand bruit s’éleva. Alors, le divin Odysseus dit à Alkinoos :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, certes, tu m’as annoncé les meilleurs danseurs, et cela est manifeste. L’admiration me saisit en les regardant.
Il parla ainsi, et la force sacrée d’Alkinoos fut remplie de joie, et il dit aussitôt aux Phaiakiens qui aiment les avirons :
– Écoutez, princes et chefs des Phaiakiens. Notre hôte me semble plein de sagesse. Allons ! Il convient de lui offrir les dons hospitaliers.
Douze rois illustres, douze princes, commandent ce peuple, et moi, je suis le treizième. Apportez-lui, chacun, un manteau bien lavé, une tunique et un talent d’or précieux. Et, aussitôt, nous apporterons tous ensemble ces présents, afin que notre hôte, les possédant, siège au repas, l’âme pleine de joie. Et Euryalos l’apaisera par ses paroles, puisqu’il n’a point parlé convenablement.
Il parla ainsi, et tous, ayant applaudi, ordonnèrent qu’on apportât les présents, et chacun envoya un héraut. Et Euryalos, répondant à Alkinoos, parla ainsi :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, j’apaiserai notre hôte, comme tu me l’ordonnes, et je lui donnerai cette épée d’airain, dont la poignée est d’argent et dont la gocine est d’ivoire récemment travaillé. Ce don sera digne de notre hôte.
En parlant ainsi, il mit l’épée aux clous d’argent entre les mains d’Odysseus, et il lui dit en paroles ailées :
– Salut, hôte, mon père ! si j’ai dit une parole mauvaise, que les tempêtes l’emportent ! Que les dieux t’accordent de retourner dans ta patrie et de revoir ta femme, car tu as longtemps souffert loin de tes amis.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Et toi, ami, je te salue. Que les dieux t’accordent tous les biens. Puisses-tu n’avoir jamais le regret de cette épée que tu me donnes en m’apaisant par tes paroles.
Il parla ainsi, et il suspendit l’épée aux clous d’argent autour de ses épaules. Puis, Hèlios tomba, et les splendides présents furent apportés, et les hérauts illustres les déposèrent dans la demeure d’Alkinoos ; et les irréprochables fils d’Alkinoos, les ayant reçus, les placèrent devant leur mère vénérable. Et la force sacrée d’Alkinoos commanda aux Phaiakiens de venir dans sa demeure, et ils s’assirent sur des thrônes élevés, et la force d’Alkinoos dit à Arètè :
– Femme, apporte un beau coffre, le plus beau que tu aies, et tu y renfermeras un manteau bien lavé et une tunique. Qu’on mette un vase sur le feu, et que l’eau chauffe, afin que notre hôte, s’étant baigné, contemple les présents que lui ont apportés les irréprochables Phaiakiens, et qu’il se réjouisse du repas, en écoutant le chant de l’aoide. Et moi, je lui donnerai cette belle coupe d’or, afin qu’il se souvienne de moi tous les jours de sa vie, quand il fera, dans sa demeure, des libations à Zeus et aux autres dieux.
Il parla ainsi, et Arètè ordonna aux servantes de mettre promptement un grand vase sur le feu. Et elles mirent sur le feu ardent le grand vase pour le bain : et elles y versèrent de l’eau, et elles allumèrent le bois par-dessous.
Et le feu enveloppa le vase à trois pieds, et l’eau chauffa.
Et, pendant ce temps, Arètè descendit, de sa chambre nuptiale, pour son hôte, un beau coffre, et elle y plaça les présents splendides, les vêtements et l’or que les Phaiakiens lui avaient donnés. Elle-même y déposa un manteau et une belle tunique, et elle dit à Odysseus ces paroles ailées :
– Vois toi-même ce couvercle, et ferme-le d’un nœud, afin que personne, en route, ne puisse te dérober quelque chose, car tu dormiras peut-être d’un doux sommeil dans la nef noire.
Ayant entendu cela, le patient et divin Odysseus ferma aussitôt le couvercle à l’aide d’un nœud inextricable que la vénérable Kirkè lui avait enseigné autrefois. Puis, l’intendante l’invita à se baigner, et il descendit dans la baignoire, et il sentit, plein de joie, l’eau chaude, car il y avait longtemps qu’il n’avait usé de ces soins, depuis qu’il avait quitté la demeure de Kalypsô aux beaux cheveux, où ils lui étaient toujours donnés comme à un dieu. Et les servantes, l’ayant baigné, le parfumèrent d’huile et le revêtirent d’une tunique et d’un beau manteau ; et, sortant du bain, il revint au milieu des hommes buveurs de vin. Et Nausikaa, qui avait reçu des dieux la beauté, s’arrêta sur le seuil de la demeure bien construite, et, regardant Odysseus qu’elle admirait, elle lui dit ces paroles ailées :
– Salut, mon hôte ! Plaise aux dieux, quand tu seras dans la terre de la patrie, que tu te souviennes de moi à qui tu dois la vie.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Nausikaa, fille du magnanime Alkinoos, si, maintenant, Zeus, le retentissant époux de Hèrè, m’accorde de voir le jour du retour et de rentrer dans ma demeure, là, certes, comme à une déesse, je t’adresserai des vœux tous les jours de ma vie, car tu m’as sauvé, ô vierge !
Il parla ainsi, et il s’assit sur un thrône auprès du roi Alkinoos. Et les hommes faisaient les parts et mélangeaient le vin. Et un héraut vint, conduisant l’aoide harmonieux, Dèmodokos vénérable au peuple, et il le plaça au milieu des convives, appuyé contre une haute colonne. Alors Odysseus, coupant la plus forte part du dos d’un porc aux blanches dents, et qui était enveloppée de graisse, dit au héraut :
– Prends, héraut, et offre, afin, qu’il la mange, cette chair à Dèmodokos. Moi aussi je l’aime, quoique je sois affligé. Les aoides sont dignes d’honneur et de respect parmi tous les hommes terrestres, car la Muse leur a enseigné le chant, et elle aime la race des aoides.
Il parla ainsi, et le héraut déposa le mets aux mains du héros Dèmodokos, et celui-ci le reçut, plein de joie. Et tous étendirent les mains vers la nourriture placée devant eux. Et, après qu’ils se furent rassasiés de boire et de manger, le subtil Odysseus dit à Dèmodokos :
– Dèmodokos, je t’honore plus que tous les hommes mortels, soit que la Muse, fille de Zeus, t’ait instruit, soit Apollôn. Tu as admirablement chanté la destinée des Akhaiens, et tous les maux qu’ils ont endurés, et toutes les fatigues qu’ils ont subies, comme si toi-même avais été présent, ou comme si tu avais tout appris d’un Argien. Mais chante maintenant le cheval de bois qu’Épéios fit avec l’aide d’Athènè, et que le divin Odysseus conduisit par ses ruses dans la citadelle, tout rempli d’hommes qui renversèrent Ilios. Si tu me racontes exactement ces choses, je déclarerai à tous les hommes qu’un dieu t’a doué avec bienveillance du chant divin.
Il parla ainsi, et l’Aoide, inspiré par un Dieu, commença de chanter. Et il chanta d’abord comment les Argiens, étant montés sur les nefs aux bancs de rameurs, s’éloignèrent après avoir mis le feu aux tentes. Mais les autres Akhaiens étaient assis déjà auprès de l’illustre Odysseus, enfermés dans le cheval, au milieu de l’agora des Troiens. Et ceux-ci, eux-mêmes, avaient traîné le cheval dans leur citadelle. Et là, il se dressait, tandis qu’ils proféraient mille paroles, assis autour de lui.
Et trois desseins leur plaisaient, ou de fendre ce bois creux avec l’airain tranchant, ou de le précipiter d’une hauteur sur les rochers, ou de le garder comme une vaste offrande aux dieux. Ce dernier dessein devait être accompli, car leur destinée était de périr, après que la ville eut reçu dans ses murs le grand cheval de bois où étaient assis les princes des Akhaiens, devant porter le meurtre et la kèr aux Troiens. Et Dèmodokos chanta comment les fils des Akhaiens, s’étant précipités du cheval, leur creuse embuscade, saccagèrent la ville. Puis, il chanta la dévastation de la ville escarpée, et Odysseus et le divin Ménélaos semblable à Arès assiégeant la demeure de Dèiphobos, et le très rude combat qui se livra en ce lieu, et comment ils vainquirent avec l’aide de la magnanime Athènè.
L’illustre aoide chantait ces choses, et Odysseus défaillait, et, sous ses paupières, il arrosait ses joues de larmes. De même qu’une femme entoure de ses bras et pleure son mari bien aimé tombé devant sa ville et son peuple, laissant une mauvaise destinée à sa ville et à ses enfants ; et de même que, le voyant mort et encore palpitant, elle se jette sur lui en hurlant, tandis que les ennemis, lui frappant le dos et les épaules du bois de leurs lances, l’emmènent en servitude afin de subir le travail et la douleur, et que ses jours sont flétris par un très misérable désespoir ; de même Odysseus versait des larmes amères sous ses paupières, en les cachant à tous les autres convives.
Et le seul Alkinoos, étant assis auprès de lui, s’en aperçut, et il l’entendit gémir profondément, et aussitôt il dit aux Phaiakiens habiles dans la science de la mer :
– Écoutez, princes et chefs des Phaiakiens, et que Dèmodokos fasse taire sa kithare sonore. Ce qu’il chante ne plaît pas également à tous. Dès le moment où nous avons achevé le repas et où le divin aoide a commencé de chanter, notre hôte n’a point cessé d’être en proie à un deuil cruel, et la douleur a envahi son cœur. Que Dèmodokos cesse donc, afin que, nous et notre hôte, nous soyons tous également satisfaits. Ceci est de beaucoup le plus convenable. Nous avons préparé le retour de notre hôte vénérable et des présents amis que nous lui avons offerts parce que nous l’aimons. Un hôte, un suppliant, est un frère pour tout homme qui peut encore s’attendrir dans l’âme.
C’est pourquoi, étranger, ne me cache rien, par ruse, de tout ce que je vais te demander, car il est juste que tu parles sincèrement. Dis-moi comment se nommaient ta mère, ton père, ceux qui habitaient ta ville, et tes voisins. Personne, en effet, parmi les hommes, lâches ou illustres, n’a manqué de nom, depuis qu’il est né. Les parents qui nous ont engendrés nous en ont donné à tous. Dis-moi aussi ta terre natale, ton peuple et ta ville, afin que nos nefs qui pensent t’y conduisent ; car elles n’ont point de pilotes, ni de gouvernails, comme les autres nefs, mais elles pensent comme les hommes, et elles connaissent les villes et les champs fertiles de tous les hommes, et elles traversent rapidement la mer, couvertes de brouillards et de nuées, sans jamais craindre d’être maltraitées ou de périr.
Cependant j’ai entendu autrefois mon père Nausithoos dire que Poseidaôn s’irriterait contre nous, parce que nous reconduisons impunément tous les étrangers. Et il disait qu’une solide nef des Phaiakiens périrait au retour d’un voyage sur la mer sombre, et qu’une grande montagne serait suspendue devant notre ville. Ainsi parlait le vieillard. Peut-être ces choses s’accompliront-elles, peut-être n’arriveront-elles point. Ce sera comme il plaira au dieu.
Mais parle, et dis-nous dans quels lieux tu as erré, les pays que tu as vus, et les villes bien peuplées et les hommes, cruels et sauvages, ou justes et hospitaliers et dont l’esprit plaît aux dieux. Dis pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Argiens, des Danaens et d’Ilios ! Les dieux eux-mêmes ont fait ces choses et voulu la mort de tant de guerriers, afin qu’on les chantât dans les jours futurs. Un de tes parents est-il mort devant Ilios ? Était-ce ton gendre illustre ou ton beau-père, ceux qui nous sont le plus chers après notre propre sang ? Est-ce encore un irréprochable compagnon ? Un sage compagnon, en effet, n’est pas moins qu’un frère.Chant 9
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, il est doux d’écouter un aoide tel que celui-ci, semblable aux dieux par la voix. Je ne pense pas que rien soit plus agréable. La joie saisit tout ce peuple, et tes convives, assis en rang dans ta demeure, écoutent l’aoide. Et les tables sont chargées de pain et de chairs, et l’échanson, puisant le vin dans le kratère, en remplit les coupes et le distribue. Il m’est très doux, dans l’âme, de voir cela. Mais tu veux que je dise mes douleurs lamentables, et je n’en serai que plus affligé. Que dirai-je d’abord ? Comment continuer ? comment finir ? car les dieux Ouraniens m’ont accablé de maux innombrables. Et maintenant je dirai d’abord mon nom, afin que vous le sachiez et me connaissiez, et, qu’ayant évité la cruelle mort, je sois votre hôte, bien qu’habitant une demeure lointaine.
Je suis Odysseus Laertiade, et tous les hommes me connaissent par mes ruses, et ma gloire est allée jusqu’à l’Ouranos. J’habite la très illustre Ithakè, où se trouve le mont Nèritos aux arbres battus des vents. Et plusieurs autres îles sont autour, et voisines, Doulikhios, et Samè, et Zakynthos couverte de forêts. Et Ithakè est la plus éloignée de la terre ferme et sort de la mer du côté de la nuit ; mais les autres sont du côté d’Éôs et de Hèlios. Elle est âpre, mais bonne nourrice de jeunes hommes, et il n’est point d’autre terre qu’il me soit plus doux de contempler.
Certes, la noble déesse Kalypsô m’a retenu dans ses grottes profondes, me désirant pour mari ; et, de même, Kirkè, pleine de ruses, m’a retenu dans sa demeure, en l’île Aiaiè, me voulant aussi pour mari ; mais elles n’ont point persuadé mon cœur dans ma poitrine, tant rien n’est plus doux que la patrie et les parents pour celui qui, loin des siens, habite même une riche demeure dans une terre étrangère. Mais je te raconterai le retour lamentable que me fit Zeus à mon départ de Troiè.
D’Ilios le vent me poussa chez les Kikônes, à Ismaros. Là, je dévastai la ville et j’en tuai les habitants ; et les femmes et les abondantes dépouilles enlevées furent partagées, et nul ne partit privé par moi d’une part égale. Alors, j’ordonnai de fuir d’un pied rapide, mais les insensés n’obéirent pas. Et ils buvaient beaucoup de vin, et ils égorgeaient sur le rivage les brebis et les bœufs noirs aux pieds flexibles.
Et, pendant ce temps, des Kikônes fugitifs avaient appelé d’autres Kikônes, leurs voisins, qui habitaient l’intérieur des terres. Et ceux-ci étaient nombreux et braves, aussi habiles à combattre sur des chars qu’à pied, quand il le fallait. Et ils vinrent aussitôt, vers le matin, en aussi grand nombre que les feuilles et les fleurs printanières. Alors la mauvaise destinée de Zeus nous accabla, malheureux, afin que nous subissions mille maux. Et ils nous combattirent auprès de nos nefs rapides ; et des deux côtés nous nous frappions de nos lances d’airain.
Tant que dura le matin et que la lumière sacrée grandit, malgré leur multitude, le combat fut soutenu par nous ; mais quand Hèlios marqua le moment de délier les bœufs, les Kikônes domptèrent les Akhaiens, et six de mes compagnons aux belles knèmides furent tués par nef, et les autres échappèrent à la mort et à la kèr.
Et nous naviguions loin de là, joyeux d’avoir évité la mort et tristes dans le cœur d’avoir perdu nos chers compagnons ; et mes nefs armées d’avirons des deux côtés ne s’éloignèrent pas avant que nous eussions appelé trois fois chacun de nos compagnons tués sur la plage par les Kikônes. Et Zeus qui amasse les nuées souleva Boréas et une grande tempête, et il enveloppa de nuées la terre et la mer, et la nuit se rua de l’Ouranos.
Et les nefs étaient emportées hors de leur route, et la force du vent déchira les voiles en trois ou quatre morceaux ; et, craignant la mort, nous les serrâmes dans les nefs. Et celles-ci, avec de grands efforts, furent tirées sur le rivage, où, pendant deux nuits et deux jours, nous restâmes gisants, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand Éôs aux beaux cheveux amena le troisième jour, ayant dressé les mâts et déployé les blanches voiles, nous nous assîmes sur les bancs, et le vent et les pilotes nous conduisirent ; et je serais arrivé sain et sauf dans la terre de la patrie, si la mer et le courant du cap Maléien et Boréas ne m’avaient porté par delà Kythèrè.
Et nous fûmes entraînés, pendant neuf jours, par les vents contraires, sur la mer poissonneuse : mais, le dixième jour, nous abordâmes la terre des Lotophages qui se nourrissent d’une fleur. Là, étant montés sur le rivage, et ayant puisé de l’eau, mes compagnons prirent leur repas auprès des nefs rapides. Et, alors, je choisis deux de mes compagnons, et le troisième fut un héraut, et je les envoyai afin d’apprendre quels étaient les hommes qui vivaient sur cette terre.
Et ceux-là, étant partis, rencontrèrent les Lotophages, et les Lotophages ne leur firent aucun mal, mais ils leur offrirent le lotos à manger. Et dès qu’ils eurent mangé le doux lotos, ils ne songèrent plus ni à leur message, ni au retour ; mais, pleins d’oubli, ils voulaient rester avec les Lotophages et manger du lotos. Et, les reconduisant aux nefs, malgré leurs larmes, je les attachai sous les bancs des nefs creuses ; et j’ordonnai à mes chers compagnons de se hâter de monter dans nos nefs rapides, de peur qu’en mangeant le lotos, ils oubliassent le retour.
Et ils y montèrent, et, s’asseyant en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent de leurs avirons la blanche mer, et nous naviguâmes encore, tristes dans le cœur.
Et nous parvînmes à la terre des kyklopes orgueilleux et sans lois qui, confiants dans les dieux immortels, ne plantent point de leurs mains et ne labourent point. Mais, n’étant ni semées, ni cultivées, toutes les plantes croissent pour eux, le froment et l’orge, et les vignes qui leur donnent le vin de leurs grandes grappes que font croître les pluies de Zeus.
Et les agoras ne leur sont point connues, ni les coutumes ; et ils habitent le faîte des hautes montagnes, dans de profondes cavernes, et chacun d’eux gouverne sa femme et ses enfants, sans nul souci des autres.
Une petite île est devant le port de la terre des kyklopes, ni proche, ni éloignée. Elle est couverte de forêts où se multiplient les chèvres sauvages. Et la présence des hommes ne les a jamais effrayées, car les chasseurs qui supportent les douleurs dans les bois et les fatigues sur le sommet des montagnes ne parcourent point cette île. On n’y fait point paître de troupeaux et on n’y laboure point ; mais elle n’est ni ensemencée ni labourée ; elle manque d’habitants et elle ne nourrit que des chèvres bêlantes. En effet, les kyklopes n’ont point de nefs peintes en rouge, et ils n’ont point de onstructeurs de nefs à bancs de rameurs qui les portent vers les villes des hommes, comme ceux-ci traversent la mer les uns vers les autres, afin que, sur ces nefs, ils puissent venir habiter cette île. Mais celle-ci n’est pas stérile, et elle produirait toutes choses selon les saisons. Il y a de molles prairies arrosées sur le bord de la blanche mer, et des vignes y croîtraient abondamment, et cette terre donnerait facilement des moissons, car elle est très grasse. Son port est sûr, et on n’y a besoin ni de cordes, ni d’ancres jetées, ni de lier les câbles ; et les marins peuvent y rester aussi longtemps que leur âme le désire et attendre le vent. Au fond du port, une source limpide coule sous une grotte, et l’aune croît autour.
C’est là que nous fûmes poussés, et un dieu nous y conduisit pendant une nuit obscure, car nous ne pouvions rien voir. Et un épais brouillard enveloppait les nefs, et Séléné ne luisait point dans l’Ouranos, étant couverte de nuages. Et aucun de nous ne vit l’île de ses yeux, ni les grandes lames qui roulaient vers le rivage, avant que nos nefs aux bancs de rameurs n’y eussent abordé. Alors nous serrâmes toutes les voiles et nous descendîmes sur le rivage de la mer, puis, nous étant endormis, nous attendîmes la divine Eôs.
Quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, admirant l’île, nous la parcourûmes. Et les nymphes, filles de Zeus tempétueux, firent lever les chèvres montagnardes, afin que mes compagnons pussent faire leur repas. Et, aussitôt, on retira des nefs les arcs recourbés et les lances à longues pointes d’airain, et, divisés en trois corps, nous lançâmes nos traits, et un dieu nous donna une chasse abondante. Douze nefs me suivaient, et à chacune le sort accorda neuf chèvres, et dix à la mienne. Ainsi, tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, nous mangeâmes, assis, les chairs abondantes, et nous bûmes le vin rouge ; mais il en restait encore dans les nombreuses amphores que nous avions enlevées de la citadelle sacrée des Kikônes. Et nous apercevions la fumée sur la terre prochaine des kyklopes, et nous entendions leur voix, et celle des brebis et des chèvres. Et quand Hèlios tomba, la nuit survint, et nous nous endormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, ayant convoqué l’agora, je dis à tous mes compagnons :
– Restez ici, mes chers compagnons. Moi, avec ma nef et mes rameurs, j’irai voir quels sont ces hommes, s’ils sont injurieux, sauvages et injustes, ou s’ils sont hospitaliers et craignant les dieux.
Ayant ainsi parlé, je montai sur ma nef et j’ordonnai à mes compagnons d’y monter et de détacher le câble. Et ils montèrent, et, assis en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons.
Quand nous fûmes parvenus à cette terre prochaine, nous vîmes, à son extrémité, une haute caverne ombragée de lauriers, près de la mer. Et là, reposaient de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Auprès, il y avait un enclos pavé de pierres taillées et entouré de grands pins et de chênes aux feuillages élevés. Là habitait un homme géant qui, seul et loin de tous, menait paître ses troupeaux, et ne se mêlait point aux autres, mais vivait à l’écart, faisant le mal. Et c’était un monstre prodigieux, non semblable à un homme qui mange le pain, mais au faite boisé d’une haute montagne, qui se dresse, seul, au milieu des autres sommets.
Et alors j’ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès de la nef et de la garder. Et j’en choisis douze des plus braves, et je partis, emportant une outre de peau de chèvre, pleine d’un doux vin noir que m’avait donné Maron, fils d’Euanthéos, sacrificateur d’Apollôn, et qui habitait Ismaros, parce que nous l’avions épargné avec sa femme et ses enfants, par respect.
Et il habitait dans le bois sacré de Phoibos Apollôn : il me fit de beaux présents, car il me donna sept talents d’or bien travaillés, un kratère d’argent massif, et, dans douze amphores, un vin doux, pur et divin, qui n’était connu dans sa demeure ni de ses serviteurs, ni de ses servantes, mais de lui seul, de sa femme et de l’intendante. Toutes les fois qu’on buvait ce doux vin rouge, on y mêlait, pour une coupe pleine, vingt mesures d’eau, et son arôme parfumait encore le kratère, et il eût été dur de s’en abstenir. Et j’emportai une grande outre pleine de ce vin, et des vivres dans un sac, car mon âme courageuse m’excitait à m’approcher de cet homme géant, doué d’une grande force, sauvage, ne connaissant ni la justice ni les lois.
Et nous arrivâmes rapidement à son antre, sans l’y trouver, car il paissait ses troupeaux dans les gras pâturages ; et nous entrâmes, admirant tout ce qu’on voyait là. Les claies étaient chargées de fromages, et les étables étaient pleines d’agneaux et de chevreaux, et ceux-ci étaient renfermés en ordre et séparés, les plus jeunes d’un côté, et les nouveau-nés de l’autre. Et tous les vases à traire étaient pleins, dans lesquels la crème flottait sur le petit lait. Et mes compagnons me suppliaient d’enlever les fromages et de retourner, en chassant rapidement vers la nef les agneaux et les chevreaux hors des étables, et de fuir sur l’eau salée. Et je ne le voulus point, et, certes, cela eût été le plus sage ; mais je désirais voir cet homme, afin qu’il me fit les présents hospitaliers. Bientôt sa vue ne devait pas être agréable à mes compagnons.
Alors, ranimant le feu et mangeant les fromages, nous l’attendîmes, assis. Et il revint du pâturage, et il portait un vaste monceau de bois sec, afin de préparer son repas, et il le jeta à l’entrée de la caverne, avec retentissement. Et nous nous cachâmes, épouvantés, dans le fond de l’antre. Et il poussa dans la caverne large tous ceux de ses gras troupeaux qu’il devait traire, laissant dehors les mâles, béliers et boucs, dans le haut enclos. Puis, soulevant un énorme bloc de pierre, si lourd que vingt-deux chars solides, à quatre roues, n’auraient pu le remuer, il le mit en place. Telle était la pierre immense qu’il plaça contre la porte. Puis, s’asseyant, il commença de traire les brebis et les chèvres bêlantes, comme il convenait, et il mit les petits sous chacune d’elles. Et il fit cailler aussitôt la moitié du lait blanc qu’il déposa dans des corbeilles tressées, et il versa l’autre moitié dans les vases, afin de la boire en mangeant et qu’elle lui servît pendant son repas. Et quand il eut achevé tout ce travail à la hâte, il alluma le feu, nous aperçut et nous dit :
– Ô étrangers, qui êtes-vous ? D’où venez-vous sur la mer ? Est-ce pour un trafic, ou errez-vous sans but, comme des pirates qui vagabondent sur la mer, exposant leurs âmes au danger et portant les calamités aux autres hommes ?
Il parla ainsi, et notre cher cœur fut épouvanté au son de la voix du monstre et à sa vue. Mais, lui répondant ainsi, je dis :
– Nous sommes des Akhaiens venus de Troiè, et nous errons entraînés par tous les vents sur les vastes flots de la mer, cherchant notre demeure par des routes et des chemins inconnus. Ainsi Zeus l’a voulu. Et nous nous glorifions d’être les guerriers de l’Atréide Agamemnôn, dont la gloire, certes, est la plus grande sous l’Ouranos. En effet, il a renversé une vaste ville et dompté des peuples nombreux. Et nous nous prosternons, en suppliants, à tes genoux, pour que tu nous sois hospitalier, et que tu nous fasses les présents qu’on a coutume de faire à des hôtes. Ô excellent, respecte les dieux, car nous sommes tes suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants et des étrangers dignes d’être reçus comme des hôtes vénérables.
Je parlai ainsi, et il me répondit avec un cœur farouche :
– Tu es insensé, ô étranger, et tu viens de loin, toi qui m’ordonnes de craindre les Dieux et de me soumettre à eux. Les kyklopes ne se soucient point de Zeus tempétueux, ni des dieux heureux, car nous sommes plus forts qu’eux. Pour éviter la colère de Zeus, je n’épargnerai ni toi, ni tes compagnons, à moins que mon âme ne me l’ordonne. Mais dis-moi où tu as laissé, pour venir ici, ta nef bien construite. Est-ce loin ou près ? que je le sache.
Il parla ainsi, me tentant ; mais il ne put me tromper, car je savais beaucoup de choses, et je lui répondis ces paroles rusées :
– Poseidaôn qui ébranle la terre a brisé ma nef poussée contre les rochers d’un promontoire à l’extrémité de votre terre, et le vent l’a jetée hors de la mer et, avec ceux-ci, j’ai échappé à la mort.
Je parlai ainsi, et, dans son cœur farouche, il ne me répondit rien ; mais, en se ruant, il étendit les mains sur mes compagnons, et il en saisit deux et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Et leur cervelle jaillit et coula sur la terre. Et, les coupant membre à membre, il prépara son repas. Et il les dévora comme un lion montagnard, et il ne laissa ni leurs entrailles, ni leurs chairs, ni leurs os pleins de moelle. Et nous, en gémissant, nous levions nos mains vers Zeus, en face de cette chose affreuse, et le désespoir envahit notre âme.
Quand le kyklôps eut empli son vaste ventre en mangeant les chairs humaines et en buvant du lait sans mesure, il s’endormit étendu au milieu de l’antre, parmi ses troupeaux. Et je voulus, dans mon cœur magnanime, tirant mon épée aiguë de la gaine et me jetant sur lui, le frapper à la poitrine, là où les entrailles entourent le foie ; mais une autre pensée me retint. En effet, nous aurions péri de même d’une mort affreuse, car nous n’aurions pu mouvoir de nos mains le lourd rocher qu’il avait placé devant la haute entrée. C’est pourquoi nous attendîmes en gémissant la divine Éôs.
Quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, il alluma le feu et se mit à traire ses illustres troupeaux.
Et il plaça les petits sous leurs mères. Puis, ayant achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et prépara son repas. Et dès qu’il eut mangé, écartant sans peine la grande pierre, il poussa hors de l’antre ses gras troupeaux. Et il remit le rocher en place, comme le couvercle d’un carquois. Et il mena avec beaucoup de bruit ses gras troupeaux sur la montagne.
Et je restai, méditant une action terrible et cherchant comment je me vengerais et comment Athènè exaucerait mon vœu. Et ce dessein me sembla le meilleur dans mon esprit. La grande massue du kyklôps gisait au milieu de l’enclos, un olivier vert qu’il avait coupé afin de s’y appuyer quand il serait sec. Et ce tronc nous semblait tel qu’un mât de nef de charge à vingt avirons qui fend les vastes flots. Telles étaient sa longueur et son épaisseur. J’en coupai environ une brasse que je donnai à mes compagnons, leur ordonnant de l’équarrir. Et ils l’équarrirent, et je taillai le bout de l’épieu en pointe, et je le passai dans le feu ardent pour le durcir ; puis je le cachai sous le fumier qui était abondamment répandu dans toute la caverne, et j’ordonnai à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l’enfoncer dans l’oeil du kyklôps quand le doux sommeil l’aurait saisi. Ils tirèrent au sort, qui marqua ceux mêmes que j’aurais voulu prendre. Et ils étaient quatre, et j’étais le cinquième, car ils m’avaient choisi.
Le soir, le kyklôps revint, ramenant ses troupeaux du pâturage ; et, aussitôt, il les poussa tous dans la vaste caverne et il n’en laissa rien dans l’enclos, soit par défiance, soit qu’un dieu le voulût ainsi. Puis, il plaça l’énorme pierre devant l’entrée, et, s’étant assis, il se mit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis, il mit les petits sous leurs mères. Ayant achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et prépara son repas. Alors, tenant dans mes mains une coupe de vin noir, je m’approchai du kyklôps et je lui dis :
– Kyklôps, prends et bois ce vin après avoir mangé des chairs humaines, afin de savoir quel breuvage renfermait notre nef. Je t’en rapporterais de nouveau, si, me prenant en pitié, tu me renvoyais dans ma demeure : mais tu es furieux comme on ne peut l’être davantage. Insensé ! Comment un seul des hommes innombrables pourra-t-il t’approcher désormais, puisque tu manques d’équité ?
Je parlai ainsi, et il prit et but plein de joie ; puis, ayant bu le doux breuvage, il m’en demanda de nouveau :
– Donne-m’en encore, cher, et dis-moi promptement ton nom, afin que je te fasse un présent hospitalier dont tu te réjouisses. La terre féconde rapporte aussi aux kyklopes un vin généreux, et les pluies de Zeus font croître nos vignes ; mais celui-ci est fait de nektar et d’ambroisie.
Il parla ainsi, et de nouveau je lui donnai ce vin ardent. Et je lui en offris trois fois, et trois fois il le but dans sa démence. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, alors je lui parlai ainsi en paroles flatteuses :
– Kyklôps, tu me demandes mon nom illustre. Je te le dirai, et tu me feras le présent hospitalier que tu m’as promis. Mon nom est Personne. Mon père et ma mère et tous mes compagnons me nomment Personne.
Je parlai ainsi, et, dans son âme farouche, il me répondit :
– Je mangerai Personne après tous ses compagnons, tous les autres avant lui. Ceci sera le présent hospitalier que je te ferai.
Il parla ainsi, et il tomba à la renverse, et il gisait, courbant son cou monstrueux, et le sommeil qui dompte tout le saisit, et de sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine ; et il vomissait ainsi, plein de vin. Aussitôt je mis l’épieu sous la cendre, pour l’échauffer ; et je rassurai mes compagnons, afin qu’épouvantés, ils ne m’abandonnassent pas. Puis, comme l’épieu d’olivier, bien que vert, allait s’enflammer dans le feu, car il brûlait violemment, alors je le retirai du feu. Et mes compagnons étaient autour de moi, et un daimôn nous inspira un grand courage.
Ayant saisi l’épieu d’olivier aigu par le bout, ils l’enfoncèrent dans l’oeil du kyklôps, et moi, appuyant dessus, je le tournais, comme un constructeur de nefs troue le bois avec une tarière, tandis que ses compagnons la fixent des deux côtés avec une courroie, et qu’elle tourne sans s’arrêter. Ainsi nous tournions l’épieu enflammé dans son oeil. Et le sang chaud en jaillissait, et la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil ; et les racines de l’oeil frémissaient, comme lorsqu’un forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l’eau froide, et qu’elle crie, stridente, ce qui donne la force au fer. Ainsi son oeil faisait un bruit strident autour de l’épieu d’olivier. Et il hurla horriblement, et les rochers en retentirent. Et nous nous enfuîmes épouvantés. Et il arracha de son oeil l’épieu souillé de beaucoup de sang, et, plein de douleur, il le rejeta. Alors, à haute voix, il appela les kyklopes qui habitaient autour de lui les cavernes des promontoires battus des vents. Et, entendant sa voix, ils accoururent de tous côtés, et, debout autour de l’antre, ils lui demandaient pourquoi il se plaignait :
– Pourquoi, Polyphèmos, pousses-tu de telles clameurs dans la nuit divine et nous réveilles-tu ? Souffres-tu ? Quelque mortel a-t-il enlevé tes brebis ? Quelqu’un veut-il te tuer par force ou par ruse ?
Et le robuste Polyphèmos leur répondit du fond de son antre :
– Ô amis, qui me tue par ruse et non par force ? Personne.
Et ils lui répondirent en paroles ailées :
– Certes, nul ne peut te faire violence, puisque tu es seul. On ne peut échapper aux maux qu’envoie le grand Zeus. Supplie ton père, le roi Poseidaôn.
Ils parlèrent ainsi et s’en allèrent. Et mon cher cœur rit, parce que mon nom les avait trompés, ainsi que ma ruse irréprochable.
Mais le kyklôps, gémissant et plein de douleurs, tâtant avec les mains, enleva le rocher de la porte, et, s’asseyant là, étendit les bras, afin de saisir ceux de nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il pensait, certes, que j’étais insensé. Aussitôt, je songeai à ce qu’il y avait de mieux à faire pour sauver mes compagnons et moi-même de la mort. Et je méditai ces ruses et ce dessein, car il s’agissait de la vie, et un grand danger nous menaçait. Et ce dessein me parut le meilleur dans mon esprit.
Les mâles des brebis étaient forts et laineux, beaux et grands, et ils avaient une laine de couleur violette. Je les attachai par trois avec l’osier tordu sur lequel dormait le kyklôps monstrueux et féroce. Celui du milieu portait un homme, et les deux autres, de chaque côté, cachaient mes compagnons.
Et il y avait un bélier, le plus grand de tous. J’embrassai son dos, suspendu sous son ventre, et je saisis fortement de mes mains sa laine très épaisse, dans un esprit patient. Et c’est ainsi qu’en gémissant nous attendîmes la divine Éôs.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, alors le kyklôps poussa les mâles des troupeaux au pâturage. Et les femelles bêlaient dans les étables, car il n’avait pu les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Et lui, accablé de douleurs, tâtait le dos de tous les béliers qui passaient devant lui, et l’insensé ne s’apercevait point que mes compagnons étaient liés sous le ventre des béliers laineux. Et celui qui me portait dans sa laine épaisse, alourdi, sortit le dernier, tandis que je roulais mille pensées. Et le robuste Polyphèmos, le tâtant, lui dit :
– Bélier paresseux, pourquoi sors-tu le dernier de tous de mon antre ? Auparavant, jamais tu ne restais derrière les autres, mais, le premier, tu paissais les tendres fleurs de l’herbe, et, le premier, marchant avec fierté, tu arrivais au cours des fleuves, et, le premier, le soir, tu rentrais à l’enclos. Maintenant, te voici le dernier. Regrettes-tu l’oeil de ton maître qu’un méchant homme a arraché, à l’aide de ses misérables compagnons, après m’avoir dompté l’âme par le vin, Personne, qui n’échappera pas, je pense, à la mort ? Plût aux dieux que tu pusses entendre, parler, et me dire où il se dérobe à ma force ! Aussitôt sa cervelle écrasée coulerait çà et là dans la caverne, et mon cœur se consolerait des maux que m’a faits ce misérable Personne !
Ayant ainsi parlé, il laissa sortir le bélier. À peine éloignés de peu d’espace de l’antre et de l’enclos, je quittai le premier le bélier et je détachai mes compagnons. Et nous poussâmes promptement hors de leur chemin les troupeaux chargés de graisse, jusqu’à ce que nous fussions arrivés à notre nef. Et nos chers compagnons nous revirent, nous du moins qui avions échappé à la mort, et ils nous regrettaient ; aussi ils gémissaient, et ils pleuraient les autres. Mais, par un froncement de sourcils, je leur défendis de pleurer, et j’ordonnai de pousser promptement les troupeaux laineux dans la nef, et de fendre l’eau salée. Et aussitôt ils s’embarquèrent, et, s’asseyant en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Mais quand nous fûmes éloignés de la distance où porte la voix, alors je dis au kyklôps ces paroles outrageantes :
– Kyklôps, tu n’as pas mangé dans ta caverne creuse, avec une grande violence, les compagnons d’un homme sans courage, et le châtiment devait te frapper, malheureux ! toi qui n’as pas craint de manger tes hôtes dans ta demeure. C’est pourquoi Zeus et les autres dieux t’ont châtié.
Je parlai ainsi, et il entra aussitôt dans une plus violente fureur, et, arrachant la cime d’une grande montagne, il la lança. Et elle tomba devant notre nef à noire proue, et l’extrémité de la poupe manqua être brisée, et la mer nous inonda sous la chute de ce rocher qui la fit refluer vers le rivage, et le flot nous remporta jusqu’à toucher le bord.
Mais, saisissant un long pieu, je repoussai la nef du rivage, et, d’un signe de tête, j’ordonnai à mes compagnons d’agiter les avirons afin d’échapper à la mort, et ils se courbèrent sur les avirons. Quand nous nous fûmes une seconde fois éloignés à la même distance, je voulus encore parler au kyklôps, et tous mes compagnons s’y opposaient par des paroles suppliantes :
– Malheureux ! pourquoi veux-tu irriter cet homme sauvage ? Déjà, en jetant ce rocher dans la mer, il a ramené notre nef contre terre, où, certes, nous devions périr ; et s’il entend tes paroles ou le son de ta voix, il pourra briser nos têtes et notre nef sous un autre rocher qu’il lancera, tant sa force est grande.
Ils parlaient ainsi, mais ils ne persuadèrent point mon cœur magnanime, et je lui parlai de nouveau injurieusement :
– Kyklôps, si quelqu’un parmi les hommes mortels t’interroge sur la perte honteuse de ton oeil, dis-lui qu’il a été arraché par le dévastateur de citadelles Odysseus, fils de Laertès, et qui habite dans Ithakè.
Je parlai ainsi, et il me répondit en gémissant :
– Ô dieux ! voici que les anciennes prédictions qu’on m’a faites se sont accomplies. Il y avait ici un excellent et grand divinateur, Tèlémos Eurymide, qui l’emportait sur tous dans la divination, et qui vieillit en prophétisant au milieu des kyklopes.
Et il me dit que toutes ces choses s’accompliraient qui me sont arrivées, et que je serais privé de la vue par Odysseus. Et je pensais que ce serait un homme grand et beau qui viendrait ici, revêtu d’une immense force. Et c’est un homme de rien, petit et sans courage, qui m’a privé de mon oeil après m’avoir dompté avec du vin ! Viens ici, Odysseus, afin que je te fasse les présents de l’hospitalité. Je demanderai à l’illustre qui ébranle la terre de te reconduire. Je suis son fils, et il se glorifie d’être mon père, et il me guérira, s’il le veut, et non quelque autre des dieux immortels ou des hommes mortels.
Il parla ainsi et je lui répondis :
– Plût aux dieux que je t’eusse arraché l’âme et la vie, et envoyé dans la demeure d’Aidès aussi sûrement que celui qui ébranle la terre ne guérira point ton oeil.
Je parlais ainsi, et, aussitôt, il supplia le roi Poseidaôn, en étendant les mains vers l’Ouranos étoilé :
– Entends-moi, Poseidaôn aux cheveux bleus, qui contiens la terre ! Si je suis ton fils, et si tu te glorifies d’être mon père, fais que le dévastateur de citadelles, Odysseus, fils de Laertès, et qui habite dans Ithakè, ne retourne jamais dans sa patrie. Mais si sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa demeure bien construite et dans la terre de sa patrie, qu’il n’y parvienne que tardivement, après avoir perdu tous ses compagnons, et sur une nef étrangère, et qu’il souffre encore en arrivant dans sa demeure !
Il pria ainsi, et l’illustre aux cheveux bleus l’entendit.
Puis, il souleva un plus lourd rocher, et, le faisant tourner, il le jeta avec une immense force. Et il tomba à l’arrière de la nef à proue bleue, manquant d’atteindre l’extrémité du gouvernail, et la mer se souleva sous le coup ; mais le flot, cette fois, emporta la nef et la poussa vers l’île ; et nous parvînmes bientôt là où étaient les autres nefs à bancs de rameurs. Et nos compagnons y étaient assis, pleurant et nous attendant toujours. Ayant abordé, nous tirâmes la nef sur le sable et nous descendîmes sur le rivage de la mer.
Et nous partageâmes les troupeaux du kyklôps, après les avoir retirés de la nef creuse, et nul ne fut privé d’une part égale. Et mes compagnons me donnèrent le bélier, outre ma part, et après le partage. Et, l’ayant sacrifié sur le rivage à Zeus Kronide qui amasse les noires nuées et qui commande à tous, je brûlai ses cuisses. Mais Zeus ne reçut point mon sacrifice ; mais, plutôt, il songeait à perdre toutes mes nefs à bancs de rameurs et tous mes chers compagnons.
Et nous nous reposâmes là, tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Et quand Hèlios tomba et que les ombres survinrent, nous dormîmes sur le rivage de la mer.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, je commandai à mes compagnons de s’embarquer et de détacher les câbles.
Et, aussitôt, ils s’embarquèrent, et, s’asseyant en ordre sur les bancs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Et, de là, nous naviguâmes, tristes dans le cœur, bien que joyeux d’avoir échappé à la mort, car nous avions perdu nos chers compagnons.Chant 10
Et nous arrivâmes à l’île Aioliè, où habitait Aiolos Hippotade cher aux dieux immortels. Et un mur d’airain qu’on ne peut rompre entourait l’île entière, et une roche escarpée la bordait de toute part. Douze enfants étaient nés dans la maison royale d’Aiolos : six filles et six fils pleins de jeunesse. Et il unit ses filles à ses fils afin qu’elles fussent les femmes de ceux-ci, et tous prenaient leur repas auprès de leur père bien-aimé et de leur mère vénérable, et de nombreux mets étaient placés devant eux. Pendant le jour, la maison et la cour retentissaient, parfumées ; et, pendant la nuit tous dormaient auprès de leurs femmes chastes, sur des tapis et sur des lits sculptés.
Et nous entrâmes dans la ville et dans les belles demeures. Et tout un mois Aiolos m’accueillit, et il m’interrogeait sur Ilios, sur les nefs des Argiens et sur le retour des Akhaiens. Et je lui racontai toutes ces choses comme il convenait. Et quand je lui demandai de me laisser partir et de me renvoyer, il ne me refusa point et il prépara mon retour. Et il me donna une outre, faite de la peau d’un bœuf de neuf ans, dans laquelle il enferma le souffle des vents tempétueux ; car le Kroniôn l’avait fait le maître des vents, et lui avait donné de les soulever ou de les apaiser, selon sa volonté. Et, avec un splendide câble d’argent, il l’attacha dans ma nef creuse, afin qu’il n’en sortît aucun souffle. Puis il envoya le seul Zéphyros pour nous emporter, les nefs et nous. Mais ceci ne devait point s’accomplir, car nous devions périr par notre démence.
Et, sans relâche, nous naviguâmes pendant neuf jours et neuf nuits, et au dixième jour la terre de la patrie apparaissait déjà, et nous apercevions les feux des habitants. Et, dans ma fatigue, le doux sommeil me saisit. Et j’avais toujours tenu le gouvernail de la nef, ne l’ayant cédé à aucun de mes compagnons, afin d’arriver promptement dans la terre de la patrie. Et mes compagnons parlèrent entre eux, me soupçonnant d’emporter dans ma demeure de l’or et de l’argent, présents du magnanime Aiolos Hippotade. Et ils se disaient entre eux :
– Dieux ! combien Odysseus est aimé de tous les hommes et très honoré de tous ceux dont il aborde la ville et la terre ! Il a emporté de Troiè, pour sa part du butin, beaucoup de choses belles et précieuses, et nous rentrons dans nos demeures, les mains vides, après avoir fait tout ce qu’il a fait. Et voici que, par amitié, Aiolos l’a comblé de présents ! Mais voyons à la hâte ce qu’il y a dans cette outre, et combien d’or et d’argent on y a renfermé.
Ils parlaient ainsi, et leur mauvais dessein l’emporta. Ils ouvrirent l’outre, et tous les vents en jaillirent. Et aussitôt la tempête furieuse nous emporta sur la mer, pleurants, loin de la terre de la patrie. Et, m’étant réveillé, je délibérai dans mon cœur irréprochable si je devais périr en me jetant de ma nef dans la mer, ou si, restant parmi les vivants, je souffrirais en silence. Je restai et supportai mes maux. Et je gisais caché dans le fond de ma nef, tandis que tous étaient de nouveau emportés par les tourbillons du vent vers l’île Aioliè. Et mes compagnons gémissaient.
Étant descendus sur le rivage, nous puisâmes de l’eau, et mes compagnons prirent aussitôt leur repas auprès des nefs rapides. Après avoir mangé et bu, je choisis un héraut et un autre compagnon, et je me rendis aux illustres demeures d’Aiolos. Et je le trouvai faisant son repas avec sa femme et ses enfants. Et, en arrivant, nous nous assîmes sur le seuil de la porte. Et tous étaient stupéfaits et ils m’interrogèrent :
– Pourquoi es-tu revenu, Odysseus ? Quel daimôn t’a porté malheur ? N’avions-nous pas assuré ton retour, afin que tu parvinsses dans la terre de ta patrie, dans tes demeures, là où il te plaisait d’arriver ?
Ils parlaient ainsi, et je répondis, triste dans le cœur :
– Mes mauvais compagnons m’ont perdu, et, avant eux, le sommeil funeste. Mais venez à mon aide, amis, car vous en avez le pouvoir.
Je parlai ainsi, tâchant de les apaiser par des paroles flatteuses ; mais ils restèrent muets, et leur père me répondit :
– Sors promptement de cette île, ô le pire des vivants ! Il ne m’est point permis de recueillir ni de reconduire un homme qui est odieux aux dieux heureux. Va ! car, certes, si tu es revenu, c’est que tu es odieux aux dieux heureux.
Il parla ainsi, et il me chassa de ses demeures tandis que je soupirais profondément.
Et nous naviguions de là, tristes dans le cœur ; et l’âme de mes compagnons était accablée par la fatigue cruelle des avirons, car le retour ne nous semblait plus possible, à cause de notre démence. Et nous naviguâmes ainsi six jours et six nuits. Et, le septième jour, nous arrivâmes à la haute ville de Lamos, dans la Laistrygoniè Télépyle. Là, le pasteur qui rentre appelle le pasteur qui sort en l’entendant. Là, le pasteur qui ne dort pas gagne un salaire double, en menant paître les bœufs d’abord, et, ensuite, les troupeaux aux blanches laines, tant les chemins du jour sont proches des chemins de la nuit.
Et nous abordâmes le port illustre entouré d’un haut rocher. Et, des deux côtés, les rivages escarpés se rencontraient, ne laissant qu’une entrée étroite. Et mes compagnons conduisirent là toutes les nefs égales, et ils les amarrèrent, les unes auprès des autres, au fond du port, où jamais le flot ne se soulevait, ni peu, ni beaucoup, et où il y avait une constante tranquillité. Et, moi seul, je retins ma nef noire en dehors, et je l’amarrai aux pointes du rocher. Puis, je montai sur le faîte des écueils, et je ne vis ni les travaux des bœufs, ni ceux des hommes, et je ne vis que de la fumée qui s’élevait de terre. Alors, je choisis deux de mes compagnons et un héraut, et je les envoyai pour savoir quels hommes nourris de pain habitaient cette terre.
Et ils partirent, prenant un large chemin par où les chars portaient à la ville le bois des hautes montagnes.
Et ils rencontrèrent devant la ville, allant chercher de l’eau, une jeune vierge, fille du robuste Laistrygôn Antiphatès. Et elle descendait à la fontaine limpide d’Artakiè. Et c’est là qu’on puisait de l’eau pour la ville. S’approchant d’elle, ils lui demandèrent quel était le roi qui commandait à ces peuples ; et elle leur montra aussitôt la haute demeure de son père. Étant entrés dans l’illustre demeure, ils y trouvèrent une femme haute comme une montagne, et ils en furent épouvantés. Mais elle appela aussitôt de l’agora l’illustre Antiphatès son mari, qui leur prépara une lugubre destinée, car il saisit un de mes compagnons pour le dévorer. Et les deux autres, précipitant leur fuite, revinrent aux nefs.
Alors, Antiphatès poussa des clameurs par la ville, et les robustes Laistrygones, l’ayant entendu, se ruaient de toutes parts, innombrables, et pareils, non à des hommes, mais à des géants. Et ils lançaient de lourdes pierres arrachées au rocher, et un horrible retentissement s’éleva d’hommes mourants et de nefs écrasées. Et les Laistrygones transperçaient les hommes comme des poissons, et ils emportaient ces tristes mets. Pendant qu’ils les tuaient ainsi dans l’intérieur du port, je tirai de la gaine mon épée aiguë et je coupai les câbles de ma nef noire, et, aussitôt, j’ordonnai à mes compagnons de se courber sur les avirons, afin de fuir notre perte. Et tous ensemble se courbèrent sur les avirons, craignant la mort. Ainsi ma nef gagna la pleine mer, évitant les lourdes pierres mais toutes les autres périrent en ce lieu.
Et nous naviguions loin de là, tristes dans le cœur d’avoir perdu tous nos chers compagnons, bien que joyeux d’avoir évité la mort. Et nous arrivâmes à l’île Aiaiè, et c’est là qu’habitait Kirkè aux beaux cheveux, vénérable et éloquente déesse, sœur du prudent Aiètès. Et tous deux étaient nés de Hèlios qui éclaire les hommes, et leur mère était Persè, qu’engendra Okéanos. Et là, sur le rivage, nous conduisîmes notre nef dans une large rade, et un dieu nous y mena. Puis, étant descendus, nous restâmes là deux jours, l’âme accablée de fatigue et de douleur. Mais quand Éôs aux beaux cheveux amena le troisième jour, prenant ma lance et mon épée aiguë, je quittai la nef et je montai sur une hauteur d’où je pusse voir des hommes et entendre leurs voix. Et, du sommet escarpé où j’étais monté, je vis s’élever de la terre large, à travers une forêt de chênes épais, la fumée des demeures de Kirkè. Puis, je délibérai, dans mon esprit et dans mon cœur, si je partirais pour reconnaître la fumée que je voyais. Et il me parut plus sage de regagner ma nef rapide et le rivage de la mer, de faire prendre le repas à mes compagnons et d’envoyer reconnaître le pays.
Mais, comme, déjà, j’étais près de ma nef, un dieu qui, sans doute, eut compassion de me voir seul, envoya sur ma route un grand cerf au bois élevé qui descendait des pâturages de la forêt pour boire au fleuve, car la force de Hèlios le poussait. Et, comme il s’avançait, je le frappai au milieu de l’épine du dos, et la lame d’airain le traversa, et, en bramant, il tomba dans la poussière et son esprit s’envola.
Je m’élançai, et je retirai la lance d’airain de la blessure. Je la laissai à terre, et, arrachant toute sorte de branches pliantes, j’en fis une corde tordue de la longueur d’une brasse, et j’en liai les pieds de l’énorme bête. Et, la portant à mon cou, je descendis vers ma nef, appuyé sur ma lance, car je n’aurais pu retenir un animal aussi grand, d’une seule main, sur mon épaule. Et je le jetai devant la nef, et je ranimai mes compagnons en adressant des paroles flatteuses à chacun d’eux :
– Ô amis, bien que malheureux, nous ne descendrons point dans les demeures d’Aidès avant notre jour fatal. Allons, hors de la nef rapide, songeons à boire et à manger, et ne souffrons point de la faim.
Je parlai ainsi, et ils obéirent à mes paroles, et ils descendirent sur le rivage de la mer, admirant le cerf, et combien il était grand. Et après qu’ils se furent réjouis de le regarder, s’étant lavé les mains, ils préparèrent un excellent repas. Ainsi, tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, nous restâmes assis, mangeant les chairs abondantes et buvant le vin doux. Et quand Hèlios tomba et que les ombres survinrent, nous nous endormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, alors, ayant convoqué l’agora, je parlai ainsi :
– Écoutez mes paroles et supportez patiemment vos maux, compagnons.
Ô amis ! nous ne savons, en effet, où est le couchant, où le levant, de quel côté Hèlios se lève sur la terre pour éclairer les hommes, ni de quel côté il se couche. Délibérons donc promptement, s’il est nécessaire ; mais je ne le pense pas. Du faîte de la hauteur où j’ai monté, j’ai vu que cette terre est une île que la mer sans bornes environne. Elle est petite, et j’ai vu de la fumée s’élever à travers une forêt de chênes épais.
Je parlai ainsi, et leur cher cœur fut brisé, se souvenant des crimes du Laistrygôn Antiphatès et de la violence du magnanime kyklôps mangeur d’hommes. Et ils pleuraient, répandant des larmes abondantes. Mais il ne servait à rien de gémir. Je divisai mes braves compagnons, et je donnai un chef à chaque troupe. Je commandai l’une, et Eurylokhos semblable à un dieu commanda l’autre. Et les sorts ayant été promptement jetés dans un casque d’airain, ce fut celui du magnanime Eurylokhos qui sortit. Et il partit à la hâte, et en pleurant, avec vingt-deux compagnons, et ils nous laissèrent gémissants.
Et ils trouvèrent, dans une vallée, en un lieu découvert, les demeures de Kirkè, construites en pierres polies. Et tout autour erraient des loups montagnards et des lions. Et Kirkè les avait domptés avec des breuvages perfides ; et ils ne se jetaient point sur les hommes, mais ils les approchaient en remuant leurs longues queues, comme des chiens caressant leur maître qui se lève du repas, car il leur donne toujours quelques bons morceaux.
Ainsi les loups aux ongles robustes et les lions entouraient, caressants, mes compagnons ; et ceux-ci furent effrayés de voir ces bêtes féroces, et ils s’arrêtèrent devant les portes de la déesse aux beaux cheveux. Et ils entendirent Kirkè chantant d’une belle voix dans sa demeure et tissant une grande toile ambroisienne, telle que sont les ouvrages légers, gracieux et brillants des déesses. Alors Polytès, chef des hommes, le plus cher de mes compagnons, et que j’honorais le plus, parla le premier :
– Ô amis, quelque femme, tissant une grande toile, chante d’une belle voix dans cette demeure, et tout le mur en résonne. Est-ce une déesse ou une mortelle ? Poussons promptement un cri.
Il les persuada ainsi, et ils appelèrent en criant. Et Kirkè sortit aussitôt, et, ouvrant les belles portes, elle les invita, et tous la suivirent imprudemment. Eurylokhos resta seul dehors, ayant soupçonné une embûche. Et Kirkè, ayant fait entrer mes compagnons, les fit asseoir sur des sièges et sur des thrônes. Et elle mêla, avec du vin de Pramnios, du fromage, de la farine et du miel doux ; mais elle mit dans le pain des poisons, afin de leur faire oublier la terre de la patrie. Et elle leur offrit cela, et ils burent, et, aussitôt, les frappant d’une baguette, elle les renferma dans les étables à porcs. Et ils avaient la tête, la voix, le corps et les soies du porc, mais leur esprit était le même qu’auparavant. Et ils pleuraient, ainsi renfermés ; et Kirkè leur donna du gland de chêne et du fruit de cornouiller à manger, ce que mangent toujours les porcs qui couchent sur la terre.
Mais Eurylokhos revint à la hâte vers la nef noire et rapide nous annoncer la dure destinée de nos compagnons. Et il ne pouvait parler, malgré son désir, et son cœur était frappé d’une grande douleur, et ses yeux étaient pleins de larmes, et son âme respirait le deuil. Mais, comme nous l’interrogions tous avec empressement, il nous raconta la perte de ses compagnons :
– Nous avons marché à travers la forêt, comme tu l’avais ordonné, illustre Odysseus, et nous avons rencontré, dans une vallée, en un lieu découvert, de belles demeures construites en pierres polies. Là, une déesse, ou une mortelle, chantait harmonieusement en tissant une grande toile. Et mes compagnons l’appelèrent en criant. Aussitôt, elle sortit, et, ouvrant la belle porte, elle les invita, et tous la suivirent imprudemment, et, moi seul, je restai, ayant soupçonné une embûche. Et tous les autres disparurent à la fois, et aucun n’a reparu, bien que je les aie longtemps épiés et attendus.
Il parla ainsi, et je jetai sur mes épaules une grande épée d’airain aux clous d’argent et un arc, et j’ordonnai à Eurylokhos de me montrer le chemin. Mais, ayant saisi mes genoux de ses mains, en pleurant, il me dit ces paroles ailées :
– Ne me ramène point là contre mon gré, ô divin, mais laisse-moi ici. Je sais que tu ne reviendras pas et que tu ne ramèneras aucun de nos compagnons.
Fuyons promptement avec ceux-ci, car, sans doute, nous pouvons encore éviter la dure destinée.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Eurylokhos, reste donc ici, mangeant et buvant auprès de la nef noire et creuse. Moi, j’irai, car une nécessité inexorable me contraint.
Ayant ainsi parlé, je m’éloignai de la mer et de la nef, et traversant les vallées sacrées, j’arrivai à la grande demeure de l’empoisonneuse Kirkè. Et Herméias à la baguette d’or vint à ma rencontre, comme j’approchais de la demeure, et il était semblable à un jeune homme dans toute la grâce de l’adolescence. Et, me prenant la main, il me dit :
– Ô malheureux où vas-tu seul, entre ces collines, ignorant ces lieux. Tes compagnons sont enfermés dans les demeures de Kirkè, et ils habitent comme des porcs des étables bien closes. Viens-tu pour les délivrer ? Certes, je ne pense pas que tu reviennes toi-même, et tu resteras là où ils sont déjà. Mais je te délivrerai de ce mal et je te sauverai. Prends ce remède excellent, et le portant avec toi, rends-toi aux demeures de Kirkè, car il éloignera de ta tête le jour fatal. Je te dirai tous les mauvais desseins de Kirkè. Elle te préparera un breuvage et elle mettra les poisons dans le pain, mais elle ne pourra te charmer, car l’excellent remède que je te donnerai ne le permettra pas. Je vais te dire le reste.
Quand Kirkè t’aura frappé de sa longue baguette, jette-toi sur elle, comme si tu voulais la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t’invitera à coucher avec elle. Ne refuse point le lit d’une déesse, afin qu’elle délivre tes compagnons et qu’elle te traite toi-même avec bienveillance. Mais ordonne-lui de jurer par le grand serment des dieux heureux, afin qu’elle ne te tende aucune autre embûche, et que, t’ayant mis nu, elle ne t’enlève point ta virilité.
Ayant ainsi parlé, le tueur d’Argos me donna le remède qu’il arracha de terre, et il m’en expliqua la nature. Et sa racine est noire et sa fleur semblable à du lait. Les dieux la nomment môly. Il est difficile aux hommes mortels de l’arracher, mais les dieux peuvent tout. Puis Herméias s’envola vers le grand Olympos, sur l’île boisée, et je marchai vers la demeure de Kirkè, et mon cœur roulait mille pensées tandis que je marchais.
Et, m’arrêtant devant la porte de la déesse aux beaux cheveux, je l’appelai, et elle entendit ma voix, et, sortant aussitôt, elle ouvrit les portes brillantes et elle m’invita. Et, l’ayant suivie, triste dans le cœur, elle me fit entrer, puis asseoir sur un thrône à clous d’argent, et bien travaillé. Et j’avais un escabeau sous les pieds. Aussitôt elle prépara dans une coupe d’or le breuvage que je devais boire, et, méditant le mal dans son esprit, elle y mêla le poison. Après me l’avoir donné, et comme je buvais, elle me frappa de sa baguette et elle me dit :
– Va maintenant dans l’étable à porcs, et couche avec tes compagnons.
Elle parla ainsi, mais je tirai de la gaine mon épée aiguë et je me jetai sur elle comme si je voulais la tuer. Alors, poussant un grand cri, elle se prosterna, saisit mes genoux et me dit ces paroles ailées, en pleurant :
– Qui es-tu parmi les hommes ? Où est ta ville ? Où sont tes parents ? Je suis stupéfaite qu’ayant bu ces poisons tu ne sois pas transformé. Jamais aucun homme, pour les avoir seulement fait passer entre ses dents, n’y a résisté. Tu as un esprit indomptable dans ta poitrine, ou tu es le subtil Odysseus qui devait arriver ici, à son retour de Troiè, sur sa nef noire et rapide, ainsi que Herméias à la baguette d’or me l’avait toujours prédit. Mais, remets ton épée dans sa gaine, et couchons-nous tous deux sur mon lit, afin que nous nous unissions, et que nous nous confiions l’un à l’autre.
Elle parla ainsi, et, lui répondant, je lui dis :
– Ô Kirkè ! comment me demandes-tu d’être doux pour toi qui as changé, dans tes demeures, mes compagnons en porcs, et qui me retiens ici moi-même, m’invitant à monter sur ton lit, dans la chambre nuptiale, afin qu’étant nu, tu m’enlèves ma virilité ? Certes, je ne veux point monter sur ton lit, à moins que tu ne jures par un grand serment, ô déesse, que tu ne me tendras aucune autre embûche.
Je parlais ainsi, et aussitôt elle jura comme je le lui demandais ; et après qu’elle eut juré et prononcé toutes les paroles du serment, alors je montai sur son beau lit. Et les servantes s’agitaient dans la demeure ; et elles étaient quatre, et elles prenaient soin de toute chose. Et elles étaient nées des sources des forêts et des fleuves sacrés qui coulent à la mer. L’une d’elles jeta sur les thrônes de belles couvertures pourprées, et, pardessus, de légères toiles de lin. Une autre dressa devant les thrônes des tables d’argent sur lesquelles elle posa des corbeilles d’or. Une troisième mêla le vin doux et mielleux dans un kratère d’argent et distribua des coupes d’or. La quatrième apporta de l’eau et alluma un grand feu sous un grand trépied, et l’eau chauffa. Et quand l’eau eut chauffé dans l’airain brillant, elle me mit au bain, et elle me lava la tête et les épaules avec l’eau doucement versée du grand trépied. Et quand elle m’eut lavé et parfumé d’huile grasse, elle me revêtit d’une tunique et d’un beau manteau. Puis elle me fit asseoir sur un thrône d’argent bien travaillé, et j’avais un escabeau sous mes pieds. Une servante versa, d’une belle aiguière d’or dans un bassin d’argent, de l’eau pour les mains, et dressa devant moi une table polie. Et la vénérable intendante, bienveillante pour tous, apporta du pain qu’elle plaça sur la table ainsi que beaucoup de mets. Et Kirkè m’invita à manger, mais cela ne plut point à mon âme.
Et j’étais assis, ayant d’autres pensées et prévoyant d’autres maux. Et Kirkè, me voyant assis, sans manger, et plein de tristesse, s’approcha de moi et me dit ces paroles ailées :
– Pourquoi, Odysseus, restes-tu ainsi muet et te rongeant le cœur, sans boire et sans manger ? Crains-tu quelque autre embûche ? Tu ne dois rien craindre, car j’ai juré un grand serment.
Elle parla ainsi, et, lui répondant, je dis :
– Ô Kirkè, quel homme équitable et juste oserait boire et manger, avant que ses compagnons aient été délivrés, et qu’il les ait vus de ses yeux ? Si, dans ta bienveillance, tu veux que je boive et que je mange, délivre mes compagnons et que je les voie.
Je parlai ainsi, et Kirkè sortit de ses demeures, tenant une baguette à la main, et elle ouvrit les portes de l’étable à porcs. Elle en chassa mes compagnons semblables à des porcs de neuf ans. Ils se tenaient devant nous, et, se penchant, elle frotta chacun d’eux d’un autre baume, et de leurs membres tombèrent aussitôt les poils qu’avait fait pousser le poison funeste que leur avait donné la vénérable Kirkè ; et ils redevinrent des hommes plus jeunes qu’ils n’étaient auparavant, plus beaux et plus grands. Et ils me reconnurent, et tous, me serrant la main, pleuraient de joie, et la demeure retentissait de leurs sanglots. Et la déesse elle-même fut prise de pitié. Puis, la noble déesse, s’approchant de moi, me dit :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, va maintenant vers ta nef rapide et le rivage de la mer.
Fais tirer, avant tout, ta nef sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une caverne, et revenez aussitôt, toi-même et tes chers compagnons.
Elle parla ainsi, et mon esprit généreux fut persuadé, et je me hâtai de retourner à ma nef rapide et au rivage de la mer, et je trouvai auprès de ma nef rapide mes chers compagnons gémissant misérablement et versant des larmes abondantes. De même que les génisses, retenues loin de la prairie, s’empressent autour des vaches qui, du pâturage, reviennent à l’étable après s’être rassasiées d’herbes, et vont toutes ensemble au-devant d’elles, sans que les enclos puissent les retenir, et mugissent sans relâche autour de leurs mères ; de même, quand mes compagnons me virent de leurs yeux, ils m’entourèrent en pleurant, et leur cœur fut aussi ému que s’ils avaient revu leur patrie et la ville de l’âpre Ithakè, où ils étaient nés et avaient été nourris. Et, en pleurant, ils me dirent ces paroles ailées :
– À ton retour, ô divin ! nous sommes aussi joyeux que si nous voyions Ithakè et la terre de la patrie. Mais dis-nous comment sont morts nos compagnons.
Ils parlaient ainsi, et je leur répondis par ces douces paroles :
– Avant tout, tirons la nef sur le rivage, et cachons dans une caverne nos richesses et toutes nos armes.
Puis, suivez-moi tous à la hâte, afin de revoir, dans les demeures sacrées de Kirkè, vos compagnons mangeant et buvant et jouissant d’une abondante nourriture.
Je parlai ainsi, et ils obéirent promptement à mes paroles ; mais le seul Eurylokhos tentait de les retenir, et il leur dit ces paroles ailées :
– Ah ! malheureux, où allez-vous ? Vous voulez donc subir les maux qui vous attendent dans les demeures de Kirkè, elle qui nous changera en porcs, en loups et en lions, et dont nous garderons de force la demeure ? Elle fera comme le kyklops, quand nos compagnons vinrent dans sa caverne, conduits par l’audacieux Odysseus. Et ils y ont péri par sa démence.
Il parla ainsi, et je délibérai dans mon esprit si, ayant tiré ma grande épée de sa gaine, le long de la cuisse, je lui couperais la tête et la jetterais sur le sable, malgré notre parenté ; mais tous mes autres compagnons me retinrent par de flatteuses paroles :
– Ô divin ! laissons-le, si tu y consens, rester auprès de la nef et la garder. Nous, nous te suivrons à la demeure sacrée de Kirkè.
Ayant ainsi parlé, ils s’éloignèrent de la nef et de la mer, mais Eurylokhos ne resta point auprès de la nef creuse, et il nous suivit, craignant mes rudes menaces.
Pendant cela, Kirkè, dans ses demeures, baigna et parfuma d’huile mes autres compagnons, et elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux, et nous les trouvâmes tous faisant leur repas dans les demeures. Et quand ils se furent réunis, ils se racontèrent tous leurs maux, les uns aux autres, et ils pleuraient, et la maison retentissait de leurs sanglots. Et la noble déesse, s’approchant, me dit :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, ne vous livrez pas plus longtemps à la douleur. Je sais moi-même combien vous avez subi de maux sur la mer poissonneuse et combien d’hommes injustes vous ont fait souffrir sur la terre. Mais, mangez et buvez, et ranimez votre cœur dans votre poitrine, et qu’il soit tel qu’il était quand vous avez quitté la terre de l’âpre Ithakè, votre patrie. Cependant, jamais vous n’oublierez vos misères, et votre esprit ne sera jamais plus dans la joie, car vous avez subi des maux innombrables.
Elle parla ainsi, et notre cœur généreux lui obéit. Et nous restâmes là toute une année, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Mais, à la fin de l’année, quand les heures eurent accompli leur tour, quand les mois furent passés et quand les longs jours se furent écoulés, alors, mes chers compagnons m’appelèrent et me dirent :
– Malheureux, souviens-toi de ta patrie, si toutefois il est dans ta destinée de survivre et de rentrer dans ta haute demeure et dans la terre de la patrie.
Ils parlèrent ainsi, et mon cœur généreux fut persuadé. Alors, tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, nous restâmes assis, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Et quand Hèlios tomba, et quand la nuit vint, mes compagnons s’endormirent dans la demeure obscure. Et moi, étant monté dans le lit splendide de Kirkè, je saisis ses genoux en la suppliant, et la déesse entendit ma voix. Et je lui dis ces paroles ailées :
– Ô Kirkè, tiens la promesse que tu m’as faite de me renvoyer dans ma demeure, car mon âme me pousse, et mes compagnons affligent mon cher cœur et gémissent autour de moi, quand tu n’es pas là.
Je parlai ainsi, et la noble Déesse me répondit aussitôt :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, vous ne resterez pas plus longtemps malgré vous dans ma demeure ; mais il faut accomplir un autre voyage et entrer dans la demeure d’Aidès et de l’implacable Perséphonéia, afin de consulter l’âme du Thébain Teirésias, du divinateur aveugle, dont l’esprit est toujours vivant. Perséphonéia n’a accordé qu’à ce seul mort l’intelligence et la pensée. Les autres ne seront que des ombres autour de toi.
Elle parla ainsi, et mon cher cœur fut dissous, et je pleurais, assis sur le lit, et mon âme ne voulait plus vivre, ni voir la lumière de Hèlios. Mais, après avoir pleuré et m’être rassasié de douleur, alors, lui répondant, je lui dis :
– Ô Kirkè, qui me montrera le chemin ? Personne n’est jamais arrivé chez Aidés sur une nef noire.
Je parlai ainsi, et la noble déesse me répondit aussitôt :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, n’aie aucun souci pour ta nef. Assieds-toi, après avoir dressé le mât et déployé les blanches voiles ; et le souffle de Boréas conduira ta nef. Mais quand tu auras traversé l’Okéanos, jusqu’au rivage étroit et aux bois sacrés de Perséphonéia, où croissent de hauts peupliers et des saules stériles, alors arrête ta nef dans l’Okéanos aux profonds tourbillons, et descends dans la noire demeure d’Aidès, là où coulent ensemble, dans l’Akhérôn, le Pyriphlégéthôn et le Kokytos qui est un courant de l’eau de Styx. Il y a une roche au confluent des deux fleuves retentissants. Tu t’en approcheras, héros, comme je te l’ordonne, et tu creuseras là une fosse d’une coudée dans tous les sens, et, sur elle, tu feras des libations à tous les morts, de lait mielleux d’abord, puis de vin doux, puis enfin d’eau, et tu répandras par-dessus de la farine blanche. Prie alors les têtes vaines des morts et promets, dès que tu seras rentré dans Ithakè, de sacrifier dans tes demeures la meilleure vache stérile que tu posséderas, d’allumer un bûcher formé de choses précieuses, et de sacrifier, à part, au seul Teirésias un bélier entièrement noir, le plus beau de tes troupeaux. Puis, ayant prié les illustres âmes des morts, sacrifie un mâle et une brebis noire, tourne-toi vers l’Érébos, et, te penchant, regarde dans le cours du fleuve, et les innombrables âmes des morts qui ne sont plus accourront.
Alors, ordonne et commande à tes compagnons d’écorcher les animaux égorgés par l’airain aigu, de les brûler et de les vouer aux dieux, à l’illustre Aidés et à l’implacable Perséphonéia. Tire ton épée aiguë de sa gaine, le long de ta cuisse, et ne permets pas aux ombres vaines des morts de boire le sang, avant que tu aies entendu Teirésias. Aussitôt le divinateur arrivera, ô chef des peuples, et il te montrera ta route et comment tu la feras pour ton retour, et comment tu traverseras la mer poissonneuse.
Elle parla ainsi, et aussitôt Éôs s’assit sur son thrône d’or. Et Kirkè me revêtit d’une tunique et d’un manteau. Elle-même se couvrit d’une longue robe blanche, légère et gracieuse, ceignit ses reins d’une belle ceinture et mit sur sa tête un voile couleur de feu. Et j’allai par la demeure, excitant mes compagnons, et je dis à chacun d’eux ces douces paroles :
– Ne dormez pas plus longtemps, et chassez le doux sommeil, afin que nous partions, car la vénérable Kirkè me l’a permis.
Je parlai ainsi, et leur cœur généreux fut persuadé. Mais je n’emmenai point tous mes compagnons sains et saufs. Elpènôr, un d’eux, jeune, mais ni très brave, ni intelligent, à l’écart de ses compagnons, s’était endormi au faîte des demeures sacrées de Kirkè, ayant beaucoup bu et recherchant la fraîcheur. Entendant le bruit que faisaient ses compagnons, il se leva brusquement, oubliant de descendre par la longue échelle.
Et il tomba du haut du toit, et son cou fut rompu, et son âme descendit chez Aidés. Mais je dis à mes compagnons rassemblés :
– Vous pensiez peut-être que nous partions pour notre demeure et pour la chère terre de la patrie ? Mais Kirkè nous ordonne de suivre une autre route, vers la demeure d’Aidès et de l’implacable Perséphonéia, afin de consulter l’âme du Thébain Teirésias.
Je parlai ainsi, et leur cher cœur fut brisé, et ils s’assirent, pleurant et s’arrachant les cheveux. Mais il n’y a nul remède à gémir. Et nous parvînmes à notre nef rapide et au rivage de la mer, en versant des larmes abondantes. Et, pendant ce temps, Kirkè était venue, apportant dans la nef un bélier et une brebis noire ; et elle s’était aisément cachée à nos yeux car qui pourrait voir un dieu et le suivre de ses yeux, s’il ne le voulait pas ?Chant 11
Étant arrivés à la mer, nous traînâmes d’abord notre nef à la mer divine. Puis, ayant dressé le mât, avec les voiles blanches de la nef noire, nous y portâmes les victimes offertes. Et, nous-mêmes nous y prîmes place, pleins de tristesse et versant des larmes abondantes. Et Kirkè à la belle chevelure, déesse terrible et éloquente, fit souffler pour nous un vent propice derrière la nef à proue bleue, et ce vent, bon compagnon, gonfla la voile.
Toutes choses étant mises en place sur la nef, nous nous assîmes, et le vent et le pilote nous dirigeaient. Et, tout le jour, les voiles de la nef qui courait sur la mer furent déployées, et Hèlios tomba, et tous les chemins s’emplirent d’ombre. Et la nef arriva aux bornes du profond Okéanos.
Là, étaient le peuple et la ville des Kimmériens, toujours enveloppés de brouillards et de nuées ; et jamais le brillant Hèlios ne les regardait de ses rayons, ni quand il montait dans l’Ouranos étoilé, ni quand il descendait de l’Ouranos sur la terre ; mais une affreuse nuit était toujours suspendue sur les misérables hommes. Arrivés là, nous arrêtâmes la nef, et, après en avoir retiré les victimes, nous marchâmes le long du cours d’Okéanos, jusqu’à ce que nous fussions parvenus dans la contrée que nous avait indiquée Kirkè. Et Périmèdès et Eurylokhos portaient les victimes.
Alors je tirai mon épée aiguë de sa gaine, le long de ma cuisse, et je creusai une fosse d’une coudée dans tous les sens, et j’y fis des libations pour tous les morts, de lait mielleux d’abord, puis de vin doux, puis enfin d’eau, et, par-dessus, je répandis la farine blanche.
Et je priai les têtes vaines des morts, promettant, dès que je serais rentré dans Ithakè, de sacrifier dans mes demeures la meilleure vache stérile que je posséderais, d’allumer un bûcher formé de choses précieuses, et de sacrifier à part, au seul Teirésias, un bélier entièrement noir, le plus beau de mes troupeaux. Puis, ayant prié les générations des morts, j’égorgeai les victimes sur la fosse, et le sang noir y coulait. Et les âmes des morts qui ne sont plus sortaient en foule de l’Érébos. Les nouvelles épouses, les jeunes hommes, les vieillards qui ont subi beaucoup de maux, les tendres vierges ayant un deuil dans l’âme, et les guerriers aux armes sanglantes, blessés par les lances d’airain, tous s’amassaient de toutes parts sur les bords de la fosse, avec un frémissement immense. Et la terreur pâle me saisit.
Alors j’ordonnai à mes compagnons d’écorcher les victimes qui gisaient égorgées par l’airain cruel, de les brûler et de les vouer aux dieux, à l’illustre Aidès et à l’implacable Perséphonéia. Et je m’assis, tenant l’épée aiguë tirée de sa gaine, le long de ma cuisse ; et je ne permettais pas aux têtes vaines des morts de boire le sang, avant que j’eusse entendu Teirésias.
La première, vint l’âme de mon compagnon Elpènôr. Et il n’avait point été enseveli dans la vaste terre, et nous avions laissé son cadavre dans les demeures de Kirkè, non pleuré et non enseveli, car un autre souci nous pressait. Et je pleurai en le voyant, et je fus plein de pitié dans le cœur. Et je lui dis ces paroles ailées :
– Elpènôr, comment es-tu venu dans les épaisses ténèbres ? Comment as-tu marché plus vite que moi sur ma nef noire ?
Je parlai ainsi, et il me répondit en pleurant :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, la mauvaise volonté d’un daimôn et l’abondance du vin m’ont perdu. Dormant sur la demeure de Kirkè, je ne songeai pas à descendre par la longue échelle, et je tombai du haut du toit, et mon cou fut rompu, et je descendis chez Aidès. Maintenant, je te supplie par ceux qui sont loin de toi, par ta femme, par ton père qui t’a nourri tout petit, par Tèlémakhos, l’enfant unique que tu as laissé dans tes demeures ! Je sais qu’en sortant de la demeure d’Aidès tu retourneras sur ta nef bien construite à l’île Aiaiè. Là, ô roi, je te demande de te souvenir de moi, et de ne point partir, me laissant non pleuré et non enseveli, de peur que je ne te cause la colère des dieux ; mais de me brûler avec toutes mes armes. Élève sur le bord de la mer écumeuse le tombeau de ton compagnon malheureux. Accomplis ces choses, afin qu’on se souvienne de moi dans l’avenir, et plante sur mon tombeau l’aviron dont je me servais quand j’étais avec mes compagnons.
Il parla ainsi, et, lui répondant, je dis :
– Malheureux, j’accomplirai toutes ces choses.
Nous nous parlions ainsi tristement, et je tenais mon épée au-dessus du sang, tandis que, de l’autre côté de la fosse, mon compagnon parlait longuement.
Puis, arriva l’âme de ma mère morte, d’Antikléia, fille du magnanime Autolykos, que j’avais laissée vivante en partant pour la sainte Ilios. Et je pleurai en la voyant, le cœur plein de pitié ; mais, malgré ma tristesse, je ne lui permis pas de boire le sang avant que j’eusse entendu Teirésias. Et l’âme du Thébain Teirésias arriva, tenant un sceptre d’or, et elle me reconnut et me dit :
– Pourquoi, ô malheureux, ayant quitté la lumière de Hèlios, es-tu venu pour voir les morts et leur pays lamentable ? Mais recule de la fosse, écarte ton épée, afin que je boive le sang, et je te dirai la vérité.
Il parla ainsi, et, me reculant, je remis dans la gaine mon épée aux clous d’argent. Et il but le sang noir, et, alors, l’irréprochable divinateur me dit :
– Tu désires un retour très facile, illustre Odysseus, mais un dieu te le rendra difficile ; car je ne pense pas que celui qui entoure la terre apaise sa colère dans son cœur, et il est irrité parce que tu as aveuglé son fils. Vous arriverez cependant, après avoir beaucoup souffert, si tu veux contenir ton esprit et celui de tes compagnons. En ce temps, quand ta nef solide aura abordé l’île Thrinakiè, où vous échapperez à la sombre mer, vous trouverez là, paissant, les bœufs et les gras troupeaux de Hèlios qui voit et entend tout. Si vous les laissez sains et saufs, si tu te souviens de ton retour, vous parviendrez tous dans Ithakè, après avoir beaucoup souffert ; mais, si tu les blesses, je te prédis la perte de ta nef et de tes compagnons.
Tu échapperas seul, et tu reviendras misérablement, ayant perdu ta nef et tes compagnons, sur une nef étrangère. Et tu trouveras le malheur dans ta demeure et des hommes orgueilleux qui consumeront tes richesses, recherchant ta femme et lui offrant des présents. Mais, certes, tu te vengeras de leurs outrages en arrivant. Et, après que tu auras tué les prétendants dans ta demeure, soit par ruse, soit ouvertement avec l’airain aigu, tu partiras de nouveau, et tu iras, portant un aviron léger, jusqu’à ce que tu rencontres des hommes qui ne connaissent point la mer et qui ne salent point ce qu’ils mangent, et qui ignorent les nefs aux proues rouges et les avirons qui sont les ailes des nefs. Et je te dirai un signe manifeste qui ne t’échappera pas. Quand tu rencontreras un autre voyageur qui croira voir un fléau sur ta brillante épaule, alors, plante l’aviron en terre et fais de saintes offrandes au roi Poseidaôn, un bélier, un taureau et un verrat. Et tu retourneras dans ta demeure, et tu feras, selon leur rang, de saintes hécatombes à tous les dieux immortels qui habitent le large Ouranos. Et la douce mort te viendra de la mer et te tuera consumé d’une heureuse vieillesse, tandis qu’autour de toi les peuples seront heureux. Et je t’ai dit, certes, des choses vraies.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Teirésias, les dieux eux-mêmes, sans doute, ont résolu ces choses. Mais dis-moi la vérité. Je vois l’âme de ma mère qui est morte. Elle se tait et reste loin du sang, et elle n’ose ni regarder son fils, ni lui parler.
Dis-moi, ô roi, comment elle me reconnaîtra.
Je parlai ainsi, et il me répondit :
– Je t’expliquerai ceci aisément. Garde mes paroles dans ton esprit. Tous ceux des morts qui ne sont plus, à qui tu laisseras boire le sang, te diront des choses vraies ; celui à qui tu refuseras cela s’éloignera de toi.
Ayant ainsi parlé, l’âme du roi Teirésias, après avoir rendu ses oracles, rentra dans la demeure d’Aidès ; mais je restai sans bouger jusqu’à ce que ma mère fût venue et eût bu le sang noir. Et aussitôt elle me reconnut, et elle me dit, en gémissant, ces paroles ailées :
– Mon fils, comment es-tu venu sous le noir brouillard, vivant que tu es ? Il est difficile aux vivants de voir ces choses. Il y a entre celles-ci et eux de grands fleuves et des courants violents, Okéanos d’abord qu’on ne peut traverser, à moins d’avoir une nef bien construite. Si, maintenant, longtemps errant en revenant de Troiè, tu es venu ici sur ta nef et avec tes compagnons, tu n’as donc point revu Ithakè, ni ta demeure, ni ta femme ?
Elle parla ainsi, et je lui répondis :
– Ma mère, la nécessité m’a poussé vers les demeures d’Aidès, afin de demander un oracle à l’âme du Thébain Teirésias.
Je n’ai point en effet abordé ni l’Akhaiè, ni notre terre ; mais j’ai toujours erré, plein de misères, depuis le jour où j’ai suivi le divin Agamemnôn à Ilios qui nourrit d’excellents chevaux, afin d’y combattre les Troiens. Mais dis-moi la vérité. Comment la kèr de la cruelle mort t’a-t-elle domptée ? Est-ce par une maladie ? Ou bien Artémis qui se réjouit de ses flèches t’a-t-elle atteinte de ses doux traits ? Parle-moi de mon père et de mon fils. Mes biens sont-ils encore entre leurs mains, ou quelque autre parmi les hommes les possède-t-il ? Tous, certes, pensent que je ne reviendrai plus. Dis-moi aussi les desseins et les pensées de ma femme que j’ai épousée. Reste-t-elle avec son enfant ? Garde-t-elle toutes mes richesses intactes ? ou déjà, l’un des premiers Akhaiens l’a-t-il emmenée ?
Je parlai ainsi, et, aussitôt, ma mère vénérable me répondit :
– Elle reste toujours dans tes demeures, le cœur affligé, pleurant, et consumant ses jours et ses nuits dans le chagrin. Et nul autre ne possède ton beau domaine ; et Tèlémakhos jouit, tranquille, de tes biens, et prend part à de beaux repas, comme il convient à un homme qui rend la justice, car tous le convient. Et ton père reste dans son champ ; et il ne vient plus à la ville, et il n’a plus ni lits moelleux, ni manteaux, ni couvertures luisantes. Mais, l’hiver, il dort avec ses esclaves dans les cendres près du foyer, et il couvre son corps de haillons ; et quand vient l’été, puis l’automne verdoyant, partout, dans sa vigne fertile, on lui fait un lit de feuilles tombées, et il se couche là, triste ; et une grande douleur s’accroît dans son cœur, et il pleure ta destinée, et la dure vieillesse l’accable.
Pour moi, je suis morte, et j’ai subi la destinée ; mais Artémis habile à lancer des flèches ne m’a point tuée de ses doux traits dans ma demeure, et la maladie ne m’a point saisie, elle qui enlève l’âme du corps affreusement flétri ; mais le regret, le chagrin de ton absence, illustre Odysseus, et le souvenir de ta bonté, m’ont privée de la douce vie.
Elle parla ainsi, et je voulus, agité dans mon esprit, embrasser l’âme de ma mère morte. Et je m’élançai trois fois, et mon cœur me poussait à l’embrasser, et trois fois elle se dissipa comme une ombre, semblable à un songe. Et une vive douleur s’accrut dans mon cœur, et je lui dis ces paroles ailées :
– Ma mère, pourquoi ne m’attends-tu pas quand je désire t’embrasser ? Même chez Aidès, nous entourant de nos chers bras, nous nous serions rassasiés de deuil ! N’es-tu qu’une image que l’illustre Perséphonéia suscite afin que je gémisse davantage ?
Je parlai ainsi, et ma mère vénérable me répondit :
– Hélas ! mon enfant, le plus malheureux de tous les hommes, Perséphonéia, fille de Zeus, ne se joue point de toi ; mais telle est la loi des mortels quand ils sont morts. En effet, les nerfs ne soutiennent plus les chairs et les os, et la force du feu ardent les consume aussitôt que la vie abandonne les os blancs, et l’âme vole comme un songe.
Mais retourne promptement à la lumière des vivants, et souviens-toi de toutes ces choses, afin de les redire à Pènélopéia.
Nous parlions ainsi, et les femmes et les filles des héros accoururent, excitées par l’illustre Perséphonéia. Et elles s’assemblaient, innombrables, autour du sang noir. Et je songeais comment je les interrogerais tour à tour ; et il me sembla meilleur, dans mon esprit, de tirer mon épée aiguë de la gaine, le long de ma cuisse, et de ne point leur permettre de boire, toutes à la fois, le sang noir. Et elles approchèrent tour à tour, et chacune disait son origine, et je les interrogeais l’une après l’autre.
Et je vis d’abord Tyrô, née d’un noble père, car elle me dit qu’elle était la fille de l’irréprochable Salmoneus et la femme de Krètheus Aioliade. Et elle aimait le divin fleuve Énipeus, qui est le plus beau des fleuves qui coulent sur la terre ; et elle se promenait le long des belles eaux de l’Énipeus. Sous la figure de ce dernier, celui qui entoure la terre et qui la secoue sortit des bouches du fleuve tourbillonnant ; et une lame bleue, égale en hauteur à une montagne, enveloppa, en se recourbant, le dieu et la femme mortelle. Et il dénoua sa ceinture de vierge, et il répandit sur elle le sommeil. Puis, ayant accompli le travail amoureux, il prit la main de Tyrô et lui dit :
– Réjouis-toi, femme, de mon amour. Dans une année tu enfanteras de beaux enfants, car la couche des immortels n’est point inféconde.
Nourris et élève-les. Maintenant, va vers ta demeure, mais prends garde et ne me nomme pas. Je suis pour toi seule Poseidaôn qui ébranle la terre.
Ayant ainsi parlé, il plongea dans la mer agitée. Et Tyrô, devenue enceinte, enfanta Péliès et Nèleus, illustres serviteurs du grand Zeus. Et Péliès riche en troupeaux habita la grande Iaolkôs, et Nèleus la sablonneuse Pylos. Puis, la reine des femmes conçut de son mari, Aisôn, Phérès et le dompteur de chevaux Hamythaôr.
Puis, je vis Antiopè, fille d’Aisopos, qui se glorifiait d’avoir dormi dans les bras de Zeus. Elle en eut deux fils, Amphiôn et Zèthos, qui, les premiers, bâtirent Thèbè aux sept portes et l’environnèrent de tours. Car ils n’auraient pu, sans ces tours, habiter la grande Thèbè, malgré leur courage.
Puis, je vis Alkmènè, la femme d’Amphitryôn, qui conçut Hèraklès au cœur de lion dans l’embrassement du magnanime Zeus ; puis, Mègarè, fille de l’orgueilleux Krèiôn, et qu’eut pour femme l’Amphitryonade indomptable dans sa force.
Puis, je vis la mère d’Oidipous, la belle Épikastè, qui commit un grand crime dans sa démence, s’étant mariée à son fils. Et celui-ci, ayant tué son père, épousa sa mère. Et les dieux révélèrent ces actions aux hommes. Et Oidipous, subissant de grandes douleurs dans la désirable Thèbè, commanda aux Kadméiones par la volonté cruelle des dieux.
Et Épikastè descendit dans les demeures aux portes solides d’Aidès, ayant attaché, saisie de douleur, une corde à une haute poutre, et laissant à son fils les innombrables maux que font souffrir les Érinnyes d’une mère.
Puis, je vis la belle Khlôris qu’autrefois Nèleus épousa pour sa beauté, après lui avoir offert les présents nuptiaux. Et c’était la plus jeune fille d’Amphiôn laside qui commanda autrefois puissamment sur Orkhomènos Minyèénne et sur Pylos. Et elle conçut de lui de beaux enfants, Nestôr, Khromios et l’orgueilleux Périklyménos. Puis, elle enfanta l’illustre Pèrô, l’admiration des hommes qui la suppliaient tous, voulant l’épouser ; mais Nèleus ne voulait la donner qu’à celui qui enlèverait de Phylakè les bœufs au large front de la Force Iphikléenne. Seul, un divinateur irréprochable le promit ; mais la moire contraire d’un dieu, les rudes liens et les bergers l’en empêchèrent. Cependant, quand les jours et les mois se furent écoulés, et que, l’année achevée, les saisons recommencèrent, alors la force Iphikléenne délivra l’irréprochable divinateur, et le dessein de Zeus s’accomplit.
Puis, je vis Lèdè, femme de Tyndaros. Et elle conçut de Tyndaros des fils excellents, Kastor dompteur de chevaux et Polydeukès formidable par ses poings. La terre nourricière les enferme, encore vivants, et, sous la terre, ils sont honorés par Zeus. Ils vivent l’un après l’autre et meurent de même, et sont également honorés par les dieux.
Puis, je vis Iphimédéia, femme d’Aôleus, et qui disait s’être unie à Poseidaôn. Et elle enfanta deux fils dont la vie fut brève, le héros Otos et l’illustre Éphialtès, et ils étaient les plus grands et les plus beaux qu’eût nourris la terre féconde, après l’illustre Oriôn. Ayant neuf ans, ils étaient larges de neuf coudées, et ils avaient neuf brasses de haut. Et ils menacèrent les immortels de porter dans l’Olympos le combat de la guerre tumultueuse. Et ils tentèrent de poser l’Ossa sur l’Olympos et le Pèlios boisé sur l’Ossa, afin d’atteindre l’Ouranos. Et peut-être eussent-ils accompli leurs menaces, s’ils avaient eu leur puberté ; mais le fils de Zeus, qu’enfanta Lètô aux beaux cheveux, les tua tous deux, avant que le duvet fleurit sur leurs joues et qu’une barbe épaisse couvrît leurs mentons.
Puis, je vis Phaidrè, et Prokris, et la belle Ariadnè, fille du sage Minôs, que Thèseus conduisit autrefois de la Krètè dans la terre sacrée des Athénaiens ; mais il ne le put pas, car Artémis, sur l’avertissement de Dionysos, retint Ariadnè dans Diè entourée des flots.
Puis, je vis Mairè, et Klyménè, et la funeste Ériphylè qui trahit son mari pour de l’or.
Mais je ne pourrais ni vous dire combien je vis de femmes et de filles de héros, ni vous les nommer avant la fin de la nuit divine. Voici l’heure de dormir, soit dans la nef rapide avec mes compagnons, soit ici ; car c’est aux dieux et à vous de prendre soin de mon départ.
Il parla ainsi, et tous restèrent immobiles et pleins de plaisir dans la demeure obscure. Alors, Arètè aux bras blancs parla la première :
– Phaiakiens, que penserons-nous de ce héros, de sa beauté, de sa majesté et de son esprit immuable ? Il est, certes, mon hôte, et c’est un honneur que vous partagez tous. Mais ne vous hâtez point de le renvoyer sans lui faire des présents, car il ne possède rien. Par la bonté des Dieux nous avons beaucoup de richesses dans nos demeures.
Alors, le vieux héros Ekhéneus parla ainsi, et c’était le plus vieux des Phaiakiens :
– Ô amis, la reine prudente nous parle selon le sens droit. Obéissez donc. C’est à Alkinoos de parler et d’agir, et nous l’imiterons.
Et Alkinoos dit :
– Je ne puis parler autrement, tant que je vivrai et que je commanderai aux Phaiakiens habiles dans la navigation. Mais que notre hôte reste, malgré son désir de partir, et qu’il attende le matin, afin que je réunisse tous les présents. Le soin de son retour me regarde plus encore que tous les autres, car je commande pour le peuple.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, si vous m’ordonniez de rester ici toute l’année, tandis que vous prépareriez mon départ et que vous réuniriez de splendides présents, j’y consentirais volontiers ; car il vaudrait mieux pour moi rentrer les mains pleines dans ma chère patrie. J’en serais plus aimé et plus honoré de tous ceux qui me verraient de retour dans Ithakè.
Et Alkinoos lui dit :
– Ô Odysseus, certes, nous ne pouvons te soupçonner d’être un menteur et un voleur, comme tant d’autres vagabonds, que nourrit la noire terre, qui ne disent que des mensonges dont nul ne peut rien comprendre. Mais ta beauté, ton éloquence, ce que tu as raconté, d’accord avec l’Aoide, des maux cruels des Akhaiens et des tiens, tout a pénétré en nous. Dis-moi donc et parle avec vérité, si tu as vu quelques-uns de tes illustres compagnons qui t’ont suivi à Ilios et que la destinée a frappés là. La nuit sera encore longue, et le temps n’est point venu de dormir dans nos demeures. Dis-moi donc tes travaux admirables. Certes, je t’écouterai jusqu’au retour de la divine Éôs, si tu veux nous dire tes douleurs.
Et le subtil Odysseus parla ainsi :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, il y a un temps de parler et un temps de dormir ; mais, si tu désires m’entendre, certes, je ne refuserai pas de raconter les misères et les douleurs de mes compagnons, de ceux qui ont péri auparavant, ou qui, ayant échappé à la guerre lamentable des Troiens, ont péri au retour par la ruse d’une femme perfide.
Après que la vénérable Perséphonéia eut dispersé çà et là les âmes des femmes, survint l’âme pleine de tristesse de l’Atréide Agamemnôn ; et elle était entourée de toutes les âmes de ceux qui avaient subi la destinée et qui avaient péri avec lui dans la demeure d’Aigisthos.
Ayant bu le sang noir, il me reconnut aussitôt, et il pleura, en versant des larmes amères, et il étendit les bras pour me saisir ; mais la force qui était en lui autrefois n’était plus, ni la vigueur qui animait ses membres souples. Et je pleurai en le voyant, plein de pitié dans mon cœur, et je lui dis ces paroles ailées :
– Atréide Agamemnôn, roi des hommes, comment la kèr de la dure mort t’a-t-elle dompté ? Poseidaôn t’a-t-il dompté dans tes nefs en excitant les immenses souffles des vents terribles, ou des hommes ennemis t’ont-ils frappé sur la terre ferme, tandis que tu enlevais leurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis, ou bien que tu combattais pour ta ville et pour tes femmes ?
Je parlai ainsi, et, aussitôt, il me répondit :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, Poseidaôn ne m’a point dompté sur mes nefs, en excitant les immenses souffles des vents terribles, et des hommes ennemis ne m’ont point frappé sur la terre ferme ; mais Aigisthos m’a infligé la kèr et la mort à l’aide de ma femme perfide.
M’ayant convié à un repas dans la demeure, il m’a tué comme un bœuf à l’étable. J’ai subi ainsi une très lamentable mort. Et, autour de moi, mes compagnons ont été égorgés comme des porcs aux dents blanches, qui sont tués dans les demeures d’un homme riche et puissant, pour des noces, des festins sacrés ou des repas de fête. Certes, tu t’es trouvé au milieu du carnage de nombreux guerriers, entouré de morts, dans la terrible mêlée ; mais tu aurais gémi dans ton cœur de voir cela. Et nous gisions dans les demeures, parmi les kratères et les tables chargées, et toute la salle était souillée de sang. Et j’entendais la voix lamentable de la fille de Priamos, Kassandrè, que la perfide Klytaimnestrè égorgeait auprès de moi. Et comme j’étais étendu mourant, je soulevai mes mains vers mon épée ; mais la femme aux yeux de chien s’éloigna et elle ne voulut point fermer mes yeux et ma bouche au moment où je descendais dans la demeure d’Aidès. Rien n’est plus cruel, ni plus impie qu’une femme qui a pu méditer de tels crimes. Ainsi, certes, Klytaimnestrè prépara le meurtre misérable du premier mari qui la posséda, et je péris ainsi, quand je croyais rentrer dans ma demeure, bien accueilli de mes enfants, de mes servantes et de mes esclaves ! Mais cette femme, pleine d’affreuses pensées, couvrira de sa honte toutes les autres femmes futures, et même celles qui auront la sagesse en partage.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Ô dieux ! combien, certes, Zeus qui tonne hautement n’a-t-il point haï la race d’Atreus à cause des actions des femmes !
Déjà, à cause de Hélénè beaucoup d’entre nous sont morts, et Klytaimnestrè préparait sa trahison pendant que tu étais absent.
Je parlai ainsi, et il me répondit aussitôt :
– C’est pourquoi, maintenant, ne sois jamais trop bon envers ta femme, et ne lui confie point toutes tes pensées, mais n’en dis que quelques-unes et cache-lui en une partie. Mais pour toi, Odysseus, ta perte ne te viendra point de ta femme, car la sage fille d’Ikarios, Pènélopéia, est pleine de prudence et de bonnes pensées dans son esprit. Nous l’avons laissée nouvellement mariée quand nous sommes partis pour la guerre, et son fils enfant était suspendu à sa mamelle ; et maintenant celui-ci s’assied parmi les hommes ; et il est heureux, car son cher père le verra en arrivant, et il embrassera son père. Pour moi, ma femme n’a point permis à mes yeux de se rassasier de mon fils, et m’a tué auparavant. Mais je te dirai une autre chose ; garde mon conseil dans ton esprit : Fais aborder ta nef dans la chère terre de la patrie, non ouvertement, mais en secret ; car il ne faut point se confier dans les femmes. Maintenant, parle et dis-moi la vérité. As-tu entendu dire que mon fils fût encore vivant, soit à Orkhoménos, soit dans la sablonneuse Pylos, soit auprès de Ménélaos dans la grande Sparta ? En effet, le divin Orestès n’est point encore mort sur la terre.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Atréide, pourquoi me demandes-tu ces choses ? Je ne sais s’il est mort ou vivant. Il ne faut point parler inutilement.
Et nous échangions ainsi de tristes paroles, affligés et répandant des larmes. Et l’âme du Pèlèiade Akhilleus survint, celle de Patroklos, et celle de l’irréprochable Antilokhos, et celle d’Aias qui était le plus grand et le plus beau de tous les Akhaiens, après l’irréprochable Pèléiôn. Et l’âme du rapide Aiakide me reconnut, et, en gémissant, il me dit ces paroles ailées :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, malheureux, comment as-tu pu méditer quelque chose de plus grand que tes autres actions ? Comment as-tu osé venir chez Aidés où habitent les images vaines des hommes morts ?
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Ô Akhilleus, fils de Pèleus, le plus brave des Akhaiens, je suis venu pour l’oracle de Teirésias, afin qu’il m’apprenne comment je parviendrai dans l’âpre Ithakè, car je n’ai abordé ni l’Akhaiè, ni la terre de ma patrie, et j’ai toujours souffert. Mais toi, Akhilleus, aucun des anciens hommes n’a été, ni aucun des hommes futurs ne sera plus heureux que toi. Vivant, nous, Akhaiens, nous t’honorions comme un dieu, et, maintenant, tu commandes à tous les morts. Tel que te voilà, et bien que mort, ne te plains pas, Akhilleus.
Je parlai ainsi, et il me répondit :
– Ne me parle point de la mort, illustre Odysseus. J’aimerais mieux être un laboureur, et servir, pour un salaire, un homme pauvre et pouvant à peine se nourrir, que de commander à tous les morts qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon illustre fils. Combat-il au premier rang, ou non ? Dis-moi ce que tu as appris de l’irréprochable Pèleus. Possède-t-il encore les mêmes honneurs parmi les nombreux Myrmidones, ou le méprisent-ils dans Hellas et dans la Phthiè, parce que ses mains et ses pieds sont liés par la vieillesse ? En effet, je ne suis plus là pour le défendre, sous la splendeur de Hèlios, tel que j’étais autrefois devant la grande Troiè, quand je domptais les plus braves, en combattant pour les Akhaiens. Si j’apparaissais ainsi, un instant, dans la demeure de mon père, certes, je dompterais de ma force et de mes mains inévitables ceux qui l’outragent ou qui lui enlèvent ses honneurs.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
– Certes, je n’ai rien appris de l’irréprochable Pèleus ; mais je te dirai toute la vérité, comme tu le désires, sur ton cher fils Néoptolémos. Je l’ai conduit moi-même, sur une nef creuse, de l’île Skyros vers les Akhaiens aux belles knèmides. Quand nous convoquions l’agora devant la ville Troiè, il parlait le premier sans se tromper jamais, et l’illustre Nestôr et moi nous luttions seuls contre lui.
Toutes les fois que nous, Akhaiens, nous combattions autour de la ville des Troiens, jamais il ne restait dans la foule des guerriers, ni dans la mêlée ; mais il courait en avant, ne le cédant à personne en courage. Et il tua beaucoup de guerriers dans le combat terrible, et je ne pourrais ni les rappeler, ni les nommer tous, tant il en a tué en défendant les Akhaiens. C’est ainsi qu’il tua avec l’airain le héros Tèléphide Eurypylos ; et autour de celui-ci de nombreux Kètéiens furent tués à cause des présents des femmes. Et Eurypylos était le plus beau des hommes que j’aie vus, après le divin Memnôn. Et quand nous montâmes, nous, les princes des Akhaiens, dans le cheval qu’avait fait Épéios, c’est à moi qu’ils remirent le soin d’ouvrir ou de fermer cette énorme embûche. Et les autres chefs des Akhaiens versaient des larmes, et les membres de chacun tremblaient ; mais lui, je ne le vis jamais ni pâlir, ni trembler, ni pleurer. Et il me suppliait de le laisser sortir du cheval, et il secouait son épée et sa lance lourde d’airain, en méditant la perte des Troiens. Et quand nous eûmes renversé la haute ville de Priamos, il monta, avec une illustre part du butin, sur sa nef, sain et sauf, n’ayant jamais été blessé de l’airain aigu, ni de près ni de loin, comme il arrive toujours dans la guerre, quand Arès mêle furieusement les guerriers.
Je parlai ainsi, et l’âme de l’Aiakide aux pieds rapides s’éloigna, marchant fièrement sur la prairie d’asphodèle, et joyeuse, parce que je lui avais dit que son fils était illustre par son courage.
Et les autres âmes de ceux qui ne sont plus s’avançaient tristement, et chacune me disait ses douleurs ; mais, seule, l’âme du Télamoniade Aias restait à l’écart, irritée à cause de la victoire que j’avais remportée sur lui, auprès des nefs, pour les armes d’Akhilleus. La mère vénérable de l’Aiakide les déposa devant tous, et nos juges furent les fils des Troiens et Pallas Athènè. Plût aux dieux que je ne l’eusse point emporté dans cette lutte qui envoya sous la terre une telle tête, Aias, le plus beau et le plus brave des Akhaiens après l’irréprochable Pèléiôn ! Et je lui adressai ces douces paroles :
– Aias, fils irréprochable de Télamôn, ne devrais-tu pas, étant mort, déposer ta colère à cause des armes fatales que les dieux nous donnèrent pour la ruine des Argiens ? Ainsi, tu as péri, toi qui étais pour eux comme une tour ! Et les Akhaiens ne t’ont pas moins pleuré que le Pèlèiade Akhilleus. Et la faute n’en est à personne. Zeus, seul, dans sa haine pour l’armée des Danaens, t’a livré à la moire. Viens, ô roi, écoute ma prière, et dompte ta colère et ton cœur magnanime.
Je parlai ainsi, mais il ne me répondit rien, et il se mêla, dans l’Érébos, aux autres âmes des morts qui ne sont plus. Cependant, il m’eût parlé comme je lui parlais, bien qu’il fût irrité ; mais j’aimai mieux, dans mon cher cœur, voir les autres âmes des morts.
Et je vis Minôs, l’illustre fils de Zeus, et il tenait un sceptre d’or, et, assis, il jugeait les morts. Et ils s’asseyaient et se levaient autour de lui, pour défendre leur cause, dans la vaste demeure d’Aidès.
Puis, je vis le grand Oriôn chassant, dans la prairie d’asphodèle, les bêtes fauves qu’il avait tuées autrefois sur les montagnes sauvages, en portant dans ses mains la massue d’airain qui ne se brisait jamais.
Puis, je vis Tityos, le fils de l’illustre Gaia, étendu sur le sol et long de neuf plèthres. Et deux vautours, des deux côtés, fouillaient son foie avec leurs becs ; et, de ses mains, il ne pouvait les chasser ; car, en effet, il avait outragé par violence Lètô, l’illustre concubine de Zeus, comme elle allait à Pythô, le long du riant Panopeus.
Et je vis Tantalos, subissant de cruelles douleurs, debout dans un lac qui lui baignait le menton. Et il était là, souffrant la soif et ne pouvant boire. Toutes les fois, en effet, que le vieillard se penchait, dans son désir de boire, l’eau décroissait absorbée, et la terre noire apparaissait autour de ses pieds, et un daimôn la desséchait. Et des arbres élevés laissaient pendre leurs fruits sur sa tête, des poires, des grenades, des oranges, des figues douces et des olives vertes. Et toutes les fois que le vieillard voulait les saisir de ses mains, le vent les soulevait jusqu’aux nuées sombres.
Et je vis Sisyphos subissant de grandes douleurs et poussant un immense rocher avec ses deux mains. Et il s’efforçait, poussant ce rocher des mains et des pieds jusqu’au faîte d’une montagne. Et quand il était près d’atteindre ce faîte, alors la force lui manquait, et l’immense rocher roulait jusqu’au bas. Et il recommençait de nouveau, et la sueur coulait de ses membres, et la poussière s’élevait au-dessus de sa tête.
Et je vis la force Hèrakléenne, ou son image, car lui-même est auprès des dieux immortels, jouissant de leurs repas et possédant Hèbè aux beaux talons, fille du magnanime Zeus et de Hèrè aux sandales d’or. Et, autour de la force Hèrakléenne, la rumeur des morts était comme celle des oiseaux, et ils fuyaient de toutes parts.
Et Hèraklès s’avançait, semblable à la nuit sombre, l’arc en main, la flèche sur le nerf, avec un regard sombre, comme un homme qui va lancer un trait. Un effrayant baudrier d’or entourait sa poitrine, et des images admirables y étaient sculptées, des ours, des sangliers sauvages et des lions terribles, des batailles, des mêlées et des combats tueurs d’hommes, car un très habile ouvrier avait fait ce baudrier. Et, m’ayant vu, il me reconnut aussitôt, et il me dit en gémissant ces paroles ailées :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, sans doute tu es misérable et une mauvaise destinée te conduit, ainsi que moi, quand j’étais sous la clarté de Hèlios.
J’étais le fils du Kroniôn Zeus, mais je subissais d’innombrables misères, opprimé par un homme qui m’était inférieur et qui me commandait de lourds travaux. Il m’envoya autrefois ici pour enlever le chien Kerbéros, et il pensait que ce serait mon plus cruel travail ; mais j’enlevai Kerbéros et je le traînai hors des demeures d’Aidès, car Herméias et Athènè aux yeux clairs m’avaient aidé.
Il parla ainsi, et il rentra dans la demeure d’Aidès. Et moi, je restai là, immobile, afin de voir quelques-uns des hommes héroïques qui étaient morts dans les temps antiques ; et peut-être eussé-je vu les anciens héros que je désirais, Thèseus, Peirithoos, illustres enfants des dieux ; mais l’innombrable multitude des morts s’agita avec un si grand tumulte que la pâle terreur me saisit, et je craignis que l’illustre Perséphonéia m’envoyât, du Hadès, la tête de l’horrible monstre Gorgônien. Et aussitôt je retournai vers ma nef, et j’ordonnai à mes compagnons d’y monter et de détacher le câble. Et aussitôt ils s’assirent sur les bancs de la nef, et le courant emporta celle-ci sur le fleuve Okéanos, à l’aide de la force des avirons et du vent favorable.Chant 12
La nef, ayant quitté le fleuve Okéanos, courut sur les flots de la mer, là où Hèlios se lève, où Éôs, née au matin, a ses demeures et ses chœurs, vers l’île Aiaiè. Étant arrivés là, nous tirâmes la nef sur le sable ; puis, descendant sur le rivage de la mer, nous nous endormîmes en attendant la divine Éôs.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, j’envoyai mes compagnons vers la demeure de Kirkè, afin d’en rapporter le cadavre d’Elpènôr qui n’était plus. Puis, ayant coupé des arbres sur la hauteur du rivage, nous fîmes ses funérailles, tristes et versant d’abondantes larmes. Et quand le cadavre et les armes du mort eurent été brûlés, ayant construit le tombeau surmonté d’une colonne, nous plantâmes l’aviron au sommet. Et ces choses furent faites ; mais, en revenant du Hadès, nous ne retournâmes point chez Kirkè. Elle vint elle-même à la hâte, et, avec elle, vinrent ses servantes qui portaient du pain, des chairs abondantes et du vin rouge. Et la noble déesse au milieu de nous, parla ainsi :
– Malheureux, qui, vivants, êtes descendus dans la demeure d’Aidès, vous mourrez deux fois, et les autres hommes ne meurent qu’une fois. Allons ! mangez et buvez pendant tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios ; et, à la lumière naissante, vous naviguerez, et je vous dirai la route, et je vous avertirai de toute chose, de peur que vous subissiez encore des maux cruels sur la mer ou sur la terre.
Elle parla ainsi, et elle persuada notre âme généreuse. Et, pendant tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, nous restâmes, mangeant les chairs abondantes et buvant le vin doux. Et, quand Hèlios tomba, le soir survint, et mes compagnons s’endormirent auprès des câbles de la nef. Mais Kirkè, me prenant par la main, me conduisit loin de mes compagnons, et, s’étant couchée avec moi, m’interrogea sur les choses qui m’étaient arrivées. Et je lui racontai tout, et, alors, la vénérable Kirkè me dit :
– Ainsi, tu as accompli tous ces travaux. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Un dieu lui-même fera que tu t’en souviennes. Tu rencontreras d’abord les Seirènes qui charment tous les hommes qui les approchent ; mais il est perdu celui qui, par imprudence, écoute leur chant, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure, et ne se réjouiront. Les Seirènes le charment par leur chant harmonieux, assises dans une prairie, autour d’un grand amas d’ossements d’hommes et de peaux en putréfaction. Navigue rapidement au-delà, et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu’aucun d’eux entende. Pour toi, écoute-les, si tu veux ; mais que tes compagnons te lient, à l’aide de cordes, dans la nef rapide, debout contre le mât, par les pieds et les mains, avant que tu écoutes avec une grande volupté la voix des Seirènes. Et, si tu pries tes compagnons, si tu leur ordonnes de te délier, qu’ils te chargent de plus de liens encore.
Après que vous aurez navigué au-delà, je ne puis te dire, des deux voies que tu trouveras, laquelle choisir ; mais tu te décideras dans ton esprit.
Je te les décrirai cependant. Là, se dressent deux hautes roches, et contre elles retentissent les grands flots d’Amphitrite aux yeux bleus. Les dieux heureux les nomment les Errantes. Et jamais les oiseaux ne volent au-delà, pas même les timides colombes qui portent l’ambroisie au père Zeus. Souvent une d’elles tombe sur la roche, mais le père en crée une autre, afin que le nombre en soit complet. Jamais aucune nef, ayant approché ces roches, n’en a échappé ; et les flots de la mer et la tempête pleine d’éclairs emportent les bancs de rameurs et les corps des hommes. Et une seule nef, sillonnant la mer, a navigué au-delà : Argô, chère à tous les dieux, et qui revenait de la terre d’Aiètès. Et même, elle allait être jetée contre les grandes roches, mais Hèrè la fit passer outre, car Jèsôn lui était cher.
Tels sont ces deux écueils. L’un, de son faîte aigu, atteint le haut Ouranos, et une nuée bleue l’environne sans cesse, et jamais la sérénité ne baigne son sommet, ni en été, ni en automne ; et jamais aucun homme mortel ne pourrait y monter ou en descendre, quand il aurait vingt bras et vingt pieds, tant la roche est haute et semblable à une pierre polie. Au milieu de l’écueil il y a une caverne noire dont l’entrée est tournée vers l’Érébos et c’est de cette caverne, illustre Odysseus, qu’il faut approcher ta nef creuse. Un homme dans la force de la jeunesse ne pourrait, de sa nef, lancer une flèche jusque dans cette caverne profonde. Et c’est là qu’habite Skyllè qui pousse des rugissements et dont la voix est aussi forte que celle d’un jeune lion.
C’est un monstre prodigieux, et nul n’est joyeux de l’avoir vu, pas même un Dieu. Elle a douze pieds difformes, et six cous sortent longuement de son corps, et à chaque cou est attachée une tête horrible, et dans chaque gueule pleine de la noire mort il y a une triple rangée de dents épaisses et nombreuses. Et elle est plongée dans la caverne creuse jusqu’aux reins ; mais elle étend au-dehors ses têtes, et, regardant autour de l’écueil, elle saisit les dauphins, les chiens de mer et les autres monstres innombrables qu’elle veut prendre et que nourrit la gémissante Amphitritè. Jamais les marins ne pourront se glorifier d’avoir passé auprès d’elle sains et saufs sur leur nef, car chaque tête enlève un homme hors de la nef à proue bleue. L’autre écueil voisin que tu verras, Odysseus, est moins élevé, et tu en atteindrais le sommet d’un trait. Il y croit un grand figuier sauvage chargé de feuilles, et, sous ce figuier, la divine Kharybdis engloutit l’eau noire. Et elle la revomit trois fois par jour et elle l’engloutit trois fois horriblement. Et si tu arrivais quand elle l’engloutit, celui qui ébranle la terre, lui-même, voudrait te sauver, qu’il ne le pourrait pas. Pousse donc rapidement ta nef le long de Skyllè, car il vaut mieux perdre six hommes de tes compagnons, que de les perdre tous.
Elle parla ainsi, et je lui répondis :
– Parle, déesse, et dis-moi la vérité. Si je puis échapper à la désastreuse Kharybdis, ne pourrai-je attaquer Skyllè, quand elle saisira mes compagnons ?
Je parlai ainsi, et la noble Déesse me répondit :
– Malheureux, tu songes donc encore aux travaux de la guerre ? Et tu ne veux pas céder, même aux dieux immortels ! Mais Skyllè n’est point mortelle, et c’est un monstre cruel, terrible et sauvage, et qui ne peut être combattu. Aucun courage ne peut en triompher. Si tu ne te hâtes point, ayant saisi tes armes près de la roche, je crains que, se ruant de nouveau, elle emporte autant de têtes qu’elle a déjà enlevé d’hommes. Vogue donc rapidement, et invoque Krataïs, mère de Skyllè, qui l’a enfantée pour la perte des hommes, afin qu’elle l’apaise, et que celle-ci ne se précipite point de nouveau.
Tu arriveras ensuite à l’île Thrinakiè. Là, paissent les bœufs et les gras troupeaux de Hèlios. Et il a sept troupeaux de bœufs et autant de brebis, cinquante par troupeau. Et ils ne font point de petits, et ils ne meurent point, et leurs pasteurs sont deux nymphes divines, Phaéthousa et Lampétiè, que la divine Néaira a conçues du Hypérionide Hèlios. Et leur mère vénérable les enfanta et les nourrit, et elle les laissa dans l’île Thrinakiè, afin qu’elles habitassent au loin, gardant les brebis paternelles et les bœufs aux cornes recourbées. Si, songeant à ton retour, tu ne touches point à ces troupeaux, vous rentrerez tous dans Ithakè, après avoir beaucoup souffert ; mais si tu les blesses, alors je te prédis la perte de ta nef et de tes compagnons. Et tu échapperas seul, mais tu rentreras tard et misérablement dans ta demeure, ayant perdu tous tes compagnons.
Elle parla ainsi, et aussitôt Éôs s’assit sur son thrône d’or, et la noble déesse Kirkè disparut dans l’île. Et, retournant vers ma nef, j’excitai mes compagnons à y monter et à détacher les câbles. Et ils montèrent aussitôt, et ils s’assirent en ordre sur les bancs, et ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Kirkè aux beaux cheveux, terrible et vénérable déesse, envoya derrière la nef à proue bleue un vent favorable qui emplit la voile ; et, toutes choses étant mises en place sur la nef, nous nous assîmes, et le vent et le pilote nous conduisirent. Alors, triste dans le cœur, je dis à mes compagnons :
– Ô amis, il ne faut pas qu’un seul, et même deux seulement d’entre nous, sachent ce que m’a prédit la noble déesse Kirkè ; mais il faut que nous le sachions tous, et je vous le dirai. Nous mourrons après, ou, évitant le danger, nous échapperons à la mort et à la kèr. Avant tout, elle nous ordonne de fuir le chant et la prairie des divines Seirènes, et à moi seul elle permet de les écouter ; mais liez-moi fortement avec des cordes, debout contre le, mât, afin que j’y reste immobile, et, si je vous supplie et vous ordonne de me délier, alors, au contraire, chargez-moi de plus de liens.
Et je disais cela à mes compagnons, et, pendant ce temps, la nef bien construite approcha rapidement de l’île des Seirènes, tant le vent favorable nous poussait ; mais il s’apaisa aussitôt, et il fit silence, et un daimôn assoupit les flots. Alors, mes compagnons, se levant, plièrent les voiles et les déposèrent dans la nef creuse ; et, s’étant assis, ils blanchirent l’eau avec leurs avirons polis.
Et je coupai, à l’aide de l’airain tranchant, une grande masse ronde de cire, dont je pressai les morceaux dans mes fortes mains ; et la cire s’amollit, car la chaleur du roi Hèlios était brûlante, et j’employais une grande force. Et je fermai les oreilles de tous mes compagnons. Et, dans la nef, ils me lièrent avec des cordes, par les pieds et les mains, debout contre le mât. Puis, s’asseyant, ils frappèrent de leurs avirons la mer écumeuse.
Et nous approchâmes à la portée de la voix, et la nef rapide, étant proche, fut promptement aperçue par les Seirènes, et elles chantèrent leur chant harmonieux :
– Viens, ô illustre Odysseus, grande gloire des Akhaiens. Arrête ta nef, afin d’écouter notre voix. Aucun homme n’a dépassé notre île sur sa nef noire sans écouter notre douce voix ; puis, il s’éloigne, plein de joie, et sachant de nombreuses choses. Nous savons, en effet, tout ce que les Akhaiens et les Troiens ont subi devant la grande Troiè par la volonté des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière.
Elles chantaient ainsi, faisant résonner leur belle voix, et mon cœur voulait les entendre ; et, en remuant les sourcils, je fis signe à mes compagnons de me détacher ; mais ils agitaient plus ardemment les avirons ; et, aussitôt, Périmèdès et Eurylokhos, se levant, me chargèrent de plus de liens.
Après que nous les eûmes dépassées et que nous n’entendîmes plus leur voix et leur chant, mes chers compagnons retirèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent ; mais, à peine avions-nous laissé l’île, que je vis de la fumée et de grands flots et que j’entendis un bruit immense. Et mes compagnons, frappés de crainte, laissèrent les avirons tomber de leurs mains. Et le courant emportait la nef, parce qu’ils n’agitaient plus les avirons. Et moi, courant çà et là, j’exhortai chacun d’eux par de douces paroles :
– Ô amis, nous n’ignorons pas les maux. N’avons nous pas enduré un mal pire quand le kyklôps nous tenait renfermés dans sa caverne creuse avec une violence horrible ? Mais, alors, par ma vertu, par mon intelligence et ma sagesse, nous lui avons échappé. Je ne pense pas que vous l’ayez oublié. Donc, maintenant, faites ce que je dirai ; obéissez tous. Vous, assis sur les bancs, frappez de vos avirons les flots profonds de la mer ; et toi, pilote, je t’ordonne ceci, retiens-le dans ton esprit, puisque tu tiens le gouvernail de la nef creuse. Dirige-la en dehors de cette fumée et de ce courant, et gagne cet autre écueil. Ne cesse pas d’y tendre avec vigueur, et tu détourneras notre perte.
Je parlai ainsi, et ils obéirent promptement à mes paroles ; mais je ne leur dis rien de Skyllè, cette irrémédiable tristesse, de peur qu’épouvantés, ils cessassent de remuer les avirons, pour se cacher tous ensemble dans le fond de la nef. Et alors j’oubliai les ordres cruels de Kirkè qui m’avait recommandé de ne point m’armer.
Et, m’étant revêtu de mes armes splendides, et, ayant pris deux, longues lances, je montai sur la proue de la nef d’où je croyais apercevoir d’abord la rocheuse Skyllè apportant la mort à mes compagnons. Mais je ne pus la voir, mes yeux se fatiguaient à regarder de tous les côtés de la roche noire.
Et nous traversions ce détroit en gémissant. D’un côté était Skyllè ; et, de l’autre, la divine Kharybdis engloutissait l’horrible eau salée de la mer ; et, quand elle la revomissait, celle-ci bouillonnait comme dans un bassin sur un grand feu, et elle la lançait en l’air, et l’eau pleuvait sur les deux écueils. Et, quand elle engloutissait de nouveau l’eau salée de la mer, elle semblait bouleversée jusqu’au fond, et elle rugissait affreusement autour de la roche ; et le sable bleu du fond apparaissait, et la pâle terreur saisit mes compagnons. Et nous regardions Kharybdis, car c’était d’elle que nous attendions notre perte ; mais, pendant ce temps, Skyllè enleva de la nef creuse six de mes plus braves compagnons. Et, comme je regardais sur la nef, je vis leurs pieds et leurs mains qui passaient dans l’air ; et ils m’appelaient dans leur désespoir.
De même qu’un pêcheur, du haut d’un rocher, avec une longue baguette, envoie dans la mer, aux petits poissons, un appât enfermé dans la corne d’un bœuf sauvage, et jette chaque poisson qu’il a pris, palpitant, sur le rocher ; de même Skyllè emportait mes compagnons palpitants et les dévorait sur le seuil, tandis qu’ils poussaient des cris et qu’ils tendaient vers moi leurs mains.
Et c’était la chose la plus lamentable de toutes celles que j’aie vues dans mes courses sur la mer.
Après avoir fui l’horrible Kharybdis et Skyllè, nous arrivâmes à l’île irréprochable du dieu. Et là étaient les bœufs irréprochables aux larges fronts et les gras troupeaux du Hypérionide Hèlios. Et comme j’étais encore en mer, sur la nef noire, j’entendis les mugissements des bœufs dans les étables et le bêlement des brebis ; et la parole du divinateur aveugle, du Thébain Teirésias, me revint à l’esprit, et Kirkè aussi qui m’avait recommandé d’éviter l’île de Hèlios qui charme les hommes. Alors, triste dans mon cœur, je parlai ainsi à mes compagnons :
– Écoutez mes paroles, compagnons, bien qu’accablés de maux, afin que je vous dise les oracles de Teirésias et de Kirkè qui m’a recommandé de fuir promptement l’île de Hèlios qui donne la lumière aux hommes. Elle m’a dit qu’un grand malheur nous menaçait ici. Donc, poussez la nef noire au-delà de cette île.
Je parlai ainsi, et leur cher cœur fut brisé. Et, aussitôt, Eurylokhos me répondit par ces paroles funestes :
– Tu es dur pour nous, ô Odysseus ! Ta force est grande, et tes membres ne sont jamais fatigués, et tout te semble de fer. Tu ne veux pas que tes compagnons, chargés de fatigue et de sommeil, descendent à terre, dans cette île entourée des flots où nous aurions préparé un repas abondant ; et tu ordonnes que nous errions à l’aventure, pendant la nuit rapide, loin de cette île, sur la sombre mer !
Les vents de la nuit sont dangereux et perdent les nefs. Qui de nous éviterait la kèr fatale, si, soudainement, survenait une tempête du Notos ou du violent Zéphyros qui perdent le plus sûrement les nefs, même malgré les dieux ? Maintenant donc, obéissons à la nuit noire, et préparons notre repas auprès de la nef rapide. Nous y remonterons demain, au matin, et nous fendrons la vaste mer.
Eurylokhos parla ainsi, et mes compagnons l’approuvèrent. Et je vis sûrement qu’un daimôn méditait leur perte. Et je lui dis ces paroles ailées :
– Eurylokhos, vous me faites violence, car je suis seul ; mais jure-moi, par un grand serment, que, si nous trouvons quelque troupeau de bœufs ou de nombreuses brebis, aucun de vous, de peur de commettre un crime, ne tuera ni un bœuf, ni une brebis. Mangez tranquillement les vivres que nous a donnés l’immortelle Kirkè.
Je parlai ainsi, et, aussitôt, ils me le jurèrent comme je l’avais ordonné. Et, après qu’ils eurent prononcé toutes les paroles du serment, nous arrêtâmes la nef bien construite, dans un port profond, auprès d’une eau douce ; et mes compagnons sortirent de la nef et préparèrent à la hâte leur repas. Puis, après s’être rassasiés de boire et de manger, ils pleurèrent leurs chers compagnons que Skyllè avait enlevés de la nef creuse et dévorés. Et, tandis qu’ils pleuraient, le doux sommeil les saisit.
Mais, vers la troisième partie de la nuit, à l’heure où les astres s’inclinent, Zeus qui amasse les nuées excita un vent violent, avec de grands tourbillons ; et il enveloppa la terre et la mer de brouillards, et l’obscurité tomba de l’Ouranos.
Et quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, nous traînâmes la nef à l’abri dans une caverne profonde. Là étaient les belles demeures des nymphes et leurs sièges. Et alors, ayant réuni l’agora, je parlai ainsi :
– Ô amis, il y a dans la nef rapide à boire et à manger. Abstenons-nous donc de ces bœufs, de peur d’un grand malheur. En effet, ce sont les bœufs terribles et les illustres troupeaux d’un dieu, de Hèlios, qui voit et entend tout.
Je parlai ainsi, et leur esprit généreux fut persuadé. Et, tout un mois, le Notos souffla perpétuellement ; et aucun des autres vents ne soufflait, que le Notos et l’Euros. Et aussi longtemps que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils s’abstinrent des bœufs qu’ils désiraient vivement ; mais quand tous les vivres furent épuisés, la nécessité nous contraignant, nous fîmes, à l’aide d’hameçons recourbés, notre proie des poissons et des oiseaux qui nous tombaient entre les mains. Et la faim tourmentait notre ventre.
Alors, je m’enfonçai dans l’île, afin de supplier les dieux, et de voir si un d’entre eux me montrerait le chemin du retour. Et j’allai dans l’île, et, laissant mes compagnons, je lavai mes mains à l’abri du vent, et je suppliai tous les dieux qui habitent le large Olympos.
Et ils répandirent le doux sommeil sur mes paupières. Alors, Eurylokhos inspira à mes compagnons un dessein fatal :
– Écoutez mes paroles, compagnons, bien que souffrant beaucoup de maux. Toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes, mais mourir par la faim est tout ce qu’il y a de plus lamentable. Allons ! saisissons les meilleurs bœufs de Hèlios, et sacrifions-les aux immortels qui habitent le large Ouranos. Si nous rentrons dans Ithakè, dans la terre de la patrie, nous élèverons aussitôt à Hèlios un beau temple où nous placerons toute sorte de choses précieuses ; mais, s’il est irrité à cause de ses bœufs aux cornes dressées, et s’il veut perdre la nef, et si les autres dieux y consentent, j’aime mieux mourir en une fois, étouffé par les flots, que de souffrir plus longtemps dans cette île déserte.
Eurylokhos parla ainsi, et tous l’applaudirent. Et, aussitôt, ils entraînèrent les meilleurs bœufs de Hèlios, car les bœufs noirs au large front paissaient non loin de la nef à proue bleue. Et, les entourant, ils les vouèrent aux immortels ; et ils prirent les feuilles d’un jeune chêne, car ils n’avaient point d’orge blanche dans la nef. Et, après avoir prié, ils égorgèrent les bœufs et les écorchèrent ; puis, ils rôtirent les cuisses recouvertes d’une double graisse, et ils posèrent par-dessus les entrailles crues. Et, n’ayant point de vin pour faire les libations sur le feu du sacrifice, ils en firent avec de l’eau, tandis qu’ils rôtissaient les entrailles.
Quand les cuisses furent consumées, ils goûtèrent les entrailles. Puis, ayant coupé le reste en morceaux, ils les traversèrent de broches.
Alors, le doux sommeil quitta mes paupières, et je me hâtai de retourner vers la mer et vers la nef rapide. Mais quand je fus près du lieu où celle-ci avait été poussée, la douce odeur vint au-devant de moi. Et, gémissant, je criai vers les dieux immortels :
– Père Zeus, et vous, dieux heureux et immortels, certes, c’est pour mon plus grand malheur que vous m’avez envoyé ce sommeil fatal. Voici que mes compagnons, restés seuls ici, ont commis un grand crime.
Aussitôt, Lampétiè au large péplos alla annoncer à Hèlios Hypérionide que mes compagnons avaient tué ses bœufs, et le Hypérionide, irrité dans son cœur, dit aussitôt aux autres dieux :
– Père Zeus, et vous, dieux heureux et immortels, vengez-moi des compagnons du Laertiade Odysseus. Ils ont tué audacieusement les bœufs dont je me réjouissais quand je montais à travers l’Ouranos étoilé, et quand je descendais de l’Ouranos sur la terre. Si vous ne me donnez pas une juste compensation pour mes bœufs, je descendrai dans la demeure d’Aidès, et j’éclairerai les morts.
Et Zeus qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi :
– Hèlios, éclaire toujours les immortels et les hommes mortels sur la terre féconde. Je brûlerai bientôt de la blanche foudre leur nef fracassée au milieu de la sombre mer.
Et j’appris cela de Kalypsô aux beaux cheveux, qui le savait du messager Herméias.
Étant arrivé à la mer et à ma nef, je fis des reproches violents à chacun de mes compagnons ; mais nous ne pouvions trouver aucun remède au mal, car les bœufs étaient déjà tués. Et déjà les prodiges des dieux s’y manifestaient : les peaux rampaient comme des serpents, et les chairs mugissaient autour des broches, cuites ou crues, et on eût dit les voix des bœufs eux-mêmes. Et, pendant six jours, mes chers compagnons mangèrent les meilleurs bœufs de Hèlios, les ayant tués. Quand Zeus amena le septième jour, le vent cessa de souffler par tourbillons. Alors, étant montés sur la nef, nous la poussâmes au large ; et, le mât étant dressé, nous déployâmes les blanches voiles. Et nous abandonnâmes l’île, et aucune autre terre n’était en vue, et rien ne se voyait que l’Ouranos et la mer.
Alors le Kroniôn suspendit une nuée épaisse sur la nef creuse qui ne marchait plus aussi vite, et, sous elle, la mer devint toute noire. Et aussitôt le strident Zéphyros souffla avec un grand tourbillon, et la tempête rompit les deux câbles du mât, qui tomba dans le fond de la nef avec tous les agrès.
Et il s’abattit sur la poupe, brisant tous les os de la tête du pilote, qui tomba de son banc, semblable à un plongeur. Et son âme généreuse abandonna ses ossements. En même temps, Zeus tonna et lança la foudre sur la nef, et celle-ci, frappée de la foudre de Zeus, tourbillonna et s’emplit de soufre, et mes compagnons furent précipités. Semblables à des corneilles marines, ils étaient emportés par les flots, et un dieu leur refusa le retour. Moi, je marchai sur la nef jusqu’à ce que la force de la tempête eût arraché ses flancs. Et les flots l’emportaient, inerte, çà et là. Le mât avait été rompu à la base, mais une courroie de peau de bœuf y était restée attachée. Avec celle-ci je le liai à la carène, et, m’asseyant dessus, je fus emporté par la violence des vents.
Alors, il est vrai, le Zéphyros apaisa ses tourbillons, mais le Notos survint, m’apportant d’autres douleurs, car, de nouveau, j’étais entraîné vers la funeste Kharybdis. Je fus emporté toute la nuit, et, au lever de Hèlios, j’arrivai auprès de Skyllè et de l’horrible Kharybdis, comme celle-ci engloutissait l’eau salée de la mer. Et je saisis les branches du haut figuier, et j’étais suspendu en l’air comme un oiseau de nuit, ne pouvant appuyer les pieds, ni monter, car les racines étaient loin, et les rameaux immenses et longs ombrageaient Kharybdis ; mais je m’y attachai fermement, jusqu’à ce qu’elle eût revomi le mât et la carène. Et ils tardèrent longtemps pour mes désirs.
À l’heure où le juge, afin de prendre son repas, sort de l’agora où il juge les nombreuses contestations des hommes, le mât et la carène rejaillirent de Kharybdis ; et je me laissai tomber avec bruit parmi les longues pièces de bois et, m’asseyant dessus, je nageai avec mes mains pour avirons. Et le père des dieux et des hommes ne permit pas à Skyllè de me voir, car je n’aurais pu échapper à la mort. Et je fus emporté pendant neuf jours, et, la dixième nuit, les dieux me poussèrent à l’île Ogygiè, qu’habitait Kalypsô, éloquente et vénérable déesse aux beaux cheveux, qui me recueillit et qui m’aima. Mais pourquoi te dirais-je ceci ? Déjà je te l’ai raconté dans ta demeure, à toi et à ta chaste femme ; et il m’est odieux de raconter de nouveau les mêmes choses.Chant 13
Il parla ainsi, et tous, dans les demeures obscures, restaient muets et charmés. Et Alkinoos lui répondit :
– Ô Odysseus, puisque tu es venu dans ma haute demeure d’airain, je ne pense pas que tu erres de nouveau et que tu subisses d’autres maux pour ton retour, car tu en as beaucoup souffert. Et je dis ceci à chacun de vous qui, dans mes demeures, buvez l’honorable vin rouge et qui écoutez l’aoide. Déjà sont enfermés dans le beau coffre les vêtements, et l’or bien travaillé, et tous les présents que les chefs des Phaiakiens ont offerts à notre hôte ; mais, allons ! que chacun de nous lui donne encore un grand trépied et un bassin. Réunis de nouveau, nous nous ferons aider par tout le peuple, car il serait difficile à chacun de nous de donner autant.
Alkinoos parla ainsi, et ses paroles plurent à tous, et chacun retourna dans sa demeure pour y dormir.
Quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, ils se hâtèrent vers la nef, portant l’airain solide. Et la force sacrée d’Alkinoos déposa les présents dans la nef ; et il les rangea lui-même sous les bancs des rameurs, afin que ceux-ci, en se courbant sur les avirons, ne les heurtassent point. Puis, ils retournèrent vers les demeures d’Alkinoos et préparèrent le repas.
Au milieu d’eux, la force sacrée d’Alkinoos égorgea un bœuf pour Zeus Kronide qui amasse les nuées et qui commande à tous.
Et ils brûlèrent les cuisses, et ils prirent, charmés, l’illustre repas ; et au milieu d’eux chantait le divin aoide Dèmodokos, honoré des peuples. Mais Odysseus tournait souvent la tête vers Hèlios qui éclaire toutes choses, pressé de se rendre à la nef, et désirant son départ. De même que le laboureur désire son repas, quand tout le jour ses bœufs noirs ont traîné la charrue dans le sillon, et qu’il voit enfin la lumière de Hèlios tomber, et qu’il se rend à son repas, les genoux rompus de fatigue ; de même Odysseus vit tomber avec joie la lumière de Hèlios, et, aussitôt, il dit aux Phaiakiens habiles aux avirons, et surtout à Alkinoos :
– Roi Alkinoos, le plus illustre de tout le peuple, renvoyez-moi sain et sauf, et faites des libations. Je vous salue tous. Déjà ce que désirait mon cher cœur est accompli ; mon retour est décidé, et je possède vos chers présents dont les dieux Ouraniens m’ont fait une richesse. Plaise aux dieux que je retrouve dans ma demeure ma femme irréprochable et mes amis sains et saufs ! Pour vous, qui vous réjouissez ici de vos femmes et de vos chers enfants, que les dieux vous donnent la vertu et vous préservent de tout malheur public !
Il parla ainsi, et tous l’applaudirent et décidèrent de renvoyer leur hôte qui parlait toujours si convenablement. Et, alors, la force d’Alkinoos dit au héraut :
– Pontonoos, distribue, du kratère plein, du vin à tous, dans la demeure, afin qu’ayant prié le Père peus, nous renvoyions notre hôte dans sa patrie.
Il parla ainsi, et Pontonoos mêla le vin mielleux et le distribua à tous. Et ils firent des libations aux dieux heureux qui habitent le large Ouranos, mais sans quitter leurs sièges.
Et le divin Odysseus se leva. Et, mettant aux mains d’Arètè une coupe ronde, il dit ces paroles ailées :
– Salut, ô reine ! et sois heureuse jusqu’à ce que t’arrivent la vieillesse et la mort qui sont inévitables pour les hommes. Moi, je pars. Toi, réjouis-toi, dans ta demeure, de tes enfants, de tes peuples et du roi Alkinoos.
Ayant ainsi parlé, le divin Odysseus sortit, et la force d’Alkinoos envoya le héraut pour le précéder vers la nef rapide et le rivage de la mer. Et Arètè envoya aussi ses servantes, et l’une portait une blanche khlamide et une tunique, et l’autre un coffre peint, et une troisième du pain et du vin rouge.
Etant arrivés à la nef et à la mer, aussitôt les marins joyeux montèrent sur la nef creuse et y déposèrent le vin et les vivres. Puis ils étendirent sur la poupe de la nef creuse un lit et une toile de lin, afin qu’Odysseus fût mollement couché. Et il entra dans la nef, et il se coucha en silence. Et, s’étant assis en ordre sur les bancs, ils détachèrent le câble de la pierre trouée ; puis, se courbant, ils frappèrent la mer de leurs avirons. Et un doux sommeil se répandit sur les paupières d’Odysseus, invincible, très agréable et semblable à la mort.
De même que, dans une plaine, un quadrige d’étalons, excité par les morsures du fouet, dévore rapidement la route, de même la nef était enlevée, et l’eau noire et immense de la mer sonnante se ruait par derrière. Et la nef courait ferme et rapide, et l’épervier, le plus rapide des oiseaux, n’aurait pu la suivre. Ainsi, courant avec vitesse, elle fendait les eaux de la mer, portant un homme ayant des pensées égales à celles des dieux, et qui, en son âme, avait subi des maux innombrables, dans les combats des hommes et sur les mers dangereuses. Et maintenant il dormait en sûreté, oublieux de tout ce qu’il avait souffert.
Et quand la plus brillante des étoiles se leva, celle qui annonce la lumière d’Éôs née au matin, alors la nef qui fendait la mer aborda l’île.
Le port de Phorkys, vieillard de la mer, est sur la côte d’Ithakè. Deux promontoires abrupts l’enserrent et le défendent des vents violents et des grandes eaux ; et les nefs à bancs de rameurs, quand elles y sont entrées, y restent sans câbles. À la pointe du port, un olivier aux rameaux épais croit devant l’antre obscur, frais et sacré, des nymphes qu’on nomme naiades. Dans cet antre il y a des kratères et des amphores de pierre où les abeilles font leur miel, et de longs métiers à tisser où les nymphes travaillent des toiles pourprées admirables à voir. Et là sont aussi des sources inépuisables. Et il y a deux entrées, l’une, pour les hommes, vers le Boréas, et l’autre, vers le Notos, pour les dieux.
Et jamais les hommes n’entrent par celle-ci, mais seulement les dieux.
Et dès que les Phaiakiens eurent reconnu ce lieu, ils y abordèrent. Et une moitié de la nef s’élança sur la plage, tant elle était vigoureusement poussée par les bras des rameurs. Et ceux-ci, étant sortis de la nef à bancs de rameurs, transportèrent d’abord Odysseus hors de la nef creuse, et, avec lui, le lit brillant et la toile de lin ; et ils le déposèrent endormi sur le sable. Et ils transportèrent aussi les choses que lui avaient données les illustres Phaiakiens à son départ, ayant été inspirés par la magnanime Athènè. Et ils les déposèrent donc auprès des racines de l’olivier, hors du chemin, de peur qu’un passant y touchât avant le réveil d’Odysseus. Puis, ils retournèrent vers leurs demeures.
Mais celui qui ébranle la terre n’avait point oublié les menaces qu’il avait faites au divin Odysseus, et il interrogea la pensée de Zeus :
– Père Zeus, je ne serai plus honoré par les dieux immortels, puisque les Phaiakiens ne m’honorent point, eux qui sont cependant de ma race. En effet, je voulais qu’Odysseus souffert encore beaucoup de maux avant de rentrer dans sa demeure, mais je ne lui refusais point entièrement le retour, puisque tu l’as promis et juré. Et voici qu’ils l’ont conduit sur la mer, dormant dans leur nef rapide, et qu’ils l’ont déposé dans Ithakè.
Et ils l’ont comblé de riches présents, d’airain, d’or et de vêtements tissés, si nombreux, qu’Odysseus n’en eût jamais rapporté autant de Troiè, s’il en était revenu sain et sauf, avec sa part du butin.
Et Zeus qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi :
– Ô dieu ! toi qui entoures la terre, qu’as-tu dit ? Les immortels ne te mépriseront point, car il serait difficile de mépriser le plus ancien et le plus illustre des dieux ; mais si quelque mortel, inférieur en force et en puissance, ne te respecte point, ta vengeance ne sera pas tardive. Fais comme tu le veux et comme il te plaira.
Et Poseidaôn qui ébranle la terre lui répondit :
– Je le ferai aussitôt, ainsi que tu le dis, toi qui amasses les nuées, car j’attends ta volonté et je la respecte. Maintenant, je veux perdre la belle nef des Phaiakiens, qui revient de son voyage sur la mer sombre, afin qu’ils s’abstiennent désormais de reconduire les étrangers ; et je placerai une grande montagne devant leur ville.
Et Zeus qui amasse les nuées lui répondit :
– Ô Poseidaôn, il me semble que ceci sera pour le mieux. Quand la multitude sortira de la ville pour voir la nef, transforme, près de terre, la nef rapide en un rocher, afin que tous les hommes l’admirent, et place une grande montagne devant leur ville.
Et Poseidaôn qui ébranle la terre, ayant entendu cela, s’élança vers Skhériè, où habitaient les Phaiàkiens. Et comme la nef, vigoureusement poussée, arrivait, celui qui ébranle la terre, la frappant de sa main, la transforma en rocher aux profondes racines, et s’éloigna. Et les Phaiakiens illustres par les longs avirons se dirent les uns aux autres :
– O dieux ! qui donc a fixé notre nef rapide dans la mer, comme elle revenait vers nos demeures ?
Chacun parlait ainsi, et ils ne comprenaient pas comment cela s’était fait. Mais Alkinoos leur dit :
– O dieux ! Certes, voici que les anciens oracles de mon père se sont accomplis, car il me disait que Poseidaôn s’irriterait contre nous, parce que nous reconduisions tous les étrangers sains et saufs. Et il me dit qu’une belle nef des Phaiakiens se perdrait à son retour d’un voyage sur la sombre mer, et qu’une grande montagne serait placée devant notre ville. Ainsi parla le vieillard, et les choses se sont accomplies. Allons ! faites ce que je vais dire. Ne reconduisons plus les étrangers, quel que soit celui d’entre eux qui vienne vers notre ville. Faisons un sacrifice de douze taureaux choisis à Poseidaôn, afin qu’il nous prenne en pitié et qu’il ne place point cette grande montagne devant notre ville.
Il parla ainsi, et les Phaiakiens craignirent, et ils préparèrent les taureaux. Et les peuples, les chefs et les princes des Phaiakiens suppliaient le roi Poseidaôn, debout autour de l’autel.
Mais le divin Odysseus se réveilla couché sur la terre de la patrie, et il ne la reconnut point, ayant été longtemps éloigné. Et la déesse Pallas Athènè l’enveloppa d’une nuée, afin qu’il restât inconnu et qu’elle l’instruisît de toute chose, et que sa femme, ses concitoyens et ses amis ne le reconnussent point avant qu’il eût réprimé l’insolence des prétendants. Donc, tout lui semblait changé, les chemins, le port, les hautes roches et les arbres verdoyants. Et, se levant, et debout, il regarda la terre de la patrie. Et il pleura, et, se frappant les cuisses de ses deux mains, il dit en gémissant :
– Ô malheureux ! Dans quelle terre des hommes suis-je venu ? Ceux-ci sont-ils injurieux, cruels et iniques ? sont-ils hospitaliers, et leur esprit est-il pieux ? où porter toutes ces richesses ? où aller moi-même ? Plût aux dieux que je fusse resté avec les Phaiakiens ! J’aurais trouvé quelque autre roi magnanime qui m’eût aimé et donné des compagnons pour mon retour. Maintenant, je ne sais où porter ces richesses, ni où les laisser, de peur qu’elles soient la proie d’étrangers. O dieux ! ils ne sont point, en effet, véridiques ni justes, les princes et les chefs des Phaiakiens qui m’ont conduit dans une terre étrangère, et qui me disaient qu’ils me conduiraient sûrement dans Ithakè ! Mais ils ne l’ont point fait. Que Zeus qu’on supplie me venge d’eux, lui qui veille sur les hommes et qui punit ceux qui agissent mal ! Mais je compterai mes richesses, et je verrai s’ils ne m’en ont rien enlevé en les transportant hors de la nef creuse.
Ayant parlé ainsi, il compta les beaux trépieds et les bassins, et l’or et les beaux vêtements tissés ; mais rien n’en manquait. Et il pleurait la terre de sa patrie, et il se jeta en gémissant sur le rivage de la mer aux bruits sans nombre. Et Athènè s’approcha de lui sous la figure d’un jeune homme pasteur de brebis, tel que sont les fils des rois, ayant un beau vêtement sur ses épaules, des sandales sous ses pieds délicats, et une lance à la main. Et Odysseus, joyeux de la voir, vint à elle, et il lui dit ces paroles ailées :
– Ô ami ! puisque je te rencontre le premier en ce lieu, salut ! Ne viens pas à moi dans un esprit ennemi. Sauve ces richesses et moi. Je te supplie comme un dieu et je me mets à tes chers genoux. Dis-moi la vérité, afin que je la sache. Quelle est cette terre ? Quels hommes l’habitent ? Quel est ton peuple ? Est-ce une belle île, ou est-ce la côte avancée dans la mer d’une terre fertile ?
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Tu es insensé, ô étranger, ou tu viens de loin, puisque tu me demandes quelle est cette terre, car elle n’est point aussi méprisable, et beaucoup la connaissent, soit les peuples qui habitent du côté d’Eôs et de Hèlios, ou du côté de la nuit obscure. Certes, elle est âpre et non faite pour les chevaux ; mais elle n’est point stérile, bien que petite. Elle possède beaucoup de froment et beaucoup de vignes, car la pluie et la rosée y abondent.
Elle a de bons pâturages pour les chèvres et les vaches, et des forêts de toute sorte d’arbres, et elle est arrosée de sources qui ne tarissent point. C’est ainsi, étranger, que le nom d’Ithakè est parvenu jusqu’à Troiè qu’on dit si éloignée de la terre Akhaienne.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus fut rempli de joie, se réjouissant de sa patrie que nommait Pallas Athènè, la fille de Zeus tempétueux. Et il lui dit en paroles ailées, mais en lui cachant la vérité, car il n’oubliait point son esprit rusé !
– J’avais entendu parler d’Ithakè dans la grande Krètè située au loin sur la mer. Maintenant je suis venu ici avec mes richesses, et j’en ai laissé autant à mes enfants. Je fuis, car j’ai tué le fils bien-aimé d’Idoméneus, Orsilokhos aux pieds rapides, qui, dans la grande Krètè, l’emportait sur tous les hommes par la rapidité de ses pieds. Et je le tuai parce qu’il voulait m’enlever ma part du butin, que j’avais rapportée de Troiè, et pour laquelle j’avais subi mille maux dans les combats des hommes ou en parcourant les mers. Car je ne servais point, pour plaire à son père, dans la plaine Troienne, et je commandais à d’autres guerriers que les siens. Et, dans les champs, m’étant mis en embuscade avec un de mes compagnons, je perçai de ma lance d’airain Orsilokhos qui venait à moi. Et comme la nuit noire couvrait tout l’Ouranos, aucun homme ne nous vit, et je lui arrachai l’âme sans témoin.
Et quand je l’eus tué de l’airain aigu, je me rendis aussitôt dans une nef des illustres Phaiakiens, et je les priai de me recevoir, et je leur donnai une part de mes richesses. Je leur demandai de me porter à Pylos ou dans la divine Élis, où commandent les Épéiens ; mais la force du vent les en éloigna malgré eux, car ils ne voulaient point me tromper. Et nous sommes venus ici à l’aventure, cette nuit ; et nous sommes entrés dans le port ; et, sans songer au repas, bien que manquant de forces, nous nous sommes tous couchés en sortant de la nef. Et le doux sommeil m’a saisi, tandis que j’étais fatigué. Et les Phaiakiens, ayant retiré mes richesses de leur nef creuse, les ont déposées sur le sable où j’étais moi-même couché. Puis ils sont partis pour la belle Sidôn et m’ont laissé plein de tristesse.
Il parla ainsi, et la déesse Athènè aux yeux clairs se mit à rire, et, le caressant de la main, elle prit la figure d’une femme belle et grande et habile aux travaux, et elle lui dit ces paroles ailées :
– Ô fourbe, menteur, subtil et insatiable de ruses qui te surpasserait en adresse, si ce n’est peut-être un dieu ! Tu ne veux donc pas, même sur la terre de ta patrie, renoncer aux ruses et aux paroles trompeuses qui t’ont été chères dès ta naissance ? Mais ne parlons pas ainsi. Nous connaissons tous deux ces ruses ; et de même que tu l’emportes sur tous les hommes par la sagesse et l’éloquence, ainsi je me glorifie de l’emporter par là sur tous les dieux.
N’as-tu donc point reconnu Pallas Athènè, fille de Zeus, moi qui t’assiste toujours dans tous tes travaux et qui te protège ? moi qui t’ai rendu cher à tous les Phaiakiens ? Viens donc, afin que je te conseille et que je t’aide à cacher les richesses que j’ai inspiré aux illustres Phaiakiens de te donner à ton retour dans tes demeures. Je te dirai les douleurs que tu es destiné à subir dans tes demeures bien construites. Subis-les par nécessité ; ne confie à aucun homme ni à aucune femme tes courses et ton arrivée ; mais supporte en silence tes maux nombreux et les outrages que te feront les hommes.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Il est difficile à un homme qui te rencontre de te reconnaître, ô déesse ! même au plus sage ; car tu prends toutes les figures. Certes, je sais que tu m’étais bienveillante, quand nous, les fils des Akhaiens, nous combattions devant Troiè ; mais quand nous eûmes renversé la haute citadelle de Priamos, nous montâmes sur nos nefs, et un dieu dispersa les Akhaiens. Et, depuis, je ne t’ai point revue, fille de Zeus ; et je n’ai point senti ta présence sur ma nef pour éloigner de moi le malheur ; mais toujours, le cœur accablé dans ma poitrine, j’ai erré, jusqu’à ce que les dieux m’aient délivré de mes maux. Et tu m’as encouragé par tes paroles chez le riche peuple des Phaiakiens, et tu m’as conduit toi-même à leur ville. Maintenant je te supplie par ton père ! Je ne pense point, en effet, être arrivé dans Ithakè, car je vois une terre étrangère, et je pense que tu me parles ainsi pour te jouer de moi et tromper mon esprit.
Dis-moi donc sincèrement si je suis arrivé dans ma chère patrie.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Tu as donc toujours cette pensée dans ta poitrine ? Mais je ne puis permettre que tu sois malheureux, car tu es éloquent, intelligent et sage. Un autre homme, de retour après avoir tant erré, désirerait ardemment revoir sa femme et ses enfants dans ses demeures ; mais toi, tu ne veux parler et apprendre qu’après avoir éprouvé ta femme qui est assise dans tes demeures, passant les jours et les nuits dans les gémissements et les larmes. Certes, je n’ai jamais craint ce qu’elle redoute, et je savais dans mon esprit que tu reviendrais, ayant perdu tous tes compagnons. Mais je ne pouvais m’opposer au frère de mon père, à Poseidaôn qui était irrité dans son cœur contre toi, parce que tu avais aveuglé son cher fils. Et, maintenant, je te montrerai la terre d’Ithakè, afin que tu croies. Ce port est celui de Phorkys, le Vieillard de la mer, et, à la pointe du port, voici l’olivier épais devant l’antre haut et obscur des nymphes sacrées qu’on nomme naïades. C’est cette caverne où tu sacrifiais aux nymphes de complètes hécatombes. Et voici le mont Nèritos couvert de forêts.
Ayant ainsi parlé, la déesse dissipa la nuée, et la terre apparut. Et le patient et divin Odysseus fut plein de joie, se réjouissant de sa patrie. Et il baisa la terre féconde, et, aussitôt, levant les mains, il supplia les Nymphes :
– Nymphes, naïades, filles de Zeus, je disais que je ne vous reverrais plus ! Et, maintenant, je vous salue d’une voix joyeuse. Je vous offrirai des présents, comme autrefois, si la dévastatrice, fille de Zeus, me laisse vivre et fait grandir mon cher fils.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Prends courage, et que ceci ne t’inquiète point ; mais déposons aussitôt tes richesses au fond de l’antre divin, où elles seront en sûreté, et délibérons tous deux sur ce qu’il y a de mieux à faire.
Ayant ainsi parlé, la déesse entra dans la grotte obscure, cherchant un lieu secret ; et Odysseus y porta aussitôt l’or et le dur airain, et les beaux vêtements que les Phaiakiens lui avaient donnés. Il les y déposa, et Pallas Athènè, fille de Zeus tempétueux, ferma l’entrée avec une pierre. Puis, tous deux, s’étant assis au pied de l’olivier sacré, méditèrent la perte des prétendants insolents. Et la déesse Athènè aux yeux clairs parla la première :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, songe comment tu mettras la main sur les prétendants insolents qui commandent depuis trois ans dans ta maison, recherchant ta femme divine et lui faisant des présents. Elle attend toujours ton retour, gémissant dans son cœur, et elle donne de l’espoir et elle fait des promesses à chacun d’eux, et elle leur envoie des messagers ; mais son esprit a d’autres pensées.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– O dieux ! je devais donc, comme l’Atréide Agamemnôn, périr d’une mauvaise mort dans mes demeures, si tu ne m’eusses averti à temps, ô déesse ! Mais dis-moi comment nous punirons ces hommes. Debout auprès de moi, souffle dans mon cœur une grande audace, comme au jour où nous avons renversé les grandes murailles de Troiè. Si tu restes, pleine d’ardeur, auprès de moi, ô Athènè aux yeux clairs, et si tu m’aides, ô vénérable déesse, je combattrai seul trois cents guerriers.
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Certes, je serai auprès de toi et je ne te perdrai pas de vue, quand nous accomplirons ces choses. Et j’espère que le large pavé sera souillé du sang et de la cervelle de plus d’un de ces prétendants qui mangent tes richesses. Je vais te rendre inconnu à tous les hommes. Je riderai ta belle peau sur tes membres courbés ; je ferai tomber tes cheveux blonds de ta tête ; je te couvrirai de haillons qui font qu’on se détourne de celui qui les porte ; je ternirai tes yeux maintenant si beaux, et tu apparaîtras à tous les prétendants comme un misérable, ainsi qu’à ta femme et au fils que tu as laissés dans tes demeures. Va d’abord trouver le porcher qui garde tes porcs, car il te veut du bien, et il aime ton fils et la sage Pènélopéia. Tu le trouveras surveillant les porcs ; et ceux-ci se nourrissent auprès de la roche du Corbeau et de la fontaine Aréthousè, mangeant le gland qui leur plait et buvant l’eau noire.
Reste là, et interroge-le avec soin sur toute chose, jusqu’à ce que je revienne de Spartè aux belles femmes, où j’appellerai, ô Odysseus, ton cher fils Tèlémakhos qui est allé dans la grande Lakédaimôn, vers Ménélaos, pour s’informer de toi et apprendre si tu vis encore.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Pourquoi ne lui avoir rien dit, toi qui sais tout ? Est-ce pour qu’il soit errant et subisse mille maux sur la mer indomptée, tandis que ceux-ci mangent ses richesses ?
Et la déesse Athènè aux yeux clairs lui répondit :
– Qu’il ne soit point une inquiétude pour toi. Je l’ai conduit là moi-même, afin qu’il se fasse une bonne renommée ; mais il ne souffre aucune douleur, et il est assis, tranquille, dans les demeures de l’Atréide, où tout lui est abondamment offert. À la vérité, les jeunes prétendants lui tendent une embûche sur leur nef noire, désirant le tuer avant qu’il rentre dans la terre de sa patrie ; mais je ne pense pas que cela soit, et je pense plutôt que la terre recevra auparavant plus d’un de ces prétendants qui mangent tes richesses.
En parlant ainsi, Athènè le toucha d’une baguette et elle dessécha sa belle peau sur ses membres courbés, et elle fit tomber ses blonds cheveux de sa tête.
Elle chargea tout son corps de vieillesse ; elle ternit ses yeux, si beaux auparavant ; elle lui donna un vêtement en haillons, déchiré, sale et souillé de fumée ; elle le couvrit ensuite de la grande peau nue d’un cerf rapide, et elle lui donna enfin un bâton et une besace misérable attachée par une courroie tordue.
Ils se séparèrent après s’être ainsi entendus, et Athènè se rendit dans la divine Lakédaimôn, auprès du fils d’Odysseus.Chant 14
Et Odysseus s’éloigna du port, par un âpre sentier, à travers les bois et les hauteurs, vers le lieu où Athènè lui avait dit qu’il trouverait son divin porcher, qui prenait soin de ses biens plus que tous les serviteurs qu’il avait achetés, lui, le divin Odysseus.
Et il le trouva assis sous le portique, en un lieu découvert où il avait construit de belles et grandes étables autour desquelles on pouvait marcher. Et il les avait construites, pour ses porcs, de pierres superposées et entourées d’une haie épineuse, en l’absence du roi, sans l’aide de sa maîtresse et du vieux Laertès. Et il avait planté au-dehors des pieux épais et nombreux, en cœur noir de chêne ; et, dans l’intérieur, il avait fait douze parcs à porcs. Dans chacun étaient couchées cinquante femelles pleines ; et les mâles couchaient dehors ; et ceux-ci étaient beaucoup moins nombreux, car les divins prétendants les diminuaient en les mangeant, et le porcher leur envoyait toujours le plus gras et le meilleur de tous ; et il n’y en avait plus que trois cent soixante. Quatre chiens, semblables à des bêtes fauves, et que le prince des porchers nourrissait, veillaient toujours sur les porcs.
Et celui-ci adaptait à ses pieds des sandales qu’il taillait dans la peau d’une vache coloriée. Et trois des autres porchers étaient dispersés, faisant paître leurs porcs ; et le quatrième avait été envoyé par nécessité à la ville, avec un porc pour les prétendants orgueilleux, afin que ceux-ci, l’ayant tué, dévorassent sa chair.
Et aussitôt les chiens aboyeurs virent Odysseus, et ils accoururent en hurlant ; mais Odysseus s’assit plein de ruse, et le bâton tomba de sa main. Alors il eût subi un indigne traitement auprès de l’étable qui était à lui ; mais le porcher accourut promptement de ses pieds rapides ; et le cuir lui tomba des mains, et, en criant, il chassa les chiens à coups de pierres, et il dit au roi :
– Ô vieillard, certes, ces chiens allaient te déchirer et me couvrir d’opprobre. Les dieux m’ont fait assez d’autres maux. Je reste ici, gémissant, et pleurant un roi divin, et je nourris ses porcs gras, pour que d’autres que lui les mangent ; et peut-être souffre-t-il de la faim, errant parmi les peuples étrangers, s’il vit encore et s’il voit la lumière de Hèlios. Mais suis-moi, et entrons dans l’étable, ô vieillard, afin que, rassasié dans ton âme de nourriture et de vin, tu me dises d’où tu es et quels maux tu as subis.
Ayant ainsi parlé, le divin porcher le précéda dans l’étable, et, l’introduisant, il le fit asseoir sur des branches épaisses qu’il recouvrit de la peau d’une chèvre sauvage et velue. Et, s’étant couché sur cette peau grande et épaisse, Odysseus se réjouit d’être reçu ainsi, et il dit :
– Que Zeus, ô mon hôte, et les autres dieux immortels t’accordent ce que tu désires le plus, car tu me reçois avec bonté.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Etranger, il ne m’est point permis de mépriser même un hôte plus misérable encore, car les étrangers et les pauvres viennent de Zeus, et le présent modique que nous leur faisons lui plaît ; car cela seul est au pouvoir d’esclaves toujours tremblants que commandent de jeunes rois. Certes, les dieux s’opposent au retour de celui qui m’aimait et qui m’eût donné un domaine aussi grand qu’un bon roi a coutume d’en donner à son serviteur qui a beaucoup travaillé pour lui et dont un dieu a fait fructifier le labeur ; et, aussi, une demeure, une part de ses biens et une femme désirable. Ainsi mon travail a prospéré, et le roi m’eût grandement récompensé, s’il était devenu vieux ici ; mais il a péri. Plût aux dieux que la race des Hélénè eût péri entièrement, puisqu’elle a rompu les genoux de tant de guerriers ! car mon maître aussi, pour la cause d’Agamemnôn, est allé vers Ilios nourrice de chevaux, afin de combattre les Troiens.
Ayant ainsi parlé, il ceignit sa tunique, qu’il releva, et, allant vers les étables où était enfermé le troupeau de porcs, il prit deux jeunes pourceaux, les égorgea, alluma le feu, les coupa et les traversa de broches, et, les ayant fait rôtir, les offrit à Odysseus, tout chauds autour des broches. Puis, il les couvrit de farine blanche, mêla du vin doux dans une coupe grossière, et, s’asseyant devant Odysseus, il l’exhorta à manger et lui dit :
– Mange maintenant, ô étranger, cette nourriture destinée aux serviteurs, car les prétendants mangent les porcs gras, n’ayant aucune pudeur, ni aucune bonté. Mais les dieux heureux n’aiment pas les actions impies, et ils aiment au contraire la justice et les actions équitables. Même les ennemis barbares qui envahissent une terre étrangère, à qui Zeus accorde le butin, et qui reviennent vers leurs demeures avec des nefs pleines, sentent l’inquiétude et la crainte dans leurs âmes. Mais ceux-ci ont appris sans doute, ayant entendu la voix d’un dieu, la mort fatale d’Odysseus, car ils ne veulent point rechercher des noces légitimes, ni retourner chez eux ; mais ils dévorent immodérément, et sans rien épargner, les biens du roi ; et, toutes les nuits et tous les jours qui viennent de Zeus, ils sacrifient, non pas une seule victime, mais deux au moins. Et ils puisent et boivent le vin sans mesure. Certes, les richesses de mon maître étaient grandes. Aucun héros n’en avait autant, ni sur la noire terre ferme, ni dans Ithakè elle-même. Vingt hommes n’ont point tant de richesses. Je t’en ferai le compte : douze troupeaux de bœufs sur la terre ferme, autant de brebis, autant de porcs, autant de larges étables de chèvres. Le tout est surveillé par des pasteurs étrangers. Ici, à l’extrémité de l’île, onze grands troupeaux de chèvres paissent sous la garde de bons serviteurs ; et chacun de ceux-ci mène tous les jours aux prétendants la meilleure des chèvres engraissées. Et moi, je garde ces porcs et je les protège, mais j’envoie aussi aux prétendants le meilleur et le plus gras.
Il parla ainsi, et Odysseus mangeait les chairs et buvait le vin en silence, méditant le malheur des prétendants. Après qu’il eut mangé et bu et satisfait son âme, Eumaios lui remit pleine de vin la coupe où il avait bu lui-même. Et Odysseus la reçut, et, joyeux dans son cœur, il dit à Eumaios ces paroles ailées :
– O ami, quel est cet homme qui t’a acheté de ses propres richesses, et qui, dis-tu, était si riche et si puissant ? Tu dis aussi qu’il a péri pour la cause d’Agamemnôn ? Dis-moi son nom, car je le connais peut-être. Zeus et les autres dieux immortels savent, en effet, si je viens vous annoncer que je l’ai vu, car j’ai beaucoup erré.
Et le chef des porchers lui répondit :
– Ô vieillard, aucun voyageur errant et apportant des nouvelles ne persuadera sa femme et son cher fils. Que de mendiants affamés mentent effrontément et ne veulent point dire la vérité ! Chaque étranger qui vient parmi le peuple d’Ithakè va trouver ma maîtresse et lui fait des mensonges. Elle les reçoit avec bonté, les traite bien et les interroge sur chaque chose. Puis elle gémit, et les larmes tombent de ses paupières, comme c’est la coutume de la femme dont le mari est mort. Et toi, vieillard, tu inventerais aussitôt une histoire, afin qu’elle te donnât un manteau, une tunique, des vêtements. Mais déjà les chiens rapides et les oiseaux carnassiers ont arraché sa chair de ses os, et il a perdu l’âme ; ou les poissons l’ont mangé dans la mer, et ses os gisent sur le rivage, couverts d’un monceau de sable.
Il a péri ainsi, laissant à ses amis et à moi de grandes douleurs ; car, dans quelque lieu que j’aille, je ne trouverai jamais un autre maître aussi bon, même quand j’irais dans la demeure de mon père et de ma mère, là où je suis né et où ceux-ci m’ont élevé. Et je ne les pleure point tant, et je ne désire point tant les revoir de mes yeux sur la terre de ma patrie, que je ne suis saisi du regret d’Odysseus absent. Et maintenant qu’il n’est point là, ô étranger, je le respecte en le nommant, car il m’aimait beaucoup et prenait soin de moi ; c’est pourquoi je l’appelle mon frère aîné, bien qu’il soit absent au loin.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Ô ami, puisque tu nies mes paroles, et que tu affirmes qu’il ne reviendra pas, ton esprit est toujours incrédule. Cependant, je ne parle point au hasard, et je jure par serment qu’Odysseus reviendra. Qu’on me récompense de cette bonne nouvelle quand il sera rentré dans ses demeures. Je n’accepterai rien auparavant, malgré ma misère ; mais, alors seulement, qu’on me donne des vêtements, un manteau et une tunique. Il m’est odieux, non moins que les portes d’Aidès, celui qui, poussé par la misère, parle faussement. Que Zeus, le premier des dieux, le sache ! Et cette table hospitalière, et le foyer de l’irréprochable Odysseus où je me suis assis ! Certes, toutes les choses que j’annonce s’accompliront. Odysseus arrivera ici dans cette même année, même à la fin de ce mois ; même dans peu de jours il rentrera dans sa demeure et il punira chacun de ceux qui outragent sa femme et son illustre fils.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Ô vieillard, je ne te donnerai point cette récompense d’une bonne nouvelle, car jamais Odysseus ne reviendra vers sa demeure. Bois donc en repos ; ne parlons plus de cela, et ne me rappelle point ces choses, car je suis triste dans mon cœur quand quelqu’un se souvient de mon glorieux maître. Mais j’accepte ton serment ; qu’Odysseus revienne, comme je le désire, ainsi que Pènélopéia, le vieux Laertès et le divin Tèlémakhos. Maintenant, je gémis sur cet enfant, Tèlémakhos, qu’a engendré Odysseus, et que les dieux ont nourri comme une jeune plante. J’espérais que, parmi les hommes, il ne serait inférieur à son père bien-aimé, ni en sagesse, ni en beauté ; mais quelqu’un d’entre les immortels, ou d’entre les hommes, a troublé son esprit calme, et il est allé vers la divine Pylos pour s’informer de son père, et les prétendants insolents lui tendent une embuscade au retour, afin que la race du divin Arkeisios périsse entièrement dans Ithakè. Mais laissons-le, soit qu’il périsse, soit qu’il échappe, et que le Kroniôn le couvre de sa main ! Pour toi, vieillard, raconte-moi tes malheurs, et parle avec vérité, afin que je t’entende. Qui es-tu ? quel est ton peuple ? où sont tes parents et ta ville ? sur quelle nef es-tu venu ? comment des marins t’ont-ils mené à Ithakè ? qui sont-ils ? car je pense que tu n’es pas venu ici à pied ?
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Je te dirai, en effet, ces choses avec vérité ; mais, quand même cette nourriture et ton vin doux dureraient un long temps, quand même nous resterions ici, mangeant tranquillement, tandis que d’autres travaillent, il me serait facile, pendant toute une année, de te raconter les douleurs que j’ai subies par la volonté des dieux. Je me glorifie d’être né dans la vaste Krètè et d’être le fils d’un homme riche. Beaucoup d’autres fils lui étaient nés dans ses demeures, d’une femme légitime, et y avaient été élevés. Pour moi, c’est une mère achetée et concubine qui m’a enfanté ; mais Kastôr Hylakide m’aima autant que ses enfants légitimes ; et je me glorifie d’avoir été engendré par lui qui, autrefois, était honoré comme un dieu par les Krètois, à cause de ses domaines, de ses richesses et de ses fils illustres. Mais les kères de la mort l’emportèrent aux demeures d’Aidès, et ses fils magnanimes partagèrent ses biens et les tirèrent au sort. Et ils m’en donnèrent une très petite part avec sa maison.
Mais, par ma vertu, j’épousai une fille d’hommes très riches, car je n’étais ni insensé, ni lâche. Maintenant tout est flétri en moi, mais, cependant, tu peux juger en regardant le chaume ; et, certes, j’ai subi des maux cruels. Arès et Athènè m’avaient donné l’audace et l’intrépidité, et quand, méditant la perte des ennemis, je choisissais des hommes braves pour une embuscade, jamais, en mon cœur courageux, je n’avais la mort devant les yeux ; mais, courant aux premiers rangs, je tuais de ma lance celui des guerriers ennemis qui me le cédait en agilité.
Tel j’étais dans la guerre ; mais les travaux et les soins de la famille, par lesquels on élève les chers enfants, ne me plaisaient point ; et j’aimais seulement les nefs armées d’avirons, les combats, les traits aigus et les flèches ; et ces armes cruelles qui sont horribles aux autres hommes me plaisaient, car un dieu me les présentait toujours à l’esprit. Ainsi chaque homme se réjouit de choses différentes. En effet, avant que les fils des Akhaiens eussent mis le pied devant Troiè, j’avais neuf fois commandé des guerriers et des nefs rapides contre des peuples étrangers, et tout m’avait réussi. Je choisissais d’abord ma part légitime du butin, et je recevais ensuite beaucoup de dons ; et ma maison s’accroissait, et j’étais craint et respecté parmi les Krètois.
Mais quand l’irréprochable Zeus eut décidé cette odieuse expédition qui devait rompre les genoux à tant de héros, alors les peuples nous ordonnèrent, à moi et à l’illustre Idoméneus, de conduire nos nefs à Ilios, et nous ne pûmes nous y refuser à cause des rumeurs menaçantes du peuple. Là, nous, fils des Akhaiens, nous combattîmes pendant neuf années, et, la dixième, ayant saccagé la ville de Priamos, nous revînmes avec nos nefs vers nos demeures ; mais un dieu dispersa les Akhaiens. Mais à moi, malheureux, le sage Zeus imposa d’autres maux. Je restai un seul mois dans ma demeure, me réjouissant de mes enfants, de ma femme et de mes richesses ; et mon cœur me poussa ensuite à naviguer vers l’Aigyptiè sur mes nefs bien construites, avec de divins compagnons.
Et je préparai neuf nefs, et aussitôt les équipages en furent réunis. Pendant six jours mes chers compagnons prirent de joyeux repas, car j’offris beaucoup de sacrifices aux dieux, et, en même temps, des mets à mes hommes. Le septième jour, étant partis de la grande Krètè, nous naviguâmes aisément au souffle propice de Boréas, comme au courant d’un fleuve ; et aucune de mes nefs n’avait souffert mais, en repos et sains et saufs, nous restâmes assis et le vent et les pilotes conduisaient les nefs ; et, le cinquième jour, nous parvînmes au beau fleuve Aigyptos. Et j’arrêtai mes nefs recourbées dans le fleuve Aigyptos. Là, j’ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès des nefs pour les garder, et j’envoyai des éclaireurs pour aller à la découverte. Mais ceux-ci, égarés par leur audace et confiants dans leurs forces, dévastèrent aussitôt les beaux champs des hommes Aigyptiens, entraînant les femmes et les petits enfants et tuant les hommes. Et aussitôt le tumulte arriva jusqu’à la ville. Et les habitants, entendant ces clameurs, accoururent au lever d’Éôs, et toute la plaine se remplit de piétons et de cavaliers et de l’éclat de l’airain. Et le foudroyant Zeus mit mes compagnons en fuite, et aucun d’eux ne soutint l’attaque, et la mort les environna de toutes parts. Là, un grand nombre des nôtres fut tué par l’airain aigu, et les autres furent emmenés vivants pour être esclaves. Mais Zeus lui-même mit cette résolution dans mon esprit. Plût aux dieux que j’eusse dû mourir en Aigyptiè et subir alors ma destinée, car d’autres malheurs m’attendaient.
Ayant aussitôt retiré mon casque de ma tête et mon bouclier de mes épaules, et jeté ma lance, je courus aux chevaux du roi, et j’embrassai ses genoux, et il eut pitié de moi, et il me sauva ; et, m’ayant fait monter dans son char, il m’emmena dans ses demeures. Certes, ses guerriers m’entouraient, voulant me tuer de leurs lances de frêne, car ils étaient très irrités ; mais il m’arracha à eux, craignant la colère de Zeus hospitalier qui châtie surtout les mauvaises actions. Je restai là sept ans, et j’amassai beaucoup de richesses parmi les Aigyptiens, car tous me firent des présents.
Mais vers la huitième année, arriva un homme de la Phoinikiè, plein de mensonges, et qui avait déjà causé beaucoup de maux aux hommes. Et il me persuada par ses mensonges d’aller en Phoinikiè, où étaient sa demeure et ses biens. Et je restai là une année entière auprès de lui. Et quand les jours et les mois se furent écoulés, et que, l’année étant accomplie, les saisons revinrent, il me fit monter sur une nef, sous prétexte d’aller avec lui conduire un chargement en Libyè, mais pour me vendre et retirer de moi un grand prix. Et je le suivis, le soupçonnant, mais contraint. Et la nef, poussée par le souffle propice de Boréas, approchait de la Krètè, quand Zeus médita notre ruine. Et déjà nous avions laissé la Krètè, et rien n’apparaissait plus que l’Ouranos et la mer. Alors, le Kroniôn suspendit une nuée noire sur la nef creuse, et sous cette nuée toute la mer devint noire aussi. Et Zeus tonna, et il lança la foudre sur la nef, qui se renversa, frappée par la foudre de Zeus, et se remplit de fumée.
Et tous les hommes furent précipités de la nef, et ils étaient emportés, comme des oiseaux de mer, par les flots, autour de la nef noire, et un dieu leur refusa le retour. Alors Zeus me mit entre les mains le long mât de la nef à proue bleue, afin que je pusse fuir la mort ; et l’ayant embrassé, je fus la proie des vents furieux. Et je fus emporté pendant neuf jours, et, dans la dixième nuit noire, une grande lame me jeta sur la terre des Thesprôtes.
Alors le héros Pheidôn, le roi des Thesprôtes, m’accueillit généreusement ; car je rencontrai d’abord son cher fils, et celui-ci me conduisit, accablé de froid et de fatigue, et, me soutenant de la main, m’emmena dans les demeures de son père. Et celui-ci me donna des vêtements, un manteau et une tunique. Là, j’entendis parler d’Odysseus. Pheidôn me dit que, lui ayant donné l’hospitalité, il l’avait traité en ami, comme il retournait dans la terre de sa patrie. Et il me montra les richesses qu’avait réunies Odysseus, de l’airain, de l’or et du fer très difficile à travailler, le tout assez abondant pour nourrir jusqu’à sa dixième génération. Et tous ces trésors étaient déposés dans les demeures du roi. Et celui-ci me disait qu’Odysseus était allé à Dôdônè pour apprendre du grand Chêne la volonté de Zeus, et pour savoir comment, depuis longtemps absent, il rentrerait dans la terre d’Ithakè, soit ouvertement, soit en secret. Et Pheidôn me jura, en faisant des libations dans sa demeure, que la nef et les hommes étaient prêts qui devaient conduire Odysseus dans la chère terre de sa patrie.
Mais il me renvoya d’abord, profitant d’une nef des Thesprôtes qui allait à Doulikhios. Et il ordonna de me mener au roi Akastos ; mais ces hommes prirent une résolution funeste pour moi, afin, sans doute, que je subisse toutes les misères.
Quand la nef fut éloignée de terre, ils songèrent aussitôt à me réduire en servitude ; et, m’arrachant mon vêtement, mon manteau et ma tunique, ils jetèrent sur moi ce misérable haillon et cette tunique déchirée, tels que tu les vois. Vers le soir ils parvinrent aux champs de la riante Ithakè, et ils me lièrent aux bancs de la nef avec une corde bien tordue ; puis ils descendirent sur le rivage de la mer pour prendre leur repas. Mais les dieux eux-mêmes détachèrent aisément mes liens. Alors, enveloppant ma tête de ce haillon, je descendis à la mer par le gouvernail, et pressant l’eau de ma poitrine et nageant des deux mains, j’abordai très loin d’eux. Et je montai sur la côte, là où croissait un bois de chênes touffus, et je me couchai contre terre, et ils me cherchaient en gémissant ; mais, ne me voyant point, ils jugèrent qu’il était mieux de ne plus me chercher ; car les dieux m’avaient aisément caché d’eux, et ils m’ont conduit à l’étable d’un homme excellent, puisque ma destinée est de vivre encore.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Etranger très malheureux, certes, tu as fortement ému mon cœur en racontant les misères que tu as subies et tes courses errantes ; mais, en parlant d’Odysseus, je pense que tu n’as rien dit de sage, et tu ne me persuaderas point. Comment un homme tel que toi peut-il mentir aussi effrontément ? Je sais trop que penser du retour de mon maître. Certes, il est très odieux à tous les dieux, puisqu’ils ne l’ont point dompté par la main des Troiens, ou qu’ils ne lui ont point permis, après la guerre, de mourir entre les bras de ses amis. Car tous les Akhaiens lui eussent élevé un tombeau, et une grande gloire eût été accordée à son fils dans l’avenir. Et maintenant les Harpyes l’ont déchiré sans gloire, et moi, séparé de tous, je reste auprès de mes porcs ; et je ne vais point à la ville, si ce n’est quand la sage Pènélopéia m’ordonne d’y aller, quand elle a reçu quelque nouvelle. Et, alors, tous s’empressent de m’interroger, ceux qui s’attristent de la longue absence de leur roi et ceux qui se réjouissent de dévorer impunément ses richesses. Mais il ne m’est point agréable de demander ou de répondre depuis qu’un Aitôlien m’a trompé par ses paroles. Ayant tué un homme, il avait erré en beaucoup de pays, et il vint dans ma demeure, et je le reçus avec amitié. Il me dit qu’il avait vu, parmi les Krètois, auprès d’Idoméneus, mon maître réparant ses nefs que les tempêtes avaient brisées. Et il me dit qu’Odysseus allait revenir, soit cet été, soit cet automne, ramenant de nombreuses richesses avec ses divins compagnons. Et toi, vieillard, qui as subi tant de maux, et que la destinée a conduit vers moi, ne cherche point à me plaire par des mensonges, car je ne t’honorerai, ni ne t’aimerai pour cela, mais par respect pour Zeus hospitalier et par compassion pour toi.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Certes, tu as dans ta poitrine un esprit incrédule, puisque ayant juré par serment, je ne t’ai point persuadé. Mais faisons un pacte, et que les dieux qui habitent l’Olympos soient témoins. Si ton roi revient dans cette demeure, donne-moi des vêtements, un manteau et une tunique, et fais-moi conduire à Doulikhios, ainsi que je le désire ; mais si ton roi ne revient pas comme je te le dis, ordonne à tes serviteurs de me jeter du haut d’un grand rocher, afin que, désormais, un mendiant craigne de mentir.
Et le divin porcher lui répondit :
– Étranger, je perdrais ainsi ma bonne renommée et ma vertu parmi les hommes, maintenant et à jamais, moi qui t’ai conduit dans mon étable et qui t’ai offert les dons de l’hospitalité, si je te tuais et si je t’arrachais ta chère âme. Comment supplierais-je ensuite le Kroniôn Zeus ? Mais voici l’heure du repas, et mes compagnons vont arriver promptement, afin que nous préparions un bon repas dans l’étable.
Tandis qu’ils se parlaient ainsi, les porcs et les porchers arrivèrent. Et ils enfermèrent les porcs, comme de coutume, pour la nuit, et une immense rumeur s’éleva du milieu des animaux qui allaient à l’enclos. Puis le divin porcher dit à ses compagnons :
– Amenez-moi un porc excellent, afin que je le tue pour cet hôte qui vient de loin, et nous nous en délecterons aussi, nous qui souffrons beaucoup, et qui surveillons les porcs aux dents blanches, tandis que d’autres mangent impunément le fruit de notre travail.
Ayant ainsi parlé, il fendit du bois avec l’airain tranchant. Et les porchers amenèrent un porc très gras ayant cinq ans. Et ils l’étendirent devant le foyer. Mais Eumaios n’oublia point les immortels, car il n’avait que de bonnes pensées ; et il jeta d’abord dans le feu les soies de la tête du porc aux dents blanches, et il pria tous les dieux, afin que le subtil Odysseus revint dans ses demeures. Puis, levant les bras, il frappa la victime d’un morceau de chêne qu’il avait réservé, et la vie abandonna le porc. Et les porchers l’égorgèrent, le brûlèrent et le coupèrent par morceaux. Et Eumaios, retirant les entrailles saignantes, qu’il recouvrit de la graisse prise au corps, les jeta dans le feu après les avoir saupoudrées de fleur de farine d’orge. Et les porchers, divisant le reste, traversèrent les viandes de broches, les firent rôtir avec soin et les retirèrent du feu. Puis ils les déposèrent sur des disques. Eumaios se leva, faisant les parts, car il avait des pensées équitables ; et il fit en tout sept parts. Il en consacra une aux nymphes et à Hermès, fils de Maiè, et il distribua les autres à chacun ; mais il honora Odysseus du dos entier du porc aux dents blanches. Et le héros, le subtil Odysseus, s’en glorifia, et dit à Eumaios :
– Plaise aux dieux, Eumaios, que tu sois toujours cher au père Zeus, puisque, tel que je suis, tu m’as honoré de cette part excellente.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Mange heureusement, mon hôte, et délecte-toi de ces mets tels qu’ils sont. Un dieu nous les a donnés et nous laissera en jouir, s’il le veut ; car il peut tout.
Il parla ainsi, et il offrit les prémices aux dieux éternels. Puis, ayant fait des libations avec du vin rouge, il mit une coupe entre les mains d’Odysseus destructeur des citadelles. Et celui-ci s’assit devant le dos du porc ; et Mésaulios, que le chef des porchers avait acheté en l’absence de son maître, et sans l’aide de sa maîtresse et du vieux Laertès, distribua les parts. Il l’avait acheté de ses propres richesses à des Taphiens.
Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux. Et après qu’ils eurent assouvi le besoin de boire et de manger, Mésaulios enleva le pain, et tous, rassasiés de nourriture, allèrent à leurs lits.
Mais la nuit vint, mauvaise et noire ; et Zeus plut toute la nuit, et le grand Zéphyros soufflait chargé d’eau.
Alors Odysseus parla ainsi, pour éprouver le porcher qui prenait tant de soins de lui, afin de voir si, retirant son propre manteau, il le lui donnerait, ou s’il avertirait un de ses compagnons :
– Écoutez-moi maintenant, toi, Eumaios, et vous, ses compagnons, afin que je vous parle en me glorifiant, car le vin insensé m’y pousse, lui qui excite le plus sage à chanter, à rire, à danser, et à prononcer des paroles qu’il eût été mieux de ne pas dire ; mais dès que j’ai commencé à être bavard, je ne puis rien cacher. Plût aux dieux que je fusse jeune et que ma force fût grande, comme au jour où nous tendîmes une embuscade sous Troiè. Les chefs étaient Odysseus et l’Atréide Ménélaos, et je commandais avec eux, car ils m’avaient choisi eux-mêmes. Quand nous fûmes arrivés à la ville, sous la haute muraille, nous nous couchâmes avec nos armes, dans un marais, au milieu de roseaux et de broussailles épaisses. La nuit vint, mauvaise, et le souffle de Boréas était glacé. Puis la neige tomba, froide, et le givre couvrait nos boucliers. Et tous avaient leurs manteaux et leurs tuniques ; et ils dormaient tranquilles, couvrant leurs épaules de leurs boucliers. Pour moi, j’avais laissé mon manteau à mes compagnons comme un insensé ; mais je n’avais point pensé qu’il dût faire un si grand froid, et je n’avais que mon bouclier et une tunique brillante. Quand vint la dernière partie de la nuit, à l’heure où les astres s’inclinent, ayant touché du coude Odysseus, qui était auprès de moi, je lui dis ces paroles qu’il comprit aussitôt :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, je ne vivrai pas longtemps et ce froid me tuera, car je n’ai point de manteau et un daimôn m’a trompé en me persuadant de ne prendre que ma seule tunique ; et maintenant il n’y a plus aucun remède.’ Je parlai ainsi, et il médita aussitôt un projet dans son esprit, aussi prompt qu’il l’était toujours pour délibérer ou pour combattre. Et il me dit à voix basse : – Tais-toi maintenant, de peur qu’un autre parmi les Akhaiens t’entende.’ Il parla ainsi, et, appuyé sur le coude, il dit : – Écoutez-moi, amis. Un songe divin m’a réveillé. Nous sommes loin des nefs ; mais qu’un de nous aille prévenir le prince des peuples, l’Atréide Agamemnôn, afin qu’il ordonne à un plus grand nombre de sortir des nefs et de venir ici.’ Il parla ainsi, et aussitôt Thoas Andraimonide se leva, jeta son manteau pourpré et courut vers les nefs, et je me couchai oiseusement dans son manteau, jusqu’à la clarté d’Eôs au thrône d’or. plût aux Dieux que je fusse aussi jeune et que ma force fût aussi grande ! un des porchers, dans ces étables, me donnerait un manteau, par amitié et par respect pour un homme brave. Mais maintenant, je suis méprisé, à cause des misérables haillons qui me couvrent le corps.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Ô vieillard, tu as raconté une histoire irréprochable, et tu n’auras point dit en vain une parole excellente.
C’est pourquoi tu ne manqueras ni d’un manteau, ni d’aucune chose qui convienne à un suppliant malheureux venu de loin ; mais, au matin, tu reprendras tes haillons, car ici nous n’avons pas beaucoup de manteaux, ni de tuniques de rechange, et chaque homme n’en a qu’une. Quand le cher fils d’Odysseus sera revenu, il te donnera lui-même des vêtements, un manteau et une tunique, et il te fera conduire où ton cœur désire aller.
Ayant ainsi parlé, il se leva, approcha le feu du lit de peaux de chèvres et de brebis où Odysseus se coucha, et il jeta sur lui un grand et épais manteau de rechange et dont il se couvrait quand les mauvais temps survenaient. Et Odysseus se coucha, et, auprès de lui, les jeunes porchers s’endormirent ; mais il ne plut point à Eumaios de reposer dans son lit loin de ses porcs, et il sortit, armé. Et Odysseus se réjouissait qu’il prît tant de soin de ses biens pendant son absence. Et, d’abord, Eumaios mit une épée aiguë autour de ses robustes épaules ; puis, il se couvrit d’un épais manteau qui garantissait du vent : et il prit aussi la peau d’une grande chèvre, et il saisit une lance aiguë pour se défendre des chiens et des hommes ; et il alla dormir où dormaient ses porcs, sous une pierre creuse, à l’abri de Boréas.Chant 15
Et Pallas Athènè se rendit dans la grande Lakédaimôn, vers l’illustre fils du magnanime Odysseus, afin de l’avertir et de l’exciter au retour. Et elle trouva Tèlémakhos et l’illustre fils de Nestôr dormant sous le portique de la demeure de l’illustre Ménélaos. Et le Nestoride dormait paisiblement ; mais le doux sommeil ne saisissait point Tèlémakhos, et il songeait à son père, dans son esprit, pendant la nuit solitaire. Et Athènè aux yeux clairs, se tenant près de lui, parla ainsi :
– Tèlémakhos, il ne serait pas bien de rester plus longtemps loin de ta demeure et de tes richesses laissées en proie à des hommes insolents qui dévoreront et se partageront tes biens ; car tu aurais fait un voyage inutile. Excite donc très promptement l’illustre Ménélaos à te renvoyer, afin que tu retrouves ton irréprochable mère dans tes demeures. Déjà son père et ses frères lui ordonnent d’épouser Eurymakhos, car il l’emporte sur tous les prétendants par les présents qu’il offre et la plus riche dot qu’il promet. Prends garde que, contre son gré, elle emporte ces richesses de ta demeure. Tu sais, en effet, quelle est l’âme d’une femme ; elle veut toujours enrichir la maison de celui qu’elle épouse. Elle ne se souvient plus de ses premiers enfants ni de son premier mari mort, et elle n’y songe plus. Quand tu seras de retour, confie donc, jusqu’à ce que les dieux t’aient donné une femme vénérable, toutes tes richesses à la meilleure de tes servantes. Mais je te dirai autre chose. Garde mes paroles dans ton esprit.
Les plus braves des prétendants te tendent une embuscade dans le détroit d’Ithakè et de la stérile Samos, désirant te tuer avant que tu rentres dans ta patrie ; mais je ne pense pas qu’ils le fassent, et, auparavant, la terre enfermera plus d’un de ces prétendants qui mangent tes biens. Conduis ta nef bien construite loin des îles, et navigue la nuit. Celui des immortels qui veille sur toi t’enverra un vent favorable. Et dès que tu seras arrivé au rivage d’Ithakè, envoie la nef et tous tes compagnons à la ville, et va d’abord chez le porcher qui garde tes porcs et qui t’aime. Dors chez lui, et envoie-le à la ville annoncer à l’irréprochable Pènélopéia que tu la salues et que tu reviens de Pylos.
Ayant ainsi parlé, elle remonta dans le haut Olympos. Et Tèlémakhos éveilla le Nestoride de son doux sommeil en le poussant du pied, et il lui dit :
– Lève-toi, Nestoride Peisistratos, et lie au char les chevaux au sabot massif afin que nous partions.
Et le Nestoride Peisistratos lui répondit :
– Tèlémakhos, nous ne pouvons, quelque hâte que nous ayons, partir dans la nuit ténébreuse. Bientôt Eôs paraîtra. Attendons au matin et jusqu’à ce que le héros Atréide Ménélaos illustre par sa lance ait placé ses présents dans le char et t’ait renvoyé avec des paroles amies. Un hôte se souvient toujours d’un homme aussi hospitalier qui l’a reçu avec amitié.
Il parla ainsi, et aussitôt Éôs s’assit sur son thrône d’or, et le brave Ménélaos s’approcha d’eux, ayant quitté le lit où était Hélénè aux beaux cheveux. Et dès que le cher fils du divin Odysseus l’eut reconnu, il se hâta de se vêtir de sa tunique brillante, et, jetant un grand manteau sur ses épaules, il sortit du portique, et dit à Ménélaos :
– Divin Atréide Ménélaos, prince des peuples, renvoie-moi dès maintenant dans la chère terre de la patrie, car voici que je désire en mon âme revoir ma demeure.
Et le brave Ménélaos lui répondit :
– Tèlémakhos, je ne te retiendrai pas plus longtemps, puisque tu désires t’en retourner. Je m’irrite également contre un homme qui aime ses hôtes outre mesure ou qui les hait. Une conduite convenable est la meilleure. Il est mal de renvoyer un hôte qui veut rester, ou de retenir celui qui veut partir ; mais il faut le traiter avec amitié s’il veut rester, ou le renvoyer s’il veut partir. Reste cependant jusqu’à ce que j’aie placé sur ton char de beaux présents que tu verras de tes yeux, et je dirai aux servantes de préparer un repas abondant dans mes demeures à l’aide des mets qui s’y trouvent. Il est honorable, glorieux et utile de parcourir une grande étendue de pays après avoir mangé. Si tu veux parcourir Hellas et Argos, je mettrai mes chevaux sous le joug et je te conduirai vers les villes des hommes, et aucun d’eux ne nous renverra outrageusement, mais chacun te donnera quelque chose, ou un trépied d’airain, ou un bassin, ou deux mulets, ou une coupe d’or.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Divin Atréide Ménélaos, prince des peuples, je veux rentrer dans nos demeures, car je n’ai laissé derrière moi aucun gardien de mes richesses, et je crains, ou de périr en cherchant mon divin père, ou, loin de mes demeures, de perdre mes richesses.
Et le brave Ménélaos, l’ayant entendu, ordonna aussitôt à sa femme et à ses servantes de préparer dans les demeures un repas abondant, à l’aide des mets qui s’y trouvaient. Et alors le Boèthoide Etéônteus, qui sortait de son lit et qui n’habitait pas loin du roi, arriva près de lui. Et le brave Ménélaos lui ordonna d’allumer du feu et de faire rôtir les viandes. Et le Boèthoide obéit dès qu’il eut entendu. Et Ménélaos rentra dans sa chambre nuptiale parfumée, et Hélénè et Mégapenthès allaient avec lui. Quand ils furent arrivés là où les choses précieuses étaient enfermées, l’Atréide prit une coupe ronde, et il ordonna à son fils Mégapenthès d’emporter un kratère d’argent. Et Hélénè s’arrêta devant un coffre où étaient enfermés les vêtements aux couleurs variées qu’elle avait travaillés elle-même. Et Hélénè, la divine femme, prit un péplos, le plus beau de tous par ses couleurs diverses, et le plus grand, et qui resplendissait comme une étoile ; et il était placé sous tous les autres. Et ils retournèrent par les demeures jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés auprès de Tèlémakhos. Et le brave Ménélaos lui dit :
– Tèlémakhos, que Zeus, le puissant mari de Hèrè, accomplisse le retour que tu désires dans ton âme ! De tous mes trésors qui sont enfermés dans ma demeure je te donnerai le plus beau et le plus précieux, ce kratère bien travaillé, d’argent massif, et dont les bords sont enrichis d’or. C’est l’ouvrage de Hèphaistos, et l’illustre héros, roi des Sidônes, me l’offrit, quand il me reçut dans sa demeure, à mon retour ; et, moi, je veux te l’offrir.
Ayant ainsi parlé, le héros Atréide lui mit la coupe ronde entre les mains ; et le robuste Mégapenthès posa devant lui le splendide kratère d’argent, et Hélénè, tenant le péplos à la main, s’approcha et lui dit :
– Et moi aussi, cher enfant, je te ferai ce présent, ouvrage des mains de Hélénè, afin que tu le donnes à la femme bien-aimée que tu épouseras. Jusque-là, qu’il reste auprès de ta chère mère. En quittant notre demeure pour la terre de ta patrie, réjouis-toi de mon souvenir.
Ayant ainsi parlé, elle lui mit le péplos entre les mains, et il le reçut avec joie. Et le héros Peisistratros plaça les présents dans une corbeille, et il les admirait dans son âme. Puis, le blond Ménélaos les conduisit dans les demeures où ils s’assirent sur des sièges et sur des thrônes. Et une servante versa, d’une belle aiguière d’or dans un bassin d’argent, de l’eau pour laver leurs mains ; et, devant eux, elle dressa la table polie.
Et l’irréprochable intendante, pleine de grâce pour tous, couvrit la table de pain et de mets nombreux ; et le Boèthoide coupait les viandes et distribuait les parts, et le fils de l’illustre Ménélaos versait le vin. Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux.
Après qu’ils eurent assouvi la faim et la soif, Télémakhos et l’illustre fils de Nestôr, ayant mis les chevaux sous le joug, montèrent sur le beau char et sortirent du vestibule et du portique sonore. Et le blond Ménélaos Atréide allait avec eux, portant à la main une coupe d’or pleine de vin doux, afin de faire une libation avant le départ. Et, se tenant devant les chevaux, il parla ainsi :
– Salut, ô jeunes hommes ! Portez mon salut au prince des peuples Nestôr, qui était aussi doux qu’un père pour moi, quand les fils des Akhaiens combattaient devant Troiè.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ô divin, nous répéterons toutes tes paroles à Nestôr. Plaise aux dieux que, de retour dans Ithakè et dans la demeure d’Odysseus, je puisse dire avec quelle amitié tu m’as reçu, toi dont j’emporte les beaux et nombreux présents.
Et tandis qu’il parlait ainsi, un aigle s’envola à sa droite, portant dans ses serres une grande oie blanche domestique. Les hommes et les femmes le poursuivaient avec des cris ; et l’aigle, s’approchant, passa à la droite des chevaux.
Et tous, l’ayant vu, se réjouirent dans leurs âmes ; et le Nestoride Peisistratos dit le premier :
– Décide, divin Ménélaos, prince des peuples, si un dieu nous envoie ce signe, ou à toi.
Il parla ainsi, et Ménélaos cher à Arès songeait comment il répondrait sagement ; mais Hélénè au large péplos le devança et dit :
– Écoutez-moi, et je prophétiserai ainsi que les immortels me l’inspirent, et je pense que ceci s’accomplira. De même que l’aigle, descendu de la montagne où est sa race et où sont ses petits, a enlevé l’oie dans les demeures, ainsi Odysseus, après avoir beaucoup souffert et beaucoup erré, reviendra dans sa maison et se vengera. Peut-être déjà est-il dans sa demeure, apportant la mort aux prétendants.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Puisse Zeus, le tonnant mari de Hèrè, le vouloir ainsi, et, désormais, je t’adresserai des prières comme à une déesse.
Ayant ainsi parlé, il fouetta les chevaux, et ceux-ci s’élancèrent rapidement par la ville et la plaine. Et, ce jour entier, ils coururent tous deux sous le joug. Et Hèlios tomba, et tous les chemins devinrent sombres.
Et ils arrivèrent à Phèra, dans la demeure de Diokleus, fils d’Orsilokhos que l’Alphéios avait engendré. Et ils y dormirent la nuit, car il leur offrit l’hospitalité. Mais quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, ils attelèrent leurs chevaux, et, montant sur leur beau char, ils sortirent du vestibule et du portique sonore. Et ils excitèrent les chevaux du fouet, et ceux-ci couraient avec ardeur. Et ils parvinrent bientôt à la haute ville de Pylos. Alors Tèlémakhos dit au fils de Nestôr :
– Nestoride, comment accompliras-tu ce que tu m’as promis ? Nous nous glorifions d’être hôtes à jamais, à cause de l’amitié de nos pères, de notre âge qui est le même, et de ce voyage qui nous unira plus encore. Ô divin, ne me conduis pas plus loin que ma nef, mais laisse-moi ici, de peur que le vieillard me retienne malgré moi dans sa demeure, désirant m’honorer ; car il est nécessaire que je parte très promptement.
Il parla ainsi, et le Nestoride délibéra dans son esprit comment il accomplirait convenablement sa promesse. Et, en délibérant, ceci lui sembla la meilleure résolution. Il tourna les chevaux du côté de la nef rapide et du rivage de la mer. Et il déposa les présents splendides sur la poupe de la nef, les vêtements et l’or que Ménélaos avait donnés, et il dit à Tèlémakhos ces paroles ailées :
– Maintenant, monte à la hâte et presse tous tes compagnons, avant que je rentre à la maison et que j’avertisse le vieillard. Car je sais dans mon esprit et dans mon cœur quelle est sa grande âme. Il ne te renverrait pas, et, lui-même, il viendrait ici te chercher, ne voulant pas que tu partes les mains vides. Et, certes, il sera très irrité.
Ayant ainsi parlé, il poussa les chevaux aux belles crinières vers la ville des Pyliens, et il parvint rapidement à sa demeure.
Et aussitôt Tèlémakhos excita ses compagnons :
– Compagnons, préparez les agrès de la nef noire, montons-y et faisons notre route.
Il parla ainsi, et, dès qu’ils l’eurent entendu, ils montèrent sur la nef et s’assirent sur les bancs. Et, tandis qu’ils se préparaient, il suppliait Athènè à l’extrémité de la nef. Et voici qu’un étranger survint, qui, ayant tué un homme, fuyait Argos ; et c’était un divinateur de la race de Mélampous. Et celui-ci habitait autrefois Pylos nourrice de brebis, et il était riche parmi les Pyliens, et il possédait de belles demeures ; mais il s’enfuit loin de sa patrie vers un autre peuple, par crainte du magnanime Nèleus, le plus illustre des vivants, qui lui avait retenu de force ses nombreuses richesses pendant une année, tandis que lui-même était chargé de liens et subissait de nouvelles douleurs dans la demeure de Phylas ; car il avait outragé Iphiklès, à cause de la fille de Nèleus, poussé par la cruelle déesse Érinnys.
Mais il évita la mort, ayant chassé les bœufs mugissants de Phylakè à Pylos et s’étant vengé de l’outrage du divin Nèleus ; et il conduisit vers son frère la jeune fille qu’il avait épousée, et sa destinée fut d’habiter parmi les Argiens qu’il commanda. Là, il s’unit à sa femme et bâtit une haute demeure.
Et il engendra deux fils robustes, Antiphatès et Mantios. Antiphatès engendra le magnanime Oikleus, et Oikleus engendra Amphiaraos, sauveur du peuple, que Zeus tempétueux et Apollon aimèrent au-dessus de tous. Mais il ne parvint pas au seuil de la vieillesse, et il périt à Thèbè, trahi par sa femme que des présents avaient séduite. Et deux fils naquirent de lui, Alkmaôn et Amphilokhos. Et Mantios engendra Polypheideus et Klitos. Mais Éôs au thrône d’or enleva Klitos à cause de sa beauté et le mit parmi les immortels. Et, quand Amphiaraos fut mort, Apollon rendit le magnanime Polypheideus le plus habile des divinateurs. Et celui-ci, irrité contre son père, se retira dans la Hypérèsiè, où il habita, prophétisant pour tous les hommes. Et ce fut son fils qui survint, et il se nommait Théoklyménos. Et, s’arrêtant auprès de Tèlémakhos, qui priait et faisait des libations à l’extrémité de la nef noire, il lui dit ces paroles ailées :
– Ô ami, puisque je te trouve faisant des libations en ce lieu, je te supplie par ces libations, par le dieu invoqué, par ta propre tête et par tes compagnons, dis-moi la vérité et ne me cache rien.
Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Où est ta ville ? Où sont tes parents ?
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Etranger, je te dirai la vérité. Ma famille est d’Ithakè et mon père est Odysseus, s’il vit encore ; mais déjà sans doute il a péri d’une mort lamentable. Je suis venu ici, avec mes compagnons et ma nef noire, pour m’informer de mon père depuis longtemps absent.
Et le divin Théoklyménos lui répondit :
– Moi, je fuis loin de ma patrie, ayant tué un homme. Ses frères et ses compagnons nombreux habitent Argos nourrice de chevaux et commandent aux Akhaiens. Je fuis leur vengeance et la kèr noire, puisque ma destinée est d’errer parmi les hommes. Laisse-moi monter sur ta nef, puisque je viens en suppliant, de peur qu’ils me tuent, car je pense qu’ils me poursuivent.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Certes, je ne te chasserai point de ma nef égale. Suis-moi ; nous t’accueillerons avec amitié et de notre mieux.
Ayant ainsi parlé, il prit la lance d’airain de Théoklyménos et il la déposa sur le pont de la nef aux deux rangs d’avirons ; et il y monta lui-même, et il s’assit sur la poupe, et il y fit asseoir Théoklyménos auprès de lui.
Et ses compagnons détachèrent le câble, et il leur ordonna d’appareiller, et ils se hâtèrent d’obéir. Ils dressèrent le mât de sapin sur le pont creux et ils le soutinrent avec des cordes, et ils déployèrent les blanches voiles tenues ouvertes à l’aide de courroies. Athènè aux yeux clairs leur envoya un vent propice qui soufflait avec force, et la nef courait rapidement sur l’eau salée de la mer. Hèlios tomba et tous les chemins devinrent sombres. Et la nef, poussée par un vent propice de Zeus, dépassa Phéras et la divine Élis où commandent les Épéiens. Puis Tèlémakhos s’engagea entre les îles rocheuses, se demandant s’il éviterait la mort ou s’il serait fait captif.
Mais Odysseus et le divin porcher et les autres pâtres prenaient de nouveau leur repas dans l’étable ; et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, alors Odysseus dit au porcher, afin de voir s’il l’aimait dans son cœur, s’il voudrait le retenir dans l’étable ou s’il l’engagerait à se rendre à la ville :
– Écoutez-moi, Eumaios, et vous, ses compagnons. Je désire aller au matin à la ville, afin d’y mendier et de ne plus vous être à charge. Donnez-moi donc un bon conseil et un conducteur qui me mène. J’irai, errant çà et là, par nécessité, afin qu’on m’accorde à boire et à manger. Et j’entrerai dans la demeure du divin Odysseus, pour en donner des nouvelles à la sage Pènélopéia. Et je me mêlerai aux prétendants insolents, afin qu’ils me donnent à manger, car ils ont des mets en abondance.
Je ferai même aussitôt au milieu d’eux tout ce qu’ils m’ordonneront. Car je te le dis, écoute-moi et retiens mes paroles dans ton esprit : par la faveur du messager Herméias qui honore tous les travaux des hommes, aucun ne pourrait lutter avec moi d’adresse pour allumer du feu, fendre le bois sec et l’amasser afin qu’il brûle bien, préparer le repas, verser le vin et s’acquitter de tous les soins que les pauvres rendent aux riches.
Et le porcher Eumaios, très irrité, lui répondit :
– Hélas ! mon hôte, quel dessein a conçu ton esprit ? Certes, si tu désires te mêler à la foule des prétendants, c’est que tu veux périr. Leur insolence et leur violence sont montées jusqu’à l’Ouranos de fer. Leurs serviteurs ne te ressemblent pas ; ce sont des jeunes hommes vêtus de beaux manteaux et de belles tuniques, beaux de tête et de visage, qui chargent les tables polies de pain, de viandes et de vins. Reste ici ; aucun ne se plaint de ta présence, ni moi, ni mes compagnons. Dès que le cher fils d’Odysseus sera revenu, il te donnera une tunique et un manteau, et il te fera reconduire là où ton âme t’ordonne d’aller.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Plaise aux dieux, Eumaios, que tu sois aussi cher au père Zeus qu’à moi, puisque tu as mis fin à mes courses errantes et à mes peines ; car il n’est rien de pire pour les hommes que d’errer ainsi, et celui d’entre eux qui vagabonde subit l’inquiétude et la douleur et les angoisses d’un ventre affamé.
Maintenant, puisque tu me retiens et que tu m’ordonnes d’attendre Tèlémakhos, parle-moi de la mère du divin Odysseus, et de son père qu’il a laissé en partant sur le seuil de la vieillesse. Vivent-ils encore sous la splendeur de Hèlios, ou sont-ils morts et dans les demeures d’Aidès ?
Et le chef des porchers lui répondit :
– Mon hôte, je te dirai la vérité. Laertès vit encore, mais il supplie toujours Zeus, dans ses demeures, d’enlever son âme de son corps, car il gémit très amèrement sur son fils qui est absent, et sur sa femme qu’il avait épousée vierge ; et la mort de celle-ci l’accable surtout de tristesse et lui fait sentir l’horreur de la vieillesse. Elle est morte d’une mort lamentable par le regret de son illustre fils. Ainsi, bientôt, mourra ici quiconque m’a aimé. Aussi longtemps qu’elle a vécu, malgré sa douleur, elle aimait à me questionner et à m’interroger ; car elle m’avait élevé elle-même, avec son illustre fille Klyménè au large péplos, qu’elle avait enfantée la dernière. Elle m’éleva avec sa fille et elle m’honora non moins que celle-ci. Mais, quand nous fûmes arrivés tous deux à la puberté, Klyménè fut mariée à un Samien qui donna de nombreux présents à ses parents. Et alors Antikléia me donna un manteau, une tunique, de belles sandales, et elle m’envoya aux champs, et elle m’aima plus encore dans son cœur. Et, maintenant, je suis privé de tous ces biens ; mais les dieux ont fécondé mon travail, et, par eux, j’ai mangé et bu, et j’ai donné aux suppliants vénérables.
Cependant, il m’est amer de ne plus entendre les paroles de ma maîtresse ; mais le malheur et des hommes insolents sont entrés dans sa demeure, et les serviteurs sont privés de parler ouvertement à leur maîtresse, de l’interroger, de manger et de boire avec elle et de rapporter aux champs les présents qui réjouissent l’âme des serviteurs.
Et le patient Odysseus lui répondit :
– O dieux ! ainsi, porcher Eumaios, tu as été enlevé tout jeune à ta patrie et à tes parents. Raconte-moi tout, et dis la vérité. La ville aux larges rues a-t-elle été détruite où habitaient ton père et ta mère vénérable, ou des hommes ennemis t’ont-ils saisi, tandis que tu étais auprès de tes brebis ou de tes bœufs, transporté dans leur nef et vendu dans les demeures d’un homme qui donna de toi un bon prix ?
Et le chef des porchers lui répondit :
– Etranger, puisque tu m’interroges sur ces choses, écoute en silence et réjouis-toi de boire ce vin en repos. Les nuits sont longues et laissent le temps de dormir et le temps d’être charmé par les récits. Il ne faut pas que tu dormes avant l’heure, car beaucoup de sommeil fait du mal. Si le cœur et l’âme d’un d’entre ceux-ci lui ordonnent de dormir, qu’il sorte ; et, au lever d’Éôs, après avoir mangé, il conduira les porcs du maître.
Pour nous, mangeant et buvant dans l’étable, nous nous charmerons par le souvenir de nos douleurs ; car l’homme qui a beaucoup souffert et beaucoup erré est charmé par le souvenir de ses douleurs. Je vais donc te répondre, puisque tu m’interroges.
Il y a une île qu’on nomme Syrè, au-dessous d’Ortygiè, du côté où Hèlios tourne. Elle est moins grande, mais elle est agréable et produit beaucoup de bœufs, de brebis, de vin et de froment ; et jamais la famine n’afflige son peuple, ni aucune maladie ne frappe les mortels misérables hommes. Quand les générations ont vieilli dans leur ville, Apollôn à l’arc d’argent et Artémis surviennent et les tuent de leurs flèches illustres. Il y a deux villes qui se sont partagé tout le pays, et mon père Ktèsios Orménide, semblable aux immortels, commandait à toutes deux, quand survinrent des Phoinikes illustres par leurs nefs, habiles et rusés, amenant sur leur nef noire mille choses frivoles. Il y avait dans la demeure de mon père une femme de Phoinikiè, grande, belle et habile aux beaux ouvrages des mains. Et les Phoinikes rusés la séduisirent. Tandis qu’elle allait laver, un d’eux, dans la nef creuse, s’unit à elle par l’amour qui trouble l’esprit des femmes luxurieuses, même de celles qui sont sages. Et il lui demanda ensuite qui elle était et, d’où elle venait ; et, aussitôt, elle lui parla de la haute demeure de son père :
– Je me glorifie d’être de Sidôn riche en airain, et je suis la fille du riche Arybas.
Des pirates Taphiens m’ont enlevée dans les champs, transportée ici dans les demeures de Ktèsios qui leur a donné de moi un bon prix.
Et l’homme lui répondit :
– Certes, si tu voulais revenir avec nous vers tes demeures, tu reverrais la haute maison de ton père et de ta mère, et eux-mêmes, car ils vivent encore et sont riches.
Et la femme lui répondit :
– Que cela soit, si les marins veulent me jurer par serment qu’ils me reconduiront saine et sauve.
Elle parla ainsi, et tous le lui jurèrent, et, après qu’ils eurent juré et prononcé toutes les paroles du serment, la femme leur dit encore :
– Maintenant, qu’aucun de vous, me rencontrant, soit dans la rue, soit à la fontaine, ne me parle, de peur qu’on le dise au vieillard ; car, me soupçonnant, il me chargerait de liens et méditerait votre mort. Mais gardez mes paroles dans votre esprit, et hâtez-vous d’acheter des vivres. Et quand la nef sera chargée de provisions, qu’un messager vienne promptement m’avertir dans la demeure. Je vous apporterai tout l’or qui me tombera sous les mains, et même je vous ferai, selon mon désir, un autre présent.
J’élève, en effet, dans les demeures, le fils de Ktèsios, un enfant remuant et courant dehors. Je le conduirai dans la nef, et vous en aurez un grand prix en le vendant à des étrangers.
Ayant ainsi parlé, elle rentra dans nos belles demeures. Et les Phoinikes restèrent toute une année auprès de nous, rassemblant de nombreuses richesses dans leur nef creuse. Et quand celle-ci fut pleine, ils envoyèrent à la femme un messager pour lui annoncer qu’ils allaient partir. Et ce messager plein de ruses vint à la demeure de mon père avec un collier d’or orné d’émaux. Et ma mère vénérable et toutes les servantes se passaient ce collier de mains en mains et l’admiraient, et elles lui offrirent un prix ; mais il ne répondit rien ; et, ayant fait un signe à la femme, il retourna vers la nef. Alors, la femme, me prenant par la main, sortit de la demeure. Et elle trouva dans le vestibule des coupes d’or sur les tables des convives auxquels mon père avait offert un repas. Et ceux-ci s’étaient rendus à l’agora du peuple. Elle saisit aussitôt trois coupes qu’elle cacha dans son sein, et elle sortit, et je la suivis sans songer à rien. Hèlios tomba, et tous les chemins devinrent sombres ; et nous arrivâmes promptement au port où était la nef rapide des Phoinikes qui, nous ayant mis dans la nef, y montèrent et sillonnèrent les chemins humides ; et Zeus leur envoya un vent propice. Et nous naviguâmes pendant six jours et six nuits ; mais quand le Kroniôn Zeus amena le septième jour, Artémis, qui se réjouit de ses flèches, tua la femme, qui tomba avec bruit dans la sentine comme une poule de mer et les marins la jetèrent pour être mangée par les poissons et par les phoques, et je restai seul, gémissant dans mon cœur.
Et le vent et le flot poussèrent les Phoinikes jusqu’à Ithakè, où Laertès m’acheta de ses propres richesses. Et c’est ainsi que j’ai vu de mes yeux cette terre.
Et le divin Odysseus lui répondit :
– Eumaios, certes, tu as profondément ému mon cœur en me racontant toutes les douleurs que tu as déjà subies : mais Zeus a mêlé pour toi le bien au mal, puisque tu es entré, après avoir beaucoup souffert, dans la demeure d’un homme excellent qui t’a donné abondamment à boire et à manger, et chez qui ta vie est paisible ; mais moi, je ne suis arrivé ici qu’après avoir erré à travers de nombreuses villes des hommes !
Et ils se parlaient ainsi. Puis ils s’endormirent, mais peu de temps ; et, aussitôt, Éôs au beau thrône parut.
Pendant ce temps les compagnons de Tèlémakhos, ayant abordé, plièrent les voiles et abattirent le mât et conduisirent la nef dans le port, à force d’avirons. Puis, ils jetèrent les ancres et lièrent les câbles. Puis, étant sortis de la nef, ils préparèrent leur repas sur le rivage de la mer et mêlèrent le vin rouge. Et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, le prudent Tèlémakhos leur dit :
– Conduisez la nef noire à la ville ; moi, j’irai vers mes champs et mes bergers.
Ce soir, je m’en reviendrai après avoir vu les travaux des champs ; et demain, au matin, je vous offrirai, pour ce voyage, un bon repas de viandes et de vin doux.
Et, alors, le divin Théoklyménos lui dit :
– Et moi, cher enfant, où irai-je ? Quel est celui des hommes qui commandent dans l’âpre Ithakè dont je dois gagner la demeure ? Dois-je me rendre auprès de ta mère, dans ta propre maison ?
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Je ne te dirais point de te rendre à une autre demeure que la mienne, et les dons hospitaliers ne t’y manqueraient pas ; mais ce serait le pire pour toi. Je serais absent, et ma mère ne te verrait point, car elle tisse la toile, loin des prétendants, dans la chambre supérieure ; mais je t’indiquerai un autre homme vers qui tu iras, Eurymakhos, illustre fils du prudent Polybos, que les Ithakèsiens regardent comme un dieu. C’est de beaucoup l’homme le plus illustre, et il désire ardemment épouser ma mère et posséder les honneurs d’Odysseus. Mais l’olympien Zeus qui habite l’aithèr sait s’ils ne verront pas tous leur dernier jour avant leurs noces.
Il parlait ainsi quand un épervier, rapide messager d’Apollôn, vola à sa droite, tenant entre ses serres une colombe dont il répandait les plumes entre la nef et Tèlémakhos.
Alors Théoklyménos, entraînant celui-ci loin de ses compagnons, le prit par la main et lui dit :
– Tèlémakhos, cet oiseau ne vole point à ta droite sans qu’un dieu l’ait voulu. Je reconnais, l’ayant regardé, que c’est un signe augural. Il n’y a point de race plus royale que la vôtre dans Ithakè, et vous y serez toujours puissants.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit aussitôt :
– Plaise aux dieux, étranger, que ta parole s’accomplisse ! Je t’aimerai, et je te ferai de nombreux présents, et nul ne pourra se dire plus heureux que toi.
Il parla ainsi, et il dit à son fidèle compagnon Peiraios :
– Peiraios Klytide, tu m’es le plus cher des compagnons qui m’ont suivi à Pylos. Conduis maintenant cet étranger dans ta demeure ; aie soin de lui et honore-le jusqu’à ce que je revienne.
Et Peiraios illustre par sa lance lui répondit :
– Tèlémakhos, quand même tu devrais rester longtemps ici, j’aurai soin de cet étranger, et rien ne lui manquera de ce qui est dû à un hôte.
Ayant ainsi parlé, il entra dans la nef, et il ordonna à ses compagnons d’y monter et de détacher les câbles.
Et Tèlémakhos, ayant lié de belles sandales à ses pieds, prit sur le pont de la nef une lance solide et brillante à pointe d’airain. Et, tandis que ses compagnons détachaient les câbles et naviguaient vers la ville, comme l’avait ordonné Tèlémakhos, le cher fils du divin Odysseus, les pieds du jeune homme le portaient rapidement vers l’étable où étaient enfermés ses nombreux porcs auprès desquels dormait le porcher fidèle et attaché à ses maîtres.Chant 16
Au lever d’Éôs, Odysseus et le divin porcher préparèrent le repas, et ils allumèrent le feu, et ils envoyèrent les pâtres avec les troupeaux de porcs. Alors les chiens aboyeurs n’aboyèrent pas à l’approche de Tèlémakhos, mais ils remuaient la queue. Et le divin Odysseus, les ayant vus remuer la queue et ayant entendu un bruit de pas, dit à Eumaios ces paroles ailées :
– Eumaios, certes, un de tes compagnons approche, ou un homme bien connu, car les chiens n’aboient point, et ils remuent la queue, et j’entends un bruit de pas.
Il avait à peine ainsi parlé, quand son cher fils s’arrêta sous le portique. Et le porcher stupéfait s’élança, et le vase dans lequel il mêlait le vin rouge tomba de ses mains ; et il courut au-devant du maître, et il baisa sa tête, ses beaux yeux et ses mains, et il versait des larmes, comme un père plein de tendresse qui revient d’une terre lointaine, dans la dixième année, et qui embrasse son fils unique, engendré dans sa vieillesse, et pour qui il a souffert bien des maux. Ainsi le porcher couvrait de baisers le divin Tèlémakhos ; et il l’embrassait comme s’il eût échappé à la mort, et il lui dit, en pleurant, ces paroles ailées :
– Tu es donc revenu, Tèlémakhos, douce lumière. Je pensais que je ne te reverrais plus, depuis ton départ pour Pylos. Hâte-toi d’entrer, cher enfant, afin que je me délecte à te regarder, toi qui reviens de loin.
Car tu ne viens pas souvent dans tes champs et vers tes pâtres ; mais tu restes loin d’eux, et il te plaît de surveiller la multitude funeste des prétendants.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Qu’il en soit comme tu le désires, père. C’est pour toi que je suis venu, afin de te voir de mes yeux et de t’entendre, et pour que tu me dises si ma mère est restée dans nos demeures, ou si quelqu’un l’a épousée. Certes, peut-être le lit d’Odysseus, étant abandonné, reste-t-il en proie aux araignées immondes.
Et le chef des porchers lui répondit :
– Ta mère est restée, avec un cœur patient, dans tes demeures ; elle pleure nuit et jour, accablée de chagrins.
Ayant ainsi parlé, il prit sa lance d’airain. Et Tèlémakhos entra et passa le seuil de pierre. Et son père Odysseus voulut lui céder sa place ; mais Tèlémakhos le retint et lui dit :
– Assieds-toi, ô étranger. Je trouverai un autre siège dans cette étable, et voici un homme qui me le préparera.
Il parla ainsi, et Odysseus se rassit, et le porcher amassa des branches vertes et mit une peau par-dessus, et le cher fils d’Odysseus s’y assit.
Puis le porcher plaça devant eux des plateaux de chairs rôties que ceux qui avaient mangé la veille avaient laissées. Et il entassa à la hâte du pain dans des corbeilles, et il mêla le vin rouge dans un vase grossier, et il s’assit en face du divin Odysseus. Puis, ils étendirent les mains vers la nourriture placée devant eux. Et, après qu’ils eurent assouvi la faim et la soif, Tèlémakhos dit au divin porcher :
– Dis-moi, père, d’où vient cet étranger ? Comment des marins l’ont-ils amené à Ithakè ? Qui se glorifie-t-il d’être ? Car je ne pense pas qu’il soit venu ici à pied.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Certes, mon enfant, je te dirai la vérité. Il se glorifie d’être né dans la grande Krètè. Il dit qu’en errant il a parcouru de nombreuses villes des hommes, et, sans doute, un dieu lui a fait cette destinée. Maintenant, s’étant échappé d’une nef de marins Thesprôtes, il est venu dans mon étable, et je te le confie. Fais de lui ce que tu veux. Il dit qu’il est ton suppliant.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Eumaios, certes, tu as prononcé une parole douloureuse. Comment le recevrais-je dans ma demeure ? Je suis jeune et je ne pourrais réprimer par la force de mes mains un homme qui l’outragerait le premier.
L’esprit de ma mère hésite, et elle ne sait si, respectant le lit de son mari et la voix du peuple, elle restera dans sa demeure pour en prendre soin, ou si elle suivra le plus illustre d’entre les Akhaiens qui l’épousera et lui fera de nombreux présents. Mais, certes, puisque cet étranger est venu dans ta demeure, je lui donnerai de beaux vêtements, un manteau et une tunique, une épée à double tranchant et des sandales, et je le renverrai où son cœur désire aller. Si tu y consens, garde-le dans ton étable. J’enverrai ici des vêtements et du pain, afin qu’il mange et qu’il ne soit point à charge à toi et à tes compagnons. Mais je ne le laisserai point approcher des prétendants, car ils ont une grande insolence, de peur qu’ils l’outragent, ce qui me serait une amère douleur. Que pourrait faire l’homme le plus vigoureux contre un si grand nombre ? Ils seront toujours les plus forts.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Ô ami, certes, puisqu’il m’est permis de répondre, mon cœur est déchiré de t’entendre dire que les prétendants, malgré toi, et tel que te voilà, commettent de telles iniquités dans tes demeures. Dis-moi si tu leur cèdes volontairement, ou si les peuples, obéissant aux dieux, te haïssent ? Accuses-tu tes frères ? Car c’est sur leur appui qu’il faut compter, quand une dissension publique s’élève. Plût aux dieux que je fusse jeune comme toi, étant plein de courage, ou que je fusse le fils irréprochable d’Odysseus, ou lui-même, et qu’il revînt, car tout espoir n’en est point perdu !
Je voudrais qu’un ennemi me coupât la tête, si je ne partais aussitôt pour la demeure du Laertiade Odysseus, pour être leur ruine à tous ! Et si, étant seul, leur multitude me domptait, j’aimerais mieux être tué dans mes demeures que de voir ces choses honteuses : mes hôtes maltraités, mes servantes misérablement violées dans mes belles demeures, mon vin épuisé, mes vivres dévorés effrontément, et cela pour un dessein inutile qui ne s’accomplira point !
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Étranger, je te dirai la vérité. Le peuple n’est point irrité contre moi, et je n’accuse point de frères sur l’appui desquels il faut compter, quand une dissension publique s’élève. Le Kroniôn n’a donné qu’un seul fils à chaque génération de toute notre race. Arkeisios n’a engendré que le seul Laertès, et Laertès n’a engendré que le seul Odysseus, et Odysseus n’a engendré que moi dans ses demeures où il m’a laissé et où il n’a point été caressé par moi. Et, maintenant, de nombreux ennemis sont dans ma demeure. Ceux qui dominent dans les îles, à Doulikhios, à Samè, à Zakynthos couverte de bois, et ceux qui dominent dans l’âpre Ithakè, tous recherchent ma mère et ruinent ma maison. Et ma mère ne refuse ni n’accepte ces noces odieuses ; et tous mangent mes biens, ruinent ma maison, et bientôt ils me tueront moi-même. Mais, certes, ces choses sont sur les genoux des dieux. Va, père Eumaios, et dis à la prudente Pènélopéia que je suis sauvé et revenu de Pylos. Je resterai ici.
Reviens, n’ayant parlé qu’à elle seule ; et qu’aucun des autres Akhaiens ne t’entende, car tous méditent ma perte.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– J’entends et je comprends ce que tu m’ordonnes de faire. Mais dis-moi la vérité, et si, dans ce même voyage, je porterai cette nouvelle à Laertès qui est malheureux. Auparavant, bien que gémissant sur Odysseus, il surveillait les travaux, et, quand son âme le lui ordonnait, il buvait et mangeait avec ses serviteurs dans sa maison ; mais depuis que tu es parti sur une nef pour Pylos, on dit qu’il ne boit ni ne mange et qu’il ne surveille plus les travaux, mais qu’il reste soupirant et gémissant, et que son corps se dessèche autour de ses os.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Cela est très triste ; mais cependant ne va pas à lui malgré sa douleur. Si les destinées pouvaient être choisies par les hommes, nous nous choisirions le jour du retour de mon père. Reviens donc après avoir parlé à ma mère, et ne t’éloigne pas vers Laertès et vers ses champs ; mais dis à ma mère d’envoyer promptement, et en secret, l’intendante annoncer mon retour au vieillard.
Il parla ainsi, excitant le porcher qui attacha ses sandales à ses pieds et partit pour la ville.
Mais le porcher Eumaios ne cacha point son départ à Athènè, et celle-ci apparut, semblable à une femme belle, grande et habile aux beaux ouvrages. Et elle s’arrêta sur le seuil de l’étable, étant visible seulement à Odysseus ; et Tèlémakhos ne la vit pas, car les dieux ne se manifestent point à tous les hommes. Et Odysseus et les chiens la virent, et les chiens n’aboyèrent point, mais ils s’enfuirent en gémissant au fond de l’étable. Alors Athènè fit un signe avec ses sourcils, et le divin Odysseus le comprit, et, sortant, il se rendit au-delà du grand mur de l’étable ; et il s’arrêta devant Athènè, qui lui dit :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, parle maintenant à ton fils et ne lui cache rien, afin de préparer le carnage et la mort des prétendants et d’aller à la ville. Je ne serai pas longtemps loin de vous et j’ai hâte de combattre.
Athènè parla ainsi, et elle le frappa de sa baguette d’or. Et elle le couvrit des beaux vêtements qu’il portait auparavant, et elle le grandit et le rajeunit ; et ses joues devinrent plus brillantes, et sa barbe devint noire. Et Athènè, ayant fait cela, disparut.
Alors Odysseus rentra dans l’étable, et son cher fils resta stupéfait devant lui ; et il détourna les yeux, craignant que ce fût un dieu, et il lui dit ces paroles ailées :
– Étranger, tu m’apparais tout autre que tu étais auparavant ; tu as d’autres vêtements et ton corps n’est plus le même.
Si tu es un des dieux qui habitent le large Ouranos, apaise-toi. Nous t’offrirons de riches sacrifices et nous te ferons des présents d’or. Épargne-nous.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Je ne suis point un des dieux. Pourquoi me compares-tu aux dieux ? Je suis ton père, pour qui tu soupires et pour qui tu as subi de nombreuses douleurs et les outrages des hommes.
Ayant ainsi parlé, il embrassa son fils, et ses larmes coulèrent de ses joues sur la terre, car il les avait retenues jusque-là. Mais Tèlémakhos, ne pouvant croire que ce fût son père, lui dit de nouveau :
– Tu n’es pas mon père Odysseus, mais un dieu qui me trompe, afin que je soupire et que je gémisse davantage. Jamais un homme mortel ne pourrait, dans son esprit, accomplir de telles choses, si un dieu, survenant, ne le faisait, aisément, et comme il le veut, paraître jeune ou vieux. Certes, tu étais vieux, il y a peu de temps, et vêtu misérablement, et voici que tu es semblable aux dieux qui habitent le large Ouranos.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Tèlémakhos, il n’est pas bien à toi, devant ton cher père, d’être tellement surpris et de rester stupéfait.
Jamais plus un autre Odysseus ne reviendra ici. C’est moi qui suis Odysseus et qui ai souffert des maux innombrables, et qui reviens, après vingt années, dans la terre de la patrie. C’est la dévastatrice Athènè qui a fait ce prodige. Elle me fait apparaître tel qu’il lui plaît, car elle le peut. Tantôt elle me rend semblable à un mendiant, tantôt à un homme jeune ayant de beaux vêtements sur son corps ; car il est facile aux dieux qui habitent le large Ouranos de glorifier un homme mortel ou de le rendre misérable.
Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors Tèlémakhos embrassa son brave père en versant des larmes. Et le désir de pleurer les saisit tous les deux, et ils pleuraient abondamment, comme les aigles aux cris stridents, ou les vautours aux serres recourbées, quand les pâtres leur ont enlevé leurs petits avant qu’ils pussent voler. Ainsi, sous leurs sourcils, ils versaient des larmes. Et, avant qu’ils eussent cessé de pleurer, la lumière de Hèlios fût tombée, si Tèlémakhos n’eût dit aussitôt à son père :
– Père, quels marins t’ont conduit sur leur nef dans Ithakè ? Quels sont-ils ? Car je ne pense pas que tu sois venu ici à pied.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Mon enfant, je te dirai la vérité. Les illustres marins Phaiakiens m’ont amené, car ils ont coutume de reconduire tous les hommes qui viennent chez eux.
M’ayant amené, à travers la mer, dormant sur leur nef rapide, ils m’ont déposé sur la terre d’Ithakè ; et ils m’ont donné en abondance des présents splendides, de l’airain, de l’or et de beaux vêtements. Par le conseil des dieux toutes ces choses sont déposées dans une caverne ; et je suis venu ici, averti par Athènè, afin que nous délibérions sur le carnage de nos ennemis. Dis-moi donc le nombre des prétendants, pour que je sache combien d’hommes braves ils sont ; et je verrai, dans mon cœur irréprochable, si nous devons les combattre seuls, ou si nous chercherons un autre appui.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ô père, certes, j’ai appris ta grande gloire, et je sais que tu es très brave et plein de sagesse ; mais tu as dit une grande parole, et la stupeur me saisit, car deux hommes seuls ne peuvent lutter contre tant de robustes guerriers. Les prétendants ne sont pas seulement dix, ou deux fois dix, mais ils sont beaucoup plus, et je vais te dire leur nombre, afin que tu le saches. Il y a d’abord cinquante-deux jeunes hommes choisis de Doulikhios, suivis de six serviteurs ; puis vingt-quatre de Samè ; puis vingt jeunes Akhaiens de Zakynthos ; puis les douze plus braves, qui sont d’Ithakè. Avec ceux-ci se trouvent Médôn, héraut et aoide divin, et deux serviteurs habiles à préparer les repas. Si nous les attaquons tous ainsi réunis, vois si tu ne souffriras point amèrement et terriblement de leur violence. Mais tu peux appeler à notre aide un allié qui nous secoure d’un cœur empressé.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Je te le dis. Écoute-moi avec attention. Vois si Athènè et son père Zeus suffiront, et si je dois appeler un autre allié à l’aide.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ceux que tu nommes sont les meilleurs alliés. Ils sont assis dans les hautes nuées, et ils commandent aux hommes et aux dieux immortels.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Ils ne seront pas longtemps éloignés, dans la rude mêlée, quand la force d’Arès décidera entre nous et les prétendants dans nos demeures. Mais toi, dès le lever d’Éôs, retourne à la maison et parle aux prétendants insolents. Le porcher me conduira ensuite à la ville, semblable à un vieux mendiant. S’ils m’outragent dans nos demeures, que ton cher cœur supporte avec patience mes souffrances. Même s’ils me traînaient par les pieds hors de la maison, même s’ils me frappaient de leurs armes, regarde tout patiemment. Par des paroles flatteuses, demande-leur seulement de cesser leurs outrages. Mais ils ne t’écouteront point, car leur jour fatal est proche. Quand Athènè aux nombreux conseils aura averti mon esprit, je te ferai signe de la tête, et tu me comprendras. Transporte alors dans le réduit de la chambre haute toutes les armes d’Arès qui sont dans la grande salle.
Et si les prétendants t’interrogent sur cela, dis-leur en paroles flatteuses : « Je les ai mises à l’abri de la fumée, car elles ne sont plus telles qu’elles étaient autrefois, quand Odysseus les laissa à son départ pour Troiè ; mais elles sont souillées par la grande vapeur du feu. Puis, le Kroniôn m’a inspiré une autre pensée meilleure, et je crains qu’excités par le vin, et une querelle s’élevant parmi vous, vous vous blessiez les uns les autres et vous souilliez le repas et vos noces futures, car le fer attire l’homme. » Tu laisseras pour nous seuls deux épées, deux lances, deux boucliers, que nous puissions saisir quand nous nous jetterons sur eux. Puis, Pallas Athènè et le très sage Zeus leur troubleront l’esprit. Maintenant, je te dirai autre chose. Retiens ceci dans ton esprit. Si tu es de mon sang, que nul ne sache qu’Odysseus est revenu, ni Laertès, ni le porcher, ni aucun des serviteurs, ni Pènélopéia elle-même. Que seuls, toi, et moi, nous connaissions l’esprit des servantes et des serviteurs, afin de savoir quel est celui qui nous honore et qui nous respecte dans son cœur, et celui qui n’a point souci de nous et qui te méprise.
Et son illustre fils lui répondit :
– Ô père, certes, je pense que tu connaîtras bientôt mon courage, car je ne suis ni paresseux ni mou ; mais je pense aussi que ceci n’est pas aisé pour nous deux, et je te demande d’y songer. Tu serais longtemps à éprouver chaque serviteur en parcourant les champs, tandis que les prétendants, tranquilles dans tes demeures, dévorent effrontément tes richesses et n’en épargnent rien.
Mais tâche de reconnaître les servantes qui t’outragent et celles qui sont fidèles. Cependant, il ne faut pas éprouver les serviteurs dans les demeures. Fais-le plus tard, si tu as vraiment quelque signe de Zeus tempétueux.
Et tandis qu’ils se parlaient ainsi, la nef bien construite qui avait porté Tèlémakhos et tous ses compagnons à Pylos était arrivée à Ithakè et entra dans le port profond. Là, ils traînèrent la nef noire à terre. Puis, les magnanimes serviteurs enlevèrent tous les agrès et portèrent aussitôt les splendides présents dans les demeures de Klytios. Puis, ils envoyèrent un messager à la demeure d’Odysseus, afin d’annoncer à la prudente Pènélopéia que Tèlémakhos était allé aux champs, après avoir ordonné de conduire la nef à la ville, et pour que l’illustre reine, rassurée, ne versât plus de larmes. Et leur messager et le divin porcher se rencontrèrent, chargés du même message pour la noble femme. Mais quand ils furent arrivés à la demeure du divin roi, le héraut dit, au milieu des servantes :
– Ton cher fils, ô reine, est arrivé.
Et le porcher, s’approchant de Pènélopéia, lui répéta tout ce que son cher fils avait ordonné de lui dire. Et, après avoir accompli son message, il se hâta de rejoindre ses porcs, et il quitta les cours et la demeure.
Et les prétendants, attristés et soucieux dans l’âme, sortirent de la demeure et s’assirent auprès du grand mur de la cour, devant les portes. Et, le premier, Eurymakhos, fils de Polybos, leur dit :
– Ô amis, certes, une audacieuse entreprise a été accomplie, ce voyage de Tèlémakhos, que nous disions qu’il n’accomplirait pas. Traînons donc à la mer une solide nef noire et réunissons très promptement des rameurs qui avertiront nos compagnons de revenir à la hâte.
Il n’avait pas achevé de parler, quand Amphinomos, tourné vers la mer, vit une nef entrer dans le port profond. Et les marins, ayant serré les voiles, ne se servaient que des avirons. Alors, il se mit à rire, et il dit aux prétendants :
– N’envoyons aucun message. Les voici entrés. Ou quelque dieu les aura avertis, ou ils ont vu revenir l’autre nef et n’ont pu l’atteindre.
Il parla ainsi, et tous, se levant, coururent au rivage de la mer. Et aussitôt les marins traînèrent la nef noire à terre, et les magnanimes serviteurs enlevèrent tous les agrès. Puis ils se rendirent tous à l’agora ; et ils ne laissèrent s’asseoir ni les jeunes, ni les vieux. Et Antinoos, fils d’Eupeithès, leur dit :
– Ô amis, les dieux ont préservé cet homme de tout mal. Tous les jours, de nombreuses sentinelles étaient assises sur les hauts rochers battus des vents.
Même à la chute de Hèlios, jamais nous n’avons dormi à terre ; mais, naviguant sur la nef rapide, nous attendions la divine Éôs, épiant Tèlémakhos afin de le tuer au passage. Mais quelque Dieu l’a reconduit dans sa demeure. Délibérons donc ici sur sa mort. Il ne faut pas que Tèlémakhos nous échappe, car je ne pense pas que, lui vivant, nous accomplissions notre dessein. Il est, en effet, plein de sagesse et d’intelligence, et, déjà, les peuples ne nous sont pas favorables. Hâtons-nous avant qu’il réunisse les Akhaiens à l’agora, car je ne pense pas qu’il tarde à le faire. Il excitera leur colère, et il dira, se levant au milieu de tous, que nous avons médité de le tuer, mais que nous ne l’avons point rencontré. Et, l’ayant entendu, ils n’approuveront point ce mauvais dessein. Craignons qu’ils méditent notre malheur, qu’ils nous chassent dans nos demeures, et que nous soyons contraints de fuir chez des peuples étrangers. Prévenons Tèlémakhos en le tuant loin de la ville, dans les champs, ou dans le chemin. Nous prendrons sa vie et ses richesses que nous partagerons également entre nous, et nous donnerons cette demeure à sa mère, quel que soit celui qui l’épousera. Si mes paroles ne vous plaisent pas, si vous voulez qu’il vive et conserve ses biens paternels, ne consumons pas, assemblés ici, ses chères richesses ; mais que chacun de nous, retiré dans sa demeure, recherche Pènélopéia à l’aide de présents, et celui-là l’épousera qui lui fera le plus de présents et qui l’obtiendra par le sort.
Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et, alors, Amphinomos, l’illustre fils du roi Nisos Arètiade, leur parla.
C’était le chef des prétendants venus de Doulikhios herbue et fertile en blé, et il plaisait plus que les autres à Pènélopéia par ses paroles et ses pensées. Et il leur parla avec prudence, et il leur dit :
– Ô amis, je ne veux point tuer Tèlémakhos. Il est terrible de tuer la race des rois. Mais interrogeons d’abord les desseins des dieux. Si les lois du grand Zeus nous approuvent, je tuerai moi-même Tèlémakhos et j’exciterai les autres à m’imiter ; mais si les dieux nous en détournent, je vous engagerai à ne rien entreprendre.
Amphinomos parla ainsi, et ce qu’il avait dit leur plut. Et, aussitôt, ils se levèrent et entrèrent dans la demeure d’Odysseus, et ils s’assirent sur des thrônes polis. Et, alors, la prudente Pènélopéia résolut de paraître devant les prétendants très injurieux. En effet, elle avait appris la mort destinée à son fils dans les demeures. Le héraut Médôn, qui savait leurs desseins, les lui avait dits. Et elle se hâta de descendre dans la grande salle avec ses femmes. Et quand la noble femme se fut rendue auprès des prétendants, elle s’arrêta sur le seuil de la belle salle, avec un beau voile sur les joues. Et elle réprimanda Antinoos et lui dit :
– Antinoos, injurieux et mauvais, on dit que tu l’emportes sur tes égaux en âge, parmi le peuple d’Ithakè, par ta sagesse et par tes paroles. Mais tu n’es point ce qu’on dit. Insensé ! Pourquoi médites-tu le meurtre et la mort de Tèlémakhos ?
Tu ne te soucies point des prières des suppliants ; mais Zeus n’est-il pas leur témoin ? C’est une pensée impie que de méditer la mort d’autrui. Ne sais-tu pas que ton père s’est réfugié ici, fuyant le peuple qui était très irrité contre lui ? Avec des pirates Taphiens, il avait pillé les Thesprôtes qui étaient nos amis, et le peuple voulait le tuer, lui déchirer le cœur et dévorer ses nombreuses richesses. Mais Odysseus les en empêcha et les retint. Et voici que, maintenant, tu ruines honteusement sa maison, tu recherches sa femme, tu veux tuer son fils et tu m’accables moi-même de douleurs ! Je t’ordonne de t’arrêter et de faire que les autres s’arrêtent.
Et Eurymakhos, fils de Polybos, lui répondit :
– Fille d’Ikarios, sage Pènélopéia, reprends courage et n’aie point ces inquiétudes dans ton esprit. L’homme n’existe point et n’existera jamais qui, moi vivant et les yeux ouverts, portera la main sur ton fils Tèlémakhos. Je le dis, en effet, et ma parole s’accomplirait : aussitôt son sang noir ruissellerait autour de ma lance. Souvent, le destructeur de citadelles Odysseus, me faisant asseoir sur ses genoux, m’a offert de ses mains de la chair rôtie et du vin rouge. C’est pourquoi Tèlémakhos m’est le plus cher de tous les hommes. Je l’invite à ne point craindre la mort de la part des prétendants mais on ne peut l’éviter de la part d’un dieu.
Il parla ainsi, la rassurant, et il méditait la mort de Tèlémakhos.
Et Pènélopéia remonta dans la haute chambre splendide, où elle pleura son cher mari Odysseus, jusqu’à ce que Athènè aux yeux clairs eut répandu le doux sommeil sur ses paupières.
Et, vers le soir, le divin porcher revint auprès d’Odysseus et de son fils. Et ceux-ci, sacrifiant un porc d’un an, préparaient le repas dans l’étable. Mais Athènè s’approchant du Laertiade Odysseus, et le frappant de sa baguette, l’avait de nouveau rendu vieux. Et elle lui avait couvert le corps de haillons, de peur que le porcher, le reconnaissant, allât l’annoncer à la prudente Pènélopéia qui oublierait peut-être sa prudence.
Et, le premier, Tèlémakhos lui dit :
– Tu es revenu, divin Eumaios ! Que dit-on dans la ville ? Les prétendants insolents sont-ils de retour de leur embuscade, ou sont-ils encore à m’épier au passage ?
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Je ne me suis point inquiété de cela en traversant la ville, car mon cœur m’a ordonné de revenir très promptement ici, après avoir porté mon message ; mais j’ai rencontré un héraut rapide envoyé par tes compagnons, et qui a, le premier, parlé à ta mère. Mais je sais ceci, et mes yeux l’ont vu : étant hors de la ville, sur la colline de Herméias, j’ai vu une nef rapide entrer dans le port.
Elle portait beaucoup d’hommes, et elle était chargée de boucliers et de lances à deux pointes. Je pense que c’étaient les prétendants eux-mêmes, mais je n’en sais rien.
Il parla ainsi, et la force sacrée de Tèlémakhos se mit à rire en regardant son père à l’insu du porcher. Et, après avoir terminé leur travail, ils préparèrent le repas, et ils mangèrent, et aucun, dans son âme, ne fut privé d’une part égale. Et, quand ils eurent assouvi la soif et la faim, ils se couchèrent et s’endormirent.Chant 17
Quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, Tèlémakhos, le cher fils du divin Odysseus, attacha de belles sandales à ses pieds, saisit une lance solide qui convenait à ses mains, et, prêt à partir pour la ville, il dit au porcher :
– Père, je vais à la ville, afin que ma mère me voie, car je ne pense pas qu’elle cesse, avant de me revoir, de pleurer et de gémir. Et je t’ordonne ceci. Mène à la ville ce malheureux étranger afin qu’il y mendie sa nourriture. Celui qui voudra lui donner à manger et à boire le fera. Je ne puis, accablé moi-même de douleurs, supporter tous les hommes. Si cet étranger s’en irrite, ceci sera plus cruel pour lui ; mais, certes, j’aime à parler sincèrement.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Ô ami, je ne désire point être retenu ici. Il vaut mieux mendier sa nourriture à la ville qu’aux champs. Me donnera qui voudra. Je ne veux point rester davantage dans tes étables afin d’obéir à tous les ordres d’un chef. Va donc, et celui-ci me conduira, comme tu le lui ordonnes, dès que je me serai réchauffé au feu et que la chaleur sera venue : car, n’ayant que ces haillons, je crains que le froid du matin me saisisse, et on dit que la ville est loin d’ici.
Il parla ainsi, et Tèlémakhos sortit de l’étable et marcha rapidement en méditant la perte des prétendants.
Puis, étant arrivé aux demeures bien peuplées, il appuya sa lance contre une haute colonne, et il entra, passant le seuil de pierre. Et, aussitôt, la nourrice Eurykléia, qui étendait des peaux sur les thrônes bien travaillés, le vit la première. Et elle s’élança, fondant en larmes. Et les autres servantes du patient Odysseus se rassemblèrent autour de lui, et elles l’entouraient de leurs bras, baisant sa tête et ses épaules. Et la sage Pènélopéia sortit à la hâte de la chambre nuptiale, semblable à Artémis ou à Aphroditè d’or. Et, en pleurant, elle jeta ses bras autour de son cher fils, et elle baisa sa tête et ses beaux yeux, et elle lui dit, en gémissant, ces paroles ailées :
– Tu es donc revenu, Tèlémakhos, douce lumière. Je pensais ne plus te revoir depuis que tu es allé sur une nef à Pylos, en secret et contre mon gré, afin de t’informer de ton cher père. Mais dis-moi promptement ce que tu as appris.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ma mère, n’excite point mes larmes et ne remue point mon cœur dans ma poitrine, à moi qui viens d’échapper à la mort. Mais baigne ton corps, prends des vêtements frais, monte avec tes servantes dans les chambres hautes et voue à tous les dieux de complètes hécatombes que tu sacrifieras si Zeus m’accorde de me venger. Pour moi, je vais à l’agora, où je vais chercher un hôte qui m’a suivi quand je suis revenu.
Je l’ai envoyé en avant avec mes divins compagnons, et j’ai ordonné à Peiraios de l’emmener dans sa demeure, de prendre soin de lui et de l’honorer jusqu’à ce que je vinsse.
Il parla ainsi, et sa parole ne fut pas vaine. Et Pénèlopéia baigna son corps, prit des vêtements frais, monta avec ses servantes dans les chambres hautes et voua à tous les dieux de complètes hécatombes qu’elle devait leur sacrifier si Zeus accordait à son fils de se venger.
Tèlémakhos sortit ensuite de sa demeure, tenant sa lance. Et deux chiens aux pieds rapides le suivaient, et Athènè répandit sur lui une grâce divine. Tous les peuples l’admiraient au passage ; et les prétendants insolents s’empressèrent autour de lui, le félicitant à l’envi, mais, au fond de leur âme, méditant son malheur. Et il se dégagea de leur multitude et il alla s’asseoir là où étaient Mentôr, Antiphos et Halithersès, qui étaient d’anciens amis de son père. Il s’assit là, et ils l’interrogèrent sur chaque chose. Et Peiraios illustre par sa lance vint à eux, conduisant son hôte à l’agora, à travers la ville. Et Tèlémakhos ne tarda pas à se tourner du côté de l’étranger. Mais Peiraios dit le premier :
– Tèlémakhos, envoie promptement des servantes à ma demeure, afin que je te remette les présents que t’a faits Ménélaos.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Peiraios, nous ne savons comment tourneront les choses. Si les prétendants insolents me tuent en secret dans mes demeures et se partagent mes biens paternels, je veux que tu possèdes ces présents, et j’aime mieux que tu en jouisses qu’eux. Si je leur envoie la kèr et la mort, alors tu me les rapporteras, joyeux, dans mes demeures, et je m’en réjouirai.
Ayant ainsi parlé, il conduisit vers sa demeure son hôte malheureux. Et dès qu’ils furent arrivés ils déposèrent leurs manteaux sur des sièges et sur des thrônes, et ils se baignèrent dans des baignoires polies. Et, après que les servantes les eurent baignés et parfumés d’huile, elles les couvrirent de tuniques et de riches manteaux, et ils s’assirent sur des thrônes. Une servante leur versa de l’eau, d’une belle aiguière d’or dans un bassin d’argent, pour se laver les mains, et elle dressa devant eux une table polie que la vénérable intendante, pleine de bienveillance pour tous, couvrit de pain qu’elle avait apporté et de nombreux mets. Et Pènélopéia s’assit en face d’eux, à l’entrée de la salle, et, se penchant de son siège, elle filait des laines fines. Puis, ils étendirent les mains vers les mets placés devant eux ; et, après qu’ils eurent assouvi la soif et la faim, la prudente Pènélopéia leur dit la première :
– Tèlémakhos, je remonterai dans ma chambre nuptiale et je me coucherai sur le lit plein de mes soupirs et arrosé de mes larmes depuis le jour où Odysseus est allé à Ilios avec les Atréides, et tu ne veux pas, avant l’entrée des prétendants insolents dans cette demeure, me dire tout ce que tu as appris sur le retour de ton père !
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ma mère, je vais te dire la vérité. Nous sommes allés à Pylos, auprès du prince des peuples Nestôr. Et celui-ci m’a reçu dans ses hautes demeures, et il m’a comblé de soins, comme un père accueille son fils récemment arrivé après une longue absence. C’est ainsi que lui et ses illustres fils m’ont accueilli. Mais il m’a dit qu’aucun des hommes terrestres ne lui avait rien appris du malheureux Odysseus mort ou vivant. Et il m’a envoyé avec un char et des chevaux vers l’Atréide Ménélaos, illustre par sa lance. Et là j’ai vu l’Argienne Hélénè, pour qui tant d’Argiens et de Troiens ont souffert par la volonté des dieux. Et le brave Ménélaos m’a demandé aussitôt pourquoi je venais dans la divine Lakédaimôn ; et je lui ai dit la vérité, et, alors, il m’a répondu ainsi :
– Ô dieux ! certes, des lâches veulent coucher dans le lit d’un brave ! Ainsi une biche a déposé dans le repaire d’un lion robuste ses faons nouveau-nés et qui tettent, tandis qu’elle va paître sur les hauteurs ou dans les vallées herbues ; et voici que le lion, rentrant dans son repaire, tue misérablement tous les faons. Ainsi Odysseus leur fera subir une mort misérable. Plaise au père Zeus, à Athènè, à Apollôn, qu’Odysseus se mêle aux prétendants, tel qu’il était dans Lesbos bien bâtie, quand, se levant pour lutter contre le Philomèléide, il le terrassa rudement ! Tous les Akhaiens s’en réjouirent. La vie des prétendants serait brève et leurs noces seraient amères.
Mais les choses que tu me demandes en me suppliant, je te les dirai sans te rien cacher, telles que me les a dites le Vieillard véridique de la mer. Je te les dirai toutes et je ne te cacherai rien. Il m’a dit qu’il avait vu Odysseus subissant de cruelles douleurs dans l’île et dans les demeures de la nymphe Kalypsô, qui le retient de force. Et il ne pouvait regagner la terre de sa patrie. Il n’avait plus, en effet, de nefs armées d’avirons, ni de compagnons pour le reconduire sur le large dos de la mer.
– C’est ainsi que m’a parlé l’Atréide Ménélaos, illustre par sa lance. Puis, je suis parti, et les immortels m’ont envoyé un vent propice et m’ont ramené promptement dans la terre de la patrie.
Il parla ainsi, et l’âme de Pènélopéia fut émue dans sa poitrine. Et le divin Théoklyménos leur dit :
– Ô vénérable femme du Laertiade Odysseus, certes, Tèlémakhos ne sait pas tout. Écoute donc mes paroles. Je te prédirai des choses vraies et je ne te cacherai rien. Que Zeus, le premier des dieux, le sache ! et cette table hospitalière, et la maison du brave Odysseus où je suis venu ! Certes, Odysseus est déjà dans la terre de la patrie. Caché ou errant, il s’informe des choses funestes qui se passent et il prépare la perte des prétendants. Tel est le signe que j’ai vu sur la nef et que j’ai révélé à Tèlémakhos.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Plaise aux dieux, étranger, que tes paroles s’accomplissent ! Tu connaîtras alors mon amitié, et je te ferai de nombreux présents, et chacun te dira un homme heureux.
Et c’est ainsi qu’ils se parlaient. Et les prétendants, devant la demeure d’Odysseus, sur le beau pavé, là où ils avaient coutume d’être insolents, se réjouissaient en lançant les disques et les traits. Mais quand le temps de prendre le repas fut venu, et quand les troupeaux arrivèrent de tous côtés des champs avec ceux qui les amenaient ordinairement, alors Médôn, qui leur plaisait le plus parmi les hérauts et qui mangeait avec eux, leur dit :
– Jeunes hommes, puisque vous avez charmé votre âme par ces jeux, entrez dans la demeure, afin que nous préparions le repas. Il est bon de prendre son repas quand le temps en est venu.
Il parla ainsi, et tous se levèrent et entrèrent dans la maison. Et quand ils furent entrés, ils déposèrent leurs manteaux sur les sièges et sur les thrônes. Puis, ils égorgèrent les grandes brebis et les chèvres grasses. Et ils égorgèrent aussi les porcs gras et une génisse indomptée, et ils préparèrent le repas.
Pendant ce temps, Odysseus et le divin porcher se disposaient à se rendre des champs à la ville, et le chef des porchers, le premier, parla ainsi :
– Etranger, allons ! puisque tu désires aller aujourd’hui à la ville, comme mon maître l’a ordonné. Certes, j’aurais voulu te faire gardien des étables ; mais je respecte mon maître et je crains qu’il s’irrite, et les menaces des maîtres sont à redouter. Allons donc maintenant. Le jour s’incline déjà, et le froid est plus vif vers le soir.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– J’entends et je comprends, et je ferai avec intelligence ce que tu ordonnes. Allons, et conduis-moi, et donne-moi un bâton, afin que je m’appuie, puisque tu dis que le chemin est difficile.
Ayant ainsi parlé, il jeta sur ses épaules sa misérable besace pleine de trous et fermée par une courroie tordue. Et Eumaios lui donna un bâton à son goût, et ils partirent, laissant les chiens et les porchers garder les étables. Et Eumaios conduisait ainsi vers la ville son roi semblable à un vieux et misérable mendiant, appuyé sur un bâton et couvert de haillons.
En avançant sur la route difficile, ils approchèrent de la ville et de la fontaine aux belles eaux courantes où venaient puiser les citoyens.
Ithakos, Nèritos et Polyktôr l’avaient construite, et, tout autour, il y avait un bois sacré de peupliers rafraîchis par l’eau qui coulait en cercle régulier. Et l’eau glacée tombait aussi de la cime d’une roche, et, au-dessous, il y avait un autel des nymphes où sacrifiaient tous les voyageurs.
Ce fut là que Mélanthios, fils de Dolios, les rencontra tous deux. Il conduisait les meilleures chèvres de ses troupeaux pour les repas des prétendants, et deux bergers le suivaient. Alors, ayant vu Odysseus et Eumaios, il les insulta grossièrement et honteusement, et il remua l’âme d’Odysseus :
– Voici qu’un misérable conduit un autre misérable, et c’est ainsi qu’un dieu réunit les semblables ! Ignoble porcher, où mènes-tu ce mendiant vorace, vile calamité des repas, qui usera ses épaules en s’appuyant à toutes les portes, demandant des restes et non des épées et des bassins. Si tu me le donnais, j’en ferais le gardien de mes étables, qu’il nettoierait. Il porterait le fourrage aux chevaux, et buvant au moins du petit lait, il engraisserait. Mais, sans doute, il ne sait faire que le mal, et il ne veut point travailler, et il aime mieux, parmi le peuple, mendier pour repaître son ventre insatiable. Je te dis ceci, et ma parole s’accomplira : s’il entre dans les demeures du divin Odysseus, les escabeaux des hommes voleront autour de sa tête par la demeure, le frapperont et lui meurtriront les flancs.
Ayant ainsi parlé, l’insensé se rua et frappa Odysseus à la cuisse, mais sans pouvoir l’ébranler sur le chemin. Et Odysseus resta immobile, délibérant s’il lui arracherait l’âme d’un coup de bâton, ou si, le soulevant de terre, il lui écraserait la tête contre le sol. Mais il se contint dans son âme. Et le porcher, ayant vu cela, s’indigna, et il dit en levant les mains :
– Nymphes Krèniades, filles de Zeus, si jamais Odysseus a brûlé pour vous les cuisses grasses et odorantes des agneaux et des chevreaux, accomplissez mon vœu. Que ce héros revienne et qu’une divinité le conduise ! Certes, alors, ô Mélanthios, il troublerait les joies que tu goûtes en errant sans cesse, plein d’insolence, par la ville, tandis que de mauvais bergers perdent les troupeaux.
Et le chevrier Mélanthios lui répondit :
– Ô dieux ! Que dit ce chien rusé ? Mais bientôt je le conduirai moi-même, sur une nef noire, loin d’Ithakè, et un grand prix m’en reviendra. Plût aux dieux qu’Apollôn à l’arc d’argent tuât aujourd’hui Tèlémakhos dans ses demeures, ou qu’il fût tué par les prétendants, aussi vrai qu’Odysseus, au loin, a perdu le jour du retour !
Ayant ainsi parlé, il les laissa marcher en silence, et, les devançant, il parvint rapidement aux demeures du roi. Et il y entra aussitôt, et il s’assit parmi les prétendants, auprès d’Eurymakhos qui l’aimait beaucoup.
Et on lui offrit sa part des viandes, et la vénérable intendante lui apporta du pain à manger.
Alors, Odysseus et le divin porcher, étant arrivés, s’arrêtèrent ; et le son de la kithare creuse vint jusqu’à eux, car Phèmios commençait à chanter au milieu des prétendants. Et Odysseus, ayant prit la main du porcher, lui dit :
– Eumaios, certes, voici les belles demeures d’Odysseus. Elles sont faciles à reconnaître au milieu de toutes les autres, tant elles en sont différentes. La cour est ornée de murs et de pieux, et les portes à deux battants sont solides. Aucun homme ne pourrait les forcer. Je comprends que beaucoup d’hommes prennent là leur repas, car l’odeur s’en élève, et la kithare résonne, elle dont les dieux ont fait le charme des repas.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Tu as tout compris aisément, car tu es très intelligent ; mais délibérons sur ce qu’il faut faire. Ou tu entreras le premier dans les riches demeures, au milieu des prétendants, et je resterai ici ; ou, si tu veux rester, j’irai devant. Mais ne tarde pas dehors, de peur qu’on te frappe et qu’on te chasse. Je t’engage à te décider.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Je sais, je comprends, et je ferai avec intelligence ce que tu dis. Va devant, et je resterai ici. J’ai l’habitude des blessures, et mon âme est patiente sous les coups, car j’ai subi bien des maux sur la mer et dans la guerre. Advienne que pourra. Il ne m’est point possible de cacher la faim cruelle qui ronge mon ventre et qui fait souffrir tant de maux aux hommes, et qui pousse sur la mer indomptée les nefs à bancs de rameurs pour apporter le malheur aux ennemis.
Et ils se parlaient ainsi, et un chien, qui était couché là, leva la tête et dressa les oreilles. C’était Argos, le chien du malheureux Odysseus qui l’avait nourri lui-même autrefois, et qui n’en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilios. Les jeunes hommes l’avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; et, maintenant, en l’absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l’amas de fumier de mulets et de bœufs qui était devant les portes, et y restait jusqu’à ce que les serviteurs d’Odysseus l’eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait, et il remua la queue et dressa les oreilles ; mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l’ayant vu, essuya une larme, en se cachant aisément d’Eumaios. Et, aussitôt, il demanda à celui-ci :
– Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide à la course, ou si c’est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les rois élèvent à cause de leur beauté.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– C’est le chien d’un homme mort au loin. S’il était encore, par les formes et les qualités, tel qu’Odysseus le laissa en allant à Troiè, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu’il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d’un flair excellent. Maintenant les maux l’accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leurs maîtres ne commandent plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l’homme la moitié de sa vertu, quand il le soumet à la servitude.
Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu’il traversa pour se rendre au milieu des illustres prétendants. Et, aussitôt, la kèr de la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Odysseus après la vingtième année.
Et le divin Tèlémakhos vit, le premier, Eumaios traverser la demeure, et il lui fit signe pour l’appeler promptement à lui. Et le porcher, ayant regardé, prit le siège vide du découpeur qui servait alors les viandes abondantes aux prétendants, et qui les découpait pour les convives. Et Eumaios, portant ce siège devant la table de Tèlémakhos, s’y assit. Et un héraut lui offrit une part des mets et du pain pris dans une corbeille.
Et, après lui, Odysseus entra dans la demeure, semblable à un misérable et vieux mendiant, appuyé sur un bâton et couvert de vêtements en haillons.
Et il s’assit sur le seuil de frêne, en dedans des portes, et il s’adossa contre le montant de cyprès qu’un ouvrier avait autrefois habilement poli et dressé avec le cordeau. Alors, Tèlémakhos, ayant appelé le porcher, prit un pain entier dans la belle corbeille, et des viandes, autant que ses mains purent en prendre, et dit :
– Porte ceci, et donne-le à l’étranger, et ordonne lui de demander à chacun des prétendants. La honte n’est pas bonne à l’indigent.
Il parla ainsi, et le porcher, l’ayant entendu, s’approcha d’Odysseus et lui dit ces paroles ailées :
– Tèlémakhos, ô étranger, te donne ceci, et il t’ordonne de demander à chacun des prétendants. Il dit que la honte n’est pas bonne à l’indigent.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Roi Zeus ! accorde-moi que Tèlémakhos soit heureux entre tous les hommes, et que tout ce qu’il désire s’accomplisse !
Il parla ainsi, et, prenant la nourriture des deux mains, il la posa à ses pieds sur sa besace trouée, et il mangea pendant que le divin aoide chantait dans les demeures.
Mais le divin aoide se tut, et les prétendants élevèrent un grand tumulte, et Athènè, s’approchant du Laertiade Odysseus, l’excita à demander aux prétendants, afin de reconnaître ceux qui étaient justes et ceux qui étaient iniques. Mais aucun d’eux ne devait être sauvé de la mort. Et Odysseus se hâta de prier chacun d’eux en commençant par la droite et en tendant les deux mains, comme ont coutume les mendiants. Et ils lui donnaient, ayant pitié de lui, et ils s’étonnaient, et ils se demandaient qui il était et d’où il venait. Alors, le chevrier Mélanthios leur dit :
– Écoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, je parlerai de cet étranger que j’ai déjà vu. C’est assurément le porcher qui l’a conduit ici ; mais je ne sais où il est né.
Il parla ainsi, et Antinoos réprimanda le porcher par ces paroles :
– Ô porcher, pourquoi as-tu conduit cet homme à la ville ? N’avons-nous pas assez de vagabonds et de mendiants, calamité des repas ? Trouves-tu qu’il ne suffit pas de ceux qui sont réunis ici pour dévorer les biens de ton maître, que tu aies encore appelé celui-ci ?
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Antinoos, tu ne dis pas de bonnes paroles, bien que tu sois illustre.
Quel homme peut appeler un étranger, afin qu’il vienne de loin, s’il n’est de ceux qui sont habiles, un divinateur, un médecin, un ouvrier qui taille le bois, ou un grand aoide qui charme en chantant ? Ceux-là sont illustres parmi les hommes sur la terre immense. Mais personne n’appelle un mendiant, s’il ne désire se nuire à soi-même. Tu es le plus dur des prétendants pour les serviteurs d’Odysseus, et surtout pour moi ; mais je n’en ai nul souci, tant que la sage Pènélopéia et le divin Tèlémakhos vivront dans leurs demeures.
Et le prudent Tèlémakhos lui dit :
– Tais-toi, et ne lui réponds point tant de paroles. Antinoos a coutume de chercher querelle par des paroles injurieuses et d’exciter tous les autres.
Il parla ainsi, et il dit ensuite à Antinoos ces paroles ailées :
– Antinoos, tu prends soin de moi comme un père de son fils, toi qui ordonnes impérieusement à un étranger de sortir de ma demeure ! mais qu’un dieu n’accomplisse point cet ordre. Donne à cet homme. Je ne t’en blâmerai point. Je te l’ordonne même. Tu n’offenseras ainsi ni ma mère, ni aucun des serviteurs qui sont dans la demeure du divin Odysseus. Mais telle n’est point la pensée que tu as dans ta poitrine, et tu aimes mieux manger davantage toi-même que de donner à un autre.
Et Antinoos lui répondit :
– Tèlémakhos, agorète orgueilleux et plein de colère, qu’as-tu dit ? Si tous les prétendants lui donnaient autant que moi, il serait retenu loin de cette demeure pendant trois mois au moins.
Il parla ainsi, saisissant et montrant l’escabeau sur lequel il appuyait ses pieds brillants sous la table. Mais tous les autres donnèrent à Odysseus et emplirent sa besace de viandes et de pain. Et déjà Odysseus s’en retournait pour goûter les dons des Akhaiens, mais il s’arrêta auprès d’Antinoos et lui dit :
– Donne-moi, ami, car tu ne parais pas le dernier des Akhaiens mais plutôt le premier d’entre eux, et tu es semblable à un roi. Il t’appartient de me donner plus abondamment que les autres, et je te louerai sur la terre immense. En effet, moi aussi, autrefois, j’ai habité une demeure parmi les hommes ; j’ai été riche et heureux, et j’ai souvent donné aux étrangers, quels qu’ils fussent et quelle que fût leur misère. Je possédais de nombreux serviteurs et tout ce qui fait vivre heureux et fait dire qu’on est riche ; mais Zeus Kroniôn a tout détruit, car telle a été sa volonté. Il m’envoya avec des pirates vagabonds dans l’Aigyptiè lointaine, afin que j’y périsse. Le cinquième jour j’arrêtai mes nefs à deux rangs d’avirons dans le fleuve Aigyptos. Alors j’ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès des nefs pour les garder, et j’envoyai des éclaireurs pour aller à la découverte.
Mais ceux-ci, égarés par leur audace et confiants dans leurs forces, dévastèrent aussitôt les beaux champs des hommes Aigyptiens, entraînant les femmes et les petits enfants et tuant les hommes. Et aussitôt le tumulte arriva jusqu’à la ville, et les habitants, entendant ces clameurs, accoururent au lever d’Éôs, et toute la plaine se remplit de piétons et de cavaliers et de l’éclat de l’airain. Et le foudroyant Zeus mit mes compagnons en fuite, et aucun d’eux ne soutint l’attaque, et la mort les environna de toutes parts. Là, un grand nombre des nôtres fut tué par l’airain aigu, et les autres furent emmenés vivants pour être esclaves. Et les Aigyptiens me donnèrent à Dmètôrlaside, qui commandait à Kypros, et il m’y emmena, et de là je suis venu ici, après avoir beaucoup souffert.
Et Antinoos lui répondit :
– Quel dieu a conduit ici cette peste, cette calamité des repas ? Tiens-toi au milieu de la salle, loin de ma table, si tu ne veux voir bientôt une Aigyptiè et une Kypros amères, aussi sûrement que tu es un audacieux et impudent mendiant. Tu t’arrêtes devant chacun, et ils te donnent inconsidérément, rien ne les empêchant de donner ce qui ne leur appartient pas, car ils ont tout en abondance.
Et le subtil Odysseus dit en s’en retournant :
– Ô dieux ! Tu n’as pas les pensées qui conviennent à ta beauté ; et à celui qui te le demanderait dans ta propre demeure tu ne donnerais pas même du sel, toi qui, assis maintenant à une table étrangère, ne peux supporter la pensée de me donner un peu de pain, quand tout abonde ici.
Il parla ainsi, et Antinoos fut grandement irrité dans son cœur, et, le regardant d’un oeil sombre, il lui dit ces paroles ailées :
– Je ne pense pas que tu sortes sain et sauf de cette demeure, puisque tu as prononcé cet outrage.
Ayant ainsi parlé, il saisit son escabeau et en frappa l’épaule droite d’Odysseus à l’extrémité du dos. Mais Odysseus resta ferme comme une pierre, et le trait d’Antinoos ne l’ébranla pas. Il secoua la tête en silence, en méditant la mort du prétendant. Puis, il retourna s’asseoir sur le seuil, posa à terre sa besace pleine et dit aux prétendants :
– Écoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m’ordonne dans ma poitrine. Il n’y a ni douleur, ni honte, quand un homme est frappé, combattant pour ses biens, soit des bœufs, soit de grasses brebis ; mais Antinoos m’a frappé parce que mon ventre est rongé par la faim cruelle qui cause tant de maux aux hommes. Donc, s’il est des dieux et des Érinnyes pour les mendiants, Antinoos, avant ses noces, rencontrera la mort.
Et Antinoos, le fils d’Eupeithès, lui dit :
– Mange en silence, étranger, ou sors, de peur que, parlant comme tu le fais, les jeunes hommes te traînent, à travers la demeure, par les pieds ou par les bras, et te mettent en pièces.
Il parla ainsi, mais tous les autres le blâmèrent rudement, et un des jeunes hommes insolents lui dit :
– Antinoos, tu as mal fait de frapper ce malheureux vagabond. Insensé ! si c’était un des dieux Ouraniens ? Car les dieux, qui prennent toutes les formes, errent souvent par les villes, semblables à des étrangers errants, afin de reconnaître la justice ou l’iniquité des hommes.
Les prétendants parlèrent ainsi, mais leurs paroles ne touchèrent point Antinoos. Et une grande douleur s’éleva dans le cœur de Tèlémakhos à cause du coup qui avait été porté. Cependant, il ne versa point de larmes, mais il secoua la tête en silence, en méditant la mort du prétendant. Et la prudente Pènélopéia, ayant appris qu’un étranger avait été frappé dans la demeure, dit à ses servantes :
– Puisse Apollôn illustre par son arc frapper ainsi Antinoos !
Et Eurynomè l’intendante lui répondit :
– Si nous pouvions accomplir nos propres vœux, aucun de ceux-ci ne verrait le retour du beau matin.
Et la prudente Pènélopéia lui dit :
– Nourrice, tous me sont ennemis, car ils méditent le mal ; mais Antinoos, plus que tous, est pour moi semblable à la noire kèr. Un malheureux étranger mendie dans la demeure, demandant à chacun, car la nécessité le presse, et tous lui donnent ; mais Antinoos le frappe d’un escabeau à l’épaule droite !
Elle parla ainsi au milieu de ses servantes. Et le divin Odysseus acheva son repas, et Pènélopéia fit appeler le divin porcher et lui dit :
– Va, divin Eumaios, et ordonne à l’étranger de venir, afin que je le salue et l’interroge. Peut-être qu’il a entendu parler du malheureux Odysseus, ou qu’il l’a vu de ses yeux, car il semble lui-même avoir beaucoup erré.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Plût aux dieux, reine, que tous les Akhaiens fissent silence et qu’il charmât ton cher cœur de ses paroles ! Je l’ai retenu dans l’étable pendant trois nuits et trois jours, car il était d’abord venu vers moi après s’être enfui d’une nef. Et il n’a point achevé de dire toute sa destinée malheureuse.
De même qu’on révère un aoide instruit par les dieux à chanter des paroles douces aux hommes, et qu’on ne veut jamais cesser de l’écouter quand il chante, de même celui-ci m’a charmé dans mes demeures. Il dit qu’il est un hôte paternel d’Odysseus et qu’il habitait la Krètè où commande la race de Minôs. Après avoir subi beaucoup de maux, errant çà et là, il est venu ici. Il dit qu’il a entendu parler d’Odysseus chez le riche peuple des Thesprôtes, et qu’il vit encore, et qu’il rapporte de nombreuses richesses dans sa demeure.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Va ! Appelle-le, afin qu’il parle devant moi. Les prétendants se réjouissent, assis les uns devant les portes, les autres dans la demeure, car leur esprit est joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leurs maisons, leur pain et leur vin doux, dont se nourrissent leurs serviteurs seulement. Mais, tous les jours, dans notre demeure, ils tuent nos bœufs, nos brebis et nos chèvres grasses, et ils les mangent, et ils boivent notre vin rouge impunément, et ils ont déjà consumé beaucoup de richesses. Il n’y a point ici d’homme tel qu’Odysseus pour chasser cette ruine hors de la demeure. Mais si Odysseus revenait et abordait la terre de la patrie, bientôt, avec son fils, il aurait réprimé les insolences de ces hommes.
Elle parla ainsi, et Tèlémakhos éternua très fortement, et toute la maison en retentit.
Et Pènélopéia se mit à rire, et, aussitôt, elle dit à Eumaios ces paroles ailées :
– Va ! Appelle cet étranger devant moi. Ne vois-tu pas que mon fils a éternué comme j’achevais de parler ? Que la mort de tous les prétendants s’accomplisse ainsi, et que nul d’entre eux n’évite la kèr et la mort ! Mais je te dirai ceci ; retiens-le dans ton esprit : si je reconnais que cet étranger me dit la vérité, je lui donnerai de beaux vêtements, un manteau et une tunique.
Elle parla ainsi, et le porcher, l’ayant entendue, s’approcha d’Odysseus et lui dit ces paroles ailées :
– Père étranger, la sage Pènélopéia, la mère de Tèlémakhos, t’appelle. Son âme lui ordonne de t’interroger sur son mari, bien qu’elle subisse beaucoup de douleurs. Si elle reconnaît que tu lui as dit la vérité, elle te donnera un manteau et une tunique dont tu as grand besoin ; et tu demanderas ton pain parmi le peuple, et tu satisferas ta faim, et chacun te donnera s’il le veut.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Eumaios, je dirai bientôt toute la vérité à la fille d’Ikarios, la très sage Pènélopéia. Je sais toute la destinée d’Odysseus, et nous avons subi les mêmes maux. Mais je crains la multitude des prétendants insolents.
Leur orgueil et leur violence sont montés jusqu’à l’Ouranos de fer. Voici qu’un d’entre eux, comme je traversais innocemment la salle, m’ayant frappé, m’a fait un grand mal. Et Tèlémakhos n’y a point pris garde, ni aucun autre. Donc, maintenant, engage Pènélopéia, malgré sa hâte, à attendre dans ses demeures jusqu’à la chute de Hèlios. Alors, tandis que je serai assis auprès du foyer, elle m’interrogera sur le jour du retour de son mari. Je n’ai que des vêtements en haillons ; tu le sais, puisque c’est toi que j’ai supplié le premier.
Il parla ainsi, et le porcher le quitta après l’avoir entendu. Et, dès qu’il parut sur le seuil, Pènélopéia lui dit :
– Tu ne l’amènes pas, Eumaios ? Pourquoi refuse-t-il ? Craint-il quelque outrage, ou a-t-il honte ? La honte n’est pas bonne à l’indigent.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
– Il parle comme il convient et comme chacun pense. Il veut éviter l’insolence des prétendants orgueilleux. Mais il te prie d’attendre jusqu’au coucher de Hèlios. Il te sera ainsi plus facile, ô reine, de parler seule à cet étranger et de l’écouter.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Cet étranger, quel qu’il soit, ne semble point sans prudence ; et, en effet, aucun des plus injurieux parmi les hommes mortels n’a médité plus d’iniquités que ceux-ci.
Elle parla ainsi, et le divin porcher retourna dans l’assemblée des prétendants, après avoir tout dit. Et, penchant la tête vers Tèlémakhos, afin que les autres ne l’entendissent pas, il dit ces paroles ailées :
– Ô ami, je pars, afin d’aller garder tes porcs et veiller sur tes richesses et les miennes. Ce qui est ici te regarde. Mais conserve-toi et songe dans ton âme à te préserver. De nombreux Akhaiens ont de mauvais desseins, mais que Zeus les perde avant qu’ils nous nuisent !
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Il en sera ainsi, père. Mais pars avant la nuit. Reviens demain, au matin, et amène les belles victimes. C’est aux immortels et à moi de nous inquiéter de tout le reste.
Il parla ainsi, et le porcher s’assit de nouveau sur le siège poli, et là il contenta son âme en buvant et en mangeant ; puis, se hâtant de retourner vers ses porcs, il laissa les cours et la demeure pleines de convives qui se charmaient par la danse et le chant, car déjà le soir était venu.Chant 18
Et il vint un mendiant qui errait par la ville et qui mendiait dans Ithakè. Et il était renommé par son ventre insatiable, car il mangeait et buvait sans cesse ; mais il n’avait ni force, ni courage, bien qu’il fût beau et grand. Il se nommait Arnaios, et c’était le nom que sa mère vénérable lui avait donné à sa naissance ; mais les jeunes hommes le nommaient tous Iros, parce qu’il faisait volontiers les messages, quand quelqu’un le lui ordonnait. Et dès qu’il fut arrivé, il voulut chasser Odysseus de sa demeure, et, en l’injuriant, il lui dit ces paroles ailées :
– Sors du portique, vieillard, de peur d’être traîné aussitôt par les pieds. Ne comprends-tu pas que tous me font signe et m’ordonnent de te traîner dehors ? Cependant, j’ai pitié de toi. Lève-toi donc, de peur qu’il y ait de la discorde entre nous et que nous en venions aux mains.
Et le subtil Odysseus, le regardant d’un oeil sombre, lui dit :
– Malheureux ! Je ne te fais aucun mal, je ne te dis rien, et je ne t’envie pas à cause des nombreux dons que tu pourras recevoir. Ce seuil nous servira à tous deux. Il ne faut pas que tu sois envieux d’un étranger, car tu me sembles un vagabond comme moi, et ce sont les dieux qui distribuent les richesses. Ne me provoque donc pas aux coups et n’éveille pas ma colère, de peur que je souille de sang ta poitrine et tes lèvres, bien que je sois vieux. Demain je n’en serai que plus tranquille, et je ne pense pas que tu reviennes après cela dans la demeure du Laertiade Odysseus.
Et le mendiant Iros, irrité, lui dit :
– Ô dieux ! comme ce mendiant parle avec facilité, semblable à une vieille enfumée. Mais je vais le maltraiter en le frappant des deux mains, et je ferai tomber toutes ses dents de ses mâchoires, comme celles d’un sanglier mangeur de moissons ! Maintenant, ceins-toi, et que tous ceux-ci nous voient combattre. Mais comment lutteras-tu contre un homme jeune ?
Ainsi, devant les hautes portes, sur le seuil poli, ils se querellaient de toute leur âme. Et la force sacrée d’Antinoos les entendit, et, se mettant à rire, il dit aux prétendants :
– Ô amis ! jamais rien de tel n’est arrivé. Quel plaisir un dieu nous envoie dans cette demeure ! L’étranger et Iros se querellent et vont en venir aux coups. Mettons-les promptement aux mains.
Il parla ainsi, et tous se levèrent en riant, et ils se réunirent autour des mendiants en haillons, et Antinoos, fils d’Eupeithès, leur dit :
– Écoutez-moi, illustres prétendants, afin que je parle. Des poitrines de chèvres sont sur le feu, pour le repas, et pleines de sang et de graisse. Celui qui sera vainqueur et le plus fort choisira la part qu’il voudra. Il assistera toujours à nos repas, et nous ne laisserons aucun autre mendiant demander parmi nous.
Ainsi parla Antinoos, et ses paroles plurent à tous. Mais le subtil Odysseus parla ainsi, plein de ruse :
– Ô amis, il n’est pas juste qu’un vieillard flétri par la douleur lutte contre un homme jeune ; mais la faim, mauvaise conseillère, me pousse à me faire couvrir de plaies. Cependant, jurez tous par un grand serment qu’aucun de vous, pour venir en aide à Iros, ne me frappera de sa forte main, afin que je sois dompté.
Il parla ainsi, et tous jurèrent comme il l’avait demandé. Et la force sacrée de Tèlémakhos lui dit :
– Étranger, si ton cœur et ton âme courageuse t’invitent à chasser cet homme, ne crains aucun des Akhaiens. Celui qui te frapperait aurait à combattre contre plusieurs, car je t’ai donné l’hospitalité, et deux rois prudents, Eurymakhos et Antinoos, m’approuvent.
Il parla ainsi, et tous l’approuvèrent. Et Odysseus ceignit ses parties viriles avec ses haillons, et il montra ses cuisses belles et grandes, et ses larges épaules, et sa poitrine et ses bras robustes. Et Athènè, s’approchant de lui, augmenta les membres du prince des peuples. Et tous les prétendants furent très surpris, et ils se dirent les uns aux autres :
– Certes, bientôt Iros ne sera plus Iros, et il aura ce qu’il a cherché. Quelles cuisses montre ce vieillard en retirant ses haillons !
Ils parlèrent ainsi, et l’âme de Iros fut troublée ; mais les serviteurs, après l’avoir ceint de force, le conduisirent, et toute sa chair tremblait sur ses os. Et Antinoos le réprimanda et lui dit :
– Puisses-tu n’être jamais né, n’étant qu’un fanfaron, puisque tu trembles, plein de crainte, devant un vieillard flétri par la misère ! Mais je te dis ceci, et ma parole s’accomplira : si celui-ci est vainqueur et le plus fort, je t’enverrai sur la terre ferme, jeté dans une nef noire, chez le roi Ékhétos, le plus féroce de tous les hommes, qui te coupera le nez et les oreilles avec l’airain tranchant, qui t’arrachera les parties viriles et les donnera, sanglantes, à dévorer aux chiens.
Il parla ainsi, et une plus grande terreur fit trembler la chair d’Iros. Et on le conduisit au milieu, et tous deux levèrent leurs bras. Alors, le patient et divin Odysseus délibéra s’il le frapperait de façon à lui arracher l’âme d’un seul coup, ou s’il ne ferait que l’étendre contre terre. Et il jugea que ceci était le meilleur, de ne le frapper que légèrement de peur que les Akhaiens le reconnussent.
Tous deux ayant levé les bras, Iros le frappa à l’épaule droite ; mais Odysseus le frappa au cou, sous l’oreille, et brisa ses os, et un sang noir emplit sa bouche, et il tomba dans la poussière en criant, et ses dents furent arrachées, et il battit la terre de ses pieds. Les prétendants insolents, les bras levés, mouraient de rire.
Mais Odysseus le traîna par un pied, à travers le portique, jusque dans la cour et jusqu’aux portes, et il l’adossa contre le mur de la cour, lui mit un bâton à la main, et lui adressa ces paroles ailées :
– Maintenant, reste là, et chasse les chiens et les porcs, et ne te crois plus le maître des étrangers et des mendiants, misérable ! de peur d’un mal pire.
Il parla ainsi, et, jetant sur son épaule sa pauvre besace pleine de trous suspendue à une courroie tordue, il revint s’asseoir sur le seuil. Et tous les prétendants rentrèrent en riant, et ils lui dirent :
– Que Zeus et les autres dieux immortels, étranger, t’accordent ce que tu désires le plus et ce qui est cher à ton cœur ! car tu empêches cet insatiable de mendier. Nous l’enverrons bientôt sur la terre ferme, chez le roi Ékhétos, le plus féroce de tous les hommes.
Ils parlaient ainsi, et le divin Odysseus se réjouit de leur vœu. Et Antinoos plaça devant lui une large poitrine de chèvre pleine de sang et de graisse. Et Amphinomos prit dans une corbeille deux pains qu’il lui apporta, et, l’honorant d’une coupe d’or, il lui dit :
– Salut, père Étranger. Que la richesse que tu possédais te soit rendue, car, maintenant, tu es accablé de beaucoup de maux.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Amphinomos, tu me sembles plein de prudence, et tel que ton père, car j’ai appris par la renommée que Nisos était à Doulikhios un homme honnête et riche. On dit que tu es né de lui, et tu sembles un homme sage. Je te dis ceci ; écoute et comprends-moi. Rien n’est plus misérable que l’homme parmi tout ce qui respire ou rampe sur la terre, et qu’elle nourrit. Jamais, en effet, il ne croit que le malheur puisse l’accabler un jour, tant que les dieux lui conservent la force et que ses genoux se meuvent ; mais quand les dieux heureux lui ont envoyé les maux, il ne veut pas les subir d’un cœur patient. Tel est l’esprit des hommes terrestres, semblable aux jours changeants qu’amène le père des hommes et des dieux. Moi aussi, autrefois, j’étais heureux parmi les guerriers, et j’ai commis beaucoup d’actions injustes, dans ma force et dans ma violence, me fiant à l’aide de mon père et de mes frères. C’est pourquoi qu’aucun homme ne soit inique, mais qu’il accepte en silence les dons des dieux. Je vois les prétendants, pleins de pensées iniques, consumant les richesses et outrageant la femme d’un homme qui, je le dis, ne sera pas longtemps éloigné de ses amis et de la terre de la patrie. Qu’un daimôn te ramène dans ta demeure, de peur qu’il te rencontre quand il reviendra dans la chère terre de la patrie. Ce ne sera pas, en effet, sans carnage, que tout se décidera entre les prétendants et lui, quand il reviendra dans ses demeures.
Il parla ainsi, et, faisant une libation, il but le vin doux et remit la coupe entre les mains du prince des peuples. Et celui-ci, le cœur déchiré et secouant la tête, allait à travers la salle, car, en effet, son âme prévoyait des malheurs. Mais cependant il ne devait pas éviter la kèr, et Athènè l’empêcha de partir, afin qu’il fût tué par les mains et par la lance de Tèlémakhos. Et il alla s’asseoir de nouveau sur le thrône d’où il s’était levé.
Alors, la déesse Athènè aux yeux clairs mit dans l’esprit de la fille d’Ikarios, de la prudente Pènélopéia, d’apparaître aux prétendants, afin que leur cœur fût transporté, et qu’elle-même fût plus honorée encore par son mari et par son fils. Pènélopéia se mit donc à rire légèrement, et elle dit :
– Eurynomè, voici que mon âme m’excite maintenant à apparaître aux prétendants odieux. Je dirai à mon fils une parole qui lui sera très utile. Je lui conseillerai de ne point se mêler aux prétendants insolents qui lui parlent avec amitié et méditent sa mort.
Et Eurynomè l’intendante lui répondit :
– Mon enfant, ce que tu dis est sage ; fais-le. Donne ce conseil à ton fils, et ne lui cache rien. Lave ton corps et parfume tes joues avec de l’huile, et ne sors pas avec un visage sillonné de larmes, car rien n’est pire que de pleurer continuellement. En effet, ton fils est maintenant tel que tu suppliais ardemment les dieux qu’il devint.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Eurynomè, ne me parle point, tandis que je gémis, de laver et de parfumer mon corps. Les dieux qui habitent l’Olympos m’ont ravi ma splendeur, du jour où Odysseus est parti sur ses nefs creuses. Mais ordonne à Autonoè et à Hippodamia de venir, afin de m’accompagner dans les demeures. Je ne veux point aller seule au milieu des hommes, car j’en aurais honte.
Elle parla ainsi, et la vieille femme sortit de la maison afin d’avertir les servantes et qu’elles vinssent à la hâte.
Et, alors, la déesse Athènè aux yeux clairs eut une autre pensée, et elle répandit le doux sommeil sur la fille d’Ikarios. Et celle-ci s’endormit, penchée en arrière, et sa force l’abandonna sur le lit de repos. Et, alors, la noble déesse lui fit des dons immortels, afin qu’elle fût admirée des Akhaiens. Elle purifia son visage avec de l’ambroisie, de même que Kythéréia à la belle couronne se parfume, quand elle se rend aux chœurs charmants des Kharites. Elle la fit paraître plus grande, plus majestueuse, et elle la rendit plus blanche que l’ivoire récemment travaillé. Cela fait, la noble déesse s’éloigna, et les deux servantes aux bras blancs, ayant été appelées, arrivèrent de la maison, et le doux sommeil quitta Pènélopéia. Et elle pressa ses joues avec ses mains, et elle s’écria :
– Certes, malgré mes peines, le doux sommeil m’a enveloppée. Puisse la chaste Artémis m’envoyer une mort aussi douce ! Je ne consumerais plus ma vie à gémir dans mon cœur, regrettant mon cher mari qui avait toutes les vertus et qui était le plus illustre des Akhaiens.
Ayant ainsi parlé, elle descendit des chambres splendides. Et elle n’était point seule, car deux servantes la suivaient. Et quand la divine femme arriva auprès des prétendants, elle s’arrêta sur le seuil de la salle richement ornée, ayant un beau voile sur les joues. Et les servantes prudentes se tenaient à ses côtés. Et les genoux des prétendants furent rompus, et leur cœur fut transporté par l’amour, et ils désiraient ardemment dormir avec elle dans leurs lits. Mais elle dit à son fils Tèlémakhos :
– Tèlémakhos, ton esprit n’est pas ferme, ni ta pensée. Quand tu étais encore enfant, tu avais des pensées plus sérieuses ; mais, aujourd’hui que tu es grand et parvenu au terme de la puberté, et que chacun dit que tu es le fils d’un homme heureux, et que l’étranger admire ta grandeur et ta beauté, ton esprit n’est plus équitable, ni ta pensée. Comment as-tu permis qu’une telle action mauvaise ait été commise dans tes demeures et qu’un hôte ait été ainsi outragé ? Qu’arrivera-t-il donc, si un étranger assis dans nos demeures souffre un tel outrage ? La honte et l’opprobre seront pour toi parmi les hommes.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ma mère, je ne te blâme point de t’irriter ; mais je comprends et je sais dans mon âme ce qui est juste ou injuste. Il y a peu de temps j’étais encore enfant, et je ne puis avoir une égale prudence en toute chose. Ces hommes, assis les uns auprès des autres, méditent ma perte et je n’ai point de soutiens. Mais le combat de l’étranger et d’Iros ne s’est point terminé selon le désir des prétendants, et notre hôte l’a emporté par sa force. Plaise au père Zeus, à Athènè, à Apollôn, que les prétendants, domptés dans nos demeures, courbent bientôt la tête, les uns sous le portique, les autres dans la demeure, et que leurs forces soient rompues ; de même qu’Iros est assis devant les portes extérieures, baissant la tête comme un homme ivre et ne pouvant ni se tenir debout, ni revenir à sa place accoutumée, parce que ses forces sont rompues.
Et ils se parlaient ainsi. Eurymakhos dit à Pènélopéia :
– Fille d’Ikarios, sage Pènélopéia, si tous les Akhaiens de l’Argos d’Iasos te voyaient, demain, d’autres nombreux prétendants viendraient s’asseoir à nos repas dans ces demeures, car tu l’emportes sur toutes les femmes par la beauté, la majesté et l’intelligence.
Et la sage Pènélopéia lui répondit :
– Eurymakhos, certes, les immortels m’ont enlevé ma vertu et ma beauté depuis que les Argiens sont partis pour Ilios, et qu’Odysseus est parti avec eux ; mais s’il revenait et gouvernait ma vie, ma renommée serait meilleure et je serais plus belle. Maintenant je suis affligée, tant un daimôn ennemi m’a envoyé de maux. Quand Odysseus quitta la terre de la patrie, il me prit la main droite et il me dit :
– Ô femme, je ne pense pas que les Akhaiens aux belles knèmides reviennent tous sains et saufs de Troiè. On dit, en effet, que les Troiens sont de braves guerriers, lanceurs de piques et de flèches, et bons conducteurs de chevaux rapides qui décident promptement de la victoire dans la mêlée du combat furieux. Donc, je ne sais si un dieu me sauvera, ou si je mourrai là, devant Troiè. Mais toi, prends soin de toute chose, et souviens-toi, dans mes demeures, de mon père et de ma mère, comme maintenant, et plus encore quand je serai absent. Puis, quand tu verras ton fils arrivé à la puberté, épouse celui que tu choisiras et abandonne ta demeure. Il parla ainsi, et toutes ces choses sont accomplies, et la nuit viendra où je subirai d’odieuses noces, car Zeus m’a ravi le bonheur. Cependant, une douleur amère a saisi mon cœur et mon âme, et vous ne suivez pas la coutume ancienne des prétendants. Ceux qui voulaient épouser une noble femme, fille d’un homme riche, et qui se la disputaient, amenaient dans sa demeure des bœufs et de grasses brebis, et ils offraient à la jeune fille des repas et des présents splendides, et ils ne dévoraient pas impunément les biens d’autrui.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus se réjouit parce qu’elle attirait leurs présents et charmait leur âme par de douces paroles, tandis qu’elle avait d’autres pensées.
Et Antinoos, fils d’Eupeithès, lui répondit :
– Fille d’Ikarios, sage Pènélopéia, accepte les présents que chacun des Akhaiens voudra apporter ici. Il n’est pas convenable de refuser des présents, et nous ne retournerons point à nos travaux et nous ne ferons aucune autre chose avant que tu aies épousé celui des Akhaiens que tu préféreras.
Antinoos parla ainsi, et ses paroles furent approuvées de tous. Et chacun envoya un héraut pour apporter les présents. Et celui d’Antinoos apporta un très beau péplos aux couleurs variées et orné de douze anneaux d’or où s’attachaient autant d’agrafes recourbées. Et celui d’Eurymakhos apporta un riche collier d’or et d’ambre étincelant, et semblable à Hèlios. Et les deux serviteurs d’Eurydamas des boucles d’oreilles merveilleuses et bien travaillées et resplendissantes de grâce. Et le serviteur de Peisandros Polyktoride apporta un collier, très riche ornement. Et les hérauts apportèrent aux autres Akhaiens d’aussi beaux présents. Et la noble femme remonta dans les chambres hautes, tandis que les servantes portaient ces présents magnifiques.
Mais les prétendants restèrent jusqu’à ce que le soir fût venu, se charmant par la danse et le chant. Et le soir sombre survint tandis qu’ils se charmaient ainsi. Aussitôt, ils dressèrent trois lampes dans les demeures, afin d’en être éclairés, et ils disposèrent, autour, du bois depuis fort longtemps desséché et récemment fendu à l’aide de l’airain. Puis ils enduisirent les torches. Et les servantes du subtil Odysseus les allumaient tour à tour ; mais le patient et divin Odysseus leur dit :
– Servantes du roi Odysseus depuis longtemps absent, rentrez dans la demeure où est la reine vénérable. Réjouissez-la, assises dans la demeure ; tournez les fuseaux et préparez les laines. Seul j’allumerai ces torches pour les éclairer tous. Et, même s’ils voulaient attendre la brillante Éôs, ils ne me lasseraient point, car je suis plein de patience.
Il parla ainsi, et les servantes se mirent à rire, se regardant les unes les autres. Et Mélanthô aux belles joues lui répondit injurieusement. Dolios l’avait engendrée, et Pènélopéia l’avait nourrie et élevée comme sa fille et entourée de délices ; mais elle ne prenait point part à la douleur de Pènélopéia, et elle s’était unie d’amour à Eurymakhos, et elle l’aimait ; et elle adressa ces paroles injurieuses à Odysseus :
– Misérable étranger, tu es privé d’intelligence, puisque tu ne veux pas aller dormir dans la demeure de quelque ouvrier, ou dans quelque bouge, et puisque tu dis ici de vaines paroles au milieu de nombreux héros et sans rien craindre.
Certes, le vin te trouble l’esprit, ou il est toujours tel, et tu ne prononces que de vaines paroles. Peut-être es-tu fier d’avoir vaincu le vagabond Iros ? Mais crains qu’un plus fort qu’Iros se lève bientôt, qui t’accablera de ses mains robustes et qui te chassera d’ici souillé de sang.
Et le subtil Odysseus, la regardant d’un oeil sombre, lui répondit :
– Chienne ! je vais répéter à Tèlémakhos ce que tu oses dire, afin qu’ici même il te coupe en morceaux !
Il parla ainsi, et il épouvanta les servantes ; et elles s’enfuirent à travers la demeure, tremblantes de terreur et croyant qu’il disait vrai. Et il alluma les torches, se tenant debout et les surveillant toutes ; mais il méditait dans son esprit d’autres desseins qui devaient s’accomplir. Et Athènè ne permit pas que les prétendants insolents cessassent de l’outrager, afin que la colère entrât plus avant dans le cœur du Laertiade Odysseus. Alors, Eurymakhos, fils de Polybos, commença de railler Odysseus, excitant le rire de ses compagnons :
– Ecoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m’ordonne dans ma poitrine. Cet homme n’est pas venu dans la demeure d’Odysseus sans qu’un dieu l’ait voulu. La splendeur des torches me semble sortir de son corps et de sa tête, où il n’y a plus absolument de cheveux.
Il parla ainsi, et il dit au destructeur de citadelles Odysseus :
– Étranger, si tu veux servir pour un salaire, je t’emmènerai à l’extrémité de mes champs. Ton salaire sera suffisant. Tu répareras les haies et tu planteras les arbres. Je te donnerai une nourriture abondante, des vêtements et des sandales. Mais tu ne sais faire que le mal ; tu ne veux point travailler, et tu aimes mieux mendier parmi le peuple afin de satisfaire ton ventre insatiable.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Eurymakhos, plût aux dieux que nous pussions lutter en travaillant, au printemps, quand les jours sont longs, promenant, tous deux à jeun, la faux recourbée dans un pré, et jusqu’au soir, tant qu’il y aura de l’herbe à couper ! Plût aux dieux que j’eusse à conduire deux grands bœufs gras, rassasiés de fourrage, et de force égale, dans un vaste champ de quatre arpents ! Tu verrais alors si je saurais tracer un profond sillon et faire obéir la glèbe à la charrue. Si le Kroniôn excitait une guerre, aujourd’hui même, et si j’avais un bouclier, deux lances, et un casque d’airain autour des tempes, tu me verrais alors mêlé aux premiers combattants et tu ne m’outragerais plus en me raillant parce que j’ai faim. Mais tu m’outrages dans ton insolence, et ton esprit est cruel, et tu te crois grand et brave parce que tu es mêlé à un petit nombre de lâches. Mais si Odysseus revenait et abordait la terre de la patrie, aussitôt ces larges portes seraient trop étroites pour ta fuite, tandis que tu te sauverais hors du portique.
Il parla ainsi, et Eurymakhos fut très irrité dans son cœur, et, le regardant d’un oeil sombre, il dit ces paroles ailées :
– Ah ! misérable, certes je vais t’accabler de maux, puisque tu prononces de telles paroles au milieu de nombreux héros, et sans rien craindre. Certes, le vin te trouble l’esprit, ou il est toujours tel, et c’est pour cela que tu prononces de vaines paroles. Peut-être es-tu fier parce que tu as vaincu le mendiant Iros ?
Comme il parlait ainsi, il saisit un escabeau ; mais Odysseus s’assit aux genoux d’Amphinomos de Doulikhios pour échapper à Eurymakhos, qui atteignit à la main droite l’enfant qui portait à boire, et l’urne tomba en résonnant, et lui-même, gémissant, se renversa dans la poussière. Et les prétendants, en tumulte dans les demeures sombres, se disaient les uns aux autres :
– Plût aux dieux que cet étranger errant eût péri ailleurs et ne fût point venu nous apporter tant de trouble ! Voici que nous nous querellons pour un mendiant, et que la joie de nos repas est détruite parce que le mal l’emporte !
Et la force sacrée de Tèlémakhos leur dit :
– Malheureux, vous devenez insensés. Ne mangez ni ne buvez davantage, car quelque dieu vous excite. Allez dormir, rassasiés, dans vos demeures, quand votre cœur vous l’ordonnera, car je ne contrains personne.
Il parla ainsi, et tous se mordirent les lèvres, admirant Tèlémakhos parce qu’il avait parlé avec audace.
Alors, Amphinomos, l’illustre fils du roi Nisos Arètiade, leur dit :
– Ô amis, qu’aucun ne réponde par des paroles irritées à cette juste réprimande. Ne frappez ni cet étranger, ni aucun des serviteurs qui sont dans la maison du divin Odysseus. Allons ! que le verseur de vin distribue les coupes, afin que nous fassions des libations et que nous allions dormir dans nos demeures. Laissons cet étranger ici, aux soins de Tèlémakhos qui l’a reçu dans sa chère demeure.
Il parla ainsi, et ses paroles furent approuvées de tous. Et le héros Moulios, héraut de Doulikhios et serviteur d’Amphinomos, mêla le vin dans le kratère et le distribua comme il convenait. Et tous firent des libations aux dieux heureux et burent le vin doux. Et, après avoir fait des libations et bu autant que leur âme le désirait, ils se hâtèrent d’aller dormir, chacun dans sa demeure.Chant 19
Mais le divin Odysseus resta dans la demeure, méditant avec Athènè la mort des prétendants. Et, aussitôt, il dit à Tèlémakhos ces paroles ailées :
– Tèlémakhos, il faut transporter toutes les armes guerrières hors de la salle, et, quand les prétendants te les demanderont, les tromper par ces douces paroles : – ‘Je les ai mises à l’abri de la fumée, car elles ne sont pas telles qu’elles étaient autrefois, quand Odysseus les laissa à son départ pour Troiè ; mais elles sont souillées par la grande vapeur du feu. Puis, le Kroniôn m’a inspiré une autre pensée meilleure, et je crains qu’excités par le vin, et une querelle s’élevant parmi vous, vous vous blessiez les uns les autres et vous souilliez le repas et vos noces futures, car le fer attire l’homme.
Il parla ainsi, et Tèlémakhos obéit à son cher père et, ayant appelé la nourrice Eurykléia, il lui dit :
– Nourrice, enferme les femmes dans les demeures, jusqu’à ce que j’aie transporté dans la chambre nuptiale les belles armes de mon père, qui ont été négligées et que la fumée a souillées pendant l’absence de mon père, car j’étais encore enfant. Maintenant, je veux les transporter là où la vapeur du feu n’ira pas.
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Plaise aux dieux, mon enfant, que tu aies toujours la prudence de prendre soin de la maison et de conserver toutes tes richesses ! Mais qui t’accompagnera en portant une lumière, puisque tu ne veux pas que les servantes t’éclairent ?
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ce sera cet étranger. Je ne le laisserai pas sans rien faire, puisqu’il a mangé à ma table, bien qu’il vienne de loin.
Il parla ainsi, et sa parole ne fut point vaine. Et Eurykléia ferma les portes des grandes demeures. Puis, Odysseus et son illustre fils se hâtèrent de transporter les casques, les boucliers bombés et les lances aiguës. Et Pallas Athènè portant devant eux une lanterne d’or, les éclairait vivement ; et, alors, Tèlémakhos dit aussitôt à son père :
– Ô père, certes, je vois de mes yeux un grand prodige ! Voici que les murs de la demeure, et ses belles poutres, et ses solives de sapin, et ses hautes colonnes, brillent comme un feu ardent. Certes, un des dieux qui habitent le large Ouranos est entré ici.
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Tais-toi, et retiens ton esprit, et ne m’interroge pas. Telle est la coutume des dieux qui habitent l’Olympos. Toi, va dormir.
Je resterai ici, afin d’éprouver les servantes et ta mère. Dans sa douleur elle va m’interroger sur beaucoup de choses.
Il parla ainsi, et Tèlémakhos sortit de la salle, et il monta, éclairé par les torches flambantes, dans la chambre où il avait coutume de dormir. Là, il s’endormit, en attendant le matin ; et le divin Odysseus resta dans la demeure, méditant avec Athènè la mort des prétendants.
Et la prudente Pènélopéia, semblable à Artémis ou à Aphroditè d’or, sortit de sa chambre nuptiale. Et les servantes placèrent pour elle, devant le feu, le thrône où elle s’asseyait. Il était d’ivoire et d’argent, et travaillé au tour. Et c’était l’ouvrier Ikmalios qui l’avait fait autrefois, ainsi qu’un escabeau pour appuyer les pieds de la reine, et qui était recouvert d’une grande peau. Ce fut là que s’assit la prudente Pènélopéia.
Alors, les femmes aux bras blancs vinrent de la demeure, et elles emportèrent les pains nombreux, et les tables, et les coupes dans lesquelles les prétendants insolents avaient bu. Et elles jetèrent à terre le feu des torches, et elles amassèrent, par-dessus, du bois qui devait les éclairer et les chauffer. Et, alors, Mélanthô injuria de nouveau Odysseus :
– Étranger, te voilà encore qui erres dans la demeure, épiant les femmes ! Sors d’ici, misérable, après t’être rassasié, ou je te frapperai de ce tison !
Et le sage Odysseus, la regardant d’un oeil sombre, lui dit :
– Malheureuse ! pourquoi m’outrager avec fureur ? Est-ce parce que je suis vêtu de haillons et que je mendie parmi le peuple, comme la nécessité m’y contraint ? Tels sont les mendiants et les vagabonds. Et moi aussi, autrefois, j’étais heureux, et j’habitais une riche demeure, et je donnais aux vagabonds, quels qu’ils fussent et quels que fussent leurs besoins. Et j’avais de nombreux serviteurs et tout ce qui rend heureux et fait appeler un homme riche ; mais le Kroniôn Zeus m’a tout enlevé, le voulant ainsi. C’est pourquoi, femme, crains de perdre un jour la beauté dont tu es ornée parmi les servantes ; crains que ta maîtresse irritée te punisse, ou qu’Odysseus revienne, car tout espoir n’est pas perdu. Mais s’il a péri, et s’il ne doit plus revenir, son fils Tèlémakhos le remplace par la volonté d’Apollôn, et rien de ce que font les femmes dans les demeures ne lui échappera, car rien n’est plus au-dessus de son âge.
Il parla ainsi, et la prudente Pènélopéia, l’ayant entendu, réprimanda sa servante et lui dit :
– Chienne audacieuse, tu ne peux me cacher ton insolence effrontée que tu payeras de ta tête, car tu sais bien, m’ayant entendue toi-même, que je veux, étant très affligée, interroger cet étranger sur mon mari.
Elle parla ainsi, et elle dit à l’intendante Eurynomè :
– Eurynomè, approche un siège et recouvre-le d’une peau afin que cet étranger, s’étant assis, m’écoute et me réponde, car je veux l’interroger.
Elle parla ainsi, et Eurynomè approcha à la hâte un siège poli qu’elle recouvrit d’une peau, et le patient et divin Odysseus s’y assit, et la prudente Pènélopéia lui dit :
– Étranger, je t’interrogerai d’abord sur toi-même. Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Où sont ta ville et tes parents ?
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Ô femme, aucune des mortelles qui sont sur la terre immense ne te vaut, et, certes, ta gloire est parvenue jusqu’au large Ouranos, telle que la gloire d’un roi irréprochable qui, vénérant les dieux, commande à de nombreux et braves guerriers et répand la justice. Et par lui la terre noire produit l’orge et le blé, et les arbres sont lourds de fruits, et les troupeaux multiplient, et la mer donne des poissons, et, sous ses lois équitables, les peuples sont heureux et justes. C’est pourquoi, maintenant, dans ta demeure, demande-moi toutes les autres choses, mais non ma race et ma patrie. N’emplis pas ainsi mon âme de nouvelles douleurs en me faisant souvenir, car je suis très affligé, et je ne veux pas pleurer et gémir dans une maison étrangère, car il est honteux de pleurer toujours. Peut-être qu’une de tes servantes m’outragerait, ou que tu t’irriterais toi-même, disant que je pleure ainsi ayant l’esprit troublé par le vin.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Étranger, certes, les dieux m’ont ravi ma vertu et ma beauté du jour où les Argiens sont partis pour Ilios, et, avec eux, mon mari Odysseus. S’il revenait et gouvernait ma vie, ma gloire serait plus grande et plus belle. Mais, maintenant, je gémis, tant un daimôn funeste m’a accablée de maux. Voici que ceux qui dominent dans les îles, à Doulikhios, à Samè, à Zakynthos couverte de bois, et ceux qui habitent l’âpre Ithakè elle-même, tous me recherchent malgré moi et ruinent ma maison. Et je ne prends plus soin des étrangers, ni des suppliants, ni des hérauts qui agissent en public ; mais je regrette Odysseus et je gémis dans mon cher cœur. Et les prétendants hâtent mes noces, et je médite des ruses. Et, d’abord, un dieu m’inspira de tisser dans mes demeures une grande toile, large et fine, et je leur dis aussitôt : – Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Odysseus est mort, cessez de hâter mes noces, jusqu’à ce que j’aie achevé, pour que mes fils ne restent pas inutiles, ce linceul du héros Laertès, quand la moire mauvaise, de la mort inexorable l’aura saisi, afin qu’aucune des femmes akhaiennes ne puisse me reprocher devant tout le peuple qu’un homme qui a possédé tant de biens ait été enseveli sans linceul.’ – Je parlai ainsi, et leur cœur généreux fut persuadé ; et alors, pendant le jour, je tissais la grande toile, et pendant la nuit, ayant allumé des torches, je la défaisais.
Ainsi, pendant trois ans, je cachai ma ruse et trompai les Akhaiens ; mais quand vint la quatrième année, et quand les saisons recommencèrent, après le cours des mois et des jours nombreux, alors avertis par mes chiennes de servantes, ils me surprirent et me menacèrent, et, contre ma volonté, je fus contrainte d’achever ma toile. Et, maintenant, je ne puis plus éviter mes noces, ne trouvant plus aucune ruse. Et mes parents m’exhortent à me marier, et mon fils supporte avec peine que ceux-ci dévorent ses biens, auxquels il tient ; car c’est aujourd’hui un homme, et il peut prendre soin de sa maison, et Zeus lui a donné la gloire. Mais toi, étranger, dis-moi ta race et ta patrie, car tu ne sors pas du chêne et du rocher des histoires antiques.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, ne cesseras-tu point de m’interroger sur mes parents ? Je te répondrai donc, bien que tu renouvelles ainsi mes maux innombrables ; mais c’est là la destinée d’un homme depuis longtemps absent de la patrie, tel que moi qui ai erré parmi les villes des hommes, étant accablé de maux. Je te dirai cependant ce que tu me demandes.
La Krètè est une terre qui s’élève au milieu de la sombre mer, belle et fertile, où habitent d’innombrables hommes et où il y a quatre-vingt-dix villes. On y parle des langages différents, et on y trouve des Akhaiens, de magnanimes Krètois indigènes, des Kydônes, trois tribus de Dôriens et les divins Pélasges.
Sur eux tous domine la grande ville de Knôssos, où régna Minôs qui s’entretenait tous les neuf ans avec le grand Zeus, et qui fut le père du magnanime Deukaliôn mon père. Et Deukaliôn nous engendra, moi et le roi Idoméneus. Et Idoméneus alla, sur ses nefs à proues recourbées, à Ilios, avec les Atréides. Mon nom illustre est Aithôn, et j’étais le plus jeune. Idoméneus était l’aîné et le plus brave. Je vis alors Odysseus et je lui offris les dons hospitaliers. En effet, comme il allait à Ilios, la violence du vent l’avait poussé en Krètè, loin du promontoire Maléien, dans Amnisos où est la caverne des Ilithyies ; et, dans ce port difficile, à peine évita-t-il la tempête. Arrivé à la ville, il demanda Idoméneus, qu’il appelait son hôte cher et vénérable. Mais Éôs avait reparu pour la dixième ou onzième fois depuis que, sur ses nefs à proue recourbée, Idoméneus était parti pour Ilios. Alors, je conduisis Odysseus dans mes demeures, et je le reçus avec amitié, et je le comblai de soins à l’aide des richesses que je possédais et je lui donnai, ainsi qu’à ses compagnons, de la farine, du vin rouge, et des bœufs à tuer, jusqu’à ce que leur âme fût rassasiée. Et les divins Akhaiens restèrent là douze jours, car le grand et tempétueux Boréas soufflait et les arrêtait, excité par quelque daimôn. Mais le vent tomba le treizième jour, et ils partirent.
Il parlait ainsi, disant ces nombreux mensonges semblables à la vérité ; et Pènélopéia, en l’écoutant, pleurait, et ses larmes ruisselaient sur son visage, comme la neige ruisselle sur les hautes montagnes, après que Zéphyros l’a amoncelée et que l’Euros la fond en torrents qui emplissent les fleuves.
Ainsi les belles joues de Pènélopéia ruisselaient de larmes tandis qu’elle pleurait son mari. Et Odysseus était plein de compassion en voyant pleurer sa femme ; mais ses yeux, comme la corne et le fer, restaient immobiles sous ses paupières, et il arrêtait ses larmes par prudence. Et après qu’elle se fut rassasiée de larmes et de deuil, Pènélopéia, lui répondant, dit de nouveau :
– Maintenant, étranger, je pense que je vais t’éprouver, et je verrai si, comme tu le dis, tu as reçu dans tes demeures mon mari et ses divins compagnons. Dis-moi quels étaient les vêtements qui le couvraient, quel il était lui-même, et quels étaient les compagnons qui le suivaient.
Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Ô femme, il est bien difficile, après tant de temps, de te répondre, car voici la vingtième année qu’Odysseus est venu dans ma patrie et qu’il en est parti. Cependant, je te dirai ce dont je me souviens dans mon esprit. Le divin Odysseus avait un double manteau de laine pourprée qu’attachait une agrafe d’or à deux tuyaux, et ornée, par-dessus, d’un chien qui tenait sous ses pattes de devant un jeune cerf tremblant. Et tous admiraient, s’étonnant que ces deux animaux fussent d’or, ce chien qui voulait étouffer le faon, et celui-ci qui, palpitant sous ses pieds, voulait s’enfuir. Et je vis aussi sur le corps d’Odysseus une tunique splendide. Fine comme une pelure d’oignon, cette tunique brillait comme Hèlios. Et, certes, toutes les femmes l’admiraient.
Mais, je te le dis, et retiens mes paroles dans ton esprit : je ne sais si Odysseus portait ces vêtements dans sa demeure, ou si quelqu’un de ses compagnons les lui avait donnés comme il montait sur sa nef rapide, ou bien quelqu’un d’entre ses hôtes, car Odysseus était aimé de beaucoup d’hommes, et peu d’Akhaiens étaient semblables à lui. Je lui donnai une épée d’airain, un double et grand manteau pourpré et une tunique longue, et je le conduisis avec respect sur sa nef à bancs de rameurs. Un héraut, un peu plus âgé que lui, le suivait, et je te dirai quel il était. Il avait les épaules hautes, la peau brune et les cheveux crépus, et il se nommait Eurybatès, et Odysseus l’honorait entre tous ses compagnons, parce qu’il était plein de sagesse.
Il parla ainsi, et le désir de pleurer saisit Pènélopéia, car elle reconnut ces signes certains que lui décrivait Odysseus. Et, après qu’elle se fut rassasiée de larmes et de deuil, elle dit de nouveau :
– Maintenant, ô mon hôte, auparavant misérable, tu seras aimé et honoré dans mes demeures. J’ai moi-même donné à Odysseus ces vêtements que tu décris et qui étaient pliés dans ma chambre nuptiale, et j’y ai attaché cette agrafe brillante. Mais je ne le verrai plus de retour dans la chère terre de la patrie ! C’est par une mauvaise destinée qu’Odysseus, montant dans sa nef creuse, est parti pour cette Troiè fatale qu’on ne devrait plus nommer.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, ne flétris point ton beau visage et ne te consume point dans ton cœur à pleurer. Cependant, je ne te blâme en rien. Quelle femme pleurerait un jeune mari dont elle a conçu des enfants, après s’être unie d’amour à lui, plus que tu dois pleurer Odysseus qu’on dit semblable aux dieux ? Mais cesse de gémir et écoute-moi. Je te dirai la vérité et je ne te cacherai rien. J’ai entendu parler du retour d’Odysseus chez le riche peuple des Thesprôtes où il a paru vivant, et il rapporte de nombreuses richesses qu’il a amassées parmi beaucoup de peuples ; mais il a perdu ses chers compagnons et sa nef creuse, dans la noire mer, en quittant Thrinakiè. Zeus et Hèlios étaient irrités, parce que ses compagnons avaient tué les bœufs de Hèlios ; et ils ont tous péri dans la mer tumultueuse. Mais la mer a jeté Odysseus, attaché à la carène de sa nef, sur la côte des Phaiakiens qui descendent des dieux. Et ils l’ont honoré comme un dieu, et ils lui ont fait de nombreux présents, et ils ont voulu le ramener sain et sauf dans sa demeure. Odysseus serait donc déjà revenu depuis longtemps, mais il lui a semblé plus utile d’amasser d’autres richesses en parcourant beaucoup de terres ; car il sait un plus grand nombre de ruses que tous les hommes mortels, et nul ne pourrait lutter contre lui. Ainsi me parla Pheidôn, le roi des Thesprôtes. Et il me jura, en faisant des libations dans sa demeure, que la nef et les hommes étaient prêts qui devaient reconduire Odysseus dans la chère terre de sa patrie. Mais il me renvoya d’abord, profitant d’une nef des Thesprôtes qui allait à Doulikhios fertile en blé.
Et il me montra les richesses qu’avait réunies Odysseus, de l’airain, de l’or et du fer très difficile à travailler, le tout assez abondant pour nourrir jusqu’à sa dixième génération. Et il me disait qu’Odysseus était allé à Dôdônè pour apprendre du grand chêne la volonté de Zeus, et pour savoir comment, depuis longtemps absent, il rentrerait dans la terre d’Ithakè, soit ouvertement, soit en secret. Ainsi Odysseus est sauvé, et il viendra bientôt, et, désormais, il ne sera pas longtemps éloigné de ses amis et de sa patrie. Et je te ferai un grand serment : Qu’ils le sachent, Zeus, le meilleur et le plus grand des dieux, et la demeure du brave Odysseus où je suis arrivé ! Tout s’accomplira comme je le dis. Odysseus reviendra avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, dans quelques jours.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Plaise aux dieux, étranger, que tes paroles s’accomplissent ! Je te prouverais aussitôt mon amitié par de nombreux présents et chacun te dirait heureux ; mais je sens dans mon cœur que jamais Odysseus ne reviendra dans sa demeure et que ce n’est point lui qui te renverra. Il n’y a point ici de chefs tels qu’Odysseus parmi les hommes, si jamais il en a existé, qui congédient les étrangers après les avoir accueillis et honorés. Maintenant, servantes, baignez notre hôte, et préparez son lit avec des manteaux et des couvertures splendides, afin qu’il ait chaud en attendant Éôs au thrône d’or. Puis, au matin, baignez et parfumez-le, afin qu’assis dans la demeure, il prenne son repas auprès de Tèlémakhos.
Il arrivera malheur à celui d’entre eux qui l’outragera. Et qu’il ne soit soumis à aucun travail, quel que soit celui qui s’en irrite. Comment, ô étranger, reconnaîtrais-tu que je l’emporte sur les autres femmes par l’intelligence et par la sagesse, si, manquant de vêtements, tu t’asseyais en haillons au repas dans les demeures ? La vie des hommes est brève. Celui qui est injuste et commet des actions mauvaises, les hommes le chargent d’imprécations tant qu’il est vivant, et ils le maudissent quand il est mort ; mais celui qui est irréprochable et qui a fait de bonnes actions, les étrangers répandent au loin sa gloire, et tous les hommes le louent.
Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, les beaux vêtements et les couvertures splendides me sont odieux, depuis que, sur ma nef aux longs avirons, j’ai quitté les montagnes neigeuses de la Krètè. Je me coucherai, comme je l’ai déjà fait pendant tant de nuits sans sommeil, sur une misérable couche, attendant la belle et divine Éôs. Les bains de pieds non plus ne me plaisent point, et aucune servante ne me touchera les pieds, à moins qu’il n’y en ait une, vieille et prudente, parmi elles, et qui ait autant souffert que moi. Je n’empêche point celle-ci de me laver les pieds.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Cher hôte, aucun homme n’est plus sage que toi de tous les étrangers amis qui sont venus dans cette demeure, car tout ce que tu dis est plein de sagesse.
J’ai ici une femme âgée et très prudente qui nourrit et qui éleva autrefois le malheureux Odysseus, et qui l’avait reçu dans ses bras quand sa mère l’eut enfanté. Elle lavera tes pieds, bien qu’elle soit faible. Viens, lève-toi, prudente Eurykléia ; lave les pieds de cet étranger qui a l’âge de ton maître. Peut-être que les pieds et les mains d’Odysseus ressemblent aux siens, car les hommes vieillissent vite dans le malheur.
Elle parla ainsi, et la vieille femme cacha son visage dans ses mains, et elle versa de chaudes larmes et elle dit ces paroles lamentables :
– Hélas ! je suis sans force pour te venir en aide, ô mon enfant ! Assurément Zeus te hait entre tous les hommes, bien que tu aies un esprit pieux. Aucun homme n’a brûlé plus de cuisses grasses à Zeus qui se réjouit de la foudre, ni d’aussi complètes hécatombes. Tu le suppliais de te laisser parvenir à une pleine vieillesse et de te laisser élever ton fils illustre, et voici qu’il t’a enlevé le jour du retour ! Peut-être aussi que d’autres femmes l’outragent, quand il entre dans les illustres demeures où parviennent les étrangers, comme ces chiennes-ci t’outragent toi-même. Tu fuis leurs injures et leurs paroles honteuses, et tu ne veux point qu’elles te lavent ; et la fille d’Ikarios, la prudente Pènélopéia, m’ordonne de le faire, et j’y consens. C’est pourquoi je laverai tes pieds, pour l’amour de Pènélopéia et de toi, car mon cœur est ému de tes maux.
Mais écoute ce que je vais dire : de tous les malheureux étrangers qui sont venus ici, aucun ne ressemble plus que toi à Odysseus. Tu as son corps, sa voix et ses pieds.
Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Ô vieille femme, en effet, tous ceux qui nous ont vus tous deux de leurs yeux disent que nous nous ressemblons beaucoup. Tu as parlé avec sagesse.
Il parla ainsi, et la vieille femme prit un bassin splendide dans lequel on lavait les pieds, et elle y versa beaucoup d’eau froide, puis de l’eau chaude. Et Odysseus s’assit devant le foyer, en se tournant vivement du côté de l’ombre, car il craignit aussitôt, dans son esprit, qu’en le touchant elle reconnût sa cicatrice et que tout fût découvert. Eurykléia, s’approchant de son roi, lava ses pieds, et aussitôt elle reconnut la cicatrice de la blessure qu’un sanglier lui avait faite autrefois de ses blanches dents sur le Parnèsos, quand il était allé chez Autolykos et ses fils. Autolykos était l’illustre père de sa mère, et il surpassait tous les hommes pour faire du butin et de faux serments. Un dieu lui avait fait ce don, Herméias, pour qui il brûlait des chairs d’agneaux et de chevreaux et qui l’accompagnait toujours. Et Autolykos étant venu chez le riche peuple d’Ithakè, il trouva le fils nouveau-né de sa fille. Et Eurykléia, après le repas, posa l’enfant sur les chers genoux d’Autolykos et lui dit :
– Autolykos, donne toi-même un nom au cher fils de ta fille, puisque tu l’as appelé par tant de vœux.
Et Autolykos lui répondit :
– Mon gendre et ma fille, donnez-lui le nom que je vais dire. Je suis venu ici très irrité contre un grand nombre d’hommes et de femmes sur la face de la terre nourricière. Que son nom soit donc Odysseus. Quand il sera parvenu à la puberté, qu’il vienne sur le Parnèsos, dans la grande demeure de son aïeul maternel où sont mes richesses, et je lui en ferai de nombreux présents, et je le renverrai plein de joie.
Et, à cause de ces paroles, Odysseus y alla, afin de recevoir de nombreux présents. Et Autolykos et les fils d’Autolykos le saluèrent des mains et le reçurent avec de douces paroles. Amphithéè, la mère de sa mère, l’embrassa, baisant sa tête et ses deux beaux yeux. Et Autolykos ordonna à ses fils illustres de préparer le repas. Aussitôt, ceux-ci obéirent et amenèrent un taureau de cinq ans qu’ils écorchèrent. Puis, le préparant, ils le coupèrent en morceaux qu’ils embrochèrent, firent rôtir avec soin et distribuèrent. Et tout le jour, jusqu’à la chute de Hèlios, ils mangèrent, et nul dans son âme ne manqua d’une part égale. Quand Hèlios tomba et que les ténèbres survinrent, ils se couchèrent et s’endormirent, mais quand Éôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, les fils d’Autolykos et leurs chiens partirent pour la chasse, et le divin Odysseus alla avec eux.
Et ils gravirent le haut Parnèsos couvert de bois, et ils pénétrèrent bientôt dans les gorges battues des vents. Hèlios, à peine sorti du cours profond d’Okéanos, frappait les campagnes, quand les chasseurs parvinrent dans une vallée. Et les chiens les précédaient, flairant une piste ; et derrière eux venaient les fils d’Autolykos, et, avec eux, après les chiens, le divin Odysseus marchait agitant une longue lance.
Là, dans le bois épais, était couché un grand sanglier. Et la violence humide des vents ne pénétrait point ce hallier, et le splendide Hèlios ne le perçait point de ses rayons, et la pluie n’y tombait point, tant il était épais ; et le sanglier était couché là, sous un monceau de feuilles. Et le bruit des hommes et des chiens parvint jusqu’à lui, et, quand les chasseurs arrivèrent, il sortit du hallier à leur rencontre, les soies hérissées sur le cou et le feu dans les yeux, et il s’arrêta près des chasseurs. Alors, le premier, Odysseus, levant sa longue lance, de sa forte main, se rua, désirant le percer ; mais le sanglier, le prévenant, le blessa au genou d’un coup oblique de ses défenses et enleva profondément les chairs, mais sans arriver jusqu’à l’os. Et Odysseus le frappa à l’épaule droite, et la pointe de la lance brillante le traversa de part en part, et il tomba étendu dans la poussière, et son âme s’envola. Aussitôt les chers fils d’Autolykos, s’empressant autour de la blessure de l’irréprochable et divin Odysseus, la bandèrent avec soin et arrêtèrent le sang noir par une incantation ; puis, ils rentrèrent aux demeures de leur cher père.
Et Autolykos et les fils d’Autolykos, ayant guéri Odysseus et lui ayant fait de riches présents, le renvoyèrent plein de joie dans sa chère Ithakè. Là, son père et sa mère vénérable se réjouirent de son retour et l’interrogèrent sur chaque chose et sur cette blessure qu’il avait reçue. Et il leur raconta qu’un sanglier l’avait blessé de ses défenses blanches, à la chasse, où il était allé sur le Parnèsos avec les fils d’Autolykos.
Et voici que la vieille femme, touchant de ses mains cette cicatrice, la reconnut et laissa retomber le pied dans le bassin d’airain qui résonna et se renversa, et toute l’eau fut répandue à terre. Et la joie et la douleur envahirent à la fois l’âme d’Eurykléia, et ses yeux s’emplirent de larmes, et sa voix fut entrecoupée ; et, saisissant le menton d’Odysseus, elle lui dit :
– Certes, tu es Odysseus mon cher enfant ! Je ne t’ai point reconnu avant d’avoir touché tout mon maître.
Elle parla ainsi, et elle fit signe des yeux à Pènélopéia pour lui faire entendre que son cher mari était dans la demeure ; mais, du lieu où elle était, Pènélopéia ne put la voir ni la comprendre, car Athènè avait détourné son esprit. Alors, Odysseus, serrant de la main droite la gorge d’Eurykléia, et l’attirant à lui de l’autre main, lui dit :
– Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre, toi qui m’as nourri toi-même de ta mamelle ? Maintenant, voici qu’ayant subi bien des maux, j’arrive après vingt ans dans la terre de la patrie.
Mais, puisque tu m’as reconnu, et qu’un dieu te l’a inspiré, tais-toi, et que personne ne t’entende, car je te le dis, et ma parole s’accomplira : Si un dieu tue par mes mains les prétendants insolents, je ne t’épargnerai même pas, bien que tu sois ma nourrice, quand je tuerai les autres servantes dans mes demeures.
Et la prudente Eurykléia lui répondit :
– Mon enfant, quelle parole s’échappe d’entre tes dents ? Tu sais que mon âme est constante et ferme. Je me tairai comme la pierre ou le fer. Mais je te dirai autre chose ; garde mes paroles dans ton esprit : Si un dieu dompte par tes mains les prétendants insolents, je t’indiquerai dans les demeures les femmes qui te méprisent et celles qui sont innocentes.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Nourrice, pourquoi me les indiquerais-tu ? Il n’en est pas besoin. J’en jugerai moi-même et je les reconnaîtrai. Garde le silence et remets le reste aux dieux.
Il parla ainsi, et la vieille femme traversa la salle pour rapporter un autre bain de pieds, car toute l’eau s’était répandue. Puis, ayant lavé et parfumé Odysseus, elle approcha son siège du feu, afin qu’il se chauffât, et elle cacha la cicatrice sous les haillons. Et la sage Pènélopéia dit de nouveau :
– Étranger, je t’interrogerai encore quelques instants ; car l’heure du sommeil est douce, et le sommeil lui-même est doux pour le malheureux. Pour moi, un dieu m’a envoyé une grande affliction. Le jour, du moins, je surveille en pleurant les travaux des servantes de cette maison et je charme ainsi ma douleur ; mais quand la nuit vient et quand le sommeil saisit tous les hommes, je me couche sur mon lit, et, autour de mon cœur impénétrable, les pensées amères irritent mes peines. Ainsi que la fille de Pandaros, la verte Aèdôn, chante, au retour du printemps, sous les feuilles épaisses des arbres, d’où elle répand sa voix sonore, pleurant son cher fils Itylos qu’engendra le roi Zéthoios, et qu’elle tua autrefois, dans sa démence, avec l’airain ; ainsi mon âme est agitée çà et là, hésitant si je dois rester auprès de mon fils, garder avec soin mes richesses, mes servantes et ma haute demeure, et respecter le lit de mon mari et la voix du peuple, ou si je dois me marier, parmi les Akhaiens qui me recherchent dans mes demeures, à celui qui est le plus noble et qui m’offrira le plus de présents. Tant que mon fils est resté enfant et sans raison, je n’ai pu ni me marier, ni abandonner la demeure de mon mari ; mais voici qu’il est grand et parvenu à la puberté, et il me supplie de quitter ces demeures, irrité qu’il est à cause de ses biens que dévorent les Akhaiens. Mais écoute, et interprète moi ce songe. Vingt oies, sortant de l’eau, mangent du blé dans ma demeure, et je les regarde, joyeuse. Et voici qu’un grand aigle au bec recourbé, descendu d’une haute montagne, tombe sur leurs cous et les tue. Et elles restent toutes amassées dans les demeures, tandis que l’aigle s’élève dans l’aithèr divin.
Et je pleure et je gémis dans mon songe : et les Akhaiennes aux beaux cheveux se réunissent autour de moi qui gémis amèrement parce que l’aigle a tué mes oies. Mais voici qu’il redescend sur le faîte de la demeure, et il me dit avec une voix d’homme :
– Rassure-toi, fille de l’illustre Ikarios ; ceci n’est point un songe, mais une chose heureuse qui s’accomplira. Les oies sont les prétendants, et moi, qui semble un aigle, je suis ton mari qui suis revenu pour infliger une mort honteuse à tous les prétendants. Il parle ainsi, et le sommeil me quitte, et, les cherchant des yeux, je vois mes oies qui mangent le blé dans le bassin comme auparavant.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Ô femme, personne ne pourrait expliquer ce songe autrement ; et certes, Odysseus lui-même t’a dit comment il s’accomplira. La perte des prétendants est manifeste, et aucun d’entre eux n’évitera les kères et la mort.
Et la sage Pènélopéia lui répondit :
– Étranger, certes, les songes sont difficiles à expliquer, et tous ne s’accomplissent point pour les hommes. Les songes sortent par deux portes, l’une de corne et l’autre d’ivoire. Ceux qui sortent de l’ivoire bien travaillé trompent par de vaines paroles qui ne s’accomplissent pas ; mais ceux qui sortent par la porte de corne polie disent la vérité aux hommes qui les voient.
Je ne pense pas que celui-ci sorte de là et soit heureux pour moi et mon fils. Voici venir le jour honteux qui m’emmènera de la demeure d’Odysseus, car je vais proposer une épreuve. Odysseus avait dans ses demeures des haches qu’il rangeait en ordre comme des mâts de nefs, et, debout, il les traversait de loin d’une flèche. Je vais proposer cette épreuve aux prétendants. Celui qui, de ses mains, tendra le plus facilement l’arc et qui lancera une flèche à travers les douze anneaux des haches, celui-là je le suivrai loin de cette demeure si belle, qui a vu ma jeunesse, qui est pleine d’abondance, et dont je me souviendrai, je pense, même dans mes songes !
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, ne retarde pas davantage cette épreuve dans tes demeures. Le prudent Odysseus reviendra avant qu’ils aient tendu le nerf, tiré l’arc poli et envoyé la flèche à travers le fer.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Si tu voulais, étranger, assis à côté de moi, me charmer dans mes demeures, le sommeil ne se répandrait pas sur mes paupières ; mais les hommes ne peuvent rester sans sommeil, et les immortels, sur la terre féconde, ont fait la part de toute chose aux mortels. Certes, je remonterai donc dans la haute chambre, et je me coucherai sur mon lit plein d’affliction et arrosé de mes larmes depuis le jour où Odysseus est parti pour cette Ilios fatale qu’on ne devrait plus nommer.
Je me coucherai là ; et toi, couche dans cette salle, sur la terre ou sur le lit qu’on te fera.
Ayant ainsi parlé, elle monta dans sa haute chambre splendide, mais non pas seule, car deux servantes la suivaient. Et quand elle eut monté avec les servantes dans la haute chambre, elle pleura Odysseus, son cher mari, jusqu’à ce que Athènè aux yeux clairs eût répandu le doux sommeil sur ses paupières.Chant 20
Et le divin Odysseus se coucha dans le vestibule, et il étendit une peau de bœuf encore saignante, et, pardessus, les nombreuses peaux de brebis que les Akhaiens avaient sacrifiées ; et Eurykléia jeta un manteau sur lui, quand il se fut couché. C’est là qu’Odysseus était couché, méditant dans son esprit la mort des prétendants, et plein de vigilance.
Et les femmes qui s’étaient depuis longtemps livrées aux prétendants sortirent de la maison, riant entre elles et songeant à la joie. Alors, le cœur d’Odysseus s’agita dans sa poitrine, et il délibérait dans son âme, si, se jetant sur elles, il les tuerait toutes, ou s’il les laisserait pour la dernière fois s’unir aux prétendants insolents. Et son cœur aboyait dans sa poitrine, comme une chienne qui tourne autour de ses petits aboie contre un inconnu et désire le combattre. Ainsi son cœur aboyait dans sa poitrine contre ces outrages ; et, se frappant la poitrine, il réprima son cœur par ces paroles :
– Souffre encore, ô mon cœur ! Tu as subi des maux pires le jour où le kyklôps indomptable par sa force mangea mes braves compagnons. Tu le supportas courageusement, jusqu’à ce que ma prudence t’eût retiré de la caverne où tu pensais mourir.
Il parla ainsi, apaisant son cher cœur dans sa poitrine, et son cœur s’apaisa et patienta. Mais Odysseus se retournait çà et là.
De même qu’un homme tourne et retourne, sur un grand feu ardent, un ventre plein de graisse et de sang, de même il s’agitait d’un côté et de l’autre, songeant comment, seul contre une multitude, il mettrait la main sur les prétendants insolents. Et voici qu’Athènè, étant descendue de l’Ouranos, s’approcha de lui, semblable à une femme, et, se tenant près de sa tête, lui dit ces paroles :
– Pourquoi veilles-tu, ô le plus malheureux de tous les hommes ? Cette demeure est la tienne, ta femme est ici, et ton fils aussi, lui que chacun désirerait pour fils.
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Certes, déesse, tu as parlé très sagement, mais je songe dans mon âme comment je mettrai la main sur les prétendants insolents, car je suis seul, et ils se réunissent ici en grand nombre. Et j’ai une autre pensée plus grande dans mon esprit. Serai-je tué par la volonté de Zeus et par la tienne ? Échapperai-je ? Je voudrais le savoir de toi.
Et la déesse aux yeux clairs, Athènè, lui répondit :
– Insensé ! Tout homme a confiance dans le plus faible de ses compagnons, qui n’est qu’un mortel, et de peu de sagesse. Mais moi, je suis déesse, et je t’ai protégé dans tous tes travaux, et je te le dis hautement : Quand même cinquante armées d’hommes parlant des langues diverses nous entoureraient pour te tuer avec l’épée, tu n’en ravirais pas moins leurs bœufs et leurs grasses brebis.
Dors donc. Il est cruel de veiller toute la nuit. Bientôt tu échapperas à tous tes maux.
Elle parla ainsi et répandit le sommeil sur ses paupières. Puis, la noble déesse remonta dans l’Olympos, dès que le sommeil eut saisi Odysseus, enveloppant ses membres et apaisant les peines de son cœur. Et sa femme se réveilla ; et elle pleurait, assise sur son lit moelleux. Et, après qu’elle se fut rassasiée de larmes, la noble femme supplia d’abord la vénérable déesse Artémis, fille de Zeus :
– Artémis, vénérable déesse, fille de Zeus, plût aux dieux que tu m’arrachasses l’âme, à l’instant même, avec tes flèches, ou que les tempêtes pussent m’emporter par les routes sombres et me jeter dans les courants du rapide Okéanos ! Ainsi, les tempêtes emportèrent autrefois les filles de Pandaros. Les dieux avaient fait mourir leurs parents et elles étaient restées orphelines dans leurs demeures, et la divine Aphroditè les nourrissait de fromage, de miel doux et de vin parfumé. Hèrè les doua, plus que toutes les autres femmes, de beauté et de prudence, et la chaste Artémis d’une haute taille, et Athènè leur enseigna à faire de beaux ouvrages. Alors, la divine Aphroditè monta dans le haut Olympos, afin de demander, pour ces vierges, d’heureuses noces à Zeus qui se réjouit de la foudre et qui connaît les bonnes et les mauvaises destinées des hommes mortels. Et, pendant ce temps, les Harpyes enlevèrent ces vierges et les donnèrent aux odieuses Érinnyes pour les servir. Que les Olympiens me perdent ainsi !
Qu’Artémis aux beaux cheveux me frappe, afin que je revoie au moins Odysseus sous la terre odieuse, plutôt que réjouir l’âme d’un homme indigne ! On peut supporter son mal, quand, après avoir pleuré tout le jour, le cœur gémissant, on dort la nuit ; car le sommeil, ayant fermé leurs paupières, fait oublier à tous les hommes les biens et les maux. Mais l’insomnie cruelle m’a envoyé un daimôn qui a couché cette nuit auprès de moi, semblable à ce qu’était Odysseus quand il partit pour l’armée. Et mon cœur était consolé, pensant que ce n’était point un songe, mais la vérité.
Elle parla ainsi, et, aussitôt, Éôs au thrône d’or apparut. Et le divin Odysseus entendit la voix de Pènélopéia qui pleurait. Et il pensa et il lui vint à l’esprit que, placée au-dessus de sa tête, elle l’avait reconnu. C’est pourquoi, ramassant le manteau et les toisons sur lesquelles il était couché, il les plaça sur le thrône dans la salle ; et, jetant dehors la peau de bœuf, il leva les mains et supplia Zeus :
– Père Zeus ! si, par la volonté des dieux, tu m’as ramené dans ma patrie, à travers la terre et la mer, et après m’avoir accablé de tant de maux, fais qu’un de ceux qui s’éveillent dans cette demeure dise une parole heureuse, et, qu’au-dehors, un de tes signes m’apparaisse.
Il parla ainsi en priant, et le très sage Zeus l’entendit, et, aussitôt, il tonna du haut de l’Olympos éclatant et par-dessus les nuées, et le divin Odysseus s’en réjouit.
Et, aussitôt, une femme occupée à moudre éleva la voix dans la maison. Car il y avait non loin de là douze meules du prince des peuples, et autant de servantes les tournaient, préparant l’huile et la farine, moelle des hommes. Et elles s’étaient endormies, après avoir moulu le grain, et l’une d’elles n’avait pas fini, et c’était la plus faible de toutes. Elle arrêta sa meule et dit une parole heureuse pour le roi :
– Père Zeus, qui commandes aux dieux et aux hommes, certes, tu as tonné fortement du haut de l’Ouranos étoilé où il n’y a pas un nuage. C’est un de tes signes à quelqu’un. Accomplis donc mon souhait, à moi, malheureuse : Que les prétendants, en ce jour et pour la dernière fois, prennent le repas désirable dans la demeure d’Odysseus ! Ils ont rompu mes genoux sous ce dur travail de moudre leur farine ; qu’ils prennent aujourd’hui leur dernier repas !
Elle parla ainsi, et le divin Odysseus se réjouit de cette parole heureuse et du tonnerre de Zeus, et il se dit qu’il allait punir les coupables. Et les autres servantes se rassemblaient dans les belles demeures d’Odysseus, et elles allumèrent un grand feu dans le foyer. Et le divin Tèlémakhos se leva de son lit et se couvrit de ses vêtements. Il suspendit une épée à ses épaules et il attacha de belles sandales à ses pieds brillants ; puis, il saisit une forte lance à pointe d’airain, et, s’arrêtant, comme il passait le seuil, il dit à Eurykléia :
– Chère nourrice, comment avez-vous honoré l’étranger dans la demeure ?
Lui avez-vous donné un lit et de la nourriture, ou gît-il négligé ? Car ma mère est souvent ainsi, bien que prudente ; elle honore inconsidérément le moindre des hommes et renvoie le plus méritant sans honneurs.
Et la prudente Eurykléia lui répondit :
– N’accuse point ta mère innocente, mon enfant. L’étranger s’est assis et il a bu du vin autant qu’il l’a voulu ; mais il a refusé de manger davantage quand ta mère l’invitait elle-même. Elle a ordonné aux servantes de préparer son lit ; mais lui, comme un homme plein de soucis et malheureux, a refusé de dormir dans un lit, sous des couvertures ; et il s’est couché, dans le vestibule, sur une peau de bœuf encore saignante et sur des peaux de brebis ; et nous avons jeté un manteau par-dessus.
Elle parla ainsi, et Tèlémakhos sortit de la demeure, tenant sa lance à la main. Et deux chiens rapides le suivaient. Et il se hâta vers l’agora des Akhaiens aux belles knèmides. Et Eurykléia, fille d’Ops Peisènoride, la plus noble des femmes, dit aux servantes :
– Allons ! hâtez-vous ! Balayez la salle, arrosez-la, jetez des tapis pourprés sur les beaux thrônes, épongez les tables, purifiez les kratères et les coupes rondes ; et qu’une partie d’entre vous aille puiser de l’eau à la fontaine et revienne aussitôt. Les prétendants ne tarderont pas à arriver, et ils viendront dès le matin, car c’est une fête pour tous.
Elle parla ainsi, et les servantes, l’ayant entendue, lui obéirent. Et les unes allèrent à la fontaine aux eaux noires, et les autres travaillaient avec ardeur dans la maison. Puis, les prétendants insolents entrèrent ; et ils se mirent à fendre du bois. Et les servantes revinrent de la fontaine, et, après elles, le porcher qui amenait trois de ses meilleurs porcs. Et il les laissa manger dans l’enceinte des haies. Puis il adressa à Odysseus ces douces paroles :
– Étranger, les Akhaiens te traitent-ils mieux, ou t’outragent-ils comme auparavant ?
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Puissent les dieux, Eumaios, châtier leur insolence, car ils commettent des actions outrageantes et honteuses dans une demeure étrangère, et ils n’ont plus la moindre pudeur.
Et, comme ils se parlaient ainsi, le chevrier Mélanthios s’approcha d’eux, conduisant, pour le repas des prétendants, les meilleures chèvres de tous ses troupeaux, et deux bergers le suivaient. Et il attacha les chèvres sous le portique sonore, et il dit à Odysseus, en l’injuriant de nouveau :
– Étranger, es-tu encore ici à importuner les hommes en leur demandant avec insistance ? Ne passeras-tu point les portes ? Je ne pense pas que nous nous séparions avant que tu aies éprouvé nos mains, car tu demandes à satiété, et il y a d’autres repas parmi les Akhaiens.
Il parla ainsi, et le prudent Odysseus ne répondit rien, et il resta muet, mais secouant la tête et méditant sa vengeance. Puis, arriva Philoitios, chef des bergers, conduisant aux prétendants une génisse stérile et des chèvres grasses. Des bateliers, de ceux qui faisaient passer les hommes, l’avaient amené. Il attacha les animaux sous le portique sonore, et, s’approchant du porcher, il lui dit :
– Porcher, quel est cet étranger nouvellement venu dans notre demeure ? D’où est-il ? Quelle est sa race et quelle est sa patrie ? Le malheureux ! certes, il est semblable à un roi : mais les dieux accablent les hommes qui errent sans cesse, et ils destinent les rois eux-mêmes au malheur.
Il parla ainsi, et, tendant la main droite à Odysseus, il lui dit ces paroles ailées :
– Salut, père étranger ! Que la richesse t’arrive bientôt, car maintenant, tu es accablé de maux ! Père Zeus, aucun des dieux n’est plus cruel que toi, car tu n’as point pitié des hommes que tu as engendrés toi-même pour être accablés de misères et d’amères douleurs ! La sueur me coule, et mes yeux se remplissent de larmes en voyant cet étranger, car je me souviens d’Odysseus, et je pense qu’il erre peut-être parmi les hommes, couvert de semblables haillons, s’il vit encore et s’il voit la lumière de Hèlios. Mais, s’il est mort et s’il est dans les demeures d’Aidès, je gémirai toujours au souvenir de l’irréprochable Odysseus qui m’envoya, tout jeune, garder ses bœufs chez le peuple des Képhalléniens.
Et maintenant ils sont innombrables, et aucun autre ne possède une telle race de bœufs aux larges fronts. Et les prétendants m’ordonnent de les leur amener pour qu’ils les mangent ; et ils ne s’inquiètent point du fils d’Odysseus dans cette demeure, et ils ne respectent ni ne craignent les dieux, et ils désirent avec ardeur partager les biens d’un roi absent depuis longtemps. Cependant, mon cœur hésite dans ma chère poitrine. Ce serait une mauvaise action, Tèlémakhos étant vivant, de m’en aller chez un autre peuple, auprès d’hommes étrangers, avec mes bœufs ; et, d’autre part, il est dur de rester ici, gardant mes bœufs pour des étrangers et subissant mille maux. Déjà, depuis longtemps, je me serais enfui vers quelque roi éloigné, car, ici, rien n’est tolérable ; mais je pense que ce malheureux reviendra peut-être et dispersera les prétendants dans ses demeures.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Bouvier, tu ne ressembles ni à un méchant homme, ni à un insensé, et je reconnais que ton esprit est plein de prudence. C’est pourquoi je te le jure par un grand serment : que Zeus, le premier des dieux, le sache ! Et cette table hospitalière, et cette demeure du brave Odysseus où je suis venu ! Toi présent, Odysseus reviendra ici, et tu le verras de tes yeux, si tu le veux, tuer les prétendants qui oppriment ici.
– Étranger, puisse le Kroniôn accomplir tes paroles ! Tu sauras alors à qui appartiendront ma force et mes mains.
Et Eumaios suppliait en même temps tous les dieux de ramener le très sage Odysseus dans ses demeures.
Et tandis qu’ils se parlaient ainsi, les prétendants préparaient le meurtre et la mort de Tèlémakhos. Mais, en ce moment, un aigle vola à leur gauche, tenant une colombe tremblante.
Alors Amphinomos leur dit :
– Ô amis, notre dessein de tuer Tèlémakhos ne s’accomplira pas. Ne songeons plus qu’au repas.
Ainsi parla Amphinomos, et sa parole leur plut. Puis, entrant dans la demeure du divin Odysseus, ils déposèrent leurs manteaux sur les sièges et sur les thrônes, ils sacrifièrent les grandes brebis, les chèvres grasses, les porcs et la génisse indomptée. Et ils distribuèrent les entrailles rôties. Puis ils mêlèrent le vin dans les kratères ; et le porcher distribuait les coupes, et Philoitios, le chef des bouviers, distribuait le pain dans de belles corbeilles, et Mélanthios versait le vin. Et ils étendirent les mains vers les mets placés devant eux. Mais Tèlémakhos vit asseoir Odysseus, qui méditait des ruses, auprès du seuil de pierre, dans la salle, sur un siège grossier, et il plaça devant lui, sur une petite table, une part des entrailles. Puis, il versa du vin dans une coupe d’or, et il lui dit :
– Assieds-toi là, parmi les hommes, et bois du vin.
J’écarterai moi-même, loin de toi, les outrages de tous les prétendants, car cette demeure n’est pas publique ; c’est la maison d’Odysseus, et il l’a construite pour moi. Et vous, prétendants, retenez vos injures et vos mains, de peur que la discorde se manifeste ici.
Il parla ainsi, et tous, mordant leurs lèvres, admiraient Tèlémakhos et comme il avait parlé avec audace. Et Antinoos, fils d’Eupeithès, leur dit :
– Nous avons entendu, Akhaiens, les paroles sévères de Tèlémakhos, car il nous a rudement menacés. Certes, le Kroniôn Zeus ne l’a point permis ; mais, sans cela, nous l’aurions déjà fait taire dans cette demeure, bien qu’il soit un habile agorète.
Ainsi parla Antinoos, et Tèlémakhos ne s’en inquiéta point. Et les hérauts conduisirent à travers la ville l’hécatombe sacrée, et les Akhaiens chevelus se réunirent dans le bois épais de l’archer Apollôn.
Et, après avoir rôti les chairs supérieures, les prétendants distribuèrent les parts et prirent leur repas illustre ; et, comme l’avait ordonné Tèlémakhos, le cher fils du divin Odysseus, les serviteurs apportèrent à celui-ci une part égale à celles de tous les autres convives ; mais Athènè ne voulut pas que les prétendants cessassent leurs outrages, afin qu’une plus grande colère entrât dans le cœur du Laertiade Odysseus.
Et il y avait parmi les prétendants un homme très inique. Il se nommait Ktèsippos, et il avait sa demeure dans Samè. Confiant dans les richesses de son père, il recherchait la femme d’Odysseus absent depuis longtemps. Et il dit aux prétendants insolents :
– Écoutez-moi, illustres prétendants. Déjà cet étranger a reçu une part égale à la nôtre, comme il convient, car il ne serait ni bon, ni juste de priver les hôtes de Tèlémakhos, quels que soient, ceux qui entrent dans sa demeure. Mais moi aussi, je lui ferai un présent hospitalier, afin que lui-même donne un salaire aux baigneurs ou aux autres serviteurs qui sont dans la maison du divin Odysseus.
Ayant ainsi parlé, il saisit dans une corbeille un pied de bœuf qu’il lança d’une main vigoureuse ; mais Odysseus l’évita en baissant la tête, et il sourit sardoniquement dans son âme ; et le pied de bœuf frappa le mur bien construit. Alors Tèlémakhos réprimanda ainsi Ktèsippos :
– Ktèsippos, certes, il vaut beaucoup mieux pour toi que tu n’aies point frappé mon hôte, et qu’il ait lui-même évité ton trait, car, certes, je t’eusse frappé de ma lance aiguë au milieu du corps, et, au lieu de tes noces, ton père eût fait ton sépulcre. C’est pourquoi qu’aucun de vous ne montre son insolence dans ma demeure, car je comprends et je sais quelles sont les bonnes et les mauvaises actions, et je ne suis plus un enfant.
J’ai longtemps souffert et regardé ces violences, tandis que mes brebis étaient égorgées, et que mon vin était épuisé, et que mon pain était mangé car il est difficile à un seul de s’opposer à plusieurs mais ne m’outragez pas davantage. Si vous avez le désir de me tuer avec l’airain, je le veux bien, et il vaut mieux que je meure que de voir vos honteuses actions, mes hôtes chassés et mes servantes indignement violées dans mes belles demeures.
Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et le Damastoride Agélaos dit enfin :
– Ô amis, à cette parole juste, il ne faut point répondre injurieusement, ni frapper cet étranger, ou quelqu’un des serviteurs qui sont dans les demeures du divin Odysseus ; mais je parlerai doucement à Tèlémakhos et à sa mère ; puissé-je plaire au cœur de tous deux. Aussi longtemps que votre âme dans vos poitrines a espéré le retour du très sage Odysseus en sa demeure, nous n’avons eu aucune colère de ce que vous reteniez, les faisant attendre, les prétendants dans vos demeures. Puisque Odysseus devait revenir, cela valait mieux en effet. Maintenant il est manifeste qu’il ne reviendra plus. Va donc à ta mère et dis-lui qu’elle épouse le plus illustre d’entre nous, et celui qui lui fera le plus de présents. Tu jouiras alors des biens paternels, mangeant et buvant ; et ta mère entrera dans la maison d’un autre.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Agélaos, non, par Zeus et par les douleurs de mon pere qui est mort ou qui erre loin d’Ithakè, non, je ne m’oppose point aux noces de ma mère, et je l’engage à épouser celui qu’elle choisira et qui lui fera le plus de présents ; mais je crains de la chasser de cette demeure par des paroles rigoureuses, de peur qu’un dieu n’accomplisse pas ceci.
Ainsi parla Tèlémakhos, et Pallas Athènè excita un rire immense parmi les prétendants, et elle troubla leur esprit, et ils riaient avec des mâchoires contraintes, et ils mangeaient les chairs crues, et leurs yeux se remplissaient de larmes, et leur âme pressentait le malheur.
Alors, le divin Théoklyménos leur dit :
– Ah ! malheureux ! quel malheur allez-vous subir ! Vos têtes, vos visages, vos genoux sont enveloppés par la nuit ; vous sanglotez, vos joues sont couvertes de larmes ; ces colonnes et ces murailles sont souillées de sang ; le portique et la cour sont pleins d’ombres qui se hâtent vers les ténèbres de l’Érébos ; Hèlios périt dans l’Ouranos, et le brouillard fatal s’avance !
Il parla ainsi, et tous se mirent à rire de lui ; et Eurymakhos, fils de Polybos, dit le premier :
– Tu es insensé, étranger récemment arrivé ! Chassez-le aussitôt de cette demeure, et qu’il aille à l’agora, puisqu’il prend le jour pour la nuit.
Et le divin Théoklyménos lui répondit :
– Eurymakhos, n’ordonne point de me chasser d’ici. Il me suffit de mes yeux, de mes oreilles, de mes pieds et de l’esprit équitable qui est dans ma poitrine. Je sortirai d’ici, car je devine le malheur qui est suspendu sur vous ; et nul d’entre vous n’y échappera, ô prétendants, hommes injurieux qui commettez des actions iniques dans la demeure du divin Odysseus !
Ayant ainsi parlé, il sortit des riches demeures et retourna chez Peiraios qui l’avait accueilli avec bienveillance. Et les prétendants, se regardant les uns les autres, irritaient Tèlémakhos en raillant ses hôtes. Et l’un de ces jeunes hommes insolents dit :
– Tèlémakhos, aucun donneur d’hospitalité n’est plus à plaindre que toi. Tu as encore, il est vrai, ce vagabond affamé, privé de pain et de vin, sans courage et qui ne sait rien faire, inutile fardeau de la terre, mais l’autre est allé prophétiser ailleurs. Écoute-moi ; ceci est pour le mieux ; jetons tes deux hôtes sur une nef et envoyons-les aux Sikèles. Chacun vaudra un bon prix.
Ainsi parlaient les prétendants, et Tèlémakhos ne s’inquiéta point de leurs paroles ; mais il regardait son père, en silence, attendant toujours qu’il mît la main sur les prétendants insolents.
Et la fille d’Ikarios, la sage Pènélopéia, accoudée sur son beau thrône, écoutait les paroles de chacun d’eux dans les demeures. Et ils riaient joyeusement en continuant leur repas, car ils avaient déjà beaucoup mangé.
Mais, bientôt, jamais fête ne devait leur être plus funeste que celle que leur préparaient une déesse et un homme brave, car, les premiers, ils avaient commis de honteuses actions.Chant 21
Alors, la déesse Athènè aux yeux clairs inspira à la fille d’Ikarios, à la prudente Pènélopéia, d’apporter aux prétendants l’arc et le fer brillant, pour l’épreuve qui, dans les demeures d’Odysseus, devait être le commencement du carnage. Elle gravit la longue échelle de la maison, tenant à la main la belle clef recourbée, d’airain et à poignée d’ivoire ; et elle se hâta de monter avec ses servantes dans la chambre haute où étaient renfermés les trésors du roi, l’airain, l’or et le fer difficile à travailler. Là, se trouvaient l’arc recourbé, le carquois porte-flèches et les flèches terribles qui le remplissaient. Iphitos Eurythide, de Lakédaimôn, semblable aux immortels, les avait donnés à Odysseus, l’ayant rencontré à Messènè, dans la demeure du brave Orsilokhos, où Odysseus était venu pour une réclamation de tout le peuple qui l’en avait chargé. En effet, les Messèniens avaient enlevé d’Ithakè, sur leurs nefs, trois cents brebis et leurs bergers. Et, pour cette réclamation, Odysseus était venu, tout jeune encore, car son père et les autres vieillards l’avaient envoyé. Et Iphitos était venu de son côté, cherchant douze cavales qu’il avait perdues et autant de mules patientes, et qui, toutes, devaient lui attirer la mort ; car, s’étant rendu auprès du magnanime fils de Zeus, Héraklès, illustre par ses grands travaux, celui-ci le tua dans ses demeures, bien qu’il fût son hôte. Et il le tua indignement, sans respecter ni les dieux, ni la table où il l’avait fait asseoir, et il retint ses cavales aux sabots vigoureux. Ce fut en cherchant celles-ci qu’Iphitos rencontra Odysseus et qu’il lui donna cet arc qu’avait porté le grand Eurytos et qu’il laissa en mourant à son fils dans ses hautes demeures.
Et Odysseus donna à celui-ci une épée aiguë et une forte lance. Ce fut le commencement d’une triste amitié, et qui ne fut pas longue, car ils ne se reçurent point à leurs tables, et le fils de Zeus tua auparavant l’Eurytide Iphitos semblable aux immortels. Et le divin Odysseus se servait de cet arc à Ithakè, mais il ne l’emporta point sur ses nefs noires en partant pour la guerre, et il le laissa dans ses demeures, en mémoire de son cher hôte.
Et quand la noble femme fut arrivée à la chambre haute, elle monta sur le seuil de chêne qu’autrefois un ouvrier habile avait poli et ajusté au cordeau, et auquel il avait adapté des battants et de brillantes portes. Elle détacha aussitôt la courroie de l’anneau, fit entrer la clef et ouvrit les verrous. Et, semblables à un taureau qui mugit en paissant dans un pré, les belles portes résonnèrent, frappées par la clef, et s’ouvrirent aussitôt.
Et Pènélopéia monta sur le haut plancher où étaient les coffres qui renfermaient les vêtements parfumés, et elle détacha du clou l’arc et le carquois brillant. Et, s’asseyant là, elle les posa sur ses genoux, et elle pleura amèrement. Et, après s’être rassasiée de larmes et de deuil, elle se hâta d’aller à la grande salle, vers les prétendants insolents, tenant à la main l’arc recourbé et le carquois porte-flèches et les flèches terribles qui le remplissaient. Et les servantes portaient le coffre où étaient le fer et l’airain des jeux du roi.
Et la noble femme, étant arrivée auprès des prétendants, s’arrêta sur le seuil de la belle salle, un voile léger sur ses joues et deux servantes à ses côtés. Et, aussitôt, elle parla aux prétendants et elle leur dit :
– Écoutez-moi, illustres prétendants qui, pour manger et boire sans cesse, avez envahi la maison d’un homme absent depuis longtemps, et qui dévorez ses richesses, sans autre prétexte que celui de m’épouser. Voici, ô prétendants, l’épreuve qui vous est proposée. Je vous apporte le grand arc du divin Odysseus. Celui qui, de ses mains, tendra le plus facilement cet arc et lancera une flèche à travers les douze haches, je le suivrai, et il me conduira loin de cette demeure qui a vu ma jeunesse, qui est belle et pleine d’abondance, et dont je me souviendrai, je pense, même dans mes songes.
Elle parla ainsi et elle ordonna au porcher Eumaios de porter aux prétendants l’arc et le fer brillant. Et Eumaios les prit en pleurant et les porta ; et le bouvier pleura aussi en voyant l’arc du roi. Et Antinoos les réprimanda et leur dit :
– Rustres stupides, qui ne pensez qu’au jour le jour, pourquoi pleurez-vous, misérables, et remuez-vous ainsi dans sa poitrine l’âme de cette femme qui est en proie à la douleur, depuis qu’elle a perdu son cher mari ? Mangez en silence, ou allez pleurer dehors et laissez ici cet arc. Ce sera pour les prétendants une épreuve difficile, car je ne pense pas qu’on tende aisément cet arc poli.
Il n’y a point ici un seul homme tel que Odysseus. Je l’ai vu moi-même, et je m’en souviens, mais j’étais alors un enfant.
Il parla ainsi, et il espérait, dans son âme, tendre l’arc et lancer une flèche à travers le fer ; mais il devait, certes, goûter le premier une flèche partie des mains de l’irréprochable Odysseus qu’il avait déjà outragé dans sa demeure et contre qui il avait excité tous ses compagnons. Alors, la force sacrée de Tèlémakhos parla ainsi :
– Ô dieux ! Certes, le Kroniôn Zeus m’a rendu insensé. Voici que ma chère mère, bien que très prudente, dit qu’elle va suivre un autre homme et quitter cette demeure ! Et voici que je ris et que je me réjouis dans mon esprit insensé ! Tentez donc, ô prétendants, l’épreuve proposée ! Il n’est point de telle femme dans la terre Akhaienne, ni dans la sainte Pylos, ni dans Argos, ni dans Mykènè, ni dans Ithakè, ni dans la noire Épeiros. Mais vous le savez, qu’est-il besoin de louer ma mère ? Allons, ne retardez pas l’épreuve ; hâtez-vous de tendre cet arc, afin que nous voyions qui vous êtes. Moi-même je ferai l’épreuve de cet arc ; et, si je le tends, si je lance une flèche à travers le fer, ma mère vénérable, à moi qui gémis, ne quittera point ces demeures avec un autre homme et ne m’abandonnera point, moi qui aurai accompli les nobles jeux de mon père !
Il parla ainsi, et, se levant, il retira son manteau pourpré et son épée aiguë de ses épaules, puis, ayant creusé un long fossé, il dressa en ligne les anneaux des haches, et il pressa la terre tout autour.
Et tous furent stupéfaits de son adresse, car il ne l’avait jamais vu faire. Puis, se tenant debout sur le seuil, il essaya l’arc. Trois fois il faillit le tendre, espérant tirer le nerf et lancer une flèche à travers le fer, et trois fois la force lui manqua. Et comme il le tentait une quatrième fois, Odysseus lui fit signe et le retint malgré son désir. Alors la force sacrée de Tèlémakhos parla ainsi :
– Ô dieux ! ou je ne serai jamais qu’un homme sans force, ou je suis trop jeune encore et je n’ai point la vigueur qu’il faudrait pour repousser un guerrier qui m’attaquerait. Allons ! vous qui m’êtes supérieurs par la force, essayez cet arc et terminons cette épreuve.
Ayant ainsi parlé, il déposa l’arc sur la terre, debout et appuyé contre les battants polis de la porte, et il mit la flèche aiguë auprès de l’arc au bout recourbé ; puis, il retourna s’asseoir sur le thrône qu’il avait quitté. Et Antinoos, fils d’Eupeithès, dit aux prétendants :
– Compagnons, levez-vous tous, et avancez, l’un après l’autre, dans l’ordre qu’on suit en versant le vin.
Ainsi parla Antinoos, et ce qu’il avait dit leur plut. Et Leiôdès, fils d’Oinops, se leva le premier. Et il était leur sacrificateur, et il s’asseyait toujours le plus près du beau kratère. Il n’aimait point les actions iniques et il s’irritait sans cesse contre les prétendants. Et il saisit le premier l’arc et le trait rapide.
Et, debout sur le seuil, il essaya l’arc ; mais il ne put le tendre et il se fatigua vainement les bras. Alors, il dit aux prétendants :
– Ô amis, je ne tendrai point cet arc ; qu’un autre le prenne. Cet arc doit priver de leur cœur et de leur âme beaucoup de braves guerriers, car il vaut mieux mourir que de nous retirer vivants, n’ayant point accompli ce que nous espérions ici. Qu’aucun n’espère donc plus, dans son âme, épouser Pènélopéia, la femme d’Odysseus. Après avoir éprouvé cet arc, chacun de vous verra qu’il lui faut rechercher quelque autre femme parmi les Akhaiennes aux beaux péplos, et à laquelle il fera des présents. Pènélopéia épousera ensuite celui qui lui fera le plus de présents et à qui elle est destinée.
Il parla ainsi, et il déposa l’arc appuyé contre les battants polis de la porte, et il mit la flèche aiguë auprès de l’arc au bout recourbé. Puis, il retourna s’asseoir sur le thrône qu’il avait quitté. Alors, Antinoos le réprimanda et lui dit :
– Leiôdès, quelle parole s’est échappée d’entre tes dents ? Elle est mauvaise et funeste, et je suis irrité de l’avoir entendue. Cet arc doit priver de leur cœur et de leur âme beaucoup de braves guerriers, parce que tu n’as pu le tendre ! Ta mère vénérable ne t’a point enfanté pour tendre les arcs, mais, bientôt, d’autres prétendants illustres tendront celui-ci.
Il parla ainsi et il donna cet ordre au chevrier Mélanthios :
– Mélanthios, allume promptement du feu dans la demeure et place devant le feu un grand siège couvert de peaux. Apporte le large disque de graisse qui est dans la maison, afin que les jeunes hommes, l’ayant fait chauffer, en amollissent cet arc, et que nous terminions cette épreuve.
Il parla ainsi, et aussitôt Mélanthios alluma un grand feu, et il plaça devant le feu un siège couvert de peaux ; et les jeunes hommes, ayant chauffé le large disque de graisse qui était dans la maison, en amollirent l’arc, et ils ne purent le tendre, car ils étaient de beaucoup trop faibles. Et il ne restait plus qu’Antinoos et le divin Eurymakhos, chefs des prétendants et les plus braves d’entre eux.
Alors, le porcher et le bouvier du divin Odysseus sortirent ensemble de la demeure, et le divin Odysseus sortit après eux. Et quand ils furent hors des portes, dans la cour, Odysseus, précipitant ses paroles, leur dit :
– Bouvier, et toi, porcher, vous dirai-je quelque chose et ne vous cacherai-je rien ? Mon âme, en effet, m’ordonne de parler. Viendriez-vous en aide à Odysseus s’il revenait brusquement et si un dieu le ramenait ? À qui viendriez-vous en aide, aux prétendants ou à Odysseus ? Dites ce que votre cœur et votre âme vous ordonnent de dire.
Et le bouvier lui répondit :
– Père Zeus ! Plût aux dieux que mon vœu fût accompli ! Plût aux dieux que ce héros revînt et qu’un dieu le ramenât, tu saurais alors à qui appartiendraient ma force et mes bras !
Et, de même, Eumaios supplia tous les dieux de ramener le prudent Odysseus dans sa demeure. Alors, celui-ci connut quelle était leur vraie pensée, et, leur parlant de nouveau, il leur dit :
– Je suis Odysseus. Après avoir souffert des maux innombrables, je reviens dans la vingtième année sur la terre de la patrie. Je sais que, seuls parmi les serviteurs, vous avez désiré mon retour ; car je n’ai entendu aucun des autres prier pour que je revinsse dans ma demeure. Je vous dirai donc ce qui sera. Si un dieu dompte par mes mains les prétendants insolents, je vous donnerai à tous deux des femmes, des richesses et des demeures bâties auprès des miennes, et vous serez pour Tèlémakhos des compagnons et des frères. Mais je vous montrerai un signe manifeste, afin que vous me reconnaissiez bien et que vous soyez persuadés dans votre âme : cette blessure qu’un sanglier me fit autrefois de ses blanches dents, quand j’allai sur le Parnèsos avec les fils d’Autolykos.
Il parla ainsi, et entrouvrant ses haillons, il montra la grande blessure. Et, dès qu’ils l’eurent vue, aussitôt ils la reconnurent.
Et ils pleurèrent, entourant le prudent Odysseus de leurs bras, et ils baisèrent sa tête et ses épaules. Et, de même, Odysseus baisa leurs têtes et leurs épaules. Et la lumière de Hèlios fût tombée tandis qu’ils pleuraient, si Odysseus ne les eût arrêtés et ne leur eût dit :
– Cessez de pleurer et de gémir, de peur que, sortant de la demeure, quelqu’un vous voie et le dise ; mais rentrez l’un après l’autre, et non ensemble. Je rentre le premier ; venez ensuite. Maintenant, écoutez ceci : les prétendants insolents ne permettront point, tous, tant qu’ils sont, qu’on me donne l’arc et le carquois ; mais toi, divin Eumaios, apporte-moi l’arc à travers la salle, remets-le dans mes mains, et dis aux servantes de fermer les portes solides de la demeure. Si quelqu’un entend, de la cour, des gémissements et du tumulte, qu’il y reste et s’occupe tranquillement de son travail. Et toi, divin Philoitios, je t’ordonne de fermer les portes de la cour et d’en assujettir les barrières et d’en pousser les verrous.
Ayant ainsi parlé, il rentra dans la grande salle et il s’assit sur le siège qu’il avait quitté. Puis, les deux serviteurs du divin Odysseus rentrèrent. Et déjà Eurymakhos tenait l’arc dans ses mains, le chauffant de tous les côtés à la splendeur du feu ; mais il ne put le tendre, et son illustre cœur soupira profondément, et il dit, parlant ainsi :
– Ô dieux ! certes, je ressens une grande douleur pour moi et pour tous.
Je ne gémis pas seulement à cause de mes noces, bien que j’en sois attristé, car il y a beaucoup d’autres Akhaiennes dans Ithakè entourée des flots et dans les autres villes ; mais je gémis que nous soyons tellement inférieurs en force au divin Odysseus que nous ne puissions tendre son arc. Ce sera notre honte dans l’avenir.
Et Antinoos, fils d’Eupeithès, lui répondit :
– Eurymakhos, ceci ne sera point. Songes-y toi-même. C’est aujourd’hui parmi le peuple la fête sacrée d’un dieu ; qui pourrait tendre un arc ? Laissons-le en repos, et que les anneaux des haches restent dressés. Je ne pense pas que quelqu’un les enlève dans la demeure du Laertiade Odysseus. Allons ! que celui qui verse le vin emplisse les coupes, afin que nous fassions des libations, après avoir déposé cet arc. Ordonnez au chevrier Mélanthios d’amener demain les meilleures chèvres de tous ses troupeaux, afin qu’ayant brûlé leurs cuisses pour Apollôn illustre par son arc, nous tentions de nouveau et nous terminions l’épreuve.
Ainsi parla Antinoos, et ce qu’il avait dit leur plut. Et les hérauts leur versèrent de l’eau sur les mains, et les jeunes hommes couronnèrent de vin les kratères et le distribuèrent entre tous à coupes pleines. Et, après qu’ils eurent fait des libations et bu autant que leur âme le désirait, le prudent Odysseus, méditant des ruses, leur dit :
– Écoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m’ordonne dans ma poitrine. Je prie surtout Eurymakhos et le roi Antinoos, car ce dernier a parlé comme il convenait. Laissez maintenant cet arc, et remettez le reste aux dieux. Demain un dieu donnera la victoire à qui il voudra : mais donnez-moi cet arc poli, afin que je fasse devant vous l’épreuve de mes mains et de ma force, et que je voie si j’ai encore la force d’autrefois dans mes membres courbés, ou si mes courses errantes et la misère me l’ont enlevée.
Il parla ainsi, et tous furent très irrités, craignant qu’il tendît l’arc poli. Et Antinoos le réprimanda ainsi et lui dit :
– Ah ! misérable étranger, ne te reste-t-il plus le moindre sens ? Ne te plaît-il plus de prendre tranquillement ton repas à nos tables ? Es-tu privé de nourriture ? N’entends-tu pas nos paroles ? Jamais aucun autre étranger ou mendiant ne nous a écoutés ainsi. Le doux vin te trouble, comme il trouble celui qui en boit avec abondance et non convenablement. Certes, ce fut le vin qui troubla l’illustre centaure Eurythiôn, chez les Lapithes, dans la demeure du magnanime Peirithoos. Il troubla son esprit avec le vin, et, devenu furieux, il commit des actions mauvaises dans la demeure de Peirithoos. Et la douleur saisit alors les héros, et ils le traînèrent hors du portique, et ils lui coupèrent les oreilles avec l’airain cruel, et les narines. Et, l’esprit égaré, il s’en alla, emportant son supplice et son cœur furieux.
Et c’est de là que s’éleva la guerre entre les centaures et les hommes ; mais ce fut d’abord Eurythiôn qui, étant ivre, trouva son malheur. Je te prédis un châtiment aussi grand si tu tends cet arc. Tu ne supplieras plus personne dans cette demeure, car nous t’enverrons aussitôt sur une nef noire au roi Ékhétos, le plus féroce de tous les hommes. Et là tu ne te sauveras pas. Bois donc en repos et ne lutte point contre des hommes plus jeunes que toi.
Et la prudente Pènélopéia parla ainsi :
– Antinoos, il n’est ni bon ni juste d’outrager les hôtes de Tèlémakhos, quel que soit celui qui entre dans ses demeures. Crois-tu que si cet étranger, confiant dans ses forces, tendait le grand arc d’Odysseus, il me conduirait dans sa demeure et ferait de moi sa femme ? Lui-même ne l’espère point dans son esprit. Qu’aucun de vous, prenant ici son repas, ne s’inquiète de ceci, car cette pensée n’est point convenable.
Et Eurymakhos, fils de Polybos, lui répondit :
– Fille d’Ikarios, prudente Pènélopéia, nous ne croyons point que cet homme t’épouse, car cette pensée ne serait point convenable ; mais nous craignons la rumeur des hommes et des femmes. Le dernier des Akhaiens dirait :
– ‘Certes, ce sont les pires des hommes qui recherchent la femme d’un homme irréprochable, car ils n’ont pu tendre son arc poli, tandis qu’un mendiant vagabond a tendu aisément l’arc et lancé une flèche à travers le fer.’ – En parlant ainsi, il nous couvrirait d’opprobre.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Eurymakhos, ils ne peuvent s’illustrer parmi le peuple ceux qui méprisent et ruinent la maison d’un homme brave. Pourquoi vous êtes-vous couverts d’opprobre vous-mêmes ? Cet étranger est grand et fort, et il se glorifie d’être d’une bonne race. Donnez-lui donc l’arc d’Odysseus, afin que nous voyions ce qu’il en fera. Et je le dis, et ma parole s’accomplira : s’il tend l’arc et si Apollôn lui accorde cette gloire, je le couvrirai de beaux vêtements, d’un manteau et d’une tunique, et je lui donnerai une lance aiguë pour qu’il se défende des chiens et des hommes, et une épée à deux tranchants. Et je lui donnerai aussi des sandales, et je le renverrai là où son cœur et son âme lui ordonnent d’aller.
Et, alors, le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ma mère, aucun des Akhaiens ne peut m’empêcher de donner ou de refuser cet arc à qui je voudrai, ni aucun de ceux qui dominent dans l’âpre Ithakè ou qui habitent Élis où paissent les chevaux. Aucun d’entre eux ne m’arrêtera si je veux donner cet arc à mon hôte. Mais rentre dans ta chambre haute et prends souci de tes travaux, de la toile et du fuseau.
Ordonne aux servantes de reprendre leur tâche. Tout le reste regarde les hommes, et surtout moi qui commande dans cette demeure.
Et Pènélopéia, surprise, rentra dans la maison, songeant en son âme aux paroles prudentes de son fils. Puis, étant montée dans la chambre haute, avec ses servantes, elle pleura son cher mari Odysseus jusqu’à ce que Athènè aux yeux clairs eût répandu le doux sommeil sur ses paupières.
Alors le divin porcher prit l’arc recourbé et l’emporta. Et les prétendants firent un grand tumulte dans la salle, et l’un de ces jeunes hommes insolents dit :
– Où portes-tu cet arc, immonde porcher ? vagabond ! Bientôt les chiens rapides que tu nourris te mangeront au milieu de tes porcs, loin des hommes, si Apollôn et les autres dieux immortels nous sont propices.
Ils parlèrent ainsi, et Eumaios déposa l’arc là où il était, plein de crainte, parce qu’ils le menaçaient en foule dans la demeure. Mais, d’un autre côté, Tèlémakhos cria en le menaçant :
– Père ! porte promptement l’arc plus loin, et n’obéis pas à tout le monde, de peur que, bien que plus jeune que toi, je te chasse à coups de pierres vers tes champs, car je suis le plus fort.
Plût aux dieux que je fusse aussi supérieur par la force de mes bras aux prétendants qui sont ici ! car je les chasserais aussitôt honteusement de ma demeure où ils commettent des actions mauvaises.
Il parla ainsi, et tous les prétendants se mirent à rire de lui et cessèrent d’être irrités. Et le porcher, traversant la salle, emporta l’arc et le remit aux mains du subtil Odysseus. Et aussitôt il appela la nourrice Eurykléia :
– Tèlémakhos t’ordonne, ô prudente Eurykléia, de fermer les portes solides de la maison. Si quelqu’un des nôtres entend, de la cour, des gémissements ou du tumulte, qu’il y reste et s’occupe tranquillement de son travail.
Il parla ainsi, et sa parole ne fut point vaine, et Eurykléia ferma les portes de la belle demeure. Et Philoitios, sautant dehors, ferma aussi les portes de la cour. Et il y avait, sous le portique, un câble d’écorce de nef à bancs de rameurs, et il en lia les portes. Puis, rentrant dans la salle, il s’assit sur le siège qu’il avait quitté, et il regarda Odysseus. Mais celui-ci, tournant l’arc de tous côtés, examinait çà et là si les vers n’avaient point rongé la corne en l’absence du maître. Et les prétendants se disaient les uns aux autres en le regardant :
– Certes, celui-ci est un admirateur ou un voleur d’arcs. Peut-être en a-t-il de semblables dans sa demeure, ou veut-il en faire ? Comme ce vagabond plein de mauvais desseins le retourne entre ses mains.
Et l’un de ces jeunes hommes insolents dit aussi :
– Plût aux dieux que cet arc lui portât malheur, aussi sûrement qu’il ne pourra le tendre !
Ainsi parlaient les prétendants ; mais le subtil Odysseus, ayant examiné le grand arc, le tendit aussi aisément qu’un homme, habile à jouer de la kithare et à chanter, tend, à l’aide d’une cheville, une nouvelle corde faite de l’intestin tordu d’une brebis. Ce fut ainsi qu’Odysseus, tenant le grand arc, tendit aisément de la main droite le nerf, qui résonna comme le cri de l’hirondelle. Et une amère douleur saisit les prétendants, et ils changèrent tous de couleur, et Zeus, manifestant un signe, tonna fortement, et le patient et divin Odysseus se réjouit de ce que le fils du subtil Kronos lui eût envoyé ce signe. Et il saisit une flèche rapide qui, retirée du carquois, était posée sur la table, tandis que toutes les autres étaient restées dans le carquois creux jusqu’à ce que les Akhaiens les eussent essayées. Puis, saisissant la poignée de l’arc, il tira le nerf sans quitter son siège ; et visant le but, il lança la flèche, lourde d’airain, qui ne s’écarta point et traversa tous les anneaux des haches. Alors, il dit à Tèlémakhos :
– Tèlémakhos, l’étranger assis dans tes demeures ne te fait pas honte. Je ne me suis point écarté du but, et je ne me suis point longtemps fatigué à tendre cet arc. Ma vigueur est encore entière, et les prétendants ne me mépriseront plus.
Mais voici l’heure pour les Akhaiens de préparer le repas pendant qu’il fait encore jour ; puis ils se charmeront des sons de la kithare et du chant, qui sont les ornements des repas.
Il parla ainsi et fit un signe avec ses sourcils, et Télémakhos, le cher fils du divin Odysseus, ceignit une épée aiguë, saisit une lance, et, armé de l’airain splendide, se plaça auprès du siège d’Odysseus.Chant 22
Alors, le subtil Odysseus, se dépouillant de ses haillons, et tenant dans ses mains l’arc et le carquois plein de flèches, sauta du large seuil, répandit les flèches rapides à ses pieds et dit aux prétendants :
– Voici que cette épreuve tout entière est accomplie. Maintenant, je viserai un autre but qu’aucun homme n’a jamais touché. Qu’Apollôn me donne la gloire de l’atteindre !
Il parla ainsi, et il dirigea la flèche amère contre Antinoos. Et celui-ci allait soulever à deux mains une belle coupe d’or à deux anses afin de boire du vin, et la mort n’était point présente à son esprit. Et, en effet, qui eût pensé qu’un homme, seul au milieu de convives nombreux, eût osé, quelle que fût sa force, lui envoyer la mort et la kèr noire ? Mais Odysseus le frappa de sa flèche à la gorge, et la pointe traversa le cou délicat. Il tomba à la renverse, et la coupe s’échappa de sa main inerte, et un jet de sang sortit de sa narine, et il repoussa des pieds la table, et les mets roulèrent épars sur la terre, et le pain et la chair rôtie furent souillés. Les prétendants frémirent dans la demeure quand ils virent l’homme tomber. Et, se levant en tumulte de leurs siéges, ils regardaient de tous côtés sur les murs sculptés, cherchant à saisir des boucliers et des lances, et ils crièrent à Odysseus en paroles furieuses :
– Étranger, tu envoies traîtreusement tes flèches contre les hommes ! Tu ne tenteras pas d’autres épreuves, car voici que ta destinée terrible va s’accomplir.
Tu viens de tuer le plus illustre des jeunes hommes d’Ithakè, et les vautours te mangeront ici !
Ils parlaient ainsi, croyant qu’il avait tué involontairement, et les insensés ne devinaient pas que les kères de la mort étaient sur leurs têtes. Et, les regardant d’un oeil sombre, le subtil Odysseus leur dit :
– Chiens ! vous ne pensiez pas que je reviendrais jamais du pays des Troiens dans ma demeure. Et vous dévoriez ma maison, et vous couchiez de force avec mes servantes, et, moi vivant, vous recherchiez ma femme, ne redoutant ni les dieux qui habitent le large Ouranos, ni le blâme des hommes qui viendront ! Maintenant, les kères de la mort vont vous saisir tous !
Il parla ainsi, et la terreur les prit, et chacun regardait de tous côtés, cherchant par où il fuirait la noire destinée. Et, seul, Eurymakhos, lui répondant, dit :
– S’il est vrai que tu sois Odysseus l’Ithakèsien revenu ici, tu as bien parlé en disant que les Akhaiens ont commis des actions iniques dans tes demeures et dans tes champs. Mais le voici gisant celui qui a été cause de tout. C’est Antinoos qui a été cause de tout, non parce qu’il désirait ses noces, mais ayant d’autres desseins que le Kroniôn ne lui a point permis d’accomplir. Il voulait régner sur le peuple d’Ithakè bien bâtie et tendait des embûches à ton fils pour le tuer.
Maintenant qu’il a été tué justement, aie pitié de tes concitoyens. Bientôt nous t’apaiserons devant le peuple. Nous te payerons tout ce que nous avons bu et mangé dans tes demeures. Chacun de nous t’amènera vingt bœufs, de l’airain et de l’or, jusqu’à ce que ton âme soit satisfaite. Mais avant que cela soit fait, ta colère est juste.
Et, le regardant d’un oeil sombre, le prudent Odysseus lui dit :
– Eurymakhos, même si vous m’apportiez tous vos biens paternels et tout ce que vous possédez maintenant, mes mains ne s’abstiendraient pas du carnage avant d’avoir châtié l’insolence de tous les prétendants. Choisissez, ou de me combattre, ou de fuir, si vous le pouvez, la kèr et la mort. Mais je ne pense pas qu’aucun de vous échappe à la noire destinée.
Il parla ainsi, et leurs genoux à tous furent rompus. Et Eurymakhos, parlant une seconde fois, leur dit :
– Ô amis, cet homme ne retiendra pas ses mains inévitables, ayant saisi l’arc poli et le carquois, et tirant ses flèches du seuil de la salle, jusqu’à ce qu’il nous ait tués tous. Souvenons-nous donc de combattre ; tirez vos épées, opposez les tables aux flèches rapides, jetons-nous tous sur lui, et nous le chasserons du seuil et des portes, et nous irons par la ville, soulevant un grand tumulte, et, bientôt, cet homme aura tiré sa dernière flèche.
Ayant ainsi parlé, il tira son épée aiguë à deux tranchants, et se rua sur Odysseus en criant horriblement ; mais le divin Odysseus le prévenant, lança une flèche et le perça dans la poitrine auprès de la mamelle, et le trait rapide s’enfonça dans le foie. Et l’épée tomba de sa main contre terre, et il tournoya près d’une table, dispersant les mets et les coupes pleines : et lui-même se renversa en se tordant et en gémissant, et il frappa du front la terre, repoussant un thrône de ses deux pieds, et l’obscurité se répandit sur ses yeux.
Alors Amphinomos se rua sur le magnanime Odysseus, après avoir tiré son épée aiguë, afin de l’écarter des portes ; mais Tèlémakhos le prévint en le frappant dans le dos, entre les épaules, et la lance d’airain traversa la poitrine ; et le prétendant tomba avec bruit et frappa la terre du front. Et Tèlémakhos revint à la hâte, ayant laissé sa longue lance dans le corps d’Amphinomos, car il craignait qu’un des Akhaiens l’atteignît, tandis qu’il l’approcherait, et le frappât de l’épée sur sa tête penchée. Et, en courant, il revint promptement auprès de son cher père, et il lui dit ces paroles ailées :
– Ô père, je vais t’apporter un bouclier et deux lances et un casque d’airain adapté à tes tempes. Moi-même je m’armerai, ainsi que le porcher et le bouvier, car il vaut mieux nous armer.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Apporte-les en courant ; tant que j’aurai des flèches pour combattre, ils ne m’éloigneront pas des portes, bien que je sois seul.
Il parla ainsi, et Tèlémakhos obéit à son cher père, et il se hâta de monter dans la chambre haute où étaient les armes illustres, et il saisit quatre boucliers, huit lances et quatre casques épais d’airain, et il revint en les portant, et il rejoignit promptement son cher père. Lui-même, le premier, il se couvrit d’airain, et, les deux serviteurs s’étant aussi couverts de belles armes, ils entourèrent le sage et subtil Odysseus. Et, tant que celui-ci eut des flèches, il en perça sans relâche les prétendants, qui tombaient amoncelés dans la salle. Mais après que toutes les flèches eurent quitté le roi qui les lançait, il appuya son arc debout contre les murs splendides de la salle solide, jeta sur ses épaules un bouclier à quatre lames, posa sur sa tête un casque épais à crinière de cheval, et sur lequel s’agitait une aigrette, et il saisit deux fortes lances armées d’airain.
Il y avait dans le mur bien construit de la salle, auprès du seuil supérieur, une porte qui donnait issue au-dehors et que fermaient deux ais solides. Et Odysseus ordonna au divin porcher de se tenir auprès de cette porte pour la garder, car il n’y avait que cette issue. Et alors Agélaos dit aux prétendants :
– Ô amis, quelqu’un ne pourrait-il pas monter à cette porte, afin de parler au peuple et d’exciter un grand tumulte ?
Cet homme aurait bientôt lancé son dernier trait.
Et le chevrier Mélanthios lui dit :
– Cela ne se peut, divin Agélaos. L’entrée de la belle porte de la cour est étroite et difficile à passer, et un seul homme vigoureux nous arrêterait tous. Mais je vais vous apporter des armes de la chambre haute ; c’est là, je pense, et non ailleurs, qu’Odysseus et son illustre fils les ont déposées.
Ayant ainsi parlé, le chevrier Mélanthios monta dans la chambre haute d’Odysseus par les échelles de la salle. Là, il prit douze boucliers, douze lances et autant de casques d’airain à crinières épaisses, et, se hâtant de les apporter, il les donna aux prétendants. Et quand Odysseus les vit s’armer et brandir de longues lances dans leurs mains, ses genoux et son cher cœur furent rompus, et il sentit la difficulté de son œuvre, et il dit à Tèlémakhos ces paroles ailées :
– Tèlémakhos, voici qu’une des femmes de la maison, ou Mélanthios, nous expose à un danger terrible.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Ô père, c’est moi qui ai failli, et aucun autre n’est cause de ceci, car j’ai laissé ouverte la porte solide de la chambre haute, et la sentinelle des prétendants a été plus vigilante que moi.
Va, divin Eumaios, ferme la porte de la chambre haute, et vois si c’est une des femmes qui a fait cela, ou Mélanthios, fils de Dolios, comme je le pense.
Et, tandis qu’ils se parlaient ainsi, le chevrier Mélanthios retourna de nouveau à la chambre haute pour y chercher des armes, et le divin porcher le vit, et, aussitôt, s’approchant d’Odysseus, il lui dit :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, ce méchant homme que nous soupçonnions retourne dans la chambre haute. Dis-moi la vérité ; le tuerai-je, si je suis le plus fort, ou te l’amènerai-je pour qu’il expie toutes les actions exécrables qu’il a commises dans ta demeure ?
Et le subtil Odysseus lui répondit :
– Certes, Tèlémakhos et moi nous contiendrons les prétendants insolents, malgré leur fureur. Vous, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans la chambre, et, avant de fermer les portes derrière vous, enchaînez-le et suspendez-le à une haute colonne, afin que, vivant longtemps, il subisse de cruelles douleurs.
Il parla ainsi, et ils entendirent et obéirent. Et ils allèrent promptement à la chambre haute, se cachant de Mélanthios qui y était entré et qui cherchait des armes dans le fond.
Ils s’arrêtèrent des deux côtés du seuil, et, quand le chevrier Mélanthios revint, tenant d’une main un beau casque, et, de l’autre, un large bouclier antique que le héros Laertès portait dans sa jeunesse, et qui gisait là depuis longtemps et dont les courroies étaient rongées ; alors ils se jetèrent sur lui et le traînèrent dans la chambre par les cheveux, l’ayant renversé gémissant contre terre. Et ils lui lièrent les pieds et les mains avec une corde bien tressée ainsi que l’avait ordonné le patient et divin Odysseus, fils de Laertès ; puis, l’ayant enchaîné, ils le suspendirent à une haute colonne, près des poutres. Et le porcher Eumaios lui dit en le raillant :
– Maintenant, Mélanthios, tu vas faire sentinelle toute la nuit, couché dans ce lit moelleux, comme il est juste. Éôs au thrône d’or ne t’échappera pas quand elle sortira des flots d’Okéanos, à l’heure où tu amènes tes chèvres aux prétendants pour préparer leur repas.
Et ils le laissèrent là, cruellement attaché. Puis, s’étant armés, ils fermèrent les portes brillantes, et, pleins de courage, ils retournèrent auprès du sage et subtil Odysseus. Et ils étaient quatre sur le seuil, et dans la salle il y avait de nombreux et braves guerriers. Et Athènè, la fille de Zeus, approcha, ayant la figure et la voix de Mentôr. Et Odysseus, joyeux de la voir, lui dit :
– Mentôr, éloigne de nous le danger et souviens-toi de ton cher compagnon qui t’a comblé de biens, car tu es de mon âge.
Il parla ainsi, pensant bien que c’était la protectrice Athènè. Et les prétendants, de leur côté, poussaient des cris menaçants dans la salle, et, le premier, le Damastoride Agélaos réprimanda Athènè :
– Mentôr, qu’Odysseus ne te persuade pas de combattre les prétendants, et de lui venir en aide. Je pense que notre volonté s’accomplira quand nous aurons tué le père et le fils. Tu seras tué avec eux, si tu songes à les aider, et tu le payeras de ta tête. Quand nous aurons dompté vos fureurs avec l’airain, nous confondrons tes richesses avec celles d’Odysseus, et nous ne laisserons vivre dans tes demeures ni tes fils, ni tes filles, ni ta femme vénérable !
Il parla ainsi et Athènè s’en irrita davantage, et elle réprimanda Odysseus en paroles irritées :
– Odysseus, tu n’as plus ni la vigueur, ni le courage que tu avais quand tu combattis neuf ans, chez les Troiens, pour Hélénè aux bras blancs née d’un père divin. Tu as tué, dans la rude mêlée, de nombreux guerriers, et c’est par tes conseils que la ville aux larges rues de Priamos a été prise. Pourquoi, maintenant que tu es revenu dans tes demeures, au milieu de tes richesses, cesses-tu d’être brave en face des prétendants ? Allons, cher ! tiens-toi près de moi ; regarde-moi combattre, et vois si, contre tes ennemis, Mentôr Alkimide reconnaît le bien que tu lui as fait !
Elle parla ainsi, mais elle ne lui donna pas encore la victoire, voulant éprouver la force et le courage d’Odysseus et de son illustre fils ; et ayant pris la forme d’une hirondelle, elle alla se poser en volant sur une poutre de la salle splendide.
Mais le Damastoride Agélaos, Eurynomos, Amphimédôn, Dèmoptolémos, Peisandros Polyktoride et le brave Polybos excitaient les prétendants. C’étaient les plus courageux de ceux qui vivaient encore et qui combattaient pour leur vie, car l’arc et les flèches avaient dompté les autres. Et Agélaos leur dit :
– Ô amis, cet homme va retenir ses mains inévitables. Déjà Mentôr qui était venu proférant de vaines bravades les a laissés seuls sur le seuil de la porte. C’est pourquoi lancez tous ensemble vos longues piques. Allons ! lançons-en six d’abord. Si Zeus nous accorde de frapper Odysseus et nous donne cette gloire, nous aurons peu de souci des autres, si celui-là tombe.
Il parla ainsi, et tous lancèrent leurs piques avec ardeur, comme il l’avait ordonné ; mais Athènè les rendit inutiles ; l’une frappa le seuil de la salle, l’autre la porte solide, et l’autre le mur. Et, après qu’ils eurent évité les piques des prétendants, le patient et divin Odysseus dit à ses compagnons :
– Ô amis, c’est à moi maintenant et à vous. Lançons nos piques dans la foule des prétendants, qui, en nous tuant, veulent mettre le comble aux maux qu’ils ont déjà causés.
Il parla ainsi, et tous lancèrent leurs piques aiguës, Odysseus contre Dèmoptolémos, Tèlémakhos contre Euryadès, le porcher contre Élatos et le bouvier contre Peisandros, et tous les quatre mordirent la terre, et les prétendants se réfugièrent dans le fond de la salle, et les vainqueurs se ruèrent en avant et arrachèrent leurs piques des cadavres.
Alors les prétendants lancèrent de nouveau leurs longues piques avec une grande force ; mais Athènè les rendit inutiles ; l’une frappa le seuil, l’autre la porte solide, et l’autre le mur. Amphimédôn effleura la main de Tèlémakhos, et la pointe d’airain enleva l’épiderme. Ktèsippos atteignit l’épaule d’Eumaios par-dessus le bouclier, mais la longue pique passa par-dessus et tomba sur la terre. Alors, autour du sage et subtil Odysseus, ils lancèrent de nouveau leurs piques aiguës dans la foule des prétendants, et le destructeur de citadelles Odysseus perça Eurydamas ; Tèlémakhos, Amphimédôn ; le porcher, Polybos ; et le bouvier perça Ktèsippos dans la poitrine et il lui dit en se glorifiant :
– Ô Polytherside, ami des injures, il faut cesser de parler avec arrogance et laisser faire les dieux, car ils sont les plus puissants. Voici le salaire du coup que tu as donné au divin Odysseus tandis qu’il mendiait dans sa demeure.
Le gardien des bœufs aux pieds flexibles parla ainsi, et de sa longue pique Odysseus perça le Damastoride, et Tèlémakhos frappa d’un coup de lance dans le ventre l’Évenôride Leiôkritos. L’airain le traversa, et, tombant sur la face, il frappa la terre du front.
Alors, Athènè tueuse d’hommes agita l’Aigide au faîte de la salle, et les prétendants furent épouvantés, et ils se dispersèrent dans la salle comme un troupeau de bœufs que tourmente, au printemps, quand les jours sont longs, un taon aux couleurs variées. De même que des vautours aux ongles et aux becs recourbés, descendus des montagnes, poursuivent les oiseaux effrayés qui se dispersent, de la plaine dans les nuées, et les tuent sans qu’ils puissent se sauver par la fuite, tandis que les laboureurs s’en réjouissent ; de même, Odysseus et ses compagnons se ruaient par la demeure sur les prétendants et les frappaient de tous côtés ; et un horrible bruit de gémissements et de coups s’élevait, et la terre ruisselait de sang.
Et Léiôdès s’élança, et, saisissant les genoux d’Odysseus, il le supplia en paroles ailées :
– Je te supplie, Odysseus ! Écoute, prends pitié de moi ! je te le jure, jamais je n’ai, dans tes demeures, dit une parole outrageante aux femmes, ni commis une action inique, et j’arrêtais les autres prétendants quand ils en voulaient commettre ; mais ils ne m’obéissaient point et ne s’abstenaient point de violences, et c’est pourquoi ils ont subi une honteuse destinée en expiation de leur folie.
Mais moi, leur sacrificateur, qui n’ai rien fait, mourrai-je comme eux ? Ainsi, à l’avenir, les bonnes actions n’auront plus de récompense !
Et, le regardant d’un oeil sombre, le prudent Odysseus lui répondit :
– Si, comme tu le dis, tu as été leur sacrificateur, n’as-tu pas souvent souhaité que mon retour dans la patrie n’arrivât jamais ? N’as-tu pas souhaité ma femme bien-aimée et désiré qu’elle enfantât des fils de toi ? C’est pourquoi tu n’éviteras pas la lugubre mort !
Ayant ainsi parlé, il saisit à terre, de sa main vigoureuse, l’épée qu’Agélaos tué avait laissée tomber, et il frappa Léiôdès au milieu du cou, et, comme celui-ci parlait encore, sa tête roula dans la poussière.
Et l’aoide Terpiade Phèmios évita la noire kèr, car il chantait de force au milieu des prétendants. Et il se tenait debout près de la porte, tenant en main sa kithare sonore ; et il hésitait dans son esprit s’il sortirait de la demeure pour s’asseoir dans la cour auprès de l’autel du grand Zeus, là où Laertès et Odysseus avaient brûlé de nombreuses cuisses de bœufs, ou s’il supplierait Odysseus en se jetant à ses genoux. Et il lui sembla meilleur d’embrasser les genoux du Laertiade Odysseus.
C’est pourquoi il déposa à terre sa kithare creuse, entre le kratère et le thrône aux clous d’argent, et, s’élançant vers Odysseus, il saisit ses genoux et il le supplia en paroles ailées :
– Je te supplie, Odysseus ! Écoute, et prends pitié de moi ! Une grande douleur te saisirait plus tard, si tu tuais un aoide qui chante les dieux et les hommes. Je me suis instruit moi-même, et un dieu a mis tous les chants dans mon esprit. Je veux te chanter toi-même comme un dieu, c’est pourquoi, ne m’égorge donc pas. Tèlémakhos, ton cher fils, te dira que ce n’a été ni volontairement, ni par besoin, que je suis venu dans ta demeure pour y chanter après le repas des prétendants. Étant nombreux et plus puissants, ils m’y ont amené de force.
Il parla ainsi, et la force sacrée de Tèlémakhos l’entendit, et, aussitôt, s’approchant de son père, il lui dit :
– Arrête ; ne frappe point de l’airain un innocent. Nous sauverons aussi le héraut Médôn, qui, depuis que j’étais enfant, a toujours pris soin de moi dans notre demeure, si toutefois Philoitios ne l’a point tué, ou le porcher, ou s’il ne t’a point rencontré tandis que tu te ruais dans la salle.
Il parla ainsi, et le prudent Médôn l’entendit. Épouvanté, et fuyant la kèr noire, il s’était caché sous son thrône et s’était enveloppé de la peau récemment enlevée d’un bœuf.
Aussitôt, il se releva ; et, rejetant la peau du bœuf, et s’élançant vers Tèlémakhos, il saisit ses genoux et le supplia en paroles ailées :
– Ô ami, je suis encore ici. Arrête ! Dis à ton père qu’il n’accable point ma faiblesse de sa force et de l’airain aigu, étant encore irrité contre les prétendants qui ont dévoré ses richesses dans ses demeures et qui t’ont méprisé comme des insensés.
Et le sage Odysseus lui répondit en souriant :
– Prends courage, puisque déjà Tèlémakhos t’a sauvé, afin que tu saches dans ton âme et que tu dises aux autres qu’il vaut mieux faire le bien que le mal. Mais sortez tous deux de la maison et asseyez-vous dans la cour, loin du carnage, toi et l’illustre aoide, tandis que j’achèverai de faire ici ce qu’il faut.
Il parla ainsi, et tous deux sortirent de la maison, et ils s’assirent auprès de l’autel du grand Zeus, regardant de tous côtés et attendant un nouveau carnage.
Alors, Odysseus examina toute la salle, afin de voir si quelqu’un des prétendants vivait encore et avait évité la noire kèr. Mais il les vit tous étendus dans le sang et dans la poussière, comme des poissons que des pêcheurs ont retirés dans un filet de la côte écumeuse de la mer profonde.
Tous sont répandus sur le sable, regrettant les eaux de la mer, et Hèlios Phaéthôn leur arrache l’âme. Ainsi les prétendants étaient répandus, les uns sur les autres.
Et le prudent Odysseus dit à Tèlémakhos :
– Tèlémakhos, hâte-toi, appelle la nourrice Eurykléia, afin que je lui dise ce que j’ai dans l’âme.
Il parla ainsi, et Tèlémakhos obéit à son cher père, et, ayant ouvert la porte, il appela la nourrice Eurykléia :
– Viens, ô vieille femme née autrefois, toi qui surveilles les servantes dans nos demeures, viens en hâte. Mon père t’appelle pour te dire quelque chose.
Il parla ainsi, et ses paroles ne furent point vaines. Eurykléia ouvrit les portes de la grande demeure, et se hâta de suivre Tèlémakhos qui la précédait. Et elle trouva Odysseus au milieu des cadavres, souillé de sang et de poussière, comme un lion sorti, la nuit, de l’enclos, après avoir mangé un bœuf, et dont la poitrine et les mâchoires sont ensanglantées, et dont l’aspect est terrible. Ainsi Odysseus avait les pieds et les mains souillés. Et dès qu’Eurykléia eut vu ces cadavres et ces flots de sang, elle commença à hurler de joie, parce qu’elle vit qu’une grande œuvre était accomplie. Mais Odysseus la contint et lui dit ces paroles ailées :
– Vieille femme, réjouis-toi dans ton âme et ne hurle pas. Il n’est point permis d’insulter des hommes morts. La moire des dieux et leurs actions impies ont dompté ceux-ci. Ils n’honoraient aucun de ceux qui venaient à eux, parmi les hommes terrestres, ni le bon, ni le mauvais. C’est pourquoi ils ont subi une mort honteuse, à cause de leurs violences. Mais, allons ! indique-moi les femmes qui sont dans cette demeure, celles qui m’ont outragé et celles qui n’ont point failli.
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Mon enfant, je te dirai la vérité. Tu as dans tes demeures cinquante femmes que nous avons instruites aux travaux, à tendre les laines et à supporter la servitude. Douze d’entre elles se sont livrées à l’impudicité. Elles ne m’honorent point, ni Pènélopéia elle-même. Quant à Tèlémakhos, qui, il y a peu de temps, était encore enfant, sa mère ne lui a point permis de commander aux femmes. Mais je vais monter dans la haute chambre splendide et tout dire à Pènélopéia, à qui un dieu a envoyé le sommeil.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Ne l’éveille pas encore. Ordonne aux femmes de venir ici, et d’abord celles qui ont commis de mauvaises actions.
Il parla ainsi, et la vieille femme sortit de la salle pour avertir les femmes et les presser de venir.
Et Odysseus, ayant appelé à lui Tèlémakhos, le bouvier et le porcher, leur dit ces paroles ailées :
– Commencez à emporter les cadavres et donnez des ordres aux femmes. Puis, avec de l’eau et des éponges poreuses purifiez les beaux thrônes et les tables. Après que vous aurez tout rangé dans la salle, conduisez les femmes, hors de la demeure, entre le dôme et le mur de la cour, et frappez-les de vos longues épées aiguës, jusqu’à ce qu’elles aient toutes rendu l’âme et oublié Aphroditè qu’elles goûtaient en secret, en se livrant en secret aux prétendants.
Il parla ainsi, et toutes les femmes arrivèrent en gémissant lamentablement et en versant des larmes. D’abord, s’aidant les unes les autres, elles emportèrent les cadavres, qu’elles déposèrent sous le portique de la cour. Et Odysseus leur commandait, et les pressait, et les forçait d’obéir. Puis, elles purifièrent les beaux thrônes et les tables avec de l’eau et des éponges poreuses. Et Tèlémakhos, le bouvier et le porcher nettoyaient avec des balais le pavé de la salle, et les servantes emportaient les souillures et les déposaient hors des portes. Puis, ayant tout rangé dans la salle, ils conduisirent les servantes, hors de la demeure, entre le dôme et le mur de la cour, les renfermant dans ce lieu étroit d’où on ne pouvait s’enfuir. Et, alors, le prudent Tèlémakhos parla ainsi le premier :
– Je n’arracherai point, par une mort non honteuse, l’âme de ces femmes qui répandaient l’opprobre sur ma tête et sur celle de ma mère et qui couchaient avec les prétendants.
Il parla ainsi, et il suspendit le câble d’une nef noire au sommet d’une colonne, et il le tendit autour du dôme, de façon à ce qu’aucune d’entre elles ne touchât des pieds la terre. De même que les grives aux ailes ployées et les colombes se prennent dans un filet, au milieu des buissons de l’enclos où elles sont entrées, et y trouvent un lit funeste ; de même ces femmes avaient le cou serré dans des lacets, afin de mourir misérablement, et leurs pieds ne s’agitèrent point longtemps.
Puis, ils emmenèrent Mélanthios, par le portique, dans la cour. Et, là, ils lui coupèrent, avec l’airain, les narines et les oreilles, et ils lui arrachèrent les parties viriles, qu’ils jetèrent à manger toutes sanglantes aux chiens ; et, avec la même fureur, ils lui coupèrent les pieds et les mains, et, leur tâche étant accomplie, ils rentrèrent dans la demeure d’Odysseus. Et, alors, celui-ci dit à la chère nourrice Eurykléia :
– Vieille femme, apporte-moi du soufre qui guérit les maux, et apporte aussi du feu, afin que je purifie la maison. Ordonne à Pènélopéia de venir ici avec ses servantes. Que toutes les servantes viennent ici.
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Certes, mon enfant, tu as bien parlé ; mais je vais t’apporter des vêtements, un manteau et une tunique. Ne reste pas dans tes demeures, tes larges épaules ainsi couvertes de haillons, car ce serait honteux.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Apporte d’abord du feu dans cette salle.
Il parla ainsi, et la chère nourrice Eurykléia lui obéit. Elle apporta du feu et du soufre, et Odysseus purifia la maison, la salle et la cour. Puis, la vieille femme remonta dans les belles demeures d’Odysseus pour appeler les femmes et les presser de venir. Et elles entrèrent dans la salle ayant des torches en mains. Et elles entouraient et saluaient Odysseus, prenant ses mains et baisant sa tête et ses épaules. Et il fut saisi du désir de pleurer, car, dans son âme, il les reconnut toutes.Chant 23
Et la vieille femme, montant dans la chambre haute, pour dire à sa maîtresse que son cher mari était revenu, était pleine de joie, et ses genoux étaient fermes, et ses pieds se mouvaient rapidement. Et elle se pencha sur la tête de sa maîtresse, et elle lui dit :
– Lève-toi, Pènélopéia, chère enfant, afin de voir de tes yeux ce que tu désires tous les jours. Odysseus est revenu ; il est rentré dans sa demeure, bien que tardivement, et il a tué les prétendants insolents qui ruinaient sa maison, mangeaient ses richesses et violentaient son fils.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Chère nourrice, les dieux t’ont rendue insensée, eux qui peuvent troubler l’esprit du plus sage et rendre sage le plus insensé. Ils ont troublé ton esprit qui, auparavant, était plein de prudence. Pourquoi railles-tu mon cœur déjà si affligé, en disant de telles choses ? Pourquoi m’arraches-tu au doux sommeil qui m’enveloppait, fermant mes yeux sous mes chères paupières ? Je n’avais jamais tant dormi depuis le jour où Odysseus est parti pour cette Ilios fatale qu’on ne devrait plus nommer. Va ! redescends. Si quelque autre de mes femmes était venue m’annoncer cette nouvelle et m’arracher au sommeil, je l’aurais aussitôt honteusement chassée dans les demeures ; mais ta vieillesse te garantit de cela.
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Je ne me raille point de toi, chère enfant ; il est vrai qu’Odysseus est revenu et qu’il est rentré dans sa maison, comme je te l’ai dit. C’est l’étranger que tous outrageaient dans cette demeure. Tèlémakhos le savait déjà, mais il cachait par prudence les desseins de son père, afin qu’il châtiât les violences de ces hommes insolents.
Elle parla ainsi, et Pènélopéia, joyeuse, sauta de son lit, embrassa la vieille femme, et, versant des larmes sous ses paupières, lui dit ces paroles ailées :
– Ah ! si tu m’as dit la vérité, chère nourrice, et si Odysseus est rentré dans sa demeure, comment, étant seul, a-t-il pu mettre la main sur les prétendants insolents qui se réunissaient toujours ici ?
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Je n’ai rien vu, je n’ai rien entendu, si ce n’est les gémissements des hommes égorgés. Nous étions assises au fond des chambres, et les portes solides nous retenaient, jusqu’à ce que ton fils Tèlémakhos m’appelât, car son père l’avait envoyé m’appeler. Je trouvai ensuite Odysseus debout au milieu des cadavres qui gisaient amoncelés sur le pavé ; et tu te serais réjouie dans ton âme de le voir souillé de sang et de poussière, comme un lion. Maintenant, ils sont tous entassés sous les portiques, et Odysseus purifie la belle salle, à l’aide d’un grand feu allumé ; et il m’a envoyée t’appeler.
Suis-moi, afin que vous charmiez tous deux vos chers cœurs par la joie, car vous avez subi beaucoup de maux. Maintenant, vos longs désirs sont accomplis. Odysseus est revenu dans sa demeure, il vous a retrouvés, toi et ton fils ; et les prétendants qui l’avaient outragé, il les a tous punis dans ses demeures.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Chère nourrice, ne te glorifie pas en te raillant ? Tu sais combien il nous comblerait tous de joie en reparaissant ici, moi surtout et le fils que nous avons engendré ; mais les paroles que tu as dites ne sont point vraies. L’un d’entre les immortels a tué les prétendants insolents, irrité de leur violente insolence et de leurs actions iniques ; car ils n’honoraient aucun des hommes terrestres, ni le bon, ni le méchant, de tous ceux qui venaient vers eux. C’est pourquoi ils ont subi leur destinée fatale, à cause de leurs iniquités ; mais, loin de l’Akhaiè, Odysseus a perdu l’espoir de retour, et il est mort.
Et la chère nourrice Eurykléia lui répondit :
– Mon enfant, quelle parole s’est échappée d’entre tes dents ? Quand ton mari, que tu pensais ne jamais revoir à son foyer, est revenu dans sa demeure, ton esprit est toujours incrédule ? Mais, écoute ; je te révélerai un signe très manifeste : j’ai reconnu, tandis que je le lavais ; la cicatrice de cette blessure qu’un sanglier lui fit autrefois de ses blanches dents.
Je voulais te le dire, mais il m’a fermé la bouche avec les mains, et il ne m’a point permis de parler, dans un esprit prudent. Suis-moi, je me livrerai à toi, si je t’ai trompée, et tu me tueras d’une mort honteuse.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Chère nourrice, bien que tu saches beaucoup de choses, il t’est difficile de comprendre les desseins des dieux non engendrés. Mais allons vers mon fils, afin que je voie les prétendants morts et celui qui les a tués.
Ayant ainsi parlé, elle descendit de la chambre haute, hésitant dans son cœur si elle interrogerait de loin son cher mari, ou si elle baiserait aussitôt sa tête et ses mains. Après être entrée et avoir passé le seuil de pierre, elle s’assit en face d’Odysseus, près de l’autre mur, dans la clarté du feu. Et Odysseus était assis près d’une haute colonne, et il regardait ailleurs, attendant que son illustre femme, l’ayant vu, lui parlât. Mais elle resta longtemps muette, et la stupeur saisit son cœur. Et plus elle le regardait attentivement, moins elle le reconnaissait sous ses vêtements en haillons.
Alors Tèlémakhos la réprimanda et lui dit :
– Ma mère, malheureuse mère au cœur cruel ! Pourquoi restes-tu ainsi loin de mon père ? Pourquoi ne t’assieds-tu point auprès de lui afin de lui parler et de l’interroger ?
Il n’est aucune autre femme qui puisse, avec un cœur inébranlable, rester ainsi loin d’un mari qui, après avoir subi tant de maux, revient dans la vingtième année sur la terre de la patrie. Ton cœur est plus dur que la pierre.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Mon enfant, mon âme est stupéfaite dans ma poitrine, et je ne puis ni parler, ni interroger, ni regarder son visage. Mais s’il est vraiment Odysseus, revenu dans sa demeure, certes, nous nous reconnaîtrons mieux entre nous. Nous avons des signes que tous ignorent et que nous connaissons seuls.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus sourit, et il dit aussitôt à Tèlémakhos ces paroles ailées :
– Tèlémakhos, laisse ta mère m’éprouver dans nos demeures, peut-être alors me reconnaîtra-t-elle mieux. Maintenant, parce que je suis souillé et couvert de haillons, elle me méprise et me méconnaît. Mais délibérons, afin d’agir pour le mieux. Si quelqu’un, parmi le peuple, a tué même un homme qui n’a point de nombreux vengeurs, il fuit, abandonnant ses parents et sa patrie. Or, nous avons tué l’élite de la ville, les plus illustres des jeunes hommes d’Ithakè. C’est pourquoi je t’ordonne de réfléchir sur cela.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Décide toi-même, cher père. On dit que tu es le plus sage des hommes et qu’aucun des hommes mortels ne peut lutter en sagesse contre toi. Nous t’obéirons avec joie, et je ne pense pas manquer de courage, tant que je conserverai mes forces.
Et le patient Odysseus lui répondit :
– Je te dirai donc ce qui me semble pour le mieux. Lavez-vous d’abord et prenez des vêtements propres, et ordonnez aux servantes de prendre d’autres vêtements dans les demeures. Puis le divin aoide, tenant sa kithare sonore, nous entraînera à la danse joyeuse, afin que chacun, écoutant du dehors ou passant par le chemin, pense qu’on célèbre ici des noces. Il ne faut pas que le bruit du meurtre des prétendants se répande par la ville, avant que nous ayons gagné nos champs plantés d’arbres. Là, nous délibérerons ensuite sur ce que l’olympien nous inspirera d’utile.
Il parla ainsi, et tous, l’ayant entendu, obéirent. Ils se lavèrent d’abord et prirent des vêtements propres ; et les femmes se parèrent, et le divin aoide fit vibrer sa kithare sonore et leur inspira le désir du doux chant et de la danse joyeuse, et la grande demeure résonna sous les pieds des hommes qui dansaient et des femmes aux belles ceintures. Et chacun disait, les entendant, hors des demeures :
– Certes, quelqu’un épouse la reine recherchée par tant de prétendants.
La malheureuse ! Elle n’a pu rester dans la grande demeure de son premier mari jusqu’à ce qu’il revint.
Chacun parlait ainsi, ne sachant pas ce qui avait été fait. Et l’intendante Eurynomè lava le magnanime Odysseus dans sa demeure et le parfuma d’huile ; puis elle le couvrit d’un manteau et d’une tunique. Et Athènè répandit la beauté sur sa tête, afin qu’il parût plus grand et plus majestueux, et elle fit tomber de sa tête des cheveux semblables aux fleurs d’hyacinthe. Et, de même qu’un habile ouvrier, que Hèphaistos et Pallas Athènè ont instruit, mêle l’or à l’argent et accomplit avec art des travaux charmants, de même Athènè répandit la grâce sur la tête et sur les épaules d’Odysseus, et il sortit du bain, semblable par la beauté aux immortels, et il s’assit de nouveau sur le thrône qu’il avait quitté, et, se tournant vers sa femme, il lui dit :
– Malheureuse ! Parmi toutes les autres femmes, les dieux qui ont des demeures Olympiennes t’ont donné un cœur dur. Aucune autre femme ne resterait aussi longtemps loin d’un mari qui, après avoir tant souffert, revient, dans la vingtième année, sur la terre de la patrie. Allons, nourrice, étends mon lit, afin que je dorme, car, assurément, cette femme a un cœur de fer dans sa poitrine !
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Malheureux ! je ne te glorifie, ni ne te méprise mais je ne te reconnais point encore, me souvenant trop de ce que tu étais quand tu partis d’Ithakè sur ta nef aux longs avirons. Va, Eurykléia, étends, hors de la chambre nuptiale, le lit compact qu’Odysseus a construit lui-même, et jette sur le lit dressé des tapis, des peaux et des couvertures splendides.
Elle parla ainsi, éprouvant son mari ; mais Odysseus, irrité, dit à sa femme douée de prudence :
– Ô femme ! quelle triste parole as-tu dite ? Qui donc a transporté mon lit ? Aucun homme vivant, même plein de jeunesse, n’a pu, à moins qu’un dieu lui soit venu en aide, le transporter, et même le mouvoir aisément. Et le travail de ce lit est un signe certain, car je l’ai fait moi-même, sans aucun autre. Il y avait, dans l’enclos de la cour, un olivier au large feuillage, verdoyant et plus épais qu’une colonne. Tout autour, je bâtis ma chambre nuptiale avec de lourdes pierres ; je mis un toit par-dessus, et je la fermai de portes solides et compactes. Puis, je coupai les rameaux feuillus et pendants de l’olivier, et je tranchai au-dessus des racines le tronc de l’olivier, et je le polis soigneusement avec l’airain, et m’aidant du cordeau. Et, l’ayant troué avec une tarière, j’en fis la base du lit que je construisis au-dessus et que j’ornai d’or, d’argent et d’ivoire, et je tendis au fond la peau pourprée et splendide d’un bœuf.
Je te donne ce signe certain ; mais je ne sais, ô femme, si mon lit est toujours au même endroit, ou si quelqu’un l’a transporté, après avoir tranché le tronc de l’olivier, au-dessus des racines.
Il parla ainsi, et le cher cœur et les genoux de Pènélopéia défaillirent tandis qu’elle reconnaissait les signes certains que lui révélait Odysseus. Et elle pleura quand il eut décrit les choses comme elles étaient ; et jetant ses bras au cou d’Odysseus, elle baisa sa tête et lui dit :
– Ne t’irrite point contre moi, Odysseus, toi, le plus prudent des hommes ! Les dieux nous ont accablés de maux ; ils nous ont envié la joie de jouir ensemble de notre jeunesse et de parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais ne t’irrite point contre moi et ne me blâme point de ce que, dès que je t’ai vu, je ne t’ai point embrassé. Mon âme, dans ma chère poitrine, tremblait qu’un homme, venu ici, me trompât par ses paroles ; car beaucoup méditent des ruses mauvaises. L’Argienne Hélénè, fille de Zeus, ne se fût point unie d’amour à un étranger, si elle eût su que les braves fils des Akhaiens dussent un jour la ramener en sa demeure, dans la chère terre de la patrie. Mais un dieu la poussa à cette action honteuse, et elle ne chassa point de son cœur cette pensée funeste et terrible qui a été la première cause de son malheur et du nôtre. Maintenant tu m’as révélé les signes certains de notre lit, qu’aucun homme n’a jamais vu. Nous seuls l’avons vu, toi, moi et ma servante Aktoris que me donna mon père quand je vins ici et qui gardait les portes de notre chambre nuptiale.
Enfin, tu as persuadé mon cœur, bien qu’il fût plein de méfiance.
Elle parla ainsi, et le désir de pleurer saisit Odysseus, et il pleurait en serrant dans ses bras sa chère femme si prudente.
De même que la terre apparaît heureusement aux nageurs dont Poseidaôn a perdu dans la mer la nef bien construite, tandis qu’elle était battue par le vent et par l’eau noire ; et peu ont échappé à la mer écumeuse, et, le corps souillé d’écume, ils montent joyeux sur la côte, ayant évité la mort ; de même la vue de son mari était douce à Pènélopéia qui ne pouvait détacher ses bras blancs du cou d’Odysseus. Et Éôs aux doigts rosés eût reparu, tandis qu’ils pleuraient, si la déesse Athènè aux yeux clairs n’avait eu une autre pensée.
Elle retint la longue nuit sur l’horizon et elle garda dans l’Okéanos Éôs au thrône d’or, et elle ne lui permit pas de mettre sous le joug ses chevaux rapides qui portent la lumière aux hommes, Lampos et Phaéthôn qui amènent Éôs. Alors, le prudent Odysseus dit à sa femme :
– Ô femme, nous n’en avons pas fini avec toutes nos épreuves, mais un grand et difficile travail me reste qu’il me faut accomplir, ainsi que me l’a appris l’âme de Teirésias le jour où je descendis dans la demeure d’Aidès pour l’interroger sur mon retour et sur celui de mes compagnons. Mais viens, allons vers notre lit, ô femme, et goûtons ensemble le doux sommeil.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Nous irons bientôt vers notre lit, puisque tu le désires dans ton âme, et puisque les dieux t’ont laissé revenir vers ta demeure bien bâtie et dans la terre de ta patrie. Mais puisque tu le sais et qu’un dieu te l’a appris, dis-moi quelle sera cette dernière épreuve. Je la connaîtrais toujours plus tard, et rien n’empêche que je la sache maintenant.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Malheureuse ! pourquoi, en me priant ardemment, me forces-tu de parler ? Mais je te dirai tout et ne te cacherai rien. Ton âme ne se réjouira pas, et moi-même je ne me réjouirai pas, car il m’a ordonné de parcourir encore de nombreuses villes des hommes, portant un aviron léger, jusqu’à ce que je rencontre des hommes qui ne connaissent point la mer, et qui ne salent point ce qu’ils mangent, et qui ignorent les nefs aux proues rouges et les avirons qui sont les ailes des nefs. Et il m’a révélé un signe certain que je ne te cacherai point. Quand j’aurai rencontré un autre voyageur qui croira voir un fléau sur ma brillante épaule, alors je devrai planter l’aviron en terre et faire de saintes offrandes au roi Poseidaôn, un bélier, un taureau et un verrat. Et il m’a ordonné, revenu dans ma demeure, de faire de saintes offrandes aux dieux immortels qui habitent le large Ouranos. Et une douce mort me viendra de la mer et me tuera dans une heureuse vieillesse, tandis qu’autour de moi les peuples seront heureux.
Et il m’a dit ces choses qui seront accomplies.
Et la prudente Pènélopéia lui répondit :
– Si les dieux te réservent une vieillesse heureuse, tu as l’espoir d’échapper à ces maux.
Et tandis qu’ils se parlaient ainsi, Eurynomè et la nourrice préparaient, à la splendeur des torches, le lit fait de vêtements moelleux. Et, après qu’elles eurent dressé à la hâte le lit épais, la vieille femme rentra pour dormir, et Eurynomè, tenant une torche à la main, les précédait, tandis qu’ils allaient vers le lit. Et les ayant conduits dans la chambre nuptiale, elle se retira, et joyeux, ils se couchèrent dans leur ancien lit. Et alors, Tèlémakhos, le bouvier, le porcher et les femmes cessèrent de danser, et tous allèrent dormir dans les demeures sombres.
Et après qu’Odysseus et Pènélopéia se furent charmés par l’amour, ils se charmèrent encore par leurs paroles. Et la noble femme dit ce qu’elle avait souffert dans ses demeures au milieu de la multitude funeste des prétendants qui, à cause d’elle, égorgeaient ses bœufs et ses grasses brebis, et buvaient tout le vin des tonneaux.
Et le divin Odysseus dit les maux qu’il avait faits aux hommes et ceux qu’il avait subis lui-même. Et il dit tout, et elle se réjouissait de l’entendre, et le sommeil n’approcha point de ses paupières avant qu’il eût achevé.
Il dit d’abord comment il avait dompté les Kikônes, puis comment il était arrivé dans la terre fertile des hommes lôtophages. Et il dit ce qu’avait fait le kyklôps, et comment il l’avait châtié d’avoir mangé sans pitié ses braves compagnons ; et comment il était venu chez Aiolos qui l’avait accueilli et renvoyé avec bienveillance, et comment la destinée ne lui permit pas de revoir encore la chère terre de la patrie, et la tempête qui, de nouveau, l’avait emporté, gémissant, sur la mer poissonneuse.
Et il dit comment il avait abordé la Laistrygoniè Tèlèpyle où avaient péri ses nefs et tous ses compagnons, et d’où lui seul s’était sauvé sur sa nef noire. Puis, il raconta les ruses de Kirkè, et comment il était allé dans la vaste demeure d’Aidès, afin d’interroger l’âme du Thébain Teirésias, et où il avait vu tous ses compagnons et la mère qui l’avait conçu et nourri tout enfant.
Et il dit comment il avait entendu la voix des Seirènes harmonieuses, et comment il avait abordé les roches errantes, l’horrible Kharybdis et Skillè, que les hommes ne peuvent fuir sains et saufs ; et comment ses compagnons avaient tué les bœufs de Hèlios, et comment Zeus qui tonne dans les hauteurs avait frappé sa nef rapide de la blanche foudre et abîmé tous ses braves compagnons, tandis que lui seul évitait les kères mauvaises.
Et il raconta comment il avait abordé l’île Ogygiè, où la Nymphe Kalypsô l’avait retenu dans ses grottes creuses, le désirant pour mari, et l’avait aimé, lui promettant qu’elle le rendrait immortel et le mettrait à l’abri de la vieillesse ; et comment elle n’avait pu fléchir son âme dans sa poitrine.
Et il dit comment il avait abordé chez les Phaiakiens, après avoir beaucoup souffert ; et comment, l’ayant honoré comme un dieu, ils l’avaient reconduit sur une nef dans la chère terre de la patrie, après lui avoir donné de l’or, de l’airain et de nombreux vêtements. Et quand il eut tout dit, le doux sommeil enveloppa ses membres et apaisa les inquiétudes de son âme.
Alors, la déesse aux yeux clairs, Athènè, eut d’autres pensées ; et, quand elle pensa qu’Odysseus s’était assez charmé par l’amour et par le sommeil, elle fit sortir de l’Okéanos la fille au thrône d’or du matin, afin qu’elle apportât la lumière aux hommes. Et Odysseus se leva de son lit moelleux, et il dit à sa femme :
– Ô femme, nous sommes tous deux rassasiés d’épreuves, toi en pleurant ici sur mon retour difficile, et moi en subissant les maux que m’ont faits Zeus et les autres dieux qui m’ont si longtemps retenu loin de la terre de la patrie. Maintenant, puisque, tous deux, nous avons retrouvé ce lit désiré, il faut que je prenne soin de nos richesses dans notre demeure.
Pour remplacer les troupeaux que les prétendants insolents ont dévorés, j’irai moi-même en enlever de nombreux, et les Akhaiens nous en donneront d’autres, jusqu’à ce que les étables soient pleines. Mais je pars pour mes champs plantés d’arbres, afin de voir mon père illustre qui gémit sans cesse sur moi. Femme, malgré ta prudence, je t’ordonne ceci : en même temps que Hèlios montera, le bruit se répandra de la mort des prétendants que j’ai tués dans nos demeures. Monte donc dans la chambre haute avec tes servantes, et que nul ne te voie, ni ne t’interroge.
Ayant ainsi parlé, il couvrit ses épaules de ses belles armes, et il éveilla Tèlémakhos, le bouvier et le porcher, et il leur ordonna de saisir les armes guerrières ; et ils lui obéirent en hâte et se couvrirent d’airain. Puis, ils ouvrirent les portes et sortirent, et Odysseus les précédait. Et déjà la lumière était répandue sur la terre, mais Athènè, les ayant enveloppés d’un brouillard, les conduisit promptement hors de la ville.Chant 24
Le Kyllénien Hermès évoqua les âmes des prétendants. Et il tenait dans ses mains la belle baguette d’or avec laquelle il charme, selon sa volonté, les yeux des hommes, ou il éveille ceux qui dorment. Et, avec cette baguette, il entraînait les âmes qui le suivaient, frémissantes.
De même que les chauves-souris, au fond d’un antre divin, volent en criant quand l’une d’elles tombe du rocher où leur multitude est attachée et amassée, de même les âmes allaient, frémissantes, et le bienveillant Herméias marchait devant elles vers les larges chemins. Et elles arrivèrent au cours d’Okéanos et à la Roche Blanche, et elles passèrent la porte de Hèlios et le peuple des songes, et elles parvinrent promptement à la prairie d’Asphodèle où habitent les âmes, images des morts. Et elles y trouvèrent l’âme du Pèlèiade Akhilleus et celle de Patroklos, et celle de l’irréprochable Antilokhos, et celle d’Aias, qui était le plus grand et le plus beau de tous les Danaens après l’irréprochable Pèléiôn. Et tous s’empressaient autour de celui-ci, quand vint l’âme dolente de l’Atréide Agamemnôn, suivie des âmes de tous ceux qui, ayant été tuées dans la demeure d’Aigisthos, avaient subi leur destinée. Et l’âme du Pèléiôn dit la première :
– Atréide, nous pensions que tu étais, parmi tous les héros, le plus cher à Zeus qui se réjouit de la foudre, car tu commandais à des hommes nombreux et braves, sur la terre des Troiens, où les Akhaiens ont subi tant de maux.
Mais la moire fatale devait te saisir le premier, elle qu’aucun homme ne peut fuir, dès qu’il est né. Plût aux dieux que, comblé de tant d’honneurs, tu eusses subi la destinée et la mort sur la terre des Troiens ! Tous les Akhaiens eussent élevé ta tombe, et tu eusses laissé à ton fils une grande gloire dans l’avenir ; mais voici qu’une mort misérable t’était réservée.
Et l’âme de l’Atréide lui répondit :
– Heureux fils de Pèleus, Akhilleus semblable aux dieux, tu es mort devant Troiè, loin d’Argos, et les plus braves d’entre les fils des Troiens et des Akhaiens se sont entre-tués en combattant pour toi. Et tu étais couché, en un tourbillon de poussière, grand, sur un grand espace, oublieux des chevaux. Et nous combattîmes tout le jour, et nous n’eussions point cessé de combattre si Zeus ne nous eût apaisés par une tempête. Après t’avoir emporté de la mêlée vers les nefs, nous te déposâmes sur un lit, ayant lavé ton beau corps avec de l’eau chaude et l’ayant parfumé d’huile. Et, autour de toi, les Danaens répandaient des larmes amères et coupaient leurs cheveux. Alors, ta mère sortit des eaux avec les immortelles marines, pour apprendre la nouvelle, car notre voix était allée jusqu’au fond de la mer. Et une grande terreur saisit tous les Akhaiens, et ils se fussent tous rués dans les nefs creuses, si un homme plein d’une sagesse ancienne, Nestôr, ne les eût retenus. Et il vit ce qu’il y avait de mieux à faire, et, dans sa sagesse, il les harangua et leur dit :
– Arrêtez, Argiens ! Ne fuyez pas, fils des Akhaiens ! Une mère sort des eaux avec les immortelles marines, afin de voir son fils qui est mort.
Il parla ainsi, et les magnanimes Akhaiens cessèrent de craindre. Et les filles du vieillard de la mer pleuraient autour de toi en gémissant lamentablement, et elles te couvrirent de vêtements immortels. Les neuf muses, alternant leurs belles voix, se lamentaient ; et aucun des Argiens ne resta sans pleurer, tant la muse harmonieuse remuait leur âme. Et nous avons pleuré dix-sept jours et dix-sept nuits, dieux immortels et hommes mortels ; et, le dix-huitième jour, nous t’avons livré au feu, et nous avons égorgé autour de toi un grand nombre de brebis grasses et de bœufs noirs. Et tu as été brûlé dans des vêtements divins, ayant été parfumé d’huile épaisse et de miel doux ; et les héros Akhaiens se sont rués en foule autour de ton bûcher, piétons et cavaliers, avec un grand tumulte. Et, après que la flamme de Hèphaistos t’eut consumé, nous rassemblâmes tes os blancs, ô Akhilleus, les lavant dans le vin pur et l’huile ; et ta mère donna une urne d’or qu’elle dit être un présent de Dionysos et l’œuvre de l’illustre Hèphaistos. C’est dans cette urne que gisent tes os blancs, ô Akhilleus, mêlés à ceux du Mènoitiade Patroklos, et auprès d’Antilokhos que tu honorais le plus entre tous tes compagnons depuis la mort de Patroklos. Et, au-dessus de ces restes, l’armée sacrée des Argiens t’éleva un grand et irréprochable tombeau sur un haut promontoire du large Hellespontos, afin qu’il fût aperçu de loin, sur la mer, par les hommes qui vivent maintenant et par les hommes futurs.
Et ta mère, les ayant obtenus des dieux, déposa de magnifiques prix des jeux au milieu des illustres Argiens. Déjà je m’étais trouvé aux funérailles d’un grand nombre de héros, quand, sur le tombeau d’un roi, les jeunes hommes se ceignent et se préparent aux jeux ; mais tu aurais admiré par-dessus tout, dans ton âme, les prix que la déesse Thétis aux pieds d’argent déposa sur la terre pour les jeux ; car tu étais cher aux dieux. Ainsi, Akhilleus, bien que tu sois mort, ton nom n’est point oublié, et, entre tous les hommes, ta gloire sera toujours grande. Mais moi, qu’ai-je gagné à échapper à la guerre ? À mon retour, Zeus me gardait une mort lamentable par les mains d’Aigisthos et de ma femme perfide.
Et tandis qu’ils se parlaient ainsi, le messager tueur d’Argos s’approcha d’eux, conduisant les âmes des prétendants domptés par Odysseus. Et tous, dès qu’ils les virent, allèrent, étonnés, au-devant d’eux. Et l’âme de l’Atréide Agamemnôn reconnut l’illustre Amphimédôn, fils de Mélantheus, car il avait été son hôte dans Ithakè. Et l’âme de l’Atréide lui dit la première :
– Amphimédôn, quel malheur avez-vous subi pour venir dans la terre noire, tous illustres et du même âge ? On ne choisirait pas autrement les premiers d’une ville. Poseidaôn vous a-t-il domptés sur vos nefs, en soulevant les vents furieux et les grands flots, ou des ennemis vous ont-ils tués sur la terre tandis que vous enleviez leurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis ? ou êtes-vous morts en combattant pour votre ville et pour vos femmes ?
Réponds-moi, car j’ai été ton hôte. Ne te souviens-tu pas que je vins dans tes demeures, avec le divin Ménélaos, afin d’exciter Odysseus à nous suivre à Ilios sur les nefs aux solides bancs de rameurs ? Tout un mois nous traversâmes la vaste mer, et nous pûmes à peine persuader le dévastateur de villes Odysseus.
Et l’âme d’Amphimédôn lui répondit :
– Illustre roi des hommes, Atréide Agamemnôn, je me souviens de toutes ces choses, et je te dirai avec vérité la fin malheureuse de notre vie. Nous étions les prétendants de la femme d’Odysseus absent depuis longtemps. Elle ne repoussait ni n’accomplissait des noces odieuses, mais elle nous préparait la mort et la kèr noire. Et elle médita une autre ruse dans son esprit, et elle se mit à tisser dans sa demeure une grande toile, large et fine, et elle nous dit aussitôt :
– Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Odysseus est mort, cessez de hâter mes noces jusqu’à ce que j’aie achevé, pour que mes fils ne restent pas inutiles, ce linceul du héros Laertès, quand la moire mauvaise, de la mort inexorable l’aura saisi ; afin qu’aucune des femmes Akhaiennes ne puisse me reprocher, devant tout le peuple, qu’un homme qui a possédé tant de biens ait été enseveli sans linceul.
Elle parla ainsi, et notre cœur généreux fut persuadé aussitôt. Et, alors, pendant le jour, elle tissait la grande toile, et, pendant la nuit, ayant allumé les torches, elle la défaisait. Ainsi, trois ans, elle cacha sa ruse et trompa les Akhaiens ; mais, quand vint la quatrième année, et quand les mois et les jours furent écoulés, une de ses femmes, sachant bien sa ruse, nous la dit. Et nous la trouvâmes, défaisant sa belle toile ; mais, contre sa volonté, elle fut contrainte de l’achever. Et elle acheva donc cette grande toile semblable en éclat à Hèlios et à Sélènè. Mais voici qu’un daimôn ennemi ramena de quelque part Odysseus, à l’extrémité de ses champs, là où habitait son porcher. Là aussi vint le cher fils du divin Odysseus, de retour sur sa nef noire de la sablonneuse Pylos. Et ils méditèrent la mort des prétendants, et ils vinrent à l’illustre ville, et Odysseus vint le dernier, car Tèlémakhos le précédait. Le porcher conduisait Odysseus couvert de haillons, semblable à un vieux mendiant et courbé sur un bâton. Il arriva soudainement, et aucun de nous, et même des plus âgés, ne le reconnut. Et nous l’outragions de paroles injurieuses et de coups ; mais il supporta longtemps, dans ses demeures, et avec patience, les injures et les coups. Et, quand l’esprit de Zeus tempétueux l’eut excité, il enleva les belles armes, à l’aide de Tèlémakhos, et il les déposa dans la haute chambre, dont il ferma les verrous. Puis il ordonna à sa femme pleine de ruses d’apporter aux prétendants l’arc et le fer brillant pour l’épreuve qui devait nous faire périr misérablement et qui devait être l’origine du meurtre.
Et aucun de nous ne put tendre le nerf de l’arc solide, car nous étions beaucoup trop faibles. Mais quand le grand arc arriva aux mains d’Odysseus, alors nous fîmes entendre des menaces pour qu’on ne le lui donnât pas, bien qu’il le demandât vivement. Le seul Tèlémakhos le voulut en l’excitant, et le patient et divin Odysseus, ayant saisi l’arc, le tendit facilement et envoya une flèche à travers le fer. Puis, debout sur le seuil, il répandit à ses pieds les flèches rapides et il perça le roi Antinoos. Alors, regardant de tous côtés, il lança ses traits mortels aux autres prétendants qui tombaient tous amoncelés et nous reconnûmes qu’un d’entre les dieux l’aidait. Et aussitôt son fils et ses deux serviteurs, s’appuyant sur sa force, tuaient çà et là, et d’affreux gémissements s’élevaient, et la terre ruisselait de sang. C’est ainsi que nous avons péri, ô Agamemnôn ! Nos cadavres négligés gisent encore dans les demeures d’Odysseus, et nos amis ne le savent point dans nos maisons, eux qui, ayant lavé le sang noir de nos blessures, nous enseveliraient en gémissant, car tel est l’honneur des morts.
Et l’âme de l’Atréide lui répondit :
– Heureux fils de Laertès, prudent Odysseus, certes, tu possèdes une femme d’une grande vertu, et l’esprit est sage de l’irréprochable Pènélopéia, fille d’Ikarios, qui n’a point oublié le héros Odysseus qui l’avait épousée vierge. C’est pourquoi la gloire de sa vertu ne périra pas, et les immortels inspireront aux hommes terrestres des chants gracieux en l’honneur de la sage Pènélopéia.
Mais la fille de Tyndaros n’a point agi ainsi, ayant tué le mari qui l’avait épousée vierge. Aussi un chant odieux la rappellera parmi les hommes et elle répandra sa renommée honteuse sur toutes les femmes, même sur celles qui seront vertueuses !
Tandis qu’ils se parlaient ainsi, debout dans les demeures d’Aidès, sous les ténèbres de la terre, Odysseus et ses compagnons, étant sortis de la ville, parvinrent promptement au beau verger de Laertès, et que lui-même avait acheté autrefois, après avoir beaucoup souffert. Là était, sa demeure entourée de sièges sur lesquels s’asseyaient, mangeaient et dormaient les serviteurs qui travaillaient pour lui. Là était aussi une vieille femme Sikèle qui, dans les champs, loin de la ville, prenait soin du vieillard. Alors Odysseus dit aux deux pasteurs et à son fils :
– Entrez maintenant dans la maison bien bâtie et tuez, pour le repas, un porc, le meilleur de tous. Moi, j’éprouverai mon père, afin de voir s’il me reconnaîtra dès qu’il m’aura vu, ou s’il me méconnaîtra quand j’aurai marché longtemps près de lui.
Ayant ainsi parlé, il remit ses armes guerrières aux serviteurs, qui entrèrent promptement dans la maison. Et, descendant le grand verger, il ne trouva ni Dolios, ni aucun de ses fils, ni aucun des serviteurs. Et ceux-ci étaient allés rassembler des épines pour enclore le verger, et le vieillard les avait précédés.
Et Odysseus trouva son père seul dans le verger, arrachant les herbes et vêtu d’une sordide tunique, déchirée et trouée. Et il avait lié autour de ses jambes, pour éviter les écorchures, des knèmides de cuir déchirées ; et il avait des gants aux mains pour se garantir des buissons, et, sur la tête, un casque de peau de chèvre qui rendait son air plus misérable.
Et le patient et divin Odysseus, ayant vu son père accablé de vieillesse et plein d’une grande douleur, versa des larmes, debout sous un haut poirier. Et il hésita dans son esprit et dans son cœur s’il embrasserait son père en lui disant comment il était revenu dans la terre de la patrie, ou s’il l’interrogerait d’abord pour l’éprouver. Et il pensa qu’il était préférable de l’éprouver par des paroles mordantes. Pensant ainsi, le divin Odysseus alla vers lui comme il creusait, la tête baissée, un fossé autour d’un arbre. Alors, le divin Odysseus, s’approchant, lui parla ainsi :
– Ô vieillard, tu n’es point inhabile à cultiver un verger. Tout est ici bien soigné, l’olivier, la vigne, le figuier, le poirier. Aucune portion de terre n’est négligée dans ce verger. Mais je te le dirai, et n’en sois point irrité dans ton âme : tu ne prends point les mêmes soins de toi. Tu subis à la fois la triste vieillesse et les vêtements sales et honteux qui te couvrent. Ton maître ne te néglige point ainsi sans doute à cause de ta paresse, car ton aspect n’est point servile, et par ta beauté et ta majesté tu es semblable à un roi.
Tu es tel que ceux qui, après le bain et le repas, dorment sur un lit moelleux, selon la coutume des vieillards. Mais dis-moi la vérité. De qui es-tu le serviteur ? De qui cultives-tu le verger ? Dis-moi la vérité, afin que je la sache : suis-je parvenu à Ithakè, ainsi que me l’a dit un homme que je viens de rencontrer et qui est insensé, car il n’a su ni m’écouter, ni me répondre, quand je lui ai demandé si mon hôte est encore vivant ou s’il est mort et descendu dans les demeures d’Aidès. Mais je te le dis ; écoute et comprends-moi. Je donnai autrefois l’hospitalité, sur la chère terre de la patrie, à un homme qui était venu dans ma demeure, le premier, entre tous les étrangers errants. Il disait qu’il était né à Ithakè et que son père était Laertès Arkeisiade. L’ayant conduit dans ma demeure, je le reçus avec tendresse. Et il y avait beaucoup de richesses dans ma demeure, et je lui fis de riches présents hospitaliers, car je lui donnai sept talents d’or bien travaillé, un kratère fleuri en argent massif, douze manteaux simples, autant de tapis, douze autres beaux manteaux et autant de tuniques, et, par surcroît, quatre femmes qu’il choisit lui-même, belles et très habiles à tous les ouvrages.
Et son père lui répondit en pleurant :
– Étranger, certes, tu es dans la contrée sur laquelle tu m’interroges ; mais des hommes iniques et injurieux l’oppriment, et les nombreux présents que tu viens de dire sont perdus.
Si tu eusses rencontré ton hôte dans Ithakè, il t’eût congédié après t’avoir donné l’hospitalité et t’avoir comblé d’autant de présents qu’il en a reçu de toi, comme c’est la coutume. Mais dis-moi la vérité : combien y a-t-il d’années que tu as reçu ton hôte malheureux ? C’était mon fils, si jamais quelque chose a été ! Le malheureux ! Loin de ses amis et de sa terre natale, ou les poissons l’ont mangé dans la mer, ou, sur la terre, il a été déchiré par les bêtes féroces et par les oiseaux, et ni sa mère, ni son père, nous qui l’avons engendré, ne l’avons pleuré et enseveli. Et sa femme si richement dotée, la sage Pènélopéia n’a point pleuré, sur le lit funèbre, son mari bien-aimé, et elle ne lui a point fermé les yeux, car tel est l’honneur des morts ! Mais dis-moi la vérité, afin que je la sache. Qui es-tu parmi les hommes ? Où sont ta ville et tes parents ? Où s’est arrêtée la nef rapide qui t’a conduit ici ainsi que tes divins compagnons ? Es-tu venu, comme un marchand, sur une nef étrangère, et, t’ayant débarqué, ont-ils continué leur route ?
Et le prudent Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
– Certes, je te dirai toute la vérité. Je suis d’Alybas, où j’ai mes demeures illustres ; je suis le fils du roi Apheidas Polypèmonide, et mon nom est Épèritos. Un daimôn m’a poussé ici, malgré moi, des côtes de Sikaniè, et ma nef s’est arrêtée, loin de la ville, sur le rivage. Voici la cinquième année qu’Odysseus a quitté ma patrie. Certes, comme il partait, des oiseaux apparurent à sa droite, et je le renvoyai, m’en réjouissant, et lui-même en était joyeux quand il partit.
Et nous espérions, dans notre âme, nous revoir et nous faire de splendides présents.
Il parla ainsi, et la sombre nuée de la douleur enveloppa Laertès, et, avec de profonds gémissements, il couvrit à deux mains sa tête blanche de poussière. Et l’âme d’Odysseus fut émue, et un trouble violent monta jusqu’à ses narines en voyant ainsi son cher père ; et il le prit dans ses bras en s’élançant, et il le baisa et lui dit :
– Père ! Je suis celui que tu attends, et je reviens après vingt ans dans la terre de la patrie. Mais cesse de pleurer et de gémir, car, je te le dis, il faut que nous nous hâtions. J’ai tué les prétendants dans nos demeures, châtiant leurs indignes outrages et leurs mauvaises actions.
Et Laertès lui répondit :
– Si tu es Odysseus mon fils de retour ici, donne moi un signe manifeste qui me persuade.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Vois d’abord de tes yeux cette blessure qu’un sanglier me fit de ses blanches dents, sur le Parnèsos, quand vous m’aviez envoyé, toi et ma mère vénérable, auprès d’Autolykos le cher père de ma mère, afin de prendre les présents qu’il m’avait promis quand il vint ici.
Mais écoute, et je te dirai encore les arbres de ton verger bien cultivé, ceux que tu m’as donnés autrefois, comme je te les demandais, étant enfant et te suivant à travers le verger. Et nous allions parmi les arbres et tu me nommais chacun d’entre eux, et tu me donnas treize poiriers, dix pommiers et quarante figuiers ; et tu me dis que tu me donnerais cinquante sillons de vignes portant des fruits et dont les grappes mûrissent quand les saisons de Zeus pèsent sur elles.
Il parla ainsi, et les genoux et le cher cœur de Laertès défaillirent tandis qu’il reconnaissait les signes manifestes que lui donnait Odysseus. Et il jeta ses bras autour de son cher fils, et le patient et divin Odysseus le reçut inanimé. Enfin, il respira, et, rassemblant ses esprits, il lui parla ainsi :
– Père Zeus, et vous, dieux ! certes, vous êtes encore dans le grand Olympos, si vraiment les prétendants ont payé leurs outrages ! Mais, maintenant, je crains dans mon âme que tous les Ithakèsiens se ruent promptement ici et qu’ils envoient des messagers à toutes les villes des Képhallèniens.
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Prends courage, et ne t’inquiète point de ceci dans ton âme. Mais allons vers la demeure qui est auprès du verger. C’est là que j’ai envoyé Tèlémakhos, le bouvier et le porcher, afin de préparer promptement le repas.
Ayant ainsi parlé, ils allèrent vers les belles demeures, où ils trouvèrent Tèlémakhos, le bouvier et le porcher, coupant les chairs abondantes et mêlant le vin rouge. Cependant la servante Sikèle lava et parfuma d’huile le magnanime Laertès dans sa demeure, et elle jeta un beau manteau autour de lui, et Athènè, s’approchant, fortifia les membres du prince des peuples et elle le fit paraître plus grand et plus majestueux qu’auparavant. Et il sortit du bain, et son cher fils l’admira, le voyant semblable aux dieux immortels, et il lui dit ces paroles ailées :
– Ô père, certes, un des dieux éternels te fait ainsi paraître plus irréprochable par la beauté et la majesté.
Et le prudent Laertès lui répondit :
– Que n’a-t-il plu au père Zeus, à Athènè, à Apollôn, que je fusse hier, dans nos demeures, tel que j’étais quand je pris, sur la terre ferme, commandant aux Képhallèniens, la ville bien bâtie de Nérikos ! Les épaules couvertes de mes armes, j’eusse chassé les prétendants et rompu les genoux d’un grand nombre d’entre eux dans nos demeures, et tu t’en fusses réjoui dans ton âme.
Et ils se parlaient ainsi, et, cessant leur travail, ils préparèrent le repas, et ils s’assirent en ordre sur les sièges et sur les thrônes, et ils allaient prendre leur repas, quand le vieux Dolios arriva avec ses fils fatigués de leurs travaux ; car la vieille mère Sikèle, qui les avait nourris et qui prenait soin du vieillard depuis que l’âge l’accablait, était allée les appeler.
Ils aperçurent Odysseus et ils le reconnurent dans leur âme, et ils s’arrêtèrent, stupéfaits, dans la demeure. Mais Odysseus, les rassurant, leur dit ces douces paroles :
– Ô vieillard, assieds-toi au repas et ne sois plus stupéfait. Nous vous avons longtemps attendus dans les demeures, prêts à mettre la main sur les mets.
Il parla ainsi, et Dolios, les deux bras étendus, s’élança ; et saisissant les mains d’Odysseus, il les baisa, et il lui dit ces paroles ailées :
– Ô ami, puisque tu es revenu vers nous qui te désirions et qui pensions ne plus te revoir, c’est que les dieux t’ont conduit. Salut ! Réjouis-toi, et que les dieux te rendent heureux ! Mais dis-moi la vérité, afin que je la sache. La prudente Pènélopéia sait-elle que tu es revenu, ou lui enverrons-nous un message ?
Et le prudent Odysseus lui répondit :
– Ô vieillard, elle le sait ! Pourquoi t’inquiéter de ces choses ?
Il parla ainsi, et il s’assit de nouveau sur son siège poli. Et, autour de l’illustre Odysseus, les fils de Dolios, de la même façon, saluèrent leur maître par leurs paroles et baisèrent ses mains. Ensuite ils s’assirent auprès de Dolios leur père.
Tandis qu’ils mangeaient ainsi dans la demeure, Ossa se répandit par la ville, annonçant la kèr et la mort lamentable des prétendants. Et, à cette nouvelle, tous accoururent de tous côtés, avec tumulte et en gémissant, devant la demeure d’Odysseus. Et ils emportèrent les morts, chacun dans sa demeure, et ils les ensevelirent ; et ceux des autres villes, ils les firent reconduire, les ayant déposés sur des nefs rapides. Puis, affligés dans leur cœur, ils se réunirent à l’agora. Et quand ils furent réunis en foule, Eupeithès se leva et parla au milieu d’eux. Et une douleur intolérable était dans son cœur à cause de son fils Antinoos que le divin Odysseus avait tué le premier. Et il parla ainsi, versant des larmes à cause de son fils :
– Ô amis, certes, cet homme a fait un grand mal aux Akhaiens. Tous ceux, nombreux et braves, qu’il a emmenés sur ses nefs, il les a perdus ; et il a perdu aussi les nefs creuses, et il a perdu ses peuples, et voici qu’à son retour il a tué les plus braves des Képhallèniens. Allons ! Avant qu’il fuie rapidement à Pylos ou dans la divine Élis où dominent les Épéiens, allons ! car nous serions à jamais méprisés, et les hommes futurs se souviendraient de notre honte, si nous ne vengions le meurtre de nos fils et de nos frères. Il ne me serait plus doux de vivre, et j’aimerais mieux descendre aussitôt chez les morts. Allons ! de peur que, nous prévenant, ils s’enfuient.
Il parla ainsi en pleurant, et la douleur saisit tous les Akhaiens.
Mais, alors, Médôn et le divin aoide s’approchèrent d’eux, étant sortis de la demeure d’Odysseus, dès que le sommeil les eut quittés. Et ils s’arrêtèrent au milieu de l’agora. Et tous furent saisis de stupeur, et le prudent Médôn leur dit :
– Écoutez-moi, Ithakèsiens. Odysseus n’a point accompli ces choses sans les dieux immortels. Moi-même j’ai vu un dieu immortel qui se tenait auprès d’Odysseus, sous la figure de Mentôr. Certes, un dieu immortel apparaissait, tantôt devant Odysseus, excitant son audace, et tantôt s’élançant dans la salle, troublant les prétendants, et ceux-ci tombaient amoncelés.
Il parla ainsi, et la terreur blême les saisit tous. Et le vieux héros Halithersès Mastoride, qui savait les choses passées et futures, plein de prudence, leur parla ainsi :
– Écoutez-moi, Ithakèsiens, quoi que je dise. C’est par votre iniquité, amis, que ceci est arrivé. En effet, vous ne m’avez point obéi, ni à Mentôr prince des peuples, en réprimant les violences de vos fils qui ont commis avec fureur des actions mauvaises, consumant les richesses et insultant la femme d’un vaillant homme qu’ils disaient ne devoir plus revenir. Et, maintenant que cela est arrivé, faites ce que je vous dis : ne partez pas, de peur qu’il vous arrive malheur.
Il parla ainsi, et les uns se ruèrent avec un grand tumulte, et les autres restèrent en grand nombre, car les paroles de Halithersès ne leur plurent point et ils obéirent à Eupeithès.
Et aussitôt ils se jetèrent sur leurs armes, et, s’étant couverts de l’airain splendide, réunis, ils traversèrent la grande ville. Et Eupeithès était le chef de ces insensés, et il espérait venger le meurtre de son fils ; mais sa destinée n’était point de revenir, mais de subir la kèr.
Alors Athènè dit à Zeus Kroniôn :
– Notre père, Kronide, le plus puissant des rois, réponds-moi : que cache ton esprit ? Exciteras-tu la guerre lamentable et la rude mêlée, ou rétabliras-tu la concorde entre les deux partis ?
Et Zeus qui amasse les nuées lui répondit :
– Mon enfant, pourquoi m’interroges-tu sur ces choses ? N’en as-tu point décidé toi-même dans ton esprit, de façon qu’Odysseus, à son retour, se venge de ses ennemis ? Fais selon ta volonté ; mais je te dirai ce qui est convenable. Maintenant que le divin Odysseus a puni les prétendants, qu’ayant scellé une alliance sincère, il règne toujours. Nous enverrons à ceux-ci l’oubli du meurtre de leurs fils et de leurs frères, et ils s’aimeront les uns les autres comme auparavant, dans la paix et dans l’abondance.
Ayant ainsi parlé, il excita Athènè déjà pleine d’ardeur et qui se rua du faîte de l’Olympos.
Et quand ceux qui prenaient leur repas eurent chassé la faim, le patient et divin Odysseus leur dit, le premier :
– Qu’un de vous sorte et voie si ceux qui doivent venir approchent.
Il parla ainsi, et un des fils de Dolios sortit, comme il l’ordonnait ; et, debout sur le seuil, il vit la foule qui approchait. Et aussitôt il dit à Odysseus ces paroles ailées :
– Les voici, armons-nous promptement.
Il parla ainsi, et tous se jetèrent sur leurs armes, Odysseus et ses trois compagnons et les six fils de Dolios. Et avec eux, Laertès et Dolios s’armèrent, quoique ayant les cheveux blancs, mais contraints de combattre.
Et, s’étant couverts de l’airain splendide, ils ouvrirent les portes et sortirent, et Odysseus les conduisait. Et la fille de Zeus, Athènè, vint à eux, semblable à Mentôr par la figure et la voix. Et le patient et divin Odysseus, l’ayant vue, se réjouit, et il dit aussitôt à son cher fils Tèlémakhos :
– Tèlémakhos, voici qu’il faut te montrer, en combattant toi-même les guerriers. C’est là que les plus braves se reconnaissent. Ne déshonorons pas la race de nos aïeux, qui, sur toute la terre, l’a emporté par sa force et son courage.
Et le prudent Tèlémakhos lui répondit :
– Tu verras, si tu le veux, cher père, que je ne déshonorerai point ta race.
Il parla ainsi, et Laertès s’en réjouit et dit :
– Quel jour pour moi, dieux amis ! Certes, je suis plein de joie ; mon fils et mon petit-fils luttent de vertu.
Et Athènè aux yeux clairs, s’approchant, lui dit :
– Arkeisiade, le plus cher de mes compagnons, supplie le père Zeus et sa fille aux yeux clairs, et, aussitôt, envoie ta longue lance, l’ayant brandie avec force.
Ayant ainsi parlé, Pallas Athènè lui inspira une grande force, et il pria la fille du grand Zeus, et il envoya sa longue lance brandie avec force. Et il frappa le casque d’airain d’Eupeithès, qui ne résista point, et l’airain le traversa. Et Eupeithès tomba avec bruit, et ses armes résonnèrent sur lui. Et Odysseus et son illustre fils se ruèrent sur les premiers combattants, les frappant de leurs épées et de lances à deux pointes. Et ils les eussent tous tués et privés du retour, si Athènè, la fille de Zeus tempétueux, n’eût arrêté tout le peuple en criant :
– Cessez la guerre lamentable, Ithakèsiens, et séparez-vous promptement sans carnage.
Ainsi parla Athènè, et la terreur blême les saisit, et leurs armes, échappées de leurs mains, tombèrent à terre, au cri de la déesse ; et tous, pour sauver leur vie, s’enfuirent vers la ville.
Et le patient et divin Odysseus, avec des clameurs terribles, se rua comme l’aigle qui vole dans les hauteurs. Alors le Kronide lança la foudre enflammée qui tomba devant la fille aux yeux clairs d’un père redoutable. Et, alors, Athènè aux yeux clairs dit à Odysseus :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, arrête, cesse la discorde de la guerre intestine, de peur que le Kronide Zeus qui tonne au loin s’irrite contre toi.
Ainsi parla Athènè, et il lui obéit, plein de joie dans son cœur. Et Pallas Athènè, fille de Zeus tempétueux, et semblable par la figure et par la voix à Mentôr, scella pour toujours l’alliance entre les deux partis.
Donner votre avis à propos de cette oeuvre
Découvrir les 2 autres oeuvres de cet auteur votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 23 Décembre 2015 à 20:31
Pilas ou l'amour sacrifié
Mahboul Ghorba

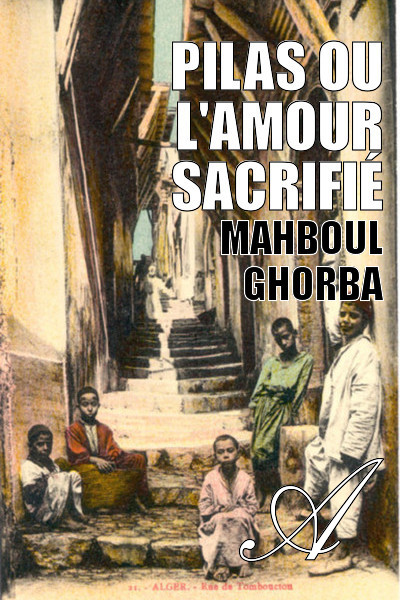
-Seigneur l’envoyé spécial de votre seigneurie est signalé à la porte Est de la ville, il vous rendra compte de sa mission dans quelques instants !
-Vizir fidèle compagnon, j’aimerais bien qu’il ramène de bonnes nouvelles !
-Seigneur, mon roi ! Nous souhaitons tous que cette alliance se réalise, car l’union des deux royaumes permettra à votre seigneurie, de posséder l’armée la plus puissante de la terre, ce qui vous permettra de détruire vos ennemis ! Votre seigneurie pourra encore conquérir de nouvelles terres et agrandir vos possessions !
-Vizir fidèle compagnon, donnes des ordres pour que notre envoyé se rende directement dans la salle du trône, pour nous rendre compte de la mission dont il a été chargé!
-A vos ordres mon maitre et seigneur !
Le vizir se retira des appartements du roi en reculant, et en faisant des signes de soumission et d’obéissance. Le roi Ardachér gagna la salle du trône ou l’attendait son fidèle vizir.
Ardachér avait dépêché un envoyé spécial au roi de Ctésiphon, auquel il demandait de se mettre sous sa protection, et d’unir les deux royaumes.
En 224 après J.C., Ardachér s’est insurgé contre l’Arsacide Artaban IV, qu’il a éliminé, maintenant Ardachér désire se proclamer ‘’Roi des rois’’, il faut que le roi de Ctésiphon accepte son offre ou Ardachér lui déclarera la guerre et l’éliminera comme Artaban. Nous sommes en l’an 226 après J.C.
Ardachér s’asseya sur son trône et regarda son vizir, et se rappela cette année, ou il envoya un envoyé au roi de la contrée du fleuve, pour demander la main de sa fille, et ce dernier refusa. Ardachér jura par ses dieux de lever une armée, et de détruire le royaume de ce roi, et de les mettre à mort lui et sa fille.
Le roi Ardachér recruta dix mille hommes, et se rendit dans la contrée du fleuve et assiégea la ville du roi Urulien, après un siège de dix-huit jours, en l’an 224, Ardachér entra dans la ville, après avoir fait exécuté le roi Urulien, il fit rechercher partout sa fille. Cette fille de roi qui a osé refuser de se marier avec Ardachér. Le roi vainqueur était dans la salle du trône, assit à la place du roi Urulien en train de savourer sa victoire, lorsqu’une esclave se précipita à ses pieds.
-Seigneur, sauvez-moi !
-Lèves-toi ! Qui es-tu ?
-Seigneur et maitre, je suis la fille du roi Ursus, que le roi despote Urulien a tué, et a fait de moi, une esclave au service de sa fille Néferti !
-Ou est la fille du roi Urulien ? Demanda Ardachér.
-Son père l’a fait sortir de la ville, lorsque ses éclaireurs, lui signalèrent la venue de votre armée !
Ardachér regarda la fille du roi Ursus, malgré ses habits d’esclave, sa beauté, son port de princesse, la trahissaient.
-Que diriez-vous fille du roi Ursus, vous deviendrez notre reine ?
-Mon seigneur et maitre, vous m’avez sauvé des griffes du roi Urulien, et ceux de sa fille Néferti, je suis votre esclave !
-Quel est ton nom ?
-Pilas, seigneur !
Ardachér ordonna à son vizir de s’occuper de Pilas, et de la préparer pour les noces. Le vizir mit au service de la fille du roi Ursus, les femmes qui étaient au service de la fille du roi Urulien. Les noces d’Ardachér et de Pilas furent célébrées dans les appartements du roi vaincu.
Le lendemain Ardachér ordonna de lever le campement, et s’en retourna à son royaume fort satisfait, une ville conquise et qu’il ajoute à ses possessions, son ennemi tué, une jolie femme qu’il a épousé, belle, corps élancé, aimante, de bonne compagnie, et fille de roi.
-Seigneur votre envoyé spécial, Gamenon !….
Ardachér fut tiré de sa rêverie, il regarda Gamenon qui s’avançait en direction du trône, et se courba devant son roi.
-Seigneur, mon roi le maitre de Ctésiphon refuse votre offre, et se déclare prêt à se battre contre votre armée, et qu’il fera appel à ses alliées.
-Comment ? Cette descente de lit se refuse à s’allier à son seigneur et maitre ? Cette larve ose me défier moi Ardachér !
-Seigneur, votre armée ne fera qu’une bouchée de ses soldats, commandez seigneur ! dit le vizir.
-Moi Ardachér ordonne à mon armée de se diriger vers Ctésiphon, et dresser le siège de la ville, deux solutions sont offertes aux habitant : la soumission ou la destruction !
Le vizir se fait accompagner par Gamenon pour procéder aux préparatifs, le départ pour les murs de Ctésiphon se fera le lendemain. Ardachér resta dans la salle tu trône.
Vers la fin de l’année 224, alors que le roi Ardacher se trouvait dans ses appartements, en compagnie de Pilas, ils avaient fait l’amour et avaient vogué dans l’extase. Le voyant heureux et tout joyeux. Pilas s’approcha de lui amoureuse et aimante, elle posa sa tête sur le genou d’Ardachér et lui dit d’une voix douce et envoutante.
-Mon seigneur et maitre Ardachér, savez-vous que vous allez être père ?
-Comment s’exclama le roi, c’est vrai ce que tu dis, je vais être père, enfin moi Ardachér je vais avoir un héritier !
Pilas voyant le roi Ardachér, content et heureux de la nouvelle, lui assura.
-Seigneur et maitre, je voudrais vous avouer ma faute, et j’espère que mon roi acceptera cette ruse, et saura qu’une femme a eu raison d’Ardachér par la ruse !
-Comment ?….. S’écria le roi.
-Je ne suis pas la fille du roi Ursus, mais la fille du roi Urulien, j’avais entendu que vous avez juré de me tuer, j’ai usé de ce subterfuge, et maintenant je suis enceinte de votre fils ou de votre fille, vous n’oserez pas ordonner ma mort.
-Comment tu as osé t’amuser à mes dépends, et tu crois que je ne déciderais pas de ta mort, en te sachant enceinte !
-Seigneur, avant j’avais refusé de vous épouser, mais maintenant que je vous connais, je suis amoureuse de vous !
-Moi aussi je t’aime et je suis même fol amoureux, mais je ne permettrais pas qu’on jase sur mon dos, moi Ardachér !
Le roi ordonna à ce qu’on enferme Pilas dans ses appartements, et fit venir son vizir. Ardachér lui raconta ce qu’il venait d’apprendre de Pilas, qui était en réalité Néferti la fille d’Urulien.
-Vizir fidèle compagnon, que me conseillez-vous ? J’ai juré de la mettre à mort, et elle porte en son sein mon héritier !
-Mon seigneur et maitre ! Si vous ne décidez pas de sa mort, son histoire sera narrée à travers le royaume. Vous vous devez de respecter votre serment, il ne sera pas dit qu’une femme par la ruse, a eu raison du roi Ardachér !
-Tu as raison Vizir, demain la fille d’Urulien sera confiée au bourreau !
-Mon seigneur et maitre, si vous permettez à votre humble serviteur de s’occuper de sa mise à mort, elle sera noyée, et pour cela personne n’entendra parler de l’histoire de Pilas ou Néferti la fille du roi Urulien !
-Faites, faites fidèle vizir, demain en mon nom tu exécuteras Pilas !….
Le roi Ardachér regagna ses appartements, durant cette nuit-là, il rêva de Pilas,
la femme qu’il a aimé et qui portait dans ses entrailles, son héritier ou héritière et il avait ordonné sa mise à mort pour respecter son serment. Il se réveilla en sursaut, tout en sueur, il fit appeler son vizir Vishtapsa, son confident.
-Seigneur et maitre, votre serviteur est à vos ordres !
-Vizir faites lire les textes sacrés de Zarathoustra dans tous les temples, faites des offrandes à Ahra-Mazda, pour que les dieux nous comblent de leurs bienfaits, et qu’ils nous assurent la victoire. Et invoquez Ahra-Mazda et Mithra, faites allumer les feux sacrés dans tous les temples, donnez aux pauvres ce dont ils ont besoin !
-Seigneur et maitre, dormez en paix, tout ce que vous venez de dire, a été exécuté depuis le retour de votre envoyé !
-Fidèle vizir, tu penses à tout !
-Seigneur, vous semblez préoccupé !
-Fidèle vizir, je viens de voir en rêve Pilas !
-Maitre, chassez ce mauvais souvenir de votre mémoire, et pensez à la victoire contre la ville de Ctésiphon.
-Fidèle Vishtapsa, bonne nuit !
-Bonne nuit, seigneur !
****
Le lendemain l’armée d’Ardachér, prit la route en direction du royaume de Ctésiphon. Le siège de la ville dura un mois. Ardachér s’impatienta d’entrer dans la ville et de mettre à mort le roi de cette ville. Il fit convoquer ses généraux dans sa tente.
-Je vous donne deux journées, je veux la ville sous mes pieds le troisième jour !
-A vos ordres seigneur !
Le roi renvoya ses généraux et ne garda avec lui que le vizir et Gamenon.
-Vizir et toi Gamenon, je veux que vous promettiez de grandes récompenses aux soldats, pour les encourager à redoubler d’ardeur et de sacrifice, pour la prise de la ville.
-Seigneur, il sera fait selon vos ordres !
Vishtapsa et Gamenon sortirent de la tente royale, et laissèrent Ardachér dans ses méditations.
****
Le vizir vint lui rendre compte, de la mission dont le roi l’avait chargé, la mise à mort de Pilas ou Néferti la fille du roi Urulien.
-Maitre, vous n’entendrez plus parler de la fille d’Urulien !
-Alors racontes-moi fidèle vizir, comment as-tu procédé ?
-Maitre je l’ai emmené dans une barque, arrivés au milieu du fleuve, je l’ai jeté dans la partie la plus profonde du fleuve, après lui avoir attaché, les mains et les pieds !
-Fidèle vizir, je te remercie d’avoir mis fin aux jours de Pilas, et pour te récompenser de ta fidélité, le château d’Urulien et les terres qui l’entourent sont à toi!
-C’est trop pour moi seigneur, vous servir est un honneur pour moi, pour cela pardonnez-moi seigneur, de ne pas accepter les terres et le château. Et acceptez-moi comme votre fidèle serviteur !
Le lendemain Vishtapsa revint auprès du roi Ardachér, dans ses mains un coffret.
-Seigneur comme vous savez, je possède quelques biens, pour cela je vous confie, mon testament qui se trouve dans ce coffret, et vous prie humblement de partager mes biens entre mes enfants, comme stipulé dans le testament, seigneur je vous prie de ne faire ouvrir ce coffret qu’à ma mort !…
-Fidèle vizir, il sera fait selon ton désir !
-Seigneur et maitre, seigneur et maitre !….
-Qu’y a-t-il fidèle vizir ?
-Nos braves soldats sont entrés dans la basse ville, et assiègent le château du roi Orodès !
-Allons voir vizir, préparez mon cheval, pour que j’aille voir de près la défaite du roi de Ctésiphon !….
Ardachér franchit la porte sud de la ville aux milieux des acclamations de ses soldats. Le troisième jour ils entrèrent dans la forteresse. Orodès fut trouvé mort parmi ses soldats. Les cadavres jonchaient le sol.
Ardachér se proclama ‘’Roi des rois’’ et fit reconnaitre son autorité sur toute la Perse.
L’année 226 fut l’avènement de la dynastie des sassanides. Le roi Ardachér régna sur la perse mais il n’eut pas d’enfants.
En l’an 238 Ardachér tomba malade, il fit appeler son vizir.
-Vizir je suis sur la pente, je vais mourir et mon royaume tombera aux mains de gens, qui ne sont pas de mon sang, je regrette d’avoir ordonné la mort de Pilas, malgré toutes les femmes que j’ai épousé aucune ne m’a donné d’héritier, je crois que c’est la malédiction des dieux, qui est sur moi, car j’ai mis à mort la seule femme que j’ai aimé, et que j’aime encore, je regrette d’avoir décidé de la mort de mon aimée !
Le vizir voyant les regrets et le remord du roi Ardachér.
-Seigneur et maitre mon roi, Pilas est toujours vivante, et votre fils est un fort beau jeune homme !
-Comment que dis-tu Vizir ?
-Je n’ai jamais mis à exécution votre ordre, j’ai emmené Pilas dans mon domicile, ou elle a accouché d’un joli bébé, entouré de la tendresse de ma famille ; mes femmes et leurs filles. Votre fils a été confié aux plus grands maitres dans tous les domaines, il a reçu une bonne éducation, et comme vous le remarquerez c’est un fils de roi.
-Emmène le que je les vois !
-Non seigneur, je voudrais que ce soit vous qui le reconnaissiez parmi les jeunes de son âge.
Des jeunes habillés de la même façon, beaux, de même taille, furent emmenés devant le roi Ardacher pour jouer de la balle, le roi remarqua lorsque la balle échouait devant ses pieds, les jeunes ne se risquait pas à venir la récupérer sauf l’un d’eux, le roi remarqua sa beauté, son maintien droit, il crut reconnaitre Pilas, il lui demanda.
-Comment te nommes-tu ?
-Chahpuhr !
-Oui tu as raison, tu es mon fils !
Chahpuhr veut dire en persan ‘’Fils de roi’’. Le vizir n’avait trouvé plus noble nom que celui-là. Après qu’Ardachér ait reconnu son fils, le vizir lui demanda le coffret. Le vizir remit un parchemin au roi, c’était le témoignage des prêtres du roi, qui assistèrent à l’ablation totale des glandes génitales du vizir Vishtapsa, et sur sa demande en l’an 224, et le jour où le roi lui confia Pilas.
FIN votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 23 Décembre 2015 à 20:15
La Louve Normande
Alfgard du Cotentin

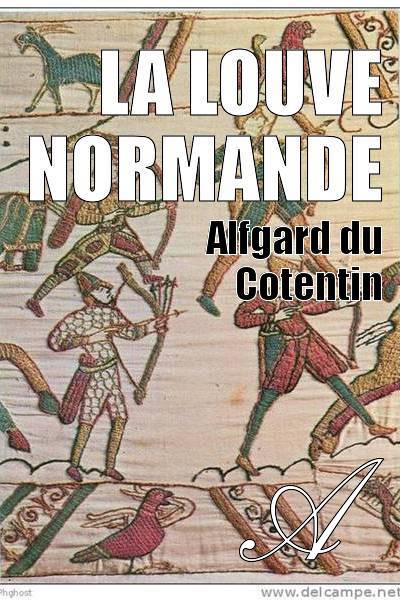
Chapitre 01 : Bêtises d’enfants
Hiver 1057 - Forêt de Soulles - Cotentin.
Un lapin courageux sortait son nez à la recherche de quelque nourriture sans se douter que plusieurs paires de yeux l’observent. Il avança vers la tige d’un perce-neige qu’il commença à grignoter de façon consciencieuse. Un choc l’arrêta et du sang coula sur son beau pelage blanc. Un cri de joie s’éleva d’un fourré et un adolescent de seize ans, une fronde à la main, se dirigea vers le rongeur. Soudain, le garçon cria de douleur et se tint le bras, il venait de recevoir une pierre à son tour. Il prit son poignard et cria : "Qui a fait ça, montrez-vous, espèce de lâche !
— C’est moi, espèce de voleur, répartit une fillette de onze ans, elle aussi armée d’une fronde !
— Comment cela ?
— C’est mon lapin, c’est moi qui l’ai eut !
— Comme si une gamine comme toi avait pu atteindre cette bête !
— As-tu retrouvé ta propre pierre ?"
Là-dessus, l’adolescent rechercha sa pierre gris clair qu’il trouva quelques pas plus loin ! Quant à la fillette, elle brandit fièrement sa pierre noire sur laquelle coulait du sang ! Le garçon s’approcha d’elle en sifflant !
— Tu es drôlement forte !!! Pourquoi utilises-tu des pierres noires ?
— Parce qu’elles se voient mieux sur la neige !
— Je me présente… Herulf, fils de Guillaume de Moyon
— Moi, c’est Alfgard, fille de Roderick de Briovère. Veux-tu que nous partagions MON lapin ?
— Oui, répondit-il en riant, allons à la vieille ruine !"
Elle opina de la tête et attrapa son lapin. Ils cheminèrent en silence plusieurs minutes et arrivèrent au pied d’une ruine celtique, un vieux rempart. Alfgard avait entendu son père parler d’une ruine encore plus grande dans le Nord du Cotentin, le Hag’Dik. Pendant qu’elle se mit à dépecer son gibier son compagnon cherchait du bois après avoir déposé son lourd manteau. La fillette en profita pour l’observer. Il était grand, très grand, encore un peu dégingandé. On pouvait néanmoins remarquer que sa musculature commençait à poindre sous sa chemise et ses hauts de chausses. Il avait des yeux bleus très clairs, des cheveux châtains parsemés de mèches blondes. Son visage montrait déjà l’homme d’autorité qu’il deviendrait à la maturité. Une mâchoire carrée, des pommettes hautes et un nez droit et anguleux complétaient un portrait très flatteur de ce bel adolescent. La fillette aussi était observée par le garçon. Il l’a trouvait mignonne. En tant que jeune mâle déjà pubère et ayant déjà eu des expériences, il avait suffisamment d’expérience pour déceler chez la fillette une beauté en puissance. Certes son habillement de garçon manqué, la crasse de son visage et sa fronde aurait pu lui faire détourner les yeux mais il avait ressenti que la femme n’allait pas tarder à poindre chez elle. Ses yeux étaient d’un bleu-saphir herminé d’or, sa longue tresse descendait dans son dos et de multiples de cheveux s’échappaient de son bonnet. Ses cheveux étaient d’un brun chaud, où courraient de nombreux reflets roux. Le froid donnait une belle couleur rose à ses joues fraîches, elle avait un petit nez droit et une petite bouche orangée. Alors qu’il allumait le feu, il leva les yeux et vit qu’elle le regardait aussi. Il sentit son bas-ventre se réchauffer et se morigéna en grognant. Alfgard lui amena le lapin qu’ils transpercèrent d’un bâton et le mirent à cuire au-dessus du feu. Herulf trouva quelques herbes gelées qu’il mit dans le feu afin d’en parfumer le lapin. Ils parlèrent un peu de leurs familles respectives, du Duc Guillaume que tous deux admiraient. Puis, une fois cuit, ils mangèrent le lapin assis côte à côte sur un tronc d’arbre. Alors que du jus de viande coulait au coin de ses lèvres, Alfgard fut surprise de sentir le pouce d’Herulf récupérer ce jus. Ils se regardèrent les yeux dans les yeux et le jeune homme se détourna en rougissant. Ils parlèrent de leurs passions, de leurs rêves. Herulf lui dit qu’il allait rejoindre la cour du Duc Guillaume comme écuyer de l’un de ses fils. La fillette s’écria : "Vous, les garçons, vous avez beaucoup de chance. Moi, on va m’envoyer dans un couvent pour parfaire mon éducation, comme dit mon père. Ma mère m’a appris à lire et à compter mais ils veulent que je sois plus érudite encore. J’aimerais tant être un garçon et pouvoir être un miles.
— Et alors, vous avez la vie facile !
— Quoi ? Les femmes doivent rester chez elles, se tuer à la maternité et à la tâche, elles ne peuvent pas aller où elles veulent, ni rien décider seules !
— Pourtant toi, tu es bien ici ! Ton père t’a laissé partir ?
— Non, J’AI décidé de partir hier quand ils m’ont dit pour le couvent !
— Mais alors, ils doivent te chercher ?
— Oui, sûrement !
— Tu es inconsciente… écoute, tu va venir avec moi chez mon père et il va prévenir tes parents !
— NON, hurla t-elle et prenant ses affaires, elle s’enfuit !
— Alfgard, reviens !"
Il lui courut après mais fut étonné de sa rapidité ! Parmi les arbres, elle disparut de sa vue. Pendant quelques minutes, il s’évertua à la chercher. Et soudain, il fut frôlé par un puissant cheval ! Il la vit prendre la route du Mont St Michel. Il courut rejoindre sa monture qui n’était pas loin et essaya de la rattraper. Après dix minutes de course, il la talonnait. Quand il entendit un lourd craquement ! Il vit Alfgard et sa monture sombrer dans une mare recouverte d’une fine pellicule de glace. Un instant, il ne vit ni l’un ni l’autre puis le cheval resurgit, il s’affola un peu et réussit à s’accrocher à la berge, il se hissa et sortit de l’eau en s’ébrouant. Herulf s’inquiéta de ne pas voir la fillette. Il sauta de son cheval et courut à la mare. Il vit le bonnet flotter et la pointe de la longue tresse. Sans plus réfléchir, il s’y accrocha et tira l’enfant par ses cheveux. Elle ne respirait plus et l’affolement le prit. Il la secoua, lui donna des claques et miraculeusement elle inspira, elle se mit à trembler, elle le regarda mais son regard devint vitreux et elle s’évanouit. Ni une ni deux, il l’enveloppa dans sa propre cape, monta sur son cheval, prit la bride de celui d’Alfgard et partit à brides abattues vers le château de son père qui n’était qu’à une petite demi-heure. Après une longue galopade qui lui parut durer une éternité, il vit les immenses remparts de bois qui ceignait la motte où son père avait construit son donjon. Les soldats de son père le reconnurent et le laissèrent passer. Il sauta de cheval et confia les bêtes au palefrenier et entra en trombe dans le logis familial qui se trouvait au pied de la motte.
"Père, mère, il s’agit de la fille du Baron Roderick de Briovère, elle est tombée dans une mare glacée
— je m’en occupe mon fils, rétorqua sa mère Ottilia"
Pendant que sa mère s’occupait d’Alfgard, Herulf expliqua tout à son père qui s’empressa d’envoyer un messager au père de la fillette.
Ce dernier arriva dans la nuit et fut chaleureusement accueilli par les Moyons. Après une brève explication de la part d’Herulf, Roderick alla au chevet de sa fille. Elle était fiévreuse et délirante. Elle y exprima son chagrin de quitter sa famille et sa rage de n’être qu’une femme. Son père lui tenait la main. Au matin, alors que sa femme l’avait rejoint au chevet de l’enfant, celle-ci se réveilla. "Maman…
— Ma petite chérie… nous avons eu si peur ! Pourquoi t’es-tu enfuie ?
— Parce que je ne veux pas aller au couvent !
— Voyons, tu sais que c’est pour ton bien… et que tu es appelée à un grand destin !!!
— Quel grand destin ?
— Celui que ton éducation te permettra de choisir !
— Ah oui ? Chambellan du Duc ? Ambassadeur ?
— Bien sûr que non, soit raisonnable !
— Épouse soumise d’un seigneur, révérende mère d’une quelconque abbaye, dame de compagnie d’une grande dame ?
— Pourquoi cherches-tu à tout déformer ? Mon mariage avec ton père est heureux et empreint de partage, tes tantes Gislinde et Helga sont respectivement Mère Supérieure de l’Abbaye de Bernay et Dame de Compagnie de la Duchesse Mathilde et épouse du Comte de Néel, elles sont heureuses et proches du pouvoir !!!
— Mère, tu sais ce que j’aimerais être….
— Non, Alfgard, cesse d’en parler… tu peux te former à être archer ou miles mais tu ne le seras pas ! C’est impossible !"
Là-dessus, la fillette se mit à bouder. Même si elle savait que sa mère avait raison, elle souhaitait vivre comme elle l’entendait. Cette volonté de fer lui venait de ses ancêtres scandinaves et se retrouvait en chacun des membres de sa famille ce qui occasionnait de nombreuses discussions houleuses. Ainsi ses parents, Roderick et Ragnhild devaient sans cesse batailler avec leurs cinq enfants !
Après deux jours de convalescence, Alfgard était prête à repartir avec sa famille pour ses terres de Briovère. Le jour du départ, ils étaient tous réunis dans la grande salle du logis du seigneur de Moyon.
Guillaume et Roderick s’empoignèrent virilement l’avant-bras, pendant qu’Ottilia et Ragnhild s’enlacèrent affectueusement. Leurs enfants furent bien plus timides et ne se firent qu’un signe de tête. Roderick : "Nous devons y aller, je te remercie Guillaume de nous avoir accueillis chez toi ces 2 jours.
— Allons, mon ami, cela va de soi, tu en aurais fait tout autant !
— Oui, mais mes enfants sont plus intrépides et tête en l’air que les tiens ! Et je ne crois pas que ta fille se serait enfuie comme cela !
— Détrompes-toi, avant que nous accordions sa main au jeune Ulric, elle s’était enfuie avec lui !
— Grâce au ciel, ils sont mariés maintenant, rétorqua Ottilia
— Ma pauvre amie, entre nos enfants et nos gens nous voilà bien, répliqua Ragnhild,
— Oui, c’est ce fichu sang viking… s’esclaffa Roderick, auquel le rire de Guillaume répondit en écho !
— Allez… à vous revoir, reprit-il !"
Finalement, ils montèrent à cheval et reprirent la direction de Saint Laud. Alfgard qui se trouvait à l’arrière se retourna et vit Herulf, en haut du donjon, lui faire de grands signes du bras. Son cœur se serra car elle savait que ne le reverrait pas de sitôt.Chapitre 02 : Premiers émois
Printemps 1066 – Domaine de Moyon - Cotentin.
La Grande Motte de Moyon, on l’appelait ainsi car c’était la plus grande de la région, grouillait de monde. Des guerriers à pieds, des chevaliers et de nombreux écuyers s’affairaient. Plus haut au dessus de la Motte, une vaste étendue de terre servait de campement et un stock impressionnant de troncs d’arbres attendait d’être débités en planche par les menuisiers du Seigneur de Moyon. On pouvait le voir vêtu d’une magnifique tunique verte aux broderies étincelantes. Il recevait de très nombreux seigneurs du Cotentin dont son meilleur ami Roderick de Briovère. En effet, il avait reçu mission du Duc Guillaume de mander le ban et l’arrière-ban afin de recruter les barons prêts à suivre leur Duc afin que celui-ci puisse prendre possession de son héritage que son cousin Harold lui avait volé. Cet héritage n’était autre que l’Angleterre. Guillaume de Moyon avait aussi reçu la mission de fournir quantité de bois afin que les charpentiers du Duc puissent fabriquer des esnèques, ces fameux navires appelés aussi Drakkars. Certains barons étaient venus avec leurs familles. Ce n’était point encore la guerre mais une sorte de rassemblement d’information. C’est alors que le Seigneur des lieux, accompagné de son fils, monta sur une petite estrade et leva les bras pendant que son héraut souffla dans son cor. L’assemblée se tut et écouta Guillaume : "Mes amis, mes seigneurs… le Duc Guillaume m’a mandé afin que vous l’accompagniez en terre saxonne. Vous connaissez tous le parjure qu’a commit Harold le Saxon. Notre Duc veut le punir pour sa forfaiture et reprendre le trône d’Angleterre que le défunt Roi Édouard le Confesseur, par droit de naissance, lui avait attribué. Il nous attend tous au début de l’été en ses terres de l’embouchure de la Seine ….. Il m’a demandé aussi de lui fournir de grosses quantités de bois pour fabriquer des navires et des menuisiers et des charpentiers. Pour ces derniers, je manque beaucoup de bras, j’aurais besoin de vos bûcherons et de vos menuisiers pour couper les arbres de ma forêt de Soulles. Quant à vos charpentiers, ils iront rejoindre les miens et le Duc à Saint Clerc sur Epte. Mes clercs attendent votre bon vouloir en bas à mon donjon. Je vous remercie de m’avoir écouté et maintenant avez-vous des questions ?
— Oui, moi, Robert de Néel… Par cette guerre, Guillaume va gagner le trône d’Angleterre mais nous qu’y gagnerons-nous ?
— Il promets à chacun d’entre-vous ayant déjà des terres ici, un domaine d’égal surface ou supérieur, aux autres un domaine leur permettant d’en vivre ! Toutes ces terres seront prises aux saxons et vous devrez vous battre pour en combattre les dernières poches de sédition.
— Moi, je suis le Seigneur de Brix, je voudrais savoir si le Duc compte nous donner des terres dans le Nord ?
— Alors, vous m’en demandez plus que je ne sache !
— Je voudrais savoir s’il n’y aura que des normands à le rejoindre ? demanda Roderick de Briovère
— Je sais qu’il a fait mandé des gens de Bretagne, de Flandre et nombres de mercenaires. Plus de questions ? Bien un banquet vous attend pour ce soir !"
Guillaume et Herulf descendirent de l’estrade et allèrent rejoindre Robert de Brix et Roderick de Briovère. Ce dernier était accompagné d’une magnifique jeune femme. Herulf ne pouvait quitter son visage et ses yeux restèrent fixés au regard saphir. C’était une jeune femme d’environ vingt ans au regard franc et hardi, ses longs cheveux formaient une tresse épaisse lui descendant en dessous des reins, son front était ceint d’un cercle doré. Elle portait une chemise de lin fin et une robe de laine verte finement brodée. Plus il s’approchait d’elle plus son cœur palpitait.
— "Roderick mon ami, et la belle damoiselle Alfgard… à ces mots Herulf écarquilla les yeux, comment allez-vous ?
— Je me porte comme un charme malgré mon grand âge et ce printemps pluvieux !
— Je vais bien monseigneur, sourit la jeune femme !
— Que je vous présente mon fils, vous ne l’aviez pas revu depuis ce fameux incident !
— Damoiselle, dit Herulf, je suis enchanté de vous revoir, en tenant longuement la main d’Alfgard, plus longuement qu’il n’était nécessaire.
Les deux pères et leur ami de Brix ne furent pas sans remarquer que les deux jeunes gens étaient fortement attirés l’un par l’autre.
— Herulf, veux-tu bien faire visiter le domaine à Damoiselle Alfgard ?
— Oui, père, vous venez, Alfgard ?
— Nous allons pouvoir, mes amis, parler organisation, dit Guillaume en s’adressant à Roderick et Robert.
Les deux jeunes gens commencèrent leur balade. Ils se regardaient sans cesse, et incapables de dire un seul mot. Herulf était en train de se dire que son intuition sur le devenir de la jeune femme s’était avéré exacte c’était une beauté normande. Ses yeux étaient lumineux, les reflets roux de sa chevelure brune jetaient mille feux, de légères tâches de rousseur parsemaient le dessous de ses yeux. Il se mit à imaginer dans ses bras, dans un lit, nue et offerte et sa luxuriante chevelure étalée sur sa couverture en fourrure de loups blancs provenant des lointaines forêts scandinaves. Il imagina sa gorge offerte à ses baisers, ses seins….
— Alors, votre séjour auprès de notre Duc fut-il instructif, dit Alfgard le détournant ainsi de ses sensuelles pensées.
— En fait, je n’étais pas à son service mais à celui de Robert de Mortain.
Pendant que le jeune homme évoquait sa vie à la cour ducale normande, la jeune femme se prit à l’observer. Il avait grandit en taille et possédait une musculature et une crinière dignes d’un farouche guerrier viking. Quand il l’avait prise par le bras, elle s’était retenue de frissonner. Ses yeux bleus couleur glacier la fascinait et elle ne pouvait s’empêcher de regarder ses lèvres qu’elle trouvait gourmandes. Certes, elle avait connu de nombreux flirts mais aucun homme ne lui avait fait un tel effet. Était-ce les souvenirs d’enfance ou sa simple maturité sexuelle qui l’attiraient vers lui ? Elle se morigéna et écouta à nouveau sa conversation.
— … et notre Duc m’a promis des terres en Angleterre
— Oui, comme aux autres, je me demandais si seuls les seigneurs et fils de seigneurs auront droit aux terres ou si de simples archers peuvent en espérer ?
— Je ne crois pas que les archers aient droit à quoique ce soit !
— Pourtant, ils sont décisifs dans une bataille !
— Certes, et d’ailleurs, je commanderais une compagnie d’archer mais leur rang ne leur permet guère d’espérer à peine plus qu’un petit lopin de terre à cultiver !
— C’est absolument injuste !
— Toujours la même passion !
— Bien sûr ! J’adore ce corps d’armée et les armes de jets et je suis meilleure que bien des hommes !
— Vrai ? Me montreriez-vous cela ?
— Allons-y !
Arrivés sur le pas de tir qui avait été installé pour l’occasion du jour, Herulf lui tendit un des arcs les moins puissants.
— Montrez-moi alors !
La jeune fille encocha et tira six flèches à suivre et stupéfia doublement le jeune homme par sa vitesse et par sa précision. Il l’emmena dans le bois environnant et lui demanda de tirer un lapin en souvenir de celui qu’elle lui avait ravi sous le nez. Elle en tira plusieurs et réussit même à tuer une jeune biche. Il ne proposa pas de la tester à la fronde sachant qu’elle possédait déjà ce talent à onze ans. Il était éperdu d’admiration envers elle. Non seulement, elle était belle, intelligente mais aussi talentueuse et modeste. Il se dit qu’il était en train de tomber amoureux. Alors qu’il la ramenait vers le donjon, sur l’espace libéré à cet effet de nombreuses tablées avaient été dressées afin d’accueillir la noblesse présente. Tout autour de ces tablées, de nombreuses torches et lampes à huile de phoque ou de baleine, provenant de Norvège, étaient installées. Il lui fit visiter les nouvelles habitations que son père avait fait construire. Il y avait une grande maison qui serait la sienne lorsqu’il se marierait. Il fit entrer Alfgard dans sa maison, son cœur rata un battement tellement il lui sembla évident que ce devait être "sa" maison à elle. N’osant lui avouer cet élan du cœur, il lui décrit la propre habitation du duc et de son épouse Mathilde.
— C’est une maison magnifique qui respire le pouvoir mais très sobre, j’aimerai pouvoir vous y emmener.
— J’aimerais beaucoup y aller d’autant que ma tante Helga y est dame de compagnie de la duchesse.
— Vous plairait-il d’y être vous aussi ?
— Pas vraiment, à moins que mon futur époux soit un proche de Notre Duc et que ce soit la seule façon de rester à ses côtés.
— Justement, je me demandais comment il se faisait que vous ne soyez point encore mariée ?
— Vous connaissez mon caractère et mes désirs ! Mes parents ont pourtant bien essayé de me marier à plusieurs reprises mais je n’ai point trouvé l’homme qui me donnera l’impression d’être aussi importante que lui !
— Vous êtes pourtant de toute beauté !
— Comment cela ? Mon aspect devrait être décisif dans le choix d’un homme de m’épouser ? Mon esprit et mes capacités compteraient donc pour si peu ?
— Je sais ce qu’un homme doit vouloir trouver chez vous mais que cherchez-vous chez un homme ? dit-il en lui désignant un siège.
— Cet homme, s’il me protège, ne devra pas me brimer. Il ne devra pas dénigrer mes idées et mes projets en public. Il devra m’aimer sans contrepartie, rétorqua t-elle une fois assise.
— L’amour !? Voyons, des couples comme notre Duc et sa Dame sont rarissimes. Le mariage n’est pas affaire d’amour.
— Vous ne croyez pas à l’amour ? Pourtant vos parents en ont été la preuve de son existence.
— Oui, mes parents s’aimaient mais je n’oublie pas que mon père n’a attendu que six mois pour la remplacer après sa mort.
— Cela ne veut pas dire qu’il n’aimait pas votre mère. Aime t-il sa nouvelle compagne ?
— Non… effectivement…
— Et vous que cherchez-vous chez une femme ?
— Ce que tout homme recherche chez une épouse : fidélité, obéissance, de lui donner des fils, dit-il en s’asseyant par terre à ses pieds.
— Brrrr, certes je souhaite être fidèle et avoir des enfants mais l’obéissance.
— Il est vrai que vous n’y êtes guère habituée, ria t-il
— Cela vous semble t-il rédhibitoire ?
— Je ne sais pas… excepté peut être si l’on tombe amoureux de vous.
— Et vous pourriez-vous tomber amoureux de moi, sourit-t-elle en se penchant vers lui
Dès qu’il croisa ses yeux, il ne put s’en détacher, il se dit que ses paroles précédentes, où il affirmait ne pas croire en l’amour, volaient en éclat et qu’il était bel et bien en train de tomber amoureux. Il en était sur maintenant, elle deviendrait sa femme. Fallait-il lui en parler ? Ou aborder le sujet avec leurs pères respectifs ?Chapitre 03 : Préparations
Été 1066 – Embouchure de la Dive.
Une grande jeune femme déambulait parmi les nombreuses tentes élevées dans l’immense vallée. Jamais de mémoire de normand, on avait vu une telle armée réunie. L’organisation typique et compétente des hommes du Duc Guillaume était mise en application. Elle avait pu remarquer sur son trajet des secteurs très spécialisés. Elle vit ainsi une grosse partie du terrain dévolue aux animaux de bouche, des moutons, des porcs, des chèvres, de la volaille et du gibier étaient parqués et un stock impressionnant d’aliments pour bestiaux était amoncelé. Plus loin, c’était des tonnes de troncs d’arbres, provenant des forêts entre autre du père de son fiancé, qui s’entassaient et étaient déjà travaillées par les menuisiers et les charpentiers. On y fabriquait les coques des esnèques. A côté, avaient été installés des ateliers de facteurs d’arcs. Des présentoirs entiers étaient surchargés par des dizaines de flèches et d’arcs.
La jeune femme s’arrêta quand elle vit la tente arborant les "armes" des Moyon qui se trouvait à côté de celle de son propre père. Elle entra dans cette dernière.
— Bonjour, Père !
— Alfgard, te voilà enfin !!! J’ai crains que ton voyage ne se soit mal passé.
— Père, entre l’escorte que vous m’avez fournie et mes talents d’archer, vous savez que je n’ai rien à craindre.
Son cœur lui donna l’impression de sortir de sa poitrine lorsqu’elle vit alors s’approcher un homme blond à la silhouette musclée. C’était celui qui était son fiancé depuis ce printemps. Il lui attrapa la main qu’il embrassa avec gourmandise puis lui prit ses lèvres en un baiser profond et langoureux. Leurs pères respectifs se mirent à toussoter.
— Vous n’êtes pas tout seuls, jeunes gens… Attendez votre mariage !!!
— Mais père…
— Herulf, je te préviens… pas de More Danico ! Tu sais, ce qu’en pense Notre Seigneur Guillaume !
— Oui, père ! Je respecterai ma fiancée.
Alfgard regardait amoureusement Herulf et se dit que le More Danico[1] ne serait pas si détestable. Surtout que le départ et la guerre pour l’Angleterre risquaient de le tenir éloigné d’elle on ne peut plus longtemps… De nombreuses fois, chez eux, dans le Cotentin, elle avait failli se donner à lui. Elle ne comptait plus les promenades à cheval ou à pied dans les bois qui les avaient emmenés dans les fourrés, ou le long des ruisseaux qui serpentaient dans leur pays. Les mousses tendres et accueillantes avaient failli leur faire commettre l’irréparable. Leur sang viking était on ne peut plus bouillant et ne se trouvait guère affadit par l’apport français même si de nombreuses générations étaient passées depuis l’arrivée de Rollon, le premier Duc.
Le Cotentin était le dernier bastion du sang, des coutumes et du langage viking. Nombre de petits barons avaient conservé la vieille religion de leurs ancêtres, et se partageaient entre elle et le catholicisme. Il n’était que de voir leurs noms, les prénoms de leurs enfants et de leurs domaines. C’était aussi dans le Cotentin que les plus irascibles et les plus velléitaires barons déniaient le droit au Duc Guillaume de diriger la Normandie. Pour beaucoup d’entre-eux, il resterait toujours Guillaume le Bastard. Combien de frondes étaient parties de ce coin reculé de la Normandie ? Le Duc s’en méfiait grandement.
Son père, son fiancé et son futur beau-père avaient continué leur conversation sans plus lui attacher d’importance que cela. Alfgard détestait cela. Elle avait tout de même escorté une nouvelle cargaison de bois pour le Duc. Las, elle savait que les moments où sa personne aurait de l’importance, ce serait quand elle se marierait et quand elle serait grosse et accouchée. Elle se demandait parfois si elle n’entrerait pas plutôt au couvent. Or, elle savait sa nature trop sensuelle et passionnée pour supporter de rester enfermée entre quatre murs. Sa mère déplorait sans cesse que sa fille parcourt la campagne normande comme une "guerrière", armée et en chasse !
Elle écoutait attentivement les hommes discuter des plans d’attaque du Duc. Elle savait qu’un sien cousin participait à une autre forme de "bataille". Leur Seigneur avait instauré un réseau très fourni d’espions d’une très grande efficacité. Évidemment, seuls quelques barons en étaient informés et Alfgard s’étonnait qu’ils ne s’en cachent pas devant elle. Elle se demandait si c’était la confiance ou l’indifférence. Elle préféra ne pas demander. Elle alla s’installer sur la couche de son père. Elle s’y endormit très rapidement.
Dieu qu’elle avait chaud ! Était-elle trop couverte ? L’été était-il trop chaud ? Quand Alfgard sentit de grandes mains caresser sa nuque et remonter le long de ses cuisses, elle se mit à gémir. Elle entrouvrit alors ses yeux bleus sur ceux plus clairs de son fiancé. Herulf prit alors la bouche de la jeune femme. Il insinua sa langue expérimentée et dansa un ballet avec celle de sa compagne. Il était quasiment allongé sur elle et la submergeait de sa chaleur animale. Elle devinait à l’odeur qu’il venait de monter à cheval. Elle adorait ce qu’elle sentait. C’était un mélange de cuir, de cheval et d’homme. Elle se pâmait quand il portait ce "parfum". Il n’avait pas arrêté son baiser langoureux et qui devint encore plus invasif. N’y tenant plus, elle s’accrocha à sa nuque puis plaqua sa poitrine contre le torse du guerrier. Elle bougea ses mains et enfonça ses ongles dans le dos musclé. Ils se mirent à gémir. Il lâcha sa bouche et elle laissa sa tête tomber en arrière. Tandis qu’il posa ses lèvres sur la gorge blanche, sa main droite avait atteint l’intérieur des cuisses élancées. Elle avait depuis longtemps fermé les yeux tout à son plaisir. Ses mains cherchèrent le contact de la peau de son amant. Elle ouvrit sa tunique et les y glissa. Il était couvert de sueur mais cela ne la gênait pas. Ils commençaient lentement à se déshabiller l’un l’autre quand une voix se fit entendre.
— Heum, heum…
C’était le père de la jeune femme qui se tenait sur le pas de la tente. Il rabatta le pan de l’entrée afin de cacher le jeune couple. Herulf recouvrit sa compagne d’une fourrure puis se releva, se rhabilla et s’adressa à Roderick.
— Je ne vous dirais pas que je suis désolé ou que je m’excuse, ce serait mentir !
— Mon jeune ami, ma fille ne sera pas une frilla ! Alors vous veillerez à vous tenir éloigné le plus possible d’elle en attendant vos épousailles.
— Je… ferais… mon possible mais elle est si désirable !
— Je vous prie… c’est de ma fille dont vous parlez !
— Oui ! Je sais qui elle est !
— Dites-donc pourriez-vous arrêter de parler de moi comme si je n’étais pas là ! Intervint Alfgard.
— Oh non, s’il te plaît, ma fille, calme-toi !
— Me calmer, me calmer ! Père, vous savez combien je suis "sensible" sur le sujet de mon importance…
— Oh oui, je sais ! S’il te plaît, ma chérie ! Ne t’énerves pas !
— Bon ! Vois-tu, je me suis rajustée !
— Quel caractère ! Souffla Herulf !
— Oui, ta fiancée a du caractère et tu devras bien veiller à y faire attention !
— Je te jure que je ferais attention à toi, Mon Alfgard !
— Tu as intérêt ! Dit-elle avec une moue boudeuse.
Des servants arrivèrent alors avec des plats. Ils dressèrent une table et posèrent les aliments ainsi que des tranchoirs, des couverts et des hanaps. Le père de Herulf vint les rejoindre et ils s’attablèrent. Le repas fut convivial et animé. Aux dires des deux pères, la jeune femme se dit qu’elle ne reverrait pas son fiancé avant au moins un an. Comment ferait-elle pour tenir aussi longtemps ? Elle ne le pourrait pas. Laissant les hommes discuter âprement sur les stratégies du Duc, son esprit vagabonda vers un projet audacieux et dangereux. C’était décidé, elle n’attendrait pas son futur sagement assise au domicile de celui-ci comme le voulait la coutume. Non, il ne serait pas dit qu’une Briovère se cloître en attendant le retour de son aimé.
Suivre cette oeuvre (pour être averti lorsque la suite sera publiée) votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 23 Décembre 2015 à 19:52
Les Princesses d'amour : courtisanes japonaises
Judith Gautier

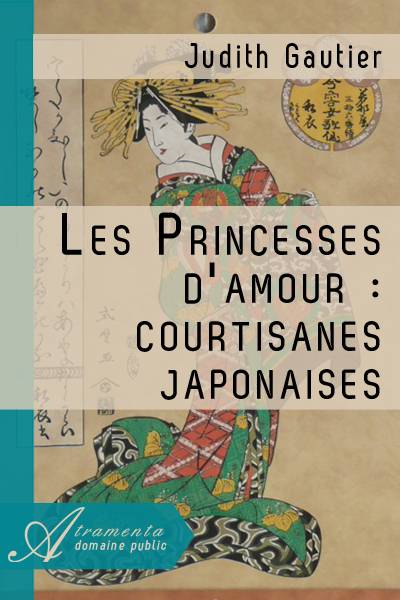
LE DAÏMIO DE KAMA-KOURA
— Si mes amis de Tokio, me voyaient ainsi, le nez vers la terre, accroupi très humblement devant le daïmio et sa noble épouse, ils me trouveraient bien peu moderne, pas du tout « dans le train », comme l’on dit à Paris, à ce qu’il paraît, et ils se moqueraient de moi. J’ai tout à fait l’air d’un samouraï du temps féodal, prosterné devant son seigneur… Il est vrai que notre féodalité, à nous, régnait encore il y a vingt-cinq ans à peine et que, moralement, je suis toujours vassal de mon prince dans cette cour très arriérée. Kama-Koura n’est pas Tokio, hélas !
C’est par la cervelle joyeuse du jeune étudiant Yamato, que passaient ces réflexions, tandis qu’accroupi, les mains sur les cuisses, la tête courbée sur sa poitrine, il écoutait, d’un air profondément respectueux, la communication que lui faisait, d’une voix lente et solennelle, le vieux daïmio de Kama-Koura.
Le prince était assis par terre, sur une natte blanche, devant un beau paravent à fond d’or fleuri de pivoines, et à côté de lui, debout, la princesse, sa femme, s’éventait avec agitation.
— Ce matin même, disait le daïmio, la mère de mon fils, s’est présentée devant moi, et m’a parlé de la sorte : « Monseigneur, avez-vous remarqué combien notre cher San-Daï est pâle, comme ses yeux se creusent, comme il se traîne d’un air las, en marchant, et quel pli trop grave crispe sa jolie bouche, faite pour le rire ? » Alors j’ai répondu « Oui, princesse, j’ai remarqué tout cela depuis longtemps, et j’ai jugé que notre unique enfant s’adonne trop exclusivement à l’étude, que l’heure est venue pour lui d’être un peu fou et dissipé, comme le sont les jeunes hommes de son âge. Je le lui ai fait entendre plusieurs fois, l’autorisant à s’amuser à sa fantaisie ; mais il m’a répondu « La vie est courte, la science infinie ; pourquoi gaspiller un temps si bref en de frivoles plaisirs ? » J’ai insisté, autant que cela était possible sans compromettre ma dignité paternelle ; San-Daï n’a pas voulu comprendre, et plus que jamais il s’acharne au travail. Nous avons pensé alors, ma noble épouse et moi-même, que vous, son camarade d’étude, vous, qui êtes aussi gai qu’il est grave et qui parvenez quelquefois à le faire rire, vous trouverez peut-être le moyen de l’arracher à cet état, que le médecin déclare dangereux, et à le distraire, presque malgré lui. Voyons, qu’imaginerez-vous pour forcer mon fils à s’amuser ?
— Monseigneur, dit Yamato, en relevant le front, si Votre Altesse le permet, j’emmènerai le prince San-Daï à Tokio et je le conduirai au Yosi-Wara.
En entendant cela, la princesse redressa sa tête pâle et orgueilleuse, en s’éventant encore plus vite ; mais le vieux seigneur souriait, et clignait les yeux d’un air fin.
— Le Champ des Roseaux ! dit-il, j’y suis allé dans ma jeunesse : c’était un lieu aussi réjouissant que magnifique.
Et posant sa pipette d’or sur l’accoudoir, le prince tirailla entre ses doigts le pinceau de poils qu’il avait au menton, en faisant claquer plusieurs fois ses lèvres.
À ces symptômes, Yamato reconnut que son seigneur allait les honorer d’un discours, et, pour l’écouter avec tout le respect qu’on lui devait, il s’assit sur ses talons et se cala le plus commodément qu’il put.
La princesse ferma son éventail, ouvrit la bouche pour dire quelque chose ; mais le daïmio, de son doigt levé, refréna cette révolte contre l’étiquette. L’épouse se mordit les lèvres, ne parla pas.
— C’est la volonté d’un grand homme d’état, commença-t-il, d’un réformateur, trop audacieux à mon avis, qui, dans un but politique, a créé de toutes pièces, voilà tantôt deux cents ans, ces princesses d’amour, qui peuplent le Yosi-Wara. Fleurs de luxe, de charme et de beauté, qu’on cultive encore aujourd’hui, et qui seront bientôt les seuls vestiges du Japon splendide d’autrefois. Elles disparaîtront aussi, comme tout le reste, hélas ! …
Yamato allait se relever, croyant que c’était tout, le daïmio ayant fait une pause, pour expirer quelques soupirs. Mais il reprit :
— C’est le fameux usurpateur Tokougava Hieyas, des Minamoto, vous l’avez deviné ; c’est lui, lui dont la dynastie a donné des shoguns à l’empire, jusqu’à la récente révolution. Vous savez combien Hieyas fit d’efforts, pour amoindrir notre pouvoir, à nous princes souverains, au profit de son pouvoir, à lui. Il n’y a que trop réussi, et, de ce qu’il avait semé, la révolution, après deux cents ans, est le fruit mûr. Lors de son avènement, il exigea des princes, qu’ils vinssent séjourner à Yédo, la nouvelle capitale, plusieurs mois de l’année, avec leurs épouses, dont le luxe devait donner de l’éclat à la cour, et dont les personnes précieuses pouvaient être retenues comme otage, si quelque malentendu survenait. Mais les fières princesses, restaient dans leurs châteaux ; et, s’ils ne pouvaient éluder l’ordre, les daïmios n’étaient présents que de fait, dans la capitale, le cœur et l’esprit ailleurs, abrégeaient leur séjour.
Décidément c’était long. Yamato s’assit tout à fait par terre, tandis que la princesse rouvrait son éventail et l’élevait jusqu’à sa bouche, pour bâiller.
— Quelle perfide et géniale invention ! s’écria le vieux seigneur, dans un geste large, qui déploya le brocard agrémenté de roues d’or, de ses grandes manches à l’ancienne mode, d’artificielles princesses, choisies parmi les beautés les plus rares, élevées dans tous les raffinements du goût aristocratique ; instruites des rites et de l’étiquette, savantes, virtuoses en tous les arts ! Jeunes, toutes ! passionnées, dangereuses, enivrantes et… accessibles ! Les princes virent-ils le piège ? en tous cas ils s’y laissèrent prendre et tombèrent dans les filets de soie. Il ne fut plus question de corvée ; le séjour dans la capitale leur devint particulièrement agréable ; ils s’y attardèrent même, au delà du temps prescrit. Dans leurs lointains châteaux, les vraies princesses ne comprirent pas tout de suite le danger. Jadis, il est vrai, la courtisane avait été un être d’élection, une rivale redoutable chantée par les poètes ; mais il y avait loin de cela, et les hautaines épouses, n’eurent que du dédain pour ces, marchandes de sourires, susceptibles de distraire un instant leur seigneur. Celles qui virent le péril, accoururent, pour s’efforcer de défendre leur bien. À beaucoup des autres, le désastre du bonheur et de la fortune, ouvrit les yeux trop tard. Le proverbe qui dit : « la courtisane est la destructrice du château » date sans doute de ce temps.
— Alors, dit la princesse en soulevant sa lèvre d’un air de dégoût, l’on continue à élever avec autant et plus de soin même que nos enfants, des filles de rien, à qui l’on rend des honneurs, comme aux femmes du plus haut rang, ce qui, à mon avis, fait peu d’honneur aux hommes.
— Ma chère, rien ne distingue ces personnes des vraies princesses, si ce n’est pourtant qu’elles sont plus belles, dit le daïmio avec malice. Ah ! quelles causeries avec elles, dans le langage fleuri des années Yngui, quand régnait le mikado Atsou Kimi[1] ! le glorieux passé revit, auprès d’elles, et l’on est tout émerveillé !
La princesse faisait de grands efforts, pour dissimuler sa colère, Yamato glissait, en dessous, un regard vers elle et se retenait de sourire.
— Vous l’avez dit vous-même, monseigneur, dit-elle ; « La courtisane est la dévastatrice du château » n’allez pas jeter votre fils en proie à cette bête vorace.
— Mon fils a trop d’esprit pour se laisser dévorer, dit le prince ; ce qui m’inquiète plutôt, c’est l’idée qu’il ne consentira pas à suivre Yamato, dans la cité d’amour. Comment le déciderez-vous à se laisser conduire ?
— Monseigneur, dit Yamato, notre cher prince n’a guère quitté Kama-Koura. En dehors de ses livres et de son château, il ne connaît rien ; il me sera facile de lui faire croire tout ce que je voudrai.
— Que lui ferez-vous croire ?
— Par exemple, qu’un prince, très savant, a découvert un manuscrit, inédit, de quelque grand philosophe chinois, et que nous l’allons prier de nous communiquer le précieux document…
— Ah ! ah ! un philosophe chinois ! s’écria le daïmio, avec un éclat de rire ; il est certain, qu’aux trousses de ce philosophe, vous le feriez aller au bout du monde, tandis qu’il ne tournerait pas le nez, pour voir la plus belle des fleurs vivantes.
— Et que ferez-vous, s’il tourne le dos, au prince très savant, changé en courtisane ? demanda la princesse.
— Une fois là, je me confierai au dieu de l’amour, Altesse, dit Yamato ; la science de la femme est de plaire. Cette science-là, en vaut bien une autre.
— Allons, rendez-vous auprès de mon intendant, dit le daïmio, il vous remettra une somme importante, afin que vous puissiez mener à bien cette jolie équipée.
TOKIO MODERNE
Le résultat de cette conférence secrète fut que le jeune prince San-Daï, et son malicieux camarade, arrivèrent à Tokio, le soir même de ce jour, par la gare de Simbassi.
Arrêté au bord du trottoir, San-Daï regardait, vaguement, la perspective de la rue, bordée de réverbères et de poteaux télégraphiques, tandis que son compagnon donnait aux domestiques, venus avec eux, des ordres pour le transport des bagages.
— Crois-tu, vraiment, que le prince consentira à me laisser voir ce précieux fragment ? demanda San-Daï, quand Yamato l’eut rejoint ; si je n’obtenais pas cette récompense, je regretterais d’avoir entrepris, ce fatigant voyage.
— Vous êtes fatigué ! s’écria Yamato ; à peine avons-nous roulé trois heures et vous avez pris, il me semble, un grand plaisir à regarder la campagne fleurie, en écoutant mes bavardages.
— C’est possible ! Quand on ne le surveille pas, l’esprit se laisse trop aisément distraire… Mais souviens-toi que, pour te suivre, j’ai interrompu une lecture qui me passionnait.
— Hélas l’ouvrage, en soixante volumes, d’un commentateur des See Chou !
— Je n’avais lu que trois chapitres.
— Patience, le livre, que je veux vous faire lire, est autrement intéressant que celui-là.
— Je le crois bien, un fragment inédit de Meng-Tze ! Mais pourquoi ris-tu en disant cela ?
— Je ne ris pas, je fais signe à un homme-cheval d’approcher son véhicule.
— Ne passons-nous pas à l’hôtel, pour changer de costume ?
— Nous sommes très bien comme cela, dit Yamato, là, où nous allons, on aime la simplicité.
Arrivant de province, les deux jeunes gens étaient vêtus à la japonaise, ce qui n’est pas trop ridicule encore, même à Tokio.
Plusieurs djinrichichas s’étaient rangés le long du trottoir. Yamato fit monter le prince dans l’un d’eux et monta dans un autre, après avoir dit un mot, tout bas, aux coureurs, qui s’élancèrent bon train.
Ils traversèrent tumultueusement la ville, à travers l’encombrement des rues ; puis, dans les quartiers plus tranquilles, roulèrent de front, presque sans bruit, purent échanger quelques mots, à voix haute.
— Comme c’est loin ! disait le prince.
— Nous voici à moitié route, répondait Yamato.
C’était de plus en plus solitaire et inhabité. Ils arrivèrent à des rizières, qui n’en finissaient pas.
— Crua ! crua ! s’écria Yamato, entendez-vous ce que disent les grenouilles ? Allez ! allez ! et toutes, tournent leur grosse tête verte, du côté du Yosi-Wara.
Alors il récita un outa populaire :
« Quand les grenouilles elles-mêmes me conseillent, comment pourrais-je ne pas aller au Yosi-Wara ? »
Les coureurs riaient et le prince entendit mal.
On atteignit l’extrémité de l’avenue Mumamitci, qui tourne en un angle brusque et, sur un signe de Yamato, les hommes arrêtèrent devant un petit temple.
Un torié, portique de bois laqué en rouge, le précède et, quand on l’a franchi, l’on voit, assis sur des socles étroits, la queue retroussée, deux renards de pierre, fidèles gardiens d’Inari, dieu de l’amour.
— On ne passe pas ici sans faire une prière, s’écria Yamato en sautant hors du djinrichicha.
Mais le prince ne descendit pas.
— Nous n’avons rien à demander à ce dieu-là, dit-il.
Le temple sintoïte d’Inari, est un édicule en bois, ouvert d’un côté, avec, au fond, une niche, dans laquelle sont suspendus des brins de papiers dorés.
Yamato était déjà près de la vasque de lapis-lazuli sculpté, voisine du seuil ; il se purifiait les dents, avec du sel, et, prenant le petit gobelet de bois à long manche, il mouilla ses lèvres et ses doigts, puis il jeta dans la vasque une pièce d’argent, qui alla en rejoindre d’autres, protégées des voleurs, seulement par l’eau sacrée.
Le penko, parfum chinois, brûlait, emplissant la chapelle d’une fumée bleue. Le jeune homme s’agenouilla en dehors, sur les marches, frappa ses mains l’une contre l’autre, et dit à haute voix :
— Inari ! Inari ! donne-nous la beauté, afin que nous puissions plaire et être aimés !
— Qu’avons-nous besoin d’être beaux, pour plaire à un vieux prince très savant ? demanda San-Daï, penché au bord de la voiture.
— Ne peut-il y avoir aussi, dans son château, des princesses exquises et d’innombrables filles d’honneur ?
— Tu es bien toujours le même fou.
Ils repartaient.
Déjà, au bout de l’avenue, sur un fond de poudroiement doré, se découpaient, en noir, les barreaux et les ramagures de la grande grille du Yosi-Wara.
Un prodigieux brouhaha bruissait tout à l’entour ; les djinrichichas arrivaient impétueusement, au milieu des cris des coureurs ; une foule bruyante et joyeuse assiégeait la porte, ou se poussait, pour voir au delà des grilles, tandis que des hommes de police, vêtus de noir avec un caractère blanc dans le dos, une étoffe nouée autour de la tête, agitaient des sonnettes, au bout de cannes en fer, en suivant un rythme drôle et joli.
— L’étrange château ! s’écria San-Daï, qu’est-ce que tout ce bruit et tout ce monde ? Cela peut-il convenir au recueillement d’un penseur ?
Pour ne pas rire, Yamato se mordait le dedans des joues.
— L’homme, absorbé par ses pensées et ses travaux, dit-il, ne voit rien et n’entend rien. C’est en effet là un château très particulier, qui ne rappelle en rien l’austère seigneurie de Kama-Koura. Mais, à des esprits comme les nôtres, la réflexion peut tout expliquer. Le sage est, peut-être, entouré de fous ; trop occupé de problèmes abstraits et de hautes questions philosophiques, il ne s’inquiète pas du tout de la vie vulgaire et laisse diriger le cérémonial du palais par les personnes de sa famille et par ses vassaux. Ceux-ci, d’après les apparences, doivent être d’humeur joyeuse.
Le jeune homme parlait avec volubilité et faisait beaucoup de gestes, afin d’étourdir son compagnon, pour l’empêcher de voir les gigantesques lanternes, un peu perdues dans la poussière soulevée par tant de pas, sur lesquelles on pouvait lire, en caractères chinois : « Yosi-Wara Daï-Mïozin. »
Ils franchirent ainsi la grande porte appelée : Omon, et pénétrèrent dans la Cité d’Amour.LA CITÉ D'AMOUR
Étrange palais, en effet !
Après la porte franchie, au lieu de l’avenue ombreuse et paisible, gardée par quelques vieux serviteurs, aux visages graves et respectueux, une large rue droite, pleine de foule et de bruit, bordée de maisons de thé, pavoisées et illuminées, avec, dans les plis des banderoles, le titre de l’établissement « À la Pluie de Printemps », « Au Bois de Cerisiers », « Au Saule Vert ».
— Il est certain que tu t’es trompé, dit le prince avec un commencement d’impatience ; trop de fous, vraiment, entourent ce sage, et je t’avertis que ce bruit et cette cohue me lassent.
— Vous oubliez que c’est aujourd’hui la fête des Poupées ! s’écria Yamato : sans doute, les filles d’honneur ont laissé entrer tout ce monde, à cette occasion ; mais venez par ici, cher seigneur, nous nous reposerons dans un lieu tranquille, tandis qu’on ira nous annoncer au daïmio, et lui demander audience.
Et, fendant la foule, il l’entraîna rapidement, pour l’empêcher de voir des brochures, contenant les portraits et les louanges des courtisanes, des danseuses et des bouffons du Yosi-Wara, que leur tendait un marchand ambulant.
Une femme élégante et qui avait dû être belle, les accueillit au seuil de la maison de thé. Yamato, qu’elle paraissait connaître, eût le temps de lui faire un signe, pour l’avertir d’être sur ses gardes, qu’il y avait un mystère, tandis que le prince, tout surpris, examinait, près de l’entrée, un autel, sur lequel étaient disposées des offrandes : du riz, des gâteaux, des fleurs, et dont les symboles, heureusement, étaient cachés par un voile en brocard d’or.
De gracieuses fillettes, vêtues de soies claires, s’empressèrent, leur ôtèrent leurs chaussures, et ils entrèrent, marchant sur de fines nattes blanches, dans une petite salle, où il n’y avait personne.
À terre, quelques beaux coussins brodés, une boîte à fumer en laque d’or et un plateau, chargé de tasses et de flacons ; sur les cloisons, de bois rare, des kakémonos, signés de noms connus et, sur des étagères, des albums et des livres.
Au grand effroi de Yamato, le prince alla droit à ces livres, avec l’avidité naïve de l’homme d’étude.
— Nous sommes perdus cette fois, murmura l’étudiant ; les sujets, peu respectables, de ces joyeux volumes, vont démasquer, trop tôt, notre supercherie.
Cependant, en apercevant le titre d’un album, qu’il poussa aussitôt dans les mains de San-Daï, avec une grimace malicieuse, il se dit en lui-même :
— Sauvés !
Il eut alors tout le temps de prendre à part la maîtresse de la maison, pour lui expliquer le complot, car le prince, s’installant auprès d’une lanterne voilée de soie blanche, d’un air très intéressé, regardait l’album et lisait les légendes.
Il voyait Sakia-Mouni, adolescent encore, quittant son château de Kavira-Vasta, pour aller à la recherche de la vraie doctrine morale et pour tâcher de découvrir le sens et le mystère de la vie humaine. Il arrivait dans une grande ville et s’informait d’un philosophe qu’il voulait interroger. De jeunes fous lui indiquaient un jardin, tout en fleur, dont les habitants pourraient le renseigner.
Là, il trouvait de délicieuses femmes, qui l’entouraient, le cajolaient, lui offraient des gâteaux et des fruits et, à toutes ses questions sur le philosophe, ne lui répondaient que par des caresses et des rires. Le livre donnait à entendre que le Bouddha ne se fâcha nullement et fut même très satisfait de sa méprise ; mais San-Daï ne croyait pas cela, hochant la tête, il se disait que la fin de l’histoire devait être faussée.
Yamato se rapprocha, s’assit auprès du prince, tandis que la femme élégante se prosternait.
— Cette aimable personne, dit-il, se nomme Mai-Dzourou, la Cigogne-Danseuse ; elle a été la nourrice de la princesse, fille bien-aimée du daïmio que vous voulez voir, et elle va nous donner, sur lui et sur son château, tous les renseignements possibles.
San-Daï inclina la tête la ; Cigogne-Danseuse se releva, s’assit en face de lui et lui offrit, tout allumée, une petite pipe d’or, qu’il accepta.
— Le prince notre maître, dit-elle, est un bien grand savant, toujours absorbé dans la lecture des livres et prenant à peine le temps de manger. Il ne s’occupe de rien, dans son domaine, et ses vassaux profitent de cela pour se divertir le jour et la nuit : — la vie est courte, il faut saisir le plaisir par la manche !
Le seigneur, tout au fond de son appartement, dans un pavillon situé au milieu de jardins déserts, n’entend rien et ne voit rien. Sauf quelques serviteurs privilégiés, nul ne peut l’approcher, si ce n’est sa fille la princesse Hana-Dori, si bien nommée « l’Oiseau-Fleur ».
— Ah ! parle-nous de la princesse Hana-Dori, s’écria Yamato.
— Celle-là, c’est la merveille du Japon, dit la Cigogne-Danseuse avec une mine extasiée. Ce n’est pas parce que je l’ai élevée et que je l’aime comme mon enfant, que je parle ainsi ; je suis connaisseuse en fait de beauté, et j’ai vu des princesses incomparables. Mais celle-ci, c’est une déesse, la perfection même, un miracle ! Sans parler de son chant, de sa danse, de son savoir accompli en tous les arts, qui la mettraient déjà au premier rang des femmes, même si elle était privée d’autres charmes, je vous décrirai seulement sa personne. L’ovale de son visage est pur et allongé, tout à fait semblable, pour la forme, à une moitié de pastèque ; ses cheveux, noirs comme la laque de Kioto, dessinent sur son front, en le cachant a demi, le sommet neigeux du Fousi-Yama ; mais la neige paraîtrait sale à côté de son teint ; ses yeux sont frais et brillants comme les Belles du Matin mouillées par la pluie ; son nez est droit et noble ; sa bouche, désireuse, rouge comme la fleur de Botan ; ses dents ressemblent à des perles de jade ; ses sourcils ont la forme du croissant nouveau ; elle a les reins souples comme du bois de saule ; les doigts fins comme les petits poissons nommés siraho : ses bras sont aussi blancs que la pulpe des navets. Enfin, toute sa personne fait honte à la lune ; debout, elle est comme le prunier kaïdo ; assise, comme une touffe de pivoines.
La Cigogne-Danseuse, un peu essoufflée, reprit haleine.
— Quelle belle description ! s’écria Yamato. Je donnerais un doigt de ma main gauche, pour voir l’original de ce magnifique portrait !
— La beauté de la princesse Hana-Dori, n’est pas ce qui doit nous intéresser ici, dit le prince, plus intéressé, cependant, qu’il ne voulait le laisser voir.
— Si je vous parle ainsi de l’Oiseau-Fleur, reprit la fausse nourrice, c’est qu’elle seule peut obtenir de son père ce que vous désirez. Elle est au courant de tous ses travaux, l’aide en ses recherches parfois, car elle est de première force en littérature, en poésie, en philosophie même, les prêtres, des grands temples de la capitale, viennent souvent s’entretenir avec elle et sont émerveillés de la gravité de son esprit. Il faut donc, d’abord, plaire à la princesse et obtenir sa confiance, si vous voulez que le précieux document, dont notre maître est possesseur, vous soit communiqué.
— Eh bien ! la soirée s’avance, hâtons-nous ; il sera trop tard, bientôt, pour être admis auprès de la princesse.
La Cigogne-Danseuse poussa du coude Yamato, pour lui faire remarquer cette belle impatience du prince.
— J’ai déjà envoyé des serviteurs vers Hana-Dori, dit-elle ; ils l’informeront qu’un jeune prince a fait le voyage de Kama-Koura à Tokio, tout exprès pour voir le savant daïmio, son père, que justement on ne voit jamais. Elle aura certainement pitié de vous et vous accordera audience, afin de pouvoir transmettre, au prince, votre requête.
— Nous sommes vraiment dans un costume bien négligé, dit San-Daï, en rajustant avec inquiétude les plis de sa robe en crêpe gris sombre.
— Ne vous inquiétez pas de cela. L’Oiseau-Fleur juge le cœur et l’esprit des hommes, et ne s’occupe pas de leur toilette.
Les jolies fillettes passèrent leurs têtes dans l’entrebâillement des cloisons ; elles agitaient, au bout de leurs doigts, les chaussures des jeunes gens, les invitant à venir les remettre ; les serviteurs étaient revenus, apportant la bonne nouvelle que la princesse Hana-Dori, consentait à recevoir le fils du daïmio de Kama-Koura, et l’attendait à l’instant même.
— En route, s’écria Yamato, soyons dignes de cette faveur en ne perdant pas une minute.
La Cigogne-Danseuse alluma une lanterne rousse, sur laquelle étaient peintes des armoiries.
— Je vous servirai de guide, dit-elle.
Elle fit signe à trois des fillettes de les suivre, passa devant, en portant la lanterne au bout d’une tige de bambou, et ils sortirent de la maison de thé.
Dehors, la foule avait un peu diminué. Ceux qui ne venaient là que pour passer un moment, en curieux, sans faire aucune dépense, s’étaient déjà retirés ; les autres organisaient des parties, engageaient des bouffons et des danseuses. Dans les maisons de thé, des bruits de musique et de chant se faisaient entendre, mêlés aux rires, aux chocs des flacons et même aux détonations des bouchons de champagne.
Des groupes, semblables à celui formé par le prince San-Daï et ses compagnons, précédés chacun par un porteur de lanterne, gagnaient ou quittaient les Maisons Vertes, habitées par les courtisanes de premier et de second rang.
La Cigogne-Danseuse, tourna bientôt dans l’avenue Kiomati, où beaucoup de monde encore se pressait, stationnait devant les façades grillées, derrière lesquelles, en toilettes superbes, sous la lumière des lanternes et du gaz, étaient exposées les courtisanes de second rang.
Pareilles à des idoles, ignorantes, en apparence, de tous ces regards, dardés sur elles, au milieu des fleurs et de l’or de leurs robes, disposées en plis gracieux, elles étaient assises sur des tapis, accoudées à des coussins brodés, occupées a lire, à fumer, à écrire, ou paraissant rêver. Parfois, un serviteur venait dire un mot, tout bas, à l’une d’elles, qui se levait alors, et, nonchalamment, s’en allait.
Yamato feignait une vive indignation.
— Vraiment, disait-il, ces mœurs d’Europe et d’Amérique nous envahissent un peu trop ! C’est scandaleux ! Aurait-on cru jamais, autrefois, que les filles d’honneur des princesses se montreraient aussi effrontément à la foule ? Le store de bambou était toujours baissé, devant la façade de leurs demeures, et les samouraïs, eux-mêmes, ne les apercevaient que comme des ombres mystérieuses, comme de beaux poissons qui glissent, avec des éclats de nacre et d’or, sous l’épaisseur de l’eau verte. Il est vrai, ajouta-t-il en manière d’excuse, que la soirée est chaude et que c’est la fête des Poupées.
Des fragments de chanson volaient par instants, terriblement modernes aussi :
« … Autrefois, la route était longue pour venir au Yosi-Wara ; les norimonos, portés par des hommes, se traînaient bien lentement. Le cheval le plus rapide lui-même n’en finissait pas d’arriver.
» Vivent les chemins de fer, qui, de tous les points de l’empire, nous amènent, aujourd’hui, en quelques heures, dans ce palais de la joie ! »
Ou bien encore :
« Je t’en conjure, délicieuse jeune fille, laisse-moi établir un téléphone entre ton lit et le mien ! »
Des fonctionnaires et des étudiants, déguisés en européens, gauches et disgracieux, passaient, d’un air important, en suçant la pomme d’or de leur canne, mêlant à leur conversation des mots français et anglais. Le prince les trouvait très ridicules et avait peine à se retenir de rire, en les regardant.
Mais on venait de s’engager dans une autre rue, plus paisible. La Cigogne-Danseuse s’arrêta devant une maison élégante, soigneusement close et peu éclairée à l’extérieur.
On pénétra dans le vestibule, entre deux rangs de serviteurs, prosternés sur le passage du prince. Derrière lui, Yamato leur jeta de l’argent.
— Ici, nous vous quittons, cher seigneur, dit-il. L’Oiseau-Fleur ne veut, à ce qu’il paraît, recevoir que vous.
La Cigogne-Danseuse souleva une portière de satin brodé et elle entra, avec Yamato et les servantes, dans une salle du rez-de-chaussée, tandis que d’autres jeunes filles, extrêmement jolies, vêtues comme de beaux papillons, entraînaient le prince vers l’escalier et de nouveau lui ôtaient ses chaussures.
Pour les remplacer, elles apportèrent les sandales, que l’on nomme : fucouzori ; si difficiles à porter pour ceux qui n’en ont pas l’habitude, car elles ne tiennent aux pieds que par un cordon bouclé sur l’orteil.
L’escalier, d’un bois charmant soigneusement lustré à la cire, était malaisé à monter, ainsi chaussé, le prince trébuchait, et, les jeunes filles, avec beaucoup de grâce et de réserve, le soutinrent jusqu’au palier.
On le fit entrer dans le salon d’honneur. Là, il retrouva tout à fait l’aménagement du palais seigneurial : les cloisons décorées de délicates peintures, les nattes blanches, les tapis bleus en poils de chèvre, les coussins brodés, les somptueux paravents, les étagères chargées d’objets exquis, les vases de bronze où s’épanouissent des bouquets savamment combinés ; tout, jusqu’au subtil et chaud parfum flottant dans l’air. Une fille d’honneur, d’une distinction parfaite, le reçut à l’entrée ; le fit asseoir, et s’éloigna, pour aller prévenir sa maîtresse.LA PRÉSENTATION
Le jeune prince San-Daï luttait en vain contre l’émotion extraordinaire qui l’envahissait, à l’idée d’être en présence de cette noble jeune fille, si belle et si savante. S’il allait lui paraître gauche, ne pas oser lui parler, lui déplaire ! cela l’emplirait de tristesse ; car, dès qu’il avait entendu prononcer ce nom si joli de l’Oiseau-Fleur, il avait éprouvé un trouble singulier, comme le choc d’un pressentiment, et lui, qui n’avait jamais pensé aux femmes, les méprisant un peu, même, comme des êtres frivoles et décevants, était forcé de s’avouer, avec une surprise profonde, que la pensée seule de cette princesse inconnue, bouleversait son cœur et effaçait toutes choses de son esprit.
La fille d’honneur revint, fit glisser une cloison, qui découvrit une autre pièce, très éclairée, et s’agenouilla, les deux mains sur le sol.
Tout aussitôt, un grand frisson de soies traînantes se fit entendre, et la belle Hana-Dori traversa, lentement, cette salle, se laissant voir de profil, la tête à demi tournée vers le prince.
Il était impossible, en effet, d’imaginer une plus ravissante beauté et le portrait, tracé par la Cigogne-Danseuse, était bien au-dessous de la réalité. D’une majesté gracieuse, l’air hautain, mais touchant à la fois, par l’expression d’une étrange mélancolie, l’Oiseau-Fleur portait, avec une aisance charmante, un magnifique manteau à manches très amples, en soie violet clair, brodée de tortues d’or, de bambous et de fleurs de cerisiers. Par dessus l’épaule, elle jeta sur le prince un regard rapide, mais plein d’une anxiété profonde, fit une légère génuflexion et s’éloigna. La fille d’honneur se releva et disparut aussi, derrière la cloison, qu’elle referma.
San-Daï était à tel point ému et émerveillé, qu’il ne se demandait que confusément ce que pouvait bien signifier ce bizarre cérémonial.
Il était seul de nouveau : est-ce que c’était là toute la réception ? N’allait-elle pas revenir ? Il avait maintenant un si ardent désir de sa présence, qu’il eut envie de pleurer à l’idée qu’il fût possible qu’il ne la revît pas.
Mais la fille d’honneur rentra d’un autre côté, s’approcha et lui dit en s’inclinant :
— Monseigneur, vous avez le bonheur de plaire à ma ma maîtresse ; elle consent à vous accueillir et sera ici dans un instant.
— Que signifie cette formule ? se demanda San-Daï ; nous sommes décidément bien arriérés, à Kama-Koura !
L’Oiseau-Fleur entra, rejetant à demi son manteau, dans un mouvement coquet qui fit mieux valoir la grâce de son corps souple. Avec une effusion attendrie, elle s’agenouilla près du prince, en creusant de son coude la soie d’un coussin brodé, et elle lui dit, d’une voix tremblante d’émotion :
— Ô mon seigneur ! vous ne savez pas que vous me sauvez la vie ! Si un autre était là, à votre place, ou si vous n’aviez pas ce visage charmant, ce regard de velours et de flamme, je n’aurais pas vécu jusqu’à la fin de cette nuit… Je me suis déjà refusée tant de fois ! … C’était mon droit ; mais il a des limites pourtant, et la nuit suprême était cette nuit-ci. Plutôt que de céder avec répugnance, j’avais choisi de mourir. C’est si peu de chose, n’est-ce pas, la vie d’un être ? Une bulle d’air, qui se forme et monte comme une perle à la surface de la mer, s’y balance un instant, s’irisant, à la lumière, reflétant l’espace et le ciel, puis qui éclate, sans laisser de trace, sans causer le plus léger trouble dans l’immensité du monde. Pourtant, l’âme redoute de se jeter, d’elle-même, avant l’heure, dans l’inconnu d’une autre vie, ou de s’exhaler dans le néant ; et j’avoue que moi, née et formée pour l’amour, j’aurais pleuré de mourir avant d’avoir connu l’amour, ô mon prince ! Je me gardais pour toi, et je te remercie d’être venu !
Il la contemplait avec une stupeur ravie. Suivant les mouvements de cette bouche exquise, ébloui par l’humide lumière de ces yeux, remué jusqu’au fond de l’être par les inflexions si tendres de cette voix, il ne s’étonnait pas des choses singulières qu’il entendait, très vaguement, d’ailleurs.
Comme elle s’était tue, il balbutia :
— J’étais venu pour voir le prince, votre père, afin de solliciter de lui une faveur… oui, une très grande faveur… celle de voir le précieux manuscrit… vous savez… le manuscrit de ce philosophe si fameux. J’ai oublié son nom ; mais le manuscrit est inédit, c’est un vrai trésor ! On m’a dit que vous, fille bien-aimée du savant prince… oh oui, bien-aimée ! … vous pouviez seule intercéder pour moi… vous seule, car il est bien certain qu’il n’y a que vous au monde !
Hana-Dori, très surprise, se recula un peu.
— Hélas ! dit-elle, est-ce que ce jeune homme, si beau en apparence, et vers lequel toute mon âme volait, serait ivre, ou privé de raison ?
Il revenait un peu à lui.
— Je ne suis pas fou, dit-il, mais extasié devant votre beauté. Pardonnez-moi, princesse, si je me suis mal exprimé. J’ai dit la vérité, cependant. Je suis parti du château de Kama-Koura, quittant à regret ma chambre d’étude, pour aller voir un daïmio, très savant, et l’on m’a conduit ici, dans son palais.
Elle se leva brusquement, toute pâlie et tremblante.
— Où donc croyez-vous être, seigneur ? s’écria-t-elle. On vous trompe, cela est certain mais je ne suis pas complice, et j’éprouve un chagrin extrême à jouer un rôle, inconscient, dans le complot singulier dont vous êtes victime.
Le prince se souvint, alors, de toutes les surprises de son voyage, des doutes qui l’avaient effleuré. Il revit le daïmio de Kama-Koura l’exhortant, avec insistance, à quitter l’étude, à se divertir, de toutes les façons ; il revit le pâle visage de sa mère inquiète, et le médecin, hochant sa tête soucieuse et grave, en tâtant le pouls au travailleur obstiné qui repoussait les frivoles plaisirs. Il comprit tout ; il devina que, par sollicitude, on l’avait arraché de force à une réclusion trop prolongée et que c’était avec l’autorisation du maître que le joyeux Yamato avait imaginé cette fable invraisemblable du manuscrit inédit. L’histoire du Bouddha, qu’on lui avait fait lire dans la maison de thé, repassa dans son esprit, et il n’eut aucun doute sur le lieu où il se trouvait.
Il se leva pâle et irrité.
— On m’a trahi ! s’écria-t-il. On s’est indignement moqué de moi, en me traitant comme un enfant entêté… Mais croit-on, vraiment, qu’on réussira à m’amuser, par force ?
L’Oiseau-Fleur, très digne, debout, dans les plis superbes de son manteau qu’elle serrait autour d’elle, regardait le jeune homme avec tristesse.
— Mon seigneur, dit-elle, je ne comprends que confusément ce qui vous arrive ; mais il me semble qu’il n’y a pas de raison de vous trop irriter, puisque vous vous apercevez du piège, assez à temps pour y échapper. Je puis vous aider à sortir de ce lieu d’infamie, puisque vous n’y êtes pas de votre plein gré, sans que vous soyez vu de vos compagnons ; de cette manière, ce sont eux qui seront bafoués, et vous pourrez rire, en retournant à vos chères études, de leur déconvenue. Pour moi, je ne vous demande qu’une faveur, c’est de me croire, en tout cela, parfaitement innocente.
— Innocente ! Voilà un mot qui ne vous convient guère, dit-il avec une expression de douloureux mépris.
— Prince, vous avez tort de me juger sans me connaître… Ce qui pour vous n’est qu’une aventure insignifiante, est pour moi un irréparable malheur ; et, ce qu’il adviendra de l’Oiseau-Fleur, quand vous serez parti, vous ne le saurez même pas.
— Un joyau sans prix, jeté dans un marais ! Une merveille aussi éclatante, tombée dans la boue ! s’écria-t-il en se tordant les mains.
Immobile, de plus en plus pâle, les yeux fermés à demi, elle dit froidement :
— La porte de mon jardin s’ouvre sur une ruelle solitaire ; venez, seigneur, ma servante vous guidera.
— Non ! non ! dit-il, en se laissant retomber sur les coussins, ils n’ont que trop bien réussi : princesse ou courtisane, vous êtes unique au monde, et il m’est impossible de m’éloigner d’ici.
D’un bond, elle fut près de lui, agenouillée.
— Est-ce vrai ? est-ce vrai ? s’écria-t-elle ; sachant qui je suis, vous ne me repoussez pas ?
— Je n’ai jamais aimé aucune femme, et pour mon malheur, Hana-Dori, c’est vous que j’aime.
— Le ciel m’accorderait-il vraiment un tel bienfait ! s’écria-t-elle, l’ivresse de l’amour, là où je redoutais un supplice pire que la mort ! Mais vous ne me connaissez pas, et je veux que vous sachiez tout de moi ; peut-être reconnaîtrez-vous alors que ce n’est pas du mépris que je mérite, mais de la compassion.
— Parle, parle, dit-il, ta voix est délicieuse ; il n’importe si tes subtils discours sont appris pour mieux séduire.
Elle lui ferma la bouche en la couvrant de sa jolie main, blanche et douce comme un camélia.
— Ne dites pas de méchantes paroles et ne doutez pas de ma sincérité : vous aurez les preuves que tout ce que je dis est vrai, si vous me faites l’injure de les exiger.
— Voile plutôt de tes chères mains mes yeux, ravis de ta beauté, si tu veux que je puisse t’entendre.
Elle prit un air grave, un peu fâché :
— Je vous en conjure, écoutez-moi, dit-elle. J’ai quelques raisons de croire que je suis de sang aussi noble que vous-même. Tout enfant, pendant les horreurs de la dernière guerre civile, je fus volée, par des serviteurs, dans l’incendie du palais de mes parents. Les voleurs m’apportèrent à Tokio, cette ville immense où l’on peut si bien se cacher, et ils me vendirent à une ancienne courtisane, mariée et propriétaire de plusieurs Maisons Vertes dans l’enceinte du Yosi-Wara. On me fit élever dans une retraite profonde, avec un soin et un luxe extraordinaires, prodiguant l’argent, aux professeurs les plus célèbres ; on me soigna comme une fleur ; on me para comme une idole, ornant mon esprit autant que mon corps ; mais la moindre dépense était portée sur un registre, et tout cet or forgeait, peu a peu, à ma liberté, une chaîne formidable, impossible à rompre jamais. Quand j’eus l’âge de comprendre, on me révéla ma destinée. Alors, je faillis mourir d’horreur et de chagrin. Hélas ! on avait empli mon jeune cœur des sentiments les plus beaux, ouvert mon esprit aux idées nobles et généreuses ; on m’avait enseigné la poésie, la musique, la danse, toutes les délicatesses du langage et des manières ; on avait fait de moi une véritable princesse, et cela, pour me mieux vendre à tout venant ! Et j’étais peut-être d’une illustre race ! Tout mon sang révolté semblait le crier, en moi-même. Je me fis apporter mes petits vêtements d’enfant, ceux dont j’étais vêtue lorsque je fus ravie à ma famille. Si je pouvais découvrir, par un indice, mon origine appeler à mon secours ceux dont j’étais née, s’ils étaient encore vivants, être rachetée, sauvée ! Cette petite toilette était d’une extrême élégance, faite de ces étoffes, que l’on fabriquait encore spécialement pour les princes, et dans lesquelles les armoiries étaient tissées ; mais il y avait des trous, à la place des emblèmes, qui auraient révélé mon origine ; on avait coupé la soie aux endroits marqués par les armoiries. J’eus beau découdre les doublures et chercher dans les moindres coins de l’étoffe, je ne trouvai rien. Alors, je versai d’abondantes larmes, à la vive colère de ceux dont j’étais le bien. Ils me démontrèrent que mes yeux étaient une marchandise de prix, que je n’avais pas le droit de détériorer. Alors, dévorant ma douleur, j’enfermai dans un coffret ces lambeaux de vêtements, tout ce qui me restait de mon enfance inconnue ; et j’ensevelis avec eux tout orgueil et toute espérance. Mais, au fond de mon cœur, je jurai de mourir, plutôt que de me donner sans amour… Et tu me sauves, ô mon doux prince, ô toi que j’attendais et que j’aime, car tu es tel que mon rêve !
— Je crois bien facilement, dit San-Daï, que le sang, qui fait fleurir ta beauté, est le plus noble qui puisse être, mais fleurit-elle pour moi seul ? Suis-je le premier, auquel tu contes ta touchante histoire ?
— Tu es le seul, tu es le premier, s’écria-t-elle. J’ai le bonheur d’être aussi intacte que la neige du mont Fousi.
— Comment le croire, étant ce que tu es ?
— Ah ! mon seigneur, j’ai été aussi jalousement gardée qu’une fille du Mikado ; sauf à mes professeurs et à quelques vieux prêtres, qui m’ont enseigné la morale et la philosophie, je n’ai jamais parlé à aucun homme.
— Quel est le moyen de te délivrer, ravissante victime ? Dis-moi ce que je puis pour toi.
Elle eut un sourire plein de grâce et de tendresse.
— Ce que tu peux ? dit-elle, m’aimer de tout ton amour, pendant quelques semaines, et, après, me laisser mourir, bien heureuse…
— Ne parle pas de mourir ! s’écria-t-il en l’appuyant contre son cœur.
À ce moment, avec une gambade prodigieuse, Yamato bondit au milieu de la chambre, et cria en battant des mains :
— Eh bien ! eh bien ! que dites-vous de mon philosophe chinois ? … Je vois qu’il est de votre goût.
L’Oiseau-Fleur s’était vivement reculé, avec un geste de pudeur offensée ; elle salua cependant le nouveau venu.
— Ce que je dis, répondit gravement le prince, c’est qu’on regrettera peut-être de m’avoir conduit vers lui, qu’on ne me trouvera que trop bien converti à sa doctrine.
— Bah ! Bah ! en attendant il faut célébrer vos noces, dit Yamato.NOCES ÉPHÉMÈRES
La Cigogne-Danseuse était entrée aussi, avec les jolies jeunes filles, et des serviteurs s’empressaient. Ils apportèrent une petite table basse, qu’ils placèrent devant le prince, puis ils posèrent sur la table, trois coupes en bois laqué ; l’on déboucha, alors, un flacon de saké.
— Vous voyez, prince, dit Yamato en versant le vin dans la première tasse, cette cérémonie est exactement la même que celle qui a lieu dans le mariage entre nobles. Vous serez donc véritablement l’époux de cette belle princesse… durant toute la nuit.
L’Oiseau-Fleur prit la coupe, la vida à moitié, puis la rendit à San-Daï qui but le reste, tandis que Yamato disait :
— C’est la première rencontre entre ce beau jeune homme et cette merveilleuse jeune fille ; que les présages soient heureux !
Puis il emplit la seconde coupe, qui fut vidée de la même façon.
— Puissiez-vous vivre de longues années, reprit Yamato, et jouir d’un bonheur parfait… jusqu’à demain matin !
Les assistants poussaient de joyeuses clameurs, en répétant les souhaits.
L’Oiseau-Fleur prit la troisième coupe et la tint un moment soulevée avant de boire, en enveloppant le prince d’un regard profond et grave. Sans le quitter des yeux, elle la lui tendit, après avoir bu. Il vida la coupe d’un trait et la reposa sur la table de cérémonie, dans un choc brusque.
— Ce mariage, qui n’est pour vous qu’un simulacre et un jeu, dit-il d’un air hautain, est pour moi absolument sérieux. Je fais serment d’être l’époux unique de l’Oiseau-Fleur, et cela pour toujours.
Hana-Dori saisit la main du jeune homme et la mouilla de larmes, tandis que Yamato, qui savait bien que son compagnon ne jurait jamais de vains serments, faisait une mine stupéfaite et épouvantée, qui allongeait étonnamment son visage. Mais il secoua vite son inquiétude, et s’écria en riant :
— Si c’est un vrai mariage, le festin ne sera que plus magnifique. Vite ! vite ! qu’on nous serve ! À en juger par moi-même, je prophétise que, si l’on tarde encore, on nous trouvera tous morts de faim.
Rien ne manqua à ce festin nuptial, auquel la Cigogne-Danseuse fut conviée par Yamato, avec l’agrément du prince.
D’innombrables petites coupes, des bols, des plats, des écuelles en fine porcelaine, disposés sur la natte blanche du sol, ou sur de petites tables basses, contenaient toutes sortes de hors-d’œuvre délicats : algues marinées, coquillages crus ou cuits, soles hachées toutes vives et mêlées à des cornichons frais ; puis des langoustes, des poissons rares accommodés au shoyo, cette liqueur fermentée si succulente ; des viandes et des volailles coupées en menus morceaux ; des pyramides de riz blanc comme la neige ; puis toutes espèces de gâteaux, de fruits et de friandises, et le saké coula abondamment et aussi le vin mousseux de France, qui jaillit dans un bruit de bataille.
Bien qu’il n’y eût que quatre convives, assis à ce repas, la salle était pleine de monde. On avait fait venir d’élégantes geshas, célèbres pour la perfection de leur danse et de leur chant, des taïkomatis, dont les bouffonneries, les mines et les grimaces, déridaient les plus sérieux. Toutes les jolies servantes de l’Oiseau-Fleur étaient entrées aussi, et, debout contre les cloisons, les tapissaient des fraîches soies claires de leurs toilettes toutes fleuries de broderies.
Les bouffons, roulant des yeux extraordinaires, sous des sourcils tordus comme des serpents en fureur, éployant leurs manches en de grands gestes saccadés, se frappant fréquemment les genoux avec leur éventail, avaient mimé une scène burlesque. Mais les samisens commencèrent à vibrer, dans un rythme gai et vif, et une gesha, s’avançant de quelques pas, se mit à danser.
Sa coiffure, qui imitait les ailes d’un papillon, était ornée de grandes épingles d’or, de beaux coquillages et de fleurs ; sa robe d’un bleu nuancé, de bas en haut, du plus foncé au plus clair, enveloppait de beaux plis souples tous ses mouvements. Elle oscillait, se balançait, tournait lentement, faisant flotter autour d’elle des banderoles de soie, couvertes d’emblèmes. Puis une autre gesha, frappant sur un tambour avec des baguettes de laque, entonna, d’une voix aiguë, le chant d’amour de la Première Entrevue.
Mais l’Oiseau-Fleur, d’un geste, l’interrompit, faisant signe qu’elle voulait chanter elle-même.
Alors sa servante favorite, dont le nom était Kin-Rau, le Broc-d’Or, lui apporta son samisen, et tout le monde fit silence.
Prenant une pose d’une grâce maniérée, qui semblait cependant toute naturelle, elle fit courir sa main gauche sur le long manche effilé de l’instrument, et à l’aide du plectre d’ivoire, gratta de l’autre main, les cordes très tendues. Dès les premières notes du prélude, chacun reconnut la célèbre chanson intitulée : Harousamé, et un murmure de plaisir bourdonna.
Elle chanta d’une voix pure et claire, comme les vibrations d’une coupe de jade :
« Sous l’averse printanière qui trempe ses plumes, le rossignol proclame la beauté du prunier fleuri.
» Vers l’arbre bien-aimé, il est revenu du lointain exil, le doux amant, malgré les dernières neiges, le vent et la grêle !
» Si fragile est son aile et si dur fut le voyage, qu’il est tout meurtri et qu’il saigne…
» C’est d’un œil mourant qu’il contemple, une dernière fois, la floraison rose et embaumée ; mais il est heureux, puisqu’il meurt à l’ombre du prunier chéri.
» Ô vous, vers qui revient toujours ma pensée, soyez l’arbre en fleur, et moi je serai l’oiseau ! Sans hésiter, je traverserai, alors, tous les périls, toutes les épreuves, pour expirer entre vos bras ! »
Elle mit un accent si tendre et si passionné dans ce dernier couplet, que les yeux du prince se mouillèrent de larmes, tandis que les assistants poussaient d’enthousiastes acclamations.
— Ni Komati, la grande poétesse, qui fut si belle, ni l’illustre Mourasaki, ni aucune des princesses célèbres n’ont égalé celle qui, ce soir, nous émerveille ! s’écria Yamato, en vidant, coup sur coup, plusieurs verres de champagne en l’honneur de l’Oiseau-Fleur.
Le prince déclara qu’il voulait échanger avec elle le kisho, ce serment d’amour éternel, écrit devant témoins, et qui voue à la mort celui qui y manquerait.
Broc-d’Or courut, aussitôt, chercher la boîte à écrire, et se mit à délayer l’encre. Mais Hana-Dori se défendait, voulait être seule à écrire le solennel engagement.
— Ô mon cher prince s’écria-t-elle, dans quelles angoisses je serais, si vous cessiez de m’aimer !
Et elle cita, à l’appui de son sentiment, un outa du poète Oukou, célèbre depuis le neuvième siècle :
« Qu’il meure sur l’heure
Le traitre !… avions-nous juré.
C’est pourquoi je pleure,
Car l’infidèle adoré,
Le ciel va vouloir qu’il meure.
San-Dai prit le pinceau des mains de la jeune servante et, déroulant le papier soyeux, il écrivit le premier. D’une écriture aussi belle que celle du prince, dans des termes rares et élégants, l’Oiseau-Fleur écrivit, à son tour, le serment sacré.
Les danses et les chants reprirent alors, avec plus de langueur et de fièvre : le saké avait circulé, et coulé abondamment, toutes les têtes étaient troublées et, bien que l’on gardât une réserve de bonne compagnie, l’on sentait monter de plus en plus l’animation et la gaieté.
La Cigogne-Danseuse faisait de grands efforts pour se tenir droite et rester digne ; Yamato s’était imaginé de lui faire boire de nombreuses tasses de saké ou de Champagne, et il s’amusait extrêmement des mines singulières qui crispaient le visage de la vieille courtisane, tout blanc de fard, de ses airs effarés, dans l’angoisse d’être incorrecte, et du clignotement continuel de ses yeux, lourds d’ivresse. Mais tout au fond de lui-même, malgré les rires dont il s’étourdissait, le jeune étudiant sentait poindre une sourde inquiétude : n’avait-on pas trop bien réussi ? Le prince l’avait dit tout à l’heure, peut-être regretterait-on de l’avoir arraché à sa retraite studieuse. Tous ces serments de fidélité, il voudrait les tenir, et qu’adviendrait-il de cela ? … Yamato ne serait-il pas considéré comme responsable par le daïmio de Kama-Koura, des désordres et des folies, éclatant, par suite de cette belle aventure, dans la vie du jeune prince ? …
Il les examinait du coin de l’œil, tous deux engourdis par un trouble délicieux, ne pouvant détacher leurs regards l’un de l’autre, échangeant des sourires d’extase. Ils avaient à peine touché à ce beau repas, éparpillant les grains de riz du bout de leurs bâtonnets d’ivoire, mordant à un fruit, buvant quelques gorgées à la même coupe. Maintenant, ils semblaient las de tout ce monde, impatients d’être seuls.
Alors, Yamato, avec un grand soupir, se leva, plongea la main dans une bourse pendue à sa ceinture et jeta à la volée, à travers la salle, une poignée d’or. Ce fut, aussitôt, une mêlée joyeuse, des cris, des rires ; toutes les jolies toilettes, les belles coiffures hérissées d’épingles, se traînèrent sur le sol, à la poursuite de la proie roulante.
Les bouffons faisaient des enjambées extraordinaires ; il y eut des luttes, des disputes, des chignons défaits ; puis quand tout le monde se fut relevé, un concert de remerciements et de bénédictions, qui n’en finissait plus. Quelques-uns, n’ayant rien pu saisir, feignaient de pleurer.
Le prince et l’Oiseau-Fleur s’étaient levés. Alors, formant un cortège, les assistants les conduisirent à la chambre à coucher.
Cette chambre, assez grande, s’ouvrait sur une véranda qui donnait sur le jardin, confusément aperçu dans une lueur bleue. Le lit était formé par un large matelas de soie étendu sur plusieurs nattes superposées ; au chevet, étaient placés deux makouras, sortes d’escabeaux rembourrés sur lesquels on appuie la tête ; et une magnifique couverture, en satin couvert de broderie, ayant la forme d’une robe géante, était jetée sur le lit.
Dans un angle se dressait, tout environnée de fleurs, une statue dorée de la déesse Benten, reine de la mer et protectrice des amants. Une petite lampe de bronze brûlait devant elle ; mais la lumière de beaucoup de lanternes voilées de soie blanche, empêchait de voir sa lueur.
On déshabilla le prince, et on le revêtit d’un costume de nuit, tandis que l’on disposait sur le sol le brasero, les parfums, la boîte contenant le tabac et les pipettes d’or, et, dans un coffret précieux, une édition rare des Poèmes de l’Oreiller.
Dès que le jeune homme fut couché, les assistants, avec maints souhaits de longue vie et d’éternelle félicité, se retirèrent, sauf Broc-d’Or et quelques servantes, qui commencèrent à dévêtir Hana-Dori. On lui ôta le somptueux manteau de soie et d’or, qui fut étendu contre la cloison, sur une étagère ; on enleva les épingles et les fleurs de sa coiffure ; on défit les hautes chaussures qui la faisaient si grande ; on dénoua sa ceinture, attachée par devant à la mode des courtisanes. La robe glissa, découvrant les épaules et la poitrine sous la gaze de la chemisette, puis les beaux bras, si blancs qu’ils paraissaient lumineux.
Quand elle fut prête, elle vint s’agenouiller près du lit, et dit, d’une voix basse et toute palpitante d’émotion :
— Mon cher seigneur, me permettez-vous de dormir à votre côté ?
Sans avoir la force de lui répondre, d’un mouvement brusque et passionné, il l’attira auprès de lui.
Alors, Broc-d’Or, en même temps que les servantes éteignaient les lumières, referma sur eux la moustiquaire en gaze de soie verte, qui les enveloppa d’une atmosphère de rêve, tandis que la douce lueur de la lune emplissait la chambre, et que la petite lampe de bronze, devant la déesse de la mer et de l’amour, brillait dans un angle, comme une étoile.LES LARMES DES MARCHANDES DE SOURIRES
Il est parti, le joli prince aux yeux de velours, et l’Oiseau-Fleur, tout anéantie, songe à lui, le long des nuits et des journées.
Après une semaine entière d’un merveilleux bonheur, il s’est arraché d’auprès d’elle, mais c’est pour la conquérir. Certain, maintenant, qu’elle n’a été qu’à lui, il a juré de nouveau qu’elle ne sera à aucun autre ; et il est parti, décidé à affronter la colère de ses parents, à lutter contre leur volonté, à triompher de tous les obstacles. Yamato, consterné et plein d’effroi, l’a suivi, promettant néanmoins, lui la cause première de toute l’aventure, de servir de son mieux son noble ami.
Et elle est là, au milieu des fleurs, assise dans la galerie extérieure de sa maison, la belle solitaire, revivant son bonheur, et si enveloppée de souvenirs brûlants, qu’elle est heureuse encore dans sa tristesse.
Mais voici que, tout à coup, on entend, au rez-de-chaussée, un bruit de voix claires, et le cliquettement des hautes chaussures de bois, que l’on détache.
— Qu’est-ce donc ?
Broc-d’Or rentre vivement, se penche et regarde, par dessus la rampe de l’escalier.
— Les plus célèbres oïrans du Yosi-Wara, dit-elle, qui viennent rendre visite à ma noble maîtresse.
Déjà, les fières courtisanes montent lentement l’escalier de bois précieux, tandis que leurs suivantes, restées en bas, jacassent entre elles ; et c’est un bruit de volière dans toute la maison.
L’Oiseau-Fleur s’est levée et rentre aussi, pour recevoir les visiteuses. Elle soulève sa main droite et cache sa bouche derrière sa longue manche brodée, ce qui est une façon câline et gracieuse de saluer.
La première qui entre s’appelle Ko-Mourasaki, Petite-Pourpre. C’est une personne très orgueilleuse d’elle-même. On la recherche beaucoup, mais sa conquête flatte l’amour-propre, plus qu’elle ne charme le cœur.
Elle a une figure longue et aristocratique, très blanche, le nez busqué, les yeux grands, à peine bridés, avec les sourcils rasés, et repeints très haut sur le front. Comme ses dents ne sont pas très belles, elle les a fait laquer en noir, à la façon de beaucoup de femmes du monde, et son sourire est singulier. Dans sa toilette, elle affecte une certaine simplicité de bon goût. Sa robe, en crêpe couleur olive, n’a d’autres broderies qu’une bordure de vagues, en satin plus clair, montant jusqu’à mi-jambes et, près de l’épaule, les armoiries, qu’elle s’est choisies un zigzag bizarre, enfermé dans un cercle ; sa ceinture souple est en soie rose unie, et sur son manteau, couvert tout entier par un fantastique dragon noir, on ne voit de l’or qu’en minces fils, indiquant les écailles, et, en perles, pour former les yeux.
Ko-Mourasaki tient à la main, comme un bâton de commandement, sa mince pipette d’argent ciselé.
Celle qui vient après elle, c’est Tama-Koto, la Guitare-de-Jade, longue, frêle et jolie, extrêmement rêveuse et nonchalante. Elle est vêtue d’une robe bleu pâle, si souple qu’elle semble mouillée : son manteau traîne loin derrière elle : on y distingue, brodé en couleurs naturelles sur un fond d’or, le portrait du beau Nari-Hira, l’illustre poète, le fier guerrier, l’incomparable séducteur. La jeune courtisane a pour ce héros d’autrefois une grande passion ; elle le pleure souvent, la nuit, car, à travers les siècles, c’est lui qu’elle aime.
Ko-Tsio, le Petit Papillon, et Vaca-Yanaghi, le Jeune Saule, entrent ensemble. La première est mignonne et gracieuse, avec une figure ronde, couleur de crème, des yeux gais, une bouche exquise, pareille à une petite rose épanouie. Sa tête est tout hérissée d’épingles, et elle semble avoir peine à traîner sa toilette, lourde de broderies. La seconde est une espèce d’idole, au visage immobile et blafard, aux longs yeux, ouverts à demi, qui semblent perdus dans un rêve. Elle a, sur la lèvre inférieure, une petite tache d’or ; sa robe est en soie jaune et son manteau en brocard d’or, semé de chrysanthèmes d’argent.
Après l’échange des formules de politesse, les belles visiteuses s’asseyent sur les tatamis couleur de neige, qui couvrent le sol, et s’accoudent aux riches coussins, épars çà et là.
— Nous avons appris le bonheur qui vous arrive, dit Ko-Mourasaki, et nous venons vous féliciter. Toute notre ville se réjouit avec vous, et l’on vous a proclamée reine du Yosi-Wara !
— Je suis très flattée de cette attention, répondit l’Oiseau-Fleur, mon bonheur est extrême, en effet ; si grand qu’il m’aide à supporter les chagrins de l’absence.
— Alors, c’est bien vrai ! s’écria Guitare de Jade, un prince, aussi beau que Nari-Hira, a été votre premier amant et veut vous libérer, pour vous faire princesse ?
— C’est vrai. La déesse Benten, que j’ai tant priée, m’accorde cette insigne faveur.
— Montrez-nous les cadeaux que vous a faits le prince, ils doivent être magnifiques, dit Petit Papillon, avec des yeux luisants de curiosité.
L’Oiseau-Fleur dégagea des plis de sa ceinture un élégant poignard, au fourreau d’argent, incrusté d’or.
— Voici son unique présent, dit-elle.
Alors, ce furent des exclamations :
— Comment ! un poignard ! rien qu’un poignard ! … Ce beau prince n’est donc pas généreux ? …
— Puisqu’il donne tout, les cadeaux sont superflus, dit Ko-Mourasaki.
— Le prince a acheté ma liberté, jusqu’à un jour fixé, où il doit revenir pour m’emmener, dit l’Oiseau-Fleur ; si, par un malheur, dont le ciel me garde ! il était retenu loin de moi, retombée dans l’esclavage, on voudra me contraindre à être infidèle ! Alors ce poignard sera la clé de ma prison ; grâce à lui, je pourrai m’évader d’ici, aller attendre mon bien-aimé dans le séjour des ombres.
Il y eut un silence. Toutes les belles oïrans étaient pensives, et Ko-Mourasaki, penchée sur le poignard, l’examina avec attention.
Les kamélos, jeunes servantes de douze à treize ans, avaient apporté les boîtes à fumer et servi le thé. On se passa de l’une à l’autre le brasero, et de minces spirales bleues montèrent vers le plafond.
Ko-Mourasaki regardait toujours le poignard ; elle l’avait tiré à demi de sa gaîne et essayait le tranchant sur son doigt mignon. Puis, d’un mouvement vif, elle éteignit l’éclat cruel de la lame dans l’ombre du fourreau et dit d’une voix grave :
— La mort ! … La mort volontaire, permettant d’éluder un ordre tyrannique, qui nous humilie, c’est Elle seule qui nous rend un peu de vraie noblesse, à nous, pauvres simulacres de princesses que nous sommes !
Petit Papillon frappait ses mains l’une contre l’autre, avec épouvante :
— Mais c’est affreux de se faire mourir s’écria-t-elle, nous si soigneuses de nos personnes, si délicates, si douillettes ! Comment pourrions-nous nous faire du mal, avec des poignards ou du poison ? … C’est là une chose impossible, qui n’est jamais arrivée.
— Jamais arrivée ! dit Ko-Mourasaki avec un sourire noir, nous n’en finirions pas, si nous contions les histoires de suicides, qui se sont produits, dans l’enceinte seule du Yosi-Wara.
— Vous savez de ces histoires ? …
— Nous en savons toutes.
— Ah ! je vous en prie, racontez-les, dit Petit Papillon avec un air de câlinerie suppliante, moi, je n’en sais aucune.
— Si l’Oiseau-Fleur, notre reine, le trouve bon, je veux bien vous conter ce que je sais, dit Ko-Mourasaki.
— J’entendrai ces histoires avec le plus grand intérêt, dit l’Oiseau-Fleur, moi qui, peut-être, en fournirai une de plus à la collection.
— N’ayez pas de pareilles idées ! s’écria Jeune Saule ; prévoir le malheur, cela l’attire. Mais je vous donnerai un talisman infaillible, et votre prince reviendra.
— Merci, mille fois ; je le porterai avec reconnaissance.
— Nous écoutons, dit Petit Papillon, en se tournant vers l’imposante Ko-Mourasaki.
Celle-ci but une gorgée de thé et reposa sa tasse sur le plateau.
— La personne dont je vais vous parler, dit-elle, vous l’avez toutes connue. On l’appelait La Perle.
— Certes, nous la connaissions, dit Guitare-de-Jade ; voilà moins d’un an qu’elle est morte, en pleine floraison de sa beauté.
— Mais, par peur de l’exemple, on a soigneusement caché la façon dont elle est morte. Moi, sa plus intime amie, je fus avertie, en secret, par sa suivante favorite, et j’ai su toute la vérité.
— Je m’étais toujours doutée que cette mort n’était pas naturelle, dit Jeune Saule.BARBARE D'OCCIDENT
Voici, dit Ko-Mourasaki :
— La Perle était extrêmement belle, très fière et très savante. Comme vous, Guitare-de-Jade ; elle avait étudié l’histoire ancienne avec passion, et gardait, au plus haut point, l’amour et l’orgueil de son pays. Aucune, comme elle, n’avait l’aspect d’une princesse des temps passés. Elle étudiait les modes d’autrefois, avec une attention extraordinaire, les copiait, jusqu’aux plus minces détails. Dans sa maison, tout portait la marque des jours disparus ; elle avait des pages, des écuyers, revêtus d’armures et armés de sabres. Mieux qu’aucune de nous, elle parlait l’Idiome de Yamato, la langue du huitième siècle, n’y mêlant jamais aucune locution moderne, et, lorsqu’ils n’étaient pas nobles, elle embarrassait, jusqu’à leur faire perdre contenance, ses amants d’une nuit, en leur débitant, d’une voix moqueuse, des discours auxquels ils ne comprenaient rien.
À cause de tout cela, sa célébrité était extrême. On parlait d’elle d’un bout à l’autre de Tokio, ses portraits étaient exposés partout, et, même, on l’avait photographiée, par surprise, car jamais elle n’aurait consenti à une pareille chose. Tout ce qui était moderne, naturellement, lui faisait horreur, et elle traitait avec un tel mépris, les jeunes hommes affublés des affreux vêtements des Occidentaux, qu’aucun n’osait se présenter devant elle, sans avoir repris le costume national.
Un soir, on vint prévenir La Perle qu’un très riche seigneur, amoureux d’elle, sur la foi de ses portraits et de sa réputation, désirait la voir. Sans tarder, elle fit appeler ses servantes, et se prépara pour la présentation.
Ko-Mourasaki frappa sa pipette d’argent, pour en faire tomber la cendre, sur le bord de la boite de laque ; puis continua son récit :
— La Perle s’avança lentement, comme c’est l’usage, pour traverser la baie, ouverte sur le salon de réception. En passant, elle jeta un regard, par dessus l’épaule, vers l’homme qu’on lui présentait. Alors, elle eut un brusque haut-le-corps, ses sourcils remontèrent, sa bouche se crispa de mépris, et, sans même saluer, elle passa très vite, faisant signe à sa servante qu’elle refusait le personnage. C’était un Occidental, un homme de haute taille, à la figure rouge, au grand nez, avec des yeux bleus, tout ronds, et une barbe rousse, ébouriffée et touffue, qui le faisait ressembler à une bête. La Perle était rentrée dans sa chambre, très irritée. Du bout de son éventail, elle éparpillait les fleurs des bouquets, brisa même quelques vases précieux et jeta loin d’elle son manteau de cérémonie.
— Comment peut-on me faire une pareille insulte ? s’écria-t-elle, à moi qui aime mon pays par dessus tout, et qui souffre des mœurs nouvelles, tellement, que je ne vis que dans le passé ? Comment a-t-on pu croire que j’accueillerais cet étranger, pour lequel toute ma personne se soulève de dégoût ?
Et elle gronda ses servantes de ne pas l’avoir avertie. Si elle avait su, elle ne se serait pas même laissée voir.
Le lendemain, l’étranger se présenta encore, mais La Perle, maintenant sur ses gardes, se voulut pas paraître. Elle lui fit dire que, revînt-il tous les jours de l’année, elle le refuserait toujours.
La pauvre femme oubliait trop, qu’elle était esclave. Ceux de qui elle dépendait vinrent lui faire des remontrances. Elle avait des fantaisies ruineuses. Sa maison, montée à la façon d’un château d’autrefois, coûtait d’énormes sommes ; des envoyés couraient tout l’empire, pour lui acheter des objets anciens, qui devenaient de plus en rares. Sa dette était effrayante, sa vie entière ne suffirait pas pour la payer, sans le hasard d’une occasion extraordinaire. Cet Occidental, fabuleusement riche, très enflammé pour elle, surtout depuis qu’il l’avait vue, la voulait à tout prix, et à tout prix n’était pas, dans sa bouche, une manière de parler : il était capable de la libérer complètement, de payer tout ce qu’elle devait. Si elle refusait une pareille aubaine, on serait obligé de vendre tout chez elle, de la dégrader de son titre d’oïran, de l’exposer, avec les courtisanes de rang inférieur, derrière les barreaux des devantures.
La Perle courba la tête, elle ne pouvait que se soumettre. Elle déclara qu’elle consentait à recevoir l’étranger. Celui-ci commanda un festin magnifique, fit venir des acteurs célèbres, qui jouèrent et chantèrent, accompagnés par un orchestre complet. La Perle, immobile et muette, ne toucha à aucun mets, ne regarda rien ; pas une seule fois elle ne leva les yeux sur l’étranger ; elle les tenait obstinément baissés, pâle, glacée, effrayante comme un fantôme. Le festin terminé, elle se leva et passa dans sa chambre, comme pour changer de toilette. Sa suivante la rejoignit presque aussitôt ; mais, dès le seuil, elle poussa un cri terrible, qui fit frémir tous les assistants : La Perle gisait dans un lac de sang. Elle s’était coupé la gorge, avec un sabre ancien, qui avait appartenu au shogun Taïko-Sama ! …
Toutes les oïrans eurent un geste d’effroi ; Petit Papillon cacha son visage, en criant, contre l’épaule de Jeune Saule, qui, seule, n’avait pas perdu son impassibilité d’idole, et entr’ouvrait seulement ses lèvres minces, ornées d’un trait d’or.
— Cette mort est digne des temps passés, dit l’Oiseau-Fleur ; La Perle méritait de vivre aux époques héroïques, qu’elle a tant aimées.
— Elle n’a même aimé que cela, dit Ko-Mourasaki.
— C’est justement ce qui me surprend le plus, dit Guitare de Jade. Comment a-t-elle puisé le courage d’une mort aussi cruelle, dans la seule répugnance d’un être d’une autre race ? Elle n’avait d’amour pour personne, et il me semble que l’amour, seul, donne le désir et la force de mourir.
— Comment savez-vous cela ? demanda Petit Papillon ; vous n’avez jamais été amoureuse.
— Personne n’ignore que j’ai livré mon cœur à une passion, impossible, pour un divin poète, mort il y a neuf cents ans. Cela me préserve de toute faiblesse, et me permet de n’éprouver qu’une paisible indifférence, pour tous les hommes que je reçois. Mais s’il fallait renoncer à mon rêve, renier mon idéal amant, je préférerais mourir. Un prince, m’offrît-il même de m’épouser, je ferais comme a fait La Sarcelle de Soie.
— Qu’a-t-elle fait ? … Dites ! dites !.. décria Petit Papillon, qui voulait encore avoir peur.
— Personne de vous ne connaît l’histoire de La Sarcelle de Soie ? Elle est célèbre cependant ; on parle souvent de cette héroïne, et ses portraits sont encore exposés au Yosi-Wara.
— Je l’ai entendue nommer, dit Ko-Mourasaki, mais je ne sais qu’une partie de son histoire.
— Si notre reine le permet, dit Guitare de Jade en s’inclinant, je vous raconterai ce que je sais.
— Je suis curieuse de vous entendre, répondit l’Oiseau-Fleur.AU POIDS DE L'OR
— Sans être très ancienne, cette histoire n’est pas d’aujourd’hui, dit Guitare de Jade ; elle s’est passée au temps où les seigneurs portaient encore des sabres, où le Japon, fermé aux étrangers, gardait jalousement les traditions et le parfum des temps disparus… Il y a trente ou quarante ans, peut-être, Sarcelle de Soie était, comme nous toutes, belle, insoucieuse et esclave ; le soin de sa personne, ses toilettes, ses coiffures, la bonne tenue de sa maison, l’occupaient uniquement. Aucun des hommes qu’elle recevait n’était parvenu à toucher son cœur, jusqu’au jour, où elle rencontra le samouraï Kaïdo. C’était le vassal d’un prince très malheureux, qui avait été vaincu, après de longs combats, par une maison rivale, avait vu ses États envahis, son château dévasté, ses trésors pillés, et s’était enfui, avec sa famille, on ne savait où. La ruine du maître fut, du même coup, naturellement, celle des serviteurs, et le charmant Kaïdo, était très pauvre.
Lorsqu’il vint au Yosi-Wara, il accompagnait un ami, plus fortuné, et était seulement invité au souper. Mais Sarcelle de Soie, touchée au cœur pour la première fois, n’avait de regards que pour lui. Elle improvisa même un outa à son adresse :
« Je ne puis pas dire son nom ; mais, ô bonheur ! il y a ici un jeune homme pour lequel, volontiers, je donnerais ma vie ! »
Kaïdo, très ému, lui aussi, avait bien compris, tout en feignant l’indifférence. Il revint, en secret, et fut l’amant adoré de Sarcelle de Soie. Elle ne voulut pas qu’il restât pauvre ; elle devint âpre au gain, pour être à même de l’enrichir. Elle était passionnément aimée, heureuse, et pleine d’espoir en l’avenir : le jeune samouraï lui avait promis, dès qu’il aurait pu s’assurer une position, de la libérer et de l’épouser. Mais ce ne fut pas cela qui arriva.
Le prince souverain de Satsouma, vit la belle oïran et s’en éprit follement. Il déclara, qu’il la voulait mettre au rang de ses épouses, et qu’il était prêt à payer ce qu’on exigerait.
Cette nouvelle, jeta les deux amants dans le désespoir : c’était la fin de leur amour, la séparation éternelle. Le prince de Satsouma était trop puissant, pour que l’on pût songer à lui résister : ils étaient bien perdus.
Cependant, Sarcelle de Soie, essayant de lutter, eut l’idée de demander, pour son rachat, une somme extravagante : elle déclara, qu’elle ne suivrait le prince, qu’à la condition qu’il la payât son poids d’or. Le seigneur de Satsouma, qui était un seigneur comme il n’y en a plus, ne fit aucune objection. Il ordonna de construire des balances, et fixa le jour du départ.
Ce jour venu, Sarcelle de Soie, consternée, se mit dans la balance, en priant le ciel que le poids de son chagrin la rendît plus lourde que du plomb. Elle avait rempli ses manches de pierres, et de toutes sortes d’objets pesants ; mais le prince, impassible, faisait entasser l’or sur l’autre plateau, et bientôt, Sarcelle de Soie, cramponnée aux cordes, fut enlevée très haut. Elle ne s’appartenait plus.
Il fallut partir, et dévorer ses larmes. Un cortège magnifique, la conduisit du Yosi-Wara jusqu’au port, où une belle jonque, toute pavoisée des bannières du prince, l’attendait.
Les yeux troublés de pleurs, Sarcelle de Soie vit s’éloigner le rivage, disparaître la ville, où son cœur était resté. Elle ne pouvait croire que tout fût fini ainsi, que Kaïdo ne tentât rien, pour l’apercevoir, au moins, une dernière fois.
Une barque s’était détachée du rivage, légère et rapide ; sa voile gonflée, elle volait sur la mer, approchant très vite du lourd et majestueux navire. La pauvre amante, regardait de toutes ses forces cette barque : c’était lui qui la conduisait, elle en était sûre. Mais le prince s’était approché, une coupe de saké à la main.
— Ma princesse, dit-il, buvez à nos amours.
Déjà elle distinguait le pâle visage de KaÏdo ; la barque était toute proche, l’amant lui tendait les bras. Alors, elle comprit ce qu’il voulait d’elle. Elle vida la coupe d’un trait.
— À toi, Kaïdo cria-t-elle.
Et elle s’élança dans la mer…
— Mourir pour celui qu’on aime, cela me paraît aussi simple que de respirer, dit Jeune Saule, celle qui ressemblait à une idole ; ce qui, à mon avis, est le plus terrible, c’est de supporter le désespoir, d’avoir la force de vivre, avec le cœur desséché, pour réaliser quelque secret dessein, ou obéir à un mort chéri. À cause de cela, l’histoire de la Princesse Inconnue est celle qui revient le plus souvent dans mon esprit, et alors ma gorge se serre, je respire avec peine, et je me retiens de pleurer.
— Vous avez toujours refusé de nous confier cette aventure, que vous êtes seule à savoir, dit Ko-Mourasaki non sans amertume, le mystère qui enveloppe celle que l’on a surnommée la Princesse Inconnue, préoccupe toutes les oïrans du Yosi-Wara, et a fait travailler toutes les têtes. À mesure que le temps s’écoule, cela s’apaise un peu ; l’éloignement tend ses voiles, et l’oubli les double ; cependant, ils sont encore assez légers pour que le moindre souffle de souvenir les écarte et découvre, aussi vif qu’aux premiers jours, l’intérêt qu’inspire cette histoire, jamais contée.
— Puisque Vaca-Yanaghi en a parlé la première, dit Guitare-de-Jade, elle nous doit l’histoire de la Princesse Inconnue. On ne remet pas l’or dans sa manche, après l’avoir montré aux mendiants.
— Que notre reine ordonne, puisqu’elle est toute-puissante, dit Petit-Papillon ; qu’elle vienne en aide à la curiosité de ses sujettes.
L’Oiseau-Fleur se tourna en souriant vers Jeune Saule, dont l’impassible et blême visage aux yeux demi-clos, ressemblait plus que jamais à la face d’albâtre d’une Idole.
— J’avoue avoir bien souvent rêvé à cette mystérieuse princesse, lui dit-elle, et ma curiosité royale, se joint à celle de mon peuple.
— Mon intention était de vous dire l’histoire, répondit Jeune Saule, seule la grande jeunesse de Ko-Tsio, me fait hésiter, car je dois vous demander le serment, de ne rien répéter des choses que je vais vous révéler ; et pourra-t-elle tenir sa promesse, presque encore enfant, comme elle l’est ?
Ainsi que se dresse le serpent lové sur lui-même au milieu du cercle soyeux de ses robes, Petit Papillon se leva, les yeux pleins de colère.
— L’enfant qui, plus tôt que d’autres, a mérité le grade d’oïran, dit-elle d’une voix frémissante, avait sans doute des qualités, que des femmes, moins favorisées, ont mis plus longtemps à acquérir.
Elle était charmante, dans son attitude de défi, avec le grand disque d’or, formé par son peigne, derrière sa nuque. Les courtisanes, étendues sur les nattes, de bas en haut, l’admiraient en souriant.
Seule l’Idole, toujours impassible, ne levait pas la tête.
— Ne vous fâchez pas, Ko-Tsio, dit-elle, la jeune tige, plus belle que la branche faite, ne s’irrite pas d’être fragile. Il y a des remords dans mon inquiétude : celui de qui je tiens l’histoire mystérieuse, a, par faiblesse pour moi, trahi le secret ; et, vous voyez, je vais le trahir aussi, par amitié pour vous, moi qui suis la fleur éclose et non plus le gracieux bouton.
— Voulez-vous que je me retire ? demanda Petit Papillon.
— Je voulais faire résonner un peu plus fort, en votre mémoire, la gravité du serment ; maintenant je suis tranquille, dit Jeune Saule.
— Merci moi qui crains la mort, je jure que je veux mourir, si je ne suis fidèle.
Et d’un mouvement brusque et souple, Petit Papillon s’abaissa de nouveau dans le moutonnement de ses robes.
— Nous vous écoutons, Vaca-Yanaghi dit l’Oiseau-Fleur.
— Qu’on éloigne les kamélos, dit Jeune Saule.
Et, seulement quand toute les jeunes suivantes eurent disparu, par l’entrebâillement d’un panneau que la dernière referma sur elle, elle commença.LA PRINCESSE INCONNUE
— Un soir, — il y a déjà plus de vingt ans et aucune de nous n’était hors de l’enfance, alors — un norimono élégant, mais sans insignes, entra dans l’enceinte du Yosi-Wara, porté par deux hommes, qui dissimulaient leur visage, sous la coiffure de ronine[2] et qui s’éloignèrent, en emportant le véhicule, dès que celle qui l’occupait en fut descendue.
C’était une jeune femme, très grave et très belle ; du type aristocratique le plus pur.
Elle fit venir la gouvernante d’une des principales maisons vertes, et, de l’air hautain, avec le parler nonchalant et dédaigneux, d’une vraie princesse, elle déclara vouloir être enrôlée, dans la phalange des princesses fictives. C’était un ordre plutôt qu’une prière : la gouvernante était tentée de se prosterner, ses genoux ployaient d’eux-mêmes, d’autant plus que l’inconnue ne demandait aucun paiement contre son engagement, offrait au contraire une somme importante pour ses frais d’installation. Elle faisait ses conditions, par exemple : Admise d’emblée au grade de grande oïran, elle ne recevrait que des hommes originaires de la principauté d’Hikone, et ne les recevrait qu’une fois. La gouvernante, extasiée, consentit à tout. Et, pendant plusieurs années, longues et lourdes, sans doute, l’inconnue vécut au Yosi-Wara, sous le nom de Glaive-Noir, qu’elle s’était choisi.
Mystérieuse et triste, hors de son service, elle ne parlait à personne, et, à cause de cela peut-être on ne parlait que d’elle. Combien s’abaissèrent au mensonge et jurèrent être nés à Hikone, pour être admis auprès d’elle ! Tous se taisaient, après l’unique entrevue, avec un inconsolable regret.
Un matin, les kamélos, en entrant chez Glaive-Noir, trouvèrent l’amant d’une nuit, égorgé, en travers du lit.
Elles s’enfuirent, en hurlant, et, bientôt, toute la Cité-d’Amour fut révolutionnée. La police fit fermer les portes du Yosi-Wara, espérant que la meurtrière ne s’était pas encore échappée. Mais on la découvrit, presque aussitôt, sous un bosquet de son jardin, la face contre terre, un poignard, armorié, planté jusqu’à la garde dans le cœur. On eût dit qu’elle l’avait enfoncé là, avec une frénésie joyeuse, comme on enfonce dans une serrure la clef qui vous délivre. Un rire de triomphe étirait ses lèvres mortes, qu’on n’avait vu jamais, vivantes, sourire.
Les armoiries du poignard étaient celles d’une famille complètement éteinte. L’homme égorgé fut reconnu pour un dignitaire de la cour, et aussitôt le silence se fit, les voiles retombèrent, on défendit d’interroger et de parler. Glaive-Noir, et sa victime, furent emportés hors du Yosi-Wara, et l’on n’a jamais rien su.
Jeune-Saule se tut, et versa du thé dans sa tasse.
Toutes les oïrans, modulèrent un, ah ! de désappointement.
— Nous connaissions, à peu près, ce que vous venez de nous redire, déclara Ko-Mourasaki. Ne savez-vous donc rien de plus ?
La tache d’or, qui décorait la lèvre inférieure de Jeune-Saule, frémit légèrement dans une ébauche de sourire. À petits coups, elle but son thé, reposa la tasse, et reprit.
— Peu après mes premières amours, au Yosi-Wara, un vieux seigneur, s’éprit de ma personne, au delà de mes mérites. Mais, il ne me plaisait guère, et, malgré les propositions avantageuses qu’il me faisait, je ne me décidai pas à l’accueillir. J’appris, un jour, qu’il avait été chef de justice et que c’était lui qui était venu faire les constatations officielles, lors du meurtre et du suicide, qui nous préoccupaient toujours. Mon indifférence pour lui cessa subitement, et, à la condition qu’il me parlât de cet événement, je voulus bien causer avec lui.
Je le fis souffrir : déchiré, entre son amour et son devoir, l’un voulant le faire parler, l’autre ordonnant le silence, il était vraiment à plaindre. Bref, je l’affolai si bien, qu’il m’avoua avoir en sa possession, le manuscrit trouvé sur le cadavre de Glaive-Noir, et dans lequel elle avait elle-même relaté, jour à jour, une partie de sa vie. Lire ce manuscrit ce fut, dès lors, le prix de mes faveurs et je n’en voulus aucun autre.
— Vous l’avez lu ? s’écria Petit Papillon tout émerveillée.
— Le brave juge résista longtemps. Un soir enfin il apporta le précieux rouleau, et me le laissa lire, quand nous fûmes seuls, après que je lui eus juré de ne jamais le trahir. Pour dormir il plaça le rouleau sous le matelas du lit. Au milieu de la nuit, je parvins à le tirer de là sans éveiller le dormeur, et, à la faible lueur d’une lanterne, je le copiai, d’un bout à l’autre…
— Vous l’avez copié ? …
Cette exclamation s’échappa de toutes les lèvres, et même l’Oiseau-Fleur se pencha en avant, la bouche entr’ouverte, distraite un moment de son rêve.
Jeune-Saule porta la main à sa coiffure, ce qui fit tomber jusqu’à l’épaule sa lourde manche et mit à nu son bras, blanc comme du papier. Elle ôta, de l’ornementation compliquée de ses cheveux, un étui en laque d’or, presque entièrement dissimulé sous les ailes du chignon. L’étui ouvert, elle en tira un rouleau de soie fine et le tint au bout de ses doigts.
— Le juge est mort durant la dernière lune, dit-elle, il n’y a plus de témoin du serment. Et, d’une saccade, elle fit le manuscrit déroulé, courir comme une coulée de lait, sur les nattes.
— Votre silence est éloquent, ajouta-t-elle, je n’ai pas besoin de vous dire : écoutez.
Elle lut.
Château de Fusimi, la 1re année de Gengi, au 6e mois[3].
« Après deux cents ans d’une paix heureuse, la guerre civile éclate, hélas !…
» Ô ! brutale douleur ! Nouvelle funeste !… C’en est fait du charme de la vie. Un buffle furieux a brisé la barrière de l’enclos et piétine les fleurs ravissantes. Hélas ! hélas ! les sentiments les plus subtils, vont être pétris avec la boue et le sang !
» Dans l’alcôve désertée, les cordes de la lyre, avec un tintement lugubre, se brisent d’elles-mêmes !
» L’angoisse serre ma gorge ; pourtant mes larmes ne peuvent pas couler : l’ouragan déchaîné ne laisse pas tomber la pluie !
⁂
» Comment durcir nos cœurs ? comment retrouver l’énergie et la force, après ces longues années de voluptueuse mollesse ? Les sabres, aux gardes embellies d’oiseaux d’or et de fleurs d’argent, ne sont plus que des parures, dans les ceintures de soie.
» Les princes, passaient leur vie en contemplation de la nature. Nonchalamment accoudés au rebord des terrasses ; ils chantaient, rêvaient ; écrivaient sur du satin, des vers. Épris de toutes beautés, savourant les sensations nobles et les mille nuances de l’amour.
» Les corps suaves, imbibés de parfums, comme ils vont être meurtris par la lourde et rude cuirasse ! Comment les mains délicates, emprisonnées dans le dur gantelet de corne, pourront-elles saisir la lance et l’épieu pesant ?
⁂
» Ô fils des héros ! Vous voilà debout ; fiers et indignés ; méconnaissables, sous l’habit de guerre ! Le cœur cuirassé aussi, car voilà que vous brisez l’interminable adieu de désespoir ! …
» Il n’y a plus que le bruit des pas qui s’éloignent… des pas sans retour… hélas ! …
» La face contre terre, je mords mes cheveux, pour étouffer mes sanglots.
⁂
» La honte et l’orgueil me relèvent, pourtant. Vais-je donc crier, sous la douleur, comme une simple femme des rizières, moi princesse, de l’illustre clan de Nagato, fille d’honneur de notre suzeraine ? …
» Ah ! c’est que l’amour venait d’éclore dans mon cœur… et… sans l’excuser, l’amour seul explique la lâcheté.
» Que se passe-t-il ? d’où vient le coup, qui anéantit le peu que je suis ? Je l’ai reçu, sans le comprendre. Maintenant il faut savoir, et suivre, de l’âme, ceux qui combattent.
⁂
« Honneur au Mikado ! hors les étrangers ! » tel est le cri de bataille.
» Les barbares de l’ouest, souillent de leur présence le sol sacré du Japon. Leurs navires jettent l’ancre dans nos ports ; les vils marchands, de ces nations inconnues, viennent faire leurs trafics. Mais ce n’est là qu’un prétexte, ils convoitent notre beau pays, et emploient toutes sortes de ruses, pour nous abuser.
» Le Shogun a eu la faiblesse de céder à ces barbares, de leur permettre ce qui est défendu, d’échanger avec eux des promesses écrites.
» L’orgueil du pouvoir l’a égaré.
» Après tant d’aïeux puissants, le Shogun ne se souvient pas, qu’il ne règne qu’au nom du divin Mikado, et qu’il n’est qu’un esclave ? Il a osé signer des conventions avec les étrangers, sans l’agrément du fils des Dieux, à cause de cela la dynastie des Tokougava sera détruite.
» Le souffle exhalé ne revient jamais aux lèvres de l’homme. Les ordres du Mikado ne peuvent être rapportés. Ne pas y obéir, est un crime dont on n’a jamais eu l’idée. Et voici que ce crime est près d’être commis.
» Que les étrangers soient rejetés hors de notre empire, ainsi que la poussière est chassée par le balai. »
» Tel est l’ordre méprisant de l’empereur céleste. Mais le Shogun l’élude, retarde le moment d’obéir, sous prétexte qu’il y a des traités, et que ces barbares ont, dans leurs navires, de terribles engins de destruction.
» Quelle honte ! Trembler devant les étrangers ! Craindre de les irriter, quand on ose mécontenter le Mikado, et tous ses aïeux divins !
⁂
» Notre Suzerain Matsudaira Daïzen-no-Daïbou, prince de Nagato, n’a pas pu endurer cette humiliation, et c’est à notre clan, que revient l’honneur d’avoir attaqué le premier.
» Des châteaux forts de Nakatsu et de Nokura, qui défendent le détroit de Simonosaki, les batteries ont tiré, sur des navires étrangers, qui franchissaient la passe.
» Et, à cause de cela, on blâme notre prince. Le Shogun, suivi de sa cour est allé, de Yédo, à Kioto se prosterner devant le voile du trône céleste. Par des insinuations perfides il veut persuader au Mikado, qu’il faut user de ménagements, avec les barbares :
» Il est parvenu à convaincre l’In-no-Mya (Ier ministre) et notre illustre seigneur doit s’excuser. Son fils, le charmant Nagato-no-Kami, se rend à Kioto.
⁂
» Oh ! qu’elles sont lourdes au cœur les journées de solitude, d’angoisse et d’attente ! Elles semblent interminables et pourtant, comme toutes se ressemblent, les mois passent, sans laisser d’autre souvenir que celui d’une monotone souffrance.
» Dans ce grand château de Fusimi, sauf la garnison, qui veille aux murailles, il n’y a plus que les femmes. Notre princesse réside au château d’Hagi, et l’ordre ne nous est pas parvenu de la rejoindre.
» Aucun service ne nous appelle plus. Les robes de cour, comme de belles mortes au cercueil, sont couchées dans les coffres parfumés. Qui donc les réveillera ? Quand donc, la houle bruissante des satins et des brocarts, ondulera-t-elle encore, sur la blancheur neigeuse des nattes fines ?
» Hélas ! il semble bien que tout est fini. La perspective des salles, par les châssis entr’ouverts, reste toujours vide. Seul, le messager que guette l’anxiété, parfois, apparaît au loin sur la lumière des jardins, s’avance et se prosterne, apportant de confuses nouvelles.
» Oh douleur ! il n’est plus le temps, où nous savourions chaque heure comme un fruit mûr ; ou quelque fête de l’esprit, était le cœur de chaque jour. Alors, aucune grâce de nos manières, aucune inflexion de notre beauté, n’était sans la récompense d’un regard ou d’un sourire. Ceux que nous courtisions nous accueillaient avec une bienveillance émue. Quand nous nous prosternions, pour l’hommage, nous nous épanouissions à leurs pieds, comme les fleurs des parterres : l’ardeur de leurs yeux était des rayons de soleil. Ils proclamaient la femme être l’accoudoir de leur âme, la parure de leur pensée…
» Maintenant la femme n’est plus rien : sa beauté inutile est une floraison ignorée du printemps.
⁂
» Les nouvelles deviennent terribles ; l’empire se déchire en lambeaux. Le clan de Nagato, désapprouvé pour avoir obéi, se révolte. Les samouraïs de notre prince, ont jeté le casque et pris la coiffure masque de ronine. Ils parcourent les routes et combattent en soldats libres, pour venger l’honneur de leur daïmio méconnu.
» Mort aux étrangers ! est plus que jamais leur cri de combat. Ils égorgent ces intrus, quand ils les rencontrent, ayant l’audace de braver notre haine, en foulant le sol du Japon.
» Mais le Shogun les soutient toujours ; veut des représailles pour les meurtres, et cherche à convaincre le Mikado, qu’il faut ménager ces importuns.
» Qu’ils soient dispersés comme la poussière avec le balai ».
» Les grands daïmios de l’empire se groupent autour du Fils des Dieux ; d’autres soutiennent le Shogun, et la confusion est affreuse.
» Oh ! les jours d’autrefois ! la fête des chrysanthèmes de l’an dernier, où, pour la première fois, entre des touffes d’or et de pourpre, celui qui a cueilli mon cœur, m’apparut, hautain et charmant !
» C’est l’anniversaire aujourd’hui, et je cache mon visage, sous ma manche trempée de larmes…
⁂
» Les Dieux ne vont-ils pas descendre sur la terre, pour nous châtier ? … Je ne puis croire le message effrayant qui vient d’arriver : Nagato veut marcher sur la capitale sacrée, attaquer les mauvais conseillers du Mikado, et reconquérir les bonnes grâces du maître. L’offense qu’il a subie explique cette folle audace ; mais un tel sacrilège, va le perdre à jamais. Le feu et l’acier, la menace et la violence, autour des palais qui, depuis vingt siècles, sont le vestibule du ciel ! le pieux silence, déchiré par les clameurs et les cliquetis d’armes ! Le Fils des Dieux, attaqué par un homme !
» Malheureuse ! ne vais-je pas, moi aussi, blâmer notre prince ? Non, non, mon souffle est à lui, et le sacrilège serait, de ne pas être, même criminelle, avec lui.
» Ici, au château de Fusimi, nous sommes tout près de Kioto, au cœur même de la guerre.
⁂
» C’était vrai, l’attaque est décidée. Nos troupes sont précipitamment rentrées au château.
» Tous les grands chefs sont ici ; et c’est un tumulte extraordinaire, après l’anxieux silence de notre solitude.
» Est-il là, lui ? osera-t-il tenter de me voir ? Garde-t-il, sous la dure cuirasse, la fleur fragile d’amour ? Voudra-t-il en aspirer un fugitif arôme ?
» Dans ma demeure, sous les grands cèdres, je guette sans relâche, à l’angle de la balustrade !
⁂
» Il est venu ! … Invisible, à travers le bois de bambous. Il m’est apparu, à la faible lueur de la lune décroissante.
» À ma vue, son beau visage sévère s’est adouci… J’ai tendu les bras. Je me suis penchée, par dessus la balustrade, tandis que, s’aidant des branches et des poutres, il se soulevait jusqu’à moi.
» Ah ! quel long baiser éperdu et avide ! … Nous y avons bu, d’un seul coup, toutes les délices de l’amour.
» — Ma mort sera embaumée de toi ! a-t-il dit.
» Et il s’est enfui ! …
» — Pour jamais ! pour jamais !
» Sur mon cœur, à grands coups, comme sur une cloche, heurtent ces mots.
» — Pour jamais ! pour jamais !
⁂
» En pleine nuit, c’est le départ des combattants. Un bruissement, pareil à celui de la mer, emplit les jardins ; par instants, des appels de trompette éclatent, et, de tous côtés, des lueurs rouges jouent l’incendie.
» Je ne puis y tenir ! Cachant ma tête dans l’enroulement d’un voile sombre, par des chemins détournés, je cours aux remparts et j’en gravis la pente. Beaucoup de mes compagnes ont fait comme moi, et nous nous serrons, en un groupe tremblant. Oh ! l’extraordinaire spectacle ! à la clarté confuse des torches résineuses et des lanternes blasonnées. Depuis deux cents ans, que régnait la paix, tout ce harnachement de guerre restait invisible ; nous ne le connaissions que par les peintures. Les voici donc, ces cuirasses pesantes ; ces casques étranges, aux masques de bronzes, hérissés de poils, avec le rictus sur leurs dents d’argent ! ces fouets aux lanières d’or, ces lances aux lames luisantes, de formes si diverses, ces orgueilleuses bannières qui soufflètent le vent.
» Oh ! quel tableau superbe et terrible ! dans l’angoisse de la nuit !
» Comme un fleuve noir sous l’arche d’un pont, l’armée coule sous la voûte du portail. Les soldats marchent d’un pas vif, qui sonne en imitant la grêle ; les fossés franchis, ils s’alignent en carrés d’ombre, et restent immobiles, la lance au poing, ou la main appuyée sur la bouche de l’arme nouvelle, le fusil venu de l’occident. Des lueurs, comme des serpents rouges, montent le long des armes.
» Mais voici que le flot tarit, un instant, sous la voûte de la grande porte, qui reste vide, et aussitôt émergent de l’ombre, s’avancent, au pas de leurs chevaux, les trop grands chefs.
» D’abord, Masuda, qui commande la réserve, il est précédé des deux étendards sacrés. Sur l’un d’eux est brodée l’image du divin guerrier, Kantoni Daï-Miojin, venu du ciel pour soumettre le Japon ; sur l’autre, le portrait de Kora Daï-Miozin, ministre de l’impératrice Zin-Sou qui conquit la Corée, il y a seize siècles.
» Puis, vient, Echigo, gouverneur du palais où nous sommes, et, enfin, paraît Kounishi, le chef suprême…
» Il prend la tête de l’armée, et passe, très éclairé par les porteurs de torches, juste au dessous de moi et son image se grave à jamais dans ma mémoire.
» Devant lui, on porte la bannière du clan de Nagato où l’on voit la ligne horizontale surmontant trois boules, qui signifient : le premier grade.
» Les pièces de son armure de corne noire, sont liées par des points de soie verte, et jouent sur le vêtement de dessous, en brocart de Yamato. Son manteau de guerre est en gaze blanche et des dragons, peints à l’encre de chine au revers de l’étoffe, transparaissent comme une fumée. Il tient a la main le fouet de commandant aux lanières dorées. Il n’est pas masqué, et l’expression intrépide et implacable de son visage, me glace d’effroi.
» Il passe, et derrière lui, avec un bruit d’orage, roulent deux canons, gardés par trente soldats, armés de piques. Et les noires cuirasses défilent, presque invisibles, reflétant çà et là, comme ferait de l’eau, les torches fumeuses.
» Fukubara Echigo prend la même route ; je le vois venir vers moi dans une clarté plus vive. Sous le casque de guerre en cuir bronzé, sa figure fière respire un héroïsme enthousiaste, qui émeut le cœur. Son manteau écarlate s’étale sur la croupe du cheval. J’aperçois sur l’épaule du prince son emblème brodé : le trèfle à trois feuilles. Des points pourpres attachent les pièces de l’armure.
» Déjà il est passé avec les bannières, ayant aussi derrière lui, des canons, et cinq cents cuirasses le suivent. Mais Lui, Lui ! je n’ai pas eu le douloureux bonheur de le voir. Sans doute il est auprès de Masuda, qui a pris une autre route.
» Et toute cette armée, qu’accompagnent de grandes ombres dansantes, pareilles à des spectres noirs, et des nuages de fumée rougie, s’enfonce dans la nuit, disparaît…
» Longtemps, longtemps, nous écoutons le grand bruit rythmé, qui s’éloigne.
⁂
» Qu’il est douloureux d’être femme, en de tels jours ! Notre souffrance, stagnante et vaine, est presque impossible à endurer.
» Nous nous sommes réunies, toutes, dans le palais central ; incapables de demeurer, seules, dans nos pavillons réservés.
» Ô ! le piétinement fiévreux, à travers les chambres vides, les mains crispées et froides, les brusques arrêts du cœur, à l’entrée d’un messager.
» D’heure en heure il doit nous en venir, pour nous empêcher de mourir d’angoisse. À peine le soleil se lève-t-il, et en voici un, déjà.
» Il s’est prosterné, et il me semble que ses larmes s’égrènent sur la natte blanche.
» Avec un tremblement nous attendons qu’il parle, sans oser l’interroger.
» — La Ville sainte est pleine de combattants, qui sont accourus pour défendre le Mikado outragé. Devant le danger, le Shogun s’est soumis ; tous ses samouraïs sont là, et les daïmios de la famille de Tokougava, commandent leurs troupes ! Stotsubachi, Echigen, Kouvana, Aidzu. Le prince de Satsuma, a envoyé des soldats, le prince de Chikouzen, garde lui-même une des portes du palais.
» Les adversaires les plus haineux, se cotoient et oublient leurs querelles ; ils font rempart de leurs corps au fils des Dieux.
» Le messager ne sait rien de plus, le petit nombre des assaillants devant cette formidable défense fait frémir. »
Pendant qu’il parle encore, le canon commence à gronder au loin.
« D’un élan irrésistible, nous quittons encore les salles, courant à travers les jardins ; et nous voici de nouveau sur le chemin de ronde, penchées entre les créneaux. Puisque nous entendons, il nous semble que nous pourrons voir aussi ; mais on voit seulement la campagne, à l’infini, qui fume toute rose, au soleil levant.
» Ô ce globe pourpre, sur la brume d’argent ! On dirait l’étendard du Japon, déployé, par les dieux mêmes, au-dessus de la ville sacrée !
⁂
» Dans la poussière soulevée, un cavalier, dont le cheval semble emporté… Il passe au-dessous de nous, franchit le pont sonore, et s’engouffre sous la voûte.
» Serrant mes robes autour de moi, je cours, entre les cèdres du terre-plein, pour savoir plus vite ; devançant mes compagnes, qui, leurs toilettes éparses, luttent contre le vent.
» Aux pieds du vieux gouverneur, le messager, la respiration sifflante, essaie de parler ; le cheval tremble sur ses pattes, s’affaisse.
— » Notre grand chef, Kounishi, d’un élan impétueux, est entré à Kioto, forçant la porte Nakada-Kiuri, gardée par le prince de Chikousen. Les soldats vainqueurs refoulent l’ennemi, jusqu’aux remparts du palais sacré ; ils attaquent la Porte des Seigneurs, que défendent, avec leurs meilleures troupes, les princes d’Aidzu de Kouvana. Mais ceux de notre clan triomphent encore malgré leur petit nombre ; sur les talons d’Aidzu et de Kouvana, qui s’enfuient, ils franchissent le saint portail et pénètrent dans les mystérieux jardins. »
» Est-ce donc possible ? … à cette heure même, le fracas des armes déchire brutalement le séculaire silence ! les flèches et les balles tranchent les douces fleurs, qui expirent leurs parfums ! la fumée souille la pureté de l’air, et la déesse Amatératzu, divine aïeule du Mikado, armée de sa lance rayonnante, ne descend pas du ciel, irritée et terrible ! …
⁂
» Je ne peux plus quitter la poterne. On attend, là, les messagers. Plus vite on entend leur parole haletante.
» Nous sommes toutes groupées autour du gouverneur, dans le courant d’air de la voûte qui rafraîchit notre fièvre. Les filles d’honneur bavardent, nerveusement, exaltées par la victoire.
Le vieux gouverneur, lui, ne parle pas. Droit et raidi dans son anxiété, il darde son regard pâle vers la route.
Je me tais aussi. Par ma gorge serrée, ne pourrait passer aucune parole. Il me semble que mon cœur laisse fuir une cascade rouge.
⁂
« — Le prince de Satsuma s’est porté au secours d’Aidzu. Les vainqueurs de Nagato, un contre dix, ont été rejetés hors de la Porte des Seigneurs, et un effrayant combat a lieu, en ce moment même. »
« Le dernier venu, sanglote cette nouvelle.
» La victoire est effacée, déjà, par la défaite.
» Le messager dit encore, que le daïmio d’Issé, qui avait franchi l’Idogava avec ses partisans, a repassé la rivière et s’est éloigné, ne voulant pas combattre contre ceux de Nagato.
» Tandis qu’on l’écoute, un bruit de galop, sur la route, nous précipite au pont-levis.
» La lance au poing, un groupe d’écuyers s’approche. L’un d’eux porte, respectueusement, quelque chose, enveloppé dans une bannière ; du sang s’égoutte, à travers l’étoffe ; une trainée s’est caillée sur le poitrail et sur une patte du cheval, Ô ! l’héroïque et terrible épisode ! Nous sommes tous prosternés sur les dalles de la cour, pour accueillir dignement le précieux fardeau : la tête du chef Matabaï.
» Elle est là, dans la bannière, étendue sur le sol ; couleur de cire, les yeux clos, les sourcils froncés, et nos larmes coulent, en écoutant comment cette chère tête est glorieusement tombée.
» — Blessé à mort, Matabaï se voit abandonné par ses soldats qui reculent. »
« — Enlevez ma tête, au moins, et emportez-la, crie-t-il, ne m’infligez pas cette honte, de la laisser aux mains de l’ennemi ! »
« La mêlée est affreuse, on hésite.
« — Guerriers stupides et indignes, crie-t-il encore, vous serez déshonorés avec moi. »
« Son neveu l’a entendu, il bondit par dessus les morts et les vivants, frappant de son glaive, avec fureur : il atteint le blessé, tranche cette noble tête, et parvient à s’échapper.
» Un grand frisson me parcourt — d’enthousiasme ? ou d’horreur ? — je ne sais. Je revois le tout jeune homme, cette nuit même, courbé sur son cheval, levant ses yeux sombres sur le visage du chef Matabaï, qui lui parle rapidement. Je revois la main, crispée sur les rênes pour maintenir le cheval indocile, le luisant de l’étrier sous la lueur des torches, et l’opacité de la nuit, alentour. Cet enfant a dû faire cette chose affreuse, et pour cela, il est glorieux, à jamais !
» Des blessés, des mourants, en défilé lugubre, à présent ; en travers des chevaux, sur des branchages, on les apporte au château. Les salles s’emplissent, et, en un instant, les nattes blanches du sol deviennent des nattes rouges.
» Le cœur tordu de désespoir, nous essayons, en vain, de soulager. Nos frêles mains, ne peuvent arrêter tout ce sang ! Oh ! les effrayants visages de souffrance ! les pâleurs de damnés ! cependant, si on entend des râles, aucun de ces héros, ne laisse échapper un gémissement.
» Hélas ! hélas ! les nouvelles funestes, tombent sur nous, comme une grêle de pierre : Notre chef suprême, Kouniski, est vaincu, écrasé ; la déroute emporte ses soldats.
» Masuda assiège le palais de Takatsu-Kasa, défendu par le prince de Hikone ; la lutte est terrible en ce lieu ; il y a, entre les hommes de Nagato et ceux de Hikone, des duels si formidables, que les combattants s’arrêtent, pour les contempler.
» Echigo résiste encore aux samouraïs d’Ogaki ; il a pris deux canons à l’ennemi. Mais quelqu’un dit, l’avoir vu tomber de cheval, grièvement blessé, emporter dans une litière.
» Jo-hi ! Jo-hi ! (hors les étrangers) est-ce donc vraiment pour ces êtres méprisables, pour ces inconnus chassés comme des chiens, qu’ont lieu de pareils massacres, que tous les fils du Japon, comme pris de folie, s’entr’égorgent ?
⁂
» Oh ! Qu’est-ce donc ! … Ces cris, ce tumulte ? … peut-être, dans mon sommeil fiévreux, un cauchemar, qui m’éveille ? …
» Non, non, c’est la réalité, plus affreuse encore ; l’armée, ce qui reste de l’armée, fuyant, poursuivie, qui rentre, en désordre, dans le château.
» Je vois de ma fenêtre, les soldats se répandre dans les jardins, traînant des morts, des blessés, qu’ils couchent sur les gazons…
Et Lui ! Lui ! … Oh ! oh ! …
⁂
Pavillon des Perles Rouges.
Au Yosi-Wara !
« C’est une morte, qui reprend le pinceau, après tant de jours, tombés sur elle, comme des coups de poignard dans une chair inerte.
» Je lui dois, à Lui, d’écrire encore pour que l’on sache la vérité, et si j’ai pu exécuter son ordre.
» L’Enfer ! je l’ai traversé, mais sans atteindre le néant : je suis dans un lieu pire que l’enfer, et c’est par ma seule volonté que j’y suis.
» D’un œil morne, je relis, sur le rouleau de soie, les caractères en désordre, que j’ai jetés là, d’heure en heure, pendant la terrible journée.
» Ils cessent au cri de douleur qui me déchira, quand je le vis, porté par deux ronines, les yeux clos, si pâle qu’on eut dit qu’un rayon de lune l’enveloppait.
» J’étais près de lui, presque aussitôt, sans savoir par ou j’avais passé, échevelée, dans mes vêtements de nuit.
» On l’avait étendu sur un tertre, puis laissé, seul, évanoui ; … mort ? … non ! il ouvrit brusquement les yeux, comme éveillé par mes sanglots, des yeux où vivaient une flamme de colère effrayante. Il me vit, il me reconnut. Ses lèvres, déjà closes sur l’éternel silence, s’entr’ouvrirent, un souffle précipité souleva sa poitrine, il voulait parler.
Terrassant ma douleur, je mis mon oreille à sa bouche…
— Si tu m’aimes, venge ma mémoire. Un homme de Hikone, un lâche, m’a frappé par derrière, pendant que, blessé déjà, je luttais contre un loyal adversaire. Celui-ci, devant cette action, avec dédain, s’est détourné, et j’ai pu saisir l’infâme à la gorge, le voir en face. Les forces m’ont trahi. Venge-moi, et, après, viens me rejoindre, pour l’éternel amour ! …
— L’homme ! l’homme ! son nom ? Déjà sa voix n’obéissait plus, ses lèvres s’agitaient en silence. Ô quelle angoisse ! Les yeux élargis, d’une fixité horrible !. Me voyait-il seulement ? … Il les ferma, puis les rouvrit et, dans un effort suprême, balbutia.
— Pas de nom ! … Cuirasse arrachée… Sous la mamelle… un tatouage… trois fleurs de cerisiers…
— Trois fleurs de cerisiers ! avais-je bien entendu ? …
Ses yeux me dirent « oui » et, aussitôt l’haleine de la mort souffla sur eux sa buée, les ternit à jamais ! …
⁂
L’écrasant fardeau de la vie, il fallait le porter, le sauver même, à grand’peine, car la mort tendait mille bras pour m’en délivrer.
L’horreur, autour de moi, me laissait aussi insensible que pouvait t’être la chimère de bronze, assise au pied des escaliers. L’assaut du château : Hikone, Satsuma, Aidzu, hurlant aux portes ; la défense désespérée des héros, — qu’on n’aurait pas vivants, — les râles, les agonies, tout cela tombait, sur la plénitude de ma douleur, comme l’eau dans un seau qui déborde.
L’idée fixe, ainsi qu’une épine dans mon front, s’enfonçait, cuisante, « trois fleurs de cerisier… un homme de Hikone ». Harcelée par ces mots, j’agissais machinalement, avec précision, m’habillant comme pour un voyage, réunissant les choses précieuses faciles à emporter.
Comment m’échapper ? comment me garder vivante ? De lourdes ondes de fumée commençaient à ramper, jusque dans les jardins. Les assiégés allumaient leur bûcher, se livraient aux flammes, pour échapper aux vainqueurs.
Le château était comme une tombe murée. Allais-je donc désobéir ? … On jeta une torche enflammée, sous les pilotis de mon pavillon, qui prit feu, craqua. Je descendis, à travers la fumée étouffante.
— Ne pas mourir ! …
Je longeai le ruisseau, j’atteignis l’étang, et, détachant une barque, je la poussai vers le milieu. Le feu ne me prendrait pas là, les arbres environnants, pleuraient sur leurs brûlures, les éteignaient.
À travers les ruines fumantes ; les vainqueurs m’ont laissée passer, riant de moi, m’envoyant des compliments moqueurs. La bannière de Hikone flottait… Il était parmi ceux-là, sans doute, l’homme aux fleurs de cerisiers ! … Oh ! pourquoi mes yeux ne voient-ils pas à travers les cuirasses ? … Comment écarter les tuniques, pour mettre à nu les poitrines ? …
⁂
La réponse me vint, brusquement, en traversant un village incendié.
« Les prostituées seules, peuvent voir les hommes nus… beaucoup d’hommes ! … »
⁂
C’est pourquoi je suis ici, au Yosi-Wara. Araignée sinistre, guettant, du bord de sa toile, une proie, qui, peut-être, ne se prendra jamais au piège.
⁂
Des jours ! des mois, des années ! oh ! si lourds ! comment n’en suis-je pas écrasée ? Ma vie est, le plus souvent, un demi-sommeil. Les plantes, à l’ombre, doivent végéter de cette façon !
⁂
Ces présences odieuses, que je dois subir, ces étreintes, ce viol de mon corps, est-ce que j’en souffre ? Non, pas plus que le cadavre, de l’attouchement des vers.
C’est tellement pareil ici, aux châteaux princiers, on simule avec tant de soin le cérémonial, on observe si bien tous les usages, que, dans de fugitifs instants, je me crois encore là-bas, à la résidence d’Hagi, près de ma souveraine. L’illusion dure peu ; mais me laisse un confus désir de savoir ce qu’il est advenu d’elle et de l’illustre prince, notre Maître, après tant de catastrophes. Comment la guerre a-t-elle fini ? Quel bienfait a pu fleurir, de tant de sang répandu ?
On dirait que des siècles se sont écoulés, pendant ces trois années, si longues. Autour de moi, par moments, mes yeux distraits, sont surpris par d’incompréhensibles choses.
J’ai fait parler les êtres qui m’approchent, et c’est comme un chaos, dans mon esprit.
Le shogunat n’existe plus ! Il n’y a plus de princes souverains ! Le nouveau Mikado, qui a dix-sept ans, abandonnant Kioto, et tout le mystère divin qui entourait sa sainteté, proclame la capitale de l’empire : Yeddo, qui s’appelle désormais : Tokio. Après de grandes luttes encore, tout semble apaisé. Nagato, pardonné et rentré en faveur, est premier ministre… Alors, à jamais, les étrangers maudits sont chassés, hors du Japon, puisque ceux qui avaient, à cause d’eux, déchaîné cette guerre terrible, ont remporté une victoire complète. Eh bien, non, au contraire, ils viennent en foule à présent, on les appelle, on les traite en frères, on veut leur ressembler, on les imite, il n’y a plus qu’eux ! … C’est comme s’ils avaient soufflé sur nous un vent de folie ! …
Je ne croirais rien de ces sacrilèges histoires, si je ne voyais pas de si étranges symptômes autour de moi.
Mais que m’importe ? Nagato est rentré en grâce, c’est tout ce que j’ai retenu.
⁂
Ô mon bien-aimé. Je perds tout espoir et mon martyre est inutile. Jamais tu ne seras vengé, jamais tu ne m’accueilleras, par delà les nuages, pour l’éternel amour.
Ces trois fleurs de cerisiers ! N’est-ce pas là, une vision de ton agonie ? Jamais aucun tatouage ne m’est apparu, sur les poitrines, courbées vers moi, pour ma honte. Peut-être a-t-il été tué aussi, l’homme de Hikone ! Alors ! … Oh ! Alors ! …
⁂
Tu devrais m’apparaître en rêve, me consoler, me soutenir. Je suis exténuée, au milieu d’un désert sans limites, si seule, si perdue ! …
Viens me dire, que tu rapportes ton ordre, que je peux te rejoindre ; ou bien, si tes mânes irrités veulent toujours la vengeance, inspire l’ennemi, pousse-le, traîne-le jusqu’ici.
⁂
Enfin ! Enfin ! l’œuvre est faite ! la vengeance accomplie ! Je suis libre ! …
L’homme est là ; il gît, frappé dans le dos par le poignard, que je portais toujours, caché dans mes cheveux.
C’est bien lui. Cherchez sous sa mamelle, les trois fleurs de cerisiers. Elles vous diront que l’homme châtié était un lâche, qu’il a frappé, traîtreusement, un noble guerrier, combattant, en face, un guerrier loyal.
Il était devenu un personnage puissant, l’homme de Hikone, il occupait une haute charge, à la nouvelle cour, il était heureux. Tant mieux ! plus la vie lui était chère, plus j’ai eu de joie à la lui arracher. Il a su pourquoi il mourrait, je le lui ai crié, avec des insultes.
Ô mon bien-aimé, je sens ton souffle qui me caresse. Je viens ! je viens ! mais pas ici, que mon sang ne se mêle pas à ce sang vil. Dans le jardin, à l’air libre ; pour nous envoler plus vite !
⁂
Un long silence régna, quand Jeune Saule eut cessé de lire. Toutes les femmes, réfléchissaient profondément, sur ce qu’elles venaient d’entendre ; quelques-unes essuyaient des larmes.
Très rêveuse aussi, Jeune Saule roula lentement le manuscrit et le replaça dans son étui de laque.
Ce fut l’Oiseau-Fleur, qui la première releva le front.
— Après une aussi terrible histoire, dit-elle, on ne devrait plus rien conter. L’usage, veut, cependant, que la reine d’un jour, qui préside la réunion, parle après ses sujettes, en terminant le tournoi. Je veux donc me conformer à l’usage, en vous disant, brièvement, une histoire, différente des vôtres, car il n’y est pas question d’amour. Elle est un exemple frappant, à mon avis, de notre caractère ; et elle montre, combien l’éducation, si haute, que l’on nous donne, peut rendre, dans un corps impur, noble l’esprit, et généreux le cœur. Voici :ÉVENTAIL DE RAYONS
Mitzu-Vogi (Éventail de Rayons) était célèbre, parmi les grandes oïrans, autant par sa beauté, sa coquetterie effrénée et son luxe, que par les raffinements de ses amours, et, surtout, son arrogance, cruelle ou câline. Elle feignait, de feindre qu’elle n’aimait pas, ou simulait, des élans de passion désordonnée, qui affolaient ses amants, sans que jamais son cœur, à elle, eût un battement plus vif. Les fortunes, elle les dévorait, puis rejetait, loin d’elle, l’homme ruiné, comme la pelure d’un kaki.
Un jour, on lui annonça, qu’une femme demandait à la voir, pour lui présenter des flèches à cheveux, en corail, d’un rare travail. Comme elle désirait, justement, acheter des ornements de cette espèce, Éventail de Rayons laissa entrer la marchande.
Une femme, amaigrie et pâle, s’avança, lui tendit, d’un geste brusque, le coffret aux épingles, qui tremblait dans sa main, tandis qu’elle attachait, sur la belle oïran un regard avide et presque affolé.
Celle-ci, un peu surprise, essayait les épingles, quand tout à coup, poussant un cri sourd, la femme tomba, évanouie, sur le sol.
On la soigna avec empressement ; mais, dès que l’inconnue reprit connaissance, Éventail de Rayons fit sortir toutes les suivantes.
À l’extrême distinction de la personne, à l’élégance sobre du costume, elle avait vite deviné que ce n’était pas là, une marchande.
— Noble femme, lui dit-elle, que venez-vous faire ici ? quelle souffrance vous fait si pâle, et que puis-je pour vous servir ? …
— Je venais vous supplier de me rendre mon époux, s’écria l’étrangère en sanglotant ; mais en voyant votre triomphante beauté, j’ai compris, combien l’on a de raisons, pour vous préférer à toutes, et que je n’ai qu’à mourir ! …
— Dites-moi le nom de votre époux et je vous jure de ne plus le recevoir, répondit Éventail de Rayons. Gardez-vous de douter de ma parole : c’est le premier serment que je fais, sérieusement, je le tiendrai, soyez-en certaine. Et, maintenant, ne sanctifiez pas plus longtemps, par votre présence, ce lieu impur.
La triste épouse, s’en alla, un peu réconfortée.
Rigoureusement, la folle oïran tint sa promesse. Comme pour en fixer le souvenir, elle portait toujours, dans ses cheveux, les épingles de corail, que l’honnête femme lui avait laissées.
L’amant éconduit, malgré tous ses efforts, ne la revit plus.
Quelques mois plus tard, un matin, qu’Éventail de Rayons à l’ombre des grands arbres de son jardin, faisait de la musique, elle vit s’avancer, franchissant le petit ruisseau, sur le pont en laque pourpre, cette même femme, accompagnée de trois petits enfants.
Sa pâleur s’était accrue, et ses traits se creusaient davantage.
— J’avais bien deviné qu’on ne guérissait pas de vous, dit-elle, vous avez tenu votre promesse, mais au lieu de le calmer, cela n’a fait qu’empirer le mal. Le désespoir s’est emparé de votre amant, loin de vous il ne pense qu’à vous, et la jalousie le dévore si cruellement, à l’idée qu’il est exilé, tandis que d’autres vous approchent, que je viens vous rendre votre parole, vous supplier d’accorder encore vos bonnes grâces, au malheureux, qui s’en va mourir, afin de conserver un père, à ces pauvres petits-là.
Elle poussait les enfants, délicieusement gauches, vers la courtisane, toute stupéfaite, qui les attira contre elle, les contempla longuement. Peut-être, n’avait-elle jamais vu d’enfants.
Un voile de tristesse, sembla tomber sur son beau visage, éteignit son sourire et elle dit, comme à elle-même, après un long silence :
— Voilà donc cette chair tendre et suave, que nous dévorons, sans le savoir, en faisant fondre, au feu de nos baisers, la fortune des pères. Ô pauvres monstres inconscients que nous sommes !
Il sembla troublé de larmes, son regard, quand elle le posa, sur les yeux de l’épouse douloureuse, qui, par elle, avait tant pleuré.
— Puisque la jalousie le consume et qu’il ne peut s’en défendre, lui dit-elle, que l’infidèle époux, vienne, ici, demain. Il me verra, car il ne faut plus qu’il soit jaloux.
Le lendemain ce fut une morte, que l’amant éperdu, contempla ; toute blanche, sur le lit somptueux.
Éventail de Rayons avait bu du poison, après avoir tracé ces lignes, sur son éventail :
« Qu’est-ce que cela pèse, l’existence d’une courtisane, contre celle d’une noble famille ?
« J’ai fait mon devoir. Que votre femme et vos enfants, vous dictent le vôtre. »
— Cette mort est certainement la plus noble et la plus désintéressée, de toutes celles dont nous avons parlé, dit Ko-Mourasaki, en se levant, l’histoire nous fait beaucoup d’honneur, il me semble.
— Nous remercions notre reine de nous l’avoir contée, dit Jeune Saule.
Et comme l’heure des réceptions approchait, les oïrans, rappelèrent leurs suivantes, et après avoir pris congé de l’Oiseau-Fleur, sans rien omettre du cérémonial prescrit, descendirent, majestueusement, l’escalier, et se retirèrent.PLEURS ET PARFUMS
L’Oiseau-Fleur, allongée sur le sol, la tête dans ses mains, pleure à grands sanglots, tandis que Broc d’Or, debout et navrée, contemple la nuque de sa maîtresse, qui semble du satin blanc, entre le satin bleu de la robe et le satin noir des cheveux.
La belle princesse d’amour, a reçu une lettre terrible : Le daïmio de Kama-Koura, s’oppose absolument à sa libération, et à son mariage avec le prince son fils. La courtisane n’entrera pas au château ; on n’y donnera le nom de fille, qu’à une princesse authentique, descendante d’une famille égale à celle de Kama-Koura. Le prince a juré qu’il ne céderait pas ; mais comme il ne peut rien, sans l’argent nécessaire à la délivrance de sa bien-aimée, il ne se révolte pas ouvertement, n’ayant pas perdu tout espoir de fléchir ses parents.
C’est cette résignation, surtout, qui terrifie la pauvre amante…
— Il ne pense donc pas, gémit-elle entre ses larmes, que le temps, pour lequel il a acheté ma liberté, est épuisé depuis huit jours, que je vais être contrainte à exercer mon horrible métier, à me livrer au premier venu. Certes, je serre la mort sur mon cœur avec tendresse quand je vois cela ; mais la mort, c’est aussi la séparation, et quand il viendra pour me chercher, mon bien-aimé pleurera.
Broc d’Or, penchée vers elle, s’efforce de l’apaiser.
— Le Seigneur Yamato a ajouté quelques lignes à la lettre du prince, dit-elle ; il nous assure, que lui, qui a causé le mal, fera tout pour le réparer. Si nous parvenons à gagner un peu de temps, il a un projet qui, réussissant, nous sauverait. Le prince est captif dans le château de son père ; mais Yamato est libre, et agit.
— Que veux-tu qu’il fasse ? il arrivera trop tard. Je ne laisserai pas les limaces, baver sur la fleur, que le papillon bien-aimé a éventée de ses ailes.
— Gagnons du temps.
— Comment ?
— Avant d’être à votre service, où je ne gagne rien, puisque vous êtes vertueuse, j’ai servi une grande oïran, qui accueillait beaucoup de seigneurs et j’ai reçu d’eux, de nombreux bouquets : ils forment un joli parterre, qui libérerait la princesse d’amour, encore quelques mois, si elle voulait bien l’accepter de moi.
— Tu me donnerais toute ta fortune, avec le risque qu’elle ne te soit jamais rendue… Car elle s’évaporera bien vite et sans doute ne suffira pas…
— Ce qui va certainement s’évaporer, si vous continuez ainsi à pleurer, dit Broc d’Or d’une voix grondeuse, c’est cette beauté ravissante, qui vous a conquis le cœur du prince. Vos yeux sont rouges, vos joues sont toutes marbrées, votre bouche se crispe, au lieu de sourire.
L’Oiseau-Fleur se releva avec effroi, courut vers son miroir, qui, brillant comme la pleine lune, arrondissait son disque d’argent au milieu de bambous sculptés.
Broc d’Or frappa ses mains l’une contre l’autre.
— Allons ! allons ! cria-t-elle, vite, la toilette de la princesse ! Nous aurons bientôt fait d’effacer les traces d’une nuit d’orage, et la beauté redeviendra délicieuse et fraîche comme une fleur au soleil levant.
Les Kamélos entrèrent, portant des linges souples et de mystérieux coffrets de laque, fermés par des cordes de soie.
Deux serviteurs, complètement nus, apportèrent la baignoire de forme ovale, en bois laqué orné de papillons d’or ; ils la remplirent d’eau chaude et disposèrent, dedans, de grandes touffes d’iris en fleur, avec leurs racines.
Les Kamélos délayèrent dans l’eau, de la farine de riz et y versèrent des parfums.
Alors, l’Oiseau-Fleur, laissa tomber ses vêtements de nuit et sa chair, pareille à la pulpe des nénuphars, attira toute la lumière ; elle resplendit, plus blanche encore par le contraste des profonds laques noirs ; mais, pudique, elle enjamba vite le rebord de la cuve et se plongea, en poussant de petits cris, dans l’eau, qui était très chaude.
Bientôt, Broc d’Or, d’après une recette tenue en grande estime, considérée même comme sacrée, trempa dans l’eau du bain, un sachet de toile, empli de fiente de rossignol, et en frotta lentement le corps de sa maîtresse, ce qui rendit la peau extrêmement lisse et brillante.
Après quelque temps on l’aida à sortir de l’eau, et après l’avoir essuyée avec des linges doux, on la frotta encore, à l’aide de pierres ponces.
Puis, enveloppée d’une draperie, molle, elle s’étendit pour se reposer, un instant, Broc d’Or lui servit une tasse de thé, dans laquelle une fleur de cerisier, séchée, s’épanouit à la chaleur, comme toute fraîche. Tandis qu’elle buvait, la fleur venait, doucement, caresser ses lèvres et elle soufflait dessus, avec une moue gentille, pour l’éloigner.
Après cela les coiffeuses s’approchèrent, pour accommoder le visage et les cheveux. Elles étendirent, sur la face et le col, une légère couche de blanc d’œuf, puis appliquèrent la poudre de riz, avec une mousseline molle. Après avoir rasé les sourcils, elles dessinèrent deux points noirs, tout en haut du front, et remontèrent le coin de l’œil par une ligne de carmin. La bouche mignonne fut aussi avivée de rouge ; puis l’on commença le travail compliqué de la coiffure.
Les lourds cheveux, noirs et luisants, furent dénoués et roulèrent jusqu’aux jarrets de l’Oiseau-Fleur ; mais après les avoir démêlés, avec des peignes en bois de Tsou-Yhé, les avoir oints d’huile verte de Natané, délicieusement odorante, on les releva, en les serrant le plus possible, et l’on posa dessus la perruque, toute disposée, en forme de papillon. Des épingles d’or la retinrent et on fixa, en avant du chignon, un peigne, surmonté d’une cigogne, d’argent et d’émail, aux ailes ouvertes.
Les coiffeuses se retirèrent, alors, et les habilleuses vinrent, portant un coffre à compartiments.
La princesse d’amour d’un mouvement d’épaule, fit tomber la draperie ; sa nudité, blanche et gracile, apparut de nouveau, singulière cette fois sous la tête volumineuse et apprêtée.
On se hâta de lui passer le juban, de soie rouge, à manches, s’arrêtant, en bas, aux genoux, fendu et croisé sur la poitrine, on mit, par dessus, une sorte de tablier, en tissu pareil, tombant jusqu’aux chevilles et faisant le tour des jambes.
On lui fit endosser, alors, le shitaghi, première robe, très légère, couleur de l’eau au clair de lune ; et on la soutint, tandis qu’elle tendait le pied, pour enfiler les tabis de soie blanche bleutée, à orteil séparé, et chausser les sandales de paille, doublées et agrémentées de soie, à semelles très hautes, et retenues seulement par un bourrelet ouaté, passé, en boucle, à l’orteil.
On apporta aussitôt la robe, qui était ce jour-là, en satin couleur de thé faible, toute couverte de poèmes, brodés en noir dans des carrés d’or.
Quand elle fut prête, on lui donna un très précieux sachet, qu’elle mit dans sa manche gauche. Ce sachet contenait un atome de l’inestimable parfum, appelé Janko, ou parfum du vieux chat. La légende raconte, que cette pierre odorante, s’était formée dans la cervelle d’un chat centenaire vagabondant sur des montagnes où on le poursuivit longtemps. Celui qui parvint à le tuer, s’empara du trésor embaumé, qu’il garda jalousement, jusqu’au jour, où sa fille, amoureuse d’un seigneur, en déroba la moitié pour le donner à son amant. Le père fit la guerre au ravisseur, afin de lui reprendre le musc unique ; mais il ne put y parvenir. Entre amants : « Veux-tu la moitié de mon parfum ? » est resté la protestation la plus ardente, pour exprimer une abnégation sans borne.
La princesse prit pour s’éventer un écrin rare et fragile, formé de l’aile d’un papillon géant, et aidée par les kamouros, qui soulevèrent la traîne de sa robe, dans l’escalier, elle descendit au rez-de-chaussée et sortit dans son jardin particulier, où il lui était enjoint de passer quelques heures, pour respirer l’air matinal.
C’est un grand jardin en miniature, avec une pagode, des rochers, des cascades, des pins et des cèdres, un étang, plein d’iris, sur lequel voguent les jolis oiseaux appelés : onidori.
Assise sous la vérandah enguirlandée de fleurs, la princesse soupire, en préparant sa pipette, dont elle tire distraitement quelques bouffées.
Des jardins voisins on entend s’envoler des chansons.
— Ne chanterez-vous pas aussi ? demande une des kamouros, en tirant de son enveloppe de soie le chamissen à long manche.
Pour masquer sa douleur, chanter peut-être ?
Elle prit l’instrument, et du bout du plectre de bois, gratta les cordes grêles ; une chanson triste lui vint aux lèvres.
« La neige voltige, pareille aux feurs de cerisiers sous un coup de vent.
» La fleur flétrie est quelque chose encore ; mais, sur la manche secouée, la neige ne laisse pas de trace.
» Ainsi, du cœur, s’efface le souvenir.
» Dans mon lit glacé, je pleure, moi qui n’oublie pas, et mes larmes gèlent sur l’oreiller.
» Pourquoi ce qui est si lointain, est-il si près de l’esprit ?
» J’écoute le silence, dans la solitude. Et voilà qu’une cloche, à coups durs, sonne l’heure.
» L’heure ! la même ! le minuit qui fut si doux !
» La grêle cingle ma porte et je me précipite pour ouvrir, comme si l’on frappait, sachant bien, pourtant, qu’il n’y a rien.
» Rien que la nuit affreuse, hostile, noire comme l’oubli.
» J’étais sans espoir, mais la déception brise en sanglots mon cœur ! »
» Hélas ! la nuit d’amour, où est-elle ? »
— Princesse ; ne chantez plus, si c’est pour pleurer davantage.
Et la kamouros enleva l’instrument. Mais Broc d’Or revenait.
Elle avait été négocier l’affaire, avec la tenancière de la Maison Verte, et c’était chose conclue. La Cigogne-Danseuse, par bonté de cœur, s’était laissée toucher. Elle avait d’ailleurs confiance dans le génie du seigneur Yamato, qui lui témoignait beaucoup d’égards. Elle avait donc consenti, à prendre toute la fortune de Broc d’Or, en échange d’un sursis de deux mois, accordé à l’Oiseau-Fleur.
Celle-ci, debout, frappait l’une contre l’autre, ses petites mains pâles.
— Ô ! Broc d’Or ! Ô ! ma douce compagne, tu as fait cela ? … Puisse ton dévouement ne pas être stérile en retardant un peu ma mort. J’ai jeté déjà tout ce que je possédais, dans le bec de cette cigogne avide, et je ne pourrais te léguer que mon cadavre.
— Ne pleurons pas les morts, quand ils sont vivants, dit la suivante, ne construisons pas l’avenir avec de la fumée. Si vous devenez une vraie princesse, j’aurai fait une bonne affaire ; si vous ne le devenez pas, j’aurai fait une bonne action.
— Les nobles cœurs, n’habitent pas seulement les nobles poitrines. Si la destinée est clémente pour moi, je jure que tu ne me quitteras jamais.
— Qui sait ? j’épouserai peut-être le seigneur Yamato. Quand il était ici, il m’a décoché des clins d’yeux significatifs, s’écria Broc d’Or, avec un franc éclat de rire. En attendant, ne perdons pas de temps, écrivez-lui le nouvel arrangement et stimulez un peu son zèle ; deux mois, c’est bien vite envolé.
Tout en parlant, elle jeta sur le sol un rouleau de papier blanc, gaufré de fleurs et d’oiseaux, prit la boîte à écrire et délaya l’encre.
La princesse, agenouillée sur le tapis, s’y appuyant de la main gauche, prit le pinceau et se mit à tracer, rapidement, des caractères.LA BARRIÈRE DE BAMBOUS VERTS
— Tu veux mourir ? … tant qu’elle est vivante, cela n’a pas de sens. Pourtant, si tu es irrévocablement décidé, c’est bien ! … je ferai tendre ce kiosque de draperies blanches et nous accomplirons ensemble le Hara-Kiri ; à moins que tu ne préfères être plus moderne, et user du revolver.
C’est tout au fond du parc, au bord d’un étang, devant une perspective ravissante, que Yamato dit ces paroles au jeune prince Sandaï, affalé sur les nattes, les deux bras sur l’accoudoir et le menton dans ses mains. Devant l’entrée de l’enclos réservé au jeune prince, une barrière légère, en bambous verts, indique, selon l’ancien usage, que le seigneur est prisonnier.
— Quelle raisons as-tu, toi, de quitter la vie ?
— Demande-le à ton père, et à la princesse ta mère, surtout, répond Yamato. On oublie, à présent, que l’on m’a sollicité, et que, avant d’agir, j’ai dit ce que je voulais faire. « Oui, oui, au Yosi-Wara, » affirmait le vieux seigneur en branlant la tête avec complaisance ; « j’y suis allé souvent dans ma jeunesse. » Il est vrai que l’épouse hautaine était fort offusquée, mais elle n’a pas fait d’opposition. Il s’agissait de sauver l’héritier du nom, que la chasteté consumait. Maintenant voilà ! Malédiction, rébellion, larmes, suicide, je suis cause de tout. On m’a chassé, dégradé, privé de solde, éloigné de toi, comme si j’étais une bête malfaisante. Comment veux-tu que l’on survive à tout cela, même dans le temps où nous sommes ? …
— As-tu nagé dans l’eau du fossé et escaladé la muraille, pour venir ici, puisque l’accès du château t’est défendu ?
— Ta longue tirade, sur ton désespoir incurable et ta mort prochaine, a mis en cage mon histoire, dit Yamato, laisse-moi ouvrir la bouche et lui donner la volée, mais prête attention à son essor, si ce n’est pas l’oiseau lui-même, c’est du moins un écho de son ramage.
Vivement, Sandaï quitta sa pose accablée.
— Tu sais quelque chose d’elle ?
— Certes…
— Ah ! … tu vas me dire que, retombée par ma faute dans la servitude, elle m’est infidèle. Non, non, je veux mourir sans avoir entendu cela.
— Encore ! s’écria Yamato avec découragement.
— Si ce n’est pas cela, parle.
— Eh bien, nous avons deux mois devant nous. Grâce au dévouement de la suivante, qui a donné toutes ses économies, la Cigogne vorace fera respecter ta bien-aimée, jusqu’à l’expiration du sursis. L’Oiseau-Fleur vient de m’écrire cela, en nous suppliant de ne pas l’abandonner.
— Oh ! donne-moi sa lettre !
Yamato leva les bras au ciel.
— Il s’agit bien de cela ! s’écria-t-il. Soupirs et pleurnicheries sentimentales, sur un rouleau de papier, voilà tout ce dont est capable un amant au désespoir. Je n’ai pas nagé dans l’eau du fossé, je n’ai pas escaladé le mur crénelé, j’ai franchi le pont et je suis entré par la porte, et les samouraïs de service, ou plutôt les concierges qui en tiennent lieu, m’ont traîné devant le vénérable seigneur de Kama-Koura, qui, en me voyant, a froncé ses nobles sourcils.
— Tu as osé braver mon père ?
— Le braver ! j’étais aussi plat que le chien battu, qui rampe aux pieds de son maître. J’affrontais sa colère, résigné à la subir ; j’expiais mes crimes, sans murmurer, la punition était trop juste, l’exil bien mérité. Mais si j’osais reparaître, c’était poussé par le désir de réparer le mal que j’avais fait, si cela était possible… Enfin sache-le, je suis près de toi, avec la permission du prince et, même, la princesse consultée, a donné son consentement… Seulement la confiance en ton complice n’étant pas sans borne, on m’a fouillé… Si j’avais eu sur moi la lettre de ton adorable amie, tout était perdu ! … Mais j’avais prévu cela ! …
— Où veux-tu en venir, avec ton bavardage ? Tu pétris mon cœur endolori, comme une pâte à gâteau ; tu me fais mal, ton rire sonne comme une cloche, rouillée par une pluie de larmes. Quel est ton projet ? dis-le vite, nous perdons du temps. Deux mois, c’est si court.
— Voilà des paroles sages, les premières, dit Yamato. C’est court en effet et l’empire est vaste. Il va me falloir le parcourir en tous sens. Sans les chemins de fer, mon projet était impossible.
— Parcourir l’Empire ? dans quel but ? Dans le but de te trouver une épouse de ton rang. Ne crie pas. J’ai l’assentiment de ta famille, et si je réussis comme je le veux, j’aurai le tien…
— Jamais !
— Reprends ce mot inutile. Voici ce que j’ai dit à ton père. Votre fils est follement épris de la beauté d’une femme, vous jugez dans votre sagesse, cette femme indigne d’être admise parmi vous ; si je trouvais, chez une fille noble, une beauté, presque semblable à celle que pleure le jeune prince, il ne serait pas impossible de le consoler et de le marier selon vos vœux.
— Si c’est cela ton projet…
— Tais-toi, et ne me décourage pas, en doutant de mon amitié, s’écria Yamato subitement grave ; si je réussis, la fiancée que le daïmo de Kama-Koura te présentera lui-même ne sera aucune autre que l’Oiseau-Fleur.
— Pardonne-moi ; je suis méchant, dit Sandaï en prenant les mains de son ami, je ne doute pas de toi, mais je suis si malheureux, et ce que tu imagines semble tellement irréalisable !
— Vois donc ce que j’ai réalisé déjà ! J’ai forcé la porte du château ; je suis rentré en grâce, à tel point que ton père, va pourvoir aux frais de mes voyages, et me donner le moyen de pénétrer dans les impénétrables châteaux des grandes familles de l’Empire. Sans lui je ne pouvais rien et voila que c’est lui, qui me fournit les armes pour le combattre.
— Le combattre ! en visitant tous les vieux nobles, dépossédés de leur souveraineté, et qui soignent, dans la retraite, les blessures de leur orgueil ? c’est ce que je ne peux comprendre, ni comment cela me servira !
— Ne cherche pas et ne parlons plus ; les minutes qui passent, trépident sur mon cœur… Tu sais ce qu’il faut savoir : la bien-aimée est fidèle et décidée à mourir, plutôt que de laisser effleurer le bout de son ongle par un autre que toi. Je fais un effort suprême pour vous sauver ; donc tu dois conserver ta précieuse existence, jusqu’à ce que je sois triomphant ou vaincu. Dans ce cas je reviens, tendre ce pavillon de draperies blanches, et nous nous ouvrons le ventre de compagnie, en criant : Béni soit le Hara-Kiri du bon vieux temps, qui met fin à toutes les peines.À LA LANCE ROUILLÉE
Yamato, après une course rapide au Yosi-Wara, et une secrète entrevue avec l’Oiseau-Fleur, s’enfonça dans un quartier pauvre de Tokio et, ayant cherché quelque temps vainement, se fit indiquer, par un agent de police, en uniforme moderne, l’auberge « À la Lance Rouillée. » C’était une vieille petite maison de thé, aux boiseries vermoulues, toute noire, sous le ruissellement de la pluie, qui tombait ce jour-là. Elle devait dater de loin, la pauvre bicoque, et ne sacrifiait guère au goût nouveau, les carreaux de papier, étaient, là, toujours de mise, et il faisait sombre à l’intérieur, surtout par cette journée triste.
Avant d’entrer, Yamato dissimula, dans un angle, son parapluie anglais, pour ne choquer personne, car il savait qu’en ce lieu, toute nouveauté était en exécration.
L’hôte, un vieillard au visage tout hérissé de poils blancs, s’avança, salua avec des formules anciennes, et se prosterna, malgré son âge.
Yamato, affectant l’air hautain des anciens nobles, ne le releva pas tout de suite.
— Votre maison, à ce qu’on m’a dit, est fréquentée par des samouraïs, fidèles au passé, vieillis dans les batailles, qui dédaignant les métiers vils, endurent fièrement la misère.
— Oui, monseigneur, répondit l’hôte, qui après de grands efforts parvint à se remettre debout, la plupart de ceux qui viennent, ici sont des héros méconnus, qui vivent de souvenirs, et meurent de faim, noblement.
— Avez-vous du monde en ce moment ?
— Quelques-uns, qui furent célèbres, sont là.
— Ne pourrais-je pas les apercevoir un instant, sans être vu ?
L’hôte remua sa vieille tête, d’un air perplexe.
— Nous vivons en des temps singuliers, monseigneur, dit-il ; regretter le passé et déplorer le présent, cela constitue, parfois, un délit, et je ne puis me permettre d’exposer mes nobles convives aux regards d’un inconnu.
— Rassurez-vous, vénérable aubergiste, dit Yamato, je ne suis pas de la police. J’étais vassal du daïmio de Kama-Koura, au temps, peu éloigné, où il y avait des vassaux ; dans mon cœur je le suis toujours. Je voudrais interroger ces Braves, sur leurs souvenirs, justement, ce qui loin de les blesser, ne peut que leur plaire. Tenez, ajouta-t-il en écartant son manteau, je suis moi-même en contravention.
Et il découvrit deux courts poignards, cachés dans les plis de sa ceinture.
— Pourquoi, seigneur, demanda l’hôte, désirez-vous voir les Soshis[4] avant de leur parler ? Pensez-vous reconnaître quelqu’un d’entre eux ?
— Non, dit Yamato. J’ai vingt-cinq ans. Je comptais donc trois ans, à l’époque de la révolution, et je n’avais pas encore l’honneur de fréquenter les guerriers. Je voudrais les apercevoir, pour tâcher de deviner à quels clans ils ont appartenu, afin d’éviter, dans mes paroles, tout ce qui pourrait les blesser.
— Venez, alors, dit le vieillard en faisant glisser un panneau dont le bois humide résista un peu.
L’auberge était plus grande qu’on ne croyait. Ils traversèrent une cour, entourée de bâtiments, délabrés, mais encore solides et montèrent deux marches trempées de pluie. Ils secouèrent leurs vêtements, sous la galerie abritée.
Un bruit, d’abord confus, de piétinements et de clameurs devint distinct et éclata tout à fait, quand le vieux eut écarté, à la largeur d’un œil, le panneau formant porte.
Une salle assez grande apparut, au plancher nu, au plafond bas, où une dizaine d’êtres singuliers joutaient, à la lance, en s’excitant de la voix.
« Jo-i ! Jo-i ! » (hors les étrangers) le cri de guerre, des partisans du Mikado, pendant les révoltes, dominait.
Yamato, très intéressé par le spectacle, écarquillait un œil, en fermant l’autre.
Au fond de la salle, un maigre personnage, vêtu d’une défroque guerrière, se renversait en arrière, une jambe en avant, d’une main tenait la lance, de laque pourpre, terminée en glaive, entre le pouce et la paume, l’autre la dirigeait de l’index. Trois adversaires l’attaquaient en même temps, dans un costume analogue, armés d’une lance pareille.
Avec de menaçantes contractions de sourcils, des sauts, des voltes, des cris rauques, l’homme qui faisait face, relevait, ou abaissait, d’un coup vif, les lames brillantes, se remettait en défense, attaquait, rampait, bondissait, d’une souplesse de fauve, d’une adresse étourdissante, qui faisait pousser des « Oh ! oh ! » admiratifs à ceux qui assistaient, collés aux murailles.
— Qui est-ce, celui-là ? demanda tout bas Yamato.
L’aubergiste mit sa bouche contre l’oreille du jeune homme et répondit, de sa vieille voix tremblotante.
— C’est le frère du terrible Oï-Kantaro, qui, après la découverte du complot contre le ministre Ito, a pu s’échapper et sortir du Japon. On l’appelle aussi Kantaro et il est très mal vu de la nouvelle société, à cause de son frère et à cause de lui-même.
— Ceux qui joutent avec lui ! dis leurs noms.
— Celui du milieu c’est Nishino. On croit qu’il a été complice dans le meurtre du conseiller Mori, à cause peut-être d’une ressemblance de nom. Il ne dément pas ce bruit, qui le flatte. Celui-ci s’appelle Koyamo, il était certainement de l’affaire contre le vice-roi de Chine, Li-Hung-Tchang, qui n’a pas réussi. Le nom de l’autre est Sabouro, on sait peu de choses de lui.
— Mais ils vont le tuer, ce Kantaro ! Voyez donc, il ruisselle de sang.
— Ah ! leurs jeux, sont jeux de braves, dit le vieillard, sans s’émouvoir.
— Allons, faites garnir, copieusement, de nourriture et de saké, un large plateau, et portez-le à ces rudes seigneurs ; cela me fera bien venir.
Peu d’instants après, Yamato était accroupi sur le plancher en face du farouche Oï-Kantaro, dont le front saignant était bandé d’un linge bleu, séparé de lui par des tasses et des plats. Un léger paravent les isolait des autres, qui, bruyamment, buvaient à leur santé.
— Combien d’incendies après la défaite, répondait Kantaro à une question de son nouvel ami : le compte en est infernal. Trente-sept mille et quatre cents maisons, cent quinze temples de Bouddha, soixante du Shinto, dix-huit grands palais des nobles de la cour, quarante-quatre châteaux de daïmios, six cents demeures de samouraïs, dont la mienne, quarante ponts, trois théâtres, mille magasins, quatre cents maisons de pauvres, et même un village de mendiants. Ne croyez pas que j’exagère, cette merveilleuse statistique est officielle.
— Savez-vous quels sont les quarante-quatre châteaux de daïmios ?
Oï-Kantaro fronça son front couturé, sous le linge sanglant, en relevant ses sourcils, et appuya son regard dur, sur les yeux de Yamato.
— Qu’est-ce que vous craignez de moi ? demanda-t-il, après un silence. Nous irions beaucoup plus vite, si vous me disiez sans méfiance, quel but vous voulez atteindre. Rien n’est effacé de ma mémoire, des événements de la guerre, elle flambe toujours, à mes yeux, et tinte, à mes oreilles. Un détail, insignifiant pour tout autre, peut me mettre sur la trace de ce que vous cherchez. Sans cela nous allons tâtonner indéfiniment et puisque vous êtes pressé…
— Je n’ai d’autre crainte que de froisser, par ignorance, quelqu’une de vos convictions, dit Yamato, de vous blesser sans le vouloir.
— Allez, dites votre histoire. Je suis si bien cuirassé par les cicatrices, qu’il n’y a plus de place pour les blessures.
— Je vais la dire, s’écria Yamato en versant du saké dans la tasse du vieux brave. Vous savez que je suis vassal de Kama-Koura, vous n’avez point de prévention, j’espère, contre mon seigneur ?
— Kama-Koura reste dans son domaine et conserve, autant qu’il peut, les traditions ; aucun des siens n’a de charge à la cour et ne trempe dans les abominations modernes ; Kama-Koura a ma sympathie.
— Eh bien, il s’agit de sauver de la mort, l’unique héritier du nom.
— Comment cela ?
— En retrouvant la famille d’une ravissante personne, qui fut enlevée pendant l’incendie du château…
— Et que le jeune seigneur aime, sans doute, à la folie. Les nobles parents repoussent une fille sans nom. Il faut lui retrouver son nom !
— Justement.
— Ah ! ah ! une histoire d’amour ! peu de gloire à récolter… Mais le problème est amusant à résoudre. Où est la fille ?
— Au Yosi-Wara.
— Naturellement. Vendue par les ravisseurs… Quel âge ?
— Vingt-deux ans.
— Voyez comme déjà le cercle est resserré, autour de la question, dit Kantaro en vidant sa pipette sur le plateau, nous n’avons plus qu’à rechercher, parmi les quarante-quatre daïmios incendiés, ceux dont les enfants étaient en bas-âge, lors de la révolution.
— C’est vrai.
— Quel indice avez-vous ? Ce paquet, que vous serrez contre votre hanche, a-t-il rapport à l’affaire ?…
— Ce sont les seuls témoins, témoins muets, qui gardent bien le secret.
— Nous allons bien voir, faites les comparaître. Allons.
Écartant les plats, Yamato défit le paquet et étala, sur le plancher, une petite robe et un manteau d’enfant.
Le brave les scruta d’un regard aigu, les attira à lui.
— On a découpé les armoiries, c’était la première chose à faire, dit-il en passant ses doigts dans les trous de l’étoffe.
Un parfum, distingué et doux, s’envola des plis, dominant un instant l’odeur chaude du saké. Le guerrier déchu, aspira cet arome avec une douloureuse émotion, abaissa même ses paupières sur la buée qui troubla tout à coup ses yeux.
— Une bouffée du passé, qui me va au cœur, murmura-t-il. Oh ! si proche, et si perdu ! Quand il fut cousu, ce petit vêtement, c’était l’époque héroïque, à jamais abolie ; le tissu est tout neuf encore, et la trame de la destinée, déchirée en mille pièces. L’enfant, qu’il revêtait, n’est qu’une femme jeune ; les blessures sont mal guéries aux membres vigoureux du soldat, et nous voilà, comme des fantômes, qui reviendraient, après des siècles, pleurer sur des ruines méconnaissables. Ô que de désespérances tiennent pour moi dans ce parfum d’autrefois !
La voix lui manqua, il étouffa un sanglot, en cachant son visage dans la robe d’enfant.
Yamato le contemplait, bouche béante ; ému, mais plutôt surpris de cette grande douleur qu’il comprenait mal, lui, né trop tard pour avoir connu ce passé, si proche, datant presque, cependant, d’avant sa naissance, il ne trouva rien à dire et poussa, seulement, un soupir compatissant.
Oï-Kantaro releva vite la tête, comme honteux de cette faiblesse ; le bandeau d’étoffe bleu s’était déplacé, le sang coulait, dans les larmes. Il s’essuya le visage, d’un mouvement brusque, et jeta le bandeau loin de lui.
— Voilà ce que c’est que de boire tant de saké, dit-il, en essayant de sourire ; nous sommes loin de notre aventure, revenons-y ; le succès me tient au cœur, à présent.
Il se remit à examiner les petits vêtements.
— Rien à en tirer, n’est-ce pas ? dit Yamato.
— Que vous semble des ramages de la robe ? quelle forme y découvrez-vous ?
— Un fouillis de palmes, peut-être.
— Des palmes ? Non ; j’y vois autre chose, mais je ne voudrais pas m’abuser, en croyant voir ce que je désire voir. Regardez encore.
— Je vois des palmes, de nuances diverses, dans la même couleur.
— Des palmes ! J’y vois des plumes, moi. Ne croyez-vous pas que ce sont des plumes ?
— C’est possible, en regardant mieux ; des plumes, ou des palmes, cela ne nous avance guère.
— Que les palmes s’effritent au vent, que les plumes ne s’envolent pas, et nous serons, peut-être, sur une piste.
Kantaro se leva, écarta le paravent, et alla montrer la robe à ses compagnons, que le saké, offert par Yamato à tous les assistants, commençait à échauffer sans les griser encore.
— Des plumes ! décidément, cria le brave, en revenant.
Il referma le paravent et se rassit, en face de Yamato très intéressé.
— Vous êtes sur une piste, alors ? …
— Vous avez peut-être entendu dire, que les princes faisaient, souvent, tisser des étoffes, pour eux seuls, sur des dessins donnés par eux. Cette petite robe est faite, probablement, d’une étoffe de cette sorte, car le dessin en est singulier et rare. Je n’ai jamais rien vu de semblable. Les armoiries, qui marquaient chaque épaule, sont coupées ; si elles revenaient à leur place, j’ai comme l’idée qu’elles nous montreraient deux plumes de faucon, croisées, et enfermées dans un cercle.
— Ah ! vraiment ? …
— Ce sont là, les armoiries des princes d’Ako, ne le savez-vous pas ? …
— En effet… des princes d’Ako… balbutia Yamato qui ne savait pas du tout.
— Ne pourrait-on conjecturer que l’ idée de prendre le motif des insignes, pour ornementer un tissu, ne soit venue plus naturellement qu’à d’autres, aux dessinateurs, qui avaient constamment ces insignes sous les yeux ?
— Cela est très logique.
— Il y a même un autre indice. La bannière du clan était verte et blanche, et, vous le voyez, le semis de plumes, en toutes les nuances de vert, est jeté sur un fond blanc.
— Je suis confondu de votre sagacité, s’écria Yamato vraiment émerveillé… c’est donc au prince d’Ako, qu’aurait été ravie celle qui nous occupe.
— N’allons pas si vite. Je me trompe peut-être complètement ; mais puisque nous n’avons rien, il faut bien tenir cette conjecture pour quelque chose.
— Nous devons donc nous rendre, sans retard, dans la principauté d’Ako… qui n’en est plus une, d’ailleurs.
— La famille existe-t-elle encore, seulement ? dit Kantaro. Allons-y voir, n’hésitons pas, puisque le temps est compté. Quand partons-nous ?
— Ce soir même. Il y a un train, à neuf heures… Voulez-vous me rejoindre, à la gare de Uyéno ? …
Comme si un serpent l’eut piqué, le brave sauta sur ses pieds, le visage bouleversé par la surprise et la colère.
— Moi ! moi ! À une gare ! s’écria-t-il, moi ! montant dans une de ces machines maudites ! … Après ce que vous savez de mon caractère, n’est-ce pas pour m’insulter que vous me faites une pareille proposition ?
— Vous insulter ? … C’était tout simplement pour aller plus vite, dit Yamato très effrayé. Comment donc voyager alors ? …
— Ah ! voilà bien la gangrène moderne ! Est ce qu’on ne voyageait pas, dans ma jeunesse, quand on tenait hors du royaume ces infâmes barbares ?
— Ne peut-on profiter de leurs inventions sans cesser de les haïr ? prendre d’eux tous les moyens qui nous serviront à les chasser de nouveau, quand nous n’aurons plus rien à en tirer, dit Yamato, conciliant.
Mais le brave ne se calmait pas.
— Oui ! On refermera un Japon, pourri et défiguré, ayant tout détruit, tout oublié, où il ne restera qu’un peuple de singes, dans des déguisements ridicules !
Yamato, terrifié du tour que prenait la conversation, se hâta de céder.
— Voyageons comme vous voudrez, dit-il, mais hâtons-nous d’autant plus. Dites donc, je vous prie, ce que vous décidez.
— Le cheval est ce qui convient le mieux à des samouraïs.
— Je vous ferai remarquer qu’il pleut beaucoup ; nous serons trempés.
— Nous mettrons des manteaux de paille.
— Des manteaux de paille ? … fort bien, dit Yamato… et il ajouta mentalement : en dissimulant, par dessous, un bon caoutchouc américain. – Je vais donc acheter deux chevaux ; ce sera beaucoup plus cher, mais puisque c’est votre volonté, je me soumets.
— Je vous en sais gré, dit Kantaro un peu radouci.
— Où faudra-t-il vous attendre ?
— À la porte des Nobles, derrière le temple de Shiba.
— À quelle heure ?
— À l’heure du renard ; la lune se lèvera peu après et éclairera notre marche.
— J’y serai, dit Yamato. Permettez-moi de prendre congé, pour me mettre en quête de bons chevaux et faire tous les préparatifs.
Il s’en alla, et reprit, furtivement, dans le coin obscur, son parapluie, qu’il dissimula sous son manteau, sans oser l’ouvrir. Il marcha sous l’averse, tant qu’il fut en vue de l’auberge. — Ouf ! soupira-t-il, en s’abritant enfin, quand il eut tourné un angle ; j’ai joliment bien fait de cacher cet engin étranger, si supérieur, cependant, à nos parapluies en papier goudronné. Et mes bottines ! heureusement qu’il ne les a pas vues ; je les cachais, tout le temps sous ma robe ! … A-t-on idée de pareille antiquaille ? Me voilà joli ! obligé de trottiner par la campagne, dans les chemins défoncés, de passer les rivières à gué, de mettre trois jours à parcourir la distance, franchie en quelques heures. Enfin ! si vraiment il a trouvé, du premier coup, à quel prince nous avons affaire, ce terrible Kantaro me rend un fameux service, et m’aura fait avancer plus vite même qu’à la vapeur.
Yamato ferma son parapluie, en entrant dans un bureau de tramway.
— L’heure du renard ? … se dit-il encore, qu’est-ce donc ? neuf heures ou dix heures ? Tiens, je vais le demander à ce vieux, qui distribue des numéros.
Et il haussa la voix pour faire la question à travers le guichet, parce que le véhicule approchait, sifflant bruyamment.VERS LE PASSÉ
Une lourde jonque, de modèle ancien, presque hors de service, ouvrait sa voile de paille, et louvoyait, sur un bras de la mer intérieure, qu’elle s’efforçait de traverser, malgré l’absence de vent.
Oï-Kantaro n’avait, naturellement, pas voulu prendre le petit vapeur, qui dessert les ports, dans ces parages, et Yamato, de plus en plus impatienté, dissimulait mal sa mauvaise humeur.
Plus d’un mois s’était écoulé, depuis leur départ de Tokio.
Fidèle à ses principes, et ne voulant profiter d’aucun des avantages des mœurs nouvelles, le brave avait suscité mille obstacles, mille difficultés, et le voyage, entravé à chaque étape, s’éternisait. Une querelle, suivie de voies de faits, avec des employés de douane, avait failli tout perdre. Par bonheur, le vrai nom de Kantaro n’avait pas été connu, et, à force d’argent, Yamato avait arrêté la plainte. Il se repentait amèrement de s’être adjoint ce personnage terrible, duquel, lui-même, il avait presque peur. Tout était compromis maintenant… si l’on s’était trompé, le temps allait manquer pour les recherches ! … et, même, si la conjecture ingénieuse du brave, était la vérité, c’était plutôt un désastre, car on avait appris des nouvelles désolantes : rien ne restait de la famille d’Ako, déjà réduite avant la révolution, et éteinte complètement, dans les horreurs de la guerre civile.
Yamato ne savait pas trop pourquoi il se rendait, cependant, à ce château d’Ako, devant lequel la jonque zigzaguait, depuis des heures, sans pouvoir y aborder. La forteresse et ses dépendances appartenaient maintenant à un vieux seigneur, de bonne noblesse, qui avait racheté le domaine confisqué, et réparé les dommages.
Peut-être trouverait-on, près du vieillard, quelque renseignement précieux sur l’histoire obscure et mal connue des seigneurs d’autrefois. Yamato était décidément fort peu au courant du jeune passé ; les sites célèbres ne lui rappelaient rien, et le brave, qui, au commencement du voyage, déclamait à toute occasion, s’étant aperçu de l’ignorance de son compagnon, gardait, depuis lors, un silence méprisant.
Secrètement, et par un moyen rapide, Yamato avait fait prévenir de sa visite le nouveau seigneur d’Ako… le nom du daïmio de Kama-Koura, il n’en doutait pas, ferait s’ouvrir toutes grandes les portes de la résidence.
Il en fut certain, lorsqu’il vit une longue barque, armée de dix rameurs, se détacher du rivage. On venait au secours de la lourde jonque, captive de la mer trop calme. Les passagers, avec joie, l’abandonnèrent à sa somnolence.
En franchissant le pont-levis, pour s’engager sous le portail du château, Oï-Kantaro ne put retenir l’expression de son enthousiasme. Il faisait sonner le bois sous ses pas, les bras levés au ciel, le visage illuminé.
— Je vous contemple, enfin, murailles fameuses ! Je foule le plancher sacré, que firent retentir les pas nerveux des fidèles vengeurs ! …
— Allons ! qu’est-ce qui lui prend encore ? gémit tout bas Yamato ; il va nous rendre ridicules !
Le brave, coula vers lui, de haut, un regard protecteur.
— Vous ne semblez pas vous souvenir, dit-il, que les fidèles vassaux, sont partis de ce château, pour venger leur seigneur contraint à se donner la mort.
— Au fait, je n’y pensais pas, se dit Yamato.
— Je ne vous fais pas l’injure de croire, que vous ignorez cette histoire glorieuse.
— Qui donc ne sait pas, par cœur, l’histoire des quarante-sept Ronines ? répondit le jeune homme en haussant les épaules — on nous la rabâche assez ! — ajouta-t-il tout bas.
— Voyez, continua le brave, combien une belle mort, fait vivre longtemps ! Voilà deux cents ans, bientôt, que ces héros ont accompli leur noble suicide, et leur souvenir brille, même à travers l’horrible fumée du temps présent, qui obscurcit tout. Leurs tombeaux, sur la Colline du Printemps, est un lieu de pèlerinage, pour les habitants de Tokio ; et notre Mikado, la première année de son règne, leur a accordé le suprême honneur, en suspendant la Feuille d’Or à la pierre tombale. Il n’avait que dix-sept ans, alors. Comme son cœur a changé, depuis !
Yamato allongea le pas, profitant de la songerie où le cœur du Mikado plongeait son compagnon, pour échapper à la suite du discours.
Le daïmio venait à la rencontre de ses hôtes. Yamato comprit que c’était lui, en voyant tous les serviteurs se prosterner. Il voulut en faire autant, mais le seigneur l’en empêcha en lui tendant la main. Décidément, le cérémonial était supprimé ! La plus grande simplicité régnait dans les manières du nouveau maître de l’illustre château. Rien de moderne, cependant, dans sa toilette ; il portait une belle robe souple, en crêpe pourpre foncé, où des fils d’or brodaient des saumons, aux yeux de jaspe, remontant des cascades. C’était un vieillard, au visage long et doux, dont toute la personne respirait, au plus haut point, cette nonchalance rêveuse, que l’oisiveté du corps et la culture de l’esprit, donnent à tant de princes, reclus dans leurs domaines. Il semblait très bon, ou très indifférent ; vivant en lui-même, lent à comprendre les choses extérieures. Il avait été heureux du nouvel état de choses, qui, enlevant aux seigneurs leur souveraineté, leur enlevait, du même coup, toutes les charges, les devoirs, les soucis, pour les laisser vivre, riches et paisibles, tout à leur rêve.
Yamato, en marchant lentement à côté du prince, lui expliquait la cause et le but de sa visite, et comment elle n’avait même plus de but, puisque la famille d’Ako était éteinte.
Distraitement le daïmio l’écoutait, s’arrêtant pour cueillir des fleurs.
Oï-Kantaro s’émerveillait de la beauté du parc, des perspectives bleues, des ponts légers, de laque rouge, s’arrondissant au-dessus de claires rivières, sur lesquelles voguaient des milliers d’oiseaux merveilleux.
On monta vers une véranda, puis on entra dans la fraîche pénombre d’une salle, où l’on s’accroupit sur des carreaux ouatés, en velours brodé.
Aussitôt, de jolies servantes apportèrent le thé, qu’elles offrirent à genoux.
Les boiseries étaient délicieusement décorées, dans les nuances les plus suaves. Mais, sur l’élégant tokonoma, dont deux dragons en bois de fer formaient les pieds, une pendule d’Europe, en bronze reluisant, arrondissait la blancheur crue de son cadran, et, le long des parois délicates, deux fauteuils et quatre chaises, hurlaient, cruellement, du ton groseille ardent de leur satin broché.
Le daïmio, se méprenant sur le regard dont Oï-Kantaro foudroyait ces meubles barbares, s’excusa de ne pas s’en servir.
— Les étrangers sont, sans doute, extrêmement petits, dit-il ; les enfants, seuls, peuvent croiser les jambes sur les fauteuils et, sur les chaises, on perd l’équilibre.
Yamato expliqua que l’on devait s’asseoir, les jambes pendantes, ce qui surprit beaucoup le prince.
— Cela fait enfler les pieds et doit être très malsain, dit-il.
Puis il se tut, réfléchissant à l’histoire de la petite fille volée, qui n’éveillait en lui aucun souvenir. Mais n’avait-il pas acheté, avec le château, tous les serviteurs qu’il contenait ? beaucoup devaient vivre encore, contemporains de l’incendie. Il appela son intendant, qui ne sourcilla pas, devant l’ordre, étrange, d’amener devant le prince tous les vieux et toutes les vieilles, qui servaient dans le domaine.
On vit arriver bientôt, par petits groupes, des êtres tremblants, en robe brune, ou demi-nus, ayant de la terre aux doigts, ou des brins de chaume dans tes cheveux. Les plus vieux avaient des tignasses blanches, ébouriffées. Les femmes se hâtaient de nouer, sous leur menton, un morceau de cotonnade bleue dont l’azur déteint faisait paraître encore plus jaune leur vieille figure parcheminée.
Mais tous ces gens, aussitôt en vue du seigneur, se précipitaient à quatre pattes, le front contre terre, et on ne voyait plus que leur dos et leur nuque.
On les mit au courant, on les interrogea, mais sans obtenir aucune réponse, ni aucun mouvement. Persuadés qu’ils étaient soupçonnés de quelque faute grave, ils ne comprenaient pas ce qu’on leur demandait, et leur front restait obstinément rivé au plancher.
— Rassurez-vous, disait le prince, d’une voix douce ; je n’ai jamais maltraité personne ; pourquoi donc tremblez-vous si fort ?
Personne ne se rassurait, aucun ne rompait le pieux silence.
Enfin, une vieille brodeuse, arrivée des dernières, sans savoir encore de quoi il s’agissait, poussa un cri, en apercevant la petite robe, aux plumes tissées, que l’intendant étendait, par les manches, au bout de ses deux mains.
— C’est moi qui l’ai cousue ! s’écria-t-elle ; je l’ai cousue de ces vieux doigts que voilà et qui étaient jeunes, alors. Oui, oui, je l’ai cousue, cette petite robe, pour la chère et divine Rosée de l’Aube, la dernière princesse d’Ako, brûlée dans l’incendie terrible ! …
Et elle tendait les bras, suppliant qu~on la laissât toucher de son front le petit vêtement.
— Je ne mens pas, disait-elle ; j’ai même conservé des morceaux de l’étoffe, que je pourrai retrouver.
Kantaro triomphait. Yamato, très ému, s’inclinait devant lui, en disant à demi voix :
— Votre sagacité a été vraiment merveilleuse et me remplit d’admiration.
— Si la robe a été sauvée du feu, l’enfant qu’elle revêtait l’a été aussi, dit le prince. Quelqu’un a-t-il souvenir, à ce propos, d’une rumeur de trahison, d’un crime secret ? Secouez vos vieilles mémoires, et répondez.
Quelques fronts se relevèrent. Un vieillard à barbe en broussaille, la voix encore étranglée de peur, parla : Un de ses parents, mort depuis, avait vu un homme inconnu, enjamber la fenêtre et sortir d’un pavillon en flammes, emportant la petite princesse qui criait en se débattant. C’était pour la sauver, crut-il. Mais comme on n’entendit plus jamais parler d’elle, et que, lorsqu’on vint enterrer les débris des morts, on ne trouva aucune trace d’un cadavre d’enfant, l’idée d’un enlèvement criminel vint à plusieurs. Mais on n’osa pas en parler.
D’autres voix jaillirent ; on se rassurait, et tous, par zèle, voulaient dire quelque chose. Ce fut bientôt un caquetage embrouillé, d’expressions naïves et maladroites ; puis, les timbres se haussèrent, pour se dominer les uns les autres. Tous parlaient à la fois, les mains à terre, ne relevant que la tête, racontant avec volubilité, des choses que personne n’entendait ; cela devint un extraordinaire tapage, qu’on ne pouvait plus arrêter, comme les aboiements forcenés d’une meute.
L’intendant dénoua sa ceinture, et, s’en servant comme d’un fouet, chassa, à grands coups légers, ce troupeau affolé, qui s’éparpilla en tous sens, puis, en un instant, disparut.LA CEINTURE DE SOIE
« Je vais t’attendre, mon bien-aimé, dans un séjour inaccessible, où mon amour sera hors d’atteinte.
» Mon jeune corps, qui fit tes délices, je dois le sacrifier, pour te garder mon âme.
» Laisse couler tes larmes, au souvenir de ses voluptueuses grâces, si tôt détruites :
» Puis, lève les yeux, vers ce qui survit, et souris-moi, à travers les nues. »
L’Oiseau-Fleur, termine ainsi, un long poème, son testament d’amour. Pour elle, tout est fini. Le terme de sa liberté est atteint. À la fin de cette journée, on doit lui présenter l’amant nouveau, qu’elle ne peut éconduire, qu’en lui offrant une morte. Tout a été minutieusement fouillé chez elle, on a enlevé les objets pouvant tenir lieu d’armes, même les épingles de métal, destinées aux coiffures ; mais elle a su dissimuler le poignard, présent nuptial du jeune prince. Elle n’a pas voulu se frapper avec une autre arme.
— Tâche de le lui faire parvenir, quand il sera rougi de mon sang, dit-elle à Broc d’Or ; il l’essuiera de ses lèvres et le remerciera de m’avoir aidée à tenir mon serment.
— Le prince ne vous survivra pas, répondit la suivante, pas plus que moi-même ; et le seigneur Yamato mourra aussi. Toutes ces existences sont en votre main ; c’est pourquoi je vous conjure, de ne pas hâter d’une seconde le dénouement terrible, de le retarder, au contraire, jusqu’aux dernières limites.
— Tu espères donc encore ? Chère folle. Il eut fallu des années, au seigneur Yamato, pour retrouver, peut-être, quelques indices de mon origine. Qu’a-t-il pu faire, sans aucun renseignement, à travers tout l’empire ? … Va, la mort m’enveloppe déjà ; je le sens au froid qui coule dans mon sang, et à un grand calme, qui me vient, après ces mois d’anxieuse attente. Mais je te défends, à toi, de mourir ; tu vivras, pour exécuter mes derniers désirs, porter mes adieux au prince adoré, et me pleurer avec lui.
Broc d’Or ne répondit ; rien mais ses sourcils froncés, et ses yeux fixes, disaient l’obstination de sa volonté.
L’Oiseau-Fleur enferma son poème, et une longue lettre, dans un joli coffret, qu’elle ferma, à l’aide d’une ganse de soie savamment nouée.
Plusieurs oïrans vinrent la voir. Ko-Mourasaki devinait la résolution de mourir, et son silence approuvait. Jeune Saule, elle, était d’avis qu’il fallait se résigner au sacrifice, l’infidélité ne tuant pas l’amour chez l’homme, mais l’excitant, au contraire. Les autres, préoccupées par leurs propres intrigues ou par leurs intérêts, ne semblaient pas avoir conscience du drame, dont le dénouement était tout proche.
La nuit tomba. Les kamélos montèrent, pour habiller la princesse. Elles portaient la riche toilette de l’entrevue, le kimono magnifique, en satin violet clair brodé de tortues d’or, que Hana-Dori n’avait pas revêtu depuis le soir de ses noces éphémères.
— Cela me plaît de mourir dans ces vêtements-là, dit-elle à l’oreille de Broc d’Or.
Celle-ci faisait mentalement une prière fervente à la déesse Benten, dont la statuette d’or brillait, dans un angle, à la lueur de la petite lampe, tout en habillant sa maîtresse, avec des mains rendues maladroites par un tremblement invincible.
Elle ne parvenait pas à attacher la ceinture souple, qui retombe par devant ; elle fit un double nœud, là où il ne fallait qu’une boucle.
— Laisse donc, disait l’Oiseau-Fleur, il va falloir l’ôter, tout de suite, car, puisque certainement je suis de noble sang, je mourrai de la mort des nobles, en m’ouvrant le ventre, glorieusement.
Les kamélos ne s’en allaient pas, la toilette achevée ; il fallut patienter, car on devinait, parmi elles, des espionnes de la Cigogne-Danseuse.
Tout a coup, le bruit d’une arrivée se fit entendre au rez-de-chaussée, on criait Stansiro (prosternez-vous), ce qui indiquait un seigneur d’importance.
— Descendez toutes, ordonna la princesse aux servantes, d’un ton qui ne souffrait pas d’objection.
— Vite, vite, Broc d’Or, continua-t-elle, dès quelles furent parties ; défais ma ceinture.
La lame du poignard luisait déjà hors du fourreau mais la ceinture résistait ; s’acharnant, de ses mains fébriles, Broc d’Or ne parvenait qu’à embrouiller davantage l’enchevêtrement du nœud. L’Oiseau-Fleur s’efforçait de l’aider, en trépignant d’angoisse. Des larmes emplirent ses beaux yeux.
— Au cœur ! alors, au cœur ! gémit-elle, puisque la noble mort m’est refusée.
Elle leva le bras… mais, avec un cri de joie, Broc d’Or le retint. Dans l’écartement du panneau, brusquement ouvert, Yamato venait d’apparaître.
Il vit la situation, et, tout tremblant d’épouvante et de bonheur, il se jeta aux genoux de l’Oiseau-Fleur, et prit le pan de sa ceinture, qu’il porta à son front.
— Noble princesse d’Ako, bien digne de votre naissance, dit-il, je vous salue, en pleurant.
Un vieux seigneur, parut à son tour, laissant voir derrière lui toute une escorte. Il demeura stupéfait d’admiration, en face de la jeune femme, si pâle et si belle, presque pâmée, dans la secousse qui la rejetait, si soudainement, de la mort, au bonheur.
— Vous voyez, monseigneur, disait Yamato, que je n’exagérais rien. Deux secondes de plus, tout était fini. Plutôt que d’être infidèle, votre noble fille allait se donner la mort.
— Êtes-vous donc mon père ? demanda l’Oiseau-Fleur, toute tremblante.
— Non, mon enfant, pas encore, dit-il ; mais je le serai si vous voulez. Vous êtes la seule survivante, de cette illustre famille que nous croyions éteinte. Il n’y a plus aucun doute ; vous êtes bien la princesse d’Ako, que des malfaiteurs ont enlevée ; je m’en suis convaincu, par une enquête minutieuse.
— Trop minutieuse, et qui a failli tout perdre ! chuchota Yamato à Broc d’Or.
— J’ai racheté vos domaines confisqués, continua le prince ; mais, puisque vous êtes vivante, je les usurpe, moralement. Je puis vous les rendre, par héritage, en vous adoptant pour ma fille. Il faut, pour cela, votre consentement. Dites, voulez-vous de moi, pour père ? …
La princesse d’Ako se jeta aux pieds du vieux seigneur en sanglotant. Il la releva doucement et lui dit avec bonté :
— Sèche vite cette rosée de larmes, ma fille, et souris au joli nom, qui est le tien : Rosée de l’Aube.
Broc d’Or frappait ses mains l’une contre l’autre.
— À quoi tient la destinée ! s’écria-t-elle. Si ma maladresse n’avait pas embrouillé le nœud de cette ceinture, ce ne seraient pas des larmes de joie, que nous essuierions, à présent, sur nos joues. La minute, passée en efforts, pour dénouer ce qui ne se dénouait pas, voilà ce qui a donné le temps, au bonheur, d’arriver !FIN
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 22 Décembre 2015 à 21:32
Jean Antoine de Baïf, ce méconnu
Frédéric Fabri

Préface
« Je ne sais plus par quel chemin, voici bien des années, je suis venu à Baïf. C’est, j’imagine, le goût des hommes et des choses de la Renaissance, si vif, dans cette génération, qui m’a conduit vers lui, et aussi peut-être l’attrait de l’inconnu. Ceux à qui j’exposais mon projet me disaient : « Vous ferez oeuvre utile ; mais Baïf est bien ennuyeux »
Je ne serais ni étonné, ni déçu, et je m’estimerai honnêtement payé de ma peine si l’on juge ce livre fait à l’image du poète, hérissé, broussailleux, ennuyeux, - mais utile. »
C’est par ces mots que débute la préface de Mathieu Augé-Chiquet, pour son livre de 1909 intitulé « La vie, les idées et l’œuvre de Jean Antoine de Baïf »
Loin de moi l’envie d’une telle ambition qui consisterait finalement à réécrire ce livre qui n’a pas pris une ride, en corrigeant peut-être quelques petits éléments que de rares personnes contestent. Mais en ouvrant le pdf de ce livre, en format image, j’ai été immédiatement conquis par son humilité, sa sincérité, sa documentation, ses personnages.
Car, si certains chapitres sont techniques, d’autres sont du pur roman historique, dans l’esprit du moins. La vie de Jean Antoine de Baïf mérite un meilleur accueil des lecteurs, même si le poète maudit que je veux ressusciter a été éclipsé dans l’inconscient collectif par ses congénères de l’époque, pour quelques œuvres plus du goût du public, en majorité scolaire. Si cela peut sembler à certains « de l’ordre d’un Dieu qui n’a plus besoin de rien », je suis persuadé quant à moi que traverser cette époque avec un tel compagnon est une opportunité sans pareille.
Le livre étant du domaine public, puisque Mathieu Augé Chiquet est malheureusement décédé fort jeune en 1912 (39 ans), j’emprunterai à celui-ci de nombreux passages, fort bien écrits, mieux en tout cas que je ne saurais le faire moi-même, et j’en résumerai d’autres, tout en rajoutant peut-être parfois quelques éléments historiques afin de bien planter le contexte de l’aventure.
Pour ceux qui n’ont pas peur de six-cent-soixante pages en format image, avec parfois des passages très techniques, mais instructifs, je ne peux que conseiller l’original mis à disposition par l’université de Toronto à l’adresse suivante :
https://archive.org/stream/lavielesideset00auguoft#p...
Pour les autres, j’espère être à la hauteur de leur confiance et de la tâche entreprise.Une enfance studieuse
Jean Antoine de Baïf naît à Venise en février 1532, de mère inconnue, et de père ecclésiastique, peut-être le 19 selon Mersenne dans une de ses œuvres.
Son père, en poste depuis juillet 1529, en qualité d’ambassadeur du Roi de France, alors François 1°, reste discret sur l’origine de l’enfant. Il faut dire qu’en ce même mois de février, l’Abbaye de Grenetière lui est enfin accordée, et qu’il a besoin de cette manne financière.
Piètre diplomate espion, il ne se forme point au contact des maîtres vénitiens aux arcanes de la politiques. Mais il mène grand train, pour représenter dignement son maître, avec table ouverte, pour les seigneurs vénitiens comme les hommes de lettres. Cet humaniste érudit traduit Plutarque, donne des cours de grec, prête libéralement de nombreux ouvrages de sa riche bibliothèque.
« Son obligeance, sa bonté, sa loyauté, sa générosité enfin lui conquièrent la sympathie de tous ceux qui ont l’occasion de l’approcher ».
On ne sait de cette naissance que ce que Jean Antoine en écrira plus tard, dans son « Épitre au Roy », riche en détails auto-biographiques.
Le choix des deux parrains de l’enfant est malheureux. Le cardinal George d’Armagnac, humaniste besogneux, vagabond et hâbleur, vivant de leçons et de dédicaces, ne se préoccupera pas de son neveu. Pas plus que Antonio Rincon, réfugié espagnol, émissaire du roi de passage à Venise, et espionnant le turc Soliman le Magnifique, qui sera assassiné quelques années plus tard par les sbires de Charles Quint. La famille de son père (deux sœurs) l’ignore aussi totalement, sauf quand il s’agit de récupérer une partie de l’héritage.
Son père cependant, dès son retour en France, en février 1534, remplit à son profit un acte officiel de légitimation ce qui à sa mort, évitera à son fils d’être dépossédé.
De bonne heure, l’enfant passe des mains des nourrices et gouvernantes à celles de deux précepteurs, Charles Estienne, pour le latin, et Ange Vergèce pour le grec ancien. Le premier, ami humaniste, érudit et doué, traduisant des œuvres anciennes, imprimant traités élémentaires de grammaire latine… Le second, « écrivain ordinère de François 1, parlant « mauvais françoys et l’écrivant encore plus mal », avait cependant une « gentille main » pour l’écriture grecque, et ce scribe, qui eut de nombreux élèves, fournit les modèles à Garamond pour le gravage de ses caractères d’imprimerie.
Ange Vergèce et Lazare de Baïf se trouvaient à Venise durant la même période. Connaissant l’attrait de Lazare pour les manuscrits grecs, il est fort probable qu’ils se soient connus là-bas. En tous cas, la « patte » du maître se retrouvera dans la main de l’élève par la suite.
Au début de 1540, François 1 le charge d’une mission importante en Allemagne, voyage long et périlleux (la peste y sévit) dont l’enfant est exclu, laissé aux mains de Jacques Toussain. Lazare part le 16 mai 1940, accompagné de Charles Estienne et d’un certain… Pierre de Ronsard, alors âgé de seize ans, au service du Duc d’Orléans, et devant être pour celui-ci ses « yeux et ses oreilles ».
La mission ne dure que quatre mois, mais comme son père est accaparé par de nombreux offices, Jean Antoine restera pensionnaire de Jacques Toussain durant quatre ans.
Celui-ci a étudié grec et latin. Nonchalant et timide, il n’ose écrire, et Bodé, son ami, le pousse à ordonner et imprimer ses nombreuses notes. Si de son portrait, on peut y retrouver les traits d’un savant austère, aux convictions énergiques, il restera à tout jamais pour Jean Antoine ce « Bon Tusan », placide et doux. Ses livres sont considérés comme inférieurs à son enseignement. Qualifié de bibliothèque parlante, il a toujours été exact, net et précis dans ses explications, il était aussi appliqué et modeste. Enfin, il avait l’art d’éclairer les passages obscurs des anciens textes, en s’appuyant sur la grammaire.
De cette période, il semble que Jean Antoine se soit lié durablement d’amitié avec un autre élève, Nicolas Vergece, fils de son premier maître.
Milieu 1544, Son père le confie à Jean Dorat, alors hébergé chez lui. Ronsard, âgé de vingt ans, vient lui aussi profiter de cet enseignement exceptionnel, avec Jean Antoine pour guide, malgré sa jeunesse.
Lazare de Baïf meurt en 1547 et Jean Dorat part enseigner au collège des Coquerets, emmenant ses deux élèves avec lui.
On ne sait exactement aujourd’hui combien de temps ceux-ci restèrent ainsi avec Dorat, ni tout ce qu’il leur enseigna. Néanmoins, la culture « classique » de Jean Antoine à quatorze ans est bien plus étendue que celle de Marot à sa mort : un des effets de la Renaissance, voulus par François 1, du travail acharné des pionniers, et une mission que la Pléiade plus tard voudra prolonger, pour donner à la culture française les connaissances des textes anciens en grec et en latin.
Ainsi, Jean Antoine, comme Dorat, traduira en français de nombreuses œuvres, pour le profit des suivants. Il aura le même goût que son maître pour « l’alexandrinisme, la recherche de l’anecdote historique, des curiosités de l’érudition ».
Si Jean Dorat ne doit pas à ses dons de poète sa place dans la Pléiade, c’est par son érudition et sa qualité de maître « père des poètes » qu’il s’imposa, leur ayant appris leur métier d’écrivains et de versificateurs. Jean le Masle va jusqu’à affirmer qu’il n’est point de poète français « qui ne tienne de lui, et qui n’ait autrefois cueilli les mots dorés de sa bouche sucrée ».
DeVitrac prétend que Dorat savait aussi entrecouper les auteurs anciens avec la lecture de Jean de Meug, Gaston de Foix, Alain Chartier, Villon, Philippe de Commines. C’est imaginé, mais la Pléiade ne méprisera pas indistinctement tous les écrivains qui l’ont précédée.
La disparition prématurée de Lazare, père protecteur aimé, seule famille de son fils non reconnu par les siens laisse le jeune Jean Antoine, orphelin à seize ans aux alentours de début novembre 1547, sous le début de règne d’Henri II.
Si celui-ci s’inscrit dans la lignée de son père François 1 en ce qui concerne les arts et la politique étrangère, il prend dès octobre 1547 des mesures répressives contre les protestants. Il met en place une politique monétaire moins dispendieuse, une administration de cour complètement renouvelée en 1547, de nouveaux impôts et des réformes visant à établir un État puissant au pouvoir centralisé, ce qui ne se fera pas sans heurts intérieurs que les écrivains et poètes ne pourront ignorer.De l’étude à la poésie et aux amours.
On ne sait à quel moment exact Jean Antoine et Ronsard terminèrent leurs humanités au Collège des Coquerets. On les retrouve à Paris, sur les bancs du Collège de Boncourt, écoutant de savantes lectures, comme Jean Passerat débutant, expliquant les commentaires de César. Il passe l’année 1551, moitié à Paris, moitié à Orléans, intéressé par la « Faculté des lois ».
Jean Antoine se lie d’amitié avec Muret en 1551, et il retrouvera chez lui ses amis Ronsard, Jodelle, Nicolas Denisot, Belleau… futurs membres de La Pléiade. A-t-il bien rencontré à Meudon, chez le cardinal de Lorraine, La Boétie auquel est adressé en 1555 un sonnet des « Amours de Francine ».
Comment vit-il ? Le groupe a un mécène, Jean Brinon, qui paie de somptueuses dédicaces. Il participe a une œuvre collective « Le tombeau de Marguerite » pour la sœur de François 1 qui lui donne un peu de notoriété au-delà de son cercle de connaissances. Il a déjà un peu composé : un essai « sur la paix avec les Anglais », un sonnet « Gentil Ronsard » qui sera publié en fin du livre de son ami en 1550. Il ne s’agit pas d’oeuvres très glorieuses, mais Jean Antoine prouve qu’il y maîtrise techniques et clichés de l’époque.
Dans ce contexte poétique foisonnant très à la mode, ami d’un Ronsard populaire pour ses Odes et bientôt pour « Les amours de Cassandre », Jean Antoine publie fin 1552, les « amours de Méline ».
Las. Il n’en retire qu’une polémique qui le fera rager contre un certain « Mastin », un critique peu bienveillant dont nous ne saurons rien. Il quitte Paris, sonne l’hallali, dégorge sa bile en vingt pages de malédictions ininterrompues mais… il n’est pas plus sincère que dans ses vers. Il soutiendra en 1554 que les poètes discourent mieux de l’amour quand ils sont « moins atteints de maladie ». Il n’est pas le seul à ainsi créer de feintes chansons pour « une amour contrefaite » : « chansons », car comme beaucoup de ses amis, il chante ses vers en s’accompagnant de la guitare.
En 1553, à Arcueil, avec ses amis poètes, il se prête à une joyeuse mascarade déguisée en l’honneur de Jodelle, « la fête du bouc », imitation d’un rite païen grec, qui vaudra par la suite quelques tracas à ses auteurs, pour l’avoir chacun racontée dans leurs vers. Ronsard ira jusqu’à effacer les siens pour faire cesser la polémique avec les protestant et le diocèse de Gentilly qui les accuse d’idolâtrie. Jean Antoine la raconte dans son « dithyrambe à la pompe de bouc d’Estienne Jodelle ». Le bouc a t-il bien été égorgé, quoique les participants s’en soient défendus ? Mystère.
En 1554, il est à Poitiers, avec son ami Tahureau, « poète des nuits », gentilhomme du Maine et parent de Ronsard. Il y restera neuf mois.
Poitiers est alors une ville très active, avec nombre de poètes et d’éditeurs hardis et généreux.
Les deux amis fréquenteraient alors deux sœurs, dont l’identité est toujours sujette à caution. Tahureau a souffert avec Marion, chantée dans « l’Admirée », mais point de trace de la rupture. La femme avec laquelle il s’est marié, Marie Grené, n’est pas la sœur de son ami Guillaume de Gennes. (Source : La vie de Tahureau, par Henri Chardon 1885). Jean Antoine sera présent à son mariage dans le Berry.
Malheureusement, Tahureau meurt à Paris quelques semaines plus tard, en 1555, mort « poétiquement » attribuée à Marie qui l’aurait « épuisé ». Il faut dire que ses amis qui avaient perdu un célibataire endurci n’avaient pas vu ce mariage d’un bon œil.
Quant à Jean Antoine, il tombe réellement amoureux de « Francine », qui qu’elle soit vraiment, mais son affection n’est pas réciproque. Il feint un temps d’avoir conquis la belle pour mieux implorer le pardon de son mensonge. En vain. Le livre paraîtra en 1555. Il tentera une nouvelle approche cinq ans plus tard, sans succès.
À noter entre 1554 et 1555 sa brouille avec Ronsard, certainement sur des malentendus et quelques ragots en sus de propos aigre-doux. Mais Jean Antoine en éprouve du chagrin, tend quelques vers à son ami. Des amis se chargent alors d’organiser une réconciliation définitive.
Jean Antoine rentre à Paris, où ses amours de Francine remportent un vif succès. De ses premières années d’écriture subsistent des « baisers », des œuvres un peu licencieuses, dont il s’est vite détourné. Son « pétrarquisme » s’affirme, ainsi qu’une certaine influence « Bembiste ». Il pille aussi (« emprunte sans cesser d’être original ») sans essayer de dissimuler jusqu’aux plus prestigieux. Ainsi, il concourt à la diffusion en français de nombreuses œuvres italiennes, retouchées pour l’occasion. Cependant, on croit parfois qu’il a traduit tel ou tel sonnet, mais l’original n’existe pas.
« Il imite les textes, transpose les thèmes, pétraquise et bembise les yeux fermés » puis il rejette cette défroque lyrique en s’éloignant de la poésie amoureuse… comme une libération. Il en a cependant tiré la quintessence des règles et procédés.Poète à la Cour
Malgré l’accueil flatteur de ses amis pour ses « amours », sa « docte lamentation » sur son insuccès, il faut reconnaître, et Ronsard le fera, que ces œuvres sont indignes du talent de Jean Antoine. Celui-ci admet être un peu « paresseux à se repolir ». Pire, il avoue écrire pour lui : « Mon but est de me plaire aux chansons que je chante ».
Mais ce n’est que feinte. La poésie lyrique n’est pas son domaine de prédilection même s’il en a démonté les mécanismes et compris, voire théorisé les règles.
Il voyage. Début 1556, il est dans la Sarthe, chez Jacques Morin, conseiller au Parlement de Paris. Il ne se rend qu’une seule fois en Italie, histoire de se ressourcer mais, peu observateur, il note que les gens sont les mêmes partout.
Pour vivre, moins favorisé que Dorat et Ronsard, sans famille, il fréquente assidûment la cour d’Henri II et fait payer nombre de dédicaces, épithalames, tombeaux, épitaphes, épigrammes, poèmes officiels et autres œuvres de circonstance tandis que dans le même temps il continue ses traductions, et écrit même trois œuvres de théâtre dont l’une sera jouée : « Le brave » et « l’eunuque », deux comédies, et une « Antigone », où il ne se contente pas de traduire, mais bel et bien d’adapter le théâtre grec au goût français. Il s’autorise ainsi hardiment quelques arrangements et rajouts personnels. Selon ses pairs, il aurait pu être un bon auteur dramatique mais Jean Antoine ne s’y investira pas plus, malgré un réel talent en la matière. Il aurait aussi mis en français en autres la « Médée » d’Euripide et le « Platon » d’Aristophane Malheureusement, ces ouvrages sont perdus.
Pour la « Franciade », œuvre collective de la Pleïade, il écrit « Genevre » et « Fleurdepine », deux poèmes d’aventures. Mais Ronsard n’achève pas le projet et l’édition est un échec en 1562.
Même si tout est prétexte pour se faire remarquer des puissants, il écrit pour de nombreux fonctionnaires voire petites gens (jusqu’au « capitaine d’argoulets et couppejarrets »), loue aussi les autres poètes, versifie des faits historiques comme la prise de Calais…
Il charge aussi des amis de transmettre aux puissants à l’étranger ses recueils de poèmes qu’il dédicace en vers, espérant des « commandes » pour se faire « immortaliser, moyennant un honnête salaire ».
Malgré tout, si ses vers sont pesamment assenés, c’est parce qu’il est au fond malhabile à flatter, qu’il souffre d’une gaucherie naturelle et qu’il doit lui rester encore un peu de fierté dont il n’a su se défaire, malgré les flatteries distribuées « à pleins sacs ».
Il n’en obtient que de modestes charges, parfois fictives parce que non-payées, comme « secrétaire de la chambre du Roy », et de petites cures catholiques. Plus ou moins payé pour ses nombreuses œuvres, copiées, apprises par cœur et colportées par d’autres à la cour, il ne récolte que des succès éphémères sur des œuvres « illisibles » aujourd’hui, et pourtant écrites en vers grecs, ou latins, ou français rimé et mesuré, voire les trois à la fois.
Grâce à une de ces « petites cures », on apprend qu’en 1564 Jean Antoine habite sur les fossés près de la porte Saint Marcel et de la porte Saint Victor au pied de l’ancienne enceinte de Philippe Auguste édifiée vers 1200 dans l’actuel cinquième arrondissement de Paris.
Il parvient quand même à se faire remarquer par Catherine de Médicis, pour laquelle il écrira « Les météores » en 1567 (L’églogue premier est sien, puis il s’inspirera de l’italien Giovanni Pontano, de Virgile et de Bion). Mais comme pour ses églogues, écrites pour la plupart avant 1560, il n’en tire aucun succès.
Il bénéficie aussi, dès le règne de François II, d’une pension de douze cents livres, ce qui est considérable pour l’époque mais ne semble pas le satisfaire surtout qu’il prétend qu’elle ne lui ai pas toujours payée.
Dès 1567, il prépare son idée d’« Académie de musique et de poésie », car les poèmes sont chantés, et les premiers vers mesurés le sont avec la lyre. Le jeune roi lui-même, comme son père, aime s’accompagner d’un lutrin. Jean Antoine pratique aussi la guitare espagnole. Malgré l’opposition du Parlement, L’Académie, créée le 15 novembre 1570 par Charles IX se réunit à la maison du poète. Il veut unir plus étroitement musique et poésie, avec des lois communes, en appliquant les vers mesurés à l’antique, une réforme de l’orthographe et de la prononciation, et de distinguer par des signes les syllabes longues des syllabes brèves. Son expérience et ses études personnelles en matière de poésie sont précieuses et il partage son savoir avec Claude Lejeune, Eustache de Caurroy, Jacques Mauduit…
1570, c’est aussi l’année où Jean Antoine publie « les étrènes de poézie fransoeze en vers mezurés », une tentative de réforme de l’orthographe en écrivant phonétiquement, en éliminant les lettres superflues, en créant des caractères alphabétiques supplémentaires.
Imaginez ce que serait l’orthographe aujourd’hui si Jean Antoine avait réussi à l’époque à persuader tout le monde d’employer « l’egzakte ékriture konform o parlèr an tous les élémans d’iselui ».
En 1573, Charles IX lui donne « moyen et courage » de réunir et publier ses vers. Ce sera « Euvres en rime », travail selon lui de vingt-trois années. Malheureusement, dans cette œuvre considérable, il a aussi intégré nombre de rogatons, ébauches, rognures, épreuves manquées… Il a aussi retouché ses œuvres, en particulier les « amours », malgré ses dires, car sur cette, la langue poétique a évolué, ainsi que la grammaire.
A quarante ans, dépité, il s’estime « pauvre », une pauvreté relative par rapport à Jodelle, mort dans la misère, mais bien en dessous du niveau de vie de ses amis Ronsard et Dorat.
Pourtant, avec eux, il distrait le roi Charles IX quand il ne peut aller à la chasse à cause du mauvais temps ou de chaleur extrème.
S’il faut voir dans l’expression de cette pauvreté une obligation quasi-professionnelle de quémander faite à l’artiste de l’époque, en plus dans une période troublée et de vaches maigres pour beaucoup après la prodigalité des Valois, il y a aussi pour Jean Antoine de la déception, car malgré ses efforts et sa notoriété, il reste dans l’ombre de Ronsard en particulier et quelques autres autour de lui tirent mieux les marrons de feu qu’il ne sait faire. L’argument financier n’est qu’un exutoire et un argument pour l’extérieur pour masquer cette « injustice » qu’il ressent. Nous verrons par la suite qu’il a été souvent spolié, à des niveaux divers.
« Je cuidoy pour avoir salaire
Que ce fust assez de bien faire
Et qu’ainsi l’on gangnoit le pris.
En cette sote fantaisie
Le métier de la Poésie
J’ay mené bien près de vingt ans. »
Sous Henri II, durant les années 1550, le protestantisme se répand malgré les édits répressifs et la situation se tend dès 1557 de manière inquiétante, avec des émeutes de réformés et une tentative d’assassinat du roi. En 1559, l’édit d’Ecouen stipule que tout protestant révolté ou en fuite sera abattu. Le 10 juin, le roi embastille ceux qui critiquent sa politique. Tous se rétractèrent sauf Anne du Bourg qui quelque mois après, malgré la mort du roi due à une blessure en tournoi, sera brûlée vive.
Le traité du Cateau-Cambrésis en 1559, entérine un déclin militaire face à l’Espagne et l’Angleterre et la fin des guerres d’Italie.
Le règne de François II à partir de 1559 est dominé par une importante crise politique, financière et religieuse. Les Guise qui ont la faveur du Roi, sont perçus comme des étrangers et sont les garants en France de la religion catholique. La « conjuration d’Amboise » menée par des protestants pour retirer le jeune roi de la tutelle des Guise échoue. La répression fera entre 1200 et 1500 morts. Mais la province se soulève avec l’appui secret des deux premiers prince de sang, Condé et Navarre. Condé est arrêté le 31 octobre 1560. Le roi meurt en décembre et Catherine de Médicis le fait relâcher. Charles IX est roi à dix ans. Les guerres de religions débutent en 1562 et Jean Antoine ne devait jamais en connaître la fin, même si les périodes de paix alternent avec de nouvelles hostilités, des massacres et de cruelles exécutions. Condé meurt assassiné après sa reddition durant la Bataille de Jarnac en 1569 face à Henri d’Anjou. Nouvelle paix, dite de Saint Germain en 1570.
En 1572, alors que le mariage de la sœur du Roi, Marguerite, avec le prince de Navarre, futur Henri IV semble être un gage de réconciliation durable, (Jean Antoine leur a dédié ses « Devis des Dieux), un attentat quatre jours après contre Gaspard II de Coligny, chef des Huguenots, fait craindre à Charles IX un nouveau soulèvement et il organise l’élimination des chefs protestants, sauf le prince de Condé et Henri de Navarre. Cette décision déclenche le massacre de la Saint-Barthélémy, avec de terribles exactions de la part de l’entourage royal. La guerre reprend dans le royaume (siège de la Rochelle) et le roi, en 1573 est fort faible.
À la cour règne donc une atmosphère de peur et de complot, peu favorable aux poètes et à l’optimisme.Sous le règne d’Henri III
Le 31 mai 1574, Charles IX s’éteint. Ambroise Paré procède à l’autopsie et confirme la mort par pleurésie.
Son frère Henri, alors roi de Pologne, ex-duc d’Anjou, s’enfuit de son palais pour prendre le trône de France. D’emblée, il doit faire face à la guerre et aux complots à la cour, fomentés par le duc d’Alençon, et du roi de Navarre (futur Henri IV)
Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d’Henri III et entame la sixième guerre de religion.
Privée de son parrain, l’activité de l’Académie de musique et de poésie décline.
Et pourtant, Baif qui à cette époque est l’écrivain qui a composé le plus de vers mesurés et de poèmes de toutes sorte. Les vers rimés lui semblent une mode barbare. Mais il doit s’y replonger, et ne publie pas la plupart de ses œuvres en vers mesurés de cette période. Du Verdier, Binet, Boissard, Rapin, Sainte Marthe saluent en lui le rénovateur de cet art, et attribue l’insuccès de Baif aux préjugés du public et au « style ferré » du poète. Il en est aujourd’hui considéré comme l’inventeur, par ceux bien rares qui le connaissent, bien sûr.
A suivre... votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 15 Novembre 2015 à 23:19
Henri IV

Henri IV
de Luigi Pirandello
PERSONNAGES« HENRI IV ».
LA MARQUISE MATHILDE SPINA.
SA FILLE FRIDA.
LE JEUNE MARQUIS CARLO DI NOLLI.
LE BARON TITO BELCREDI.
LE DOCTEUR DIONISIO GENONI.
LES QUATRE PSEUDO-CONSEILLERS SECRETS :
1° ARIALD (Franco).
2° LANDOLF (Lolo).
3° ORDULF (Momo).
4° BERTHOLD (Fino).
LE VIEUX VALET DE CHAMBRE GIOVANNI.
DEUX HOMMES D’ARMES EN COSTUME.
De nos jours, en Ombrie, dans une villa isolée.
Henri IV a été représenté par laCompagnie Pitoeff pour la première fois au théâtre de Monte Carlole 3 janvier 1925, à Paris au théâtre des Artsle 23 février 1925 par M. Georges Pitoeff,Mme Mora Sylvère, Mme LudmillaPitoeff et MM. Peltier, Evseief, Jim Geralds,Hort, Penay, Ponty, Nauny, Mathis, Léonard.
ACTE PREMIER
Le salon d’une villa aménagé de façon à représenter ce que pouvait être la salle du trône du palais impérial de Goslar, au temps d’Henri IV. Mais, tranchant sur le mobilier ancien, deux tableaux modernes, deux portraits de grandeur naturelle, se détachent sur le mur du fond, placés à peu de hauteur du parquet, au-dessus d’un entablement de bois sculpté qui court le long du mur, large et saillant, de façon à ce qu’on puisse s’y asseoir comme sur une banquette. L’un de ces tableaux est à droite, l’autre à gauche du trône, qui interrompt l’entablement au milieu du mur, pour y insérer le siège impérial sous son baldaquin bas. Les deux tableaux représentent l’un, unhomme, l’autre, une femme, jeunes, chacun revêtu d’un travesti decarnaval : l’homme est déguisé en Henri IV, la femme enMathilde de Toscane. Portes à droite et à gauche.
Au lever du rideau, deux hommes d’armes,comme surpris en faute, bondissent de l’entablement où ils étaientétendus et vont s’immobiliser de part et d’autre du trône, avecleurs hallebardes. Peu après, par la seconde porte à droiteentrent : Ariald, Landolf, Ordulf et Berthold, jeunes genspayés par le marquis Carlo di Molli pour jouer le rôle de« conseillers secrets », seigneurs appartenant à lapetite noblesse et appelés à la cour de Henri IV. Ils revêtentle costume des chevaliers du XIe siècle. Le dernier,Berthold, de son vrai nom Fino, prend son service pour la premièrefois. Ses trois camarades lui donnent des détails tout en semoquant de lui. La scène sera jouée avec un grand brio.
LANDOLF, à Berthold, poursuivant sesexplications. – Et maintenant, voilà la salle dutrône !
ARIALD. – À Goslar !
ORDULF. – Ou, si tu préfères, au château duHartz !
ARIALD. – Ou encore, à Worms.
LANDOLF. – C’est selon l’épisode que nousreprésentons… La salle se déplace avec nous.
ORDULF. – De Saxe en Lombardie.
ARIALD. – Et de Lombardie…
LANDOLF. – Sur le Rhin !
UN DES HOMMES D’ARMES, sans bouger remuantseulement les lèvres. – Psst ! Psst !
ARIALD, se retournant à cet appel. –Qu’est-ce qu’il y a ?
PREMIER HOMME D’ARMES, toujours immobilecomme une statue, à mi-voix. – Il entre ou non ?
Il fait allusion à Henri IV.
ORDULF. – Non, non, il dort ; prenez vosaises.
DEUXIÈME HOMME D’ARMES, quittant saposition en même temps que le premier et allant de nouveaus’étendre sur l’entablement. – Eh, bon Dieu ! vous auriezpu le dire tout de suite !
PREMIER HOMME D’ARMES, s’approchantd’Ariald. – S’il vous plaît, vous n’auriez pas uneallumette ?
LANDOLF. – Hé là ! pas de pipesici !
PREMIER HOMME D’ARMES, tandis qu’Arialdlui tend une allumette enflammée. – Non, non, je vais fumerune cigarette…
Il allume et va s’étendre à sontour, en fumant, sur l’entablement.
BERTHOLD, qui observe la scène d’un airstupéfait et perplexe, promène son regard autour de la salle, puis,examinant son costume et celui de ses camarades. – Maispardon… cette salle… ces costumes… de quel Henri IVs’agit-il ? Je ne m’y retrouve pas du tout… D’Henri IV deFrance ou d’un autre ?
À cette question, Landolf, Ariald etOrdulf éclatent d’un rire bruyant.
LANDOLF, riant toujours et montrant dudoigt Berthold à ses camarades, qui continuent à rire, comme pourles inviter à se moquer encore de lui. – Henri IV deFrance !
ORDULF, de même. – Il croyait quec’était celui de France !
ARIALD. – C’est d’Henri IV d’Allemagnequ’il s’agit, mon cher… Dynastie des Saliens !
ORDULF. – Le grand empereurtragique !
LANDOLF. – L’homme de Canossa ! Nousmenons ici, jour après jour, la plus impitoyable des guerres, entrel’État et l’Église, comprends-tu ?
ORDULF. – L’Empire contre la Papauté !As-tu compris ?
ARIALD. – Les antipapes contre lespapes !
LANDOLF. – Les rois contre lesantirois !
ORDULF. – Et guerre au Saxon !
ARIALD. – Et guerre à tous les princesrebelles !
LANDOLF. – Guerre aux fils de l’Empereureux-mêmes !
BERTHOLD, sous cette avalanche, plongeantsa tête dans ses mains. – J’ai compris ! J’aicompris ! Voilà pourquoi je ne m’y retrouvais plus du tout,quand vous m’avez donné ce costume et m’avez fait entrer dans cettesalle ! Je me disais aussi : ce ne sont pourtant pas descostumes du XVIe siècle !
ARIALD. – Il n’y a pas plus de XVIesiècle que sur ma main !
ORDULF. – Nous sommes ici entre l’an 1000 etl’an 1100 !
LANDOLF. – Tu peux calculer toi-même :c’est aujourd’hui le 25 janvier 1071, nous sommes devantCanossa…
BERTHOLD, de plus en plus affolé. –Mais alors, bon Dieu ! je suis fichu !
ORDULF. – Ah ! ça… Si tu te croyais à lacour de France !
BERTHOLD. – Toute ma préparationhistorique…
LANDOLF. – Nous sommes, mon cher, plus âgés dequatre cents ans ! Tu nous fais l’effet d’un enfant aumaillot !
BERTHOLD, en colère. – Mais,sapristi, on aurait pu me dire qu’il s’agissait d’Henri IVd’Allemagne et non pas d’Henri IV de France ! Dans lesquinze jours qu’on m’a donnés pour ma préparation, j’ai peut-êtrelu cent bouquins !
ARIALD. – Mais pardon, ne savais-tu pas que cepauvre Tito représentait ici Adalbert de Brême ?
BERTHOLD. – Qu’est-ce que tu me chantes avecton Adalbert ? Je ne savais rien du tout !
LANDOLF. – Écoute : voici comment leschoses se sont passées : après la mort de Tito, le petitmarquis di Nolli…
BERTHOLD. – Précisément, c’est la faute dumarquis ! C’était à lui de me prévenir !…
ARIALD. – Mais il te croyait sans doute aucourant !…
LANDOLF. – Eh bien, voici : il ne voulaitpas remplacer Tito. Nous restions trois, le marquis trouvait quec’était suffisant. Mais Lui a commencé à crier :« Adalbert a été chassé ! » Ce pauvre Tito,comprends-tu, il ne le croyait pas mort. Il s’imaginait que lesévêques de Cologne et de Mayence, les rivaux de l’évêque Adalbert,l’avaient chassé de sa cour.
BERTHOLD, se prenant la tête à deuxmains. – Mais je ne sais pas le premier mot de toute cettehistoire, moi !
ORDULF. – Eh bien, alors, mon pauvre, te voilàfrais !
ARIALD. – Le malheur, c’est que nous ne savonspas nous-mêmes qui tu es !
BERTHOLD. – Vous ne savez pas quel rôle jedois jouer ?
ORDULF. – Hum ! Le rôle de« Berthold ».
BERTHOLD. – Mais Berthold, qui est-ce ?Pourquoi Berthold ?
LANDOLF, – Est-ce qu’on sait !Il s’est mis à crier : « Ils m’ont chasséAdalbert ! Alors qu’on m’amène Berthold ! Je veuxBerthold ! »
ARIALD. – Nous nous sommes regardés tous lestrois dans les yeux : qui diable était ce Berthold ?
ORDULF. – Voilà, mon cher, comment tu as ététransformé en Berthold.
LANDOLF. – Tu vas jouer ce rôle àravir !
BERTHOLD, révolté et faisant mine de s’enaller. – Oh ! mais je ne le jouerai pas ! Mercibeaucoup ! Je m’en vais ! Je m’en vais !
ARIALD, le retenant, aidé d’Ordulf, enriant. – Allons, calme-toi, calme-toi !
ORDULF. – Tu ne seras pas le Berthold stupidede la fable.
LANDOLF. – Tranquillise-toi : nous nesavons pas plus que toi qui nous sommes. Voici Hérold, voilàOrdulf, moi, je suis Landolf… Il nous a donné ces noms… Nous enavons pris l’habitude, mais qui sommes-nous ? Ce sont des nomsde l’époque… Berthold doit être aussi un nom de l’époque. Seul, lepauvre Tito jouait un rôle vraiment historique, celui de l’évêquede Brême. Et on aurait dit pour de bon un évêque ! Il étaitmagnifique, ce pauvre Tito !
ARIALD. – Dame ! il avait pu étudier sonrôle dans les livres, lui !
LANDOLF. – Il donnait des ordres à tout lemonde, même à Sa Majesté : il tranchait de tout, il s’érigeaiten mentor et en grand conseiller. Nous sommes aussi « desconseillers secrets », mais… c’est pour faire nombre.L’histoire dit qu’Henri IV était détesté par la hautearistocratie, parce qu’il s’était entouré de jeunes gens de lapetite noblesse.
ORDULF. – La petite noblesse, c’est nous.
LANDOLF. – Oui, nous sommes les petits vassauxdu roi : dévoués, un peu dissolus, boute-en-train surtout…
BERTHOLD. – Il faudra aussi que je soisboute-en-train ?
LANDOLF. – Mais oui, comme nous !
ORDULF. – Et je te préviens que ce n’est pasfacile !
LANDOLF. – Mais quel dommage ! Tu vois,le cadre est parfait : nous pourrions, avec ces costumes,figurer dans un de ces drames historiques qui ont tant de succèsaujourd’hui au théâtre. Et ce n’est pas la matière qui fait défaut.L’histoire d’Henri IV ne contient pas une tragédie, elle encontient dix… Nous quatre et ces deux malheureux-là (il montreles deux hommes d’armes) quand ils se tiennent immobiles aupied du trône, raides comme des piquets, nous sommes comme despersonnages qui n’ont pas rencontré un auteur, comme des acteurs àqui on ne donne pas de pièce à représenter… Comment dire ? Laforme existe, c’est le contenu qui manque ! Ah ! noussommes beaucoup moins favorisés que les véritables conseillersd’Henri IV ; eux, personne ne leur donnait de rôle àjouer. Ils ignoraient même qu’ils avaient un rôle à jouer !Ils le jouaient au naturel, sans le savoir… Pour eux, ce n’étaitpas un rôle, c’était la vie, leur vie. Ils faisaient leursaffaires aux dépens d’autrui : ils vendaient les investitures,touchaient des pots-de-vin, toute la lyre… Tandis que nous, nousvoilà habillés comme ils l’étaient, dans cet admirable cadreimpérial… Pour faire quoi ? Rien du tout… Nous sommes pareilsà six marionnettes accrochées au mur, qui attendent un montreur quise saisira d’elles, les mettra en mouvement et leur fera prononcerquelques phrases.
ARIALD. – Non, mon cher, pardon. Il nous fautrépondre dans le ton ! S’il te parle et que tu ne sois pasprêt à lui répondre comme il veut, tu es perdu !
LANDOLF. – Oui, c’est vrai, c’estvrai !
BERTHOLD. – Précisément ! Commentpourrais-je lui répondre dans le ton, moi, qui me suis préparé pourun Henri IV de France et qui me trouve, à présent, en faced’un Henri IV d’Allemagne ?
Landolf, Ordulf et Ariald recommencent àrire.
ARIALD. – Eh ! il faut te préparer sansretard !
ORDULF. – Ne t’inquiète pas ! Nous allonst’aider.
ARIALD. – Si tu savais tous les livres quenous avons à notre disposition ! Tu n’auras qu’à en feuilleterquelques-uns.
ORDULF. – Mais oui, pour prendre uneteinture…
ARIALD. – Regarde ! (Il le faittourner et lui montre, sur le mur du fond, le portrait de lamarquise Mathilde.) Voyons, celle-là, qui est-ce ?
BERTHOLD, regardant. – Quic’est ? Mais avant tout, quelqu’un qui n’est guère dans leton ! Deux tableaux modernes ici, au milieu de toutes cesantiquailles !
ARIALD. – Tu as parfaitement raison. Ils n’yétaient pas au début. Il y a deux niches derrière ces tableaux. Ondevait y placer deux statues, sculptées dans le style del’époque ; mais les niches sont restées vides et on les adissimulées sous les deux portraits que tu vois…
LANDOLF, l’interrompant etcontinuant. – … qui détonneraient tout à fait sic’étaient véritablement des tableaux.
BERTHOLD. – Comment, ce ne sont pas destableaux ?
LANDOLF. – Si, si, tu peux les toucher, cesont des toiles peintes, mais, pour lui (il montremystérieusement sa droite faisant allusion à Henri IV)qui ne les touche pas…
BERTHOLD. – Que sont-elles donc, pourlui ?
LANDOLF. – Simple interprétation de ma part…tu sais, mais, au fond, je la crois juste. Pour lui, eh bien !ce sont des images, des images comme… voyons… comme un miroir peutles offrir. Comprends-tu ? Celle ci (il montre le portraitd’Henri IV) le représente lui-même vivant, tel qu’il est,dans cette salle du trône, qui se présente, de son côté, tellequ’elle le doit, conforme au style et aux mœurs de l’époque. Dequoi t’étonnes-tu ? Si on te plaçait devant un miroir, ne t’yverrais-tu pas vivant et présent, bien que vêtu d’étoffesanciennes ? Eh bien, sur ce mur, c’est comme s’il y avait deuxmiroirs qui reflètent deux images vivantes d’un monde mort. Cemonde-là, en restant avec nous, tu le verras peu à peu reprendrevie lui aussi !
BERTHOLD. – Prenez garde que je ne veux pasdevenir fou dans cette maison !
ARIALD. – Tu ne deviendras pas fou ! Tut’amuseras !
BERTHOLD. – Mais, dites-moi, comment diableêtes-vous devenu tous les trois aussi savants ?
LANDOLF. – Eh, mon cher, on ne remonte pas dehuit cents ans en arrière dans l’histoire sans rapporter avec soiune petite expérience !
ARIALD. – Sois tranquille, tu verras comme enpeu de temps tu seras absorbé, toi aussi, par tout cela !
ORDULF. – Et comme nous, à cette école, tudeviendras savant à ton tour.
BERTHOLD. – Eh bien, aidez-moi sanstarder ! Donnez-moi tout de suite les renseignementsessentiels !
ARIALD. – Fie-toi à nous… Un peu l’un, un peul’autre !…
LANDOLF. – Nous t’attacherons toutes lesficelles qu’il faudra et nous ferons de toi la plus parfaite desmarionnettes, sois tranquille ! Et maintenant, viens…
Il le prend par le bras et l’entraîne versla sortie.
BERTHOLD, s’arrêtant et examinant leportrait. – Attendez ! Vous ne m’avez pas dit qui estcette femme. La femme de l’Empereur ?
ARIALD. – Non, la femme de l’Empereur, c’estBerthe de Suse, la sœur d’Amédée II de Savoie.
ORDULF. – Oui, et l’Empereur qui se pique derester aussi jeune que nous, ne peut plus la souffrir ; ilpense à la répudier.
LANDOLF. – La femme que tu vois sur ce tableauest son ennemie la plus féroce : c’est la marquise Mathilde deToscane.
BERTHOLD. – Ah ! je sais ! Celle quia donné l’hospitalité au pape…
LANDOLF. – Précisément, à Canossa !
ORDULF. – Au pape Grégoire VII
ARIALD. – Grégoire VII, notre bêtenoire ! Allons, viens !
Ils se dirigent tous les quatre vers laporte à droite, par où ils sont entrés, quand, par la porte àgauche, entre le vieux valet de chambre Giovanni, en frac.
GIOVANNI. – Eh ! psst !Franco ! Lolo !
ARIALD, s’arrêtant et se tournant verslui. – Qu’est-ce que c’est ?
BERTHOLD, étonné à la vue du valet enfrac. – Comment ? Lui, ici ?
LANDOLF. – Un homme du XXe siècleici ! Dehors !
Il court sur lui, le menaçant pour rireet, aidé d’Ariald et d’Ordulf, fait mine de le chasser.
ORDULF. – Émissaire de Grégoire VII, horsd’ici !
ARIALD. – Hors d’ici ! horsd’ici !
GIOVANNI, agacé, se défendant. –Laissez-moi tranquille !
ORDULF. – Non, tu n’as pas le droit de mettreles pieds dans cette salle !
ARIALD. – Hors d’ici ! horsd’ici !
LANDOLF, à Berthold. – C’est de lamagie pure, tu sais ! C’est un démon évoqué par le Sorcier deRome ! Vite, tire ton épée !
Il fait le geste de tirer l’épée, luiaussi.
GIOVANNI, criant. – Au nom duciel ! cessez de faire les fous avec moi ! Monsieur leMarquis vient d’arriver. Il est en compagnie…
LANDOLF, se frottant les mains. – Ah,ah ! très bien ! Est-ce qu’il y a des dames ?
ORDULF, de même. – Desvieilles ? des jeunes ?
GIOVANNI. – Il y a deux messieurs.
ARIALD. – Mais les dames, les dames, quisont-elles ?
GIOVANNI. – Madame la Marquise et safille.
LANDOLF, étonné. – Commentcela ?
ORDULF, de même. – Tu dis lamarquise ?
GIOVANNI. – La marquise, la marquise,parfaitement.
ARIALD. – Et les messieurs ?
GIOVANNI. – Connais pas.
ARIALD, à Berthold. – Ils apportentle contenu qui manquait à notre forme !
ORDULF. – Ce sont tous des émissaires deGrégoire VII ! Nous allons rire !
GIOVANNI. – Allez-vous me laisser parler à lafin ?
ARIALD. – Parle ! Parle !
GIOVANNI. – Je crois qu’un de ces messieursest un médecin !
LANDOLF. – Ah ! très bien ! Encoreun nouveau médecin !
ARIALD. – Bravo, Berthold ! Tu nousportes chance !
LANDOLF. – Tu vas voir comment nous allons lerecevoir, ce médecin !
BERTHOLD. – Mais je vais me trouver, dès monarrivée, dans un sacré embarras !
GIOVANNI. – Écoutez-moi bien ! Ilsveulent pénétrer dans cette salle.
LANDOLF, stupéfait et consterné. –Comment ! Elle, la marquise, ici ?
ARIALD. – En fait de contenu…
LANDOLF. – C’est une tragédie qui va sortir delà !
BERTHOLD, plein de curiosité. – Etpourquoi cela ? Pourquoi ?
ORDULF, indiquant le portrait. – Maisc’est que la marquise, c’est elle, comprends-tu ?
LANDOLF. – Sa fille est fiancée au petitmarquis di Nolli !
ARIALD. – Mais que viennent-ils faireici ? Peut-on le savoir ?
ORDULF. – S’il la voit, gare !
LANDOLF. – Va-t-il seulement lareconnaître ?
GIOVANNI. – S’il s’éveille, retenez-le dansson appartement.
ORDULF. – C’est facile à dire, maiscomment ?
ARIALD. – Tu sais bien comment ilest !
GIOVANNI. – Par la force, s’il le faut !Voilà les ordres qu’on m’a donnés. Vous n’avez qu’à exécuter !Allez, maintenant !
ARIALD. – Allons… Il est peut-être déjàréveillé !
ORDULF. – Allons ! allons !
LANDOLF, suivant ses camarades, àGiovanni. – Mais tu nous expliqueras tout à l’heure !
GIOVANNI, criant. – Fermez à doubletour par là-bas, et cachez la clé. (Indiquant l’autre porte àdroite.) L’autre porte aussi.
Landolf et Ordulf sortent par la secondeporte à droite.
GIOVANNI, aux deux hommes d’armes. –Allez-vous-en aussi ! Passez par là ! (Il montre lapremière porte à droite.) Refermez la porte et emportez laclé !
Les deux hommes d’armes sortent par lapremière porte à droite. Giovanni va vers la porte de gauche etintroduit donna Mathilde Spina, sa fille, la marquiseFrida, le docteur Dionisio Genoni, le baron Tito Belcredi, et lejeune marquis Carlo di Nolli qui, en sa qualité de maître demaison, entre le dernier. Donna Mathilde a environ quarante-cinqans. Elle est encore belle, bien qu’elle répare d’une façon tropvoyante les outrages du temps par un maquillage excessif, toutsavant qu’il soit, qui lui donne une tête farouche de Walkyrie. Cemaquillage prend un relief en contraste profond avec la boucheadmirablement belle et douloureuse. Veuve depuis de longues années,elle est devenue la maîtresse du baron Tito Belcredi, qu’enapparence personne, pas plus elle que les autres, n’a jamais prisau sérieux. Ce que Tito Belcredi est en réalité pour elle, lui seulle sait bien, et c’est pourquoi il peut rire si son amie éprouve lebesoin de faire semblant de l’ignorer, rire aussi pour répondre auxrires que les plaisanteries de la marquise à ses dépens provoquentchez les autres. Mince, précocement gris, un peu plus jeunequ’elle, il a une curieuse tête d’oiseau. Il serait plein devivacité si sa souple agilité (qui fait de lui un escrimeur trèsredouté), ne semblait enfermée dans le fourreau d’une paressesomnolente d’Arabe qu’exprime sa voix un peu nasale et traînante.Frida, la fille de la marquise, a dix-neuf ans. Grandie tristementdans l’ombre où sa mère, impérieuse et trop voyante, l’a tenue,elle est en outre blessée par la médisance facile que provoque samère et qui, désormais, nuit surtout à elle. Par bonheur, elle estdéjà fiancée au marquis Carlo di Nolli, jeune homme sérieux, trèsindulgent pour les autres, mais réservé et désireux d’égards ;il est pénétré du peu qu’il croit être et de sa valeur dans lemonde ; bien que, peut-être, il ne sache pas bien lui-même aufond ce qu’il vaut. D’autre part, il est accablé par le sentimentde toutes les responsabilités qu’il s’imagine peser sur lui :ah ! les autres sont bien heureux, ils peuvent rire ets’amuser, tandis que lui ne le peut pas ; il le voudrait bien,mais il a le sentiment qu’il n’en a pas le droit. Il est en granddeuil de sa mère. Le docteur Dionisio Genoni a un large facièsimpudique et rubicond de satyre ; des yeux saillants, unebarbiche en pointe, brillante comme de l’argent, de belles façons.Il est presque chauve. Tous entrent avec componction, presque aveccrainte ; ils examinent la salle avec curiosité, sauf di Molliqui la connaît déjà. Les premières répliques s’échangent à voixbasse.
Di Nolli, à Giovanni. – Tu as biendonné les ordres ?
GIOVANNI. – Monsieur le Marquis peut êtretranquille.
Il s’incline et sort.
BELCREDI. – Ah ! c’est magnifique !c’est magnifique !
LE DOCTEUR. – C’est remarquablementintéressant ! Le délire est systématisé à la perfection,jusque dans le cadre ! C’est vraiment magnifique !
DONNA MATHILDE, qui a cherché des yeux sonportrait, le découvrant et s’en approchant. – Ah ! levoilà ! (Elle se place à bonne distance pour le regarder,agitée par des sentiments divers.) Oui ! Oui !…Oh ! regardez… Mon Dieu !… (Elle appelle safille.) Frida, Frida !… Regarde !…
FRIDA. – C’est ton portrait !…
DONNA MATHILDE. – Mais non !… Regardebien… ce n’est pas moi, c’est toi qui es là !…
DI NOLLI. – N’est-ce pas ? Je vousl’avais dit !…
DONNA MATHILDE. – Je n’aurais jamais cru quece fut à ce point… (S’agitant comme si un frisson luiparcourait le dos.) Mon Dieu ! quelle impression !(Puis regardant sa fille.) Mais comment, Frida ?(Elle lui entoure la taille de son bras.) Viens un peu. Tune te vois pas en moi, dans ce portrait ?
FRIDA. – À dire vrai… heu…
DONNA MATHILDE. – Tu ne trouves pas ?…Est-il possible ?… (Se tournant vers Belcredi.)Regardez, Tito, et dites-le, dites-le vous-même !
BELCREDI, sans regarder. – Non, moi,je ne regarde pas ! Pour moi, a priori, c’estnon !
DONNA MATHILDE. – Quel imbécile ! Ilcroit me faire un compliment ! (Se tournant vers ledocteur.) Et vous, docteur, qu’est-ce que vous enpensez ?
Le docteur s’approche.
BELCREDI, tournant le dos et feignant dele rappeler. – Psst ! Non, docteur ! Je vous enprie ! ne répondez pas !
LE DOCTEUR, étonné et souriant. –Mais pourquoi ?
DONNA MATHILDE. – Ne l’écoutez pas !Approchez !… Il est insupportable !
FRIDA. – Il fait l’imbécile parvocation ! Vous le savez bien.
BELCREDI, au docteur, en le voyants’approcher. – Regardez vos pieds, docteur ! Regardez vospieds ! Vos pieds !
LE DOCTEUR. – Mes pieds ? Pourquoidonc ?
BELCREDI. – Vous avez des souliers ferrés.
LE DOCTEUR. – Moi ?
BELCREDI. – Oui, monsieur, et vous allezécraser quatre pieds de cristal.
LE DOCTEUR, riant fort. – Maisnon !… Y a-t-il vraiment lieu de faire tant d’histoires parcequ’une fille ressemble à sa mère…
BELCREDI. – Patatras ! la gaffe estfaite !
DONNA MATHILDE, exagérément en colère,marchant sur Belcredi. – Pourquoi patatras ? Qu’est-cequ’il y a ? Qu’a dit le docteur ?
LE DOCTEUR, avec candeur. – N’ai-jepas raison ?
BELCREDI, regardant la marquise. – Ildit qu’il n’y a pas lieu de s’étonner de cette ressemblance…Pourquoi donc marquez-vous tant de stupeur, je vous le demande, sila chose vous semble toute naturelle ?
DONNA MATHILDE, encore plus encolère. – Idiot ! Idiot ! Précisément, ce seraittout naturel, si c’était le portrait de ma fille. (Elle montrele tableau.) Mais ce portrait, c’est le mien, et y retrouverma fille, au lieu de m’y retrouver, moi, voilà ce qui a provoqué mastupeur. Et, je vous prie de la croire sincère… Je vous défends dela mettre en doute !
Après cette violente sortie, un moment desilence embarrassé.
FRIDA, à voix basse, avec ennui. –C’est toujours la même chose ! Pour un rien, unediscussion !…
BELCREDI, à voix basse également, commepour s’excuser. – Mais je n’ai rien mis en doute… J’aiseulement remarqué que, dès le début, tu ne partageais par lastupeur de ta mère. Si tu t’es étonnée de quelque chose, c’est queta ressemblance entre toi et ce portrait parût si frappante à tamère.
DONNA MATHILDE. – Naturellement ! Elle nepeut pas se reconnaître en moi telle que j’étais à son âge ;tandis que moi, je peux, dans ce portrait, me reconnaître en elletelle qu’elle est en ce moment.
LE DOCTEUR. – C’est parfaitement juste !Un portrait fixe pour toujours une minute. Cette minute lointainene rappelle rien à mademoiselle, tandis qu’elle peut rappeler àmadame la Marquise des gestes, des attitudes, des regards, dessourires, mille choses, enfin, qui ne sont pas peintes sur latoile.
DONNA MATHILDE. – Voilà, c’est exactementcela !
LE DOCTEUR, poursuivant, tourné verselle. – Et que tout naturellement vous retrouvez aujourd’huivivantes dans votre fille !
DONNA MATHILDE. – Il faut qu’il gâte lemoindre de mes abandons à un sentiment spontané, par simple besoinde m’irriter.
LE DOCTEUR, aveuglé par les lumières qu’ilvient de répandre, reprend sur un ton professoral, en s’adressant àBelcredi. – La ressemblance, mon cher Baron, est souvent unequestion « d’impondérables »…« d’impondérables », et c’est ainsi qu’on peut expliquerque…
BELCREDI, pour interrompre la leçon.– Quelqu’un pourrait trouver, mon cher docteur, une ressemblanceentre vous et moi !
Di NOLLI. – Je vous en prie, parlons d’autrechose ! (Il montre les deux portes à droite, pour indiquerqu’on peut être entendu.) Nous avons déjà perdu trop de tempsen route…
FRIDA. – Naturellement. (MontrantBelcredi.) Quand il est là…
DONNA MATHILDE, l’interrompant. –C’est pourquoi je ne voulais pas qu’il vînt !
BELCREDI. – Quelle ingratitude ! Pendantle voyage vous avez fait rire tout le monde à mes dépens !
Di Nolli. – Je t’en prie, Tito ! Laissonscela. Le docteur est ici. Ne perdons pas de temps. Tu sais combiencette consultation me tient à cœur.
LE DOCTEUR. – Voyons un peu… Essayons toutd’abord de bien préciser quelques points. Je vous demande pardon,madame la Marquise : comment votre portrait se trouve-t-ilici ? Vous lui en aviez fait cadeau à l’époque del’accident ?
DONNA MATHILDE. – Pas du tout. À quel titreaurais-je pu lui en faire cadeau ? J’avais l’âge de Frida, jen’étais même pas encore fiancée. J’ai cédé ce portrait sur lesvives instances de sa mère (elle montre di Nolli), troisou quatre ans après l’accident ?
LE DOCTEUR. – La mère de monsieur était sasœur ?
Il montre la porte à droite, faisantallusion à Henri IV.
Di NOLLI. – Oui, docteur, et notre visited’aujourd’hui est une dette sacrée envers ma mère, que j’ai perdueil y a un mois. Au lieu d’être ici, elle (il montre Frida)et moi, nous devrions être en voyage de noces…
LE DOCTEUR. – Et occupés à bien d’autressoins, j’entends bien !
Di NOLLI. – Ma mère est morte avec l’idée quela guérison de son frère adoré était prochaine.
LE DOCTEUR. – Et vous ne pouvez pas me diresur quels symptômes elle se fondait ?
Di NOLLI. – Peu de temps avant la mort de mamère, il lui avait tenu, paraît-il, un étrange discours.
LE DOCTEUR. – Un discours ? Ehmais !… il serait extrêmement utile, extrêmement, de leconnaître !
Di NOLLI. – Ce qu’il lui a dit, je l’ignore.Je sais que ma mère revint terriblement angoissée de cette dernièrevisite. Il semble qu’il lui ait témoigné une tendresseinaccoutumée. Comme s’il avait pressenti la fin prochaine de sasœur. Sur son lit de mort, elle m’a fait promettre de ne jamaisl’abandonner, de le faire examiner par d’autres médecins…
LE DOCTEUR. – Bon, très bien. Nous allonsvoir. Tout d’abord… vous le savez, souvent les plus petites causes…Ce portrait…
DONNA MATHILDE. – Ah ! je ne crois pas,docteur, qu’il faille lui accorder une importance excessive. Sij’ai été troublée en l’apercevant, c’est que je ne l’avais pas revudepuis de longues années.
LE DOCTEUR. – Je vous en prie… je vous enprie… de la méthode…
Di NOLLI. – Le portrait est là depuis unequinzaine d’années…
DONNA MATHILDE. – Davantage ! Plus dedix-huit ans !
LE DOCTEUR. – Voudriez-vous me faire la grâcede m’écouter ! Vous ne savez pas encore ce que je veux vousdemander ! Je compte beaucoup, mais beaucoup, sur ces deuxportraits, qui ont été exécutés, naturellement, avant cette fameuseet malheureuse cavalcade ?
DONNA MATHILDE. – Naturellement !
LE DOCTEUR. – À un moment, par conséquent, oùil avait toute sa raison… J’en viens à ma question… Est-ce lui quivous avait proposé de faire exécuter ces portraits ?
DONNA MATHILDE. – Mais, pas du tout,docteur ! La plupart de ceux qui prenaient part à la cavalcadese firent portraiturer pour en conserver un souvenir.
BELCREDI. – Je me suis fait peindre, moiaussi, en « Charles d’Anjou ».
DONNA MATHILDE. – Dès que les costumes furentprêts.
BELCREDI. – Voilà. On se proposait derassembler toutes ces toiles en souvenir, comme dans un musée, dansle salon de la villa où devait avoir lieu le bal masqué après lacavalcade, mais ensuite, chacun préféra conserver son portrait.
DONNA MATHILDE. – Et le mien, je vous l’aidéjà dit, je l’ai cédé plus tard, sans regret d’ailleurs, sur lesinstances de sa mère.
Elle montre de nouveau di Nolli.
LE DOCTEUR. – Vous ne savez pas si c’est luiqui l’a réclamé ?
DONNA MATHILDE. – Je l’ignore… Peut-être…C’est peut-être aussi sa sœur, pour seconder affectueusement…
LE DOCTEUR. – Autre chose, autre chose !L’idée de la cavalcade était-elle de lui ?
BELCREDI, lui coupant la parole. –Non, non ! elle était de moi, elle était de moi !
LE DOCTEUR. – Je vous en prie…
DONNA MATHILDE. – Ne l’écoutez pas, c’est cepauvre Belassi qui en avait eu l’idée.
BELCREDI. – Belassi, pas du tout !
DONNA MATHILDE, au docteur. – Lecomte Belassi qui mourut deux ou trois mois plus tard…
BELCREDI. – Belassi n’était pas là quand…
DI NOLLI, ennuyé par la menace d’unenouvelle discussion.
– Pardon, docteur, est-ilvraiment nécessaire d’établir qui eut l’idée première de lacavalcade ?
LE DOCTEUR. – Eh oui ! cela pourraitm’être utile…
BELCREDI. – L’idée était de moi !Pourquoi me la disputer ? Je n’ai pas tant à m’en glorifier,étant donné les suites qu’elle a eues ! C’était, docteur, jeme le rappelle très bien, au cercle, un soir, début novembre. Jefeuilletais une revue illustrée allemande. (Je regardais simplementles images, bien entendu, – je ne sais pas l’allemand.) Une de cesgravures représentait l’Empereur, dans je ne sais quelle villeuniversitaire, où il avait été étudiant.
LE DOCTEUR. – Bonn, sans doute.
BELCREDI. – Bonn, c’est possible. Il était àcheval, revêtu d’un de ces étranges costumes des vieillesassociations goliardiques d’Allemagne. Un cortège d’étudiantsnobles le suivait à cheval aussi et en costumes. Cette gravure medonna l’idée de la cavalcade. Il faut que vous sachiez qu’aucercle, nous songions à organiser une grande fête travestie pour lecarnaval. Je proposai cette cavalcade historique : historiquesi l’on veut : « babélique », plutôt. Chacun de nousdevait choisir un personnage à représenter, pris dans un siècle oudans un autre : un roi, un empereur ou un prince, avec sa dameà côté de lui, reine ou impératrice, à cheval. Les chevauxcaparaçonnés, bien entendu, à la mode de l’époque. La propositionfut acceptée.
DONNA MATHILDE. – Moi, c’est Belassi quim’avait invitée.
BELCREDI. – S’il vous a dit que l’idée étaitde lui, il se l’est indûment appropriée. Il n’était même pas aucercle, je vous le répète, le soir où je fis ma proposition. Lui(il fait allusion à Henri IV) n’y était pasdavantage, du reste !
LE DOCTEUR. – Et il fixa son choix sur lepersonnage d’Henri IV ?
DONNA MATHILDE. – Oui, parce qu’à cause de monnom, et sans beaucoup réfléchir, j’avais déclaré que je medéguiserais en marquise Mathilde de Toscane.
LE DOCTEUR. – Je vous avoue que je ne vois pasbien le rapport…
DONNA Mathilde. – Je ne le voyais pas nonplus, tout d’abord, mais à mes questions, il répondit qu’il seraitalors à mes pieds comme Henri IV à Canossa. Je connaissaisbien l’affaire de Canossa, mais j’en ignorais les détails, etj’éprouvai une curieuse impression, en relisant mon histoire pourpréparer mon rôle, à me trouver l’amie fidèle et zélée du papeGrégoire VII, en lutte féroce contre l’Empire. Mais je comprisaussi pourquoi, mon choix s’étant fixé sur Mathilde, implacableennemie de l’Empereur, il avait voulu figurer à mes côtés danscette cavalcade, sous le costume d’Henri IV.
LE DOCTEUR. – Ah ! C’est que sansdoute… ?
BELCREDI. – Vous avez deviné, docteur… Il luifaisait, à cette époque, une cour acharnée, et elle,naturellement…
DONNA MATHILDE, piquée, avec feu. –Naturellement ! Oui, naturellement ! et surtout à cetteépoque : « naturellement » !
BELCREDI, la désignant. – Elle nepouvait pas le souffrir !
DONNA MATHILDE. – C’est faux ! Il nem’était pas antipathique ! Au contraire ! Mais, pour moi,il a toujours suffi que quelqu’un veuille se faire prendre ausérieux…
BELCREDI, continuant la phrase. –Pour que vous tiriez de là aussitôt une preuve éclatante de sastupidité !
DONNA MATHILDE. – Non, mon cher ! Dumoins pas cette fois-là. Vous êtes stupide, lui ne l’était pas…
BELCREDI. – Du moins je n’ai jamais essayé deme faire prendre au sérieux !
DONNA MATHILDE. – Je le sais bien ! Maisavec lui, il n’y avait pas à plaisanter. (Sur un autre ton, setournant vers le docteur.) Il arrive aux femmes, mon cherdocteur, entre mille disgrâces, de rencontrer parfois un regardchargé de la promesse contenue, intense d’un sentimentéternel ! (Elle éclate d’un rire aigu.) Rien de plusdrôle ! Ah ! si les hommes se voyaient avec ce« sentiment éternel » dans le regard… Je n’ai jamais pum’empêcher d’en rire ! et surtout à cette époque-là !…Mais je dois l’avouer : je le peux bien aujourd’hui, aprèsvingt ans et plus… Je me mis à rire de lui comme des autres, maisce fut surtout parce que j’en avais peur. On aurait pu avoirconfiance dans une promesse de ces yeux-là. Mais ç’aurait ététerriblement dangereux.
LE DOCTEUR, avec un vif intérêt,concentrant son attention. – Ah ! voilà ! voilà unechose que j’aimerais beaucoup savoir ! Très dangereux,pourquoi ?
DONNA MATHILDE, avec légèreté. –Précisément parce qu’il n’était pas comme les autres ! etétant donné que je suis, moi aussi… je suis… je peux le dire…, jesuis un peu…, et même plus qu’un peu… Je suis (elle cherche uneparole modeste), oui, tout à fait incapable de supporter…voilà, incapable de supporter tout ce qui est compassé, pesant,artificiel ! Mais j’étais si jeune alors, vouscomprenez ? Jeune fille, je rongeais mon frein, mais pourrépondre à cet amour-là, il m’aurait fallu un courage que je ne mesentais pas. Et alors j’ai ri de lui comme des autres. J’en avaisdu remords. J’enrageai contre moi, plus tard, en me rendant compteque mon rire ne faisait qu’un avec celui de tout le monde, de tousles imbéciles qui se moquaient de lui.
BELCREDI. – Oui, à peu près comme on se moquede moi.
DONNA MATHILDE. – Vous, vous faites rire àcause de votre manie de toujours vous ravaler ! Tandis quelui, c’était tout le contraire ! Vous, d’abord, on vous rit aunez !
BELCREDI. – Mieux vaut qu’on vous rie au nezque dans le dos.
LE DOCTEUR. – Voulez-vous que nous revenions ànos moutons ! Il était donc, à ce que je crois comprendre,déjà un peu exalté ?
BELCREDI. – Oui, mais d’une façon siparticulière, docteur !
LE DOCTEUR. – Expliquez-vous !
BELCREDI. – Voilà, il était exalté… mais àfroid…
DONNA MATHILDE. – Mais non, pas à froid !Il était un peu étrange, certainement, mais parce qu’il débordaitde vitalité ; c’était… un poète !
BELCREDI. – Je ne prétends pas qu’il simulait,l’exaltation. Non, tout au contraire ; souvent, il s’exaltaitvéritablement. Mais je peux vous assurer, docteur,qu’instantanément il se voyait lui-même, en proie à son exaltation,il en prenait conscience et il se mettait à contempler cetteexaltation comme un spectacle. Cela devait lui arriver jusque dansses mouvements les plus spontanés. Je suis certain qu’il ensouffrait : il entrait parfois contre lui-même dans des ragesdu plus haut comique !
LE DOCTEUR. – Ah ! vraiment !
DONNA MATHILDE. – Oui, c’est exact !
BELCREDI, au docteur Genoni. – Il ensouffrait, parce que ce dédoublement, cette lucidité immédiatel’exilait de ses sentiments les plus profonds, les lui rendaitétrangers… Ses sentiments lui paraissaient aussitôt – non pas fauxpuisqu’ils étaient sincères – mais des choses, auxquelles ilfallait donner sans retard une valeur… comment dire ? lavaleur d’un acte intellectuel, pour remplacer la chaleur desincérité qu’il sentait se retirer de lui. Et alors il improvisait,il exagérait, il s’exaltait pour s’étourdir et ne plus sevoir… C’est ce qui le faisait paraître inconstant, léger et,disons le mot, parfois même ridicule.
LE DOCTEUR. – Dites-moi un peu… était-ilinsociable ?
BELCREDI. – Mais pas le moins du monde !Il adorait mettre en scène des tableaux vivants, organiser desballets, des représentations de bienfaisance… Il se qualifiaitd’amateur en riant, mais c’était un acteur tout à faitremarquable !
Di NOLLI. – Sa folie a fait de lui un acteurmagnifique et terrible !…
BELCREDI. – Et dès le premier instant…Figurez-vous qu’aussitôt après son accident, après sa chute decheval…
LE DOCTEUR. – Il était tombé sur la nuque,n’est-ce pas ?
DONNA MATHILDE. – Quelle horreur ! Ilétait à côté de moi ! Je le vis étendu entre les pattes ducheval, qui s’était brusquement cabré…
BELCREDI. – Tout d’abord, nous n’imaginionspas qu’il se fût fait grand mal. La cavalcade s’arrêta. Il y eut unpeu de désordre, on voulait savoir ce qui était arrivé ; maisdéjà on l’avait relevé et transporté dans la villa.
DONNA MATHILDE. – Il n’avait rien, vous savez,pas la moindre blessure ! pas une goutte de sang !
BELCREDI. – On le croyait simplementévanoui…
DONNA MATHILDE. – Et quand deux heuresaprès…
BELCREDI. – Oui, quand il reparut dans lesalon de la villa – c’est à cela que je faisais allusion…
DONNA MATHILDE. – Si vous aviez vu sonvisage ! J’en fus tout de suite frappée !
BELCREDI. – Mais non, ne dites pas ça !Personne ne s’aperçut de rien. Comprenez-vous, docteur ?
DONNA MATHILDE. – Naturellement ! Vousétiez tous comme des fous !
BELCREDI. – Chacun jouait son rôle, c’étaitune vraie tour de Babel !
DONNA MATHILDE. – Imaginez, docteur,l’épouvante quand on comprit qu’il jouait son rôlesérieusement ?
LE DOCTEUR. – Comment, il était làaussi ?
BELCREDI. – Mais oui ! Il nous avaitrejoints. Nous imaginions qu’il était déjà rétabli et qu’il jouaitson rôle, lui aussi, comme nous tous… mieux que nous… parce que, jevous l’ai dit, c’était un acteur de premier ordre ! En sommenous imaginions qu’il plaisantait comme nous !
DONNA MATHILDE. – On commença à se moquer delui.
BELCREDI. – Et alors… il était armé (comme unroi devait l’être). Il dégaina et se précipita sur deux ou troisdes invités. Ce fut un moment de terreur !
DONNA MATHILDE. – Je n’oublierai jamais cettescène ! Ces visages grimés, fardés, décomposés en présencesoudain de ce masque terrible qui n’était plus un masque, qui étaitla Folie !
BELCREDI. – Oui, c’était Henri IV,Henri IV en personne, dans une crise de fureur !
DONNA MATHILDE. – Cette mascarade, l’obsessionde cette mascarade, dut avoir une influence sur lui. Depuis plusd’un mois, il ne pensait qu’à ça. Il était toujours obsédé par toutce qu’il faisait !
BELCREDI. – Vous n’imaginez pas les étudesqu’il avait faites pour préparer son personnage ! Il étaitdescendu jusqu’aux plus infimes détails !…
LE DOCTEUR. – Rien de plus facile àcomprendre ! Ce qui était une obsession momentanée devint idéefixe. La chute, le choc contre la nuque ayant troublé le cerveau,l’obsession s’est fixée, perpétuée… Deux cas peuvent seprésenter : devenir idiot, ou devenir fou…
BELCREDI, à Frida et à Di Nolli. –Vous voyez ça d’ici, hein ! les enfants ! (À DiNolli.) Toi, tu avais quatre ou cinq ans. (À Frida.)Ta mère dit que tu as pris sa place dans ce portrait, mais quandelle posait pour lui elle ne pensait même pas à te mettre au monde.Moi, j’ai les cheveux gris à présent, mais lui, regardez (ilmontre le portrait) – pan ! un coup sur la nuque, et iln’a plus bougé… – Henri IV.
LE DOCTEUR, plongé dans ses réflexions,levant les mains à hauteur de son visage comme pour réclamerl’attention de ses auditeurs ; il se prépare à donner uneexplication scientifique. – Eh bien, mesdames et messieurs,voici exactement…
La première porte à droite, – laplus proche de la rampe, – s’ouvre tout à coup et Berthold entre enscène, le visage décomposé.
BERTHOLD, sur le ton de quelqu’un qui nepeut plus se contenir. – Pardon ! Pardon !Excusez-moi !…
Il s’arrête en voyant l’embarras que sonapparition a suscité dans le groupe.
FRIDA, avec un cri d’épouvante, cherchantà se cacher. – Ah ! mon Dieu ! le voilà !
DONNA MATHILDE, reculant, épouvantée, unbras levé, pour ne pas le voir. – C’est lui ! C’estlui !
Di NOLLI. – Mais non ! Mais non ! Ducalme !
LE DOCTEUR, étonné. – Mais quiest-ce, alors ?
BELCREDI. – C’est quelque survivant de notremascarade !
Di NOLLI. – C’est un des quatre jeunes gensque nous avons ici pour servir sa folie.
BERTHOLD. – Je vous demande pardon, monsieurle Marquis…
Di NOLLI. – Il n’y a pas de pardon !J’avais donné ordre de fermer les portes à clé, et personne nedevait entrer ici !
BERTHOLD. – Oui, monsieur ! Mais je n’ytiens plus et je vous demande la permission de m’enaller !
Di NOLLI. – Ah ! vous êtes le nouveau…Vous êtes entré en service ce matin ?
BERTHOLD. – Oui, monsieur, et je n’y tiensdéjà plus !…
DONNA MATHILDE, consternée, à DiNolli. – Mais, il n’est donc pas aussi tranquille que vousnous le disiez ?
BERTHOLD. – Non, non, madame ! Il nes’agit pas de lui, ce sont mes trois camarades ! Vous parliezde servir cette folie, monsieur le Marquis ? Il s’agit bien deça : ce sont eux trois les véritables fous ! Moi quientre ici pour la première fois, monsieur le Marquis, au lieu dem’aider…
Landolf et Ariald entrent par la mêmeporte, à droite, en hâte, avec anxiété, mais s’arrêtent sur leseuil sans oser s’avancer.
LANDOLF. – Oh !… pardon…
ARIALD. – Monsieur le Marquis…
Di NOLLI. – Allons, entrez ! Mais qu’ya-t-il enfin ? Que faites-vous ?
FRIDA. – Ah ! mon Dieu ! Je mesauve, je me sauve ! J’ai trop peur !
Elle se dirige vers la porte àgauche.
Di NOLLI, la retenant. – Mais non,Frida !
LANDOLF. – Monsieur le Marquis, c’est cetimbécile…
Il montre Berthold.
BERTHOLD, protestant. – Ah !non, merci ! Je ne continuerai pas à me prêter à cejeu-là ! Je m’en vais ! Je m’en vais !
LANDOLF. – Comment, tu t’en vas ?
ARIALD. – Il a tout gâté, monsieur le Marquis,en se sauvant par ici !
LANDOLF. – Oui, Il est entré enfureur ! Nous ne pouvons plus le retenir dans sachambre ! Il a donné l’ordre qu’on l’arrête et il veut, sansretard, « le juger » dans la salle du trône ! Quefaut-il que nous fassions ?
Di NOLLI. – Mais fermez ! Fermezdonc ! Allez fermer cette porte !
Landolf va fermer la porte.
ARIALD. – Ordulf tout seul ne va pas pouvoirle retenir…
LANDOLF. – Monsieur le Marquis, si l’onpouvait tout de suite lui annoncer votre visite pour détourner lecours de ses idées ?… Ces messieurs et dames ont peut-êtredéjà décidé sous quels habits ils se présenteraient à lui…
Di NOLLI. – Nous avons pensé à tout. (Audocteur.) Docteur, croyez-vous pouvoir le visiter tout desuite ?
FRIDA. – Pas moi, pas moi, Carlo ! Je meretire, et toi aussi, maman, je t’en supplie ! viens avec moi,viens avec moi !…
LE DOCTEUR. – Je… Je veux bien. Mais,dites-moi, il n’est pas armé ?
Di NOLLI. – Il n’est pas armé, docteur, iln’est pas armé ! (À Frida). Voyons, Frida, c’estenfantin ! C’est toi qui as voulu venir…
FRIDA. – Non, je proteste ! C’est mamanqui a voulu venir !
DONNA MATHILDE. – Mais moi, je suis prête à levoir. En somme, que faudra-t-il faire ?
BELCREDI. – Est-ce qu’il est vraimentnécessaire de nous déguiser ?
LANDOLF. – C’est indispensable, indispensable,messieurs ! Il y voit clair, par malheur… (Montrant soncostume.) Et s’il vous apercevait, monsieur, dans vosvêtements d’aujourd’hui !
ARIALD. – Il croirait à un travestissementdiabolique.
Di NOLLI. – Nous lui ferions l’effet d’êtredéguisés, comme ils nous font, eux ! l’effet del’être !
LANDOLF. – Cela ne serait rien, monsieur leMarquis, s’il ne s’imaginait que c’est par ordre de son plus mortelennemi.
BELCREDI. – Le PapeGrégoire VII ?
LANDOLF. – Précisément ! Il le traite depaïen !
BELCREDI. – Le Pape ? Ce n’est pasmal !
LANDOLF. – Oui, monsieur, il dit qu’ilévoquait les morts ! Il l’accuse de toutes sortes dediableries ! Il en a une peur effroyable.
LE DOCTEUR. – C’est le délire de lapersécution.
ARIALD. – Il aurait une crise !…
Di NOLLI, à Belcredi. – Ta présencen’est pas nécessaire… Nous pouvons passer à côté : il suffitque le docteur le voie.
LE DOCTEUR. – Heu… heu !… Je veux bien,mais moi tout seul ?
DI NOLLI, montrant les trois jeunesgens. – Ils seront avec vous.
LE DOCTEUR. – Heu… heu… Si madame la Marquise…peut-être…
DONNA MATHILDE. – Mais oui, je veux y êtreaussi ! Je veux le revoir !
FRIDA. – Mais pourquoi, maman ? Je t’enprie, viens avec nous !
DONNA MATHILDE, impérieuse, –Laisse-moi !… Je suis venue exprès ! (ÀLandolf.) Je serai « Adélaïde », la mère.
LANDOLF. – Ce sera parfait ! La mère del’Impératrice Berthe, parfait ! Il suffira que madame secoiffe de la couronne ducale et revête un manteau qui la couvriratout entière. (À Ariald.) Va, va, Ariald !
ARIALD. – Minute !… (Montrant ledocteur.) Et monsieur ?
LE DOCTEUR. – Ah ! oui… Vous avez parlé,je crois, d’un évêque… l’évêque Hugues de Cluny.
ARIALD. – Monsieur veut parler de l’abbé deCluny ? Ce sera parfait. Hugues de Cluny.
LANDOLF. – Il est déjà venu ici trèssouvent…
LE DOCTEUR, stupéfait. –Comment : venu ici ?
LANDOLF. – Ne craignez rien. Je veux dire quece déguisement n’était pas compliqué…
ARIALD. – On l’a employé plusieurs foisdéjà.
LE DOCTEUR. – Mais…
LANDOLF. – Il n’y a pas de danger qu’il s’ensouvienne. Il fait plus attention au vêtement qu’à la personne.
DONNA MATHILDE. – C’est parfait pour moi,cela.
Di NOLLI. – Allons-nous-en, Frida !laissons-les ! Viens avec nous, Tito !
BELCREDI. – Ah ! mais non !(Montrant la marquise.) Si elle reste, je reste aussi.
DONNA MATHILDE. – Je n’ai pas besoin devous !
BELCREDI. – Je ne dis pas le contraire… Maismoi aussi, j’aurai plaisir à le revoir. N’en ai-je pas ledroit ?
LANDOLF. – Oui, il vaut peut-être mieux quevous soyez trois.
ARIALD. – Alors, monsieur ?
BELCREDI. – Eh bien ! mais trouvez-moi unautre de ces travestis bon marché.
LANDOLF, à Ariald. – Mais oui :en moine de Cluny.
BELCREDI. – En moine de Cluny ? C’estcomment ?
LANDOLF. – Un froc de bénédictin de l’abbayede Cluny. Vous figurerez la suite de Monseigneur. (ÀAriald.) Allons, va ! (À Berthold.) Et toi aussiva-t’en ! et qu’on ne te revoie pas d’aujourd’hui !(Il les rappelle au moment où ils sortent.)Attendez ! (À Berthold.) Toi, apporte ici lesvêtements qu’Ariald va te donner ! (À Ariald.) Ettoi, va tout de suite annoncer la visite de la « duchesseAdélaïde » et de Monseigneur « Hugues de Cluny ».C’est compris ?
Ariald et Berthold sortent par la premièreporte à droite.
Di NOLLI. – Alors, nous vous laissons.
Il sort avec Frida par la porte àgauche.
LE DOCTEUR, à Landolf. – Dites-moi unpeu… Vous croyez vraiment qu’il aura plaisir à voir l’évêque Huguesde Cluny ?
LANDOLF. – Mais certainement ! Soyeztranquille. Monseigneur a toujours été reçu ici avec le plus grandrespect. Et vous aussi, madame la Marquise, vous pouvez êtretranquille. Il n’a jamais oublié que c’est grâce à vous deux qu’ila pu, à moitié mort de froid, après quarante-huit heures d’attentedans la neige, être admis au château de Canossa, en présence deGrégoire VII, qui ne voulait pas le recevoir. Il le dit biensouvent…
BELCREDI. – Et moi, s’il vous plaît ?
LANDOLF. – Vous, vous vous tiendrezrespectueusement à l’écart…
DONNA MATHILDE irritée, avecnervosité. – Vous feriez mieux de vous en aller !
BELCREDI, bas, avec colère. – Vousvoilà bien émue…
DONNA MATHILDE, avec fierté. – Jesuis comme il me plaît… Laissez-moi en paix !
Berthold entre avec lestravestissements.
LANDOLF, le voyant entrer. –Ah ! voici les costumes ! C’est le manteau pour madame laMarquise.
DONNA MATHILDE. – Attendez, j’enlève monchapeau.
Elle enlève son chapeau et le tend àBerthold.
LANDOLF. – Portez-le à côté. (À lamarquise, en faisant le geste de poser la couronne ducalesur sa tête.) Vous permettez ?
DONNA MATHILDE. – Mon Dieu ! Pas lemoindre miroir, ici ?
LANDOLF. – Il y en a un à côté. (Il montrela porte à gauche.) Si madame la Marquise veut passer parlà…
DONNA MATHILDE. – Oui, oui, cela vaudramieux ! Donnez, je reviens tout de suite.
Elle reprend son chapeau et sort, suiviede Berthold qui porte le manteau et la couronne. Pendant ce temps,le docteur et Belcredi revêtent seuls les robes debénédictins.
BELCREDI. – Devenir bénédictin, j’avoue que jene m’y attendais pas !… Cette folie me semble assezcoûteuse…
LE DOCTEUR. – Ce n’est pas la seule…
BELCREDI. – Il faut une fortune pour s’enpayer de semblables…
LANDOLF. – Nous avons ici une garde-robecomplète. Rien que des costumes de l’époque, exécutés à laperfection sur des modèles anciens. C’est moi qui en ai la charge.Je m’adresse à des tailleurs de théâtre spécialisés. Cela coûtegros.
Donna Mathilde rentre, revêtue du manteauet la couronne sur la tête.
BELCREDI, avec admiration. – Vousêtes magnifique ! Vraiment royale !
DONNA MATHILDE, regardant Belcredi etéclatant de rire. – Oh ! mon Dieu ! Non, sortezd’ici ! Vous êtes impossible ! Vous semblez une autruchehabillée en moine !
BELCREDI. – Et regardez le docteur !
LE DOCTEUR. – Évidemment… évidemment…
DONNA MATHILDE. – Mais non, le docteur estbeaucoup mieux… C’est vous, qui êtes à mourir de rire !
LE DOCTEUR, à Landolf. – Vous recevezdonc beaucoup dans cette maison ?
LANDOLF. – C’est selon. Parfois, il demandequ’on lui présente tel ou tel personnage, et alors il faut chercherdes gens qui se prêtent à la comédie. Il réclame même desfemmes…
DONNA MATHILDE, blessée et voulant lecacher. – Ah ! vraiment ! des femmesaussi ?
LANDOLF. – Autrefois surtout, oui, il enréclamait souvent.
BELCREDI, riant. – Ah ! Elle estbien bonne… En costume ? (Montrant la marquise.)Comme ça ?
LANDOLF. – Vous savez, on lui amenait desfemmes… de ces femmes qui…
BELCREDI. – Oui, des femmes faciles ! Jecomprends ! (Perfidement, à la marquise.) Prenezgarde, la chose peut devenir dangereuse pour vous !
La seconde porte à droite s’ouvre etAriald paraît. Il fait d’abord un signe pour obtenir le silence,puis il annonce solennellement :
ARIALD. – Sa Majesté l’Empereur !
Entrent les deux hommes d’armes, qui vontse poster au pied du trône ; puis, encadré par Ordulf et parAriald qui se tiennent respectueusement un peu en arrière,Henri IV. Il approche de la cinquantaine. Très pâle, déjàgrisonnant sur la nuque. Sur les tempes et, sur le haut de la tête,ses cheveux sont teints en blond, d’une façon puérile, trèsapparente. Son visage est d’une pâleur tragique, avec deux tachesde rouge sur les pommettes, pareilles à des joues de poupées. Cemaquillage est également très apparent. Henri IV revêt,par-dessus ses habits royaux, le sayon de poil de chèvre despénitents, comme à Canossa. Il a dans les yeux une fixité anxieusequi épouvante, en contraste avec son attitude qui s’efforced’exprimer l’humilité et le repentir, attitude qu’il accentued’autant plus qu’il éprouve l’injustice de son abaissement. Ordulfporte à deux mains la couronne royale, Ariald le sceptre avecl’Aigle et le globe surmonté de la croix.
HENRI IV, s’inclinant d’abord devantdonna Mathilde, puis devant le docteur. – Madame… Monseigneur…(Il regarde Belcredi et ébauche un salut, mais il l’interromptet, se tournant vers Landolf qui s’est approché, il lui demande àvoix basse, avec défiance :) C’est PierreDamien ?
LANDOLF. – Non, Majesté. C’est un moine deCluny, qui accompagne l’abbé.
HENRI IV (il recommence à considérerBelcredi avec une défiance croissante et, remarquant que celui-cise tourne avec embarras vers donna Mathilde et vers le docteur,comme pour les consulter du regard, il se redresse etcrie) : C’est Pierre Damien ! – Inutile, mon Père,de regarder la Duchesse ! (Se tournant vers donna Mathildecomme pour conjurer un danger.) Je vous jure, madame, je vousjure que mon âme est changée envers votre fille ! J’avoue ques’il (il montre Belcredi) n’était pas venu me l’interdireau nom du Pape Alexandre, je l’aurais répudiée ! Oui, il yavait quelqu’un qui favorisait cette répudiation : c’étaitl’évêque de Mayence, en échange de cent vingt domaines.(Regardant d’un air égaré Landolf.) Mais il ne faut pas,en ce moment, que je dise du mal des évêques. (Il s’approcheavec humilité de Belcredi.) Je vous suis reconnaissant,croyez-le je vous suis reconnaissant, aujourd’hui, Pierre Damien,de cette interdiction ! – Toute ma vie est un tissud’humiliations : – ma mère, Adalbert, Tribur, Goslar – etmaintenant ce sayon de poil de chèvre que vous me voyez là, sur ledos. (Changeant de ton brusquement, comme quelqu’un qui repasseson rôle, dans une parenthèse de ruse.) N’importe ! De laclarté dans les idées, de la perspicacité, une attitude ferme et dela patience quand la fortune est adverse ! (Se tournantvers les visiteurs avec une gravité convaincue.) Je saiscorriger les erreurs commises, et devant vous aussi, Pierre Damien,je m’humilie ! (Il s’incline profondément et reste courbédevant Belcredi, comme pris d’un soupçon oblique, qui grandit enlui et lui fait ajouter comme malgré lui, sur un tonmenaçant.) À condition, toutefois, que vous n’ayez pas répandule bruit infâme qu’Agnès, ma sainte mère, avait des rapportsinavouables avec l’évêque Henri d’Augsbourg.
BELCREDI (comme Henri IV reste encorecourbé en un geste de menace contre lui, porte ses mains à sapoitrine et nie.) Eh non ! ce n’est pas moi…
HENRI IV, se redressant. – Non,n’est-ce pas ? Quelle infamie ! (Il le dévisage unmoment et reprend.) Je ne vous en crois pas capable.(S’approchant du docteur et lui tirant un peu lamanche, avec un clin d’œil de ruse.) Ce sont« eux » ! Toujours les mêmes !Monseigneur !
ARIALD, bas, avec un soupir, comme poursuggérer une réponse au docteur. – Eh, oui, les évêquesravisseurs.
LE DOCTEUR, pour jouer son rôle, setournant vers Ariald. – Eh oui, ce sont eux…, toujours lesmêmes…
HENRI IV. – Rien ne leur a suffi ! –Un pauvre enfant, Monseigneur… Que fait-il ? Il passe sontemps à jouer – même quand (sans le savoir) il est roi. J’avais sixans, et ils me ravirent à ma mère, et ils se servirent de moi, quine savais rien, contre elle et contre la dynastie elle-même,profanant tout, et volant, volant, plus gloutons l’un quel’autre : Annon plus qu’Étienne, Étienne plusqu’Annon !
LANDOLF, à voix basse, persuasif, pour lerappeler à l’ordre. – Majesté…
HENRI IV, se tournant aussitôt.– Ah ! oui ! il ne faut pas, en ce moment, que je dise dumal des évêques… Mais cette infamie sur ma mère, Monseigneur, passeles bornes ! (Il regarde la marquise et s’attendrit.)Et je ne puis même pas la pleurer, madame… Je me tourne vers vous,qui devez avoir des entrailles de mère. Elle m’a rendu visite, il ya un mois environ. Elle venait de son couvent. On m’a dit qu’elleétait morte… (Une longue pause, lourde d’émotion. Il souritavec une grande tristesse.) Et je ne puis pas la pleurer…Puisque vous vous trouvez ici, et que je revêts ce sayon (ilmontre le sayon qu’il a sur le dos) cela veut dire que je n’aique vingt-six ans…
ARIALD. – Et que, par conséquent, votre mèreest encore vivante, Majesté…
ORDULF. – Toujours dans son couvent…
HENRI IV, se tournant pour lesregarder. – Oui… Je puis ajourner ma douleur à plus tard.(Montrant à la marquise, avec coquetterie, la teinture dont ila blondi ses cheveux.) Regardez : je suis encore blond…(Puis, plus bas, comme en confidence.) C’est pourvous ! – Moi, je n’en aurais pas besoin, mais les signesextérieurs ne sont pas inutiles ; ils jalonnent le temps. Vouscomprenez, Monseigneur ? (S’approchant de la marquise etregardant ses cheveux.) Mais je m’aperçois que vous aussi,Duchesse… (Il cligne de l’œil et fait de la main unsigne expressif.) Eh, vous êtes Italienne… (Comme pourdire : « hypocrite », mais sans ombre deressentiment ; au contraire avec une admirationmalicieuse.) Dieu me préserve d’en témoigner émerveillement oudégoût. – Velléités !… Nul ne veut admettre le pouvoir obscuret fatal qui limite notre volonté. Et pourtant, puisqu’on naît,puisqu’on meurt !… Naître, Monseigneur, est-ce que vous avezdemandé à naître ? Moi, non. Et entre ces deux hasards –naître et mourir – indépendants tous deux de notre volonté, combiend’autres choses encore que nous n’aurions pas voulues et auxquellesnous nous résignons à contre-cœur !
LE DOCTEUR, pour dire quelque chose, touten l’étudiant attentivement. – Eh oui,malheureusement !
HENRI IV. – Quand nous refusons de nousrésigner, les velléités apparaissent. Une femme qui veut être unhomme… un vieillard qui veut être jeune… Velléités, velléités,chimères ridicules, c’est certain. Mais réfléchissez, Monseigneur,toutes nos autres velléités ne sont pas moins ridicules, même quandelles ne débordent pas les limites du possible humain. Nul mensongepourtant, nulle fiction de notre part. Nous sommes, de bonne foi,immobilisés dans une noble idée de nous-mêmes. Vous, par exemple,Monseigneur, vous êtes là, vous ne bougez plus, vous vous agrippezà deux mains à votre saint vêtement, et vous ne prenez pas gardequ’il glisse de vos manches, qu’il coule de vos manches quelquechose, comme un serpent : c’est la vie ! Ah ! quellesurprise, quand, soudain, vous apercevez là, dressée devant vous,cette vie qui s’est échappée de vous-même. Quelle colère, quellerage contre vous-même ! Ou bien quels remords, oui, quelsremords !… Ah ! si vous saviez, j’ai trouvé devant moitant de remords !… Avec un visage qui était le mien, mais siaffreux que je ne pouvais le regarder en face… (Il s’approchede la marquise.) Cela ne vous est-il jamais arrivé,Madame ? Vous rappelez-vous vraiment avoir toujours été lamême ? Un jour, pourtant, Dieu… comment avez-vous pu fairecela… (Il la fixe d’une façon si aiguë qu’elle est près des’évanouir.) Oui, « cela », vous savez quoi… nousnous comprenons, oh ! soyez tranquille, je ne le dirai àpersonne ! Et vous, Pierre Damien, vous, l’ami de cethomme…
LANDOLF, bas. – Majesté…
HENRI IV, vite. – Non, non, jene prononcerai pas son nom ! Je sais qu’il le supportemal ! (Se tournant vers Belcredi, comme en aparté.)Quelle opinion ? quelle opinion aviez-vous de lui ?… Iln’en est pas moins vrai que nous nous obstinons tous dans l’idéeque nous nous faisons de nous-mêmes, tout comme, en vieillissant,nous teignons nos cheveux. Peu importe que la teinture de mescheveux ne puisse pas être pour vous une réalité, si du moins, pourmoi, elle est un tout petit peu réelle. – Vous, madame, vous neteignez certainement pas vos cheveux pour tromper les autres, nivous-même, mais simplement pour tromper un peu, un tout petit peu,votre image au miroir. Moi, je me teins pour rire. Vous, vous vousteignez pour de bon, mais vous avez beau le faire sérieusement,vous n’en êtes pas moins masquée, vous aussi, madame. Oh ! jene parle pas de la vénérable couronne qui ceint votre front… Jem’incline devant elle. Je ne parle pas de votre manteauducal ; je parle uniquement du souvenir de vos cheveux blondsque vous avez voulu fixer sur vous artificiellement, parce que vousvous complaisiez autrefois à être blonde… ou bien du souvenir devos cheveux bruns, si vous étiez brune. Ce souvenir, vous le fixezsur vous comme un masque pour retenir l’image de votre jeunesse quia fui. Pour vous, Pierre Damien, c’est le contraire : lesouvenir de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, renaîtaujourd’hui avec la figure des réalités passées, et vous avezl’impression, n’est-il pas vrai ? d’un cauchemar. Et pour moiaussi, c’est comme un rêve : tant de réalités inexplicables… àbien y repenser… Bah ! il n’y a rien là d’étonnant, PierreDamien ; demain, il en sera ainsi de notre vied’aujourd’hui ! (Se mettant soudain en colère et crispantses mains sur son sayon.) Ce sayon ! (Avec une joiepresque féroce, faisant le geste de l’arracher, tandis qu’Ariald,Landolf, Ordulf se précipitent, épouvantés, comme pour l’enempêcher.) Ah ! Dieu du ciel ! (Il recule et,enlevant son sayon, il leur crie.) Demain, à Bressanone,vingt-sept évêques allemands et lombards signeront avec moi ladestitution du pape Grégoire VII, qui n’est pas le SouverainPontife, mais qui n’est qu’un faux moine !
ORDULF et ses trois compagnons leconjurant de se taire. – Majesté, Majesté, au nom duSeigneur !
ARIALD, l’invitant par gestes à endosserde nouveau le sayon. – Prenez garde à ce que vousdites !
LANDOLF. – Monseigneur est ici avec laDuchesse pour intercéder en votre faveur !
Il fait des signes pressants au docteurpour l’inviter à dire sans tarder quelque chose.
LE DOCTEUR, égaré. – Effectivement,oui, nous sommes ici pour intercéder…
HENRI IV, pris d’un repentir subit,presque épouvanté, se laissant remettre par ses trois vassaux lesayon sur les épaules et le serrant contre lui de ses mainsconvulsées. – Pardon… Oh, oui… pardon, pardon,Monseigneur ; pardon, madame… Je sens, je vous le jure, jesens tout le poids de l’anathème ! (Il se courbe, plongesa tête dans ses mains, comme dans l’attente de quelque chose quiva l’écraser. Il reste un instant ainsi, puis, d’une voix toutedifférente, sans bouger, il dit tout bas en confidence à Landolf, àAriald et à Ordulf.) Je ne sais pourquoi, aujourd’hui, je neréussis pas à me montrer humble devant celui-là !
Il indique Belcredi.
LANDOLF, à voix basse. – Maispourquoi, Majesté, vous obstinez-vous à croire que c’est PierreDamien ? Ce n’est pas lui.
HENRI IV, regardant en dessous aveccrainte. – Ce n’est pas Pierre Damien ?
ARIALD. – Mais non, ce n’est qu’un pauvrepetit moine, Majesté !
HENRI IV, avec une exaspérationcontenue et douloureuse. – Personne ne peut mesurer la portéede ses actes, quand il agit par instinct… Vous, madame, vous pouvezpeut-être me comprendre mieux que les autres… Vous êtes femme etduchesse. Nous sommes à une heure solennelle et décisive. Jepourrais, sachez-le, en ce moment même où je vous parle, accepterl’appui des évêques lombards et m’emparer du Pontife enl’assiégeant ici, dans son château, courir à Rome, élire unantipape, tendre la main à l’alliance de Robert Guiscard. –Grégoire VII serait perdu ! Je résiste à cette tentationet, croyez-le, je suis sage. Je comprends mon époque et la majestéde cet homme qui sait être ce qu’il doit : un pape digne de cenom. Si vous riez de moi en me voyant ainsi humilié, vous êtesstupides, vous ne comprenez pas que la sagesse politique meconseille de revêtir aujourd’hui cet habit de pénitent. Je vous disque les rôles, demain, pourraient être intervertis ! Et queferiez-vous alors ? Ririez-vous, par hasard, d’un papeprisonnier ? – Non. – Nous serions quittes. – Je suis déguiséaujourd’hui en pénitent ; lui le serait demain en prisonnier.Mais malheur à qui ne sait pas porter son masque, que ce soit lemasque d’un roi ou celui d’un pape. – Peut-être est-il, en cemoment, un peu trop cruel : oui, sans doute. Pensez, madame,que Berthe, votre fille, envers qui, je vous le répète, mon âme estchangée (il se tourne brusquement vers Belcredi et lui crie auvisage, comme si Belcredi avait nié) changée, changée, à causede l’affection, du dévouement dont elle a su me donner les preuvesdans ce terrible moment ! (Il se tourne vers lamarquise.) Elle m’a accompagné à Canossa, madame ; elleest en bas, dans la cour ; elle a voulu me suivre, comme unemendiante ; elle est demi-morte de froid, après ces deux nuitspassées dehors, sous la neige ! Vous êtes sa mère ! Vosentrailles devraient tressaillir de pitié, et vous devriez vousunir à lui (il montre le docteur) pour implorer duSouverain Pontife notre pardon : qu’il nous reçoive !
DONNA MATHILDE, tremblante, avec un filetde voix. – Mais oui, oui, tout de suite…
LE DOCTEUR. – C’est ce que nous allonsfaire !
HENRI IV. – Autre chose encore !Autre chose ! (Il les fait approcher de lui et leur dittout bas, en grand secret.) Il ne suffit pas qu’il me reçoive.Vous savez qu’il peut tout. Je dis « tout ». Il peut mêmeévoquer les morts ! (Il se frappe la poitrine.) Mevoici ! Vous me voyez ! Aucun secret de sorcellerie nelui est inconnu. Eh bien, Monseigneur, madame, voilà ma vraiecondamnation. Regardez ! (Il montre son portrait pendu aumur, presque avec effroi.) Ne plus pouvoir me délivrer de cetensorcellement ! Me voici pénitent, et je le resterai !Je vous jure que tel je resterai tant qu’il ne m’aura pas reçu.Mais vous devriez, tous les deux, quand il aura levé monexcommunication, implorer autre chose du Pape : qu’il medétache de là. (Il montre de nouveau son portrait.) Qu’ilme laisse vivre ma pauvre vie, toute ma vie, dont j’ai été exclu…On ne peut pas toujours avoir vingt-six ans, madame ! Et jevous le demande aussi pour votre fille : pour que je puissel’aimer comme elle le mérite. (Vous avez vu les bonnes dispositionsoù je me trouve, attendri comme je le suis maintenant par sapitié.) Voilà, c’est cela qu’il faut lui demander. Mon sort estentre vos mains… (Il salue.) Madame !Monseigneur !
Et il se retire, en saluant, repasse laporte par où il est entré, les laissant tous dans la stupeur. Pourla marquise, elle est si profondément émue qu’à peine Henri IVdisparu, elle se laisse aller sur un siège, presqueévanouie.
Rideau.
ACTE DEUXIÈME
Une autre pièce de la villa, contiguë à lasalle du trône. Austère mobilier antique. Au fond, la porte duvestibule. À gauche, deux fenêtres qui donnent sur le jardin ;à droite une porte qui conduit à la salle du trône. Tard dansl’après-midi, le même jour.
Donna Mathilde, le docteur et TitoBelcredi sont en scène. Ils sont en train de causer, mais DonnaMathilde reste à l’écart, sombre, visiblement excédée par ce quedisent les deux interlocuteurs. Pourtant, elle ne peut s’empêcherde prêter l’oreille à leurs propos. Dans l’état d’agitation où ellese trouve, tout l’intéresse malgré elle, en l’empêchant de sereplier sur elle-même pour mûrir le projet plus fort qu’elle, quila tente. Les paroles des deux autres attirent son attention, carelle sent instinctivement le besoin d’être retenue à ce momentprécis.
BELCREDI. – Vous avez sans doute raison, moncher docteur, mais je vous ai fait part de mon impression.
LE DOCTEUR. – Je ne la conteste pas, mais jecrois que ce n’est qu’une simple impression…
BELCREDI. – Comment… Mais enfin, il a tout demême été jusqu’à dire la chose clairement ! (Se tournantvers la marquise.) N’est-ce pas, marquise ?
DONNA MATHILDE, se retournant. –Qu’est-ce qu’il a dit ? (Se refusant à approuverBelcredi.) Ah, oui… Mais ce n’est pas du tout pour la raisonque vous croyez.
LE DOCTEUR. – Il voulait parler des habits quenous endossions (il montre la marquise), du manteau demadame, de nos frocs de bénédictins. Tout cela était puéril.
DONNA MATHILDE, brusquement, se tournantavec colère. – Puéril ? Que dites-vous ?docteur ?
LE DOCTEUR. – Puéril, oui, dans un sens… Oui…Permettez, Marquise, que je vous explique… Puéril dans un sens,mais d’autre part beaucoup plus compliqué que vous ne pouvezl’imaginez.
DONNA MATHILDE. – Pour moi, c’est au contrairetout ce qu’il y a de plus clair.
LE DOCTEUR, avec le sourire de pitié del’homme compétent pour les profanes. – Eh ! oui !…Il faut connaître cette psychologie spéciale des fous qui fait –prenez-y garde – qu’un fou peut, sans aucun doute possible,s’apercevoir d’un déguisement, se rendre parfaitement compte quec’est un déguisement et pourtant, messieurs, y croire sans réserve,tout à fait comme les enfants pour qui un déguisement est à la foisun jeu et une réalité. Voilà pourquoi j’ai parlé de puérilité. Maisce qu’il y a d’autre part d’extrêmement compliqué, c’est qu’il aconscience, qu’il doit avoir parfaitement conscience d’être pourlui-même, devant lui-même, une image, cette image-là !
Il fait allusion au portrait de la salledu trône et fait signe vers sa gauche.
BELCREDI. – Il l’a dit !
LE DOCTEUR. – Parfaitement ! – Il est uneimage devant laquelle se sont présentées d’autres images : lesnôtres ; comprenez-vous ? Dans son délire, – délire aiguet extrêmement lucide, – il a pu remarquer tout de suite unedifférence entre son image et les nôtres. Il a pu remarquer qu’il yavait en nous, dans nos images, une simulation, et cela l’a mis endéfiance. La défiance des fous est sans cesse en éveil… Mais c’estlà tout. Notre jeu répondant au sien n’a pu lui sembler inspiré parla pitié, et son jeu nous a paru à nous d’autant plus tragique que,comme pour nous braver – comprenez-vous ? – poussé par sadéfiance, il a précisément voulu le dénoncer, comme un jeu ;mais oui, il a voulu nous faire croire qu’il jouait en seprésentant à nous avec un peu de teinture sur les cheveux et demaquillage sur les joues, et en nous disant qu’il se teignait,qu’il se fardait exprès, pour rire !
DONNA MATHILDE, éclatant. – Non, cen’est pas cela, docteur ! Ce n’est pas cela !
LE DOCTEUR. – Comment, pas cela ?
DONNA MATHILDE, prompte, avecénergie. – Je suis parfaitement sûre qu’il m’areconnue !
LE DOCTEUR. – Impossible… C’estimpossible…
BELCREDI, en même temps. – Allonsdonc !
DONNA MATHILDE, avec plus d’énergieencore, hors d’elle-même. – Il m’a reconnue, vousdis-je ! Quand il s’est approché de moi pour me parler, detout près, il m’a regardée dans les yeux, oui, il a plongé sonregard dans le mien, et il m’a reconnue !
BELCREDI. – Il parlait de votre fille…
DONNA MATHILDE. – Ce n’est pas vrai ! Ilparlait de moi ! de moi !
BELCREDI. – Oui, peut-être quand il aparlé…
DONNA MATHILDE, sans aucune pudeur. –De mes cheveux teints ! Vous n’avez pas remarqué qu’il aajouté tout de suite : « Ou bien le souvenir de voscheveux bruns, si vous étiez brune. » Il s’est rappeléparfaitement qu’à cette époque-là j’étais brune.
BELCREDI. – Allons donc ! Allonsdonc !
DONNA MATHILDE, sans l’écouter, setournant vers le docteur. – Mes cheveux, docteur, sontnaturellement bruns, comme ceux de ma fille, et voilà pourquoi ils’est mis à parler d’elle !
BELCREDI. – Mais il ne la connaît pas, votrefille ! Il ne l’a jamais vue !
DONNA MATHILDE. – Précisément ! Vous necomprenez rien ! Ma fille, pour lui, c’est moi, moi telle quej’étais à cette époque !
BELCREDI. – Oh ! mais son mal estcontagieux, vous êtes atteinte !
DONNA MATHILDE, bas, avec mépris. –Imbécile !
BELCREDI. – Permettez : avez-vous jamaisété sa femme ? Votre fille, dans son délire, est safemme : Berthe de Suse.
DONNA MATHILDE, – Mais parfaitement ! Jeme suis présentée à lui, non plus brune – comme il m’avait gardéedans son souvenir, – mais blonde, en disant que j’étais Adélaïde,la mère. Ma fille n’existe pas pour lui, il ne l’a jamais vue, vousl’avez dit vous-même. Comment pourrait-il donc savoir si elle estblonde ou brune ?
BELCREDI. – Il a parlé d’une femme brune engénéral, mon Dieu ! d’une femme quelconque – brune ou blonde –qui cherche à retenir le souvenir de sa jeunesse dans la couleur deses cheveux ! Et voilà qu’à votre habitude, vous vous mettez àimaginer je ne sais quoi ! Docteur, elle dit que je n’auraispas dû la suivre. C’est elle qui aurait mieux fait des’abstenir !
DONNA MATHILDE, un moment abattue par laremarque de Belcredi, réfléchit, puis se reprenant, mais avecquelque irritation, parce qu’elle est dans le doute. – Non…non… Il parlait de moi… Il a constamment parlé avec moi et demoi…
BELCREDI. – Ah ! çà, par exemple !Il ne m’a pas laissé souffler une minute, et vous prétendez qu’iln’a parlé que de vous ? C’était encore de vous qu’il parlaitquand il s’adressait à Pierre Damien !
DONNA MATHILDE, avec défi, bannissanttoute retenue. – Et pourquoi pas ? – Sauriez-vous me direpourquoi, dès le premier instant, il a senti de l’aversion pourvous et rien que pour vous ?
La demande sera faite sur un tel ton quela réponse explicite devrait être : « Parcequ’il a compris que vous êtes mon amant ! » –Belcredi le comprend si bien qu’il reste interdit, sansrépondre.
LE DOCTEUR. – Je vous demande pardon, mais laraison pourrait bien être dans ce fait qu’on lui avait annoncé lavisite de la duchesse Adélaïde et de l’abbé de Cluny. En voyant unetierce personne, qu’on ne lui avait pas annoncée, sa méfiance s’esttout de suite…
BELCREDI. – Parfaitement ! C’est saméfiance qui lui a fait voir en moi un ennemi : PierreDamien ! – Mais elle s’est mis dans la tête qu’il l’areconnue…
DONNA MATHILDE. – Il n’y a pas de doute… Sesyeux me l’ont dit, docteur… Il y a des regards qui ne trompentpas !… Ce ne fut peut-être que l’espace d’une seconde !Que voulez-vous que je vous dise ?
LE DOCTEUR. – C’est… c’est bienpossible : un éclair de lucidité…
DONNA MATHILDE. – Peut-être… Et alors, sesparoles m’ont paru pleines du regret de ma jeunesse et de lasienne, lui qui, depuis cet horrible accident, vit enfermé sous cemasque qu’il n’a jamais pu quitter, et qu’il veut quitteraujourd’hui, – il l’a dit expressément !
BELCREDI. – Oui ! Pour pouvoir aimervotre fille. Ou vous-même – comme vous vous l’imaginez, – parce quevotre pitié l’a attendri.
DONNA MATHILDE. – Ma pitié pour lui estinfinie…
BELCREDI. – Cela se voit, Marquise ! Elleest si grande qu’un thaumaturge en attendrait sans nul doute unmiracle.
LE DOCTEUR. – Permettez… Je ne fais pas demiracles ; je suis un médecin, et non un thaumaturge. J’aiprêté la plus grande attention à tout ce qu’il a dit, et je vousrépète que l’élasticité analogique, qui est la marque de toutdélire spécifique, me paraît chez lui très… comment dire ?très relâchée. Je m’explique : les éléments de son délire neforment plus un tout solide. J’ai l’impression qu’il a de la peineà se maintenir dans le personnage qu’il a revêtu, et cela à causede brusques appels qui l’arrachent – symptôme très réconfortant –qui l’arrachent, non pas à un état d’apathie naissante, mais à unétat d’acceptation et d’accommodation pour le plonger dans un étatde réflexion mélancolique… qui témoigne vraiment d’une activitécérébrale considérable. Je le répète, c’est un symptôme trèsréconfortant. Eh bien, si grâce au moyen violent que nous avonspréparé…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lafenêtre, du ton d’un malade qui geint. – Mais comment cetteautomobile n’est-elle pas encore de retour ? Il y a plus detrois heures et demie…
LE DOCTEUR. – Vous dites ?
DONNA MATHILDE. – Cette automobile, docteur…Il y a plus de trois heures et demie qu’elle est partie !
LE DOCTEUR, tirant sa montre de sa pocheet la consultant – Il y a même plus de quatreheures !
DONNA MATHILDE. – Ils pourraient être icidepuis une demi-heure au moins !… mais c’est commetoujours…
BELCREDI. – Ils n’ont peut-être pas retrouvéla robe…
DONNA MATHILDE. – C’est impossible… Je leur aiindiqué, avec toutes les précisions nécessaires, où était enferméecette robe ! (Elle est très impatiente.) Mais, Frida…Où est Frida ?…
BELCREDI, se penchant à la fenêtre. –Peut-être au jardin, avec Carlo.
LE DOCTEUR. – Il doit la persuader de dominersa peur…
BELCREDI. – Mais elle n’a pas peur,docteur ; ne croyez pas cela ! Elle s’ennuie…
DONNA MATHILDE. – Faites-moi le plaisir de nepas la supplier ! Je sais comment elle est faite !
LE DOCTEUR. – Attendons patiemment. Nous n’enavons plus pour longtemps, et il faut que la chose ait lieu denuit… Il suffira d’un moment. Si nous parvenons à l’ébranler, àrompre d’un coup, par ce choc violent, le fil déjà usé qui lerattache encore à sa folie, en lui rendant ce qu’il demandelui-même (vous l’avez entendu : « On ne peut pas toujoursavoir vingt-six ans, Madame ! »), oui, en le libérant decet emprisonnement auquel il se sent condamné : en somme, sinous obtenons qu’il retrouve d’un coup la conscience de ladurée…
BELCREDI. – Il sera guéri !(Ironiquement, une syllabe après l’autre.) Nous allonsl’arracher à son image !
LE DOCTEUR. – Nous pouvons tout au moinsespérer le remettre en marche, comme une montre qui s’est arrêtée àune certaine heure. Nous serons là, avec nos montres à la main, etnous attendrons que l’heure fatale sonne de nouveau. Nous donneronsun bon coup, comme cela, et espérons qu’il se remettra à marquerles heures de sa vie, après ce long arrêt.
À ce moment, le marquis Carlo di Nollientre par le fond.
DONNA MATHILDE. – Ah ! Carlo… EtFrida ? Où est-elle passée ?
Di NOLLI. – Elle vient tout de suite.
LE DOCTEUR. – L’automobile estarrivée ?
Di NOLLI. – Mais oui.
DONNA MATHILDE. – Ah oui ? Et ils ontapporté la robe ?
Di NOLLI. – La robe est là depuis un grandmoment.
LE DOCTEUR. – Alors, c’est parfait !
DONNA MATHILDE, frémissante. – Oùest-elle ? Où est-elle ?
Di NOLLI, haussant les épaules et sourianttristement, comme quelqu’un qui joue mal volontiers un rôle dansune farce hors de saison. – Mais vous allez la voir… (Ilmontre l’entrée.) La voici…
Berthold se présente sur le seuil de laporte du fond, et annonce solennellement :
BERTHOLD. – Son Altesse la marquise Mathildede Canossa !
Frida entre magnifiquement belle. Ellea revêtu le vieux déguisement de sa mère, et elle prêtevie à l’image peinte dans la salle du trône.
FRIDA, s’approchant de Berthold, quis’incline, avec une hauteur méprisante. – De Toscane, deToscane, je vous prie ! Canossa est un de mes châteaux.
BELCREDI, avec admiration. – Maisregardez donc ! Ce n’est plus elle !
DONNA MATHILDE. – Ce n’est plus elle !…C’est moi… Vous voyez… Oh ! mon Dieu !… Arrête,Frida !… Vous la voyez ! C’est mon portrait…vivant !
LE DOCTEUR. – Oui, oui… C’est parfait !Parfait ! C’est le portrait même !
BELCREDI. – Il n’y a pas à dire… C’estvraiment le portrait ! Ah, quel type !
FRIDA. – Ne me faites pas rire !J’éclate, vous savez !… Quelle taille mince tu avais,maman ! J’ai failli étouffer en m’agrafant !
DONNA MATHILDE, à bout de nerfs,arrangeant les plis de la robe. – Viens un peu… Ne bouge plus…Ces plis… Tu es vraiment si serrée ?
FRIDA. – J’étouffe ! Dépêchons, je vousen prie…
LE DOCTEUR. – Mais il faut attendre lanuit…
FRIDA. – Je n’y tiens déjà plus… Je nerésisterai jamais jusqu’à ce soir !
DONNA MATHILDE. – Mais pourquoi t’es-tuhabillée si tôt ?
FRIDA. – Eh ! quand j’ai vu cetterobe ! La tentation ! Irrésistible…
DONNA MATHILDE. – Tu aurais au moins pum’appeler ! Je t’aurais aidée… Ce bliaud est tout froissé, monDieu !…
FRIDA. – Je l’ai bien vu, maman. Mais ce sontdes plis si invétérés… Il ne serait pas possible de les fairedisparaître…
LE DOCTEUR. – Peu importe, Marquise !L’illusion est parfaite. (S’approchant et invitant la marquiseà se placer devant sa fille, sans toutefois la cacher.) Vouspermettez ? Vous vous placerez comme cela… oui, a une certainedistance… un peu plus en avant…
BELCREDI. – Pour bien donner la conscience dela durée…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lui, dubout des lèvres. – Vingt ans passés ! Un vrai désastre,hein ?
BELCREDI. – N’exagérons rien !
LE DOCTEUR, très embarrassé, pour rompreles chiens. – Non, non ! Ce que j’en disais, c’était pourl’habit… c’était pour voir…
BELCREDI, riant. – Mais entre cesdeux robes, Docteur, ce n’est pas vingt ans, c’est huit cents ansqu’il y a ! Un véritable abîme ! Vous voulez vraiment luifaire sauter huit cents ans d’un coup ? (Montrant d’abordFrida, puis la marquise.) Pensez-y bien, messieurs ; jeparle sérieusement : pour nous, il s’agit de vingt ans, dedeux robes et d’une mascarade. Mais si vraiment, comme vous ledisiez, Docteur, le temps s’est arrêté pour lui, en lui et autourde lui, s’il vit (montrant Frida) avec elle, il y a huitsiècles, le vertige du saut que vous allez lui imposer sera tel quequand il retombera au milieu de nous… (Le docteur du doigt faitsigne que non.) Vous dites que non ?
LE DOCTEUR. – Pas du tout. La vie, mon cherBaron, se réajuste ! Dans le cas présent, notre vie reprendraaussitôt sa réalité, pour lui comme pour nous, et elle lui rendraaussitôt l’équilibre, en lui arrachant d’un coup son illusion et enlui découvrant que ces huit cents années furent à peinevingt ! Il en sera comme de certains trucs, comme, parexemple, du saut dans le vide des initiations maçonniques ;cela semble un monde et, au bout du compte on a descendu une marched’escalier.
BELCREDI. – Oh ! quelle découverte !Mais parfaitement ! – Regardez Frida et la marquise,docteur ! – Qui est le plus en avance ? – C’est nous,docteur, nous les vieux ! Nos cadets se croient en avance surnous, ils se trompent : nous sommes plus avancés qu’eux,puisque le temps est plus à nous qu’à eux.
LE DOCTEUR. – Oui, si le passé ne nouséloignait pas !
BELCREDI. – Mais pas du tout ! Nouséloigner de quoi ? (Il montre Frida et di Nolli.) Euxont encore à faire ce que nous avons déjà fait, docteur : ilsont à vieillir, en refaisant à peu près les mêmes sottises quenous… L’illusion, c’est de croire qu’on quitte la vie par une portequi se trouve en avant de nous ! C’est faux ! Dès notrenaissance, nous commençons à mourir ; celui qui a commencé lepremier à vivre est le plus jeune de tous. Le plus jeune des hommesc’est le père Adam ! Regardez (il montreFrida) : La marquise Mathilde de Toscane est de huitsiècles plus jeune que nous tous.
Il s’incline profondément devantelle.
Di NOLLI. – Je t’en prie, je t’en prie,Tito : ne plaisantons pas.
BELCREDI. – Où as-tu vu que jeplaisantais…
Di NOLLI. – Mais oui, depuis que nous sommesarrivés…
BELCREDI. – Comment ! J’ai été jusqu’àm’habiller en bénédictin. »
Di NOLLI. – En fait de chose sérieuse…
BELCREDI. – Si la chose a été sérieuse pourles autres comme en ce moment, par exemple, pour Frida, pourquoi nel’aurait-elle pas été pour moi ?… (Se tournant vers ledocteur.) Je vous jure, docteur, que je ne comprends pasencore ce que vous voulez faire.
LE DOCTEUR, ennuyé. – Mais vous leverrez bien ! Je ne vous demande qu’un peu de crédit… Lamarquise n’est pas encore habillée comme elle doit l’être…
BELCREDI. – Ah ! elle doit aussi sedéguiser…
LE DOCTEUR. – Mais naturellement ! Elleva mettre une robe pareille à celle-ci, qui se trouve dans lagarde-robe du château, pour les jours où il souhaite la présence dela marquise Mathilde de Canossa…
FRIDA, qui cause bas avec di Molli,s’apercevant de l’erreur du docteur. – De Toscane ! DeToscane !
LE DOCTEUR. – C’est la même chose !
BELCREDI. – Ah ! je comprends ! Ilva se trouver en présence de deux Mathildes ?…
LE DOCTEUR. – Précisément. De deux, etalors…
FRIDA, l’appelant à l’écart. – Venezm’expliquer, Docteur.
LE DOCTEUR. – Je suis à vous !
Il s’approche des deux jeunes gens et leurdonne des explications.
BELCREDI, bas, à donna Mathilde. –Vous voulez donc…
DONNA MATHILDE, se tournant vers lui,impassible. – Quoi ?
BELCREDI. – Vous lui portez vraiment tantd’intérêt ! Au point de vous prêter à cette comédie ?C’est énorme pour une femme !
DONNA MATHILDE. – Pour une femmequelconque !
BELCREDI. – Mais non, ma chère, pourtoutes ! C’est une abnégation…
DONNA MATHILDE. – Je le lui doisbien !
BELCREDI. – Mais ne mentez donc pas !Vous savez bien que vous ne vous abaissez pas !
DONNA MATHILDE. – Pourquoi parlez-vousd’abnégation, alors ?
BELCREDI. – Vous ne vous avilirez pas aux yeuxdes autres, mais vous vous avilirez assez pour m’offenser,moi !
DONNA MATHILDE. – Il s’agit bien de vous en cemoment !
Di NOLLI, s’avançant. – Bien, bien,voici donc comment nous ferons… (S’adressant à Berthold.)Vous, allez m’appeler un de vos trois camarades !
BERTHOLD. – Tout de suite !
Il sort par le fond.
DONNA MATHILDE. – Mais il faut d’abord quenous prenions congé de lui !
Di NOLLI. – Précisément ! Je le faisappeler pour préparer votre départ. (À Belcredi.) Toi, tupeux t’en dispenser : reste ici !
BELCREDI, hochant la tête avecironie. – Mais oui, je m’en dispense… je m’en dispense trèsvolontiers…
Di NOLLI. – Il vaut mieux ne pas éveillerencore sa défiance, comprends-tu ?
BELCREDI. – Mais oui ! Je suis unequantité négligeable !
LE DOCTEUR. – Il faut lui donner la certitudeabsolue que nous quittons le château.
Landolf, suivi de Berthold, entre par laporte à droite.
LANDOLF. – Je vous demande pardon !
Di NOLLI. – Entrez ! Entrez ! C’estbien vous Lolo, n’est-ce pas ?
LANDOLF. – Lolo ou Landolf, auchoix !
Di NOLLI, – Bien. Écoutez : Le docteur etmadame la Marquise vont prendre congé tout de suite.
LANDOLF. – Rien de plus facile. Il suffira dedire qu’ils ont obtenu sa grâce et que le Pape consent à lerecevoir. Il est là-bas, dans sa chambre, en train de gémir. Il serepent de tout ce qu’il a dit, et il est désespéré à l’idée qu’iln’obtiendra pas sa grâce. Si vous voulez bien me suivre et prendrela peine de remettre les habits que vous portiez tout àl’heure…
LE DOCTEUR. – Nous vous suivons…
LANDOLF. – J’y pense. Je me permets de voussuggérer une chose ; c’est d’ajouter que la marquise Mathildede Toscane, a comme vous, réclamé sa grâce au SouverainPontife.
DONNA MATHILDE. – Ah ! Vous voyez bienqu’il m’a reconnue !
LANDOLF. – Je vous demande pardon. Ce n’estpas pour cela : c’est qu’il redoute terriblement l’aversion dela marquise, qui a accueilli le Pape dans son château. C’est unechose étrange… Dans l’histoire, que je sache (mais ces messieurs etdames le savent certainement mieux que moi) il n’est pas dit dutout, n’est-ce pas, qu’Henri IV aimât secrètement la marquisede Toscane ?
DONNA MATHILDE, promptement. – Non,pas du tout ! Il n’y a rien de cela ! C’est même tout lecontraire !
LANDOLF. – C’est bien ce qui me semblait maislui dit qu’il l’a aimée – il ne cesse de le répéter… Et il redouteaujourd’hui que la colère de la marquise, à cause de cet amoursecret, n’agisse contre lui sur l’esprit du Souverain Pontife.
BELCREDI. – Et il faut lui faire comprendreque cette aversion n’existe plus !
LANDOLF. – C’est cela !Parfaitement !
DONNA MATHILDE, à Landolf. – C’esttrès bien ! Oui. (À Belcredi.) L’histoire ditprécisément, vous l’ignorez peut-être, que le Pape consentit à lerecevoir sur les prières de la marquise Mathilde et de l’abbé deCluny. Et je vous dirai même, mon cher Belcredi, qu’au moment de lacavalcade – je pensais me servir de ce fait pour lui prouver que jen’étais pas son ennemi autant qu’il se l’imaginait.
BELCREDI. – Mais alors, c’est parfait, machère marquise ! Vous n’avez qu’à vous conformer àl’histoire !…
LANDOLF. – Madame pourrait très bien éviter undouble déguisement et se présenter tout de suite, avec monseigneur(il montre le docteur), vêtue en marquise de Toscane.
LE DOCTEUR, promptement, avec force.– Non, non ! Pas cela, je vous en prie ! Cela démoliraittout mon plan ! L’impression que doit provoquer laconfrontation doit être brusque, foudroyante. Non, non, marquise,venez avec moi : vous vous présenterez encore à lui enduchesse Adélaïde, mère de l’impératrice, et nous prendrons congé.Il est avant tout nécessaire qu’il croie que nous avons quitté ceslieux. Allons, ne perdons plus de temps : nous avons encoremille choses à préparer.
Le docteur, donna Mathilde et Landolfsortent par la porte à droite.
FRIDA. – Voilà que je recommence à avoirpeur…
Di NOLLI. – Encore, Frida ?
FRIDA. – Il aurait mieux valu que je le vissetout à l’heure…
Di NOLLI. – Je t’assure qu’il n’y a vraimentpas de quoi avoir peur !…
FRIDA. – Il n’est pas fou furieux, c’estsûr ?
Di NOLLI. – Mais non, c’est le fou le plustranquille qui soit.
BELCREDI, avec une ironique affectationsentimentale. – Un fou mélancolique !… Tu n’as donc pasentendu ! Il est fou de toi.
FRIDA. – Merci beaucoup ! C’estprécisément ce qui m’effraie !
BELCREDI. – Il ne cherchera pas à te faire demal…
Di NOLLI. – Ce sera l’affaire d’uninstant…
FRIDA. – Oui, mais me trouver dansl’obscurité ! avec lui…
Di NOLLI. – Il ne s’agit que d’une minute… etpuis, ne serai-je pas près de toi. Tout le monde restera derrièreles portes, aux aguets, prêt à accourir. Dès qu’il verra ta mèredevant lui, comprends-tu ? ton rôle sera terminé…
BELCREDI. – Voulez-vous savoir quelle est macrainte à moi : c’est qu’on ne donne un coup d’épée dansl’eau.
Di NOLLI. – Ne recommence pas ! Le remèdeme paraît efficace !
FRIDA. – À moi aussi, à moi aussi ! Je lesens rien qu’à la façon dont je frémis déjà moi-même !
BELCREDI. – Mais les fous, mes chers amis –(malheureusement ils l’ignorent) – possèdent un bonheur dont nousavons tort de ne pas tenir compte…
Di Nolli, agacé. – Qu’est-ce que tunous chantes avec leur bonheur ?
BELCREDI, avec force. – Ils neraisonnent pas !
Di Nolli, l’interrompant avecimpatience. – Mais le raisonnement n’a rien à voirlà-dedans !
BELCREDI. – Comment ! N’est-ce pas unraisonnement qu’il devrait faire – selon nous – en la voyant(il montre Frida) et en voyant sa mère ? Ceraisonnement, nous l’avons nous-mêmes construit d’avance.
Di NOLLI. – Pas du tout ! Il ne s’agitpas d’un raisonnement ! Nous lui présentons, comme le dit ledocteur, une double image de la fiction où il s’est enfermé.
BELCREDI, avec éclat, brusquement. –Écoute : je n’ai jamais compris pourquoi ces gens-là prennentleur doctorat en médecine !
Di NOLLI, ne comprenant pas. – Quidonc ?
BELCREDI. – Les aliénistes.
Di NOLLI. – Et quel doctorat veux-tu qu’ilsprennent ?
FRIDA. – Puisqu’ils sont médecinsaliénistes ?
BELCREDI. – Précisément… Ils devraient prendreleur doctorat en droit ! Chez eux, tout est purbavardage ! Mieux un psychiatre sait parler, meilleur ilest ! « L’élasticité analogique », « laconscience de la durée » ! Et par-dessus le marché, ilsont le toupet de dire qu’ils ne font pas de miracles… Maisprécisément, ce sont des miracles qu’il faudrait ! Ah !ils savent bien que plus ils disent qu’ils ne sont pas sorciers,plus les gens les prennent au sérieux. Ils ne font pas de miracles,et ils retombent toujours sur leurs pattes ! C’estadmirable !
BERTHOLD, qui guettait derrière la portede droite, regardant par le trou de la serrure. – Lesvoilà ! Les voilà ! Ils se dirigent de ce côté…
Di NOLLI. – Vraiment ?
BERTHOLD. – Il a l’air de vouloir lesreconduire… Oui, oui, le voilà, le voilà !
Di NOLLI. – Retirons-nous ! (Setournant vers Berthold, avant de sortir.) Vous, restezici !
BERTHOLD. – Je dois rester ici ?
Sans lui répondre, Di Molli, Frida etBelcredi s’enfuient par la porte du fond, laissantBerthold hésitant et interdit. La porte à droite s’ouvre :Landolf entre le premier, et s’incline aussitôt. Entrent ensuitedonna Mathilde, avec le manteau et la couronne ducale, comme aupremier acte, et le docteur, revêtu du froc d’abbé de Cluny,encadrant Henri IV en habit royal. Entrent enfin Ordulf etAriald.
HENRI IV, continuant le discoursqu’on suppose commencé dans la salle du trône. – Je vousdemande donc comment je pourrais être fourbe, si l’on me croitentêté…
LE DOCTEUR. – Non, non, pas entêté dutout !
HENRI IV, souriant aveccomplaisance. – Selon vous, je serais donc vraimentfourbe ?
LE DOCTEUR. – Non, non, ni fourbe, nientêté !
HENRI IV, s’arrête et s’écrie sur leton d’un homme qui veut faire remarquer avec bienveillance, maisaussi avec ironie, que les deux choses ne sont pas possibles.– Monseigneur, si l’entêtement n’est pas un vice qui puisse allerde pair avec la fourberie, j’espérais qu’en me refusantl’entêtement, vous voudriez bien m’accorder au moins un peu defourberie. Elle m’est très nécessaire, je vous assure ! Maissi vous voulez la garder tout entière pour vous…
LE DOCTEUR. – Comment ? Je vous faisl’effet d’être fourbe ?
HENRI IV. – Non, Monseigneur ! Quedites-vous là ? Mais vous ai-je moi-même produit aujourd’huil’impression d’être entêté ? (Coupant court et seretournant vers donna Mathilde.) Vous permettez que je dise,avant de prendre congé, un mot en particulier à madame laduchesse ? (Il la conduit à l’écart et luidemande anxieusement, en grand secret.) Votre fille vousest-elle vraiment chère ?
DONNA MATHILDE, éperdue. – Mais oui,certainement…
HENRI IV. – Et vous voulez que jecompense, de tout mon amour, de tout mon dévouement, les gravestorts que j’ai envers elle ? Du moins ne croyez pas, je vousen supplie, aux débauches dont m’accusent mes ennemis ?
DONNA MATHILDE. – Mais non : je n’y croispas, je n’y ai jamais cru…
HENRI IV. – Alors, vous voulezbien ?
DONNA MATHILDE. – Quoi donc ?
HENRI IV. – Que je recommence à aimervotre fille ? (Il la regarde et ajoute aussitôt, d’un tonmystérieux d’avertissement et d’épouvante à la fois.) Ehbien ! cessez d’être l’amie, oui, ne soyez plus l’amie de lamarquise de Toscane !
DONNA MATHILDE. – Je vous assure, pourtant,qu’elle a prié, qu’elle a conjuré autant que nous pour obtenirvotre grâce…
HENRI IV, aussitôt, bas,frémissant. – Ne me dites pas cela ! Ne voyez-vous pas,madame, l’effet que cela me produit ?
DONNA MATHILDE, le regardant, puis toutbas, comme en confidence. – Vous l’aimez encore ?
HENRI IV, éperdu. –Encore ? Vous dites encore ? Comment lesavez-vous ?… Personne ne le sait ! Personne ne doit lesavoir !
DONNA MATHILDE. – Mais elle le sait peut-être,si elle a tant imploré en votre faveur !
HENRI IV la considère une minute,puis dit. – Et vous aimez votre fille ? (Brève pause.Il se tourne vers le docteur, sur un ton plaisant.) Ah !Monseigneur, c’est étrange, je n’ai su que j’étais marié quelongtemps après – bien tard, bien tard… Aujourd’hui même, je suismarié, je le suis sans aucun doute… Eh bien, je puis vous jurer queje n’y pense presque jamais. C’est un gros péché de ma part, maisje n’ai pas le sentiment de l’existence de ma femme ; je ne lasens pas dans mon cœur. Ce qui est le plus étonnant, c’est que samère non plus ne la sent pas dans son cœur ! Avouez-le,madame, vous vous souciez bien peu d’elle ! (Il se tournevers le docteur, avec exaspération.) Elle me parle del’autre ! de Mathilde ! (S’excitant toujoursdavantage.) Et avec une insistance, une insistance que je neparviens pas à m’expliquer.
LANDOLF, humblement. – C’estpeut-être pour vous enlever, Majesté, une opinion fausse que vousavez pu concevoir sur la marquise de Toscane. (Comme confus des’être permis cette remarque.) Je veux dire, bien entendu, ence qui concerne la minute présente…
HENRI IV. – Tu soutiens, toi aussi,qu’elle a été mon amie ?
LANDOLF. – Oui, Majesté, en ce moment, elleest votre amie !
DONNA MATHILDE. – Oui, c’est exact, elle…
HENRI IV. – Je comprends ce que celasignifie. Vous ne croyez pas que je l’aime. Je comprends. Jecomprends. Personne ne l’a jamais cru, personne ne l’a jamaissoupçonné. Cela vaut mieux ainsi. C’est assez. Assez. (Il coupecourt et se tourne vers le docteur, le visage changé.) Vousavez vu, Monseigneur ? les conditions qu’a mises le Pape pourlever son excommunication n’ont rien, exactement rien à voir avecles raisons pour lesquelles il m’avait excommunié ! Dites auPape Grégoire que nous nous reverrons à Bressanone. Et vous,madame, si vous avez la chance de rencontrer votre fille dans lacour du château de votre amie la marquise, que vousdirais-je ? Faites-la monter ; nous verrons s’il me serapossible de la garder comme épouse et comme impératrice. Jusqu’ici,combien se sont présentées à moi en m’assurant qu’elles étaientbien Berthe de Suse, mon épouse, que j’ai quelquefois désirée – (iln’y avait pas de honte à cela : puisqu’il s’agissait de mafemme légitime !) Mais je ne sais pourquoi en m’affirmantqu’elles étaient bien Berthe, qu’elles étaient bien de Suse, elleséclataient de rire ! (Sur un ton de confidence.) Vouscomprenez, madame, – au lit – moi sans vêtements – elles, mon Dieu,elles aussi sans vêtements… l’homme et la femme… c’estnaturel !… On ne pense plus à ce qu’on est quand on est nu. Onsuspend son habit, il reste là comme un fantôme ! (Sur unautre ton, en confidence, au docteur.) Pour moi, Monseigneur,je pense que les fantômes, en général, ne sont au fond rien autrechose que de petites combinaisons manquées de l’esprit : desimages que nous n’avons pas réussi à contenir dans le royaume dusommeil, et qui nous apparaissent parfois à l’état de veille, enplein jour, pour nous faire peur. Ah ! si vous saviez ma peur,la nuit, quand je vois apparaître en désordre toutes ces images –qui rient, qui tombent de cheval. – Parfois, le sang qui bat dansmes artères me terrifie, comme dans le silence de la nuit, un bruitassourdi de pas dans des chambres lointaines… Mais c’est assez, jevous ai trop retenus. Je vous salue, madame, Monseigneur, mesrespects. (Au seuil de la porte du fond, jusqu’où il les aaccompagnés, il prend congé d’eux, qui s’inclinent. Donna Mathildeet le docteur sortent. Il referme la porte et se retourne aussitôt,complètement changé.) Ah ! les bouffons ! lesbouffons ! les bouffons ! C’était un clavier decouleurs ! Je n’avais qu’à l’effleurer, et elle devenaitblanche, rouge, jaune, verte… Et cet autre : Pierre Damien. –Ah ! ah ! c’était parfait ! Je l’ai écrasé ! Iln’a pas osé reparaître devant moi ! (Tout cela sera ditavec une frénésie joyeuse et jaillissante en marchant de long enlarge, en tournant la tête de tous côtés, jusqu’au moment où ilaperçoit Berthold, plus qu’étonné, épouvanté par ce changementsoudain. Il s’arrête devant lui, et le montrant aux trois autres,qui restent éperdus de stupéfaction.) Mais regardez donc cetimbécile, qui me regarde la bouche ouverte… (Il lesecoue.) Tu ne comprends donc pas ? Tu ne vois donc pascomment je les traite, comment je les désarticule, comment je lesoblige à paraître devant moi, ces pantins demi-mortsd’épouvante ! Ce qui les terrifie, c’est uniquementceci : que je leur arrache leur masque et que je m’aperçois deleur déguisement : comme si ce n’était pas moi qui les avaiscontraints à se déguiser pour le plaisir que j’ai de faire lefou !
LANDOLF, ARIALD et ORDULF, bouleversés, seregardant entre eux. – Comment ? Que dit-il ? Maisalors…
HENRI IV, se tournant brusquement, enentendant leurs cris, impérieusement. – Je suis excédé !J’en ai assez ! Finissons-en ! (Soudain, comme si, eny repensant, il n’arrivait pas à y croire.) Quelleimpudence ! Se présenter devant moi, aujourd’hui, avec sonamant auprès d’elle… – Et ils se donnaient des airs de pitié, ilssemblaient vouloir épargner la colère à un pauvre homme déjà horsdu monde, hors du temps, hors de la vie ! Un fou ! Oui,un peu de pitié pour un pauvre fou… S’il ne l’était pas, fou, cethomme n’aurait pas toléré d’être ainsi tyrannisé ! Ilsprétendent bien, eux, tous les jours, à toutes les minutes, que lesautres soient comme ils le veulent ! Ils ne considèrent pascela comme de la tyrannie : oh, non, pas le moins dumonde ! C’est leur façon de penser, leur façon de voir, desentir : chacun a la sienne ! Vous avez aussi la vôtrecertainement. Mais je voudrais bien savoir quelle elle peutêtre ! Celle des bêtes de troupeau, misérable, changeante,incertaine !… Et eux, ils en profitent : ils vous fontsubir et accepter leur façon de voir ; ils vous font sentir etvoir comme eux, ou, tout au moins, ils s’en donnentl’illusion ! Car, enfin, que parviennent-ils à imposer ?Des mots ! des mots que chacun comprend et répète à sa façon…C’est pourtant ainsi que se forme ce qu’on appelle l’opinioncourante ! Ah ! malheur à celui qui, un beau jour, setrouve marqué d’un de ces mots que chacun répète ! Le mot« fou », par exemple, ou encore, que sais-je, le mot« imbécile » ! Mais dites-moi, peut-on rester calmeà l’idée que quelqu’un s’acharne à persuader aux autres que vousêtes tel qu’il vous voit, lui, à vous graver dans l’esprit desautres, conforme au jugement qu’il a porté sur vous ?« Un fou » « Un fou » ! – Je ne parle pasd’aujourd’hui, où je fais semblant de l’être ! Mais avant machute de cheval, avant ce choc sur ma tête… (Il s’arrêtebrusquement, en remarquant l’agitation des quatre hommes.)Vous vous regardez dans les yeux ? (Il imite les marquesde leur étonnement.) Quelle révélation, n’est-ce pas ? Lesuis-je ou ne le suis-je pas ? – Eh oui, je suis fou (ildevient terrible.) Mais alors, pardieu, à genoux, àgenoux ! (Il les force à s’agenouiller tous, l’un aprèsl’autre.) Je vous l’ordonne : tous a genoux devantmoi ! – Comme cela ! Et touchez trois fois la terre dufront ! Allons ! Devant les fous, tout le monde doit êtreà genoux ! (Il regarde les quatre hommes agenouillés etsent brusquement sa féroce gaieté s’évaporer, il s’enindigne.) Allons ! Bêtes de troupeau, relevez-vous !– Vous m’avez obéi ? Alors que vous pouviez me passer lacamisole de force !… Écraser quelqu’un sous le poids d’un mot,cela se fait comme rien, comme on écraserait une mouche !Toute la vie est écrasée sous le poids des mots ! Le poids desmorts ! Regardez moi : pouvez-vous croire sérieusementqu’Henri IV vit encore ? Et pourtant, je parle et je vouscommande, à vous qui êtes vivants. C’est moi qui vous veuxainsi ! Cela vous semble une plaisanterie, que les mortscontinuent à dominer la vie ? – Ici, oui, c’est uneplaisanterie : mais, sortez d’ici, allez dans le monde desvivants. Le jour paraît. Le temps s’étale devant vous. C’estl’aube. – Ce jour qui naît, vous dites-vous, nous allons le créernous-mêmes ? – Ah oui ! Vous-mêmes ! – Et toutes lestraditions ! Et toutes les habitudes ! – Vous vous mettezà parler ? – C’est pour répéter toutes les phrases quitoujours se sont dites ! – Vous croyez vivre ? – Vousremâchez la vie des morts ! (Il se campe devant Berthold,complètement abasourdi.) Tu ne comprends rien à tout cela,toi, n’est-ce pas ? Comment t’appelles-tu ?
BERTHOLD. – Moi… Berthold…
HENRI IV. – Imbécile ! Nous sommesici entre nous : Comment t’appelles-tu ?
BERTHOLD. – Vr… Vraiment… Je m’appelleFino…
HENRI IV, remarquant le gested’avertissement des trois autres, et se tournant aussitôt vers euxpour les faire taire. – Fino ?
BERTHOLD. – Fino Pagliuca, oui, monsieur.
HENRI IV, se tournant vers lesautres. – Vous, je sais vos noms ! Je vous ai tant defois entendu vous appeler ! (À Landolf.) Toi, tut’appelles Lolo ?
LANDOLF. – Oui, monsieur… (Avecjoie.) Oh, mon Dieu… Mais alors ?
HENRI IV, brusquement. – Quoidonc ?
LANDOLF, pâlissant. – Je disais…
HENRI IV. – Oui, tu disais : alorsil n’est plus fou ? Mais non ! Ne le voyez-vouspas ? – Nous nous amusons aux dépens de ceux qui nous croientfous. (À Ariald.) Je sais que tu t’appelles Franco… (ÀOrdulf.) Et toi, attends un peu…
ORDULF. – Momo !
HENRI IV. – Oui, Momo ! Ehbien ! Qu’en pensez-vous ?
LANDOLF. – Mais alors… Mon Dieu…
HENRI IV. – Non, rien n’est changé !Rions à gorge déployée !… Mais entre nous. (Il rit.)Ah, ah, ah, ah, ah !
LANDOLF, ARIALD, ORDULF, se regardant,incertains, pris entre leur joie et leur surprise. – Il estguéri ! Est-il possible ?
HENRI IV. – Chut, chut ! (ÀBerthold.) Tu ne ris pas ? Tu es encore offensé ? Ilne faut pas ! Je ne parlais pas pour toi, tu sais ? –C’est tout le monde, comprends-tu ? C’est tout le monde qui aintérêt à faire croire que certains hommes sont fous, afin depouvoir sans remords les enfermer. Et sais-tu pourquoi ? C’estparce que quand ces hommes-là se mettent à parler, ils cassenttout. Les conventions volent en éclats. Moi, par exemple, qui suisun de ces hommes, que vais-je dire de ces gens qui viennent de s’enaller ? Que la femme est une putain, son compagnon un salaudet que le troisième est un imposteur… Personne ne croira que c’estvrai ! Et on décide que je suis fou ; mais tout le mondem’écoute pourtant avec épouvante… Ah ! Je voudrais bien savoirpourquoi cette épouvante, puisque ce que je dis n’est pas vrai. –On ne peut pas croire ce que racontent les fous ! – Etcependant, regardez-les tous qui m’écoutent les yeux élargisd’épouvante. – Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, toi, dis-lemoi ? Tu vois, je suis calme.
BERTHOLD. – Mais parce que… ils croientpeut-être…
HENRI IV. – Que c’est vrai ! Non,mon cher… Non, mon cher… regarde-moi bien dans les yeux. Je ne dispas que ce soit vrai, sois tranquille ! – Rien n’estvrai ! – Mais regarde-moi bien dans les yeux !(Réponds : Pourquoi écoute-t-on les fous avec épouvante !Mais regarde-moi donc dans les yeux !)
BERTHOLD. – Oui, monsieur…
HENRI IV. – Tu vois bien ! Tu voisbien ! Toi aussi ! Tes yeux sont remplisd’épouvante ! Parce que de nouveau tu me crois fou (et lesfous, on les écoute toujours avec terreur !) – Voilà lapreuve ! Voilà la preuve !
Il rit.
LANDOLF, au nom des autres, prenantcourage, avec exaspération. – Mais quelle preuve ?
HENRI IV. – Que les fousterrifient ! En ce moment, vous me croyez fou de nouveau etvous m’écoutez avec épouvante ? – Et pourtant, il y alongtemps que vous êtes habitués à ma folie ! Vous avez cruque j’étais fou ! – Est-ce vrai ou non ? Alors pourquoicette épouvante ? (Il les regarde, ils sontatterrés.) Vous voyez bien ? Vous sentez que ce désarroipeut aller jusqu’à la terreur, jusqu’à la sensation que la terrevous manque sous les pieds et qu’on n’a plus d’air àrespirer ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que, meschers amis : se trouver devant un fou, savez-vous bien ce quecela signifie ? – Cela veut dire : se trouver devantquelqu’un qui ébranle jusque dans leurs assises toutes les chosesque nous avons construites en nous, autour de nous, la logique, lalogique de toutes nos constructions ! – Il n’y a rien à yfaire ! Les fous construisent sans logique ; comme ilssont heureux, hein ! Ou bien avec une logique à eux, légèrecomme une plume ! Ah ! Quelle mobilité ! Quellemobilité ! Aujourd’hui, d’une façon ; demain, d’uneautre ! Qui sait comment ? Vous employez toute votreforce à vous fixer, et eux, ils s’abandonnent. Quellemobilité ! Quelle mobilité ! – Vous dites :« Cela ne peut pas être ! » – Pour eux, tout peutêtre. – Vous dites : cette chose n’est pas vraie ?Pourquoi ? – Parce qu’elle ne semble vraie ni à toi, ni à toi,ni à toi, (il indique trois d’entre eux) ni à cent milleautres. Eh, mes chers amis, il faudrait examiner ce qui semble vraià ces cent mille autres qu’on n’appelle pas fous, voir lesspectacles que donne leur accord, fruits de leur logique !Fine fleur de logique ! Étant enfant, la lune, dans le puits,me semblait vraie. Et combien d’autres choses encore me semblaientvraies ! Je croyais à tout ce qu’on me disait et j’étaisheureux ! Malheur, oui, malheur, si vous ne vous cramponnezpas de toutes vos forces à ce qui vous semble vrai aujourd’hui, àce qui vous semblera vrai demain, même si c’est le contraire de cequi hier vous sembla vrai ! Malheur si vous allez comme moi,jusqu’au fond de cette chose terrible qui, elle, rend fou : setrouver à côté d’un autre être, regarder ses yeux, – comme un jourj’ai regardé certains yeux, – et se sentir pareil à un mendiantdevant une porte qui jamais ne s’ouvrira pour le laisser passer.Celui qui entrera, ce ne sera jamais vous, avec l’univers que vousportez en vous, tel que vous le voyez et le touchez. Ce seraquelqu’un d’inconnu de vous, conforme à celui que cet autre être,dans son univers impénétrable, croit voir et toucher en vous.(Longue pause. L’ombre commence à s’épaissir dans la salle,accroissant l’impression d’effroi et de consternation dont cesquatre hommes déguisés sont envahis, et qui les éloignent toujoursdavantage de ce grand homme masqué, qui demeure plongé dans lacontemplation de l’effroyable misère qui n’est pas seulement lasienne propre, mais celle de tous les hommes. Il se secoue, cherchedu regard les quatre hommes qu’il n’a plus l’impression d’avoirautour de lui, et dit.) La nuit s’est faite ici.
ORDULF, aussitôt s’avançant. –Faut-il aller chercher la lampe ?
HENRI IV. – La lampe, ah !oui !… Vous croyez donc que j’ignore qu’à peine le dos tournéavec ma lampe à huile, pour aller me coucher, vous allumiez pourvous la lumière électrique, ici, et dans la salle du trône ? –Je faisais semblant de ne pas m’en apercevoir…
ORDULF. – Ah ! – Voulez-vous alorsque…
HENRI IV. – Non, elle m’aveuglerait. – Jeveux ma lampe.
ORDULF. – Elle doit être préparée déjàderrière la porte.
Il va à la porte du fond, l’ouvre, fait unpas au dehors et revient aussitôt avec une lampe ancienne, decelles qu’on porte par un anneau.
HENRI IV. – Très bien, un peu de lumière.Asseyez-vous, tout autour de la table. Mais non, pas commecela ! Prenez de belles attitudes… Pleines d’aisance… (ÀBerthold.) Toi, comme ceci… (Il lui donne une attitude,puis à Landolf) Toi, comme cela… (Il lui donne uneattitude.) C’est parfait… (Il s’assied en faced’eux.) Moi, ici… (Tournant la tête vers la fenêtre.)Il faudrait pouvoir commander à la lune un beau rayon, biendécoratif… Ah ! Comme elle nous sert, la lune, comme elle nousest utile, comme elle m’est chère ! Souvent je passe desheures à la regarder de ma fenêtre. Qui pourrait croire, à lacontempler, qu’elle sait que huit cents ans se sont écoulés, etqu’assis à ma fenêtre, je ne puis vraiment être Henri IV entrain de regarder la lune comme le premier venu ! Je laregarde : c’est pour échapper à cette impression de désert quiest partout ici, où la folie a habité, où divaguer est la chosespontanée, la chose habituelle et sérieuse – qui a le droit, undroit parfaitement logique à l’existence – comme n’importe quelleautre réalité, dont la vanité trompeuse ne s’est pas encoredévoilée. Mais regardez, regardez donc ce magnifique tableaunocturne : l’Empereur entouré de ses fidèles conseillers… Nevous plaît-il pas, ce tableau ?
LANDOLF, bas à Ariald, comme pour éviterde rompre l’enchantement. – Tu comprends ? Si on avait suque ce n’était pas vrai…
HENRI IV. – Vrai, quoi donc ?
LANDOLF, hésitant comme pours’excuser. – C’est simplement que… ce matin… je lui disais(il montre Berthold,) comme il prenait pour la premièrefois le service : quel dommage qu’avec ces vêtements, qu’avecune garde-robe aussi belle… et avec une salle pareille…
Il montre la salle du trône.
HENRI IV. – Eh bien ? Tu disaisqu’il était dommage que ?…
LANDOLF. – Je disais que nous ne savionspas…
HENRI IV. – Que vous représentiez pourrien, pour rire, toute cette comédie ?
LANDOLF. – Oui, nous imaginions que…
ARIALD, pour lui venir en aide. –Oui… nous imaginions que c’était pour de bon…
HENRI IV. – Comment ? N’est-ce paspour de bon ?
LANDOLF. – Eh ! Puisque vous ditesque ?…
HENRI IV. – Je dis que vous êtes desimbéciles ! Cette illusion, vous deviez l’entretenir pourvous-mêmes, et non pas seulement pour m’en donner lacomédie à moi et aux quelques visiteurs que nous avions ; vousauriez dû la vivre de la façon la plus naturelle, tous les jours,même quand personne n’était là. (Prenant Berthold parle bras.) Comprends-tu, la vivre pour toi. Tu pouvaist’enclore dans cette fiction, y manger, y dormir et t’y gratter ledos quand il te démangeait ! (Se tournant vers lesautres.) Vous auriez dû vous sentir vivre, vivre vraiment,dans l’histoire du XIe siècle, à la cour de votreEmpereur Henri IV ! (Il saisit Ordulf par lebras.) Toi, Ordulf, un Ordulf vivant dans le château deGoslar ! Quand, le matin, tu t’éveillais et sautais de tonlit, ce n’était pas pour sortir de ton rêve, c’était pour y entrer,en revêtant ces braies et ces tuniques. Oui, pour entrer dans cerêve qui n’aurait plus été un rêve, car tu l’aurais vécu, tul’aurais constamment senti, tu l’aurais bu avec l’air que turespirais, mais, tout en sachant bien que c’était un rêve, afin demieux savourer le bonheur privilégié qui vous était donné de nerien faire d’autre ici que de vivre ce rêve, si loin de nous etcependant présent ! Ah ! Du fond du passé lointain oùnous sommes, de ce XIe siècle, si plein de couleurs etpourtant sépulcral, contempler huit cents ans plus tard les hommesdu XXe siècle en train de se débattre dans l’inquiétudeet le tourment pour savoir ce qui va advenir d’eux, comment sedénoueront les événements qui les agitent et les angoissent. Tandisque vous, au contraire, vous étiez déjà bien tranquilles, dansl’histoire ! avec moi !
LANDOLF. – Ah ! comme c’estvrai !
HENRI IV. – Dans l’histoire où tout estdécidé ! Où tout est fixé !
ORDULF. – Voilà, voilà !
HENRI IV. – Ah ! Ma vie peut êtrelamentable ; elle peut être traversée d’horreurs, de luttes,de douleurs ; c’est déjà de l’histoire ; rien n’y changeplus, rien n’y peut plus changer. Comprenez-vous ? Tout y estfixé pour toujours. Et vous pouviez vous étaler dans cette vie enadmirant comme les effets suivent leurs causes, avec obéissance, enparfaite logique et en contemplant le déroulement précis etcohérent de tous les faits dans leurs moindres détails. La joie del’histoire, cette joie qui est si grande !
LANDOLF. – Ah ! Que c’est beau ! Quec’est beau !
HENRI IV. – C’était beau, mais c’estfini ! À présent que vous connaissez mon secret, je ne pourraiplus continuer ! (Il prend la lampe pour aller secoucher.) Et, d’ailleurs, vous non plus, puisque vous n’enaviez pas démêlé jusqu’ici les raisons ! Moi, j’en ai àprésent la nausée ! (Avec une violente ragecontenue.) Par le Ciel ! Elle se repentira d’être venueici ! Elle s’était déguisée en belle-mère… et lui en moine… etils amenaient avec eux un médecin pour me faire examiner… Ilsespéraient peut-être me guérir… Quels bouffons ! Je veux medonner le plaisir d’en gifler au moins un : Lui ! C’estun escrimeur fameux ? Il m’embrochera… Nous verrons bien, nousverrons bien… (On frappe à la porte du fond.) Qui valà ?
LA VOIX DE GIOVANNI. – Deo Gratias !
ARIALD, riant à l’idée d’une bonne farcequ’on pourrait encore faire. – C’est Giovanni, c’est Giovanni,qui vient, comme tous les soirs, faire le moine !
ORDULF, de même, se frottant lesmains. – Oui, oui, laissons faire !
HENRI IV. – Pourquoi te moquer d’unpauvre vieux qui agit par affection pour moi ?
LANDOLF, à Ordulf. – Tout doit êtrecomme si c’était vrai ! N’as-tu pas compris ?
HENRI IV. – Précisément ! Comme sic’était vrai ! C’est à cette seule condition que la véritén’est pas une plaisanterie ! (Il va ouvrir la portelui-même et fait entrer Giovanni, habillé en franciscain, avec unrouleau de parchemin sous le bras.) Entrez, entrez, monPère ! (Prenant un ton de gravité tragique et de sombreressentiment.) Tous les documents de ma vie et de mon règnequi m’étaient favorables ont été détruits, de propos délibéré, parmes ennemis : Seul a échappé à la destruction le récit de mavie écrit par un pauvre frère qui m’est dévoué, et vous voudriez enrire ? (Il se tourne affectueusement vers Giovanni etl’invite à prendre place devant la table.) Asseyez-vous, monPère, asseyez-vous, la lampe près de vous. (Il pose à côté delui la lampe qu’il tenait encore à la main.) Écrivez,écrivez.
GIOVANNI, étalant le rouleau de parcheminet se disposant à écrire sous la dictée. – Je suis à vosordres, Majesté !
HENRI IV, dictant. – Le décretde paix lancé de Mayence servait les pauvres et les bonnes gens. Ilnuisait aux méchants et aux riches. (Le rideau commence àbaisser.) Il apportait aux premiers le bien-être, la famine etla misère aux autres…
Rideau.
ACTE TROISIÈME
La salle du trône, plongée dans l’obscurité.Dans l’ombre on distingue à peine le mur du fond. Les deuxportraits ont été enlevés et dans les niches qui étaient derrière,ont pris place, dans l’attitude précise des deux portraits, Frida,déguisée en Marquise de Toscane, comme on l’a vue au second acte,et Carlo di Nolli, déguisé en Henri IV.
Au lever du rideau, la scène reste vide uncourt instant. La porte à gauche s’ouvre et Henri IV, portantla lampe par l’anneau pénètre dans la salle. Il se retourne pourparler aux quatre jeunes gens, qu’on suppose dans la salle à côté,avec Giovanni, comme à la fin du second acte.
HENRI IV. – Non : restez,restez ; je me déshabillerai seul. Bonne nuit.
Il referme la porte et se dirige, plein detristesse et de lassitude, vers la seconde porte à droite, quiconduit dans ses appartements.
FRIDA, quand il a dépassé le trône,murmure, du haut de sa niche, d’une voix éteinte par la peur.– Henri…
HENRI IV, s’arrêtant à cette voix,comme s’il avait reçu par traîtrise un coup de couteau dans le dos,se tourne avec épouvante vers le mur du fond et fait le gesteinstinctif de se protéger le visage avec son bras. – Quim’appelle ?
Ce n’est pas une question, c’est uneexclamation qui jaillit dans un frisson de terreur et n’attendaucune réponse de l’obscurité et du silence terrible de la salle,qui vient brusquement de s’emplir pour lui de la terreur d’êtrevraiment fou.
FRIDA, devant ce geste, s’épouvante, non moinsterrifiée de la comédie qu’elle a consenti à jouer, puis répète unpeu plus fort. – Henri…
Elle penche un peu la tête hors de saniche, vers l’autre niche, tout en essayant de continuer à jouer lerôle qu’on lui a confié.
Henri IV pousse un hurlement, laissetomber la lampe, entoure sa tête de ses bras et veuts’enfuir.
FRIDA, sautant de sa niche sur lesoubassement et criant comme si elle était devenue folle. –Henri… Henri… J’ai peur… J’ai peur…
Di Nolli saute à son tour sur lesoubassement, de là à terre, et court vers Frida, qui continue àcrier nerveusement et qui est sur le point de s’évanouir. À cemoment entrent, par la porte à gauche et par la première porte àdroite, le docteur, donna Mathilde habillée elle aussi en marquisede Toscane, Tito Belcredi, Landolf, Berthold, Giovanni. L’un de cesderniers donne la lumière dans la salle, une lumière étrange,provenant de petites lampes cachées dans le plafond, de manière àce que le haut de la scène seul soit vivement éclairé. Sans sepréoccuper de Henri IV, qui continue à regarder, stupéfait decette irruption inattendue, après la minute de terreur dont toutesa personne frémit encore, tous les autres accourent pour souteniret réconforter Frida toute tremblante, qui gémit et se débat dansles bras de son fiancé. Ils parlent tous ensemble.
DI NOLLI. – Non, non, Frida… Je suis là… Jesuis auprès de toi !
LE DOCTEUR. – Arrêtez ! L’expérience estinutile…
DONNA MATHILDE. – Il est guéri, Frida !Tu vois ! Il est guéri !
DI NOLLI, stupéfait. –Guéri ?
BELCREDI. – C’était pour rire !Calme-toi !
FRIDA. – Non ! J’ai peur ! j’aipeur !
DONNA MATHILDE. – Mais de quoi ?Regarde-le ! Ce n’était pas vrai ! Ce n’était pasvrai !
DI NOLLI. – Ce n’était pas vrai ? Quedites-vous ? Il serait guéri ?
LE DOCTEUR. – Il paraît !… Quant àmoi…
BELCREDI, montrant les quatre jeunesgens. – Mais oui ! Ils viennent de nous ledire !
DONNA MATHILDE. – Oui, il est guéri depuislongtemps ! Il le leur a avoué !
Di Nolli, maintenant plus indignéqu’étonné. – Mais ! Comment cela, puisque, jusqu’à tout àl’heure…
BELCREDI. – Il donnait la comédie pour semoquer de toi et de nous aussi qui, en toute bonne foi…
Di Nolli. – Est-ce possible ? Il seserait moqué de sa sœur jusqu’à sa mort ?
HENRI IV, qui est resté à guetter levisage des uns et des autres, crispé sous les accusations, laréprobation pour ce que tous jugent une farce cruelle, désormaispercée à jour. Ses yeux traversés d’éclairs témoignent qu’il méditeune vengeance, que la colère qui s’agite en lui ne lui laisse pasdémêler encore avec précision. À ces dernières paroles, blessé, ilse redresse avec l’idée claire de tenir pour vraie la fiction qu’onavait insidieusement préparée pour lui, et il crie à sonneveu. – Continue ! Continue !
Di NOLLI, interdit. – Continuer, quoidonc ?
HENRI IV. – Ce n’est pas seulement« ta » sœur qui est morte !
Di Nolli. – Ma sœur ? Je parle de latienne, que tu as obligée jusqu’à la fin à se présenter là, devanttoi, comme si elle était ta mère, Agnès !
HENRI IV. – N’était-ce pas« ta » mère ?
Di NOLLI. – Mais oui, c’était ma mère,précisément, ma mère !
HENRI IV. – Mais elle est morte pour moi« vieux et lointain », ta mère ! Toi, tu viens dedescendre frais comme une rose de là ! (Il montre la niched’où Di Nolli a sauté.) Et qu’en sais-tu si je ne l’ai paspleurée longtemps, longtemps, en secret, malgré cethabit ?
DONNA MATHILDE, consternée, regardant lesautres. – Que dit-il ?
LE DOCTEUR, très impressionné,l’observant. – Doucement, doucement, je vous ensupplie !
HENRI IV. – Ce que je dis ? Quand jedemande à tous si Agnès n’était pas la mère d’Henri IV ?(Il se tourne vers Frida, comme si elle était véritablement lamarquise de Toscane.) Vous, marquise, vous devriez le savoir,il me semble !
FRIDA, encore épouvantée, se pressantdavantage contre di Nolli. – Non, moi non !non !
LE DOCTEUR. – Le délire le reprend… Doucement,je vous en prie !
BELCREDI, indigné. – Mais non,docteur ! Ce n’est pas le délire ! Il recommence à jouerla comédie !
HENRI IV, reprenant. – Moi. Vousavez vidé ces deux niches-là ; lui se présente devant moi enHenri IV.
BELCREDI. – Mais finissons-en avec cetteplaisanterie !
HENRI IV. – Qui parle deplaisanterie ?
LE DOCTEUR, à Belcredi, avec force. –Ne le provoquez pas, pour l’amour de Dieu !
BELCREDI, sans prêter d’attention auxparoles du docteur, plus fort, montrant les quatre jeunesgens. – Ce sont eux qui l’ont dit ! Eux !Eux !
HENRI IV, se tournant vers eux.– Vous avez parlé de plaisanterie ?
LANDOLF, timide, embarrassé. – Non…nous avons dit que vous étiez guéri !
BELCREDI. – Allons, cela suffit ! (Àdonna Mathilde.) Ne vous semble-t-il pas que ce spectacle(il montre di Nolli) marquise, et votre déguisement,deviennent d’une puérilité insupportable ?
DONNA MATHILDE. – Mais taisez-vous donc !Qu’importent ces habits, s’il est vraiment guéri ?
HENRI IV. – Guéri, oui ! Je suisguéri ! (À Belcredi.) Mais ce n’est pas pour en finirtout de suite, comme tu le crois ! (Il se jette surlui.) Sais-tu bien que, depuis vingt ans, personne n’a jamaisosé paraître devant moi comme toi et ce monsieur ?
Il montre le docteur.
BELCREDI. – Mais oui, je le sais ! Et cematin, j’étais venu déguisé…
HENRI IV. – En moine, oui !
BELCREDI. – Et tu m’as pris pour PierreDamien ! Et je n’ai pas ri, précisément parce que jecroyais…
HENRI IV. – Que j’étais fou ! Et turis maintenant en la voyant vêtue de la sorte, parce que je suisguéri ? Tu pourrais pourtant penser, qu’à mes yeux, à présent,ce costume… (Il s’interrompt avec un éclat d’indignation.)Ah ! (Il se tourne vers le docteur.) Vous êtesmédecin ?
LE DOCTEUR. – Mais oui…
HENRI IV. – Et vous l’aviez habilléeaussi en marquise de Toscane ? pour me préparer unecontre-plaisanterie ?…
DONNA MATHILDE, aussitôt, avec feu. –Non, non ! Que dites-vous là ! Nous l’avons fait pourvous ! Je l’ai fait pour vous !
LE DOCTEUR. – Pour essayer, pour essayer, nesachant plus…
HENRI IV, l’interrompant avecnetteté. – J’ai compris. C’est pour lui que je parle decontre-plaisanterie (il montre Belcredi), puisqu’il croitque je plaisante…
BELCREDI. – Mais naturellement, voyons !puisque tu nous dis toi-même que tu es guéri !
HENRI IV. – Laisse-moi parler !(Au docteur.) Savez-vous, docteur, que vous avez risqué derefaire pour un moment la nuit dans mon cerveau ? Que diable,faire parler des portraits ! Les faire sortir de leursniches…
LE DOCTEUR. – Mais nous sommes accourus toutde suite, vous avez vu, dès que nous avons su…
HENRI IV. – Oui… (Il contemple Fridaet di Nolli, puis la marquise, et enfin regarde son proprehabit.) L’idée était très belle… Deux couples… Très bien, trèsbien, docteur : pour un fou… (Il fait un léger signe de lamain, dans la direction de Belcredi.) Il trouve à présent quec’est une mascarade hors de saison ? (Il le regarde.)Je n’ai plus qu’à enlever mon déguisement et à m’en aller d’iciavec toi, n’est-ce pas ?
BELCREDI. – Avec moi ! Avec noustous !
HENRI IV. – Et pour aller où ? Aucercle, en frac et en cravate blanche ? Ou chez la marquise,en ta compagnie ?
BELCREDI. – Mais pour aller où tuvoudras ! Tu préférerais donc rester encore ici, à perpétuerdans la solitude ce qui fut la malheureuse plaisanterie d’un jourde carnaval ? Il est vraiment incroyable, incroyable que tuaies fait cela, après ta guérison.
HENRI IV. – Eh ! mais c’est qu’aprèsma chute de cheval, sur la tête, je suis vraiment resté fou pendantje ne sais combien de temps…
LE DOCTEUR. – Ah ! c’est cela !c’est cela ! Et pendant longtemps ?
HENRI IV, rapidement, audocteur. – Oui, docteur, longtemps. Douze ans environ, si jecalcule bien. (Il se retourne et s’adresse à nouveau àBelcredi.) Et ne plus rien voir, mon cher, de tout ce quiétait arrivé depuis ce jour de carnaval ; de tout ce qui a eulieu pour vous, mais non pour moi ; n’avoir pas vu les choseschanger, mes amis me trahir, ma place prise par d’autres… parexemple… que sais-je ! supposons dans le cœur de la femmeaimée ; n’avoir plus su qui mourait, qui disparaissait… toutcela, ça n’a pas été une plaisanterie pour moi, comme tul’imagines !
BELCREDI. – Mais non, je ne dis pascela ! Je parlais d’après ta guérison !…
HENRI IV. – Ah oui ! Après ? Unbeau jour… (Il s’arrête et se tourne vers le docteur.) Uncas très intéressant, docteur ! étudiez-moi, étudiez-moibien ! (Il frémit en parlant.) Un jour, Dieu saitcomment, mon mal… (Il se touche le front.) Oui… guérit. Jerouvre les yeux peu à peu, et tout d’abord je ne sais pas si jedors ou si je veille ; mais oui, je suis éveillé ; jetouche vraiment cette chose, cette autre ; je recommence àvoir clairement… Ah ! – comme il le dit – (il montreBelcredi) quitter alors, quitter ce masque, ce vêtement,s’évader de ce cauchemar ! Ouvrons les fenêtres :respirons la vie ! Sortons, sortons ! Courons !(Sa fougue tombe d’un coup.) Mais où ? Pour fairequoi ? Pour que tout le monde me montre du doigt, parderrière, m’appelle Henri IV, et non pas comme on le faisaitici, mais dans la vie, bras dessus, bras dessous, avec toi, parmiles bons amis d’autrefois ?
BELCREDI. – Mais non ! Que dis-tu ?Pourquoi ?
DONNA MATHILDE. – Mais pas le moins du monde.Qui en aurait eu le courage ? Ç’avait été un si grandmalheur !
HENRI IV. – Mais non, tout le monde metrouvait déjà fou auparavant ! (À Belcredi.) Et tu lesais bien, toi qui t’acharnais plus que les autres contre moi,quand on essayait de me défendre !
BELCREDI. – Mais c’était pour rire !
HENRI IV. – Regarde mescheveux !
Il lui montre ses cheveux gris sur lanuque.
BELCREDI. – Mais les miens sont grisaussi !
HENRI IV. – Oui, mais avec cettedifférence que les miens ont grisonné ici, comprends-tu ? Cesont les cheveux d’Henri IV ! Et je ne m’en étais pasaperçu ! Je m’en suis aperçu un beau jour, quand j’ai rouvertles yeux, j’en suis resté épouvanté ! J’ai compris tout desuite que ce n’était pas mes cheveux seulement, mais que toutdevait être devenu gris, que tout avait croulé, que tout étaitfini, et que je serais arrivé avec une faim de loup à un banquetdéjà desservi.
BELCREDI. – Naturellement, les autres…
HENRI IV, promptement. – Je lesais bien, les autres ne pouvaient attendre ma guérison, surtoutceux qui, derrière moi, avaient éperonné jusqu’au sang le chevalque je montais…
Di NOLLI, impressionné. – Comment,comment ?
HENRI IV. – Oui, traîtreusement, pour lefaire ruer et me faire tomber !
DONNA MATHILDE, avec horreur. – Maisj’ignorais cela ! Je l’apprends maintenant !
HENRI IV. – Sans doute était-ce aussipour rire !
DONNA MATHILDE. – Mais qui a fait cela ?Qui était derrière notre couple ?
HENRI IV. – Peu importe ! Derrièrenous, il y avait tous ceux qui ont continué à banqueter et qui nem’auraient donné que des restes, marquise, les restes d’unecompassion maigre ou molle, les restes de leur assiette sale, avecquelques arêtes de remords attachées au fond. Merci ! (Setournant brusquement vers le docteur.) Et alors, docteur,voyez si le fait n’est pas vraiment nouveau dans les annales de lafolie ! – j’ai préféré rester fou ! – Je trouvais icitout préparé, tout disposé pour ce délice d’un nouveau genre, ledélice de vivre ma folie, – avec la conscience la plus lucide – etde me venger ainsi de la brutalité d’un caillou qui m’avait dérangéle cerveau ! Ma solitude – la pauvreté et le vide de lasolitude – qui m’apparut quand je rouvris les yeux – j’ai voulu larevêtir tout de suite de toutes les couleurs, de toutes lessplendeurs de ce jour d’un carnaval passé avec vous. (Ilregarde donna Mathilde et puis montre Frida.) Vous, là,marquise, et où vous avez triomphé ! – Obliger tous ceux quise présentaient à moi à continuer du même pas que moi, à suivrecette fameuse mascarade qui fut pour vous, – non pas pour moi – uneplaisanterie d’un jour ! Faire qu’elle devînt à jamais, nonpas une plaisanterie, mais une réalité, la réalité d’une folievéritable : tout n’était que masques ici, et la salle du trôneet mes quatre conseillers secrets, qui, bien entendu, m’onttrahi ! (Il se tourne vers eux.) Je voudrais biensavoir ce que vous avez gagné à révéler que j’étais guéri. – Si jesuis guéri ! On ne va plus avoir besoin de vos services etvous serez congédiés ! – Faire une confidence à quelqu’un…voilà qui est vraiment fou ! – Ah, mais à mon tour de vousaccuser ! – Vous ne savez pas ?
– Ils croyaient pouvoir continuer cetteplaisanterie avec moi, à vos dépens !
Il éclate de rire ; les autres, saufdonna Mathilde, rient aussi, mais d’un rire gêné.
BELCREDI, à Di Nolli. – Tu entends…ce n’est pas mal…
Di NOLLI, aux quatre jeunes gens. –Vous ?
HENRI IV. – Il faut le leurpardonner ! Cet habit (il montre l’habit dont il estrevêtu), cet habit qui pour moi est la caricature évidente etconsciente de cette autre mascarade continuelle dont nous sommes, àtoutes les minutes, les pantins involontaires (il montreBelcredi) quand, sans le savoir, nous nous déguisons en ce quenous imaginons être, – cet habit, leur habit, excusez-les, ils nele confondent pas encore avec leur personne même. (Il se tournede nouveau vers Belcredi.) Tu sais, on en prend facilementl’habitude, et on parcourt une salle de ce genre avec un naturelparfait, comme un héros de tragédie. (Il traverse lasalle.) Regardez, docteur ! – Je me rappelle un prêtre –il était certainement irlandais – admirablement beau. Il dormait ausoleil, un jour de novembre, les bras appuyés au dossier d’un banc,dans un jardin public : plongé dans les délices dorées decette tiédeur qui, pour lui, homme du Nord, devait paraître presqueestivale. On pouvait être sûr qu’à cet instant, il ne se savaitplus prêtre, il ne savait plus où il était. Il rêvait ! À quoirêvait-il ? Qui le sait ? – Un gamin passe ; ilavait arraché une fleur avec toute sa tige. En passant, ilchatouilla le cou de ce prêtre endormi. – Je vis cet homme ouvrirdes yeux rieurs et toute sa bouche s’épanouissait du rire heureuxde son rêve : il avait tout oublié. Mais je puis vous assurerqu’en un clin d’œil, il reprit la raideur exigée par sa robeecclésiastique, et que ses yeux retrouvèrent la gravité que vousavez déjà vue dans les miens ; c’est que les prêtres irlandaisdéfendent le sérieux de leur foi catholique avec le même zèle quej’apporte à défendre les droits sacro-saints de la monarchiehéréditaire. – Je suis guéri, messieurs, parce que je saisparfaitement que je fais le fou dans ce château, et je le faispourtant, dans un calme complet ! – Le malheur, pour vous,c’est que comme le prêtre irlandais vous vivez notre folie dansl’agitation et l’inquiétude, sans la connaître, sans même lavoir.
BELCREDI. – Nous allons conclure que noussommes fous… c’est nous, maintenant, qui sommes les fous !
HENRI IV, éclatant, mais cherchant àse contenir. – Mais si vous n’aviez pas été fous, toi et elleaussi (il montre la marquise) seriez-vous venus chezmoi ?
BELCREDI. – À te dire le vrai, j’y suis venuen croyant que le fou c’était toi.
HENRI IV, promptement, avec force,montrant la marquise. – Et elle ?
BELCREDI. – Ah ! elle, je ne sais pas…Elle a l’air pétrifié par tout ce que tu dis… ensorcelé par tafolie « consciente » ! (Il se tourne verselle.) Habillée comme vous l’êtes, marquise, vous pourriezdemeurer ici pour la vivre, cette folie…
DONNA MATHILDE. – Vous êtes uninsolent !
HENRI IV, conciliant. – Non,marquise, il dit que le prodige – ce qui est à ses yeux est unprodige – serait accompli, si vous restiez ici, – en marquise deToscane. Et vous savez bien que vous ne pourriez être mon amie, quevous pourriez tout au plus m’accorder, comme à Canossa, un peu depitié…
BELCREDI. – Un peu, tu peux direbeaucoup ! Elle l’a avoué.
HENRI IV, à la marquise,continuant. – Et même, admettons-le, un peu de remords…
BELCREDI. – Du remords aussi ! Elle l’aavoué également.
DONNA MATHILDE, éclatant. – Ne voustairez-vous pas !
HENRI IV, l’apaisant. – Nefaites pas attention à ce qu’il dit ! N’y faites pasattention ! Il continue ses provocations. Et pourtant ledocteur l’a averti de ne pas me provoquer. (Se tournant versBelcredi.) Mais pourquoi veux-tu que je sois encore troublépar ce qui est advenu entre nous ; par le rôle que tu as jouédans mes malheurs avec elle ? (Il montre la marquise, setourne vers elle, lui montrant Belcredi.) Par le rôle qu’iljoue dans votre vie ! Ma vie est ici ! Ce n’est pas lavôtre ! – Votre vie qui vous a conduite à la vieillesse, moije ne l’ai pas vécue ! – (À donna Mathilde.) C’étaitcela que vous vouliez me dire, me démontrer par votre sacrifice, envous habillant comme vous l’avez fait, sur le conseil dudocteur ? Oh, c’était très bien conçu, je vous l’ai déjà dit,docteur : – « Ceux que nous étions alors, et ceux quenous sommes aujourd’hui. » Mais je ne suis pas un fou selonles règles, docteur ! Je sais bien que celui-ci (il montredi Nolli) ne peut pas être moi, puisque je suis moi-mêmeHenri IV depuis vingt ans, ici, comprenez-vous ? Immobilesous ce masque éternel ! Ces vingt ans (il montre lamarquise) elle les a vécus ; elle en a joui pour devenir– regardez-la – méconnaissable à mes yeux : je ne puis plus lareconnaître, car je la vois toujours ainsi (il montre Frida ets’approche d’elle.) – Pour moi, elle est toujours ainsi… Vousme faites l’effet d’enfants que je pourrais épouvanter. (ÀFrida.) Et toi, tu t’es vraiment épouvantée, mon enfant, decette plaisanterie qu’on t’avait persuadée de faire, sanscomprendre que, pour moi, elle ne pouvait pas être la plaisanteriequ’ils croyaient, mais ce terrible prodige : mon rêve qui viten toi plus que jamais ! Tu étais une image pendue aumur ; ils ont fait de toi un être vivant – tu es à moi !tu es à moi ! à moi de droit ! (Il la saisit dans sesbras en riant comme un fou ; tous crient affolés, mais quandils accourent pour arracher Frida de ses bras, il devient terribleet crie aux quatre jeunes gens :) Retenez-les !Retenez-les ! Je vous ordonne de les retenir !
Les quatre jeunes gens, étourdis, commesous l’effet d’un sortilège, essaient, avec des gestes mécaniques,de retenir di Nolli, le docteur et Belcredi.
BELCREDI, se libérant et se précipitantsur Henri IV. – Laisse-la ! laisse-la ! Tu n’espas fou !
HENRI IV, d’un geste d’une rapiditéfoudroyante, tirant l’épée de Landolf, qui est à côté de lui.– Je ne suis pas fou ? Voilà pour toi !
Il le blesse au ventre. Hurlements dedouleur. On accourt pour soutenir Belcredi. Cris confus.
DI NOLLI. – Tu es blessé ?
BERTHOLD. – Il est blessé ! Il estblessé !
LE DOCTEUR. – Je vous avaisprévenus !
FRIDA. – Oh ! mon Dieu !
DI NOLLI. – Frida, viens ici !
DONNA MATHILDE. – Il est fou ! Il estfou !
DI NOLLI. – Tenez-le bien !
BELCREDI, pendant qu’on le transporte dansla pièce à côté, par la porte de gauche, protestefarouchement. – Non, tu n’es pas fou ! Il n’est pasfou ! Il n’est pas fou !
Sortie générale par la porte à gauche.Cris confus qui se prolongent dans la pièce à côté. Tout à coup, uncri plus aigu de donna Mathilde domine le tumulte, suivi d’unsilence.
HENRI IV, qui est resté sur la scène,entre Landolf, Ariald et Ordulf, les yeux fixes, accablé par la viequi est née de sa fiction et qui, en un instant, l’a poussé aucrime.
– Maintenant oui… par forme… (Il lesrassemble autour de lui, comme pour être protégé.) Tous venezprès de moi, nous allons demeurer ici ensemble, ensemble ici, etpour toujours…
Rideau.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 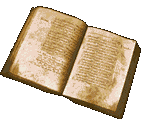
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot