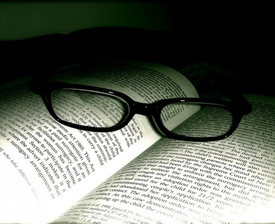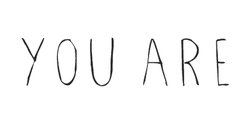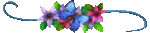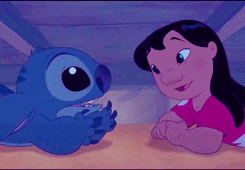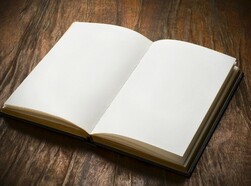-
Le Papillon
Hans Christian Andersen
(1805-1875)


Télécharger « Hans Christian Andersen Le papillon.mp3 »
Le papillon veut se marier et, comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C'est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée ils demandent :
- M'aime-t-il ou m'aime-t-elle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ? La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l'interroge :
- Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là.
La marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu'il l'avait appelée dame, alors qu'elle était encore demoiselle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il renouvela deux fois sa question, et, lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était aux premiers jours du printemps. Les crocus et les perce-neige fleurissaient à l'entour.
- Jolies, charmantes fleurettes ! dit le papillon, mais elles ont encore un peu trop la tournure de pensionnaires. Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui.
Il s'envola vers les anémones ; il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales. La fleur de tilleul était trop petite et, de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose, mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain, et tombait au premier souffle du vent; un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des pois lui plut entre toutes ; elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse ; elle a beaucoup de distinction et, en même temps, elle est bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande, lorsqu'il aperçut près d'elle une cosse à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée :
- Qu'est-ce cela ? fit-il.
- C'est ma sœur, répondit Fleur des Pois.
- Vraiment, et vous serez un jour comme cela ! s'écria le papillon qui s'enfuit.
Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d'une haie ; il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune.
- A coup sûr, pensa le papillon, il était impossible d'aimer cela.
Le printemps passa, et l'été après le printemps. On était à l'automne, et le papillon n'avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs robes les plus éclatantes ; en vain, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse. C'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes; et il y en avait fort peu, il faut l'avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu'elle est fleur tout entière, tant elle est parfumée de la tête au pied ; chacune de ses feuilles vaut une fleur, pour les senteurs qu'elle répand dans l'air. «C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon ; je l'épouse. » Et il fit sa déclaration.
La menthe demeura silencieuse et guindée, en l'écoutant. A la fin elle dit :
- Je vous offre mon amitié, s'il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille, et vous n'êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre ; mais quant à nous marier ... sachons à notre âge éviter le ridicule.
C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c'est une mauvaise méthode. Il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon.
L'automne touchait à sa fin ; le temps était sombre, et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules au point de les faire craquer. Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là ; aussi le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile, une chambre bien chauffée où régnait la température de l'été. Il y eût pu vivre assez bien, mais il se dit : « Ce n'est pas tout de vivre ; encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. » Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l'aperçut, on l'admira, on le captura et on le ficha dans la boîte aux curiosités. « Me voici sur une tige comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement, ce n'est pas très agréable ; mais enfin on est casé : cela ressemble au mariage. » Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée. «C'est une pauvre consolation », murmurèrent railleusement quelques plantes qui étaient là dans des pots pour égayer la chambre. « Il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leurs pots, se dit le papillon ; elles sont trop à leur aise pour être humaines. » votre commentaire
votre commentaire
-
La Belle au Bois dormant
Jacob et Wilhelm Grimm
(1785-1863 et 1786-1859)


Télécharger « Jacob et Wilhelm Grimm La Belle au bois dormant.mp3 »
Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour ils se disaient :
- Ah ! si seulement nous avions un enfant.
Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit:
- Ton voeu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde.
Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume. Mais, comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux : l'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde.
Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix :
- La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte.
Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son voeu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit :
- Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années dans lequel sera plongée la fille du roi.
Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adorée du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient.
Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lin avec application, était assise dans une petite chambre.
- Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là ?
- Je file, dit la vieille en branlant la tête.
- Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement, demanda la jeune fille.
Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit : elle se piqua au doigt.
À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la Cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château.
Tout autour du palais, une hale d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vît plus rien, même pas le drapeau sur le toit.
Dans le pays, la légende de la Belle au Bois Dormant - c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, - se répandait. De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles, comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés, sans pouvoir se détacher et mouraient là, d'une mort cruelle.
Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait, depuis cent ans, la merveilleuse fille d'un roi, appelée la Belle au Bois Dormant. Avec elle, dormaient le roi, la reine et toute la Cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus qui avaient tenté de forcer la hale d'épines ; mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors :
- Je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la Belle au Bois Dormant.
Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas.
Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la Belle au Bois Dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier, dans la cuisine, avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marmiton et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la Belle.
Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la Belle au Bois Dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant.
Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour, et la reine, et toute la Cour. Et tout le monde se regardait avec de grand yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches, sur les murs, reprirent leur mouvement ; dans la cuisine, le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se remit à rissoler ; le cuisinier donna une gifle au marmiton, si fort que celui-ci en cria, et la bonne acheva de plumer la poule.
Le mariage du prince et de la Belle au Bois Dormant fut célébré avec un faste exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. votre commentaire
votre commentaire
-
Blanche-Neige et Rouge-Rose
Jacob et Wilhelm Grimm
(1785-1863 et 1786-1859)

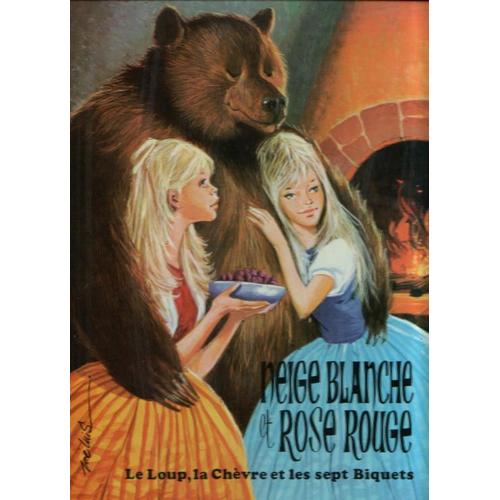
Télécharger « Grimm Frères Blanche Neige et Rougerose.mp3 »
Une pauvre veuve vivait dans une chaumière isolée; dans le jardin qui était devant la porte, il y avait deux rosiers, dont l'un portait des roses blanches et l'autre des roses rouges. La veuve avait deux filles qui ressemblaient aux deux rosiers; l'une se nommait Blancheneige et l'autre Rougerose. C'étaient les deux enfants les plus pieux, les plus obéissants et les plus laborieux que le monde eût jamais vus; mais Blancheneige était d'un caractère plus tranquille et plus doux. Rougerose courait plus volontiers dans les prés et dans les champs, à la recherche des fleurs et des papillons. Blancheneige restait à la maison avec sa mère, l'aidait aux travaux du ménage, et lui faisait la lecture quand l'ouvrage était fini. Les deux sœurs s'aimaient tant, qu'elles se tenaient par la main toutes les fois qu'elles sortaient ensemble; et quand Blancheneige disait : « Nous ne nous quitterons jamais, » Rougerose répondait : « Tant que nous vivrons; » et la mère ajoutait : « Tout devra être commun entre vous deux. » Elles allaient souvent seules au bois pour cueillir des fruits sauvages ; les animaux les respectaient et s'approchaient d'elles sans crainte. Le lièvre mangeait dans leur main, le chevreuil paissait à leurs côtés, le cerf folâtrait devant elles, et les oiseaux perchés sur les branches voisines chantaient leurs plus jolies chansons. Jamais il ne leur arrivait rien de fâcheux : si la nuit les surprenait dans le bois, elles se couchaient sur la mousse l'une près de l'autre et dormaient jusqu'au lendemain, sans que leur mère eût aucune inquiétude.
Une fois qu'elles avaient passé la nuit dans le bois, quand l'aurore les réveilla, elles virent près d'elles un bel enfant vêtu d'une robe d'un blanc éclatant; il attachait sur elles un regard amical, mais il disparut dans le bois sans dire un mot. Elles s'aperçurent alors qu'elles s'étaient couchées tout près d'un précipice, et qu'elles seraient tombées si elles avaient fait seulement deux pas de plus dans les ténèbres. Leur mère leur dit que cet enfant était sans doute l'ange gardien des bonnes petites filles.
Blancheneige et Rougerose tenaient la cabane de leur mère si propre qu'on aurait pu se mirer dedans. En été, Rougerose avait soin du ménage, et chaque matin sa mère trouvait à son réveil un bouquet dans lequel il y avait une fleur de chacun des deux rosiers. En hiver, Blancheneige allumait le feu et accrochait la marmite à la crémaillère, et la marmite était en cuivre jaune qui brillait comme de l'or, tant elle était bien écurée. Le soir, quand la neige tombait, la mère disait : « Blancheneige, va mettre le verrou. » Ensuite elles s'asseyaient au coin du feu ; la mère mettait ses lunettes et faisait la lecture dans un grand livre, et les deux petites écoutaient tout en filant leur quenouille. Auprès d'elles était couché un petit agneau, et derrière, une tourterelle dormait sur son perchoir, la tête sous l'aile.
Un soir qu'elles étaient réunies tranquillement, on frappa à la porte. « Rougerose, dit la mère, va vite ouvrir; c'est sans doute quelque voyageur égaré qui cherche un abri pour la nuit. »
Rougerose alla tirer le verrou, et elle s'attendait à voir entrer un pauvre homme, quand un ours passa sa grosse tête noire par la porte entr'ouverte. Rougerose s'enfuit en poussant des cris; l'agneau se mit à bêler, la colombe à voler par toute la chambre, et Blancheneige courut se cacher derrière le lit de sa mère. Mais l'ours leur dit: « Ne craignez rien; je ne vous ferai pas de mal. Je vous demande seulement la permission de me chauffer un peu, car je suis à moitié gelé.
— Approche-toi du feu, pauvre ours, répondit la mère ; prends garde seulement de brûler ta fourrure. »
Puis elle appela : « Blancheneige, Rougerose, revenez ; l'ours ne vous fera pas de mal, il n'a que de bonnes intentions. »
Elles revinrent toutes deux, et peu à peu l'agneau et la tourterelle s'approchèrent aussi et oublièrent leur frayeur.
L'ours dit : « Enfants, secouez un peu la neige qui est sur mon dos ! »
Elles prirent le balai et lui nettoyèrent toute la peau ; puis il s'étendit devant le feu en faisant des grognements d'aise et de satisfaction. Elles ne tardèrent pas à se rassurer tout à fait et même à jouer avec cet hôte inattendu. Elles lui tiraient le poil; elles lui montaient sur le dos, le roulaient dans la chambre, lui donnaient de petits coups de baguette, et, quand il grognait, elles éclataient de rire. L'ours se laissait faire ; seulement, quand le jeu allait trop loin, il leur disait : « Laissez-moi vivre ; ne tuez pas votre prétendu. »
Quand on alla se coucher, la mère lui dit: « Reste là, passe la nuit devant le feu ; au moins tu seras à l'abri du froid et du mauvais temps. »
Dès l'aurore, les petites filles lui ouvrirent la porte, et il s'en alla dans le bois en trottant sur la neige. A partir de ce jour, il revint chaque soir à la même heure ; il s'étendait devant le feu et les enfants jouaient avec lui tant qu'elles voulaient. On était tellement accoutumé à sa présence qu'on ne mettait pas le verrou à la porte avant qu'il fût arrivé.
Quand le printemps fut de retour et que tout fut vert au dehors, l'ours dit un matin à Blancheneige : « Je m'en vais et je ne reviendrai pas de l'été.
— Où vas-tu donc, cher ours? demanda blanche-neige.
— Je vais dans le bois; il faut que je garde mes trésors contre les méchants nains. L'hiver, quand la terre est gelée, ils sont forcés de rester dans leurs trous sans pouvoir se frayer un passage; mais à présent que le soleil a réchauffé la terre, ils vont sortir pour aller à la maraude. Ce qu'ils ont pris et caché dans leurs trous ne revient pas aisément à la lumière! »
Blancheneige était toute triste du départ de l'ours. Quand elle lui ouvrit la porte, il s'écorcha un peu en passant contre le loquet; elle crut avoir vu briller de l'or sous sa peau, mais elle n'en était pas bien sûre. L'ours partit au plus vite, et disparut bientôt derrière les arbres.
Quelque temps après, la mère ayant envoyé ses filles ramasser du bois mort dans la forêt, elles virent un grand arbre abattu, et quelque chose qui s'agitait çà et là dans l'herbe près du tronc, sans qu'on pût bien distinguer ce que c'était. En approchant, elles reconnurent que c'était un petit nain au visage vieux et ridé, avec une barbe blanche longue d'une aune. La barbe était prise dans une fente de l'arbre, et le nain sautillait comme un jeune chien après une ficelle, sans pouvoir la dégager. Il fixa des yeux ardents sur les deux petites et leur cria : « Que faites-vous là plantées, plutôt que de venir à mon secours?
— Pauvre petit homme, demanda Rougerose, comment t'es-tu ainsi pris au piège?
— Sotte curieuse, répliqua le nain, je voulais fendre cet arbre afin d'avoir du petit bois en éclats pour ma cuisine; car nos plats sont mignons et les grosses bûches les brûleraient; nous ne nous crevons pas de mangeaille comme votre engeance grossière et goulue. J'avais donc déjà introduit mon coin dans le bois, mais ce maudit coin était trop glissant; il a sauté au moment où je m'y attendais le moins, et le tronc s'est refermé si vite que je n'ai pas eu le temps de retirer ma belle barbe blanche; maintenant elle est prise et je ne peux plus la ravoir. Les voilà qui se mettent à rire, les niaises figures de crème! Fi! que vous êtes laides ! »
Les enfants eurent beau se donner du mal, elles ne purent dégager la barbe, qui tenait comme dans un étau. « Je cours chercher du monde, dit Rougerose.
— Appeler du monde ! s'écria le nain de sa voix rauque ; vous êtes déjà trop de vous deux, imbéciles bourriques!
— Un peu de patience, dit Blancheneige, nous allons vous tirer d'affaire. »
Et, sortant de sa poche ses petits ciseaux, elle coupa le bout de la barbe. Dès que le nain fut libre, il alla prendre un sac plein d'or qui était caché dans les racines de l'arbre,en murmurant: « Grossières créatures que ces enfants! couper un bout de ma barbe magnifique! Que le diable vous récompense! » Puis il mit le sac sur son dos, et s'en alla sans seulement les regarder.
A quelques mois de là, les deux sœurs allèrent un jour pêcher un plat de poisson. En approchant de la rivière, elles aperçurent une espèce de grosse sauterelle qui sautait au bord de l'eau comme si elle avait voulu s'y jeter. Elles accoururent et reconnurent le nain. «Qu'as-tu donc? dit Rougerose; est-ce que tu veux te jeter à l'eau?
— Pas si bête, s'écria le nain ; ne voyez-vous pas que c'est ce maudit poisson qui veut m'entraîner. »
Il avait jeté sa ligne ; mais malheureusement le vent avait mêlé sa barbe avec le fil, et, quelques instants après, quand un gros poisson vint mordre à l'appât, les forces de la faible créature ne suffirent pas à le tirer de l'eau; le poisson avait le dessus et attirait à lui le nain. Il avait beau se retenir aux joncs et aux herbes de la rive, le poisson l'entraînait et il était en danger de tomber à l'eau. Les petites arrivèrent à temps pour le retenir, et elles essayèrent de dégager sa barbe, mais ce fut en vain, tant elle était mêlée avec le fil. Il fallut encore avoir recours aux ciseaux et en couper un tout petit bout. Dès que le nain s'en aperçut, il s'écria avec colère : « Est-ce votre habitude, sottes brutes, de défigurer ainsi les gens? Ce n'est pas assez de m'avoir écourté la barbe une première fois, il faut aujourd'hui que vous m'en coupiez la moitié; je n'oserai plus me montrer à mes frères. Puissiez-vous courir sans souliers et vous écorcher les pieds! » Et, prenant un sac de perles qui était caché dans les roseaux, il le traîna après lui, sans ajouter un seul mot, et disparut aussitôt derrière une pierre.
Peu de temps après, la mère envoya ses filles à la ville pour acheter du fil, des aiguilles et des rubans. Il leur fallait passer par une lande parsemée de gros rochers. Elles aperçurent un grand oiseau qui planait en l'air, et qui, après avoir longtemps tourné au-dessus de leurs têtes, tout en descendant peu à peu, finit par fondre brusquement sur le sol. En même temps, on entendit des cris perçants et lamentables. Elles accoururent et virent avec effroi un aigle qui tenait dans ses serres leur vieille connaissance le nain, et qui cherchait à l'enlever. Les petites filles, dans, la bonté de leur cœur, retinrent le nain de toutes leurs forces et se débattirent si bien contre l'aigle qu'il finit par lâcher sa proie ; mais, quand le nain fut un peu remis de sa frayeur, il leur cria de sa voix glapissante : « Ne pouviez-vous pas vous y prendre un peu moins rudement? Vous avez si bien tiré sur ma pauvre robe qu'elle est maintenant en lambeaux, petites rustres maladroites que vous êtes ! » Puis il prit son sac plein de pierres précieuses et se glissa dans son trou au milieu des rochers. Les petites étaient accoutumées à son ingratitude : elles se remirent en chemin et allèrent faire leurs emplettes à la ville. En repassant par la lande à leur retour, elles surprirent le nain qui avait vidé devant lui son sac de pierres précieuses, ne songeant pas que personne dût passer par là si tard. Le soleil couchant éclairait les pierreries, qui lançaient des feux si merveilleux que les petites s'arrêtèrent immobiles à les considérer. « Pourquoi restez-vous là à bayer aux corneilles? » leur dit-il ; et son visage, ordinairement gris, était rouge de colère. Il allait continuer ses injures quand on entendit un grognement terrible, et un ours noir sortit du bois. Le nain, plein d'effroi, voulut fuir, mais il n'eut pas le temps de regagner sa cachette : l'ours lui barra le chemin. Alors, il le supplia avec un accent désespéré : « Cher seigneur ours, épargnez-moi et je vous donnerai tous mes trésors, tous ces joyaux que vous voyez devant vous. Accordez-moi la vie : que gagneriez-vous à tuer un misérable nain comme moi? Vous ne me sentiriez pas sous vos dents. Prenez plutôt ces deux maudites petites filles ; ce sont deux bons morceaux, gras comme des cailles; croquez-les, au nom de Dieu. » Mais l'ours, sans l'écouter, donna à cette méchante créature un seul coup de patte qui l'étendit raide mort.
Les petites s'étaient sauvées; mais l'ours leur cria: « Blancheneige, Rougerose, n'ayez pas peur; attendez-moi. »
Elles reconnurent sa voix et s'arrêtèrent, et, quand il fut près d'elles, sa peau d'ours tomba tout à coup et elles virent un beau jeune homme, tout revêtu d'habits dorés. « Je suis prince, leur dit-il; cet infâme nain m'avait changé en ours, après m'avoir volé mes trésors; il m'avait condamné à courir les bois sous cette forme, et je ne pouvais être délivré que par sa mort. Maintenant il a reçu le prix de sa méchanceté. »
Blancheneige épousa le prince et Rougerose épousa son frère; ils partagèrent entre eux les grands trésors que le nain avait amassés dans son trou. La vieille mère vécut encore de longues années, tranquille et heureuse près de ses enfants. Elle prit les deux rosiers et les plaça sur sa fenêtre ; ils portaient chaque été les plus belles roses, blanches et rouges. votre commentaire
votre commentaire
-
L'Ondine de l'étang
Jacob et Wilhelm Grimm
(1785-1863 et 1786-1859)


Télécharger « Grimm Frères L'ondine de l'étang.mp3 »
L'ondine de l'étan Format imprimable Format imprimable
Il y avait une fois un meunier qui vivait heureusement avec sa femme. Ils avaient de l'argent et du bien, et leur prospérité croissait d'année en année. Mais le malheur, dit le proverbe, vient pendant la nuit; leur fortune diminua d'année en année, comme elle s'était accrue, et à la fin le meunier eut à peine le droit d'appeler sa propriété le moulin qu'il occupait. Il était fort affligé, et, quand il se couchait le soir après son travail, il ne goûtait plus de repos, mais s'agitait tout soucieux dans son lit. Un matin, il se leva avant l'aube du jour et sortit pour prendre l'air, imaginant qu'il se sentirait le cœur soulagé. Comme il passait près de l'écluse de son moulin, le premier rayon du soleil commençait à poindre, et il entendit un peu de bruit dans l'étang. Il se retourna, et aperçut une belle femme qui s'élevait lentement du milieu de l'eau. Ses longs cheveux, qu'elle avait ramenés de ses mains délicates sur ses épaules, descendaient des deux côtés et couvraient son corps d'une éclatante blancheur. Il vit bien que c'était l'ondine de l'étang, et, tout effrayé, il ne savait s'il devait rester ou s'enfuir. Mais l'ondine fit entendre sa douce voix, l'appela par son nom et lui demanda pourquoi il était si triste. Le meunier resta muet d'abord; mais, l'entendant parler si gracieusement, il prit courage et lui raconta qu'il avait jadis vécu dans le bonheur et la richesse, mais qu'il était maintenant si pauvre qu'il ne savait plus que faire.
« Sois tranquille, répondit l'ondine, je te rendrai plus riche et plus heureux que tu ne l'as jamais été; seulement il faut que tu me promettes de me donner ce qui vient de naître dans ta maison.
— C'est quelque jeune chien ou un jeune chat sans doute, » se dit tout bas le meunier. Et il lui promit ce qu'elle demandait.
L'ondine se replongea dans l'eau, et il retourna bien vite, consolé et tout joyeux, à son moulin. Il n'y était pas arrivé encore, que la servante sortit de la maison et lui cria qu'il n'avait qu'à se réjouir, que sa femme venait de lui donner un garçon. Le meunier demeura comme frappé du tonnerre : il vit bien que la malicieuse ondine avait su ce qui se passait et l'avait trompé. La tête basse, il s'approcha du lit de sa femme, et, quand elle lui demanda : « Pourquoi ne te réjouis-tu pas de la venue de notre beau garçon? » Il lui raconta ce qui lui était arrivé et la promesse qu'il avait faite à l'ondine. « A quoi me sert la prospérité et la richesse, ajouta-t-il, si je dois perdre mon enfant? » Mais que faire? Les parents eux-mêmes, qui étaient accourus pour le féliciter, n'y voyaient nul remède.
Cependant le bonheur rentra dans la maison du meunier. Ce qu'il entreprenait réussissait toujours; il semblait que les caisses et les coffres se remplissaient tout seuls, et que l'argent se multipliait dans l'armoire pendant la nuit. Au bout de peu de temps, il se trouva plus riche que jamais. Mais il ne pouvait pas s'en réjouir tranquillement : la promesse qu'il avait faite à l'ondine lui déchirait le cœur. Chaque fois qu'il passait près de l'étang il craignait de la voir monter à la surface et lui rappeler sa dette. Il ne laissait pas l'enfant s'avancer près de l'eau. « Prends garde, lui disait-il ; si tu y touches jamais, il en sortira une main qui te saisira et t'entraînera au fond. » Cependant comme les années s'écoulaient l'une après l'autre et que l'ondine ne reparaissait pus, le meunier commença à se tranquilliser.
L'enfant avait grandi, était devenu jeune homme, et on le plaça à l'école d'un chasseur. Quand il eut pris ses leçons et fut devenu lui-même un chasseur habile, le seigneur du village le fit entrer à son service. Il y avait dans le village une belle et honnête jeune fille qui plut au chasseur, et quand son maître s'en fut aperçu, il lui fit présent d'une petite maison : ils célébrèrent leurs noces et vécurent heureux et tranquilles, s'aimant de tout leur cœur.
Un jour, le chasseur poursuivait un chevreuil. L'animal ayant débouché de la forêt dans la plaine, il le suivit, et d'un coup de feu retendit enfin par terre. Il ne remarqua point qu'il se trouvait tout près du dangereux étang, et, quand il eut vidé l'animal, il vint laver dans l'eau ses mains toutes tachées de sang. Mais à peine les avait-il plongées que l'ondine sortit du fond, l'enlaça en souriant dans ses bras humides et l'entraîna si vite que le flot se referma sur lui en jaillissant.
Quand le soir fut venu et que le chasseur ne rentra pas chez lui, sa femme entra dans une grande inquiétude. Elle sortit pour le chercher, et, comme il lui avait souvent raconté qu'il était obligé de se tenir en garde contre les embûches de l'ondine de l'étang et qu'il n'osait se hasarder dans le voisinage de l'eau, elle eut le soupçon de ce qui était arrivé. Elle courut à l'étang, et, quand elle vit près du bord sa gibecière, elle ne put plus douter de son malheur. Se lamentant et se tordant les mains, elle appela son bien-aimé par son nom, mais inutilement; elle courut de l'autre côté de la rive, l'appela de nouveau, adressa à l'ondine les plus violentes injures, mais on ne lui fit aucune réponse. Le miroir de l'eau restait tranquille, et la face à demi pleine de la lune la regardait sans faire un mouvement.
La pauvre femme ne quittait point l'étang. D'un pas précipité, sans prendre de repos, elle en faisait et en refaisait le tour, tantôt en silence, tantôt en poussant de grands cris, tantôt en murmurant à voix basse. Enfin ses forces furent épuisées, elle s'affaissa sur la terre et tomba dans un profond sommeil. Bientôt elle eut un rêve.
Elle montait tout inquiète entre deux grandes masses de roches; les épines et les ronces piquaient ses pieds, la pluie battait son visage et le vent agitait ses longs cheveux. Quand elle eut atteint le sommet de la montagne, un aspect tout différent s'offrit à elle. Le ciel était bleu, l'air tiède, la terre s'abaissait par une pente douce, et au milieu d'une prairie verdoyante et tout émaillée de fleurs était une jolie cabane. Elle s'en approcha et ouvrit la porte; au dedans était assise une vieille en cheveux blancs qui lui fit un signe gracieux. Au même instant la pauvre femme s'éveilla. Le jour était déjà levé, et elle se décida à faire aussitôt ce que lui conseillait son rêve. Elle gravit péniblement la montagne, et elle trouva tout semblable à ce qu'elle avait vu dans la nuit.
La vieille la reçut gracieusement et lui indiqua un siège où elle l'invitait à s'asseoir. « Sans doute tu as éprouvé quelque malheur, dit-elle, puisque tu viens visiter ma cabane solitaire. »
La femme lui raconta, tout en pleurant, ce qui lui était arrivé. « Console-toi, lui dit la vieille, je viendrai à ton secours : voici un peigne d'or. Attends jusqu'à la pleine lune, puis rends-toi près de l'étang, assieds-toi sur le bord, et passe ce peigne sur tes longs cheveux noirs. Quand tu auras fini, dépose-le sur le bord, et tu verras ce qui arrivera alors. »
La femme revint, mais le temps lui dura beaucoup jusqu'à la pleine lune. Enfin le disque arrondi brilla dans le ciel, alors elle se rendit près de l'étang, s'assit et passa le peigne d'or dans ses longs cheveux noirs; et quand elle eut fini, elle s'assit au bord de l'eau. Bientôt après, le fond vint à bouillonner, une vague s'éleva, roula vers le bord et entraîna le peigne avec elle. Le peigne n'avait eu que le temps de toucher le fond, quand le miroir de l'eau se partagea : la tête du chasseur monta à la surface. Il ne parla point, mais regarda sa femme d'un œil triste. Au même instant, une seconde femme vint avec bruit et couvrit la tête du chasseur. Tout avait disparu, l'étang était tranquille comme auparavant, et la face de la lune y brillait.
La femme revint désespérée, mais un rêve lui montra la cabane de la vieille. Le matin suivant elle se mit en route et conta sa peine à la bonne fée. La vieille lui donna une flûte d'or et lui dit : « Attends jusqu'au retour de la pleine lune; puis prends cette flûte, place-toi sur le bord, joue sur l'instrument un petit air, et, quand tu auras fini, dépose-la sur le sable, tu verras ce qui se passera alors. »
La femme fit ce que lui avait dit la vieille. A peine avait-elle déposé la flûte sur le sable, que le fond de l'eau vint à bouillonner; une vague s'éleva, s'avança vers le bord et entraîna la flûte avec elle, bientôt après l'eau s'entr'ouvrit,et non-seulement la tête du chasseur, mais lui-même jusqu'à la moitié du corps monta à la surface. Plein de désir il étendit ses bras vers elle, mais une seconde vague vint avec bruit, le couvrit et l'entraîna au fond. « Ah! dit la malheureuse, que me sert de voir mon bien-aimé pour le perdre encore? »
La tristesse remplit de nouveau son cœur, mais le rêve lui indiqua une troisième fois la maison de la vieille. Elle se mit en route, et la fée lui donna un rouet d'or, la consola et lui dit : « Tout n'est pas fini encore; attends jusqu'à ce que vienne la pleine lune, puis prends le rouet, place-toi au bord, et file jusqu'à ce que tu aies rempli ton fuseau ; quand tu auras achevé, place le rouet près de l'eau, et tu verras ce qui se passera alors. »
La femme suivit ce conseil de point en point. Dès que la nouvelle lune se montra, elle porta le rouet d'or au bord de l'eau, et fila diligemment jusqu'à ce que son lin fût épuisé et que le fil eût rempli le fuseau. A peine le rouet fut-il déposé sur le bord, que le fond de l'eau bouillonna plus violemment que jamais ; une forte vague s'avança et emporta le rouet avec elle. Bientôt la tête et le corps tout entier du chasseur montèrent à la surface. Vite il s'élança sur le bord, saisit sa femme par la main et s'enfuit. Mais à peine avaient-ils fait quelques pas, que l'étang tout entier se souleva avec un horrible bouillonnement et se répandit avec une violence irrésistible dans la plaine. Déjà les deux fuyards voyaient la mort devant leurs yeux, quand la femme dans son angoisse appela la vieille à son aide, et en un instant ils furent changés, elle en crapaud, lui en grenouille. Le flot qui les avait atteints ne put les faire périr mais il les sépara et les entraîna très-loin l'un de l'autre.
Quand l'eau se fut retirée et qu'ils eurent remis le pied sur un terrain sec, ils reprirent leur forme humaine. Mais aucun des deux ne savait ce qu'était devenu l'autre; ils se trouvaient parmi des hommes étrangers, qui ne connaissaient pas leur pays. De hautes montagnes et de profondes vallées les séparaient. Pour gagner leur vie, tous deux furent obligés de garder les moutons. Pendant plusieurs années ils conduisirent leurs troupeaux à travers les bois et les champs, accablés de tristesse et de regret.
Une fois, comme le printemps venait de refleurir, tous deux sortirent le même jour avec leurs troupeaux, et le hasard voulut qu'ils marchassent à la rencontre l'un de l'autre. Sur la pente d'une montagne éloignée, le mari aperçut un troupeau et dirigea ses moutons de ce côté. Ils arrivèrent ensemble dans la vallée, mais ne se reconnurent point ; pourtant ils se réjouissaient de n'être plus seuls. Depuis ce temps-là ils faisaient paître chaque jour leurs troupeaux l'un près de l'autre : ils ne se parlaient pas, mais ils se sentaient consolés. Un soir, comme la pleine lune brillait au ciel et que les moutons reposaient déjà, le berger tira sa flûte de son sac et en joua un air gracieux, mais triste. Quand il eut fini, il remarqua que la bergère pleurait amèrement. « Pourquoi pleures-tu? lui demanda-t-il.
— Ah! répondit-elle, c'est ainsi que brillait la pleine lune lorsque je jouai pour la dernière fois cet air sur la flûte, et que la tête de mon bien-aimé parut à la surface de l'eau. »
Il la regarda et ce fut comme si un voile était tombé de ses yeux; il reconnut sa femme bien aimée; et en la regardant, comme la lune brillait sur son visage, elle le reconnut à son tour. Us se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent, et s'ils furent heureux, qu'on ne le demande point. votre commentaire
votre commentaire
-
Nouvelles aventures du brave soldat Chvéîk
de Jaroslav Hasek

Chapitre 1
LA MÉSAVENTURE DE CHVÉÏK DANS LE TRAIN
Dans un compartiment de deuxième classe du rapide Prague-Budeiovitz se trouvaient trois personnes : le lieutenant Lukach ; en face de lui, un vieil homme complètement chauve, et Chvéïk qui se tenait modestement assis près de la portière. Il était, au moment où commence notre récit, entrain de subir un nouvel assaut de la part du lieutenant Lukach qui, sans accorder la moindre attention à la présence du pékin,décernait à Chvéïk mille noms d’oiseaux. Il n’était qu’un nom de dieu d’animal, une sombre brute, etc., etc.
Il ne s’agissait pourtant que d’un incident de peu d’importance, à savoir le nombre de paquets qui avaient été placés sous la garde de Chvéïk et dont l’un d’eux avait disparu.
– On nous a volé une valise, reprochait le lieutenant à Chvéïk, c’est facile à dire, vaurien. C’est tout ce que vous trouvez à répondre pour vous justifier ?
– Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, répondit doucement Chvéïk, qu’on nous a vraiment volé la valise. Dans les gares, il y a toujours de ces filous qui traînent à l’affût d’un mauvais coup à faire. Le misérable a dû profiter du moment où j’avais laissé les paquets pour venir vous faire mon rapport et vous dire que tout était en ordre. Ce sont toujours ces occasions que guettent les voleurs. Il y a deux ans,ils ont volé à une dame, à la gare du Nord-Ouest, une voiture d’enfant, avec une fillette au maillot dedans. Mais ils ont été si gentils qu’ils ont rapporté l’enfant au commissariat de notre rue en déclarant qu’ils venaient de la trouver sur le seuil d’une porte. Alors, les journaux ont fait un bruit de tous les diables en déclarant que cette pauvre femme était une mère dénaturée.
Et Chvéïk déclara solennellement :
– Dans les gares, il y a toujours eu desvols et il y en aura toujours.
– Je crois, Chvéïk, fit le lieutenantLukach, qu’un de ces jours ça va mal finir pour vous. Je me demandesi vous êtes complètement idiot ou si vous vous efforcez de leparaître. Pourriez-vous me dire ce qu’il y avait dans cettevalise ?
– Peu de choses, répondit Chvéïk, sanslever les yeux du crâne chauve du pékin qui, assis en face dulieutenant, ne manifestait apparemment aucun intérêt pour la scèneà laquelle il assistait. Il n’y avait que la glace de votre chambreet le portemanteau de l’antichambre, de sorte que nous ne perdonspas grand’chose, puisque ces deux objets appartenaient à votreancien propriétaire.
Le lieutenant Lukach fit une terrible grimace,mais Chvéïk continua d’une voix aimable :
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je ne savais pas qu’on nous volerait la valise.Quant à ce qui était dedans, j’avais pris la précaution d’avertirle propriétaire que nous ne lui rendrions son bien qu’à notreretour de la guerre. Dans les pays ennemis il y aura autant deglaces et de porte-manteaux que nous pourrons en emporter. Parconséquent, dès que nous aurons pris une ville…
– La ferme ! Chvéïk, l’interrompitle lieutenant avec violence. Vous n’y couperez pas du conseil deguerre un de ces jours. Vous êtes le plus grand imbécile que laterre ait jamais porté. Un autre homme, dut-il vivre mille ans,serait incapable d’accumuler autant d’idioties que vous durant cesquelques semaines. J’espère que vous vous en êtes aperçu ?
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je l’ai remarqué, moi aussi. J’ai, comme on dit, untalent d’observation très développé. Malheureusement, il necommence à m’inspirer que lorsqu’il est déjà trop tard, quand lesennuis sont arrivés. J’ai la guigne, comme un certain Nachleba dela Nekazanka qui avait l’habitude d’aller au cabaret. Il prenaittoujours la résolution de redevenir sérieux. Chaque samedi il sepromettait de changer de vie, et régulièrement, le lendemain, il medéclarait : « et malgré ça, camarade, je me suis aperçuau matin que j’étais couché sur le bat-flanc du poste depolice ». Sans qu’il sache lui-même comment la chose étaitarrivée, il se trouvait qu’il avait démoli une borne ou détaché uncheval de fiacre, ou qu’il avait nettoyé sa pipe avec le plumetd’un chapeau de gendarme. Lorsqu’il nous contait ses ennuis ilétait absolument désespéré, et, ce qui le chagrinait le plus, c’estque cette guigne se transmettait dans sa famille depuis desgénérations. Son grand-père était parti une fois pour le tour…
– Laissez-moi tranquille, Chvéïk, avecvos exemples.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que tout ce que je vous raconte est la pure vérité.Donc son grand-père étant parti…
– Chvéïk, s’emporta le lieutenant, jevous ordonne de vous taire. Je ne veux plus rien entendre de voshistoires stupides. Quand nous serons arrivés à Budeiovitz, je vousréglerai votre compte. Savez-vous, Chvéïk, que je vais vous faireenfermer ?
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que jusqu’à cette minute je n’en savais rien, ditChvéïk doucement. Pour l’excellente raison que vous ne m’en aviezencore rien dit.
Le lieutenant poussa un soupir, tira de sacapote la Bohemiaet se mit à lire les dernières nouvellesannonçant les grandes victoires remportées par l’arméeautrichienne. Comme il était plongé dans la lecture d’un articlequi donnait des détails sur une invention allemande permettant dedétruire les villes ennemies au moyen de bombes lancées par avions,bombes qui explosaient trois fois de suite, il entendit Chvéïkdemander au monsieur chauve :
– Excusez, Votre Grâce, n’êtes-vous pas,je vous prie, Monsieur Purkrabek, le fondé de pouvoir de la BanqueSlavia ?
Comme le monsieur chauve ne répondait pas,Chvéïk se tourna vers le lieutenant.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant – lui dit-il – que j’ai lu une fois, dans un journal,qu’un homme normal devait avoir une moyenne de 60 à 70.000 cheveux,et que les cheveux noirs tombent plus facilement que les autres,comme on peut le constater dans de nombreux cas. Et il poursuivitsans pitié :
– Un étudiant en médecine m’a dit un jourau café, que la chute des cheveux provenait de l’ébranlementnerveux provoqué par les accouchements.
À ce moment-là se produisit un phénomèneétrange. Le monsieur chauve bondit sur Chvéïk en hurlant :
– Fous-moi le camp d’ici, espèce decochon !
Puis, jetant Chvéïk dans le couloir, il revintaussitôt dans le compartiment, où il ménagea au lieutenant unesurprise désagréable en se présentant.
Une légère erreur s’était produite en effet.L’individu chauve n’était pas M. Purkrabek, le fondé depouvoir de la Banque Slavia, mais le général de brigade vonSchwarzburg. Le général était justement en route pour une tournéed’inspection et il se rendait à Budeiovitz.
Il avait l’habitude, lorsqu’il découvrait unléger flottement dans la discipline des casernes qu’il visitait, defaire appeler le commandant de la garnison et de lui tenir lelangage suivant :
– Avez-vous un revolver ?
– Oui, mon général.
– Bien. À votre place, je sais l’emploique j’en ferais, car ce que je vois ici ressemble plus à unepétaudière qu’à une caserne.
Après chacune des tournées d’inspection dugénéral, çà et là, l’un ou l’autre des officiers se faisait sauterla cervelle. Le général von Schwarzburg enregistrait la nouvelleavec satisfaction :
– Parfait ! Parfait !disait-il. Voilà ce qui s’appelle un soldat.
De plus, il avait la manie de déplacer lesofficiers et de les envoyer dans des garnisons perdues.
– Lieutenant, où avez-vous été à l’écoledes Cadets ? demanda-t-il à Lukach.
– À Prague, mon général.
– Que vous a-t-on appris là-bas, si vousne savez même pas qu’un officier est responsable de sonsubordonné ?
Primo : Vous devisez avec votreordonnance comme avec un ami intime, vous lui permettez de parlersans être interrogé.
Secundo : Vous lui permettez d’insultervotre supérieur. Il faut que tout cela se paie. Comment vousappelez-vous, lieutenant ?
– Lukach, mon général.
– Quel est votre régiment ?
– J’ai été…
– L’endroit où vous avez été nem’intéresse pas, il n’en est pas question. Je veux savoir où vousêtes maintenant.
– Au 91e régimentd’infanterie, mon général. On m’a déplacé.
– Déplacé ? On a très bien fait, etcela ne vous fera pas de mal de partir le plus tôt possible pour lefront.
– C’est ce qui vient d’être décidé, mongénéral.
Alors, le général se lança dans uneconférence. Il avait remarqué, disait-il, que, durant ces dernièresannées, les officiers parlaient à leurs subordonnés sur un tonbeaucoup trop familier. Il voyait là le danger de certainespropagandes démocratiques. Or, il est nécessaire, affirmait-il, demaintenir le soldat sous le joug de la discipline. Le soldat doittrembler devant son supérieur. Il doit le craindre. Les officiersdoivent tenir leurs hommes à distance et ne pas tolérer qu’ilsréfléchissent par eux-mêmes. Car c’est en cela, disait-il, queréside l’erreur tragique de ces dernières années.
Autrefois, les hommes craignaient leursofficiers comme la foudre, mais aujourd’hui…
Le général de brigade eut un geste dedécouragement.
– … Aujourd’hui, la plupart des officiersse commettent avec leurs hommes. C’est ce que j’ai vouludire !
Et le général, reprenant son journal, sereplongea dans sa lecture. Blême de rage, le lieutenant Lukachsortit dans le couloir pour régler son compte à Chvéïk.
Il le trouva debout devant la portière. Sonvisage reflétait la satisfaction et le bonheur de l’enfant quivient de s’endormir après s’être longuement abreuvé au sein de samère.
Le lieutenant, d’un geste, montra à Chvéïk uncompartiment vide.
– Chvéïk, dit-il avec solennité, lemoment est enfin venu pour vous de recevoir une paire de claques,comme le monde n’en vit jamais. Pourquoi vous êtes-vous permisd’insulter ce monsieur chauve ? Savez-vous que c’est legénéral von Schwarzburg ?
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant – répondit Chvéïk dont le visage prit une expression demartyr – que jamais je n’ai eu la moindre intention d’insulter quique ce soit. Je ne me serais jamais douté que ce monsieur pût êtrele général von Schwarzburg. Je vous assure qu’il ressembleétrangement à M. Purkrabek, le fondé de pouvoir de la BanqueSlavia. Ce monsieur avait l’habitude de venir chez nous, au café,et une fois, comme il s’était endormi à table, un individu malintentionné écrivit sur son crâne chauve : « Nousnous permettons, conformément à la circulaire 3, ci-jointe, de vousproposer respectueusement la constitution, par une assurance sur lavie, d’une dot et d’un trousseau pour vos enfants. » Bienentendu, tous mes camarades sont partis, et moi je suis resté seulavec le fondé de pouvoir.
Comme j’ai toujours la guigne, lorsqu’il s’estréveillé et qu’il a aperçu son crâne dans la glace, il s’est misdans une colère folle. Il a pensé que c’était moi le coupable. Luiaussi a voulu me donner une paire de claques.
Et cet aussi jaillit des lèvres deChvéïk d’une façon si touchante et si pleine de reproches que lelieutenant laissa retomber sa main.
Chvéïk poursuivit :
– Le général n’aurait pas dû se fâcherpour une erreur aussi insignifiante. D’ailleurs, il devraitréellement avoir de 60.000 à 70.000 cheveux comme il était écritdans l’article où l’on énumérait tout ce qu’un homme normal doitposséder. Je n’aurais jamais osé penser qu’un général de brigadepouvait être chauve. Ce malentendu, qui nous a séparés, ne reposeque sur une erreur tragique qui aurait pu arriver à tout le mondeaussi bien qu’à moi. Il suffit de faire une remarque et qu’un autres’avise de mal la prendre pour que les choses se gâtent tout desuite. Ainsi, Hyvl, le tailleur, nous a raconté, une fois, commentil avait voyagé avec un jambon qu’il avait acheté à Marbourg. Dansle compartiment, il croyait qu’il était le seul tchèque parmi lesvoyageurs. Comme il se mettait, près de Saint-Maurice, à découperle jambon, et que le monsieur qui était en face de lui commençait àjeter dans sa direction des regards envieux, Hyvl, le tailleur,s’est dit tout haut en tchèque : « Tu aimerais bien enbouffer un peu, hein ? » et le monsieur lui répondit dansla même langue : « Naturellement que j’en boufferaisvolontiers, si seulement tu voulais m’en donner. » Et c’estainsi qu’ils se sont partagé le jambon. Voitech Rous, c’est ainsique s’appelait le monsieur…
Le lieutenant Lukach jeta un sombre regard surChvéïk, haussa les épaules, et quitta le compartiment sans dire unmot. Peu après, alors qu’il était de nouveau installé à sonancienne place, le candide visage de Chvéïk apparut à laportière :
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que nous serons dans cinq minutes à Tabor. Il y a cinqminutes d’arrêt. Si vous désirez quelque chose à manger. Il y aquelques années, ils avaient ici…
Le lieutenant bondit dans le couloir, et dit àChvéïk :
– Sachez que si vous voulez m’êtreagréable, vous ne vous montrerez jamais plus devant moi. Je vous aiassez vu. Disparaissez, espèce de sombre idiot !
– Bien. À vos ordres, mon lieutenant.
Chvéïk fit le salut militaire, tournaréglementairement les talons, alla à l’extrémité du couloir où ils’assit dans un coin, à la place réservée au contrôleur. Là, ilentra immédiatement en conversation avec un cheminot :
– Avec votre permission, puis-je vousdemander quelque chose ?
Le cheminot, qui n’avait visiblement pas enviede parler, remua faiblement la tête.
– Un brave homme, poursuivit Chvéïk, uncertain Hoffman avait l’habitude de venir chez moi. Il affirmaitque les sonnettes d’alarme ne servent à rien et que quand bien mêmeon tirerait sur la poignée, il ne se passerait rien du tout. Pourvous dire la vérité, la chose ne m’a jamais beaucoup intéressée,mais puisque j’ai ici sous les yeux une pareille sonnette d’alarme,je voudrais bien savoir à quoi m’en tenir, au cas où j’aurais unjour à m’en servir.
Chvéïk se leva et, en compagnie du cheminot,se dirigea vers la sonnette d’alarme. « En cas dedanger… »
Le cheminot estima qu’il était de son devoird’expliquer à Chvéïk le mécanisme de l’appareil.
– Votre homme avait raison de vous direqu’il fallait tirer sur cette poignée, mais il vous a menti endisant que ça ne fonctionnait pas. Le train s’arrête toujours à cecommandement, car le signal est relié à la locomotive.
Tous deux avaient la main sur la poignée de lasonnette et on ne sut jamais par quel mystère le signal retentit.Toujours est-il que le train stoppa.
Chvéïk et le cheminot ne purent se mettred’accord pour savoir qui avait tiré la sonnette.
Chvéïk affirma que ce ne pouvait être lui, quejamais il n’aurait fait une chose pareille, qu’il n’était plus ungamin, etc.
– Je suis moi-même tout étonné de voirque le train s’est arrêté brusquement – dit-il avec bonhomie. Letrain roulait puis, tout d’un coup, il s’arrête. Croyez-moi, jesuis aussi ennuyé que vous.
Un monsieur d’aspect fort respectable prit leparti du cheminot. Il déclara avoir entendu les termes danslesquels le soldat avait engagé, le premier, la discussion sur lessignaux d’alarme.
Chvéïk, par contre, ne cessait de se frapperla poitrine, d’affirmer sa bonne foi, d’expliquer qu’il n’avaitaucun intérêt à provoquer un retard puisqu’il partait pour laguerre.
– Monsieur le chef de gare éclaircira ça,– dit le contrôleur. Le plus clair de cette histoire, c’est qu’ellevous coûtera vingt couronnes.
Cependant on voyait les voyageurs affoléssortir des wagons. Une femme effrayée, dégringola le remblai et seprécipita avec sa valise dans le champ voisin.
– Cela vaut les vingt couronnes, – ditChvéïk, qui avait gardé un calme absolu. – C’est vraiment pas cher.Une fois, quand sa majesté l’empereur est venue à Jikov, un certainFranta Schnor s’est jeté à genoux devant sa voiture. Alors, lecommissaire de police du quartier a dit en pleurant àM. Schnor qu’il aurait dû choisir une autre rue, qu’il auraitpu choisir le quartier du commissaire Krais par exemple. Et pourfinir on mit ce M. Schnor sous les verrous.
Chvéïk jeta un regard circulaire sur sesauditeurs, puis il ajouta avec satisfaction :
– Bon, maintenant, on peut repartir.C’est très ennuyeux quand les trains ont du retard. Lorsque çaarrive en temps de paix, ça peut encore aller ; mais,lorsqu’on est en guerre, chacun devrait savoir que, dans chaquetrain, il y a des personnalités militaires ; des généraux debrigade, des lieutenants, des ordonnances. À ce moment-là, le pluspetit retard peut être fort grave. Napoléon, pour cinq minutesperdues à Waterloo, a vu toute sa gloire foutue.
Au même instant, le lieutenant Lukach sefrayait un chemin à travers le groupe qui entourait Chvéïk. Ilétait d’une pâleur mortelle. Et sa fureur était telle qu’il ne putémettre qu’un seul mot :
– Chvéïk !
Chvéïk fit le salut militaire etdit :
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, qu’on me rend responsable de l’arrêt du train. Lesplombs que l’administration des chemins de fer fait mettre sur lessignaux d’alarme sont vraiment de drôles de plombs. Il vaut bienmieux ne pas s’en approcher du tout. Sans ça, il vous arrive unmalheur et on vous demande vingt couronnes.
À ce moment le chef de train donna le signaldu départ. Les auditeurs de Chvéïk, l’un après l’autre, rentrèrentdans leur compartiment. Le lieutenant Lukach haussa les épaules etretourna à sa place.
Seuls restèrent dans le couloir, lecontrôleur, le cheminot et le brave soldat Chvéïk, naturellement.Le contrôleur tira de sa poche son carnet et se mit à rédiger lecompte rendu de l’incident. Chvéïk, sans accorder la moindreattention au regard haineux que lui lançait le cheminot, luidemanda :
– Y a-t-il longtemps que vous êtes auchemin de fer ?
Et comme le cheminot ne répondait rien, Chvéïkexpliqua qu’il avait connu dans le temps un certain MlitchkoFrantisko qui habitait à Oujinevch, près de Prague, et qui ayanttiré, lui aussi, le signal d’alarme, en eut une telle frayeur qu’ilperdit pendant quinze jours l’usage de la parole. Il ne put seremettre à parler que deux semaines après, un après-midi où ilétait allé rendre visite à un certain Vanek, jardinier àHostivaje.
– Ça s’est passé, ajouta Chvéïk, en mai1912.
Le cheminot, sans daigner répondre, ouvrit laporte des cabinets et s’y enferma.
Le contrôleur et Chvéïk demeurèrent seuls dansle couloir. Le contrôleur demanda au soldat vingt couronnes, enexpliquant que si Chvéïk ne pouvait pas payer l’amende il seraitdans l’obligation de le faire descendre à Tabor pour l’amenerdevant le chef de gare.
– Bien, dit Chvéïk, qu’à cela ne tienne,j’aime beaucoup causer avec des gens instruits. Ça me fera grandplaisir de faire la connaissance de ce monsieur.
Il tira sa pipe de sa vareuse, l’alluma et,tout en rejetant un lourd nuage de fumée, il ajouta :
– Il y a quelques années, il y avait, àSvitave, comme chef de gare, M. Wagner. Il n’était pascommode. Il passait son temps à brimer ses subordonnés. Mais il enavait surtout après un nommé Yugwirth, qui était aiguilleur ;il l’a tellement persécuté qu’à la fin le pauvre homme s’est jeté àl’eau de désespoir. Mais, avant de se suicider, il avait écrit unelettre au chef de gare pour lui dire qu’après sa mort il serappellerait à lui. Et il a tenu parole. C’est la pure vérité. Cebonhomme de chef était donc assis, une nuit, devant le télégraphelorsque, brusquement, l’appareil se met à sonner. Et le chef prendle message suivant : « Comment vas-tu, salaud ?Signé Yugwirth. » Ça a duré toute la semaine. À la fin, lechef en question se mit à expédier partout des télégrammes ainsiconçus : « Pardonne-moi, Yugwirth. » La nuitsuivante, l’appareil lui transmit cette réponse :« Pends-toi au sémaphore devant le pont. Yugwirth. » Etmonsieur le chef de gare obéit. Pour se venger l’administration aarrêté, le lendemain, le télégraphiste de la station. Vous voyezbien qu’il existe entre le ciel et la terre des choses dont nousn’avons même pas idée.
Comme il achevait son récit, le train entra engare de Tabor. Avant de quitter son compartiment, Chvéïk,accompagné du contrôleur, alla se présenter, ainsi qu’il était deson devoir de le faire, au lieutenant Lukach.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que l’on m’emmène devant le chef de gare.
Le lieutenant Lukach ne répondit pas ; ilétait plongé dans une indifférence complète. Il avait brusquementcompris, qu’au point où en étaient les choses, le mieux était de sedésintéresser de Chvéïk aussi bien que du général chauve, dedemeurer assis tranquillement, puisqu’en arrivant à Budeiovitz, ildevait se présenter à la caserne et partir pour le front. Que luiimportait désormais ce misérable monde et les histoires d’unChvéïk !
Comme le train s’ébranlait, le lieutenantLukach regarda par la portière. Il aperçut son ordonnance sur lequai, discutant avec animation devant le chef de gare. Il étaitentouré d’un groupe de personnes parmi lesquelles se trouvaientquelques employés en uniforme.
Le lieutenant Lukach respira. Il éprouva ungrand soulagement en s’apercevant que son ordonnance était restésur le quai.
Le train s’était éloigné depuis longtempsdéjà, et la foule autour de Chvéïk demeurait aussi dense. Chvéïkjurait qu’il était innocent et il parvint à convaincre sesauditeurs. Une femme déclara :– Voilà comment ils embêtent lessoldats !
La foule l’approuva bruyamment. Un monsieurs’adressa au chef de gare pour lui déclarer qu’il était prêt àpayer les 20 couronnes d’amende pour Chvéïk. Il était convaincu,disait-il, que ce soldat n’était pas coupable.
– Il n’y a qu’à le regarder, dit-il enguise de conclusion, en montrant le visage candide de Chvéïk.
L’ordonnance s’adressa à la foule endéclarant : « Je suis innocent, bravesgens ! »
Un maréchal des logis de la gendarmerie arrêtaun citoyen dans la foule : « Vous répondrez de cesparoles, criait-il. Je vous apprendrai, moi, à exciter les gens endisant : « S’ils traitent les hommes comme ça, personnene peut leur demander de gagner la guerre. »
Le malheureux citoyen ne put que balbutierqu’il n’avait rien voulu dire de séditieux, qu’il était aucontraire un bouclier de la vieille garde.
Le brave homme qui était convaincu del’innocence de Chvéïk, paya l’amende et l’emmena au buffet destroisièmes classes, où il lui offrit un bock. Ayant appris que tousles papiers de Chvéïk, ainsi que son billet, étaient restés entreles mains du lieutenant Lukach, il lui donna généreusement cinqcouronnes pour continuer sa route et lui confia avant de s’enaller :
– Allons, mon cher ami, comme je vousl’ai dit, quand vous serez prisonnier en Russie, donnez le bonjourde ma part au brasseur Zéman de Zdolbounov. Vous avez noté lenom ? Soyez malin et restez le moins possible au front.
– Pour ça, n’ayez pas peur, dit Chvéïk,c’est toujours intéressant de voir du pays sans payer.
Chvéïk resta seul à sa table. Pendant qu’ilcommençait à liquider les cinq couronnes de son bienfaiteur, lesgens qui étaient sur le quai et qui n’avaient vu la scène que deloin, sans avoir entendu les explications de Chvéïk, racontaientqu’on avait arrêté un espion, surpris au moment où ilphotographiait la gare.
Mais une brave femme contredisait cetteversion ; elle avait entendu dire, racontait-elle, qu’ils’agissait d’un dragon qui avait frappé un officier près desw. c. pour femmes parce que cet officier s’était avisé desuivre son amie.
Les gendarmes mirent fin à cette interminablediscussion en chassant la foule du quai. Cependant que Chvéïkcontinuait tranquillement à boire en songeant avec tendresse à sonlieutenant.
– Qu’est-ce qu’il pourra bien fairejusqu’à son arrivée à Budeiovitz sans son ordonnance ? sedemandait-il avec inquiétude.
Avant l’arrivée du train omnibus, le buffetdes troisièmes classes fut envahi par une foule de voyageurs.
La plupart d’entre eux étaient des soldats,appartenant à différents régiments, à diverses nations. La rafalede la guerre les avait arrachés de chez eux, pour les disperserdans les hôpitaux de l’empire qu’ils ne quittaient que pourrepartir sur le front.
Combien parmi eux n’allaient pas tarder àconnaître le suprême honneur militaire ! Au-dessus de leurscadavres, allongés sous six pieds de terre, l’on pourrait voir,dans les tristes paysages de la Galicie Orientale, surmontant lacroix de bois généreusement offerte par leur patrie reconnaissante,le calot autrichien, portant l’anagramme de l’empereurF. J. I. balancé par le vent, trempé par là pluie, uniqueet dernier témoignage du passage de ces hommes sur la terre.
Un vieux corbeau, reconnaissant, continueraità se poser de temps à autre sur leurs tombes, en songeant avecnostalgie à cette époque bienheureuse où la terre entière n’étaitplus qu’une table abondamment garnie de délicieux cadavres d’hommeset de chevaux, où il lui était possible de se nourrir uniquement dece mets succulent qu’est l’œil de l’homme, pareil à ceux quibrillaient jadis sous ce calot.
Un camarade de misère, renvoyé après uneopération qu’il avait subie à l’hôpital militaire, s’assit près deChvéïk ; son uniforme gardait encore la trace de la boue et dusang. Cet homme était comme rapetissé. Il déposa un petit paquetsur la table, tira de sa poche un porte-monnaie déchiré, compta etrecompta son argent, puis il regarda Chvéïk et luidemanda :
– Beszélsz magyarul[1] ?
– Je suis Tchèque, camarade, réponditChveik. Veux-tu boire ?
– Nem ertem, baratom[2].
– Ça ne fait rien, insista Chvéïk enpoussant son verre plein devant le soldat. Tu n’as qu’à boire.
Celui-ci but et remercia :« Köszönöm. » Et il continua à examiner lecontenu de son porte-monnaie. Puis il se leva en poussant unsoupir. Chvéïk comprit que le Magyar aurait bien aimé se faireservir un demi, mais qu’il n’avait plus assez d’argent. C’estpourquoi Chvéïk lui en commanda un. Le Magyar remercia à nouveau etcommença, à l’aide de gestes et de grimaces, à expliquer quelquechose à Chvéïk, en lui montrant sa main blessée, tout en lui disantdans une sorte de langage international : « Pif, paf,pouf ! »
Chvéïk secoua la tête et lui sourit avecsympathie. Le convalescent lui fit savoir encore, en élevant samain gauche à 50 centimètres au-dessus du sol, puis en montranttrois doigts, qu’il avait trois petits enfants.
– Nitch han, nitch han,continua-t-il, voulant dire par là qu’il n’y avait rien à manger àla maison et avec sa manche, il essuya ses yeux mouillés de larmes.Dans sa capote en lambeaux on pouvait voir la déchirure faite parla balle qu’il avait reçue pour le bon plaisir de Sa Majesté le Roide Hongrie.
Après un pareil entretien, il ne restait àChvéïk plus rien des cinq couronnes qu’on lui avait données. Chaqueconsommation éloignait de lui toujours davantage, la possibilitéd’atteindre le but de son voyage.
Et, de nouveau, passa un train à destinationde Budeiovitz. Cependant, Chvéïk demeurait assis et il écoutait leHongrois répéter : « Pif, paf, pouf ! Haromgyermek ! (Trois enfants !) Nintch hamEljen ! »
– Bois, mon gars, bois…, lui ditChvéïk…
À la table voisine, un soldat racontait queles Magyars, lorsque les Tchèques vinrent à Szeged avec le29e régiment d’infanterie, les accueillirent avec lesmains en l’air pour les taquiner.
Cette allusion au passage en masse desTchèques dans les rangs ennemis, bien qu’elle correspondît à laréalité, blessa l’amour-propre du soldat. Les Hongrois, par lasuite, n’hésitèrent pas à suivre l’exemple des Tchèques.
Ce soldat s’assit également à côté de Chvéïket lui raconta comment ils avaient, à Szeged, chargé les Magyars etcomment ils les avaient flanqués hors des bistrots. Ilreconnaissait, toutefois, que les Magyars avaient opposé une viverésistance ; une blessure qu’il avait reçue dans le dos, etpour laquelle on l’avait envoyé à l’hôpital, en témoignait.Maintenant, disait-il, il craignait que, après son retour, lecommandant de son bataillon ne le fît mettre en prison parce qu’iln’avait pas rendu à son adversaire le coup qu’il avait reçu ainsique l’honneur du régiment l’aurait exigé.
– Vos papiers ?
C’est avec ces paroles aimables que lecommandant de la patrouille militaire qui faisait une ronde, abordaChvéïk.
C’était un sergent suivi de quatre soldats,baïonnette au canon, il ajouta, en mauvais tchèque :
– Je vois que vous assis, vous pasvoyager, vous boire, toujours boire.
– Je n’ai pas le moindre papier,milatchkou[3], répondit Chvéïk. M. lieutenantLukach, du 91e régiment les a tous sur lui. Moi je suisresté à la gare.
– Qu’est-ce que cela signifie,milatchkou ? demanda le sergent en s’adressant à l’un de sessoldats, un vieux de la territoriale.
– Milatchkou, en tchèque, ça veut diresergent, répondit celui-ci en souriant.
Le sergent déclara à Chvéïk :
– Tout soldat doit avoir des papiers.Sans papiers, un pouilleux comme toi doit être enfermé au poste dela gare comme un chien enragé.
On amena Chvéïk au poste ; les soldatsétaient assis sur les bancs et ils ressemblaient comme des frèresau vieux territorial qui avait traduit au sergent le mot milatchkou(chéri) avec tant d’à-propos.
Le poste était orné de lithographies que leministère de la guerre avait envoyées dans tous les bureauxmilitaires.
L’une d’elles représentait le brigadier FranzHammel et les sergents Panchard et Buchmayer du 21erégiment impérial et royal, en train d’encourager leurs hommes àtenir. De l’autre côté était suspendu un tableau avec la légendesuivante : « Le brigadier Jan Danko, du 5erégiment de Honved-hussard, examine la position d’une batterieennemie » ; à droite, un peu plus bas, pendait uneaffiche qui avait pour titre : Exemple rared’héroïsme.
C’est avec des affiches de ce genre, quiillustraient des exemples d’héroïsme magnifiques, inventés detoutes pièces dans les chancelleries du ministère de la Guerre, etpar la presse allemande, que la stupide et vieille Autriche voulaitgalvaniser le courage de ses soldats qui ne les lisaient jamais.Lorsqu’on donnait à ces derniers des exemples de ce genre sousforme de livres, au front, ils s’en servaient pour rouler descigarettes ou ils l’utilisaient d’une façon encore plusrationnelle, donnant ainsi aux récits de ces magnifiques exemplesofficiels une destination qui convint à leur valeur et à leuresprit.
Cependant que le sergent allait quérir unofficier, Chvéïk lut sur une affiche :
« La bravoure du soldat Joseph Bong, dutrain des équipages. »
« Les infirmiers étaient en train detransporter des grands blessés dans les fourgons qui stationnaientdans un chemin creux, on les expédia ensuite au poste de secours.Les Russes qui avaient remarqué ces fourgons commencèrent à lesarroser de grenades. Le cheval du soldat Joseph Bong, du3e escadron du train, fut tué par un éclat. Bong selamentait : « Mon pauvre coco, c’en est fait detoi ! » À ce moment précis, il fut lui-même blessé. Ildétela son cheval et tira lui-même le fourgon vers une cachettesûre. Après quoi il s’en retourna pour aller chercher leharnachement. Les Russes continuèrent le feu. « Tireztoujours, mauvais brigands, je n’abandonnerai pas mesharnais ! » s’écria Bong et il continua à déboucler lescourroies. Sa besogne achevée, il traîna le harnachement près dufourgon ; là, il dut subir, à cause de son absence prolongée,une observation de la part de l’infirmier, mais il répondit :« Je n’ai pas voulu laisser le harnachement, il est presqueneuf. J’ai pensé que ce serait dommage. Nous n’en avons pas trop deces choses-là. » Ainsi s’excusait le vaillant guerrier, puis,il partit au poste de secours, et c’est alors seulement qu’ildemanda à être hospitalisé.
« Huit jours plus tard, son commandantépingla sur sa poitrine la médaille du courage enargent ».
Lorsque Chvéïk eut fini de lire, le sergentn’étant toujours pas revenu, il dit aux soldats du quart : –Ça, c’est un bien bel exemple de courage. De cette façon, il n’yaura chez nous, dans l’armée, que des harnachements neufs. Maislorsque j’étais à Prague, j’ai lu dans le Journal officielun exemple d’héroïsme encore plus beau. Il s’agissait de l’aspirantdocteur Joseph Bojnov. Il était en Galicie, au 7ebataillon de chasseurs, et comme il partait à l’assaut à labaïonnette, il reçut une balle. Pendant qu’on le transportait auposte de secours, il ne cessait de crier qu’on n’allait tout demême pas lui faire un pansement pour ce bobo, et il voulait avancerde nouveau avec son escadron. À ce moment-là une grenade lui brisala patte. Et, de nouveau, les infirmiers voulurent l’emporter, maisil commença à ramper vers la tranchée, et c’est avec un bâton qu’ilse défendit contre l’ennemi. Vint une nouvelle grenade qui luiemporta la main qui tenait le bâton. Il saisit le bâton de l’autreen hurlant qu’il ne leur pardonnerait pas ça, et Dieu sait commentça aurait fini si un shrapnell ne l’avait définitivement occis.Sans doute qu’on lui aurait donné la médaille d’argent du courage.Lorsque la grenade lui arracha la tête, il cria encore enmourant : « Mourir pour la patrie, c’est le sort le plusbeau, le plus digne d’envie. »
– Ils n’y vont pas avec le dos de lacuillère, dans les journaux, dit un homme ; un rédacteur commeça doit devenir complètement abruti au bout d’une heure.
Le sergent apparut dans l’embrasure de laporte où il se trémoussa de fureur :
– Dès qu’on quitte cette salle pour troisminutes, hurla-t-il, on n’entend plus que : « Tcheski,Tcheski. »
Avant de se rendre à la brasserie le sergentdit au caporal, en lui montrant Chvéïk : « Emmenez cecochon au lieutenant dès que celui-ci sera de retour. »
– M. le lieutenant est avec latélégraphiste – dit le caporal, quand le maréchal des logis eutquitté la salle – il court après elle depuis quinze jours ;quand il revient du télégraphe, il est toujours furieux et ildit : « C’est une garce ! Elle ne veut pas coucheravec moi ! »
Et, cette fois encore, le lieutenant revint enproie à une sombre fureur. Lorsqu’il entra, on l’entendit jeter desvivres sur la table.
– Rien à faire, mon vieux, tu dois yaller ! dit à Chvéïk le caporal, avec pitié. Beaucoup desoldats sont passés par ses mains, des jeunes et desvieux !
Et il emmena Chvéïk dans le bureau où étaitassis, derrière une table recouverte de papiers déchirés, un jeunelieutenant furieux.
Lorsqu’il aperçut les deux hommes, il s’écria,avec une violence qui en promettait long sur ce qui allaitsuivre : « Ah ! nom de Dieu ! »
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que cet homme a été trouvé à la gare sans papiers, ditle caporal.
Le lieutenant inclina la tête comme s’il avaitvoulu affirmer ainsi qu’il avait, depuis des années, la certitudeque l’on trouverait ce jour-là Chvéïk à la gare, démuni de sespapiers.
Quant à Chvéïk, si quelqu’un l’avait regardé àcette minute, il aurait eu l’impression qu’il était absolumentimpossible qu’un homme ayant une tête pareille et une telle tenuepût avoir des papiers sur lui. Chvéïk donnait l’impressiond’arriver d’une autre planète ; il regardait naïvement, avecune grande surprise, le nouveau monde où il se trouvait et où onlui posait les questions les plus extravagantes comme, par exemple,de lui demander où étaient ses papiers.
Le lieutenant inclina encore la tête commes’il avait voulu inviter Chvéïk à prendre l’initiative de parler lepremier, afin de lui permettre d’engager l’interrogatoire.
Mais, voyant que Chvéïk gardait un silenceobstiné, il se décida à parler :
– Que faisiez-vous dans lagare ?
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que j’attendais le train de Budeiovitz, afin de merendre à mon régiment, au 91e de ligne. Je suisl’ordonnance de Monsieur le lieutenant Lukach, que j’ai été forcéde quitter parce qu’on m’a amené devant le chef de gare, à caused’une amende. J’ai été soupçonné, bien à tort d’ailleurs, d’avoirfait arrêter le rapide dans lequel nous nous trouvions en tirant lesignal d’alarme.
– Racontez-moi cela d’une façoncohérente, s’écria le lieutenant, et ne dégoisez pas tant debêtises.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que la chance m’a quitté depuis le moment où nousétions assis dans le rapide, Monsieur le lieutenant Lukach et moi,pour aller aussi vite que possible rejoindre notre régiment àBudeiovitz. Tout d’abord, nous avons perdu une malle, puis ungénéral à la tête chauve…
– Mon Dieu ! soupira lelieutenant.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je dois vous raconter la chose en détail, pour vousdonner un aperçu des événements, comme disait le cordonnierPetulik, quand il demandait à son fils de retirer sa culotte avantde le fouetter avec une corde.
Et, pendant que le lieutenant commençait à secongestionner, Chvéïk ajouta :
– Non, je ne plaisais pas à Monsieur legénéral Chauve, et Monsieur le lieutenant Lukach, dont j’étaisl’ordonnance, m’a envoyé dans le couloir. Et, dans le couloir, j’aiété accusé d’avoir fait ce que je vous ai déjà dit. Avant que cetincident ait pu être réglé, je restai tout seul sur le quai. Letrain partit. Monsieur le lieutenant avec ses malles et tous lespapiers, les siens et les miens, s’éloignèrent à la même vitesse,tandis que moi, je suis resté ici comme un pauvre abandonné.
Chvéïk regarda le lieutenant d’une façontendre et émouvante.
– Il est clair que ce gaillard, qui donnel’impression d’être un idiot, dit la pure vérité, songea lelieutenant.
Puis, nommant tous les trains qui partirentdans la direction de Budeiovitz après le rapide, il demanda àChvéïk comment il s’était arrangé pour n’en prendre aucun.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, répondit Chvéïk en souriant avec bonhomie, qu’enattendant le prochain train, j’ai eu la malchance de me trouver àla buvette où je me suis mis à boire doucement un bock aprèsl’autre.
– Je n’ai jamais connu un tel idiot,pensa le lieutenant. Il avoue tout. J’en ai déjà vu beaucoup dansson cas, mais ils ont tous nié ce qu’on leur reprochait, tandis quecet imbécile me dit tranquillement : « J’ai manqué tousles trains, parce que je me suis mis à boire un bock aprèsl’autre. »
Résumant toutes ses pensées en une seulephrase il se dressa et déclara à Chvéïk :
– Vous êtes un dégénéré. Savez-vous ceque cela signifie de traiter quelqu’un de dégénéré ?
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que chez nous, au coin du Boitche et de la rueKaterinsky, il y avait un homme qui, précisément, était undégénéré. Son père était un comte polonais et sa mère unesage-femme. Il balayait les rues et, dans les brasseries, il sefaisait appeler tout simplement : Monsieur le comte…
Le lieutenant estima qu’il était temps d’enfinir avec Chvéïk d’une façon ou d’une autre. C’est pourquoi il seleva et affirma avec énergie :
– Eh bien ! je vous dis, moi, quevous êtes un idiot et que vous allez vous rendre au guichet de lagare, que vous prendrez un ticket et que vous vous rendrezimmédiatement à Budeiovitz. Et, si je vous vois encore une fois…Rompez !
Et comme Chvéïk ne bougeait pas d’une semelle,se tenant respectueusement la main près de son calot, le lieutenants’écria :
– Allez-vous-en ! N’avez-vous pasentendu ? J’ai dit : « Rompez ! » CaporalBalelek, prenez cet imbécile, amenez-le au guichet de la gare etprenez pour lui un ticket pour Budeiovitz.
Quelques minutes après le caporal Balelekapparaissait de nouveau dans l’entrebâillement de la porte dubureau. Derrière lui, le lieutenant aperçut le candide visage deChvéïk.
– Qu’y a-t-il encore ? demanda-t-ilavec impatience.
– Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, chuchota le caporal discrètement, que cet homme n’a pasd’argent et moi non plus. Or, on ne veut pas le laisser partirgratuitement parce qu’il n’a pas, sur lui, ses papiers militairesprouvant qu’il va rejoindre son régiment.
Le lieutenant ne fit pas attendre longtemps sasentence, digne de Salomon :
– Il peut aller là-bas à pied, dit-il. Ilen sera quitte pour quelques jours de prison s’il arrive trop tardà son régiment. Qui peut s’occuper de lui, ici ?Personne ! Qu’il parte !
– Rien à faire, camarade, dit le caporalBalelek à Chvéïk quand il revint du bureau : il faut que tuailles à pied à Budeiovitz, mon vieux ! Dans la salle de gardeil y a encore un pain. Nous te le donnerons pour ta route.
Une demi-heure après, muni de ce viatique etd’un paquet de tabac, Chvéïk quitta Tabor dans la nuit. Dès qu’ilfut sur la route il se mit à chanter :
Quand nous sommes partis de Yromerch
Mais vous direz que c’est une blague…
Et le diable seulement pourrait expliquercomment il se fit que le brave soldat Chvéïk, au lieu d’avancervers le sud, dans la direction de Budeiovitz, se mit à se dirigervers l’ouest.
Il marchait sur la grand’route, transi defroid, dans la neige, enveloppé dans sa capote militaire, semblableau dernier grognard de la garde de Napoléon, après la retraite deRussie, Avec cette différence cependant que Chvéïk, loin de courberla tête, chantait avec allégresse :
J’allais gaiement au devant de la ville
En passant par des forêts vertes…
Et dans les forêts, dans le silence de lanuit, l’écho reprenait ce chant, tandis que les chiens commençaientà aboyer.
Quand il eut assez chanté, le brave soldatChvéïk s’assit sur un tas de fumier, alluma sa pipe, se reposa uninstant et repartit à nouveau vers de nouvelles aventures, versl’anabase de Budeiovitz.
Chapitre 2
L’ANABASE DE CHVÉÏK
Xénophon, grand général des temps anciens,traversa, dit-on, toute l’Asie Mineure sans se soucier de la carte.Les Goths firent également leurs préparatifs de guerre sanss’embarrasser de connaissances topographiques. Marcher de l’avant,marcher toujours tout droit devant soi, se frayer un chemin dansdes pays inconnus, entouré d’adversaires qui n’attendent que lapremière occasion pour vous décimer, voilà ce qu’on appelle uneanabase. Si l’on a la tête d’un Xénophon, ce miracle peut êtrepossible.
Les légions de César accomplirent un pareilexploit. S’étant aventurées, sans cartes, jusque sur les côtes dela mer du Nord, elles poussèrent l’audace jusqu’à s’aviser derentrer par d’autres chemins. C’est depuis ce temps-là qu’on a prisl’habitude de dire que tous les chemins mènent à Rome.
Le brave soldat Chvéïk était égalementpersuadé que tous les chemins le mèneraient à Budeiovitz, lorsqu’ilaperçut un village, dans la direction de Milevsk.
Sans se détourner d’un pouce, il poursuivit samarche, car aucune force humaine ou divine ne peut empêcher un bonsoldat d’arriver, s’il en a fermement l’intention, àBudeiovitz.
C’est ainsi que Chvéïk se trouvait à Kvetov, àl’ouest de Milevsk, au moment même où il venait d’achever dechanter toutes les chansons militaires qu’il avait apprises pendantles longues marches des manœuvres d’antan. Son répertoire étantépuisé, il se voyait obligé de reprendre la chanson&|160;:
Oui, elles ont pleuré comme des brebis
Lorsque nous sommes repartis.
Une vieille paysanne qui sortait de l’église,rencontra Chvéïk sur la chaussée.
–&|160;Bonjour, mon petit&|160;! Où est-ce quetu vas comme cela&|160;?
–&|160;Ah&|160;! dit celui ci, je vaisrejoindre mon régiment à Budeiovitz, la mère. Jepart-en-guerre.
–&|160;Mais, mon petit, tu n’y arriverasjamais, si tu avances dans cette direction, répondit la bonne femmeavec stupeur. Tu vas du côté opposé. Et si tu continues de lasorte, tu seras bientôt à Klatov&|160;!
–&|160;Je pense, dit Chvéïk doucement, quemême en passant par Klatov on peut arriver à Budeiovitz. Ça me feraune jolie balade. Ce qu’il y a de malheureux c’est que vous faitestout votre possible pour arriver à temps au régiment où on vousengueule dès que vous vous montrez.
–&|160;Nous avons eu un gars dans ton genre,soupira la vieille paysanne, il est parti pour Plesné à laLandwehr, il s’appelle Tonitchék Machka, c’est un cousin de mabelle-sœur. Il part pour le front et une semaine après lesgendarmes s’amènent pour le chercher, car on ne le trouvait plus àson régiment. Un jour, nous le voyons revenir, habillé en civil. Ilnous dit qu’il était permissionnaire. Mais le bourgmestres’empressa d’aller avertir les gendarmes qui lui ont salementécourté sa permission. Il vient justement de nous écrire dufront&|160;; il est blessé, on vient de lui couper une jambe.
La bonne femme hocha la tête, regarda Chvéïktristement, et poursuivit&|160;:
–&|160;Écoute-moi, mon fils, va au coin de laforêt. Tu m’y attendras. Je vais te chercher une bonne soupe bienchaude, ça te réchauffera un peu. Je serai vite de retour. On peutvoir d’ici notre hameau, là, derrière ce bois, à droite. Tu feraisbien d’éviter de passer par Graz, car tu pourrais rencontrer desgendarmes. Prends plutôt le chemin qui va sur Malechine, en ayantsoin de passer devant la forêt. Et fais bien attention surtoutlorsque tu arriveras à Tchizové, car dans ce coin les pandores fontune chasse en règle aux déserteurs. Marche directement à travers laforêt sur Aoreazdwits, le gendarme qui est là est un excellenthomme, il laisse passer tout le monde. As-tu des papiers surtoi&|160;?
–&|160;Non, petite mère, rien.
–&|160;Ah&|160;! Ah&|160;! Dans ce cas n’y vapas non plus, file plutôt à Radomichle, mais arrange-toi pour yarriver le soir. C’est le moment où les gendarmes sont au bistrot.Tu verras une maisonnette derrière le Saint-Florent, dans la ruequi descend tu rencontreras une maison peinte en bleu. Là, tudemanderas après le père Melicharek, c’est mon frère. Donne-lui lebonjour de ma part et il t’indiquera ta route pour continuer surBudeiovitz.
Chvéïk attendait depuis une bonne demi-heureau coin de la forêt quand il vit venir la vieille paysanne qui luiapportait la soupe promise. Elle avait eu soin d’envelopper lacasserole dans des linges pour que le potage demeurât chaud.Lorsque Chvéïk se fut rassasié, la bonne femme lui glissa dans lapoche de sa capote un morceau de pain et de lard. Puis, tout en luidonnant sa bénédiction, elle lui confia qu’elle avait deuxpetits-fils «&|160;là-bas&|160;». Ensuite elle lui indiqualonguement avant de le quitter, les villages par où il devaitpasser, les raccourcis et les détours qu’il devait prendre. Enfinelle lui tendit une couronne pour qu’il puisse s’offrir, dit-elle,un verre à Malechine, car la route est longue jusqu’àRadomichle.
Chvéïk, suivant les conseils de la bonnefemme, alla de Tchizové à Radomichle en faisant un détour versl’est&|160;; toujours fermement convaincu, puisqu’on prétend quetous les chemins mènent à Rome, qu’il n’y avait pas de raison pourqu’ils ne conduisissent pas également à Budeiovitz.
À Malechine, il rencontra, chez le bistrot oùil prenait son verre, un vieil accordéoniste qui s’attacha à lui.Le bonhomme croyant avoir affaire à un vrai déserteur, lui proposade l’accompagner dans un village voisin où il avait précisément unefille mariée à un insoumis. Chvéïk ne tarda pas à s’apercevoir quele petit père musicien était à moitié saoul.
–&|160;Elle cache son mari, lui confial’accordéoniste, depuis deux mois, dans l’écurie. Tu en ferasautant et tu pourras attendre de cette façon la fin de la guerre entoute tranquillité. D’ailleurs, quand on est deux dans une écurieon supporte mieux sa réclusion…
Comme Chvéïk refusait poliment, mais fermementde suivre ses conseils, le vieux devint subitement furieux, ils’éloigna, menaçant du poing son compagnon et déclarant qu’ilallait de ce pas le dénoncer aux gendarmes de Tchizové.
Lorsqu’il parvint à Radomichle, Chvéïk trouva,ainsi que le lui avait indiqué la vieille femme, la maison bleue dupaysan Melicharek. Les salutations qu’il lui apporta de la part desa sœur le laissèrent complètement indifférent. Il se contenta,pour toute réponse, de demander à Chvéïk s’il avait des papiers et,en vieux paysan madré, il se mit à parler longuement des maraudeurset des voyous qui empestaient le canton.
–&|160;Voilà des types qui plaquent leurrégiment, tout simplement parce qu’ils ont la frousse, puis ils secachent dans les bois et viennent la nuit faucher les biens despaysans. Ces gens-là, par-dessus le marché, ont tous de drôles degueules. Ils ne savent même pas compter jusqu’à quatre. Et ils ontencore le culot de se fâcher si on leur lâche en pleine figureleurs quatre vérités, ajouta-t-il en voyant que Chvéïk, mécontent,se levait du banc sur lequel il était assis. Si ce client avait laconscience tranquille, ajouta-t-il, il resterait tranquillementassis et ferait voir ses papiers&|160;! Mais, comme il n’en apas…
–&|160;Bonsoir, lui dit Chvéïk.
–&|160;Bonsoir et va chercher tes dupesailleurs&|160;!
Chvéïk s’était déjà remis en route dans lanuit, que le vieux grommelait encore&|160;:
–&|160;Il me fait rire avec son histoire àdormir debout, celui-là&|160;! Il me dit qu’il va à son régiment àBudeiovitz et cette vache va dans la direction de Harozdovits, puisil tourne sur Pisek. Il a peut-être l’intention de faire le tour dumonde&|160;!
Chvéïk marcha pendant toute la nuit lorsque,tout à coup, il aperçut, aux environs de Putim, une meule de pailleau milieu d’un champ. Il se creusa là-dedans une sorte de nid poury passer le restant de la nuit. Comme il s’apprêtait à se fourrerdedans, il s’entendit interpeller&|160;:
–&|160;Eh dis donc&|160;! de quel régiment quetu viens&|160;? Et où que tu vas&|160;?
–&|160;Je suis du 91e de ligne, enroute pour Budeiovitz.
–&|160;Mais tu es frappé, vieux frère&|160;!Tu veux y aller pour tout de bon&|160;?
–&|160;Naturellement, mon lieutenant m’attendlà-bas.
À peine eut-il achevé ces mots que Chvéïkperçut distinctement le rire de trois hommes. Lorsque cet accès degaîté se fut calmé, Chvéïk demanda à son tour aux inconnus de quelrégiment ils étaient. Il apprit ainsi que deux de ces hommesappartenaient au 35e de ligne et qu’il y avait parmi euxun dragon qui venait également de Budeiovitz. Les soldats du35e avaient pris le large à la formation de la dernièrecompagnie de marche, il y avait de cela un mois environ&|160;; ledragon était en bordée depuis les premiers jours de lamobilisation. La meule était à lui. Il passait généralement sesnuits dans la paille au milieu de son champ. Il avait rencontré lesdeux déserteurs dans la forêt et les avait hébergés chez lui. Tousvivaient dans l’espoir que la guerre allait bientôt finir, dans unou deux mois, disaient-ils. Ils déclaraient également que lesRusses se trouvaient déjà quelque part, là-bas, sous Budapest etdans la Moravie. C’est du moins ce qu’on racontait à Putim.
La femme du dragon vint, avant l’aube, pourleur apporter le petit déjeuner. Les gars du 35edéclarèrent avoir l’intention de se rendre à Sdrakoneitsè où vivaitla tante de l’un d’eux. Ils comptaient également sur quelques amispour trouver du travail dans une scierie située dans lesmontagnes.
–&|160;Et toi, le gars du 91e, situ veux, tu peux les accompagner, tu n’as qu’à laisser tomber tonlieutenant.
–&|160;Ce sont des choses, répondit Chvéïk,qui ne se font pas si facilement que ça.
Et sur ces paroles, il regagna son trou aumilieu de la paille, se fourra dedans, et ne tarda pas à serendormir.
Quand il se réveilla, les trois copainsétaient déjà partis. L’un d’eux, le dragon sans doute, avait eul’excellente idée de déposer une tartine à côté de la meule.
Chvéïk se remit courageusement en route et sedirigea vers la forêt. En approchant de Chteknea, il rencontra unvieux clochard qui le salua d’une façon très cordiale en luioffrant une gorgée d’eau-de-vie.
–&|160;Tu ferais bien de ne pas trop tebalader dans ce village, confia-t-il à Chvéïk, ton uniformepourrait t’attirer des ennuis, car les rues fourmillent degendarmes. Nous autres, chemineaux, on nous fiche la paixmaintenant, mais vous, ils vous guettent car vous êtes devenus legibier de choix. C’est qu’ils vous en veulent, les vaches, à vous,les insoumis&|160;! affirma-t-il avec une conviction si profondeque Chvéïk décida de ne rien dire sur son 91erégiment.
Qu’il croie ce qu’il veut, pensa-t-il,pourquoi irais-je retirer ses illusions sur mon compte à ce vieuxfrère&|160;?
–&|160;Et toi, où est-ce que tu vas&|160;?demanda le chemineau après qu’ils eurent allumé leur pipe tout ense mettant à contourner le village.
–&|160;À Budeiovitz.
–&|160;Pour l’amour de Dieu&|160;! fit levieux effrayé, on va t’empoigner en moins de deux là-bas. Tudevrais te procurer un complet de civil et boiter ou fairel’estropié. Mais t’en fais pas, ajouta-t-il, nous marchons surSdrakolitz, Voline et Dud, et je voudrais être changé en panier àsalade si nous n’arrivons pas à dégoter quelque part des fringuesde bourgeois. Dans ce patelin-là, il n’y a que des gens honnêtes,qui ne ferment jamais leurs portes. De plus, par ces soiréesd’hiver, ils ne sont jamais chez eux car ils vont veiller chez lesvoisins. Tu n’auras qu’à choisir un froc. Tu n’as pas besoin degrand’chose. Des godasses, tu en as. Tu n’as qu’à te procurer unfalzar et un veston. Tu donneras tes habits de soldat au youpinHerman Voduar. Il achète les frusques militaires pour les revendredans les villages. Pour aujourd’hui, nous allons aller àActrakoneitz. À quatre heures de marche nous trouverons le parc àmoutons du prince Schwarzburg. J’ai là un vieux copain à moi, unberger, il nous hébergera pour la nuit.
Chvéïk fit ainsi connaissance d’un bon vieuxpaysan, très cordial, qui déclara se rappeler encore fort bien leshistoires que son grand-père lui contait sur les guerresnapoléoniennes. Comme il était d’une vingtaine d’années plus âgéque le chemineau, il l’appelait, ainsi que Chvéïk&|160;: jeunehomme.
–&|160;Car voyez-vous, les gars, dit-il,lorsqu’ils eurent pris place autour du feu où cuisaient des pommesde terre, mon grand-père, lui aussi, déserta. Mais les sergentsl’ont rattrapé à Vodnan et lui ont tellement fustigé les fesses quela viande en pendait en lambeaux. Et il se déclarait heureux, caril aurait pu connaître un sort encore pire. Le fils Agarech deReasitz, derrière Protivine, le grand-père du vieux gardechampêtre, lorsqu’il s’était évadé de son régiment, fut toutbonnement zigouillé à Pisek. Avant d’être conduit au pelotond’exécution, il dut passer entre deux haies de soldats qui ne luiadministrèrent pas moins de 600 coups de verges. Alors,demanda-t-il en tournant ses yeux, que la fumée et la pitiérendaient larmoyants, vers Chvéïk, quand est-ce que tu as plaquéton régiment&|160;?
–&|160;Heu… aussitôt après la mobilisation, aumoment même où l’on me conduisait à la caserne.
–&|160;T’as sauté les grilles de lacaserne&|160;? demanda le berger avec curiosité, en se souvenantpeut-être que son grand-père avait employé le même procédé.
–&|160;On ne pouvait pas faire autrement,petit père.
–&|160;Et la garde&|160;? est-ce qu’elle étaitnombreuse, elle a tiré sur toi&|160;?
–&|160;Heu… ben oui…, grand-père.
–&|160;Et où est-ce que tu vas àprésent&|160;?
–&|160;Il a la manie, répondit le vieuxchemineau à la place de Chvéïk, de vouloir aller à tout prix àBudeiovitz. Ces jeunes gens insouciants courent tous à leur perte.Je voudrais l’amener à des idées plus raisonnables et tout d’abordlui trouver un costume de civil&|160;; après, tout ira bien. Nouspasserons l’hiver en peinards, et au printemps, nous trouveronsfacilement de l’embauche chez un paysan. On aura grand besoin detravailleurs. La famine vient et on parle même d’envoyer leschemineaux au boulot. Il vaut mieux ne pas attendre qu’on nous yforce et y aller de notre propre gré. Les gens seront bientôt touségorgés, conclut-il d’une façon assez imprévue.
–&|160;T’es d’avis, donc, que cela ne finirapas encore cet hiver&|160;? T’as raison, jeune homme&|160;! On en adéjà vu des guerres qui duraient. Comme par exemple les guerres deNapoléon, puis celles de la Suède, puis celles de Sept Ans. Lesgens ont largement mérité ce fléau. Comment le bon Dieu aurait-ilpu tolérer l’orgueil de tout ce monde-là&|160;? Voulez-voussavoir&|160;? On ne veut plus manger que de l’agneau et dugigot&|160;! Il n’y a pas très longtemps, une bande de gens estvenue ici, en procession, pour que je leur vende en douce unagneau. Ils se plaignaient de ne bouffer que du porc et desvolailles rôties au beurre et au saindoux. Je ne m’étonne pas quele Seigneur leur en veuille et puisqu’ils ont eu le culot de leverleur nez aussi haut, j’espère qu’il ne les lâchera pas jusqu’à cequ’ils aient appris à bouffer de la vache enragée, comme à l’époquedes guerres de Napoléon. Les autorités ne savent plus que faire,tellement les gens sont aveuglés par l’orgueil. Le vieux princeSchwarzenburg, par exemple, se baladait dans une simple voiture etvoilà que son voyou de fils a déjà son automobile. Le bon Dieu luifera, un jour, avaler son essence.
Pendant que l’eau chantait doucement dans labouilloire, le vieux berger, après une courte pause, reprit laparole et déclara d’un ton prophétique&|160;:
–&|160;Et bien sûr qu’il ne gagnera pas cetteguerre, je parle du kaiser. Car le peuple se fout pas mal de laguerre et de la victoire. Comme le maître de Stragonitz le disaitl’autre jour, tout cela est arrivé parce qu’il n’a pas voulu sefaire couronner roi des Tchèques. Il a beau faire le malin,maintenant&|160;! Espèce de vieille fripouille, tu avais promis dete faire couronner, il fallait tenir ta promesse&|160;!
–&|160;Peut-être, remarqua le chemineau, qu’ils’y décidera maintenant.
–&|160;On s’en fout, jeune homme, repartit leberger, il est trop tard. Tu devrais écouter ce que les voisins seracontent quand ils se réunissent en bas à Skochitz. Chacun d’eux al’un des siens «&|160;là-bas&|160;». Si tu entendais ce qu’ilsdisent de la guerre&|160;! Que la liberté, nous la trouveronslorsque la guerre sera terminée&|160;; que l’on va chasser lesseigneurs des châteaux, et que, aux rois et princes eux-mêmes, onne fera pas de quartier. Pour des parlotes de ce genre, lesgendarmes ont déjà mis en tôle un certain Koginka, en déclarantqu’il cherchait à nous exciter contre le gouvernement. Ah, on peutdire qu’ils en ont du boulot à présent les gendarmes&|160;!
–&|160;Oh pour ça, ils n’en ont jamais manqué,observa le chemineau en faisant la grimace. Je me souviens qu’àKladno, il y avait dans le temps un certain monsieur Rotter commeinspecteur de gendarmerie. Ce cochon eut l’idée, un jour, de fairecroiser ses chiens de police avec des chiens loups. Ceux-là ont unflair extraordinaire à ce qu’il paraît. Et il le fit comme ill’avait dit. Bientôt toute une meute de chiens loups trottaientderrière ses fesses. Il leur fit construire une maison où ilsvivaient aussi bien que le bon Dieu en France. Bon, voilà-t-il pasqu’il se met dans la tête, un jour, de faire des expériences surles pauvres chemineaux avec ses pensionnaires. Et il ordonna auxgendarmes dans tout le district de Kladno d’empoigner et de luilivrer tous les clochards qu’ils rencontreraient. Bon… Je radinetout juste là à ce moment. Je marchais en peinard au milieu de laforêt quand ils m’ont attrapé en route et amené devant leur chef.Vous n’avez pas idée de ce que j’ai dû supporter avec ces salescabots&|160;! D’abord, il me fait renifler par ses écoliers, puisil m’ordonne de monter à une échelle. Au moment où j’arrive enhaut, il lâche une de ses bêtes sur moi&|160;; elle se précipite àmes trousses et me jette du haut de l’échelle par terre. Là, j’aivu le moment où ce sale cabot me dévorait. Alors ils ont faitrentrer les clebs et ils m’ont dit de foutre le camp et de mecacher n’importe où. Bon. Je m’en vais dans la vallée de Katchak,dans un ravin du fin fond de la forêt, mais voilà-t-il pas qu’unedemi-heure après, deux de ces chiens loups arrivaient sur moi àtoute vitesse et me flanquaient par terre. L’un me tient à lagorge, à cet endroit même, tandis que l’autre s’en retournait pourfaire son rapport à Kladno. Au bout d’une heure je vois rappliquerl’inspecteur et ses gendarmes. Ils rappellent le chien, et le chefme donne cinq couronnes et la permission de mendier pendant deuxjours à Kladno. Des clous&|160;! Voilà ce que je me suis dit. J’aipris le large et je me suis cavalé comme si j’avais eu le feu auderrière, et depuis j’ai plus mis les pieds dans ce maudit pays.Tous les chemineaux d’ailleurs ont fait de même. Ils préféraientfaire un large détour que de passer par là, car ce cochond’inspecteur continuait toujours ses sales expériences. Il lesadorait ces sales cabots&|160;! On me racontait, dans les postes degendarmerie, que lorsqu’il faisait ses tournées d’inspection, laseule chose à laquelle il s’intéressait c’étaient ces chiens, etpartout où il en trouvait un, il était si heureux que, de joie, ilse soûlait de plaisir avec le sergent du poste.
Et, pendant que le vieux berger épluchait lespommes de terre et versait du lait caillé dans une casserole, lechemineau continuait à conter ses souvenirs, concernant lesexploits des gendarmes&|160;:
–&|160;Il y avait à Lipnitz, dit-il, un chefde poste qui habitait dans une misérable cahute. Moi, de bonne foi,j’ai toujours pensé qu’une station de gendarmerie doit se trouver àun endroit distingué, au marché ou en face de la mairie, enfin àquelque endroit chic et non pas dans une rue dégueulasse. Bon. Jemarche d’un bout à l’autre de la ville sans faire attention auxécriteaux. Je vais d’une maison à l’autre et j’arrive devant unesorte de bouge&|160;; j’ouvre la porte et je m’annonce&|160;:«&|160;Ayez pitié, messieurs-dames, d’un pauvre père defamille.&|160;» Ah, mes chers amis&|160;! mes pieds se sont commeenracinés. Je me trouvais dans le poste de gendarmerielui-même&|160;! Je vois les carabines aux murs, le crucifix sur latable, les gros registres sur les étrangers, et notre bon vieuxkaiser, accroché au mur, qui me regardait d’un air étonné. Avantque j’aie eu le temps de dire un mot, le chef saute sur moi et meflanque une de ces paires de claques qui m’ont fait dégringolerl’escalier. Je n’ai repris le souffle qu’à Keijleitz. Ahvoyez-vous, c’est ce que l’on peut appeler une administration,celle des gendarmes&|160;!
Sur ces mots les trois hommes se mirent àmanger leur soupe puis, s’allongeant sur des bancs, ils netardèrent pas à s’endormir.
Au milieu de la nuit Chvéïk se leva sans bruitet s’éloigna dans la campagne. À l’est la lune commençait à semontrer et, s’aidant de sa lueur, Chvéïk se dirigea vers l’est touten se répétant avec insistance&|160;: «&|160;Impossible que je neparvienne pas par là à Budeiovitz&|160;!&|160;»
Comme il sortait de la forêt, il vit une villesur sa droite. Chvéïk se dirigea aussitôt à l’ouest, puis vers lesud, contourna Vodnan, fit un détour par les champs, et le soleilmontant le salua sur les pentes couvertes de neige, au-dessus deProtivine.
–&|160;Toujours en avant&|160;! se dit lebrave soldat Chvéïk. Puisque le devoir m’appelle dans ce sacréBudeiovitz, il faut que j’y arrive&|160;!
Vers midi, il découvrit devant lui un village.Descendant la pente de la colline il se dit&|160;: Ça ne peut pascontinuer comme ça, il faut que je demande mon chemin pour aller àBudeiovitz.
Mais quel ne fut pas son étonnement endécouvrant à l’entrée du village une borne sur laquelle illut&|160;: Canton de Putim.
–&|160;Nom de Dieu&|160;! soupira-t-il, jesuis de nouveau à Putim&|160;!
À ce moment, un gendarme sortit d’une maison,pareil à une araignée qui surveille une proie qui vient de seprendre dans sa toile.
Le gendarme marcha droit sur Chvéïk etl’interpella&|160;:
–&|160;Où est-ce que vous allez&|160;?
–&|160;À Budeiovitz, rejoindre monrégiment.
Le pandore eut un rire railleur&|160;:
–&|160;Mais vous en venez, de Budeiovitz. Vousavez Budeiovitz derrière le dos.
Et, sans plus de façon, il entraîna Chvéïk auposte. Le chef de gendarmerie à Putim était connu, dans tout lepatelin, comme un type particulièrement poli et comme un très finpolicier. Il n’avait pas l’habitude de rudoyer ses victimes, maisil les soumettait à un interrogatoire si savamment conduit quel’innocent lui-même était contraint d’avouer.
–&|160;La science de la criminologie, avait-ill’habitude de dire, est fondée sur l’intelligence et sur lapolitesse. Inutile d’engueuler les clients, ordonnait-il à sessubordonnés. Il faut au contraire les traiter avec les plus grandségards. Qu’il s’agisse de suspects ou de délinquants, tout enfaisant le nécessaire pour qu’ils crachent ce qu’ils ont sur laconscience.
–&|160;Je vous souhaite la bienvenue,camarade.
C’est en ces termes qu’il salua le bravesoldat Chvéïk.
–&|160;Ayez l’obligeance de vous asseoir,ajouta-t-il en lui désignant un siège, cette longue marche a dûvous fatiguer. Reposez-vous et veuillez avoir l’obligeance de nousdire où vous allez.
Chvéïk répéta au chef ce qu’il avait déjà ditau gendarme, à savoir qu’il était en route pour se rendre àBudeiovitz.
–&|160;Dans ce cas-là, vous vous êtes trompéde chemin, mon cher, répondit le chef, ironique. Vous venezjustement de Budeiovitz. Il m’est facile de vous en convaincre.Tenez, justement au-dessus de vous, vous avez la carte de laBohême. Prenez donc la peine de regarder, mon brave. Dans le sud,un peu au-dessus de nous, c’est Protivine&|160;; au sud deProtivine, c’est Budeiovitz. Par conséquent, vous n’allez pas versBudeiovitz, mais vous en revenez.
Le chef de poste observa cordialement levisage candide de Chvéïk qui, tranquille et digne, se contenta derépéter&|160;:
–&|160;Je vous déclare que je vais àBudeiovitz.
Cette réponse était aussi inébranlable quecelle de Galilée à ses juges&|160;: «&|160;Eppur, simuove&|160;! – Et pourtant, elle se meut&|160;!&|160;»
–&|160;Écoutez, mon brave, reprit le chef deposte, toujours amicalement, je vais vous expliquer, et vousconviendrez vous-même, à la fin, que votre obstination à nier nefait qu’aggraver vos aveux.
–&|160;Vous avez bien raison, mon adjudant, onne peut pas nier et avouer en même temps.
–&|160;Voyez-vous&|160;! Vous finissez tout demême par me donner raison, mon brave. Et dites-moi, maintenant,sans détours, d’où vous êtes parti et le chemin que vous avez prispour vous rendre à votre Budeiovitz&|160;! Je souligne lemot, votre Budeiovitz, car il paraît qu’il existe sansdoute une autre ville de ce nom, quelque part, au nord de Putim,laquelle, par malheur, n’est pas encore marquée sur la carte.
–&|160;Je suis parti de Tabor, réponditChvéïk.
–&|160;Et que faisiez-vous à Tabor&|160;?
–&|160;J’attendais le train pourBudeiovitz.
–&|160;Et pourquoi ne l’avez-vous paspris&|160;?
–&|160;Je n’avais pas de billet.
–&|160;Et pourquoi ne vous a-t-on pas délivrégratuitement un billet, puisque vous êtes militaire&|160;?
–&|160;Je n’avais pas de papiers sur moi.
–&|160;Voilà&|160;! s’écria le chef,victorieux, à un de ses gendarmes. Il n’est pas si bête qu’il en al’air, mais il commence à s’embrouiller.
Le chef reposa sa question comme s’il n’avaitpas entendu la réponse de Chvéïk.
–&|160;Vous êtes donc parti de Tabor&|160;?Bien. Où êtes-vous allé après&|160;?
–&|160;À Budeiovitz.
L’expression cordiale du chef s’assombrit uninstant. Il jeta un coup d’œil rapide sur la carte.
–&|160;Pouvez-vous nous indiquer sur la carte,le chemin que vous avez pris pour vous rendre àBudeiovitz&|160;?
–&|160;Je ne me rappelle plus très bien tousles villages que j’ai traversés, je sais seulement que j’aitraversé déjà une fois Putim.
Le chef de poste échangea un regard inquietavec l’un de ses hommes et poursuivit ainsi soninterrogatoire&|160;:
–&|160;Vous vous trouviez donc à la gare deTabor&|160;? Bien. Avez-vous quelque chose sur vous&|160;?Montrez-moi ce que vous avez dans vos poches.
On se mit en devoir de fouiller Chvéïk. Maison ne trouva sur lui que sa pipe et quelques allumettes. Le chefl’interpella de nouveau.
–&|160;Pourriez-vous me dire comment il sefait que vous n’ayez rien sur vous&|160;?
–&|160;Cela prouve que je n’ai besoin de rien,répondit Chvéïk tranquillement.
–&|160;Mon Dieu, soupira le chef, vous nesimplifiez guère ma tâche. Voyons, vous me disiez tout à l’heureque vous étiez déjà venu à Putim. Qu’avez-vous fait ici&|160;?
–&|160;J’ai simplement continué ma route surBudeiovitz.
–&|160;Ah&|160;! voilà que vous vousembrouillez&|160;! Vous me disiez tout à l’heure que vous êtes alléà Budeiovitz, et maintenant, une fois convaincu du contraire, vousavouez que vous en revenez.
–&|160;J’ai dû faire un joli détour.
Le chef échangea une fois encore un regardsignificatif avec ses hommes.
–&|160;Oui, oui, je comprends, dit-il, un jolidétour&|160;! J’ai l’impression que vous vous êtes tout simplementoccupé à rôder autour de nous. Êtes-vous resté longtemps à la garede Tabor&|160;?
–&|160;Jusqu’au départ du dernier train pourBudeiovitz.
–&|160;Et qu’avez-vous fait pendant cetemps&|160;?
–&|160;J’ai causé avec des soldats qui setrouvaient-là.
Avec un regard encore plus significatifadressé à ses subordonnés, le chef poursuivit&|160;:
–&|160;Et de quoi par exemple avez-vous causéavec ces soldats&|160;? Que leur avez-vous demandé&|160;?
–&|160;Je leur ai demandé, répondit Chvéïk, dequel régiment ils étaient et où ils se rendaient.
–&|160;Parfait. Et n’avez-vous pas demandéégalement de combien de soldats est composé un régiment&|160;? oupar exemple, comment il est organisé&|160;?
–&|160;Je n’ai pas eu besoin de le demander,car je le sais par cœur depuis longtemps.
–&|160;Tiens, tiens, vous êtes doncparfaitement instruit sur l’organisation de notre armée&|160;?
–&|160;Mais oui, mon adjudant.
Alors le chef de poste se résolut à jouer sondernier atout. Souriant triomphalement à ses gendarmes, ildemanda&|160;:
–&|160;Vous parlez le russe&|160;?
–&|160;Non, répondit Chvéïk, en toutesimplicité.
Le chef fit un signe au brigadier qui emmenaaussitôt son homme dans la pièce voisine. Puis, se frottant lesmains comme s’il venait d’obtenir une éclatante victoire, ildéclara&|160;:
–&|160;Avez-vous entendu&|160;? Il prétendqu’il ne parle pas le russe&|160;! C’est un fin roublard. Il a toutavoué, sauf ce qui est le plus important. Demain, nous le feronsconduire au commandant de district à Pisek. La criminologie estfondée sur l’intelligence et sur la politesse. Qui aurait pu croireune chose pareille&|160;? Il a tout à fait l’air d’un crétin, maisce sont justement ceux-là qui sont les plus dangereux. Enattendant, il faut le mettre aux arrêts. Je vais rédiger leprocès-verbal de cette affaire.
Et ce même après-midi, le chef du poste,toujours souriant, se mit à faire son rapport où revenait à chaquedeux lignes, cette phrase&|160;: «&|160;Convaincud’espionnage&|160;».
La situation, à mesure qu’il écrivait, luiapparaissait de plus en plus nette. Aussi, lorsqu’il termina&|160;:«&|160;Je déclare avec obéissance que l’officier russe en questiona été conduit aujourd’hui même devant M.&|160;le Commandant dudistrict de Pisek&|160;», il ne put retenir un sourire triomphal.Puis il demanda au brigadier&|160;:
–&|160;Avez-vous donné à manger à cet officierennemi&|160;?
–&|160;Suivant vos ordres, nous ne donnons denourriture qu’à ceux qui nous sont amenés avant midi.
–&|160;Mais, c’est qu’il s’agit d’uneimportante exception, répondit vivement le chef. Cet homme doitêtre un officier supérieur, peut-être même un officierd’état-major. Vous pensez bien que les Russes ne se servent pas depauvres bougres de brigadiers pour assurer leur serviced’espionnage. Faites venir un bon déjeuner de chez Kotzourek. S’iln’a plus rien, demandez-lui de vous préparer un repas en vitesse.Ensuite vous nous ferez un bon thé au rhum que vous servirez ici.Mais surtout ne dites rien à personne, ne parlez à nulle âme quivive de la prise que nous venons de faire. C’est un secretmilitaire.
Puis, à voix basse, il demanda&|160;:
–&|160;Et que fait maintenant notreprisonnier&|160;?
–&|160;Il nous a demandé un peu de tabac,répondit le gendarme. Il a l’air très content et n’est pas plusgêné que s’il était chez lui. «&|160;Vous avez bien chaud, ici, medisait-il. Est-ce que votre fourneau ne fume pas&|160;? Je me plaisbeaucoup chez vous. Si votre fourneau fumait, vous n’auriez qu’àramoner les tuyaux. Mais surtout pas avant midi et jamais quand lesoleil se trouve au-dessus de votre cheminée.&|160;»
–&|160;Ça, c’est de la finesse&|160;! s’écriale chef plein d’enthousiasme. Il se conduit absolument comme sitoute cette affaire ne le regardait pas&|160;! Pourtant il saitfort bien qu’il sera zigouillé&|160;! Ces gens-là méritent d’êtrerespectés, même s’ils sont nos adversaires. Cet homme-là marche àla mort les yeux ouverts, crânement&|160;! Je ne sais pas trop sinous en serions capables. Nous hésiterions peut-être. Mais lui, ils’assied commodément sur un escabeau et vous déclare aveccalme&|160;: «&|160;Il fait bon chez vous. Est-ce que votrefourneau ne fume pas&|160;?&|160;» Ça, ça peut s’appeler uncaractère, brigadier&|160;! Cet homme doit avoir des nerfs enacier&|160;! Un sentiment de sacrifice, une volonté de fer et del’enthousiasme&|160;! Ah&|160;! si en Autriche nous avions cetenthousiasme&|160;! Mais nous avons aussi chez nous deshéros&|160;! Avez-vous lu sur la Narodni Politikàl’histoire de ce lieutenant d’artillerie qui s’était dissimulé ausommet d’un pin pour y établir un poste d’observation&|160;?Lorsque les nôtres ont été refoulés, il n’en pouvait plus descendresans risquer de tomber entre les mains de l’ennemi. Eh bien,savez-vous ce qu’il a-fait&|160;? Il a tout bonnement attendu leretour de notre armée. Et savez-vous combien cela a duré&|160;?Quatorze jours&|160;! Pendant quatorze jours, il s’est tenu à sonposte&|160;! À la fin, il en était réduit à ronger l’écorce de sonarbre pour ne pas mourir de faim. Il a bouffé presque tout lepin&|160;! Lorsque les nôtres sont arrivés, sa joie était tellequ’il dégringola du haut de son poste et se cassa le cou. On l’adécoré après sa mort de la médaille d’argent. Ça c’est del’héroïsme, brigadier&|160;! ajouta-t-il avec enthousiasme. Maisvoilà que nous bavardons. Allez donc lui porter son déjeuner. Puis,se ravisant, il déclara&|160;: En attendant, envoyez-le-moi.
Le brigadier ramena Chvéïk dans le bureau duchef. Celui-ci fit signe au prisonnier de s’asseoir, puis ildemanda à Chvéïk&|160;:
–&|160;Avez-vous des parents&|160;?
–&|160;Non.
Le chef de poste pensa que tout était mieuxainsi. Au moins, la mort de ce malheureux, songea-t-il, ne causerade chagrin à personne. Il regarda longuement, avec attention, lafigure innocente de Chvéïk, lui frappa sur l’épaule dans un accèsde cordialité, puis, se penchant vers lui, il lui demanda d’un tonpaternel&|160;:
–&|160;Alors, comment vous trouvez-vous enBohême&|160;?
–&|160;J’aime beaucoup la Bohême, réponditChvéïk. Sur mon chemin, je n’ai trouvé que de braves gens.
Le chef de poste hocha la tête d’un airaffirmatif.
–&|160;Notre peuple est brave et bon,ajouta-t-il. Il arrive bien que nous ayons des vols ou des rixes,mais tout cela n’est pas très grave. Je suis ici depuis quinze anset, tout compte fait, la moyenne des assassinats n’est que de troisquarts par an.
–&|160;Vous voulez parler, répliqua Chvéïk, degens aux trois quarts assassinés&|160;?
–&|160;Mais non, pas du tout, je veux dire quependant les quinze ans de mon service, il ne s’est pas commis plusde onze crimes dans cette région, dont cinq avaient le vol pourmotif. Les autres étaient insignifiants.
Le chef demeura muet un instant, puis ilreprit son interrogatoire selon sa méthode personnelle.
–&|160;Qu’aviez-vous l’intention de faire àBudeiovitz&|160;?
–&|160;Je voulais entrer au 91e deligne, répondit Chvéïk.
Sur cette réponse, le chef intima à Chvéïkl’ordre de se retirer rapidement dans la pièce à côté, afin de nepas oublier d’ajouter à son rapport au commandant dedistrict&|160;: «&|160;Connaissant bien le russe, il cherchait às’introduire dans le 91e régiment de ligne.&|160;»
Le chef de poste, ravi, se frotta les mains.Il était fort content du résultat de sa méthode. Il se souvenaitavec mépris de son prédécesseur, le sergent-chef Burger qui,incapable d’interroger les détenus d’une façon scientifique, secontentait de les envoyer simplement au juge du district enrédigeant un rapport laconique de ce genre&|160;: «&|160;Suivantles dires du brigadier, le nommé X… a été pris en flagrant délit devagabondage.&|160;»
Tout en considérant son rapport, le chefouvrit d’un air satisfait son tiroir et en retira une circulaireconfidentielle de la direction provinciale de Prague. Elle portaiten grosses lettres l’inscription habituelle&|160;:«&|160;Rigoureusement confidentielle&|160;». Et le chef lut encoreune fois&|160;:
«&|160;Les postes et stations de gendarmerieont le devoir de surveiller avec une attention toute particulièreles gens passant par leur rayon. Les mouvements de nos troupes enGalicie orientale ont ouvert une brèche dans nos lignes parlaquelle certains détachements de l’armée russe ont pu traverserles Carpathes et s’introduire à l’intérieur de l’Empire. Nos lignesont dû être reculées à l’ouest de la monarchie. Cette situation afacilité l’infiltration des espions russes à l’intérieur del’hinterland, notamment en Silésie et en Moravie, d’où, suivant nosinformations confidentielles, un certain nombre d’espions russesont pénétré en Bohême. Nous sommes parvenus à découvrir parmi euxla présence de Tchèques russes, qui, ayant été formés dans lesécoles supérieures de guerre russes, étant, d’autre part, enpossession complète de la langue tchèque, se révèlentparticulièrement dangereux. Il est à redouter surtout qu’ils nedéveloppent parmi la population tchèque une propagande subversive.La direction provinciale ordonne en conséquence d’arrêter tous leséléments suspects et de redoubler de vigilance pour surveillerparticulièrement les rayons dans le voisinage desquels se trouventdes garnisons et des dépôts militaires, ainsi que des gares lesdesservant. Les détenus devront être soumis immédiatement à uninterrogatoire très serré et conduis au chef dudistrict.&|160;»
Le chef de poste, Flanderka, sourit une foisencore à la circulaire confidentielle et la remit dans la chemiseavec les autres, dans le rayon des documents rigoureusementconfidentiels et secrets.
Il y en avait d’ailleurs à profusion. Leministère de l’intérieur, secondé par le ministère de la défensenationale auquel la gendarmerie appartenait, se chargeait d’enfabriquer chaque jour à tour de bras. À la direction provinciale,tous les ronds-de-cuir étaient chargés de ce travail. On yrédigeait&|160;:
L’ordonnance concernant le contrôle de lamentalité du peuple, les instructions pour l’observation, à l’aidedes conversations recueillies, des effets exercés par les nouvellesdu front sur la population.
Un questionnaire concernant l’attitude de lapopulation devant la souscription nationale des bons de la défenseet autres emprunts d’État.
Un questionnaire au sujet de l’humeur desconscrits et de ceux qui sont appelés à passer prochainement auconseil de révision.
Un questionnaire concernant l’opinion desconseillers municipaux et des intellectuels.
Une ordonnance prescrivant l’établissementimmédiat de la répartition des forces entre les partis politiquesreprésentant la population de la localité.
Une ordonnance concernant la surveillance del’activité des leaders des organisations politiques de la localité,ayant une influence sur le peuple.
Un questionnaire concernant les journaux,revues et brochures distribués dans le rayon des postes degendarmerie.
Instructions au sujet de la surveillance desrelations de certains personnages suspects de sentiments déloyaux,avec ordre de se renseigner sur la façon dont ils expriment leursopinions subversives.
Instructions concernant l’acquisitiond’indicateurs et d’informateurs rétribués agissant dans lapopulation.
Instructions pour le travail des indicateursau service des postes de gendarmerie, indicateurs devant êtrechoisis dans la population de la localité.
Chaque jour avait apporté de nouvellesinstructions, ordonnances et questionnaires. Sous cette avalancheministérielle, le chef de poste avait pris l’habitude de laisser laplupart de ces questionnaires sans réponse et de remplir les autresà l’aide de quelques phrases stéréotypées, déclarant par exempleque la loyauté de son rayon était au-dessus de tout soupçon&|160;;qu’elle était de la catégorie Ia. Le ministère de l’intérieurautrichien avait, en effet, inventé les catégories suivantes pourla classification des sentiments de la population en face de lamonarchie&|160;:
Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb,IVc. La dernière catégorie, que désignait le chiffre romain IV,signifiait&|160;: a&|160;: traître, bon pour la potence&|160;;b&|160;: à isoler&|160;; c&|160;: à surveiller ou arrêter. Legouvernement s’intéressait tout particulièrement à ce que lescitoyens pensaient de lui.
Le chef de poste se tordait souvent les mainsde désespoir en voyant augmenter chaque jour la masse de cesimprimés. Il se sentait défaillir en recevant son courrier. Et si,dans ses nuits d’insomnie, il songeait à la multiplicité desquestionnaires en souffrance, il sentait la folie le gagner peu àpeu. La direction provinciale, pensait-il, m’ôtera peu à peu ce quime reste de raison, je ne pourrai même pas me réjouir de lavictoire finale des armées autrichiennes, car d’ici là je seraidevenu complètement gâteux.
Mais, impitoyable, la direction provincialecontinuait à le bombarder de nouveaux questionnaires.
Pourquoi n’avait-il pas encore envoyé saréponse à la circulaire n°&|160;72.345&|160;: 721 ALF&|160;?Pourquoi les instructions n°&|160;88.772&|160;: 822 GTHrestaient-elles en souffrance&|160;? Quels étaient les résultats deses recherches au sujet du n°&|160;123.456&|160;: I. 423 BIP,etc.
Mais c’était l’ordonnance concernant lesmouchards recrutés parmi la population qui lui causa le plusd’ennuis. Comme il lui était impossible d’en trouver un dans sonvillage, aux confins de la Blata (célèbre par ses révoltespaysannes), où il n’y avait que de fortes têtes, il imagina degagner pour ce service le berger de la commune, celui qu’onappelait d’habitude&|160;: «&|160;Hé, Pekpu, saute&|160;!&|160;»,car le pauvre idiot obéissait toujours à cet ordre. C’était unmalheureux enfant qui végétait misérablement avec le salaire que lacommune lui allouait pour la garde de ses troupeaux.
M.&|160;Flanderka le fit appeler un jour etlui posa cette question&|160;: «&|160;Sais-tu, Pekpu, qui est levieux Prohaska&|160;?&|160;»
–&|160;Mée…
–&|160;Ne meugle pas. Il s’agit de chosessérieuses. Donc, sache que c’est notre empereur qu’on appelleainsi. Sais-tu qui est notre kaiser&|160;?
–&|160;Notre taïjer&|160;?
–&|160;Bien, Pekpu&|160;! Si tu entendais direquelque part, lorsque tu vas manger chez des paysans, que notrekaiser n’est qu’un vieil imbécile ou quelque chose de ce genre, tuviendrais me le dire et je te donnerai un seckserl (4 sous). Si onte racontait également que nous sommes incapables de gagner laguerre, tu viendrais me le dire aussitôt, et tu auras encore 4sous. Mais si, par hasard, je viens à apprendre que tu m’as cachéquelque chose tu auras à faire à moi&|160;! Je te fais arrêter etje t’envoie à Pisek. Et maintenant, hop&|160;! Pekpu,saute&|160;!
Ayant accompli son saut rituel, Pekpu reçutson seckserl, et M.&|160;Flanderka rédigea le jour même un longrapport dans lequel il expliquait qu’il venait d’acquérir unindicateur de premier ordre.
Le lendemain, le curé vint faire au chef deposte une communication grave et confidentielle. Il avait rencontréle matin même, au bout du village, le berger de la commune qui luiadressa la parole en ces termes&|160;:
–&|160;Monseigneur, sachez que monsieurl’adjudant m’a dit hier que le kaiser n’était qu’un vieil imbécileet que nous étions incapables de gagner la guerre… Hopp&|160;!
Après avoir complété les informations du curé,Flanderka fit arrêter le berger qui fut condamné quelques semainesplus tard par la cour de Hradjine à douze ans de prison pourintelligence avec l’ennemi, complot contre la sûreté de l’État, etcrime d’incitation de militaires à la désobéissance.
Pekpu saute&|160;! se comporta devant lesmagistrats de la cour exactement de la même façon que devant lespaysans. Il répondit à chaque question par un bêlement, etlorsqu’on lui lut la sentence, il fit un bond, ce qui lui valut unepeine de plusieurs jours de cachot, aggravée de trois jours dejeûne par semaine.
Depuis cette fâcheuse affaire,M.&|160;Flanderka décida de se passer d’indicateur, il en inventaun de toutes pièces, lui donna un état-civil et augmenta de lasorte son revenu mensuel de 5o couronnes, qu’il s’empressa deporter au cabaret du «&|160;Chat Botté&|160;». Mais à peineétait-il arrivé à son dixième demi que le remords vint letourmenter, si bien que son voisin lui-même le remarqua&|160;:
–&|160;Notre bon dieu d’adjudant paraît avoirdu chagrin, dit-il.
Le chef de poste, pour échapper à ce remords,répondit à quelques questionnaires de la façon suivante&|160;:«&|160;L’humeur de la population se maintient toujours à la hauteurde Ia.&|160;»
Mais cette mesure ne lui fit pas recouvrerentièrement sa quiétude de jadis. Le cauchemar d’une inspection decontrôle vint le hanter jour et nuit. Il voyait constamment devantlui une corde qu’on lui attachait autour du cou pour le conduire àla potence au pied de laquelle le ministre de la défense nationalel’attendait pour le terrasser par cette question&|160;:«&|160;Dites donc, adjudant, où diable avez-vous foutu la réponse àla circulaire n°&|160;178967 XYZ&|160;: 28.792&|160;?&|160;»
Mais, voici que le sort a tourné aujourd’huiet qu’il lui prépare une belle revanche&|160;; il lui sembleentendre sonner le salut des cors de chasse de tous les coins de lastation, et retentir l’éloge rituel&|160;: «&|160;Bon coup defusil, chasseur&|160;!&|160;»
M.&|160;Flanderka est persuadé cette fois quele commandant du district en personne ne tardera pas à venir luifrapper amicalement sur l’épaule, en lui disant&|160;: «&|160;Jevous félicite, mon brave Flanderka&|160;!&|160;»
Toute cette gloire, qu’il entrevoit prochaine,plonge le chef de poste dans une douce béatitude, accompagnée d’unelégère fièvre. Les images jaillissent dans son cerveau&|160;:décoration, avancement, reconnaissance éclatante de ses qualités decriminologue font une ronde folle.
Tout en songeant à ses succès prochains, ilappela le brigadier&|160;:
–&|160;A-t-on apporté le déjeuner auprisonnier&|160;?
–&|160;Mon adjudant, nous lui avons apportédes saucisses aux choux. Il n’y avait plus de soupe. Le détenu a buson thé et il m’en a redemandé une deuxième tasse.
–&|160;Qu’on la lui serve, accorda de bonnegrâce le chef de poste. Puis, lorsqu’il aura bu son thé,amenez-le-moi.
–&|160;Eh bien, ça va mieux&|160;?demanda-t-il lorsque, un instant après, le brigadier lui amena lebrave soldat Chvéïk, souriant comme toujours.
–&|160;Ça va pas trop mal, mon adjudant.J’aurais aimé seulement qu’on me donne un peu plus de choucroute.Mais je sais qu’on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Vous n’étiezpas prévenu. Les saucisses étaient bien fumées. Il paraît quec’était du cochon élevé et charcuté à la maison. Le thé au rhumétait excellent.
–&|160;Est-il vrai qu’on boive beaucoup de théen Russie&|160;? lui demanda l’adjudant. Est-ce qu’on aime aussi lerhum, là-bas&|160;?
–&|160;Le rhum, je crois qu’on l’aime partout,mon adjudant.
Le chef de poste se pencha vers Chvéïk et luidemanda d’un ton confidentiel&|160;:
–&|160;Paraît qu’il y a de jolies poules enRussie, hein&|160;?
–&|160;De jolies poules, il y en a partout,mon adjudant.
–&|160;Tu es un malin, se dit Flanderka, maisavec moi ça ne prend pas.
Et, brusquement, il découvrit sesbatteries&|160;:
–&|160;Quelle était votre intention en voulantpénétrer au 91e de ligne&|160;? demanda-t-il.
–&|160;Je voulais aller au front, monadjudant.
Le chef de poste regarda avec satisfaction lebrave soldat Chvéïk.
–&|160;Eh&|160;! eh&|160;! c’est la meilleurefaçon d’aller en Russie&|160;! songea-t-il.
C’était une idée épatante&|160;! s’écria-t-ilradieux, tout en observant attentivement le visage de Chvéïk.
–&|160;Il ne bronche pas&|160;! remarqua-t-ilétonné. Quelle magnifique éducation militaire&|160;! Si j’étais àsa place, si on me flanquait cela en pleine figure, il me seraitdifficile de conserver mon sang-froid.
–&|160;Demain matin nous vous conduirons àPisek, dit-il à mi-voix comme s’il s’agissait d’une chose sansimportance. Êtes-vous déjà allé à Pisek&|160;?
–&|160;Oui, mon adjudant, en 1910, pendant lesmanœuvres impériales.
Le sourire de Flanderka devint de plus en plustriomphal. Il s’apercevait, avec joie, que le succès de son systèmedépassait toute espérance.
–&|160;Vous avez assisté à cesmanœuvres-là&|160;?
–&|160;Mais oui, mon adjudant, comme simpletroufion de l’infanterie.
Et Chvéïk fixa à nouveau son candide regardsur le chef de poste qui commençait à être grisé par sa joiedébordante. Il appela le brigadier pour reconduire Chvéïk et ilcompléta ainsi son rapport&|160;:
«&|160;Le plan d’action de cet homme était lesuivant&|160;: aussitôt engagé au 91e régiment de ligne,il avait l’intention de partir pour le front et de rejoindre ainsison pays. Mais la vigilance des autorités autrichiennes ayant faitéchouer ses projets, il lui sera impossible désormais de les mettreà exécution. De plus, il a, après un interrogatoire long et serré,avoué qu’il avait participé aux manœuvres impériales de 1910, dansla région de Pisek, en qualité de simple fantassin. Je dois ajouterque ses aveux n’ont été obtenus qu’après un long interrogatoire quej’ai conduit d’après un système qui m’est personnel.&|160;»
À ce moment, le brigadier seprésenta&|160;:
–&|160;Mon adjudant, le détenu veut aller aucabinet.
–&|160;Baïonnette, au canon&|160;! décida lechef. Attendez&|160;! Non&|160;! Ramenez-le moi plutôt&|160;!
–&|160;Vous voulez aller au cabinet&|160;?demanda l’adjudant, toujours très cordial. Est-ce que vous n’avezpas au moins une arrière-pensée&|160;?
Et il fixa un regard scrutateur surChvéïk.
–&|160;Je n’ai jamais de pensée en arrière,mon adjudant, répondit celui-ci.
–&|160;Bon&|160;! bon&|160;! Je vais tout demême vous accompagner, répondit le chef en glissant son revolverdans sa ceinture.
–&|160;C’est un bon revolver, dit-il enpassant devant Chvéïk, à sept balles, et d’une précision de tirparfaite.
Mais, avant d’arriver dans la cour, il appelale brigadier&|160;:
–&|160;Mettez la baïonnette au canon&|160;!dit-il, et montez la garde derrière le cabinet pour empêcher qu’ilse sauve par la fosse.
Ce cabinet était un véritable invalide de lavieille garde&|160;; il avait déjà servi loyalement plusieursgénérations de gendarmes. Pour l’instant Chvéïk se tenait là,serrant dans sa main la ficelle qui remplaçait la serrure absente,cependant que le brigadier dardait sur son derrière un regardvigilant, afin que le prisonnier ne s’avisât pas de creuser unesape dans la fosse.
De son côté, l’adjudant regardait fixement laporte de la bicoque, tout en se demandant dans quelle jambe deChvéïk il tirerait, si celui-ci essayait de se sauver.
Mais la porte s’ouvrit et, le plus candidementdu monde, Chvéïk en sortit en souriant.
–&|160;Est-ce que je n’ai pas été trop long,je ne vous ai pas trop fait attendre&|160;? demanda-t-il.
–&|160;Oh non, du tout&|160;! du tout&|160;!répondit l’adjudant, qui songeait avec admiration&|160;: Quel type,tout de même&|160;! Il sait bien le sort qui l’attend&|160;! Maisl’honneur avant tout&|160;! Quel est celui d’entre nous quitiendrait si noblement le coup&|160;?
Flanderka s’assit dans la chambre à côté deChvéïk sur le lit de camp du gendarme Rampa. Ce dernier aurait dûaccomplir sa tournée dans les villages&|160;; en réalité, il jouaitau «&|160;chiacha&|160;» avec un cordonnier au «&|160;Canassonnoir&|160;», et il déclarait de temps à autre&|160;: «&|160;On lesaura&|160;».
L’adjudant alluma sa pipe, et il permitégalement à Chvéïk de bourrer la sienne. Le brigadier mit ducharbon dans le poêle et la station de gendarmerie de Putim devintainsi le lieu le plus agréable du monde&|160;; l’endroit le plustranquille, une sorte de nid bien chaud dans la nuit tombanted’hiver, un merveilleux endroit pour bavarder amicalement.
Cependant les trois hommes gardaient lesilence.
–&|160;À mon avis, dit tout à coup l’adjudant,ce n’est pas juste de pendre les espions. L’homme qui se sacrifiepour sa patrie devrait être exécuté d’une façon moins ignominieuse.Passé par les armes, par exemple. Qu’en pensez-vousbrigadier&|160;?
–&|160;Évidemment, il serait préférable de lesfusiller, approuva le brigadier. Admettons par exemple qu’on nousappelle chez le chef du district et qu’on nous dise&|160;:«&|160;Allez et tâchez de savoir le nombre de mitrailleuses que lesRusses ont foutu dans ce secteur. Service commandé&|160;!&|160;»Nous, on va se déguiser et en route. Est-ce qu’il faudrait pourcela nous pendre comme de vulgaires malfaiteurs&|160;? Nom deDieu&|160;! Non et non&|160;!
Le brigadier se mit dans une telle colère qu’àla fin il se mit à crier&|160;: «&|160;J’exige qu’on me zigouilleet qu’on m’enterre avec les honneurs militaires&|160;!&|160;»
–&|160;Seulement, voilà, fit remarquer Chvéïk,si on est malin, on a beau vous arrêter, on ne peut jamais rienprouver contre vous.
–&|160;Il n’y pas de malin qui tienne,répondit avec force l’adjudant, on peut fort bien faire la preuved’une culpabilité, mais à condition, bien entendu, d’avoir uneméthode à soi, une sorte de méthode scientifique. Vous enconviendrez bientôt, mon ami. Vous ne tarderez pas à vous enapercevoir, ajouta-t-il en souriant. Chez nous, il n’y a rien àfaire, n’est-ce pas, brigadier&|160;?
Le brigadier hocha affirmativement la tête etremarqua qu’il existe encore des types qui, quoique sachant queleur cause est perdue d’avance, prennent le masque d’une complèteindifférence.
–&|160;Mais cela ne change rien, ajouta-t-il,à leur sort, au contraire. Plus ils font les je m’en-foutisse, etplus ils accumulent contre eux les preuves de leur culpabilité.
–&|160;Je vois que vous êtes de mon école,brigadier, déclara le chef d’un ton satisfait. Cette innocencen’est à mes yeux qu’un «&|160;corpus delicti&|160;».
Interrompant là ses réflexions, il demanda aubrigadier&|160;:
–&|160;Au fait, qu’allons-nous nous faireservir ce soir pour dîner&|160;?
–&|160;Est-ce que nous n’irons pas au café,mon adjudant&|160;?
Cette question soulevait un grave problème quiexigeait cependant une solution immédiate.
Et si le client, profitant de cette absence,réussissait à prendre le large&|160;? On ne pouvait avoir dans lebrigadier qu’une confiance très limitée, car il avait déjà laissés’évader deux vagabonds. En vérité, l’histoire s’était passéeainsi&|160;: le brigadier qui en avait assez de traîner derrièrelui dans la neige, jusqu’à Pisek, les deux vagabonds, les laissapartir. Et ce n’est que pour la forme qu’il tira un coup de fusilen l’air.
–&|160;Bah, on enverra la vieille chercher ledîner, trancha le chef de poste. Ça la dégourdira un peu.
Et la vieille Peizlerka fit, durant toute lasoirée, la navette entre le poste de gendarmerie et le cabaret deKotzeurek. Ses galoches tracèrent dans la neige un double sentierreliant les deux maisons.
Et lorsque la vieille Peizlerka se rendit pourla nième fois chez le bistro avec un message deM.&|160;Flanderka affirmant que celui-ci présentait à Kotzeurek seshommages les plus empressés, en lui demandant par la même occasionune bouteille de bon touchovka, le bistro se sentit envahi par unedévorante curiosité.
–&|160;Ce que nous avons chez nous&|160;? luirépondit Peizlerka, c’est un voyou quelconque, un suspect,quoi&|160;! Au moment où je les ai quittés, le patron et sonbrigadier étaient en train d’embrasser ce type-là. L’adjudant luicaressait la tête, en lui disant&|160;: «&|160;Oh&|160;! mon petitfrère slave, mon cher petit espion&|160;!&|160;»
Lorsque minuit sonna, le brigadier s’étira surson lit et s’endormit en uniforme, remplissant le corps de garde deses ronflements sonores.
En face de lui se trouvait l’adjudant quitenait d’une main ce qui restait de touchovka au fond de labouteille, et de l’autre Chvéïk serré contre lui tout en bégayant,pendant que des larmes abondantes coulaient le long de ses jouesbrunies et dans sa barbe souillée&|160;:
–&|160;Avoue, mon brave, que vous n’avez pasen Russie une si bonne touchovka&|160;! Avoue, pour que je puissem’en aller dormir tranquillement&|160;! Avoue, comme un gentilhommeque tu es&|160;!
–&|160;Ben sûr qu’ils n’en ont pas de sibonne&|160;!
L’adjudant se rua sur Chvéïk.
–&|160;Chéri, mon ange, tu m’as fait grandplaisir&|160;! Enfin, tu as avoué&|160;! C’est ainsi qu’il fautfaire. À quoi bon nier si on est coupable&|160;!
Il se leva, et en zigzaguant, tenant toujoursla bouteille vide dans sa main, il se précipita dans sa chambre. Ilbalbutiait, ravi des résultats obtenus par ses méthodesscientifiques&|160;: si je ne m’étais pas égaré sur le mauvaischemin, tout ça pouvait tourner autrement…
Et, avant de se jeter tout habillé sur sonlit, il ouvrit son bureau, en tira le rapport, et se mit à lecompléter dans ce sens&|160;:
«&|160;J’ai l’honneur et le devoir d’ajouterqu’en vertu de l’article 126, la touchovka…&|160;», comme ilachevait d’écrire ce mot, une goutte d’encre tomba sur la feuille,qu’il s’empressa de lécher avec sa langue, puis il retomba enarrière, avec un sourire angélique et s’endormit comme unbienheureux.
Au matin, le brigadier commença à faire un telconcert avec ses ronflements qu’il réveilla Chvéïk. Celui-ci seleva, secoua le brigadier comme un prunier et se recoucha aussitôt.Un instant plus tard, les coqs se mirent à chanter et lorsque lesoleil se leva, la bonne madame Peizler franchit la porte du postede gendarmerie. Fatiguée par les nombreuses courses qu’elle avaitdû faire dans la nuit, elle avait dormi plus longtemps que decoutume. Elle trouva cependant les portes ouvertes et les troishommes plongés dans un profond sommeil. La lampe à pétrole de lachambre de garde jetait une dernière lueur sur la table. LaPeizlerka sonna l’alerte et réveilla Chvéïk et son brigadier.
Elle déclara brusquement à cedernier&|160;:
–&|160;Vous n’avez pas honte de roupiller là,tout habillé comme des cochons&|160;! Quant à vous, dit-elle en setournant vers Chvéïk, vous pourriez au moins boutonner votrebraguette lorsque vous êtes en présence d’une femme&|160;!
Puis elle bouscula le brigadier et luiconseilla d’aller vivement réveiller son adjudant.
–&|160;Vous êtes bien tombé, dit-elle àChvéïk, ce sont deux poivrots. Ils avaleraient leur nez s’ilspouvaient le transformer en vodka. Ces cochons ne m’ont jamaispayée depuis que je fais le ménage chez eux, et chaque fois quej’en parle à l’adjudant il me dit&|160;: «&|160;Taisez-vous,vieille sorcière, ou je vous fais coffrer. Nous savons que votrefils fait du braconnage et qu’il vole du bois à la forêtseigneuriale.&|160;» – C’est comme ça que je peine chez eux pourrien depuis quatre ans.
La vieille soupira amèrement etajouta&|160;:
–&|160;Surtout, méfiez-vous de ce bougred’adjudant. Il est mielleux, et ça n’en est pas moins une canaille.S’il le pouvait, il ferait coffrer tous les gens qu’ilrencontre.
Cependant, éveiller l’adjudant n’était pas unetâche facile. Le brigadier eut toutes les peines du monde à lepersuader qu’il faisait déjà grand jour.
Lorsque le chef de poste se fut bien étiré,frotté les yeux, il se rappela brusquement les événements de laveille.
–&|160;Il s’est sauvé&|160;! s’écria-t-il enbondissant.
–&|160;Pour qui le prenez-vous&|160;? Vousoubliez, que c’est un gentilhomme&|160;! répondit sonsubordonné.
Le brigadier se mit à marcher de long en largedans la chambre de son supérieur. Il prit en passant devant latable une feuille de papier pour la rouler en boule, ce quiindiquait clairement qu’il était gravement préoccupé.
L’adjudant le suivit des yeux un instant,puis, il s’écria&|160;:
–&|160;Paraît, brigadier, que j’ai encore faitdu pétard, quoi&|160;!
Le brigadier répondit d’une voix pleine dereproche&|160;:
–&|160;Si vous saviez ce que vous avezbaragouiné&|160;! Tout ce que vous nous avez raconté&|160;!
Il se pencha vers l’adjudant etajouta&|160;:
–&|160;Vous lui disiez que nous, les Tchèqueset les Russes, nous sommes des frères et que Nicolas Nikolaievitchentrerait à Prérov la semaine prochaine, que l’Autriche netiendrait pas longtemps et qu’il devait toujours nier, sans arrêt,jusqu’à la gauche, embrouiller les choses, gagner du temps jusqu’àce que les cosaques viennent le délivrer. Vous ajoutiez encore quetout craque chez nous, que tout se passera comme au temps de laguerre des Hussites, que les paysans, fléau en main, marcheront surVienne, que l’Empereur n’est qu’un vieil idiot, qu’il ne tarderapas à mordre la poussière, que le kaiser Guillaume n’est qu’unesale bête, et vous lui avez promis également de lui envoyer del’argent lorsqu’il serait en prison, afin qu’il puisse améliorerson ordinaire.
Le brigadier fit quelques pas, puis ilajouta&|160;:
–&|160;Tout cela, je l’ai bien entendu car audébut je n’étais pas encore saoul, mais ensuite je ne me rappelleplus très bien ce qui s’est passé.
L’adjudant, alors, regarda sévèrement sonbrigadier.
–&|160;Et moi, dit-il, je me souviens fortbien de ce que vous avez débité hier. Vous avez déclaré que nousn’étions pas de taille à lutter avec la Russie et vous vous êtesmis à hurler devant la porte, comme un possédé&|160;: «&|160;Vivela Russie&|160;!&|160;»
Le brigadier poursuivit nerveusement sapromenade dans la chambre.
–&|160;Et, en plus de cela, ajouta l’adjudant,vous vous êtes mis à vomir comme une bête, puis vous vous êtes jetésur votre plumard et vous avez ronflé toute la nuit comme unelocomotive.
Le brigadier resta un instant muet devant lafenêtre, puis tambourinant du doigt sur les carreaux, ilrépondit&|160;:
–&|160;Pour vous, ce qui est encore pire, monadjudant, c’est que vous avez raconté un tas de blagues devant lavieille. Je me rappelle de ce que vous lui avez déclaré&|160;:«&|160;Sachez, lui avez-vous dit, que les empereurs et les rois nesongent qu’à leur poche, et s’ils font la guerre, c’est pour mieuxles remplir.&|160;»
–&|160;Vrai&|160;? c’est ce que j’aidit&|160;?
–&|160;Parfaitement, c’est ce que vous luiavez dit avant d’aller à la cour pour rendre. Vous avez même crié àla Peizlerka&|160;: «&|160;Eh, vieille pantoufle&|160;! mets-moi ledoigt dans le gosier&|160;!&|160;»
–&|160;Bon, coupa l’adjudant d’un ton sec,mais vous aussi vous avez raconté de jolies histoires. Où diableavez-vous péché cette idiotie&|160;: que Nicolaï Vitz serait roi deBohême&|160;?
–&|160;Je… je ne me rappelle plus, répondit lebrigadier.
–&|160;Ah&|160;! ah&|160;! vous ne vousrappelez plus&|160;! Réfléchissez donc un peu&|160;! Vous avez faitpar-dessus le marché des yeux de cochon à la vieille, et, au lieude sortir par la porte, vous êtes monté sur le fourneau.
Le chef et le brigadier demeurèrent longtempssilencieux, puis l’adjudant déclara&|160;:
–&|160;Je vous ai toujours dit que l’alcoolvous serait fatal. Vous n’êtes pas assez solide pour commettre desexcès de ce genre… et si le détenu nous avait plaqués&|160;? Bondieu, comme la tête me tourne…
–&|160;Je pense, poursuivit l’adjudant,quelques instants après, que justement le fait qu’il n’a pascherché à se sauver prouve à quel point cet homme-là est dangereux.À l’interrogatoire, là-bas, il ne cessera de répéter qu’il avait laroute libre, que nous étions ivres-morts&|160;; et qu’il aurait pus’échapper mille fois s’il l’avait voulu, s’il avait été réellementcoupable… Heureusement, on ne prête pas trop attention aux dires deces gens-là, et si nous affirmons tous deux, sous serment, que toutcela n’est qu’un mensonge grossier, il aura beau invoquer le bonDieu lui-même, il ne fera qu’aggraver son cas. Évidemment, cela nechangera rien à son affaire… Mon dieu, la tête me faitmal&|160;!
Au bout de quelques minutes, l’adjudant repritla parole&|160;:
–&|160;Brigadier, appelez la vieille.
–&|160;Mère Peizlerka, dit-il en regardantsévèrement la vieille dans les yeux, allez me chercher un crucifixsur un socle et apportez-le-moi ici.
Comme la vieille femme le regardait avec desyeux à la fois effrayés et interrogateurs, il ajouta&|160;:
–&|160;Allez, oust&|160;! et tâchez de revenirrapidement&|160;!
L’adjudant retira deux cierges qui setrouvaient sur son bureau, et sur lesquels on voyait des traces decire à cacheter, il les posa sur la table et lorsque Peizlerkarevint avec le crucifix il lui dit d’un ton tragique en allumantles deux cierges&|160;:
–&|160;Asseyez-vous, mère Peizler&|160;!
La bonne femme s’affaissa sur le canapé et semit à regarder stupidement l’adjudant, les cierges et le crucifix.La peur l’envahissait peu à peu et ses mains nouées sur sontablier, ainsi que ses genoux, se mirent à trembler.
L’adjudant alla droit vers elle et, s’arrêtantà un pas de la vieille femme, déclara d’un ton solennel&|160;:
–&|160;Vous avez été témoin hier soir d’ungrand événement. Il est bien possible que, stupide comme vousl’êtes, vous n’ayez rien compris à ce que vous avez vu. Ce soldat,ajouta-t-il, est un indicateur ennemi, c’est un espion&|160;!
–&|160;Jésus Marie&|160;! s’écria la vieille.Oh&|160;! Sainte Vierge de Skopchitz&|160;!
–&|160;Silence, vieille&|160;! Pour obtenirdes aveux nous avons été obligés de lui raconter toutes sortes deboniments. Vous avez entendu toutes les balivernes que nous luiavons dites&|160;?
–&|160;Ça, je les ai bien entendues, réponditla mère Peizlerka d’une voix blanche.
–&|160;Mais sachez, mère Peizler, que tous cesbavardages avaient un but&|160;: celui de mettre l’espion enconfiance. Et nous y sommes parvenus, nous l’avons obligé à semettre à table. Il a mordu à l’appât.
L’adjudant s’interrompit un instant pourrégler la flamme du cierge, puis il continua plus gravementencore&|160;:
–&|160;Vous étiez là et vous connaissez parconséquent ce secret d’État. Car il ne s’agit de rien moins qued’un secret d’État. Vous devez garder un silence absolu sur cetteaffaire, même à votre lit de mort, sans quoi on vous refuseral’accès du cimetière.
–&|160;Jésus Marie, sanglota la vieille, quelmalheur que le jour où j’ai mis le pied dans cette maisonmaudite&|160;!
–&|160;Ne gueulez pas tant&|160;! Levez-vousplutôt et approchez-vous de ce crucifix. Mettez les deux doigts dela main droite dessus. Vous allez faire un serment. Répétez aprèsmoi.
La Peizler se traîna tout en pleurant vers latable.
–&|160;Pardonne-moi, larmoya-t-elle, sainteVierge de Skopchitz, d’avoir mis les pieds dans cette maison…
Penchée sur le visage torturé du Christ,debout devant la flamme des cierges, tout ce cérémonial étrangeapparaissait à la bonne femme comme un terrifiant mystère.
Elle leva deux doigts sur le crucifix etrépéta les paroles que l’adjudant lui dictait d’un ton pleind’importance et de solennité&|160;: «&|160;Je jure devant le Dieutout-puissant et devant vous, Monsieur l’adjudant, que je neparlerai jamais, même à l’heure suprême de ma mort, des événementsdont j’ai été témoin ici-même. Quand bien même je serais interrogéelà-dessus.&|160;»
–&|160;Embrassez le crucifix, vieille, ordonnal’adjudant après que la Peizler eût juré en sanglotant.
Puis elle se signa.
–&|160;Bon. Et maintenant emportez ce crucifixoù vous l’avez pris et dites, si l’on vous interroge, que nous enavons eu besoin pour un interrogatoire.
La Peizler, profondément émue, se retira surla pointe des pieds. Dans la rue, elle se retournait à chaque paspour regarder le poste de gendarmerie comme si elle voulait seconvaincre que tout ce qui venait de se passer n’était pas dudomaine du rêve, mais bien de la réalité.
L’adjudant, après son départ, se mit àrecopier son rapport qu’il avait souillé la veille par cette tached’encre que, dans son ivrognerie, il voulait enlever avec salangue, léchant toute l’écriture comme si c’eût été de lamarmelade.
Il s’aperçut, en le mettant définitivement aupoint, qu’un détail de cette affaire n’avait pas encore étéélucidé. Il fit appeler Chvéïk et lui demanda&|160;:
–&|160;Connaissez-vous laphotographie&|160;?
–&|160;Oui, mon adjudant.
–&|160;Pourquoi ne portez-vous pas sur vous unappareil&|160;?
–&|160;Parce que je n’en ai pas.
–&|160;Et si vous en aviez un, est-ce que vousprendriez des photos&|160;?
–&|160;Sans doute, peut-être… si j’en avaisun… répondit Chvéïk flegmatique, supportant sans sourciller leregard sévère de l’adjudant.
Le chef de poste ressentait à ce moment-là sonmal de tête avec une telle violence qu’il se sentait incapabled’imaginer une nouvelle question. Aussi poursuivit-il en ces termesdans la voie où il s’était engagé&|160;:
–&|160;Et dites-moi encore… vous serait-ildifficile de photographier une gare&|160;?
–&|160;Mais pas du tout, répondit Chvéïk,puisqu’une gare ne bouge pas, qu’elle reste toujours à la mêmeplace et qu’on n’est même pas obligé de lui dire&|160;:Souriez.
Après le départ de Chvéïk, l’adjudant se hâtade compléter son rapport&|160;:
«&|160;J’ai l’honneur d’ajouter au présentquestionnaire n°&|160;2.172… que sous les questions serrées de moninterrogatoire, l’espion a reconnu qu’il connaît parfaitement laphotographie et qu’il tient surtout à des prises de vues de gares.Nous n’avons trouvé aucun appareil sur lui, mais tout fait supposerqu’il le dissimule quelque part. Toutes ces conclusions ont étéconfirmées par l’aveu même du détenu qui prétend qu’il voudraitbien photographier une gare s’il avait un appareil surlui.&|160;»
L’adjudant, dont la tête devenait de plus enplus lourde, s’embrouillait terriblement dans cette affaire dephotographie&|160;:
«&|160;Il paraît certain, surtout après l’aveudu détenu, qu’il n’a été empêché de photographier les gares etautres lieux d’importance stratégique, que par le fait qu’iln’avait pas d’appareil sur lui. Nul doute qu’il eût réalisé sondessein si l’appareil caché par ses soins, s’était trouvé à saportée. Par cette seule circonstance qu’il n’avait pas son appareilavec lui, s’explique le fait que nous n’avons pas trouvé sur lui dephotographies…&|160;»
–&|160;Cela suffira, se dit l’adjudant.Et il s’appliqua à dessiner une bellesignature. Fort content de son œuvre il dit au brigadier&|160;:
–&|160;C’est tout à fait réussi, voyez-vous,c’est comme ça que l’on doit rédiger un bon rapport, affirma-t-ilfièrement. Tout est dedans. L’interrogatoire, sans doute, n’est paschose facile, mais l’essentiel c’est surtout de rédiger un beaurapport qui fera pâlir d’envie, là-bas, ces messieurs de laProvinciale. Maintenant, ramenez-moi notre prisonnier pour terminernotre tâche.
–&|160;Le brigadier va vous conduire à Pisek,déclara-t-il à Chvéïk, au commandant du district. Suivant nosinstructions, nous devrions vous mettre les menottes. Mais commej’ai l’impression que vous êtes un honnête homme, nous vous endispenserons. J’espère qu’en route vous ne ferez aucune tentativepour vous évader.
L’adjudant, visiblement ému de l’expressioncandide de Chvéïk, ajouta&|160;:
–&|160;Et ne m’en veuillez pas. Tenez,brigadier, voici le rapport.
–&|160;Bien au plaisir, mon adjudant, saluaChvéïk, qui se sentait tout ému à l’idée de se séparer d’un hommeaussi charmant. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.Si j’en ai l’occasion, je vous écrirai, ou si je passe un jour parvotre village, je viendrai vous dire bonjour.
Chvéïk referma doucement la porte derrière luiet s’éloigna dans la rue en compagnie du brigadier. Celui qui lesaurait vus marcher ainsi côte à côte, en train de deviseramicalement, aurait cru certainement qu’il s’agissait de deux bonscopains qui se rendaient ensemble à la ville et, peut-être même, àl’église.
–&|160;Je n’aurais jamais supposé que lechemin était si compliqué pour se rendre à Budeiovitz, racontaitChvéïk au brigadier. Cela me rappelle l’histoire qui est arrivée àun certain boucher, nommé Chaura, de Kobylis. Il avait échoué unenuit au monument de Paleatsky, à Prague, et il n’a fait que tournerautour jusqu’au matin, car il croyait marcher le long d’un murinterminable. Au matin, il était tellement exténué de fatigue que,désespéra, il se mit à crier&|160;: «&|160;À moi,police&|160;!&|160;» Et lorsque les policiers sont arrivés encourant, il leur demanda simplement par où il devait passer pour serendre à Kobylis, car, disait-il, je trotte depuis 5 heures le longde ce mur et je n’arrive jamais au bout. Là-dessus, les agentsl’ont empoigné et amené au violon où ils l’ont si bien passé àtabac, qu’il en est resté estropié.
Le brigadier garda le silence. Il secontentait de penser&|160;: «&|160;Tu as beau me raconter tout ceque tu voudras avec ton Budeiovitz et ton histoire de mur, avecmoi, ça ne prend pas&|160;!&|160;»
Ils passèrent devant un lac et Chvéïk demandaavec curiosité s’il y avait beaucoup de gens qui se livraient à lapêche nocturne et si elle était interdite.
–&|160;Chez nous, répondit le brigadier, toutle monde braconne. Les braconniers ont voulu noyer dans ce lac leprédécesseur de M.&|160;Flanderka. Le garde champêtre a beau tirerdans le derrière avec de la chevrotine, cela ne les dérange guère,car ils ont le fond de leur culotte doublé d’une plaque de tôle. Lebrigadier parla encore du progrès en général, des inventionsnouvelles, des attrape-nigauds avec lesquels les gens sedépouillent les uns les autres, puis il développa sa théorie,suivant laquelle la guerre était une excellente chose pour le genrehumain, car dans la tuerie générale, disait-il, à part quelqueshonnêtes hommes qui disparaîtront, cela permettra de nettoyer lemonde d’un grand nombre de voyous.
–&|160;Il y a trop de monde sur la terre,déclara-t-il. Et, au fait, je pense qu’un petit verre ne pourraitque nous faire du bien. Mais ne dites à personne que je vousconduis à Pisek. Il s’agit d’un secret d’État.
Le brigadier songea aux instructions querecevaient les postes de gendarmerie concernant les élémentssuspects ou subversifs que l’on devait conduire d’une ville àl’autre «&|160;en ayant soin de ne pas permettre qu’ils se mêlentau restant de la population, de les empêcher rigoureusement decauser avec qui que ce soit en cours de route.&|160;»
–&|160;Surtout, recommanda le brigadier,gardez-vous bien de dire quelle sorte de type vous êtes&|160;! Celane regarde personne. Surtout ne semez pas la panique&|160;! Lapanique, c’est le plus grand malheur des temps de guerre&|160;!Vous dites un seul mot, et une heure après tout le patelin lerépète&|160;; vous comprenez&|160;?
–&|160;Bien, je tâcherai de ne pas semer lapanique, déclara Chvéïk.
Et il tint parole, car lorsque le patron dubistro commença à l’interroger, il lui répondit&|160;:
–&|160;Mon frère, que voici, m’a dit que nousserions dans une heure à Pisek.
–&|160;Ah&|160;! je comprends, répondit lepatron du bistro en s’adressant au gendarme. Votre frère est doncen permission&|160;?
–&|160;Mais oui, il faut justement qu’ilrejoigne son corps aujourd’hui, répondit le brigadier sanssourciller.
–&|160;Il a gobé la blague, fit-il observer enriant, lorsque le bistro les quitta tous deux pour aller servird’autres clients. Surtout, répéta-t-il, pas de panique&|160;!N’oublions pas que nous sommes en guerre&|160;!
Le brigadier péchait vraiment par excès demodestie en déclarant à l’entrée du café qu’il allait boire unverre. Lorsqu’il arriva au douzième, il affirma que le commandantdu district restait toujours à table jusqu’à 3 heures del’après-midi, et qu’il était, par conséquent, inutile d’arriver àPisek avant ce moment-là. D’autre part, ajouta-t-il, il neige. Detoute façon, Pisek ne se sauvera pas. Nous pouvons nous déclarerheureux. Nous sommes dans un local bien chauffé, alors que là-bas,dans les tranchées, ils doivent en baver avec le temps de chienqu’il fait en cette saison.
Le brigadier ajouta que cette chaleurextérieure devait être compensée par une chaleur intérieure et quela meilleure façon de l’obtenir c’était encore d’absorber certainesvieilles liqueurs. Le patron du cabaret, dans cet endroit perdu, enavait de huit sortes. Comme il s’ennuyait terriblement, il pritplace à côté du brigadier et de Chvéïk et se mit à boire avec eux,cependant que dehors la tempête faisait rage en ébranlant lamaison.
Le brigadier invita le patron à lui tenirtête, le verre à la main. Il lui reprochait sans cesse de sedérober, ce que Chvéïk considérait comme une injustice, car lepatron qui ne pouvait même plus se tenir debout, voulait à toutprix jouer aux cartes. Il déclara avoir entendu la canonnade ducôté de l’est.
Le brigadier balbutia en hoquetant&|160;:
–&|160;Surtout, pas de panique&|160;! Nousavons reçu des instructions, des instructions secrètes…
Et il se mit à expliquer de quoi ils’agissait. Le patron ne comprit pas grand’chose à toutes ceshistoires, mais il se leva pour déclarer que, de toute façon, on negagnerait pas la guerre avec des instructions de ce genre.
La soirée était déjà fort avancée lorsque lebrigadier décida qu’ils allaient se remettre en route pour Pisek.Il neigeait si fort que Chvéïk et lui ne voyaient pas à un pasdevant eux. Le brigadier ne cessait d’encourager son compagnon enlui disant&|160;: «&|160;Toujours droit devant tonnez&|160;!&|160;»
Comme il le répétait pour la troisième fois,sa voix ne parvint plus à Chvéïk de la hauteur d’où elle aurait dusortir, mais bien d’en bas, de quelque part, dans une sorte defossé. S’aidant de son fusil, le brigadier parvint pourtant à serelever, et il continua sa route en s’écriant&|160;:«&|160;Toboggan&|160;!&|160;»
Chvéïk l’entendit tout à coup quihurlait&|160;: «&|160;Je tombe&|160;! Panique&|160;!&|160;» Mais,pareil à une fourmi courageuse qui se relève après chaque chute etse remet en route, le brigadier se remit debout sur ses jambes.Cinq fois, il dégringola dans le fossé et, à la cinquième,lorsqu’il rejoignit Chvéïk, il balbutia d’une voixdésespérée&|160;:
–&|160;Je risque fort de vous perdre.
–&|160;N’ayez pas peur, brigadier, réponditChvéïk, attendez, je vais vous donner un tuyau. On va s’attacher.Avez-vous des menottes sur vous&|160;?
–&|160;Un gendarme doit toujours avoir desmenottes, déclara le brigadier. C’est comme qui dirait notre painquotidien.
–&|160;Alors, on va se mettre les menottes,décida Chvéïk. Essayez mon système.
Le brigadier s’exécuta et, en homme du métier,en un clin d’œil, tous deux étaient liés comme des frèressiamois.
Ils avaient beau tomber sur la route, il leurétait désormais impossible de se séparer. Le brigadier entraînaChvéïk dans toutes ses chutes, et lorsqu’il dégringolait dans lefossé, son détenu le suivait comme son ombre. Mais cettegymnastique finit par leur briser les poignets. Le brigadierdéclara&|160;:
–&|160;Ça ne peut pas durer comme ça. Il fautretirer les menottes.
Mais, après de longs et laborieux efforts pourse libérer, il dut s’avouer impuissant&|160;:
–&|160;Nous sommes liés pour toujours,déclara-t-il.
–&|160;Amen&|160;! soupira Chvéïk.
Et il continua stoïquement son douloureuxchemin.
Lorsqu’ils arrivèrent à la caserne degendarmerie, tard dans la soirée, après de multiples avatars, lebrigadier, complètement abattu, confia à Chvéïk&|160;:
–&|160;C’est terrible, nous ne pouvons plusnous séparer.&|160;»
Et cela devint terrible, en effet, lorsquel’adjudant de service fit appeler le commandant, le RitmeisterKonig.
–&|160;Faites sentir votre bouche&|160;!Telles furent les premières paroles du Ritmeister. Je comprendsmaintenant la situation, dit-il&|160;: rhum, kontouchovka, vieuxmarc, quetsch, anisette et vanille. Voyez-vous, adjudant, dit-il ausous-officier qui se tenait respectueusement à côté de lui, voilàprécisément la façon dont un gendarme ne doit jamais se conduire.Une telle attitude est une infraction à la discipline d’une tellegravité qu’elle ne peut être jugée que par le conseil de guerre. Selier avec un détenu et se soûler en cours de route&|160;; avoirl’audace de se présenter devant son supérieur ivre-mort&|160;! Ilsdevaient déambuler dans les rues comme deux cochons&|160;!Libérez-les&|160;! Eh bien&|160;! qu’avez-vous à dire pour votredéfense&|160;? demanda-t-il au brigadier qui levait sa mainengourdie pour le salut, d’un geste gauche.
–&|160;Mon capitaine, j’ai un rapport à vousremettre.
–&|160;Bon. Mais sachez que c’est sur voussurtout que nous ferons un rapport, répondit d’un ton sec leRitmeister. Adjudant, mettez-moi ces deux cochons aux arrêts et dèsdemain matin, vous les conduirez à l’interrogatoire. Prenez lerapport de Putim, étudiez-le un peu et faites-le moi parvenirensuite à la maison.
*
**
Depuis le début de la guerre, de lourds nuagesassombrissaient l’horizon de la caserne de gendarmerie de Pisek.Une atmosphère sinistre y régnait. La foudre bureaucratiquefoudroyait adjudants, sergents, brigadiers et employés civils. Lamoindre peccadille était châtiée avec une rigueur féroce.
–&|160;Si nous voulons gagner la guerre,répétait le Ritmeister, aux postes qu’il visitait, il faut qu’à laplace d’un A se trouve toujours un A, et que le point de l’I nesoit jamais absent.
Il se croyait entouré de traîtres et il étaitpersuadé que chacun de ses subordonnés avait un crime sur laconscience.
Le ministère de la défense nationale lebombardait d’observations indiquant que les soldats du district dePisek, suivant les informations recueillies, désertaient en bandesdevant l’ennemi.
On l’avait obligé à organiser l’espionnageparmi la population de son district. Le Ritmeister savait de bonnesource que la plupart des femmes avaient accompagné leur mariappelé sous les drapeaux jusqu’à la porte de la caserne, en lespoussant au défaitisme. Le Ritmeister savait également que leshommes avaient fermement promis à leur compagne d’éviter de sefaire tuer pour sa majesté le Kaiser.
Les nuages de la révolution avaient peu à peuassombri les couleurs impériales&|160;: noir et jaune. En Serbie etdans les Carpathes, certains bataillons étaient déjà passé avecarmes et bagages à l’ennemi, suivant l’exemple des 28eet 11e de ligne. Et ce 11e régiment,précisément, était composé en majorité des fils du district dePisek. Les gars de Vodnan avaient décoré leur boutonnièred’insignes noirs.
Les soldats de Prague, qui passaient par lagare de Pisek, avaient jeté les cadeaux qui leur avaient étéofferts, à travers la figure des dames de la haute société dePisek.
Un bataillon de marche avait été salué parquelques patriotes juifs aux cris de&|160;: «&|160;À bas lesSerbes&|160;! Vive la guerre&|160;!&|160;» Et les soldats, pour lesremercier, leur avaient flanqué une telle raclée que ces messieursne purent sortir de chez eux durant plusieurs semaines.
Ces symptômes alarmants avaient démontré d’unefaçon éclatante que les hymnes nationaux, joués et chantéssolennellement dans les églises, ne pouvaient plus donner le changesur les sentiments de la population en face de la guerre. Lespostes de gendarmerie, cependant, avaient continué d’envoyer àPutim leur rapport optimiste. Les réponses aux questionnairesofficiels continuaient à affirmer que la mentalité de la populationdemeurait de la catégorie Ia&|160;; l’enthousiasme pour lacontinuation des hostilités de Ia et Ib.
Cependant le Ritmeister faisait l’impossiblepour stimuler ses hommes.
–&|160;Vous n’êtes pas des gendarmes,déclarait-il aux chefs de poste, tout au plus desgardes-champêtres, et il ajoutait&|160;: J’ai l’impression trèsnette que vous vous foutez de la guerre et des devoirs qu’on exigede vous&|160;!
Là-dessus suivaient de longues péroraisons surles devoirs du gendarme en temps de guerre, une conférence sur lasituation générale, et enfin le commandant de gendarmeriesoulignait énergiquement la nécessité de prendre en main lesleviers de commandement d’une façon énergique pour assurer l’ordre.Après avoir fait à ses hommes la description du gendarme parfait,qui ne songe qu’à renforcer l’autorité de la monarchieautrichienne, il reprenait ses injures, ses menaces, appliquait sesmesures disciplinaires&|160;: déplacements, etc.
Le Ritmeister, depuis qu’il a vu rappliquer legendarme en état d’ébriété, est plus fermement convaincu que jamaisque ses subordonnés, sans exception, ne sont qu’un tas de cochonset de paresseux, qui préfèrent fréquenter les bistros qu’assurerloyalement leur service. De plus, il était amené à cette déductionlogique&|160;: que ses subordonnés, étant assez mal payés, devaientse faire graisser la patte pour s’adonner à la boisson, et qu’ilétait impossible, avec de pareilles gens, de maintenir la paixintérieure en Autriche. Le Ritmeister se mit à étudier le rapportdu chef de poste de Putim sur Chvéïk. Devant lui se tenait son brasdroit, l’adjudant Matheika, qui se disait que le diable ferait biend’emporter le Ritmeister avec tous ses rapports, car on l’attendaitau café du coin pour faire une partie de «&|160;Chnops&|160;».
–&|160;Il me semble vous avoir dit, Matheika,s’écria le Ritmeister, que le plus grand idiot que la terre portese trouve au poste de Putim. Le soldat qu’il a fait conduire cheznous, hier, n’est pas plus un espion que vous ou moi. Tout au plusun simple déserteur. Il note dans son rapport, ce sombre idiot, detelles balivernes que n’importe quel enfant, à première vue,pourrait s’apercevoir que ce chef de poste était soûl comme unPolonais lorsqu’il le rédigea.
–&|160;Amenez-moi cet homme, ordonna-t-il,après avoir parcouru avec attention le chef-d’œuvre de l’adjudant.Il ne m’a jamais été donné de contempler une aussi belle collectiond’idioties que celle qui se trouve dans ce rapport. Et par-dessusle marché il me fait conduire cet individu par ce chameau debrigadier&|160;! Si ces messieurs ne me connaissent pas encore, jeleur apprendrai qui je suis&|160;! Je leur promets de leur en fairebaver&|160;!
Et le Ritmeister s’étendit longuement surl’incompétence de ses subordonnés qui se moquent royalement desordres qu’ils reçoivent.
–&|160;Lorsqu’ils rédigent un rapport,s’écria-t-il, ils n’y mettent que des inepties et, au lieud’éclaircir une question, se plaisent à l’embrouiller. Pour peu queleurs supérieurs attirent leur attention sur les dangersd’espionnage, ils se mettent à arrêter les premiers hommes quipassent à leur portée. Si la guerre devait durer encore quelquetemps, ajouta le commandant, notre district se transformerait parla faute de ces gens-là en une maison d’aliénés.
Il donna ordre ensuite à l’adjudant Matheikade faire expédier un télégramme à ce chef de poste, le convoquantpour le lendemain à Pisek.
–&|160;De quel régiment avez-vousdéserté&|160;? demanda-t-il à Chvéïk dès que celui-ci entra dansson bureau.
–&|160;Je n’ai pas déserté, moncommandant.
Le Ritmeister dévisagea attentivement Chvéïket il lut une telle candeur dans ses yeux qu’il le prit pour unvagabond et lui demanda&|160;:
–&|160;Où avez-vous volé cetuniforme&|160;?
–&|160;On m’a donné ce costume, réponditChvéïk, avec un bon sourire d’enfant, lorsque je suis arrivé au91e régiment de ligne, je n’ai pas plaqué mon régiment,au contraire…
Cette déclaration de foi fut lancée d’unaccent si ferme que le Ritmeister, étonné, hocha la tête. Ildemanda avec curiosité&|160;:
–&|160;Expliquez-moi alors comment vous avezété arrêté&|160;?
–&|160;C’est tout simple, mon commandant,répondit Chvéïk. Je suis en route pour mon régiment, je m’efforcede parvenir à le rejoindre et je n’ai jamais eu l’intention dedéserter, d’autant plus que tout le régiment attend après moi. Maisc’est la faute de M.&|160;le chef de poste de Putim. Il m’a montrésur sa carte que Budeiovitz se trouve dans le sud et il m’envoiedans le nord…
Le Ritmeister fit un mouvement de la maincomme pour indiquer qu’il savait à quoi s’en tenir sur sonsubordonné.
–&|160;Vous êtes donc à la recherche de votrerégiment&|160;? demanda-t-il à Chvéïk, et vous ne parvenez pas à lerejoindre&|160;?
Chvéïk le renseigna sur sa situation. Il nommaTabor et toutes les localités qu’il avait traversées en espérantparvenir enfin à Budeiovitz.
Puis, il lui raconta avec un enthousiasmecroissant, sa lutte contre la malchance qui le poursuivait, lesefforts héroïques qu’il avait faits, bravant tous les obstacles,pour essayer d’arriver à son régiment, et les mauvais tours que lesort lui avait joués pour rendre vains ses efforts.
Il parlait avec une telle ardeur, que leRitmeister vit clairement devant lui, le cercle magique quientourait le brave soldat Chvéïk, et dont celui-ci était incapablede sortir.
–&|160;Mais c’est un véritable travaild’hercule&|160;! dit-il, après avoir écouté jusqu’à la fin lalongue histoire de Chvéïk.
–&|160;On aurait pu déjà, à Putim, mettre finà cette affaire, remarqua Chvéïk, si pour mon malheur, je n’étaistombé sur M.&|160;l’adjudant Flanderka. Tout ce que je lui disaislui paraissait suspect. S’il m’avait fait conduire directement àBudeiovitz, on lui aurait expliqué, là-bas, que je suisvéritablement le soldat Joseph Chvéïk, et non un personnagesuspect. Si M.&|160;l’adjudant avait agi ainsi, j’accompliraisdepuis deux jours mes devoirs militaires.
–&|160;Pourquoi n’avez-vous pas expliqué auchef de poste que vous étiez victime d’une erreur&|160;?
–&|160;Parce que j’ai bientôt reconnu, moncommandant, que c’était inutile. Notre bon vieux bistro Rampa avaitl’habitude de dire que lorsque quelqu’un veut boire à crédit, tousles raisonnements du monde n’arriveront pas à lui prouver lecontraire.
Le Ritmeister ne perdit pas son temps àréfléchir. Il se dit qu’un pareil manque d’orientation venant de lapart d’un homme qui, de toute apparence, était fermement décidé àrejoindre son corps ne pouvait être qu’un signe de dégénérescencetotale et il se mit à dicter le rapport suivant&|160;:
«&|160;Au 91e régiment de ligneimpérial et royal, à Budeiovitz.
«&|160;Nous vous remettons le soldat JosephChvéïk, appartenant, suivant ses affirmations, au régiment de ligneci-dessus nommé. Cet homme, arrêté par la station de gendarmerie dePutim, district de Pisek, nous paraît suspect de désertion. Lesusnommé déclare avoir voulu se rendre à son régiment. Signalementdu prisonnier&|160;:
«&|160;Taille moyenne, visage normal, nezrond, yeux bleus, signe particulier néant.
«&|160;À l’annexe B&|160;1, vous trouvereznotre note de service concernant les frais de nourriture du soldatChvéïk. Vous êtes instamment priés de nous rembourser parl’intermédiaire du ministère de la défense nationale. Nous vousprions également de bien vouloir signer la feuille remise audétenu. À l’annexe B&|160;2, vous voudrez bien vérifier la listedes objets militaires que le détenu avait sur lui au moment de sonarrestation.&|160;»
Après sa longue odyssée, Chvéïk eutl’impression de se rendre à Budeiovitz avec la rapidité del’éclair. Son compagnon de route, un tout jeune gendarme, n’avaitpas osé durant tout le trajet, quitter Chvéïk tant il avait peurque son détenu lui échappât. Pendant tout le voyage ce problème lepréoccupa&|160;:
–&|160;Et si par malheur, j’étais obligé de merendre au cabinet, comment diable ferais-je&|160;?
Il décida, si cette éventualité se présentait,de placer Chvéïk en sentinelle devant la porte.
Lorsqu’ils descendirent du train, le gendarmeentretint Chvéïk, comme par hasard, du nombre de balles qu’ungendarme doit avoir sur lui lorsqu’il escorte un détenu. Cesconfidences ne troublèrent pas Chvéïk, le moins du monde&|160;; ilrépondit d’un air convaincu qu’il tenait la chose pour impossible«&|160;car, ajouta-t-il, en tirant sur son détenu, le gendarmes’exposerait à tuer un passant&|160;».
Le gendarme combattit vivement cette opinionet les deux hommes parvinrent à la caserne sans avoir pu se mettred’accord sur ce point délicat.
Le lieutenant Lukach se tenait paisiblementdans son bureau lorsque la porte s’ouvrit et son ordonnance apparutdevant lui.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je suis rentré, dit Chvéïk d’un air solennel, en lesaluant.
L’enseigne Kotatko était présent à cemoment-là. Il raconta plus tard qu’à la vue de Chvéïk, lelieutenant Lukach fit un bond, serra sa tête entre ses mains, ets’affaissa brusquement sur son siège. Revenant à lui, il prit d’unemain tremblante les papiers de Chvéïk, signa et pria l’enseigne dele laisser seul avec son ordonnance. Il déclara au gendarme quetout était en règle et il s’enferma dans son bureau.
C’est ainsi que l’anabase de Budeiovitz setermina pour Chvéïk. Mais il est hors de doute que si Chvéïk avaitdisposé de toute sa liberté d’action, il n’en aurait pas moinsrejoint son corps en toute diligence. Si toutefois les autoritésmilitaires s’avisaient de prétendre que c’est à elles que revientl’honneur d’avoir ramené Chvéïk dans le droit chemin de ladiscipline, ce serait de leur part une odieuse vantardise.
*
**
Une fois seuls, Chvéïk et le lieutenant Lukachse regardèrent fixement&|160;; la stupeur, l’horreur et ledésespoir se lisaient clairement dans les yeux du lieutenant,cependant que ceux de Chvéïk brillaient d’un regard affectueux ettendre.
Durant quelques minutes, un silence de mortrégna dans le bureau.
Dans le couloir voisin on entendait un bruitde pas. C’était un aspirant zélé qui, exempt de service pour unrhume, – ce que l’on pouvait constater par sa voix nasillarde, –était en train de réciter un paragraphe de son manuel concernant laréception de la famille impériale dans une forteresse.
On l’entendit déclamer&|160;: «&|160;Dès quele haut personnage arrive à proximité du fort, les canons tirentune salve en son honneur. Le commandant de la place, à cheval, seprésente au galop, salue le haut personnage et seretire…&|160;»
–&|160;Ta gueule, là-bas&|160;! s’écria lelieutenant en ouvrant brusquement la porte. Allez à tous lesdiables&|160;!
L’aspirant se précipita à l’autre bout ducorridor et la voix nasillarde, qui continuait à réciter la leçon,ne parvint plus dans le bureau que d’une façon assourdie&|160;:«&|160;Au moment où-le commandant salue, une nouvelle salve decanons sera tirée à la descente de voiture du hautpersonnage…&|160;».
Muet, le lieutenant Lukach et Chvéïk setenaient immobiles l’un en face de l’autre. Enfin, le lieutenants’écria, plein d’une ironie mordante&|160;:
–&|160;Je vous souhaite la bienvenue àBudeiovitz, monsieur Chvéïk&|160;! il est écrit dans les SaintesÉcritures que celui qui doit être pendu ne se noie pas&|160;! Ons’occupait déjà de vous rechercher&|160;; vous serez présenté dèsdemain au colonel. Quant à moi, je ne veux plus être embêté à causede vous&|160;! J’en ai marre de vous et de vos histoires&|160;!Vous avez eu le bout de ma patience&|160;! Je me demande même àcette heure, comment j’ai pu vivre si longtemps en compagnie d’unidiot tel que vous&|160;!
Et il se mit à marcher dans le bureau avecfureur.
–&|160;Non, mais… c’est tout simplementabominable&|160;! Je me demande ce qui me retient de vousabattre&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant…
–&|160;Nom de dieu&|160;! ne recommencez pas àvenir me raconter vos boniments&|160;! J’en ai assez, vous dis-je.Vous reculez les bornes de la bêtise&|160;! J’espère, d’ailleurs,que vous n’allez pas moisir ici. La prison vous attend.
Le lieutenant Lukach se frotta les mains avecsatisfaction.
–&|160;C’en est fini avec vous, mon vieux,dit-il.
Il retourna à sa table, traça quelques motssur un formulaire, appela la sentinelle et lui ordonna de conduireChvéïk au geôlier.
Lukach, avec une profonde joie, vit Chvéïktraverser la cour, le geôlier qui s’avançait vers lui, et quiouvrait toute grande ensuite la porte, sur laquelle était marqué enlettres noires, le mot&|160;: Prison.
–&|160;Que Dieu soit loué&|160;! Je ne lereverrai pas de si tôt, fit le lieutenant Lukach en poussant unsoupir.
*
**
En entrant dans les ténèbres de la tour dessupplices de la caserne Marie, Chvéïk fut salué par un aspirant,jovial et gras, qui s’étirait sur le bat-flanc d’une cellule. Ilétait le seul détenu et se mourait d’ennui. Chvéïk lui ayantdemandé pourquoi il se trouvait là, l’aspirant lui réponditqu’étant légèrement pris de boisson, il avait giflé par erreur unlieutenant d’artillerie, sur la place du Marché.
–&|160;Si je considère l’affaire de plus près,dit-il, je ne l’ai même pas giflé pour de bon, je lui ai seulementpoussé le képi sur le nez.
L’histoire s’était passée de la façonsuivante&|160;: le lieutenant d’artillerie attendait, sans doute,une poule quelconque. Il tournait le dos à l’aspirant et celui-cile prit par derrière, pour un de ses copains, un certain FrantzMaterna.
–&|160;Je me suis gentiment faufilé derrièrelui, raconta l’aspirant, pour lui donner une tape amicale, et jelui ai simplement poussé le képi en lui disant&|160;: salut,Frantz&|160;! Et voilà que mon type se met à gueuler, à appeler lapatrouille à son secours, qui m’empoigne et me met en prison.
Il est possible, avoua l’aspirant&|160;; aprèsavoir réfléchi pendant un instant, que je lui ai donné égalementquelques claques, mais, de toute façon, cela ne change rien àl’affaire, puisqu’il s’agissait d’une erreur. Il reconnaît lui-mêmeque j’ai dit&|160;: salut, Frantz&|160;! et son petit nom n’est pasFrantz, mais Ambroise. Tout cela est clair. Mais ce qui peut mecauser le plus de tort, c’est d’avoir filé de l’hôpital, surtout sil’on découvre mon truc avec le cahier des malades.
Lorsque je suis arrivé au régiment,poursuivit-il, j’ai d’abord loué une chambre en ville, puis je mesuis arrangé pour avoir un bon rhumatisme. Je me saoulai trois foisde suite et je passai la nuit hors de la ville, dans un fossé, sousune pluie torrentielle. J’avais eu soin de retirer mes bottes. Maisil n’y a rien eu à faire. Ça n’a pas pris. Je n’ai rien eu. Alorsje me suis amusé à prendre des bains, en plein hiver, dans larivière Malche. Et c’est justement le contraire de ce quej’espérais qui s’est produit&|160;: ma peau s’est durcie d’unetelle façon que j’ai pu me mettre à poil et rester dans la cour dela maison où j’habitais, puis m’allonger dans la neige toute lanuit, et lorsque les locataires m’ont réveillé, le lendemain matin,j’avais les pieds aussi chauds que s’ils avaient été dans despantoufles fourrées.
Pas la moindre angine, pas le moindre rhume.Pas même la goutte militaire, bien que j’aie rendu chaque jourvisite à la maison «&|160;Port Arthur&|160;», et pourtant tous mescopains ont attrapé là toutes sortes de coups de pied de Vénus.Avouez que c’était vraiment de la déveine, cher ami, la guigne,quoi&|160;? Enfin, je fais connaissance ici à Budeiovitz d’unréformé 100&|160;%. Il m’a dit de venir le voir un jour à Loubokéme disant que j’aurais le lendemain les pieds enflés comme desseaux. Il avait chez lui des seringues et c’est à peine si je pusrevenir à la caserne. Ce cher homme n’avait pas trompé mesespérances. J’avais enfin mes rhumatismes dans les jambes.
Aussitôt je suis envoyé à l’hôpital et tout vabien. La chance me sourit encore une fois. Mon beau-frère, ledocteur Measak, a été transféré un beau jour à Budeiovitz, et,grâce à lui, je suis resté à l’hôpital jusqu’à ces derniers jours.Il voulait me faire réformer&|160;: par malheur voilà que jefabrique un cahier des malades. L’idée pourtant n’était pas mal. Jeme suis procuré un gros bouquin, j’ai collé dessus une étiquetteavec cette inscription en grands caractères&|160;: Cahier desmalades du 91e de ligne. Avec des rubriques dedans, desnoms inventés, des courbes de température, diagnostics, etc., etchaque après-midi, après les visites médicales, le «&|160;cahierdes malades&|160;» sous le bras je me faufilais par la grande portepour aller en ville.
Ce sont de vieux territoriaux, qui montent lagarde, de ce côté-là, il n’y avait pas de danger. Il suffisait deleur montrer le cahier et ils me laissaient sortir. Ils merendaient même le salut. Tout allait pour le mieux. Je me rendaischez un ami qui était employé aux contributions indirectes. Là, jechangeais d’habits et nous allions au café où se tenaient desréunions clandestines. Plus tard, mis en confiance, je n’ai mêmeplus pris la peine de changer de costume&|160;; je me suis rendu enuniforme au café et me suis baladé comme cela dans la ville. Ilm’arrivait souvent de rentrer à l’aube et si, la nuit, unepatrouille venait à m’interpeller, je lui montrais mon cahier et onme laissait tranquille. Mais mon imprudence m’a perdu. Lacatastrophe arriva sous la forme de ce malentendu au marché. Lebonheur ressemble à la porcelaine, il se brise facilement. C’estainsi qu’Icare s’est brûlé les ailes. L’homme se croit un géant etil n’est qu’un peu de poussière, mon cher camarade. Il ne fautjamais se fier au hasard, et l’on ferait bien de se donner, matinet soir, une bonne tape sur la nuque pour se rappeler que laprévoyance est la mère de la sûreté, et que le mieux est l’ennemidu bien. Les grandes rigolades ont souvent des lendemainsamers&|160;! C’est une loi de la nature. Je m’en rends compte ensongeant que j’ai définitivement loupé le conseil de révision.Jamais cette occasion ne se représentera.
L’aspirant termina sa confession par cesparoles, prononcées d’une façon solennelle&|160;:
–&|160;Ainsi Carthage a été mise à sac&|160;!Ainsi Ninive a été démolie&|160;! Mais qu’importe, en avant quandmême et haut le cœur, mon ami&|160;! Que ces gens-là ne se fassentpas d’illusions&|160;: ils auront beau m’envoyer au front, je netirerai pas sur l’ennemi. J’ai été exclu de l’écoled’aspirant&|160;! Vive le crétinisme impérial et royal&|160;!Pensez-vous que je vais m’asseoir sur vos banquettes et préparerdocilement vos examens&|160;? Devenir enseigne, sous-lieutenant,lieutenant&|160;! et bien merde alors&|160;! Votre écoled’officiers de réserve, je m’en fous&|160;! Où est-ce que vousportez le fusil, sur l’épaule gauche ou droite&|160;? Combien degalons à un capitaine&|160;? Et leur truc debureaucratie&|160;!
Nous n’avons pas un brin de tabac&|160;! Etmaintenant, que désirez-vous&|160;! Un bock&|160;? Tenez, voici lacruche d’eau, il y a la goutte à boire dedans. Si vous avez faim jevous recommande vivement ce croûton. Si vous vous ennuyez, je vousconseille d’écrire des poèmes, ainsi que je le fais moi-même. Voicile poème épique que je viens de composer&|160;:
Où est le geôlier&|160;? dort-il encore, ce bravehomme,
Sait-il qu’il est le pivot central de l’armée&|160;?
Mais qu’il se lève avant que la bonne
Nouvelle arrive d’un désastre pour notre renommée.
Il ne lui restera qu’à dresser des barricades
À l’aide de nos bat-flanc pour s’opposer à l’ennemi.
Comment oses-tu camarade
Ronfler au moment du péril&|160;!
Comment oses-tu camarade
Ronfler au moment du péril&|160;!
–&|160;Eh bien voilà, cher ami, continual’aspirant, qui oserait dire après cela que le respect du peuplepour notre chère monarchie fout le camp&|160;? Un homme, du fond desa prison, qui n’a même pas une cigarette, que leconseil de guerre attend, écrit de sa propre main des poèmes enl’honneur de son loyalisme. On lui retire sa liberté, et sa bouche,bien loin de faire retentir des imprécations, ne donne naissancequ’à des hymnes pleins d’enthousiasme. «&|160;Morituri te salutant,César&|160;!&|160;» Ceux qui vont mourir te saluent. Mais legeôlier n’est qu’une fripouille&|160;! Majesté, tu as desserviteurs dignes de toi&|160;! Avant-hier, j’ai donné à cepolisson cinq couronnes pour qu’il m’achète des cigarettes et cematin le bonhomme me déclare qu’il est interdit de fumer ici etque, s’il le tolérait, cela lui attirerait des ennuis. Quant auxcinq couronnes, il n’a pas l’air pressé de me les rendre. Je n’aiplus confiance en personne&|160;! On foule ici aux pieds les droitsles plus sacrés du genre humain. Il est honteux qu’on trouve desgens assez dénués de scrupules pour dépouiller un détenu&|160;! Etle misérable, par dessus le marché, chante toute la journée.
Ayant terminé le récit de son histoire,l’aspirant demanda à Chvéïk la raison pour laquelle il avait étéincarcéré.
–&|160;Ainsi, dit-il, après le récit deChvéïk, vous avez passé plusieurs jours à la recherche de votrerégiment&|160;? «&|160;Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beauvoyage&|160;!&|160;» Et vous aussi, vous devez vous rendre aurapport du colonel&|160;? Bravo, frère&|160;! Nous allons donc nousretrouver ensemble sur le lieu de notre supplice. Notre colonel vapouvoir s’amuser. Vous n’avez pas idée de la façon dont il présideaux destinées de ce régiment. Il cavale toute la journée dans lacour de la caserne comme un chien enragé, et la langue lui sort dela bouche, comme s’il était une vulgaire charogne. Il a la manie dedébiter des sentences, des discours, tandis qu’il vous éclaboussede sa bave. Je le connais bien, car j’ai déjà eu à faire avec luiune fois, au rapport.
En arrivant au régiment, je n’avais, bienentendu, que des vêtements civils&|160;: chapeau haut de forme etbottines à boutons. Comme mon tailleur ne m’avait pas encore livrémon uniforme j’ai dû courir à la section des aspirants dans cettetenue. C’est ainsi que je me suis placé dans les rangs et que je mesuis mis en marche avec les copains. Le colonel se rue sur moi avecune telle violence que son cheval fait un brusque écart. «&|160;Nomde Dieu, hurla-t-il d’une telle voix que l’on devait l’entendredans tout Budeiovitz, qu’est-ce que vous foutez ici, espèce debourgeois.&|160;»
Je lui ai poliment répondu que j’étaisaspirant candidat à l’école des officiers de réserve, et quej’étais en train de faire mon devoir. Si vous l’aviez vu&|160;! Ilm’a engueulé pendant une demi-heure, tandis que je le saluais enlevant ma main à la hauteur de mon chapeau haut de forme.Là-dessus, il m’a dit qu’il allait me citer au rapport lelendemain. Puis, blême de fureur, il galope je ne sais où. Uneminute après il revient à la même vitesse, il se remet à gueuler età faire un chambard du diable en se frappant la poitrine et enordonnant qu’on m’amène aussitôt en tôle.
–&|160;Un aspirant, hurlait-il, est quelquechose de sacré&|160;! Vous êtes nos espoirs de gloire militaire, defuturs héros, comme par exemple cet aspirant, nommé Wohltat, qui,dès qu’il a été nommé caporal, a demandé aussitôt à être envoyé aufront. Deux jours après, il faisait à lui seul 15 prisonniers. Aumoment où il les ramenait dans nos lignes, un obus l’a déchiqueté.Cinq minutes après on le nommait au grade d’enseigne. Vous pouvezavoir une carrière aussi brillante que la sienne. Les décorationset l’avancement vous attendent. Votre nom peut être un jour inscritdans le Livre d’Or du régiment.
L’aspirant cracha de dégoût&|160;:
–&|160;Vous voyez, mon cher, continua-t-il,quelles sortes d’animaux bizarres se promènent sur notre terre. Jeme fous pas mal de leurs galons et de leurs avancements&|160;!Quelle belle distinction, en effet, que la sienne lorsqu’ilm’interpellait en ces termes&|160;: «&|160;Aspirant, vous n’êtesqu’un sombre idiot.&|160;» Quel vieil abruti que ce type-là. Moncher, je tiens à vous dire que le bœuf a sur nous un énormeavantage. C’est que, lorsqu’on le traîne vers l’abattoir, on nel’insulte pas auparavant.
L’aspirant s’étira, puis ilcontinua&|160;:
–&|160;Il est bien évident que ça va exploserun jour, que ça ne peut plus durer longtemps. Lorsqu’on m’enverraau front, j’inscrirai sur mon wagon les deux verssuivants&|160;:
On engraisse la terre de notre peau
Vivent les quarante hommes et six chevaux.
Comme il achevait ces mots, la sentinelleapparut, apportant une demi-boule de pain et une cruche d’eau. Sansse lever de son bat-flanc, l’aspirant l’interpella en cestermes&|160;:
–&|160;Salut, notre ange gardien au cœur pleinde pitié. Tu plies sous le poids du panier chargé de toutes sortesde vivres pour nous sustenter, nous rafraîchir et chasser nospeines. Je n’oublierai jamais vos bienfaits. Vous êtes dans cettesombre cellule le clair rayon du soleil qui vient nouséveiller.
–&|160;Nous verrons un peu la gueule que tuferas demain au rapport, grogna la sentinelle.
–&|160;Ne fais pas le méchant, mon gros,riposta le l’aspirant, toujours allongé sur son bat-flanc.Explique-nous plutôt la façon dont tu t’y prendrais pour ramenerdix prisonniers des tranchées ennemies. Connais-tu la loid’Archimède&|160;? Non&|160;? Eh bien, je vais tel’expliquer&|160;: Indique-moi un point fixe dans l’univers et jefais culbuter la terre, si tu me sers de levier. Espèce dechameau&|160;!
La sentinelle ouvrit de grands yeux étonnés,puis dédaigneusement referma la porte.
–&|160;Ici, nous devrions former entre détenusune association de secours mutuels pour l’extermination desgeôliers, dit l’aspirant, tout en faisant de la boule de pain deuxparts égales. D’après l’article 16 du règlement de la prison, lesdétenus, jusqu’au jour de la sentence, ont droit à l’ordinairemilitaire, mais chez nous, c’est la loi du bon plaisir qui règletout.
Chvéïk et l’aspirant s’assirent au bord de labanquette et se mirent à casser la croûte.
–&|160;C’est sur les geôliers, continual’aspirant, que l’on voit le mieux les effets abrutissants de laguerre. Il est à peu près certain que notre gardien, avant departir pour l’armée, était un jeune homme plein de beauxsentiments, tendre, affectueux, un défenseur de la veuve et del’orphelin. Il était sans doute estimé de tous, et aujourd’hui… sije pouvais lui flanquer ma main sur la gueule&|160;! Voilà mon amiles tristes effets de l’abrutissement du métiermilitaire&|160;!
Et l’aspirant se mit à chanter à pleinevoix&|160;:
Elle ne craignait même pas le diable,
Mais un jour elle rencontra un cavalier…
–&|160;Mon cher ami, continua l’aspirant,après ce court intermède vocal, si nous nous plaisions à considérertout cela du point vue de l’intérêt de notre chère monarchie, nousarriverions à cette conclusion que le cas de cet homme estexactement le même que celui de l’oncle de Poutchkine. Ce poète aécrit quelque part que le vieil ivrogne est un hommeirrémédiablement perdu&|160;:
Qu’il soupire et se dise&|160;: Vieille corde
Quand est-ce donc que le diable t’emporte&|160;!
À ce moment, les clefs du geôlier cliquetèrentdans le couloir. La lampe à pétrole fut allumée.
–&|160;La lueur dans l’abîme&|160;! s’écrial’aspirant. Enfin, la lumière pénètre dans l’armée&|160;! Bonnenuit, cher geôlier, et saluez, de notre part vos supérieurs. Jevous souhaite de faire de beaux rêves&|160;! lorsque vous m’aurezrendu cependant les cinq couronnes que je vous avais données pourm’acheter des cigarettes.
Dès que le geôlier fut parti&|160;:
–&|160;Enfin seul, s’exclama l’aspirant. Avantde m’endormir, j’ai pris l’habitude de faire de sérieuses études enmatière de zoologie. Je m’amuse à étudier nos supérieurs. Pouravoir sur la guerre des vues originales, il est indispensabled’étudier d’une façon approfondie l’histoire naturelle ou bienl’ouvrage intitulé&|160;: «&|160;Les sources de la fortune&|160;»édition Kotchi, où à chaque page l’on peut lire&|160;: Bestiaux,volailles, cochons etc. Nous constatons en effet que ces vocablessont fort employés dans les milieux militaires un peu avancés pourdésigner les nouvelles recrues. À la 11e compagnie, lecaporal Althorf se sert souvent de l’expression&|160;:«&|160;Chèvres d’Engadine&|160;», le brigadier Muller préfèreappeler ses hommes&|160;: Putois. Le feldwebel Sondernummeraffectionne tout particulièrement les expressions de&|160;: crapaudou cochons de Yorkshire, et il leur promet gentiment de les faireempailler.
Il donne tant de précisions sur cette besogneque l’on pourrait croire qu’il descend d’une famille denaturalistes. Tous les galonnards s’efforcent de cette façon denous inculquer l’amour de la patrie. Dès que les bleus arrivent cesgens-là se mettent à faire un tapage de tous les diables et àdanser sauvagement autour des nouvelles recrues, une danse barbarequi rappelle fort celle des cannibales, au moment où ceux-ci sepréparent à écorcher une pauvre antilope, ou à rôtir unmissionnaire, qu’ils se proposent de dévorer à belles dents. Bienentendu, ces injures sont réservées aux soldats tchèques, lesAllemands en sont exempts. L’adjudant Sondernummer n’oublie jamaisd’ajouter lorsqu’il les traite de «&|160;bandes de cochons&|160;»le «&|160;qualificatif&|160;» tchèque, afin que les Allemandssachent bien que ces insultes ne leur sont pas destinées. Lesgalonnés de la 11e compagnie sont si souvent en proie àune telle fureur, que l’on croirait à les voir que les yeux vontleur sortir de la tête&|160;; ils ressemblent à des chiens gloutonsqui ayant avalé précipitamment une éponge en croyant qu’ils’agissait d’une friandise, ne peuvent ni la vomir ni la fairedescendre dans leur bide. Mon cher ami, il m’est arrivé d’entendreun jour, une conversation édifiante entre le caporal Althorf et lebrigadier Muller au sujet de l’instruction des bleus de laterritoriale. Les mots «&|160;raclée, claque&|160;», «&|160;on vales dresser&|160;» revenaient sans cesse. J’ai cru tout d’abord,avec une naïveté touchante, qu’une dispute avait surgi entre eux ouqu’ils avaient entrepris une controverse au sujet de l’uniténationale allemande en danger. Mais c’était une grossière erreur dema part. Il s’agissait, comme je l’ai compris par la suite, del’éducation des bleus.
–&|160;Et si un cochon de Tchéco, disait lecaporal Althorf, après trente «&|160;couchez-vous&|160;!&|160;» nese tient pas au «&|160;fixe&|160;!&|160;» droit comme un cierge, nete contente pas de le gifler, donne-lui un vigoureux coup de poingdans le ventre, envoie-lui une raclée, puis ordonne-lui de faire«&|160;demi-tour&|160;» et dès qu’il t’a tourné le dos applique-luiun bon coup de pied dans le cul. Tu verras qu’il se tiendra droit,et l’enseigne Dauerling te félicitera.
–&|160;Maintenant, camarade, poursuivitl’aspirant, il faut que je vous dise quelques mots sur ceDauerling. À la 11e compagnie, les bleus parlent de luien tremblant, exactement comme une vieille tante, perdue au finfond du Far-West, défaille de frayeur en songeant à un bandit degrand chemin. Dauerling a une renommée de mangeur d’homme, de latribu des anthropophages australiens qui passent leur temps à sebouffer les uns les autres. L’histoire de son enfance est trèscaractéristique. Peu après sa naissance la nurse le laissa choir etle petit Conrad Dauerling est tombé sur la tête. On en voit encoreles traces&|160;: la sphère de son crâne est aplatie sur un côté,exactement comme si une comète avait heurté le pôle nord. Tout lemonde pensait qu’il ne survivrait pas à cette blessure et que, detoute façon, s’il en réchappait, il resterait idiot pour le restantde sa vie. Au milieu de cet affolement général seul son père, lecolonel Dauerling, a gardé son sang-froid, déclarant que son filsserait toujours assez intelligent pour embrasser la carrièremilitaire.
Le petit Dauerling mena une lutte farouchepour apprendre le rudiment de ce qu’on lui enseignait au lycée, ens’aidant de leçons particulières, au cours desquelles un de sesprofesseurs perdit ses cheveux de désespoir, tandis qu’un autreachevait ses jours dans une maison d’aliénés et qu’un troisièmefaillit se précipiter du haut de la tour du dôme Saint-Étienne àVienne&|160;! Après cette lutte héroïque, Dauerling entra à l’écolemilitaire de Haindirg. Fort heureusement, dans ces écoles-là, on nese soucie peu des matières enseignées aux vulgaires pékins,indignes d’intéresser les officiers de profession. Une éducationquelque peu sérieuse et profonde, soulevant des problèmesphilosophiques, peut avoir sur la formation d’une âme militaire desinfluences néfastes. N’oubliez pas, mon cher ami, que plus unofficier est abruti et mieux il est capable de faire sonmétier.
Dauerling, élève de l’école militaire, étaitincapable de comprendre quoi que ce soit à quoi que ce soit. Lesprofesseurs officiers se rendirent eux-mêmes compte que lamalheureuse chute dont avait été victime leur élève, l’avait misdans un grave état d’infériorité en face de ses condisciples.
Les réponses qu’il fit aux examensdémontrèrent d’une façon catégorique qu’une telle imbécillitéatteignait à une profondeur extraordinaire. Aussi ses professeursne l’appelaient-ils entre eux que «&|160;notre brave idiot&|160;».Son abrutissement prit par la suite un développement si éclatantqu’il fut question, pendant quelque temps, d’expédier le jeuneDauerling à l’école supérieure de l’état-major ou-de le faireentrer dans un ministère.
Lorsque la guerre a éclaté, le nom de ConradDauerling était tracé en toutes lettres sur la liste desnominations des cadets officiers. C’est pour cette raison que nousl’avons vu arriver un jour au 91e de ligne.
L’aspirant poussa un soupir et continua en cestermes&|160;:
–&|160;Aux éditions du ministère de la guerre,un livre vient de paraître&|160;: «&|160;Entraînement ouÉducation&|160;», Dauerling avait potassé ce traité et il en avaitassimilé surtout le passage où l’on indique que l’on peut exercersur ses hommes une autorité salutaire par la crainte qu’on leurinspire. La puissance de la terreur que l’on exerce sur eux est enrelation étroite avec les bons résultats de l’entraînement. Aussiceux qu’il a obtenus furent-ils excellents. Plutôt que d’êtreobligés de subirdurant toute la journée ses engueulades, lessoldats se présentèrent en masse à la visite médicale. Mais cestentatives de dérobade n’eurent aucun succès. Car, quelques joursaprès que les soldats avaient imaginé ce truc pour échapper à leurpersécuteur, automatiquement, tout homme qui se présenta à lavisite fut puni de trois jours de salle de police. Or, vousconnaissez sans doute, cher ami, ces sortes d’endroits&|160;!Durant toute la journée on vous fait faire la pelote et, la nuit,pour vous reposer de ces fatigues, vous dormez sur un bat-flanc. Decette façon on est venu à bout, dans la compagnie commandée parDauerling, des tireurs au flanc.
Dauerling possède à fond le riche vocabulairede la caserne. Il commence toujours ses diatribes par un sonore«&|160;bande d’andouilles&|160;». À part cela, c’est un homme trèslibéral. Il donne en effet le choix à ses soldats&|160;: «&|160;Quepréfères-tu, espèce de crétin, leur demande-t-il, une bonne tapesur la gueule ou trois jours de clou&|160;?&|160;» Si le malheureuxs’avise de choisir le clou, il reçoit également, en rabiot quelquesclaques, accompagnées de l’explication suivante&|160;:«&|160;Dégonfleur que tu es&|160;! tu as la frousse pour tagueule&|160;! Que viens-tu faire alors ici et que deviendras-tulorsque l’artillerie lourde t’arrosera&|160;!&|160;»
Un jour que Dauerling avait crevé l’œil à unbleu et que, pour la forme, on l’avait mis pendant deux jours auxarrêts de rigueur, il s’écria&|160;: «&|160;Pourquoi fait-on tantde chinoiseries pour si peu de chose&|160;? De toute façon cetanimal est destiné à aller crever au front&|160;!Alors&|160;?&|160;» Et il avait raison. Le chef d’état-major ConradVon Hoetzendorf disait exactement la même chose&|160;: «&|160;Lesoldat est là pour crever&|160;!&|160;»
La méthode favorite de Dauerling consistaitsurtout à rassembler de temps à autre les soldats tchèques de sacompagnie, pour leur faire une conférence sur les problèmesmilitaires concernant l’Autriche. Il en profitait pour développerses vues personnelles sur les principes de l’éducation militaire,depuis la façon de boutonner une capote jusqu’au pelotond’exécution. Au début de l’hiver, avant d’être admis à l’hôpital,j’ai participé aux manœuvres de la 11e compagnie. Unjour, pendant le repos, Dauerling adressa aux soldats tchèques lediscours suivant&|160;:
–&|160;Je sais fort bien que vous n’êtes qu’untas de voyous et qu’il est nécessaire de chasser par la violenceles folles idées qui vous remplissent la tête. Tout d’abord avecvotre maudite langue tchèque vous ne parvenez même pas à mettre unephrase d’aplomb. Notre auguste seigneur le Kaiser est Allemand.Voulez-vous m’écouter&|160;! Sacré Himmel laudon&|160;! À platventre&|160;! Couchez-vous&|160;!
Et lorsque nous fûmes tous couchés dans laboue, Dauerling se mit à se promener de long en large devantnous.
–&|160;Restez à plat ventre, couchés&|160;! Jecomprends qu’il ne soit pas agréable de demeurer dans laboue&|160;; mais pour une bande de cochons comme vous… Sachez quele plat ventre existait déjà au temps des Romains. À cette époquetous les citoyens, de 17 à 60 ans, étaient à la disposition desautorités militaires, et durant les guerres on demeurait enpremière ligne pendant trente ans. Les officiers à ce moment-làn’avaient pas de temps à perdre avec des idiots de votre genre.Aussi ne connaissait-on qu’une langue officielle à l’armée.Croyez-vous que l’officier romain se serait donné la peined’apprendre l’étrusque par exemple&|160;? Je veux que vous merépondiez en allemand et non dans votre patois. Vous vous apercevezvous-même, par votre propre expérience, combien il est agréabled’être allongé dans les flaques de boue. Maintenant, imaginons quel’un d’entre vous perde patience et s’avise de se lever. Savez-vousce que je ferais, de lui&|160;? Eh bien je lui casserais toutsimplement la gueule, car cet homme, en agissant ainsi, se rendraitcoupable d’indiscipline, de refus d’obéissance, il commettrait unattentat contre ses devoirs de bon soldat, et surtout un acteirrespectueux en face des règlements, c’est vous dire qu’un telbougre serait immédiatement mis à l’ombre.
L’aspirant se tut une minute, puis ilreprit&|160;:
–&|160;Tout cela se passait sous lecommandement du capitaine Adamitchka, un homme complètementamorphe. Lorsqu’il était dans son bureau il regardait fixement dansle vide devant lui, pendant des heures, comme un parfait idiot, etde temps à autre il s’écriait&|160;: «&|160;Venez, mouches,bouffez-moi&|160;!&|160;» Dieu seul pouvait savoir à quoi ilpouvait songer durant ces longs instants d’immobilité. Un jour, unsoldat de la 11e compagnie se présente à son rapportpour se plaindre d’avoir été apostrophé la veille dans la rue, parl’enseigne Dauerling, de la façon suivante&|160;: «&|160;cochon deTchèque&|160;!&|160;»
Ce soldat avant de venir au régiment étaitrelieur et il avait le vif sentiment de sa dignité.
«&|160;Bon, si c’est comme cela… répondit àvoix basse le capitaine&|160;» Il vous a dit cela dans la rue, hierau soir&|160;? Vous en êtes sûr&|160;? Bien&|160;! Nous allons voird’abord si vous aviez la permission de sortir en ville.Rompez.&|160;»
Deux heures plus tard, le capitaine faisaitappeler le relieur&|160;:
–&|160;Nous avons établi, dit-il, toujoursd’une voix à peine perceptible, que vous aviez la permission derester dehors jusqu’à 10 heures. Pour cette fois, ça va, vous neserez pas puni. Rompez&|160;!
Et l’on disait pourtant de ce capitaine qu’ilavait vaguement le sens de la justice&|160;! C’est la raison pourlaquelle on l’a rapidement expédié au front. C’est le commandantWenzl qui l’a remplacé. Celui-là était le diable même lorsqu’ils’agissait d’embêter ses hommes. Il cloua le bec un jour àl’enseigne Dauerling lui-même&|160;! La femme du commandant Wenzlest une Tchèque&|160;; pour cette raison il était tenu à un certainménagement des minorités nationales. On racontait que lorsqu’ilétait capitaine à la garnison de Kouthna-Hora, il avait traité dansun moment d’ivresse le garçon de son hôtel de salaud de Tchèque. Jevous ferai remarquer en passant, que le commandant ne parlaitd’habitude que cette langue et qu’il avait mis ses fils dans uneécole tchèque. Le journal local apprit la chose et, quelques joursaprès, un député nationaliste quelconque avait déposé uneinterpellation au Parlement viennois pour protester contre l’injureadressée au garçon d’hôtel, disant que tout le peupletchèque avait été offensé en sa personne. Wenzl a eu de ce faittoute une série d’ennuis, d’autant plus que cette histoire s’étaitpassée à l’époque de la discussion au Parlement du budget del’armée. Cet ivrogne de capitaine avait vraiment mal choisi sonmoment.
Wenzl apprit par la suite qu’un aspirant,nommé Zitko, avait été l’instigateur de toute cette affaire. C’estlui qui avait suggéré au journal le fameux article, car il avaitune vieille dent contre le capitaine. Leur inimitié datait du jouroù l’aspirant, emporté par une vague de lyrisme, s’était mis àparler à la fin d’un bon repas, de la nature, de ses beautés, desnuages qui courent à l’horizon, des montagnes lointaines, descabarets et des oiseaux. «&|160;Que représente, je vous le demande,s’écria l’aspirant à la fin de son poème en prose, un capitaine, unsimple capitaine en face de la majestueuse nature&|160;? Un zéro,un vulgaire zéro, ainsi qu’un aspirant&|160;!&|160;»
Or, comme les officiers s’en étaient mis cejour-là plein la lampe, Wenzl s’est jeté sur le malheureuxphilosophe et s’est mis à le frapper comme un chien. L’affaire n’enest pas restée là, et le capitaine, depuis ce jour, n’a pas laissépasser une occasion de punir son philosophe. Il était d’autant plusvexé de cette histoire que les paroles de Zitko connurent unepopularité extraordinaire. Tout Kouthna-Hora les citait à toutpropos. Les gens s’abordaient dans la rue en se disant&|160;: Quereprésente le capitaine Wenzl en face de la majestueusenature&|160;?
–&|160;Je vais traquer la rosse jusqu’ausuicide, déclara Wenzl.
Mais Zitko lui échappa en abandonnant lacarrière militaire pour s’occuper uniquement de philosophie. Depuisce temps-là, le commandant n’a pas cessé de tempêter contre lesjeunes officiers. Un lieutenant lui-même n’est pas en sûreté danssa compagnie, à plus forte raison les enseignes et autresaspirants.
–&|160;Je vais l’écraser comme unepunaise&|160;! avait promis Wenzl, en parlant d’un jeune officierqui avait eu l’audace d’envoyer un de ses hommes au rapport pourune peccadille. Wenzl se refusait farouchement à considérer commedes crimes tout autre fait que, par exemple&|160;: s’endormir à lapoudrière en étant de garde, enjamber les murs de la caserne, selaisser arrêter par une patrouille du régiment d’artillerie, brefil fallait que le délinquant commit des incartades de cet ordre,pouvant nuire à la bonne renommée du régiment, pour qu’il se mît encolère.
–&|160;Ah&|160;! nom de dieu, s’écria-t-il unefois dans la cour de la caserne, cet imbécile s’est laisséempoigner pour la troisième fois par une patrouille de laterritoriale&|160;? eh bien jetez-le immédiatement au clou, cetimposteur, doublé d’un imbécile, qu’il fiche le camp de chez nous,qu’il aille pousser les brouettes de fumier. Et tu n’as même pasessayé de leur casser la gueule&|160;! Ça, des soldats&|160;?Allons donc&|160;! De vulgaires cantonniers&|160;! Ne pas luidonner à bouffer avant demain soir, pas de matelas, et mettez-ledans le cachot, sans couvertures, cette infecte nouille&|160;!
–&|160;Figurez-vous, maintenant, cher ami,poursuivit l’aspirant, que cet imbécile de Dauerling, le lendemainmême de l’arrivée du commandant, envoya à son rapport un de seshommes. Motif&|160;: le soldat avait omis de le saluer un dimancheaprès-midi, alors que l’enseigne se promenait en voiture avec unejeune fille. Ainsi qu’un sous-off le raconta plus tard, ce rapporten appelait à tous les tonnerres de dieu du jugement dernier. Dèsque Wenzl eut le rapport en main, nous voyons le sergent debataillon, qui sort de son bureau comme un fou, son registre sousle bras, et qui se met à appeler Dauerling, comme un perdu, tout lelong des couloirs.
–&|160;Non, mais qu’est-ce que celasignifie&|160;? Himmel donner wetter&|160;! Voulez-vous me ficherla paix, lui dit le commandant, avec des boniments de cegenre&|160;! Savez-vous, enseigne, ce que c’est qu’un rapport debataillon&|160;? Sachez que ce n’est pas une foire aux puces&|160;?Comment voulez-vous que cet homme vous voie lorsque vous traversezle marché en voiture&|160;? Croyez-vous qu’un soldat n’ait pasautre chose à faire que de scruter l’horizon pour y découvrir unpetit enseigne qui se promène en voiture avec sa donzelle&|160;?Taisez-vous&|160;! Le rapport du bataillon c’est une affairesérieuse&|160;! Le soldat vous a bien dit, lui-même, qu’il ne vousavait pas vu pour l’excellente raison qu’au moment même où vouspassiez il était en train de me saluer, moi, vous comprenez, moi,le commandant Wenzl, par conséquent il aurait fallu qu’il eût desyeux à son derrière pour apercevoir la voiture dans laquelle vousvous trouviez&|160;! À l’avenir, veuillez me laisser en paix avecdes histoires de ce genre&|160;!
Depuis ce jour l’enseigne Dauerling aradicalement changé, ajouta l’aspirant tout en bâillant.
–&|160;Il faudrait essayer de roupiller un peuavant le rapport du colonel, ajouta-t-il. J’ai voulu vous informercomme ça, grosso modo, de ce qui se passe chez nous. Le colonelSchroder n’a pas beaucoup d’estime pour le commandant. Ce sont destypes rigolos d’ailleurs. Le capitaine Sagner, commandant l’écoledes aspirants, considère le colonel comme le type accompli dusoldat, bien que celui-ci ait une frousse épouvantable d’aller aufront. En ce qui concerne Sagner lui-même, c’est un roublard, et ildéteste, tout comme son colonel, les officiers de réserve. Il ditque ce sont de sales pékins. L’école, il la considère comme unesorte de ménagerie où l’on dresse des bêtes sauvages que l’onenvoie au front en leur collant quelques galons pour se faire tuerà la place des officiers de métier dont la race doit êtresoigneusement conservée.
D’ailleurs, ajouta encore l’aspirant, ens’enveloppant dans sa couverture, tout n’est que pourriture dansnotre armée. Les masses, trop effrayées, n’ont pas encore prisconnaissance d’elles-mêmes. Elles se laissent sabrer, et siquelqu’un est frappé par une balle, il tombe en s’écriant comme unimbécile&|160;: «&|160;Maman&|160;!&|160;» Il n’y a pas de héros,mon vieux, il n’y a que des bestiaux que l’on conduit à l’abattoir,et des bouchers galonnés dans les états-majors. Mais, j’espère quetoute cette passivité prendra fin un jour et alors nous en verronsdes histoires.
En attendant, vive l’armée&|160;! Et,bonsoir.
L’aspirant se tut. Il se mit à se tourner sansarrêt sous sa couverture, puis il demanda&|160;:
–&|160;Vous dormez, camarade&|160;?
–&|160;Non, répondit Chvéïk, je réfléchis.
–&|160;À quoi, mon ami&|160;?
–&|160;À cette grande médaille d’or qu’unmenuisier de la rue Vavrova, avait obtenue, un certain Militchko.Il avait été le premier grand blessé de son régiment. Un obus luiavait enlevé une jambe et on lui en avait collé une en bois. Depuisce jour, il s’était mis à se poser partout en héros, étant lepremier grand blessé de son village. Un soir, il était venu àl’Apollo et il fut mêlé à une rixe avec des gars de la GrandeBoucherie. Ceux-ci lui ont arraché sa jambe de bois et lui ontcogné la tête avec. Celui qui lui avait arraché la jambe ne s’étaitpas trop rendu compte de ce qu’il faisait, mais, en voyant ce qu’iltenait en main, il est tombé dans les pommes. On a remis àMilitchko le lendemain, au poste de police, sa jambe de bois, mais,depuis ce jour, il a été dégoûté de la gloire, et il est alléporter sa médaille au clou. Mais cela lui a attiré toutes sortesd’ennuis, car il existe pour les invalides une espèce de tribunald’honneur, qui l’a condamné à reprendre sa médaille, et à la pertede sa jambe de bois…
–&|160;Comment&|160;?
–&|160;Voici. Un jour, une commissionquelconque se rendit chez lui pour l’avertir qu’il n’était plusdigne de porter sa jambe artificielle. À la fin de cette entrevue,ces messieurs lui ont emporté sa guibole. Ce qui n’est pas mal nonplus comme rigolade, continua Chvéïk, c’est que, lorsque lesparents d’un soldat tué à la guerre héritent d’une telle médaille,on leur donne un document leur indiquant que la médaille leur estconfiée pour qu’ils la mettent à une place d’honneur dans leurmaison. Or, dans la rue Bozetchov à Vychegrade j’ai connu un homme,qui avait perdu son fils à la guerre, il la trouvait mauvaise et sedisait que ces messieurs de l’Hôtel de Ville se foutaient un peu delui en lui donnant un ordre pareil. Il prit donc la médaille, serendit aux w.&|160;c. et la cloua contre le mur. Un policier, quihabitait la même maison, et qui fréquentait les mêmes chiottes,dénonça le vieux, pour intelligence avec l’ennemi. Et le pauvrevieux la sentit passer.
–&|160;Cela prouve, répondit l’aspirant, quela chance et le verre sont également fragiles. On vient de publierà Vienne un bouquin intitulé&|160;: «&|160;Journal d’unaspirant&|160;». J’ai découvert là-dedans le poème ravissant quevoici&|160;:
Il y avait un jeune aspirant
Qui se fit tuer pour son roi.
Il a donné le brave, en expirant,
L’exemple des héros d’autrefois.
On transporte son corps sur un fourgon
Son capitaine le décore d’une médaille,
Des prières montent, l’orgue bourdonne
Autour de ce héros de la grande bataille
–&|160;Il me semble, dit l’aspirant, après unecourte pause que cette lamentable poésie nous prouve suffisammentla décadence de l’esprit guerrier. Je vous propose donc, cher ami,de chanter avec moi, au beau milieu de cette nuit calme et obscure,le lied du canonnier Gabourek. Cela nous remontera le moral. Maisil faut bien gueuler pour que toute la caserne Marie en profite.Pour cette raison, je vous invite à vous mettre avec moi devant laporte.
Et bientôt, retentit de la prison, un telhurlement que les vitres des fenêtres du couloir entressaillirent.
Là-bas, à son canon,
Debout se tient un homme
Là-bas à son canon,
Debout se tient un homme&|160;!
Mais voici qu’une marmite éclate,
Et lui arrache les pattes&|160;!
Qu’importe&|160;! À son canon,
Toujours debout, se tient cet homme&|160;!
Là-bas à son canon
Debout se tient un homme&|160;!
De la cour, des bruits de pas et de voixrépondirent bientôt à ce concert.
–&|160;C’est le geôlier, remarqua l’aspirant,et le sous-lieutenant Pelikan, qui est de service aujourd’hui,l’accompagne. C’est un réserviste, un copain à moi, membreégalement de la «&|160;Ressource tchèque&|160;». Dans le civil, ilest comptable dans une maison d’assurances. Il me donnera descigarettes. Mettons-nous à hurler davantage.
Et les murs de la caserne répercutèrent enéchos les fameuses strophes&|160;:
Là-bas à son canon,
Debout se tient un homme…
À ce moment, la porte s’ouvrit avec fracas, etle geôlier, dont le zèle était décuplé par la présence del’officier, cria dans la cellule&|160;:
–&|160;Eh là-bas&|160;! Est-ce que vous vouscroyez dans une ménagerie&|160;?
–&|160;Permettez, répondit l’aspirant, ils’agit simplement d’une filiale de la chorale du«&|160;Rudolphinum&|160;» qui donne un concert au profit despauvres prisonniers. Le premier numéro du programme, la Symphoniemartiale, vient d’être exécuté.
–&|160;Voulez-vous vous taire&|160;! réponditle sous-lieutenant Pelikan, en se donnant un air sévère. Vousdevriez savoir qu’à neuf heures du soir, ce que vous avez de mieuxà faire est de roupiller en paix. Votre concert a réveillé tout lequartier autour de la caserne.
–&|160;Il se livre à de pareilles cochonnerieschaque soir, s’empressa d’intervenir le geôlier. Il ne se conduitpas comme un homme intelligent.
–&|160;Mon sous-lieutenant, dit l’aspirant, jevoudrais rester seul un instant avec vous.
Le geôlier sortit dans le couloir, etl’aspirant s’adressa alors amicalement à l’officier.
–&|160;Passe-moi quelques cigarettes, Franto.Des bleues&|160;? C’est tout ce que tu as de mieux&|160;? Pour unsous-lieutenant… Enfin, merci. As-tu également quelquesallumettes&|160;?
–&|160;Du bleu&|160;! répéta l’aspirant enfaisant la moue, lorsque l’officier fut parti. Il ne faut pas êtredégoûté. Sachez, mon ami, – dit-il à Chvéïk, – que même dansl’infortune nous devons conserver notre dignité. En voici une,camarade, ajouta-t-il en lui tendant une cigarette. Et n’oublionspas que demain nous attend le jugement dernier.
Mais avant de s’endormir, l’aspirant n’oubliapas de chanter encore une strophe.
Monts, vallées, rochers sauvages,
Ce sont-là mes meilleurs amis
Pourtant, ils ne peuvent me donner du courage
Pour supporter ta perte, ô Marie&|160;!
*
**
L’aspirant, en déclarant que le colonelSchroder n’était qu’une brute, commettait une erreur. Le colonel,en effet, n’était pas entièrement dénué d’un certain sens de lajustice.
Pendant que l’aspirant critiquait avecvéhémence les conditions de vie faites aux soldats de la caserneMarie, le colonel écoutait, résigné, au Casino des officiers, ceque lui racontait le lieutenant Kretchman, récemment revenu dufront avec une blessure à la jambe. Il disait qu’il avait suivi duposte de l’état major auquel il était attaché, l’attaque déclenchéecontre les positions serbes.
–&|160;Bon… Ils sortent des tranchées… Surtoute la ligne, longue devant nous de deux kilomètres, ilsescaladent les parapets, traversent la zone des fils de ferbarbelés et se jettent sur l’ennemi. Ils portent des grenadesaccrochées à leurs ceintures&|160;; ils ont leur masque, leur fusilà la main, prêts à tirer. Des balles sifflent de toutes parts. Unsoldat à peine sorti de la tranchée tombe. Un deuxième s’écroulesur un tas de terre. Un troisième est fauché après avoir faitquelques pas. Mais nos hommes se jettent de l’avant, tout de même,en poussant des «&|160;hourras&|160;!&|160;» Ils s’élancent dans unnuage de poussière et de fumée. L’ennemi les mitraille de toutesparts. Il se défend dans ses tranchées, dans les entonnoirs, avecacharnement. Les mitrailleuses crépitent autour de nos hommes. Nossoldats tombent. Une escouade s’élance pour s’emparer desmitrailleuses ennemies. Elle est fauchée. Mais nos hommess’élancent courageusement à l’assaut. Hourrah&|160;! un officiertombe, une escouade disparaît entièrement, et les mitrailleusesennemies recommencent à faucher nos rangs. Alors… pardonnez moi,camarade je n’en peux plus… j’ai trop bu…
Et l’officier qui avait été blessé à la jambepar la corne d’une vache se tut.
Le colonel sourit avec cordialité et se tournavers le capitaine Spiro, qui venait de frapper brusquement sur latable, en répétant une phrase dont personne ne pouvait deviner lesens.
–&|160;Mais réfléchissez bien, messieurs,disait-il, nous avons mobilisé les uhlans, les territoriaux etchasseurs autrichiens, les chasseurs de Bosnie, l’infanterie deligne autrichienne, l’infanterie de ligne hongroise, les chasseurstyroliens du kaiser, l’infanterie de ligne bosniaque, les homvedsmagyars, les hussards magyars, les hussards territoriaux, leschasseurs à cheval, les dragons, les infirmiers et brancardiers,l’artillerie, les marins, vous comprenez&|160;? Et laBelgique&|160;? La première et deuxième classe forment l’armée enligne, la troisième protège nos derrières…
Le capitaine Spiro frappa sur la table avecplus de violence encore&|160;:
–&|160;Oui, l’armée territoriale est chargéed’assurer l’ordre en temps de paix&|160;!
Un jeune officier s’efforçait pendant ce tempsde persuader le colonel que son énergie militaire étaitinébranlable. Il déclarait à haute voix à son voisin&|160;:
–&|160;D’abord, il faudrait envoyer au fronttous les tuberculeux. Le grand air leur ferait beaucoup de bien, etnous avons intérêt également à ce que les éléments malsainsdisparaissent de la population.
Le colonel lui sourit amicalement. Tout àcoup, il s’assombrit et dit au commandant Wenzl&|160;:
–&|160;Il me semble que le lieutenant Lukachévite notre compagnie. Depuis son arrivée au régiment, il ne s’estpas encore montré parmi nous.
–&|160;Il passe ses journées à faire despoèmes, remarqua le capitaine Sagner, ironiquement. À peineétait-il arrivé ici qu’il s’éprit de Mme&|160;Schreiber,la femme de l’ingénieur, dont il fit la connaissance authéâtre.
Le colonel regarda dans son verre avecmélancolie&|160;:
–&|160;Il paraît qu’il chante très bien,dit-il.
–&|160;À l’École militaire, il nous a beaucoupamusés avec ses chansons, répondit le capitaine Sagner. Lelieutenant Lukach connaît une foule d’anecdotes et c’est unvéritable plaisir que de l’écouter. Je regrette qu’il ne vienne pasplus souvent parmi nous.
Le colonel hocha tristement la tête.
–&|160;Hélas&|160;! dit-il, il n’y a plus devraie camaraderie entre nous. Je me rappelle les beaux joursd’autrefois où chaque officier faisait de son mieux pour brillerparmi nous. L’un par exemple, un certain lieutenant Dankl, s’étaitmis à poil un jour&|160;; il se fixa la queue d’un hareng dans lederrière et nous joua une scène inénarrable où il tenait le rôled’une sirène. Un autre, le lieutenant Schleiszner, savait dresserles oreilles comme un chien et imiter à merveille le hennissementdes chevaux, le miaulement des chats et le bourdonnement desabeilles. Et je me souviens également d’un capitaine Skolay.Celui-là, chaque fois que nous le lui demandions, nous amenait despoules au casino. Il y avait parmi elles trois sœurs qui étaientstupides comme des oies. Un soir, il les fit monter sur une tableoù elles se déshabillèrent en dansant. Un autre jour, il fitapporter une baignoire pleine d’eau chaude au milieu de la salle etil nous obligea, l’un après l’autre, à nous baigner avec ces dames.C’est ainsi qu’il nous a photographiés.
Visiblement, le colonel était fort ému enévoquant ces souvenirs.
–&|160;Et les paris que nous avons engagésdans les baignoires&|160;! continuait-il en faisant claquer lalangue de plaisir. Mais aujourd’hui on ne sait vraiment pluss’amuser. Ce chanteur ne se montre même pas. Ah&|160;! les jeunesgens d’aujourd’hui ne savent pas boire. Il est à peine minuit etnous avons déjà cinq convives complètement saouls. Dans majeunesse, il m’est arrivé de passer deux jours à table, et plusnous buvions, mes amis et moi, plus nous étions lucides. Fini lebon vieil esprit militaire&|160;! Le diable seul sait où il estparti. Pas une blague&|160;! On n’entend que des discours ennuyeuxet interminables. Écoutez donc ce qu’on raconte là-bas del’Amérique, au bout de la table.
Les convives qui entouraient le colonel, setournèrent de ce côté-là, et ils entendirent une voix stridente quicriait&|160;:
«&|160;L’Amérique ne se mêlera pas de cetteguerre. L’Angleterre est son ennemie irréductible. D’autre part,l’Amérique n’est pas préparée pour une guerre…&|160;»
Le colonel soupira et dit&|160;:
–&|160;Voilà tout ce qu’on peut obtenir desofficiers de réserve. Que le diable les emporte&|160;! Ceshommes-là faisaient hier encore des calculs dans une banque, oubien ils servaient aux clientes des oignons, du poivre rouge ou ducirage pour les bottes, ou bien ils enseignaient à leurs élèves quela famine fait sortir le loup du bois, et aujourd’hui, ilss’aviseraient de se mettre sur le même rang que les officiers del’active, de se donner pour des gens au courant des chosesmilitaires, et ils prennent l’habitude de fourrer leur nez dans untas d’histoires qui ne les regardent pas. Par-dessus le marché, sinous avons des officiers qui savent chanter, comme le lieutenantLukach, on ne les voit jamais…
Le colonel sortit de là de fort mauvaisehumeur. Et lorsqu’il se réveilla le lendemain, il était plus sombreencore. Il lut son journal, au lit comme d’habitude, et ilrencontra à plusieurs reprises, dans les communiqués d’état-major,la phrase fatale&|160;: «&|160;Nos troupes ont été ramenées sur despositions préparées à l’avance.&|160;»
L’armée autrichienne connaissait des jourshistoriques.
C’est en emportant ces tristes impressions quele colonel Schroder se rendit à 10 heures du matin à ce fameuxrapport que l’aspirant avait comparé la veille au jugementdernier.
Chvéïk et l’aspirant, alignés dans la cour dela caserne, attendaient patiemment son arrivée. L’officier deservice, les secrétaires du colonel et l’adjudant-chef tenant lecahier des punitions sous le bras, étaient également à leurplace.
Enfin le colonel apparut, sombre, accompagnédu capitaine Sagner, commandant l’École des aspirants, qui frappaitses bottes montantes d’un mouvement nerveux de sa cravache.
Tout en écoutant le rapport, le colonels’approcha sans dire un mot de Chvéïk et de l’aspirant, il fitquelques pas autour, d’eux, tandis que les deux hommes tournaientla tête à droite et à gauche, suivant, ainsi que l’exige lerèglement militaire, le colonel des yeux. Ils exécutèrent cemouvement avec une telle précision que la tête leur tournaitlorsque le colonel se fixa enfin devant l’aspirant qui seprésenta&|160;:
–&|160;Mon colonel, l’aspirant…
–&|160;Je sais, interrompit le colonel. Unélève de l’École des aspirants. Que faites-vous dans lecivil&|160;? Vous étudiez la philosophie&|160;? Capitaine Sagner,ordonna-t-il, amenez-moi toute l’École des aspirants. Bien entendu,continua-t-il, en s’adressant de nouveau au prévenu, vous êtes unde ces philosophes dont nous sommes obligés de nettoyer laculotte&|160;! Demi-tour&|160;! Je m’en doutais&|160;! Les plis dela capote en désordre&|160;! Comme s’il venait directement dubordel&|160;! Attendez un peu&|160;! Je vais vousapprendre&|160;!…
L’École des aspirants pénétra à ce moment dansla cour.
–&|160;En carré&|160;! commanda lecolonel.
Et les aspirants se rangèrent autour desaccusés et du colonel.
–&|160;Regardez-moi un peu cet homme-là&|160;!hurla le colonel, en montrant l’aspirant de sa cravache. Il avaittellement soif qu’il a bu toute honte&|160;! Il ne se rend même pascompte de l’honneur qu’on lui a fait en l’admettant dans les cadresqui doivent nous fournir des officiers pleins de cran, capablesd’entraîner leurs hommes sur le champ de bataille. Mais, je vous ledemande, où diable est-il capable de conduire un régiment, cetivrogne&|160;? D’un cabaret à l’autre. Pouvez-vous dire quelquechose pour votre défense&|160;? Non. Regardez-le bien. C’est unhomme qui fréquente les philosophes et qui n’est même pas capablede trouver un mot pour se justifier.
Le colonel souligna ces mots en hurlant d’unefaçon significative et, à la fin, pour mieux marquer son mépris, ilcracha à deux pas de l’aspirant.
–&|160;Un philosophe classique qui, ivre mort,s’avise d’insulter ses officiers en leur tripotant familièrement leképi. C’est une véritable abomination&|160;! Heureusement encoreque cet officier appartenait à l’artillerie&|160;!
Dans ces paroles se marquait la haine que lesgens du 91e de ligne nourrissaient à l’égard du régimentd’artillerie de Budeiovitz. Malheur au canonnier qui, la nuit,tombait entre les mains d’un patrouille du 91e, ouvice-versa. Cette haine se poursuivait à la façon d’une vendetta,creusant plus profondément son lit d’année en année, nourried’histoires traditionnelles sur des soldats qui avaient étéprécipités dans la Voltova par des artilleurs, ou des fantassins,et de récits de batailles que s’étaient livrés, au«&|160;Port-Arthur&|160;» ou au «&|160;Café de la Rose&|160;», lesfrères ennemis.
–&|160;Ce crime doit être châtié d’une façonexemplaire, s’écria le colonel. Cet homme-là sera exclu de l’Écoledes aspirants. Nous en avons assez de ces soi-disantintellectuels&|160;! Adjudant chef&|160;!
Le secrétaire du colonel s’avança, avec un airimportant, ses cahiers sous le bras et tenant dans sa main touteune série de crayons de couleur. Dans la cour régnait un silencecomparable à celui d’une salle d’un tribunal au moment où les jugess’apprêtent à lire la sentence condamnant à mort un assassin.
De la même voix accusatrice, le coloneldéclara&|160;:
–&|160;L’aspirant Marek sera puni de 21 joursde salle de police et, après l’expiration de sa peine, il seraattaché à la cuisine pour le nettoyage.
Se tournant vers les aspirants de l’école, illeur ordonna de se retirer.
À ce propos, le colonel fit durement observerau capitaine Sagner que ses hommes ne marchaient pas en ordre, etqu’il serait absolument nécessaire de leur apprendre à marcherdroit.
–&|160;Je ne veux pas entendre leurs pasrouler comme ça, capitaine. Attendez, encore quelque chose quej’allais oublier&|160;! Flanquez-leur cinq jours de consigne àtous, quand ils arriveront à la caserne, afin qu’ils n’oublient pasla scène à laquelle ils viennent d’assister.
Cependant, cette fripouille de Marek regardaittranquillement devant lui, sans paraître s’en faire le moins dumonde. Il se réjouissait au contraire de la sentence qui venait dele frapper. Il vaut mieux mille fois, songeait-il, aller éplucherles pommes de terre ou nettoyer les casseroles que de se fairecasser la gueule sur le front.
Lorsque le colonel se tourna vers le capitaineSagner, il découvrit brusquement Chvéïk et, se plantant devant lui,le regarda attentivement.
Le visage candide de Chvéïk conservaittoujours son sourire bon enfant. Il donnait l’impression d’avoir laconscience parfaitement tranquille. Ses yeux interrogeaient lecolonel et paraissaient demander&|160;:
«&|160;Mais quel crime ai-jecommis&|160;?&|160;»
Le colonel, après l’avoir observéattentivement, résuma ses pensées dans cette seulequestion&|160;:
–&|160;C’est un idiot&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncolonel, que je suis un idiot, répondit tranquillement Chvéïk.
Le colonel le regarda un instant avec des yeuxégarés. Puis il appela son secrétaire et se mit à causer avec lui àvoix basse.
Les deux hommes étudièrent ensemble les piècesqui formaient le dossier de Chvéïk.
–&|160;Ah bon&|160;! fit le colonel, il s’agitdu fameux tampon du lieutenant Lukach qui s’est soi-disant égaré àTabor. Je pense que messieurs les officiers feraient bien des’occuper eux-mêmes de l’éducation de leur ordonnance. Si lelieutenant Lukach accepte pour le servir un imbécile, c’est tantpis pour lui. Par-dessus le marché, ce monsieur dédaigne notresociété. Est-ce que vous l’avez jamais rencontré à notremess&|160;? Non, n’est-ce pas&|160;? À quoi passe-t-il son tempsalors&|160;? Il devrait avoir assez de loisirs pour dresser sonordonnance&|160;!
Le colonel s’approcha de Chvéïk et,considérant un instant son visage candide, déclara&|160;:
–&|160;Espèce d’imbécile&|160;! Vous aureztrois jours de salle de police et, dès qu’on vous aura libéré, vousreprendrez votre service auprès du lieutenant Lukach.
Quelques instants plus tard, Chvéïk seretrouva à nouveau à la prison du régiment, à côté de son amil’aspirant.
Mais le lieutenant Lukach fit une drôle detête lorsque le colonel le fit appeler pour lui annoncer&|160;:
–&|160;Lieutenant, vous m’avez adressé, troisjours après votre arrivée au régiment, une demande pour obtenir uneordonnance. Vous m’aviez dit que la vôtre s’était égarée à la garede Tabor. Cet homme vient de rentrer… par conséquent…
–&|160;Mais, mon colonel&|160;! suppliaLukach.
–&|160;J’ai décidé, continua le colonel sanspitié, que dès qu’il sera libéré cet homme sera mis à votredisposition.
Le lieutenant Lukach s’éloigna en chancelantdu bureau du colonel.
Durant les trois jours qu’il passa en prisonen compagnie de l’aspirant, Chvéïk s’amusa follement. Tous deuxs’ingénièrent à organiser chaque soir une petite fête patriotiquedans leur cellule.
Par les fenêtres grillées de la prison, onentendit retentir chaque nuit&|160;: l’hymne impérialGotterhalte, la Ballade sur le Prince Eugène ettoute une série de chansons militaires.
Lorsque le geôlier venait pour leur imposersilence, ils le saluaient par le couplet suivant&|160;:
Salut au geôlier
Honneur et laurier
En attendant que le diable
Vienne et le charge
Sur sa brouette.
Ah&|160;! vraiment, ce sera chouette&|160;!
Puis ils dessinèrent contre le mur le portraitdu geôlier attaché à une potence. Ils écrivirent dessous le texted’une vieille chanson populaire légèrement modifié&|160;:
En partant pour Prague chercher du boudin
J’ai rencontré en route un méchant galopin.
Ce maudit galopin n’était autre que le geôlier.
Je me suis sauvé en courant, car il voulait mecoffrer.
Et, pendant qu’ils se distrayaient ainsi, lelieutenant Lukach comptait avec anxiété et tristesse le peu dejours qui le séparaient encore du retour de Chvéïk.
Chapitre 3
CE QU’IL ARRIVA À CHVÉÏK À KIRALYHIDA
Le 91e régiment d’infanterie futtransféré à Kiralyhida que traverse la rivière de Litha.
Trois heures avant sa libération, Chvéïk futconduit sous bonne escorte, en compagnie de l’aspirant, vers lagare.
–&|160;On parlait déjà depuis longtemps denous transférer en Hongrie, confia Marek à son compagnon. On vanous apprendre encore un peu à manier le fusil puis, après quelquescombats d’entraînement avec les Magyars, nous partirons pleinsd’enthousiasme pour les Carpathes. À Budeiovitz, on enverra à notreplace un régiment hongrois et, de la sorte, on fera croiser lesraces. Nous connaissons déjà une théorie disant que pour combattrela dégénérescence d’une race, il n’y a pas de meilleur moyen que devioler les filles d’une autre nation. C’est ce système que lesSuédois et les Espagnols ont appliqué avec succès durant la guerrede Trente ans, ainsi que les Français sous Napoléon.
Maintenant, ce sont les Magyars qui sechargeront de cette tâche dans la région de Budeiovitz, et je pensemême qu’ils n’auront pas toujours besoin de recourir à la violence.Le temps adoucit peu à peu les méthodes. En fin de compte, il nes’agit que d’une transfusion du sang. Le soldat tchèque coucheraavec une fille magyar, et les poules de Tchécoslovaquie recevrontchez elles les gars du Homved hongrois.
Les gens qui s’occupent d’anthropologie sedemanderont dans les siècles à venir comment il se fait qu’au bordde la rivière Malcho, patelin tchèque par excellence, on découvredes types mongols.
–&|160;Il arrive des histoires curieuses avecce mélange des races, poursuivit Chvéïk. À Prague, j’ai connu ungarçon de café, un nègre du nom de Christian, dont le père avaitété roi en Abyssinie. Celui-ci s’exhiba pendant quelques semaines àla foire de Prague dans un cirque. Une institutrice qui écrivaitdes vers dans le journal Lada, sur les bergers et sur lespetites rivières des bois, en eut un béguin fou. Elle se renditavec lui à l’hôtel et, suivant le langage des Saintes Écritures,elle commit le péché capital. Neuf mois plus tard elle fut trèsétonnée lorsqu’elle accoucha d’un bébé blanc. Oui, mais au bout dequatorze jours, la peau du petit bonhomme commençait à brunirterriblement, et elle devint de plus en plus noire. À six mois, legosse était devenu un nègre comme son père, le roi d’Abyssinie.
Elle avait couru avec son bébé à une cliniquespécialisée dans le traitement des maladies de la peau, afin defaire décolorer son fils. Mais là, on lui a répondu que c’était unvéritable gosse noir, et qu’il n’y avait rien à faire. Elle étaittellement affolée, qu’elle se précipita dans les rédactions dejournaux pour y déposer des annonces demandant la recette d’un bondécolorant. Finalement, on l’a enfermée dans une maison de fous, àKaterjinek. Quant au petit nègre, il a été confié à l’Assistancepublique où on a pas mal rigolé avec lui. C’est ainsi qu’il devintgarçon de café plus tard, et danseur ensuite dans des boîtes denuit. Un étudiant en médecine qui fréquentait notre café «&|160;LaCoupe&|160;», disait que ces histoires de croisement ne sont pasaussi simples qu’on pourrait le croire. «&|160;Avec des genspanachés, disait-il, on peut avoir des surprises, car, tout à coup,dans une génération de blancs un nègre peut apparaître.&|160;»Figurez-vous ce malheur&|160;: Vous épousez une belle poule, elleest blanche comme la neige et, un beau jour, sans crier gare, ellevous met au monde un petit nègre. Et, si par hasard, neuf moisavant, elle avait assisté à un match de boxe où combattaient desnègres, alors vous pourrez vous demander si vous n’êtes pascocu.
–&|160;Le cas de votre nègre Christian,répondit Marek, devrait être envisagé également du point de vue dela guerre. Admettons qu’il soit cité devant le conseil de revision,il est de Prague, donc il appartient au 28e régimentd’infanterie. Vous avez certainement entendu dire que les gars du28e avaient passé dans les lignes russes avec armes etbagages. Imaginez la tête qu’ils feraient en voyant qu’ils ontcapturé un nègre du plus beau noir&|160;! Les journaux de là-basvont expliquer, à coup sûr, que les Autrichiens en sont arrivés àmobiliser leurs troupes coloniales, alors que vous savez comme moique l’Autriche n’a pas de colonies.
–&|160;On nous racontait une fois, réponditChvéïk, que l’Autriche possède une colonie quelque part dans ladirection du Pôle Nord. Un pays qui s’appelle la terreFrançois-Joseph.
–&|160;Voulez-vous vous taire, interrompit undes soldats de l’escorte, c’est très imprudent par les temps quicourent de bavarder de choses comme ça. Vous feriez mieux de ne pasappeler les choses par leur nom…
–&|160;Mais regardez donc la carte, réponditvivement l’aspirant, vous saurez qu’il existe vraiment un paysnommé, après notre auguste empereur, François-Joseph. Il paraîtqu’on y produit beaucoup de glaces, qui viendront alimenter lesglacières municipales de Prague. Les étrangers eux-mêmes estimentbeaucoup cette industrie, car elle est très fructueuse, bienqu’elle présente en même temps quelque danger. Savez-vouspourquoi&|160;?
Le soldat de l’escorte pour toute réponse,grommela quelques paroles incompréhensibles, et le caporal quicommandait le convoi s’approcha pour mieux écouter les explicationsde l’aspirant.
–&|160;Cette unique colonie autrichienne,poursuivit celui-ci, est capable de suffire aux besoins de glace detous les pays d’Europe et, pour cette raison, elle est un facteurimportant de l’économie mondiale. Pourtant la colonisation sedéveloppe assez lentement, car les colons ne tiennent pas às’aventurer dans cette région déserte, et ceux qui y vonts’exposent à mourir congelés. Néanmoins, les ministères du Commerceet des Affaires étrangères n’ont pas renoncé à l’espoir de pouvoirexploiter les immenses richesses que représentent les icebergs. Deplus, ils se proposent de construire là-bas quelques hôtelsmodernes et d’y attirer les touristes étrangers. On s’occupe deremettre à neuf les chemins et les routes, et de poser des poteauxindicateurs. Malheureusement, les Esquimaux sabotent ce travail etrendent vain l’effort de nos autorités. Ces voyous ne veulent pasapprendre l’allemand, ajouta l’aspirant, tandis que le caporal serapprochait encore, en dressant une oreille attentive.
C’était un engagé, garçon d’écurie dans lecivil, soldat jusqu’au fond de l’âme, et dont la soupe assurée àchaque repas était le suprême idéal.
–&|160;Le ministère de l’Instruction publiquefit construire une école à grands frais et sacrifices, car cinqarchitectes sont morts de froid…
–&|160;Pas tous, interrompit Chvéïk, carquelques-uns se sont sauvés, en se chauffant les mains à leurpipe…
–&|160;Vous oubliez de dire, brave soldatChvéïk, objecta l’aspirant, que deux d’entre eux avaient oubliéd’aspirer et que leur feu s’était éteint. Il fallut les enfouirdans la glace. Bref, on est tout de même parvenu à construire pourles Esquimaux une école faite entièrement avec des blocs de glace,mais ces gens-là se sont amusés à faire du feu autour et l’école decette façon a été détruite, car la glace a fondu en quelquesheures. Les professeurs et les représentants du gouvernement,arrivés la veille des fêtes de l’inauguration, ont été précipitésdans la mer. On entendit le représentant du gouvernement qui,plongé dans l’eau jusqu’au cou, s’écriait avant dedisparaître&|160;: «&|160;Que Dieu punissel’Angleterre&|160;!&|160;» J’espère qu’on enverra là-bas des forcesmilitaires, ajouta l’aspirant, pour rétablir l’ordre. Il est bienévident que cette guerre présenterait d’énormes difficultés pournous, car le pays est peuplé d’ours redoutables.
–&|160;Ah&|160;! c’est ce qui nous manqueencore&|160;! soupira le caporal, des ours apprivoisés. Etpourtant, on a inventé depuis la guerre beaucoup de choses. Parexemple, les masques à gaz. On nous a expliqué à l’école dessous-officiers que tu n’as qu’à les mettre pour être immédiatementasphyxié.
–&|160;On veut nous faire peur, réponditChvéïk, mais un vrai soldat n’a jamais la frousse. Même si aumilieu de la bataille tu tombes dans une latrine, tu n’as qu’àt’essuyer et à te jeter de nouveau dans la lutte. Pour ce quiconcerne les gaz asphyxiants, on nous fait déjà faire del’entraînement à la caserne lorsqu’on nous donne de la barbaquefaisandée. Mais voilà maintenant que les Russes ont inventé quelquechose contre nos officiers…
–&|160;Ce sont probablement des rayonsélectriques, s’empressa d’ajouter l’aspirant, pour compléter lesinformations de Chvéïk. Dès qu’ils se poseront sur les étoiles denos officiers, ils les feront exploser aussitôt, car ces étoiles,comme vous ne l’ignorez pas, sont en celluloïd. Ah, seigneur&|160;!quelles nouvelles catastrophes&|160;!
Bien que le caporal ne fût pas une lumière del’esprit, il commença à se douter, alors, que Chvéïk et l’aspirants’amusaient à le mettre en boîte, et il les quitta pour se placer àla tête du cortège.
Lorsqu’ils arrivèrent devant la gare, leshabitants se rassemblèrent sur le quai, pour adresser un suprêmeadieu à leur régiment. La foule était considérable. Tandis que lesbraves soldats étaient refoulés dans les wagons à bestiaux, Chvéïket l’aspirant prirent place dans le wagon spécial des détenus, quiétait accroché à la voiture du commandant du régiment. Chvéïk, dela portière du wagon, retira son calot, et fit retentir le salutnational tchèque «&|160;Na’Zdar&|160;!&|160;» Et la foule répéta enchœur&|160;: «&|160;Na’Zdar&|160;!&|160;»
Le caporal de l’escorte se mit à crier àChvéïk&|160;:
–&|160;Ta gueule&|160;!
Mais il était déjà trop tard pour enrayer lamanifestation.
Aux fenêtres des hôtels qui se trouvaient enface de la gare, des femmes apparurent, souriantes, agitant leursmouchoirs.
Aux «&|160;Na’Zdar&|160;» anti-autrichiens desTchèques, les cris de «&|160;Heil&|160;!&|160;» (Vive laguerre&|160;!) se joignirent. Un patriote qui voulut réagir, enpoussant le cri de&|160;: «&|160;À bas les Serbes&|160;!&|160;»,fut violemment pris à partie.
L’orchestre de «&|160;l’Association desTireurs&|160;», qui était un peu ahuri par cette manifestationanti-autrichienne, se préparait à jouer l’hymne impérial, ce quipouvait amener de graves désordres.
Heureusement, le révérend père Latsina,aumônier principal de la 7e division de cavalerie, sechargea de rétablir l’ordre.
Le révérend père Latsina, gros mangeur etgrand buveur, comme la plupart de ses confrères, assistait à lafête d’adieu organisée par les officiers du 91e deligne. Il y mangea et but autant que dix convives, et, à la fin durepas, se rendit à la cuisine pour demander s’il y avait du rabiot.Il nettoya les casseroles, acheva de dévorer ce qui restait depoulet, et finit par découvrir une bouteille de rhum, qu’il écoulajusqu’à la dernière goutte. À la 7e division decavalerie, on savait à quoi s’en tenir sur le compte de ce sainthomme.
Donc, comme le chef d’orchestre se disposait àjouer l’hymne national, il accourut, lui arracha la baguette desmains, et s’écria&|160;: «&|160;Halte-là, ne faites rien sans meconsulter&|160;!&|160;»
Après ces paroles énergiques, il se précipitasur le quai.
–&|160;Où allez-vous&|160;? demanda-t-il aucaporal qui dirigeait l’escorte.
Comme celui-ci, tremblant, n’osait répondre,Chvéïk prit la parole à sa place.
–&|160;On nous conduit à Kiralyhida. Si vousvoulez, vous pouvez monter avec nous.
–&|160;C’est ce que je vais faire, déclaral’aumônier. Allez, ouste, en avant&|160;!
Aussitôt installé dans le wagon des détenus,l’aumônier s’allongea sur la banquette. Le brave soldat Chvéïk ôtasa capote et la glissa sous la tête du révérend père.
Le père Latsina déclara alors&|160;:
–&|160;Le ragoût aux champignons, messieurs,est excellent, et plus il y a de champignons, meilleur il est. Maisencore faut-il savoir préparer ce plat. Vous prenez quelquesoignons, vous y ajoutez des feuilles de laurier, puis desoignons…
–&|160;Mais vous en avez déjà mis, observal’aspirant, à la grande indignation du caporal, qui ne comprenaitguère que l’on se permît de faire des objections de ce genre à unsupérieur, même s’il se trouvait dans un état d’ébriétémanifeste.
–&|160;Mais parfaitement, remarqua Chvéïk,monsieur l’aumônier principal a raison. Plus on met d’oignons etmeilleur devient le ragoût. Il y avait, à Pakomerjitz, un brasseurqui mettait des oignons partout, même dans sa bière, car ildisait…
Cependant, l’aumônier continuait à rêver touthaut sur sa banquette&|160;:
–&|160;Tout dépend des épices qu’on y met, etdans quelles proportions. Pas beaucoup de poivre, et pas trop depaprica…
Sa langue devenait pâteuse. Les parolessortaient difficilement de sa bouche&|160;:
–&|160;… Pas… trop… de… piments… pas trop decitron… pas trop…
Il ne put achever sa phrase et s’endormitprofondément, cependant que les soldats de l’escorte se mettaient àrigoler.
–&|160;Il ne s’en remettra pas de sitôt,déclara Chvéïk en hochant la tête. Il est complètement saoul.
Le caporal lui fit signe de se taire, mais iln’en continua pas moins&|160;:
–&|160;Il est mûr, le vieux frère. Cesaumôniers ont l’habitude de s’en mettre plein la lampe chaque foisqu’une occasion se présente. J’ai été en service chez l’aumônierKatz, qui buvait tout ce qu’il gagnait. Il aurait même bu son nez,s’il avait été potable. Ce que nous avons sous les yeux n’est rienen comparaison de ce que j’ai vu chez celui-là. Nous avons bazardé,pourboire, l’ostensoir et le calice, et nous aurions bu le bon Dieului-même, si quelqu’un avait pu nous avancer sur sa peau un bonlitre de rouge.
Chvéïk s’approcha de l’aumônier, l’empoigna,le tourna de l’autre côté, puis d’un ton solenneldéclara&|160;:
–&|160;Il va ronfler jusqu’à Kiralyhida.
Puis il reprit sa place, tandis que le caporalle suivait d’un regard furieux.
–&|160;Faudrait peut-être avertir lesautorités militaires… hasarda-t-il d’un ton incertain.
–&|160;Pensez donc, répondit l’aspirant, vousêtes le chef, ici, vous n’avez pas le droit de nous quitter. Etmême, suivant les règlements, vous n’avez pas le droit d’envoyer unhomme de votre escorte pour prévenir vos supérieurs, avant que vousen ayez un autre pour le remplacer. Il est formellement interditpar les règlements de laisser entrer qui que ce soit dans lecompartiment des détenus, à part bien entendu les prisonniers etles hommes chargés de les surveiller. D’autre part, fairedisparaître l’aumônier en le précipitant par la portière, seraitune solution simpliste, parce qu’il y a trop de témoins qui l’ontvu monter dans ce wagon où il n’avait rien à faire. Ceci est grave,caporal, pour vos galons&|160;!
Le caporal se défendit comme un beau diable,en disant qu’il n’était pour rien dans toute cette affaire, qu’iln’avait nullement invité l’aumônier à monter dans le wagon, et quede plus, celui-ci étant son supérieur, il ne pouvait l’empêcherd’agir comme bon lui semblait.
–&|160;Ici, c’est vous qui commandez, déclarad’un ton péremptoire l’aspirant.
Chvéïk approuva ces paroles de cettefaçon&|160;:
–&|160;Même si Sa Majesté l’Empereur voulaitse joindre à notre détachement, vous n’auriez pas le droit de lelui permettre. C’est comme si vous êtes en sentinelle, et quel’officier de service vienne vous voir pour vous demander d’allerlui chercher des cigarettes et que vous quittiez votre poste, c’estBiribi qui vous attend.
Le caporal, effrayé, fit remarquer que c’étaitChvéïk, le premier, qui avait conseillé à l’aumônier de venir aveceux.
–&|160;Je peux bien me permettre cela,repartit Chvéïk, car je suis un imbécile notoire. Mais vous,caporal…
–&|160;Vous êtes déjà depuis longtemps aurégiment&|160;? lui demanda l’aspirant.
–&|160;Ça fait trois ans. Je dois être nommésergent prochainement.
–&|160;Vous pouvez en faire votre deuil, fitremarquer l’aspirant avec cynisme. Comme je vous l’ai dit tout àl’heure, je crois que vous êtes dans de sales draps, et ça nem’étonnerait pas le moins du monde que l’on vous cassât de votregrade.
–&|160;Ne vous en faites pas, continua Chvéïk.Que vous soyez tué à l’ennemi comme gradé ou comme simple soldat,ça n’a pas une grande importance. Il est vrai, ajouta-t-il, quel’on envoie de préférence aux endroits dangereux ceux qui ont étécassés de leur grade.
L’aumônier, à ce moment, s’étira sur labanquette.
–&|160;Il ronfle, déclara Chvéïk, il doitfaire de beaux rêves. Seulement j’ai peur qu’il se mette àdégueuler. Mon ancien aumônier, quand il était noir, n’avait plusconscience de rien. Une fois…
Et Chvéïk se mit à raconter les exploits deson aumônier d’une façon si détaillée que personne ne s’aperçut quele train se mettait en route. Les hurlements de la population, quicontinuaient à s’élever du quai, parvenaient dans une lointainerumeur.
Les gars de l’Oémesie, composés exclusivementd’Allemands, lancèrent leur cri de guerre&|160;:
Wann ich kumm, wann ich kumm,Wann ich wieda, wieda kumm…
&|160;
(Lorsque je viens, lorsque je viens. Lorsqueje vous reviens, reviens…)
Et des autres wagons, un chant nostalgiques’éleva qui clamait ses adieux à Budeiovitz&|160;:
Et toi, mon trésor.
Tu restes bel et bien là,
Hollario, hollario, hola&|160;!
–&|160;Ce qui m’étonne, dit l’aspirant aucaporal, c’est que nous n’ayons pas encore vu d’officiers deservice. Suivant les règlements, vous auriez dû vous présenter auchef du convoi plutôt que de vous compromettre avec un aumônierivre-mort.
Le malheureux caporal garda farouchement lesilence et se mit à contempler les poteaux télégraphiques quidéfilaient de chaque côté de la portière.
–&|160;Lorsque je songe, continua l’aspirantimplacable, que nous n’avons donné de rapport à personne, à lagare, et qu’à la prochaine station le commandant du train viendravous demander des comptes, je sens un frisson me glisser dans ledos. Nous sommes là comme…
–&|160;Comme des vagabonds, répliqua Chvéïk.Il me semble que nous fuyons devant le courroux de Dieu, comme sinous avions peur d’un châtiment terrible.
–&|160;D’autre part, reprit l’aspirant, ilaurait fallu tenir compte également des instructions del’ordonnance du 21 novembre 1879 concernant le transport desdétenus&|160;: 1° le wagon des détenus doit être muni de grilles.Pour cela nous sommes en règle&|160;; 20 suivantl’ordonnance complémentaire du 21 novembre 1879, un cabinet doitêtre à la disposition des détenus dans les wagons grillés. Au casoù le wagon ne serait pas pourvu d’un cabinet, l’autorité militaireest chargée de mettre à la disposition des détenus et des hommeschargés de les surveiller, un seau avec un couvercle, pour leursgrands et petits besoins. Or, chez nous, par exemple, cet ustensilefait absolument défaut. On nous a tout simplement flanqués dans uncompartiment isolé du monde extérieur.
–&|160;Vous n’avez qu’à vous mettre à laportière, répondit d’un ton désespéré le caporal.
–&|160;Je vous ferai remarquer, mon caporal,dit Chvéïk, qu’il est rigoureusement interdit aux détenus de semontrer aux portières.
–&|160;Troisièmement, continua impitoyablementl’aspirant, nous devrions avoir à notre disposition une carafed’eau fraîche. Où est-elle&|160;? Voilà encore une preuve, caporal,de votre négligence. Pourriez-vous nous dire également quand et oùla soupe nous sera servie&|160;? Vous n’en savez rien&|160;?Naturellement&|160;! Je m’en doutais&|160;! Vous vous fichez detout&|160;!
–&|160;Voyez-vous, caporal, remarqua Chvéïk,ce n’est pas toujours drôle d’assurer la garde des prisonniers.Vous devez nous surveiller avec autant de soins que la prunelle devos yeux, car nous ne sommes pas de simples soldats comme vous,mais bien des détenus. Vous êtes obligé de mettre à notredisposition tout ce qui nous est nécessaire, car tout cela estréglé d’avance par les instructions que l’on vous donne et qu’ilfaut rigoureusement respecter. Sans cela, que deviendraitl’ordre&|160;? «&|160;Un homme en prison est quelque chose d’aussisacré qu’un bébé au maillot&|160;», disait toujours un chemineau dema connaissance. Je vous prierai également de me prévenir lorsqu’ilsera onze heures…
Le caporal regarda Chvéïk avec des yeuxétonnés.
–&|160;Vous semblez vous demander pourquoi,mon caporal, c’est parce que, lorsque onze heures sonneront, jen’appartiendrai plus à ce wagon de détenus et je devrai rejoindreun compartiment à bestiaux, déclara Chvéïk solennellement. Puis ilajouta&|160;: J’ai été puni de trois jours de salle depolice&|160;; j’ai commencé à purger ma peine à onze heures dumatin, et ce matin, à onze heures, je dois être libéré. À partir dece moment-là, je n’ai plus rien à faire ici. Le soldat ne peut êtreretenu en prison lorsque sa peine est terminée, ainsi que lerèglement le prescrit, car, n’est-ce pas, mon caporal, sans cela,que deviendraient l’ordre et la discipline…
Le caporal demeura muet pendant quelquesminutes. Puis il objecta simplement qu’il n’avait reçu aucun ordreconcernant les détenus.
–&|160;Mais, mon cher caporal, s’écrial’aspirant, les ordres ne sont jamais venus tout seuls aucommandant d’une escorte. Vous vous trouvez en face d’une situationtout à fait imprévue. En effet, d’une part, suivant le règlementqui régit le transport des détenus, ce wagon ne peut être quittépar aucun de nous avant notre arrivée à destination. D’autre part,vous n’avez pas le droit de garder un homme qui a terminé sa peine.Je me demande comment vous allez vous débrouiller. Chaque minutequi passe aggrave votre cas. Et songez qu’il est déjà dix heures etdemie.
L’aspirant sortit sa montre etajouta&|160;:
–&|160;Je suis très curieux de savoir ce quevous allez faire dans une demi-heure.
–&|160;Dans une demi-heure, je dois rejoindrele wagon à bestiaux, répéta Chvéïk d’un ton ému.
Le caporal se crut dans l’obligation de letranquilliser&|160;:
–&|160;Si notre société ne vous dérange pastrop, dit-il d’une vois douce, vous pourriez bien continuer levoyage dans ce compartiment, je pense…
Il fut interrompu, comme il achevait ces mots,par un cri que poussa le Révérend Père, qui était en train derêver&|160;:
–&|160;Ajoutez de la sauce&|160;!
–&|160;Dors, dors, lui dit Chvéïk doucement,fais de jolis rêves.
L’aspirant se mit à chanter&|160;:
Fais dodo petite poulette
Fais dodo t’auras du gâteau.
Le caporal, très abattu, laissa faire. Ilregardait, morne et muet, le paysage, et laissait les détenus seconduire comme bon leur semblait. Cependant les soldats del’escorte jouaient à «&|160;tape-cul&|160;» et, de leur coin, onentendait retentir des claques sonores.
Comme le caporal se retournait pour lesregarder, le derrière d’un poilu se dressa en face de lui. Lecaporal soupira tristement et tourna à nouveau son regard vers laportière.
L’aspirant prit la parole et, s’adressant aucaporal écrasé par ses responsabilités, il lui demanda&|160;:
–&|160;Connaissez-vous un journal quis’appelle&|160;: le Monde des Animaux&|160;?
Le caporal, visiblement joyeux de cettediversion, répondit vivement&|160;:
–&|160;Je le connais très bien, car mon patrons’y était abonné, chez nous. Il aimait beaucoup les chèvres Angoraet comme toutes celles qu’il élevait étaient brusquement mortes, ils’était adressé au journal pour demander conseil au sujet del’élevage.
–&|160;Cher ami, reprit l’aspirant, ce que jevais vous raconter vous prouvera, d’une façon indiscutable, que nuln’est sans défaut. Je pense même, messieurs, qui jouez là-bas àtape-cul, que mon histoire vous intéressera également, surtout àcause des expressions techniques dont vous pourrez enrichir votrevocabulaire. Je vais vous raconter l’histoire du Monde desAnimaux, pour vous faire oublier les soucis de la guerreactuelle.
Comment suis-je devenu le rédacteur en chefd’un journal aussi intéressant&|160;? Voilà qui a toujours été pourmoi une énigme. Je crois me rappeler que c’est pour rendre serviceà mon vieil ami Haiek, qui dirigeait jusque-là cette revue d’unefaçon fort honorable, que j’avais assumé cette responsabilité.Haiek s’était noblement épris de la fille de l’éditeur du journal,d’un certain monsieur Fuchs, qui, dès qu’il a appris la chose, l’aimmédiatement renvoyé, non sans avoir auparavant mis mon ami dansl’obligation de lui procurer un nouveau rédacteur en chef. Commevous voyez, il y avait à cette époque d’étranges conditionsd’embauche…
Lorsque mon ami m’a présenté à l’éditeur, ilme reçut très cordialement et me demanda si j’avais quelquesnotions d’histoire naturelle. Il fut très content de ma réponse,déclarant qu’il était très heureux de la sympathie que je portaisaux animaux, que je considérais à ce moment-là comme des étapesreprésentatives de l’évolution du genre humain. Aussi ai-jetoujours approuvé les ligues qui se proposent de défendre lesanimaux. Les bêtes, en effet, ne demandent pas autre chose qued’être traitées humainement avant d’être égorgées et mangées.L’habitude de certains chefs de cuisine, qui tordent le cou auxpoules, se trouve en contradiction avec les principes mêmes de laLigue pour la défense des animaux.
Ce brave homme me demanda si j’avais quelquesconnaissances sur les mœurs des oiseaux, des chiens, des lapins,des abeilles et toutes sortes d’autres animaux et insectes. Il medemanda également si j’étais habile à manier les ciseaux, pour endétacher les photographies des autres feuilles concurrentes, pourillustrer notre journal, et si j’étais en mesure de traduire lesarticles des revues étrangères qui s’occupaient des mêmes sujetsque notre canard.
Il me conseilla de m’inspirer du fameuxouvrage de Brehm sur les animaux, pour en tirer de bons sujetsd’éditoriaux, qu’il me proposait de rédiger en collaboration aveclui.
Il m’a demandé également si j’étais capable depondre des articles sur la météorologie, sur les concourshippiques, sur la chasse, sur l’éducation des chiens policiers, surles fêtes nationales et religieuses, bref, si j’étais à la page enmatière journalistique.
Je lui ai déclaré que je m’étais déjà occupéde la direction d’un journal de ce genre, et je répondis à toutesses questions d’une façon affirmative. Je lui assurai que le sien,sous ma direction éclairée, ne tarderait pas à élever son niveau àune hauteur prodigieuse, et j’ajoutai que je me proposais deréorganiser sa rédaction par la création de nouvelles rubriques,comme par exemple&|160;: le coin humoristique des animaux&|160;;les opinions des animaux sur leurs semblables, etc., tout cela entenant compte de la situation politique. Je vais préparer, luidis-je, quelques surprises à vos lecteurs, pour que leur attentionet l’intérêt qu’ils portent à votre journal ne se relâchent pas enpassant d’un animal à un autre. La rubrique&|160;: la journée desbestiaux, doit alterner avec un nouveau programme destiné àéclaircir la solution des problèmes qui se posent pour l’élevagedes animaux domestiques et du mouvement des bêtes à cornes.
Il m’a répondu alors, en déclarant que mesprojets le satisfaisaient pleinement que si je réussissais àréaliser seulement la moitié de mon programme, il m’offrirait unepaire de pigeons Wyandot-nains, qui avaient obtenu le premier prixà la dernière Exposition de Berlin, et pour lesquels leurpropriétaire avait été décoré de la médaille des Accouplementsréussis.
Je puis vous dire en toute modestie que j’aifait de sérieux efforts pour réaliser entièrement mon programme.J’ai mis toutes mes capacités en jeu et je puis vous affirmer que,bien souvent même, mes articles dépassaient largement les ditescapacités. Comme je m’étais promis d’offrir coûte que coûte dunouveau à mes lecteurs, j’ai inventé des noms d’animaux. J’avaisfait le raisonnement suivant&|160;: que les éléphants, les tigres,les lions, etc., étant depuis longtemps bien connus de notrepublic, il était nécessaire de lui présenter autre chose. J’aicommencé par lui parler de la baleine au ventre sulfurique. Cenouveau type de baleine que je leur décrivais, n’était pas plusgrand qu’un squale scie, mais avec cette particularité qu’il étaitpourvu d’une vessie particulière remplie d’acide sulfurique que lecétacé pouvait répandre à volonté sur les petits poissons pour lesparalyser avant de les bouffer. Un savant anglais, dont le nomm’échappe, bien qu’il soit également de mon invention, avaitexaminé, écrivais-je, ce liquide, qu’il avait dénommé&|160;:sulfate de baleine. L’huile de baleine était déjà fort connue, maisle sulfate a vivement intrigué certains de nos lecteurs qui m’ontécrit pour me demander l’adresse de la maison qui s’occupait detraiter ce nouveau produit industriel.
Je puis vous assurer, messieurs, que leslecteurs du Monde des Animaux étaient des gens fortimpatients de s’instruire. Peu après la baleine sulfurique, j’aiélargi leurs connaissances en leur présentant plusieurs nouvellesespèces d’animaux. Comme par exemple&|160;: le phoque-traque, unmammifère du genre kangourou&|160;; le bœuf-séculaire, que je leurai présenté comme une vache du type préhistorique&|160;; lerat-sépia, une sorte de rat vagabond qui aspergeait de sépia toutce qui l’entourait.
Bref, les animaux se multipliaient de jour enjour. J’étais étonné moi-même du succès que j’obtenais avec eux. Jerévélais les lacunes de l’histoire naturelle et les négligences deBrehm qui avait oublié dans son bouquin, faisant pourtant autoritéen la matière, toutes les sortes d’animaux que je décrivais. Car nilui ni aucun de ses disciples, n’avait eu en effet l’idée de parlerde ma chauve-souris d’Islande, de mon chat-domestique du nom deKilimandjaro, que j’avais dénommé&|160;: chat-cerf-sauvage.
Les savants qui s’occupaient de ces sortes dechoses n’avaient jamais soupçonné non plus l’existence de ma puceaveugle qui vivait sur le dos d’une taupe préhistorique, aveugleégalement, car son arrière-grand’mère avait épousé un parent pauvredans les grottes d’Adelsberg, lesquelles grottes se prolongeaient àcette époque jusqu’à la Mer Baltique.
Mes découvertes provoquèrent une polémiquepassionnée entre les journaux Tchas et Tchèkh de Prague. Le Tchèkh,organe clérical, en citant mon article sur la puce aveugle, l’avaitrésumé de la sorte&|160;: «&|160;Ce que Dieu fait est toujours bienfait&|160;». Le Tchas, au contraire, organe des radicaux, publia unarticle de démolition pour écraser, en même temps que ma puce,l’honorable journal catholique. C’est depuis ce jour que lamalchance commença à s’acharner sur mes découvertes. Les lecteursdu Monde des Animauxse mirent également à réagir.
Ils avaient été surtout choqués par lescommunications que j’avais faites au sujet de l’apiculture et del’aviculture, où j’avais développé mes théories qui provoquèrentune stupéfaction générale. Un grand apiculteur, du nom de Pazourek,ayant suivi mes conseils, avait été foudroyé par une apoplexie,cependant que les abeilles de toute la région de la forêt de Bohêmeet des Monts Géants étaient décimées.
Les basses cours connurent le même sort. Ellesfurent frappées d’une série d’épidémies qui détruisirent sans pitiétous les volatiles qui les peuplaient. Les lecteurs envoyèrent à ladirection du journal une quantité de lettres remplies d’invectivesen retournant le canard.
J’ai changé alors mon fusil d’épaule, et je mesuis lancé dans l’étude des oiseaux sauvages. Je me souviens encorede l’affaire que j’ai eue avec le rédacteur en chef du journalagricole, Cetsky Obsor, le député clérical Kadeltchak.J’avais découpé dans une revue anglaise un oiseau quelconque qui setenait sur une branche de noyer. Je l’avais dénommé&|160;:pic-noyer, ce qui était logique, puisqu’il se trouvait sur l’arbreque l’on appelle ainsi. S’il s’était trouvé sur un sapin, jel’aurais nommé naturellement&|160;: pic-sapin.
Vous n’imagineriez jamais tous les embêtementsque j’ai eus à cause de cet animal d’oiseau&|160;!
M.&|160;Kadeltchak prit la liberté dem’envoyer une carte postale pour m’apprendre que le pic-noyer enquestion n’était point un pic, mais une pie-de-chêne, que cette piepossédait déjà un nom en allemand et qu’il aurait fallu trouver unéquivalent dans la langue tchèque.
Je lui répondis, le même jour, pour luidévelopper mes théories sur la famille des pic-noyer, et jetruffais ma lettre de citations inventées, disant qu’ellesprovenaient de l’Histoire naturelle classique deBrehm.
M.&|160;le député me répondit par un éditorialdans son Cetsky Obsor.
Mon patron, M.&|160;Fuchs, qui se trouvait cejour-là comme d’habitude, assis sur la banquette de son café, où ilétudiait les journaux de province, avait découvert une quantitéconsidérables d’articles qui faisaient des allusions fréquentes auxpapiers sensationnels que je donnais dans le Monde desAnimaux.
Lorsque je vins le rejoindre dans le dit café,il me montra la réponse du député, avec un regard attristé.
Pour l’édification des consommateurs qui nousentouraient, je lus l’article à haute voix&|160;:
«&|160;M.&|160;le Directeur. Je vous ai déjàindiqué que votre journal, depuis quelque temps, avait prisl’habitude d’user d’une terminologie inexacte pour tout ce quiconcerne les animaux, qu’il néglige, d’autre part, les règlesélémentaires de notre langue tchèque et qu’il s’amuse à inventerdes animaux fantaisistes. Je donne comme preuve de ce que j’avancele cas de cette fameuse pie-de-chêne que votre rédacteur s’étaitpermis de présenter à ses lecteurs sous le nom de pic-noyer.
–&|160;Pie-de-chêne&|160;! soupira monpatron.
Je poursuivis ma lecture&|160;:
«&|160;J’ai reçu en réponse à unerectification que j’avais envoyée à votre rédacteur en chef, unelettre fort impolie, dans laquelle ce monsieur me traitait«&|160;d’ignorant criminel&|160;» et «&|160;stupide bête&|160;». Onne répond pas de cette façon à un honnête homme qui se permet devous faire des observations purement scientifiques. Il me seraitfacile, ridiculement facile de démontrer lequel de nous deux n’estqu’une «&|160;bête ignorante&|160;».
–&|160;J’avoue, fit observer l’aspirant, quej’avais peut-être un peu manqué aux usages, en lui envoyant unesimple carte postale, mais, étant surchargé de besogne, je n’avaisguère le temps de m’occuper de la forme sous laquellej’écrivais.
«&|160;Après l’attaque brutale du rédacteur enchef du Monde des Animaux, ajoutait la lettre, je me voisdans l’obligation de clouer ce rédacteur au pilori.
«&|160;Sachez que je fais, monsieur, desétudes et cela non seulement à l’aide de livres, mais en observantla nature elle-même. Sachez, monsieur, qu’il y a plus d’oiseaux encage dans ma maison, que votre rédacteur n’en a vu dans sa vie, carj’imagine que ce monsieur pour rédiger des articles dans le genrede ceux qu’il sert à ses lecteurs passe son temps à étudier lesanimaux dans les cafés de Prague.
«&|160;Mais tout cela n’est à mes yeux quechose secondaire, bien qu’il eût été fort utile, sans doute, àvotre rédacteur en chef, de prendre quelques renseignements sur moiavant de se mêler de me traiter de «&|160;bête ignorante&|160;».Mais il s’agit moins d’une polémique personnelle avec un personnagequi me paraît un peu timbré que de questions scientifiques, et jetiens à répéter qu’il est stupide d’inventer de nouveaux noms pourdésigner des oiseaux connus comme la pie-de-chêne en question.
–&|160;Ah, oui, la pie-de-chêne&|160;! soupiraencore mon patron d’un ton désespéré.
Mais, sans me laisser décourager, jepoursuivis ma lecture&|160;:
«&|160;On n’a pas idée de se permettre depareilles libertés avec des sujets scientifiques. Votre rédacteuren chef ne connaît absolument rien aux choses de cet ordre etsachez que je le considère comme un vulgaire voyou. Commentose-t-on nommer pic-noyer une simple pie-de-chêne&|160;?
«&|160;Votre rédacteur sera bien obligé dereconnaître que ma science est de beaucoup supérieure à la sienne,qu’il sache que le pic-noyer est appelé par le docteur Bayer&|160;:meucifrga carycatectes B et ce B ne signifie nullementcomme votre rédacteur en chef pourrait le supposer&|160;: bêteignorante. Les Ornithologues tchèques ignorent absolument tout devotre pic-noyer que ce monsieur s’est permis d’inventer de toutespièces. Qu’il me traite de bête ignorante, cela ne changeabsolument rien au fait.
«&|160;Une pie-de-chêne&|160;» reste toujoursune pie-de-chêne, même si le rédacteur en chef du Monde desAnimaux s’obstine à le nier. Tout cela, hélas&|160;! estsurtout à mes yeux une nouvelle preuve des libertés qu’à notreépoque se permettent de prendre envers la science un grand nombrede gribouilleurs et d’ignorants comme ce malhonnête homme qui sepermet de citer un passage tiré soit disant de l’Histoirenaturelle de Brehm, contenant, d’après lui, un fragment del’étude sur la pie-de-chêne, alors, qu’à la place indiquée ontrouve une étude sur l’échassier noir (lanius minor). De plus, cetignorant crétin pousse l’audace jusqu’à vouloir me faire croire quele grand savant nommé plus haut a classé la pie-de-chêne dans le15e groupe des corbeaux, alors que Brehm a classé lescorbeaux dans la 18e famille des oiseaux&|160;».
–&|160;Pie-de chêne&|160;! s’écria mon patron,en se prenant la tête à deux mains. Passez-moi cet article. Je veuxle lire moi-même.
Je fus effrayé par sa voix, qui avait pris unton sombrement désespéré, pendant qu’il continuait la lecture de lalettre&|160;:
«&|160;Le colibri ou merle turc, ajoutait moncorrespondant, demeure dans toutes les langues un colibri, comme lapie-de-pin demeure toujours une pie-de-pin…
–&|160;La pie-de-pin devrait être nommée«&|160;pinavore&|160;», remarquai-je, car elle se nourrit avec lesfruits du pin.
M.&|160;Fuchs jeta violemment le journal surla table et se mit tout à coup à quatre pattes pour se dissimulersous le billard, en criant d’une voix rauque&|160;:
–&|160;Turdus&|160;! Colibri&|160;! Pas depie-de-chêne&|160;! Non, c’est un pic-de-noyer&|160;! Attendez, jevais vous mordre&|160;!
Enfin, on l’a empoigné et, trois jours après,il succombait à une méningite.
Les dernières paroles qu’il prononça, à un deses rares moments de lucidité, furent celles-ci&|160;: «&|160;Il nes’agit pas de mon intérêt personnel, mais de la justice.&|160;»
L’aspirant, ayant terminé son histoire, setourna vers le caporal pour lui dire sèchement&|160;:
–&|160;Je vous ai raconté tout cela pour vousprouver qu’il y a des situations où chacun est amené à commettredes erreurs.
Le caporal baissa la tête d’un air confus etse tourna vers la portière pour admirer le paysage qui fuyait.
Chvéïk avait écouté l’histoire de l’aspirantavec un intérêt passionné, cependant que les soldats de l’escortese regardaient avec un air ahuri.
Chvéïk prit la parole et dit&|160;:
–&|160;Rien ne demeure caché dans ce monde. Lavérité finit toujours par éclater, comme vous venez de le voir àl’aide de l’exemple précédent, qui nous montre qu’une pie-de-chênene peut pas devenir un pic-de-noyer. C’est toujours trèsintéressant de voir comment on se fait duper. Inventer des animaux,évidemment, c’est pas facile&|160;; mais présenter ces animauximaginés, c’est plus difficile encore. Il y a quelques années, nousavons connu un certain Mestek, qui inventa une sirène pourl’exhiber dans la rue Havlitchkova, dans le quartier de Vilohrade,derrière une tapisserie. Il avait ouvert un trou dans cettetapisserie et on pouvait voir à travers, un long divan tout à faitordinaire, sur lequel une dame de Zijkov était allongée comme sielle apprenait à nager. Ses jambes étaient enveloppées dans uneécharpe d’indienne vert argenté, imitant la queue d’une sirène. Sescheveux étaient teints en vert aussi, elle portait des gants enforme de nageoires en carton vert et, dans le dos, on lui avait misaussi une sorte de nageoire qu’elle pouvait bouger comme ungouvernail, à l’aide d’une ficelle cachée.
L’entrée était interdite aux jeunes gens demoins de quinze ans. Mais au-dessus de seize ans, on pouvait allervoir le miracle, moyennant une entrée, et tout le monde était fortcontent, car la sirène avait une croupe qui se posait un peu là, etsur laquelle on avait fixé un écriteau où était écrit&|160;:«&|160;Au revoir&|160;!&|160;»
Quant à la poitrine, elle était beaucoup moinsdéveloppée. À sept heures du soir, M.&|160;Mestek avait fermé laboutique et dit à la sirène&|160;: «&|160;Mademoiselle, vous pouvezretourner chez vous&|160;». Là-dessus, elle s’habilla et à dixheures du soir, nous la vîmes se promener dans la rue principale deTabor. À chaque monsieur qu’elle rencontrait, elle adressait, trèsaimablement, cette invitation&|160;: «&|160;Mon petit, veux-tuvenir chez moi&|160;?&|160;» Mais comme elle n’était pas en carteM.&|160;Drascher la fit monter dans le panier à salade, et ill’envoya au dépôt, ce qui obligea M.&|160;Mestek à fermerboutique.
Comme Chvéïk achevait de conter cellehistoire, l’aumônier dégringola tout à coup de la banquette. Il nese réveilla pas pour si peu et continua à dormir, étendu, sur leplancher.
Le caporal le regarda, d’un air penaud, puisil s’approcha de lui et, sans demander qu’on l’aidât, le remit surla banquette. Il était clair qu’il avait perdu le sentiment de sonautorité, et lorsqu’il dit d’une voix brisée&|160;: «&|160;Enfin,vous pourriez tout de même me donner un coup de main&|160;!&|160;»les soldats de l’escorte continuèrent à regarder avec indifférencedans le vide, et personne ne bougea le petit doigt.
–&|160;Il aurait fallu le laisser roupiller oùil était, fit observer Chvéïk. Je n’agissais pas autrement avec monaumônier. Une fois, je l’ai laissé dormir au cabinet, une autrefois dans une armoire, un autre jour je l’ai trouvé endormi dansune grande lessiveuse. Dieu sait que messieurs les aumôniersronflent comme des bienheureux.
Le caporal manifesta, à ces mots, une certaineindignation et il voulut montrer son autorité, fortcompromise&|160;:
–&|160;Ta gueule, dit-il, et ferme ça&|160;!Ces tampons sont comme des concierges, ils passent leur temps àbavarder. C’est une race de punaises…
–&|160;Mais oui, naturellement, et vous, vousêtes un ange, mon caporal, répondit Chvéïk calmement, avec laplacidité d’un philosophe qui, s’étant proposé comme tâche laréalisation de la paix mondiale, se serait heurté à de violentesobstructions, vous êtes semblable à la mère douloureuse dedieu…
–&|160;Seigneur tout-puissant&|160;! s’écrial’aspirant en joignant pieusement ses mains comme pour une prière,fais que nous n’ayons dans notre cœur que de l’amour pour nosgalonnés&|160;! Que dieu bénisse notre séjour dans cette prisonroulante&|160;!
Le caporal se mit à hurlersérieusement&|160;:
–&|160;Je vous défends de m’adresser lamoindre observation&|160;! vous m’entendez&|160;?
–&|160;Mais, mon cher, vous n’êtes pas lemoins du monde visé, répondit d’un ton conciliateur l’aspirant. Ily a toutes sortes de créatures de par le monde auxquelles la naturea refusé l’intelligence. Si l’on vous ôtait les galons qui vousrevêtent d’un peu de prestige, vous seriez en tout point semblableà ces milliers de pauvres bougres que l’on abat chaque jour sur lefront. D’autre part, on aurait beau vous flanquer un galon de pluset même davantage, soyez assuré que votre horizon intellectuel nes’agrandirait pas le moins du monde. Songez que lorsque vousdisparaîtrez de cette planète pas une personne sur terre ne verseraune larme sur vous.
–&|160;Vous aurez à faire à moi lorsque nousarriverons à destination&|160;! cria le caporal furieux.
L’aspirant se mit à rire&|160;:
–&|160;Vous voulez dire que vous me dénoncerezpour vous avoir offensé&|160;? Mais êtes-vous capable de comprendrece qui est blessant pour vous dans ce que je viens de dire&|160;?Je parie que vous n’avez pas retenu un traître mot de notreconversation. Si je vous déclarais, avec juste raison, que vousn’êtes qu’un être embryonnaire, vous l’oublieriez aussitôt, je nedis pas avant d’arriver à la prochaine station, mais avant même quede voir défiler le prochain poteau télégraphique. Vous êtesestropié de cervelle, mon ami&|160;! Je ne peux même pas imaginerque vous soyiez capable de vous souvenir du tiers de la moitié duquart de ce que nous avons dit ensemble. D’ailleurs vous pouvezinvoquer le témoignage des camarades présents, qu’ils disent s’ilsm’ont entendu prononcer un seul mot d’injure vousconcernant&|160;?
–&|160;Bien entendu, répondit Chvéïk, personnene vous a dit un mot que vous pourriez mal interpréter. C’esttoujours malheureux de voir quelqu’un qui se fâche. Ainsi parexemple, un soir que je me trouvais dans le café au«&|160;Tunnel&|160;», et que nous étions en train de discuter,entre nous, sur les orangs-outangs, il y avait dans notre société,un type de la marine qui nous raconta qu’il avait vu, un jour, unorang-outang et qu’on pouvait à peine le distinguer d’un bourgeoisbarbu, «&|160;car il avait, ajouta-t-il, une barbiche comme parexemple… par exemple, ce monsieur qui est là, à la tablevoisine&|160;», nous nous sommes mis à regarder le monsieur que cecamarade nous indiquait et, tout à coup, le type se lève de satable, s’approche de notre marin et lui fout une baffe.
Là-dessus le matelot se dresse, comme s’ilavait eu un ressort dans le derrière, et lui brise la tête avec unebouteille de bière. Le monsieur à la barbe d’orang-outang tombaraide à la renverse. Sur le moment, nous l’avons cru mort, ce quevoyant notre marin prit le large. Alors, nous nous sommesprécipités vers ce monsieur pour essayer de le faire revenir à lui.Ça ne nous a pas beaucoup réussi, car dès que le type a repris sessens, voilà qu’il se met à gueuler et à appeler la police. Bref,pour finir, on nous a tous emmenés au commissariat. Là, devant lecommissaire, le bonhomme ne fait que répéter que nous l’avons prispour un orang-outang, que nous avons raconté un tas de blagues surson compte, etc. J’ai demandé au commissaire qu’il ait l’obligeanced’expliquer à ce monsieur son erreur. Mais le cochon n’était pasfacile à convaincre&|160;; il s’est mis à accuser le commissaired’être notre complice. Alors celui-ci, dégoûté, le fit mettre auviolon. Nous, nous nous apprêtions à retourner au«&|160;Tunnel&|160;» mais nous avons dû prendre le même chemin quel’orang-outang. Vous voyez donc, mon caporal, qu’il peut arriverqu’un malentendu insignifiant entraîne un tas d’ennuis, et quecertaines paroles mal interprétées peuvent créer des«&|160;piquo-pros&|160;». Ainsi, par exemple, un autre jour, àKroleitsikh, j’ai connu un autre bourgeois qui s’était fâché luiaussi parce qu’on lui avait dit, une fois, à Nemetsky-Brode, qu’ilétait un serpent-tigre. Je crois qu’il ne faut pas attacherbeaucoup d’importance aux mots. Si je me permettais, par exemple,de vous dire que vous êtes un rat, est-ce que vous vousfâcheriez&|160;?
Le caporal bondit de la banquette et se mit àhurler. Des cris de rage, de désespoir, sortirent de sa bouche enune vaste rumeur&|160;; c’était une avalanche de cris sauvages quidominaient même le ronflement de l’aumônier.
Puis, brusquement, le caporal se calma. Iltomba dans une morne prostration et, assis sur sa banquette, sesyeux fixèrent à nouveau, derrière la portière, les monts et leschamps qui défilaient.
–&|160;Mon caporal, lui dit l’aspirant,l’attitude dans laquelle vous vous trouvez me rappelle la sombrefigure de Dante. Vous avez la noble expression de ce poète, d’unhomme de cœur et d’esprit, auquel aucune subtilité ne peutéchapper. Restez, je vous en prie, dans cette attitude. Ce regardnostalgique, ces yeux ahuris fixés sur le paysage sont un des plusbeaux spectacles qu’il m’ait été donné de contempler. Vous songez,sans doute, à ce que deviendra cette campagne, lorsque le printempsla recouvrira d’un tapis de fleurs parfumées…
–&|160;… et dans ce tapis coulera une petitesource, ajouta Chvéïk, qui venait de se sentir submergé tout à couppar une vague poétique.
Cependant, le caporal gardait un mornesilence. L’aspirant fit remarquer qu’il avait certainement aperçula tête du caporal dans une exposition de sculpture.
–&|160;Permettez-moi de vous demander, moncaporal, si vous n’avez jamais servi de modèle au célèbre sculpteurSaurza&|160;?
Le caporal le regarda tristement etrépondit&|160;:
–&|160;Non.
L’aspirant secoua la tête et s’allongea sur labanquette, cependant que les soldats de l’escorte se mettaient àjouer aux cartes avec Chvéïk.
Le caporal, pour chasser les sombres idées quile harcelaient, se plaça derrière lui en spectateur, se permettantmême de faire des observations à son détenu. Il fit remarquer àChvéïk qu’il n’aurait pas dû jouer pique&|160;: «&|160;Qu’il avaitcommis ainsi une grosse faute car il aurait dû garder son sept pourle coup final.&|160;»
–&|160;Dans les restaurants de chez nous, luirépondit Chvéïk, il y avait autrefois de jolies affiches pour cessortes de spectateurs qui se mêlent de donner des conseils à ceuxqui jouent. Je me rappelle encore de ces deux vers&|160;:
Bon spectateur ferme-la
Sinon, tu dérouilleras…
Le train s’arrêta brusquement et l’officier deservice monta dans le compartiment pour inspecter le wagon desdétenus.
–&|160;Ah&|160;! Ah&|160;! nous y voici&|160;!dit l’aspirant en souriant.
Le commandant du train était en l’occurrence,le docteur Mraz, lieutenant de réserve. Ces travaux fastidieux desurveillance étaient en général confiés à des réservistes. Ledocteur Mraz ne savait plus où donner de la tête. Bien qu’il fûtprofesseur de mathématiques, en temps de paix, il n’arrivait jamaisà trouver le nombre exact de wagons qui composaient le train. Illui arrivait souvent d’égarer dans ses listes, un ou plusieurshommes. En compulsant ses notes il était stupéfait en s’apercevantqu’il trouvait deux cuisines de plus que celles qu’il y avait enréalité, ou il constatait, parfois, que le nombre de chevaux,depuis le départ de Budeiovitz, avait augmenté d’une façon tout àfait extraordinaire. Sur la liste des officiers il cherchait envain deux cadets sans pouvoir deviner ce qu’ils étaient devenus. Aubureau du colonel on recherchait inutilement une machine à écrirequi avait disparu. Tous ces comptes embrouillés lui avaient donnéune migraine épouvantable. Bien qu’il eût pris, déjà, depuis ledépart, trois cachets d’aspirine, il avait en montant dans lecompartiment une mine de martyr.
Debout dans le wagon des détenus, il écouta,impassible, le rapport du caporal. Celui-ci lui annonça qu’il étaitchargé de la surveillance des deux prisonniers, qu’il disposait detant de soldats, etc.
Le lieutenant compara son rapport avec seschiffres et jeta autour de lui un regard attentif.
–&|160;Quel est cet oiseau-là&|160;?demanda-t-il sévèrement en apercevant l’aumônier étendu sur labanquette, et dont le derrière se dressait irrespectueusement enface de l’officier.
–&|160;Mon lieutenant, balbutia le caporal,c’est que… je veux dire… que…
–&|160;Que voulez-vous dire&|160;? grogna ledocteur Mraz. Expliquez-vous clairement&|160;!
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, répondit Chvéïk à la place du caporal, que ce monsieurqui dort là, couché sur le ventre, c’est l’aumônier du régiment. Ilest complètement noir. À notre départ de Budeiovitz, il a voulu àtout prix nous accompagner et il a grimpé dans notre wagon. Vu quec’était un gradé supérieur, nous n’avons pas osé le foutre à laporte, pour ne pas commettre le crime d’insubordination contre ladiscipline. Il a dû se tromper et prendre notre wagon de détenuspour celui de l’état-major.
Le docteur Mraz prit alors une mesureénergique. Il ordonna au caporal de retourner l’aumônier sur lacouchette en déclarant qu’il était impossible de reconnaîtrel’identité de celui-ci en ne voyant que la partie qu’il montrait deson individu. Après des efforts acharnés, le caporal réussit àretourner sur le dos le révérend père qui se réveilla. Voyant unofficier devant lui, il le salua amicalement&|160;:
–&|160;Tiens, bonjour Fredy&|160;! Quoi deneuf&|160;? Le dîner est prêt&|160;?
Là-dessus, il referma aussitôt les paupières,se retourna et se rendormit.
Le docteur Mraz avait reconnu le pochard de laveille, le même qui s’était empiffré au mess des officiers. Ilsoupira et dit tout bas&|160;:
–&|160;Caporal, pour cette affaire, vous irezdemain au rapport.
Puis il tourna les talons, mais comme ils’apprêtait à partir, Chvéïk lui dit&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je ne devrais pas être ici. J’aurais dû quitter laprison à dix heures et demie, puisque c’est à ce moment-là que mapeine se termine. Ma place devrait être dans le wagon à bestiaux,parmi les copains de ma compagnie. Étant donné que onze heures ontsonné, je vous serais fort reconnaissant si vous me faisiez mettreen liberté et si vous me faisiez conduire, soit dans mon wagon àbestiaux, soit chez le lieutenant Lukach, dont je suisl’ordonnance.
–&|160;Comment vous appelez-vous&|160;? luidemanda le docteur Mraz.
–&|160;Joseph Chvéïk.
–&|160;Ah, voici donc ce fameux Chvéïk, grognale lieutenant. Vous auriez dû en effet sortir de prison à dixheures et demie, mais le lieutenant Lukach m’a demandé de vousgarder ici jusqu’à notre arrivée à destination. Comme çà noussommes sûrs que vous ne ferez pas de nouvelles blagues enroute.
Lorsque le lieutenant fut parti, le caporals’écria avec satisfaction&|160;:
–&|160;Vous vouliez m’attirer des embêtements,Chvéïk&|160;! Mais vous voyez que cela ne vous a pas réussi. Sij’avais voulu, c’est moi qui aurais pu vous mettre en mauvaiseposture.
–&|160;Mon caporal, riposta l’aspirant, vousparlez sans réfléchir. Ce n’est pas avec des arguments de ce genreque vous arriverez à vous relever dans notre estime. Un hommeintelligent comme vous, même s’il est furieux, doit dire des chosessensées. Je digère mal également votre vantardise odieuse. Vousauriez pu, avez-vous dit, nous mettre en mauvaise posture. Etpourquoi alors ne l’avez-vous pas fait&|160;? Auriez-vous vouluainsi nous donner la preuve du haut degré de délicatesse auquelvous pouvez atteindre&|160;?
–&|160;En voilà assez, s’écria le caporal. Sivous continuez à vous foutre de moi, je vous fais passer en conseilde guerre&|160;!
–&|160;Mais pour quelle raison, monpetit&|160;? demanda l’aspirant.
–&|160;C’est mon affaire&|160;! répondit lecaporal d’un ton décidé.
–&|160;Votre affaire&|160;? dit l’aspirant ensouriant, votre affaire et la nôtre sans doute&|160;! Je comprends,mon ami, la raison de votre mauvaise humeur. Mais ce n’est pas uneraison, parce que vous irez demain au rapport, pour vous permettrede nous engueuler au mépris de tous les règlements.
–&|160;Vous n’êtes que des voyous&|160;!s’écria le caporal.
–&|160;Je vais vous dire une bonne chose, fitChvéïk. Je suis déjà un vieux soldat, j’ai fait mes trois ans avantla guerre, et je vous assure que ces engueulades ne rapportent pasgrand chose. Lorsque j’étais encore bleu, nous avons eu un juteux àla compagnie, un certain Schreiter. C’était un rengagé&|160;; ilavait dû se cogner la tête quelque part et perdre son bon sens pourchoisir un métier pareil. Or, cet homme-là ne cessait pas de noustraquer, il trouvait partout des sujets d’observations. Ça, cen’est pas réglementaire, ça ce n’est pas ce qui convient à unmilitaire, vous n’êtes pas des soldats, vous n’êtes que des gardeschampêtres. Un jour j’en ai eu assez, je me présente au rapport dela compagnie.
–&|160;Que voulez-vous&|160;? me demanda lecapitaine.
–&|160;Mon capitaine, je vous déclare avecobéissance, que je viens me plaindre au sujet de notre adjudant.Nous sommes des soldats de sa majesté impériale et royale et nonpas des gardes champêtres. Nous sommes au service du kaiser et nonpas de simples bourgeois, que je lui réponds.
–&|160;Tâche de déguerpir d’ici, espèced’imbécile&|160;! me dit le capitaine.
Alors, je lui ai répondu que je demandais àêtre conduit au rapport du bataillon.
Au rapport du bataillon lorsque j’ai expliquéque nous n’étions pas des gardes champêtres, mais des soldats de SaMajesté Impériale et Royale, le lieutenant-colonel m’a collé deuxjours de salle de police.
Là-dessus, j’ai demandé qu’on m’amène aurapport du régiment.
Au rapport du régiment, le colonel m’a d’abordengueulé, en me disant que j’étais un idiot et qu’il me souhaitaitd’aller au diable. Là-dessus je répondis&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncolonel, que je demande à être présenté au rapport du régiment.
Alors, il a eu la frousse, et il a fait venirl’adjudant Schleiter au bureau du régiment, et le juteux a étéobligé de me faire des excuses devant tous les officiers pourm’avoir outragé en me traitant de garde champêtre. Mais en sortantdu bureau, cet enfant de salaud m’a rejoint dans la cour et m’adéclaré qu’à partir de ce jour il ne m’adresserait plus la parole,mais qu’il s’arrangerait tout de même pour me faire coffrer.
J’ai eu beau me tenir peinard, un jour quej’étais en sentinelle devant le magasin aux munitions, où lessoldats avaient pris l’habitude de se distraire en écrivant sur lemur du bâtiment, le juteux m’a eu. Lorsque je suis arrivé pourprendre ma faction, il y avait déjà sur le mur, dessiné à la craie,un sexe de femme, et dessous on avait écrit un vers.
Moi, j’avais pas grand’chose comme idée,aussi, je n’ai fait que mettre ma signature sousl’inscription&|160;: «&|160;Le juteux Schleiter est unchameau.&|160;» Et voilà-t-il pas que ce chameau de Schleiter m’adénoncé, car il m’avait espionné, le traître&|160;!
Mais, par malheur, au-dessus de l’inscriptionqui concernait le juteux, il y en avait encore une autre&|160;:«&|160;Penses-tu que nous irons faire la guerre&|160;? Ah&|160;!merde alors&|160;!&|160;»
Ça se passait en 1912, cette même année où, àcause de notre consul Prochaska, qui avait été assassiné, on avoulu marcher contre la Serbie. Aussi on m’a immédiatement envoyé àTérésina, au tribunal régional. Les messieurs du tribunal sontvenus photographier au moins quinze fois le mur, avec les dessinset inscriptions. Ils m’ont fait faire plusieurs pages d’écriturepour savoir comment j’écrivais&|160;: «&|160;Penses-tu que nousirons faire la guerre&|160;? Ah merde alors&|160;!&|160;»
Puis il m’a fallu écrire une quinzaine de foisau moins que «&|160;le juteux Schleiter est un chameau&|160;».Ensuite un graphologue est venu et il m’a fait encore écrire&|160;:«&|160;C’était le 29 juin 1897, l’année où Kralov Dur sur l’Ebbe aconnu les terreurs de l’inondation…&|160;»
Mais, comme disait le capitaine-rapporteur,tout cela n’était pas encore suffisant, car il ne s’agissait passeulement de se rendre compte si les N, les I, les R que je faisaisétaient pareils à ceux de l’inscription mais il fallait également,d’après lui, savoir comment j’écrivais toutes les lettres dont secompose le mot&|160;: merde. Alors, l’expert s’est mis à medicter&|160;: moche, melon, madame, mardi. Ce graphologue-expert afini par devenir dingo avec toutes ces histoires. Il regardait toutle temps derrière lui, où se tenait un soldat baïonnette au canon.Enfin il a déclaré que toutes mes pages d’écriture, accompagnées dephotographies, devaient être envoyées à Vienne, et il me fit encoreécrire cette phrase&|160;: «&|160;Qui va lentement vasûrement&|160;». Là-dessus, toutes ces paperasses ont été expédiéesà Vienne et, pour finir, ces messieurs ont reconnu que lesinscriptions n’étaient pas de mon écriture, mais que la signatureétait la mienne, ce que j’ai d’ailleurs reconnu volontiers.
J’ai écopé de six semaines de prison pouravoir gribouillé mon nom sur le mur d’un bâtiment appartenant àl’armée, et le jugement ajoutait&|160;: «&|160;Que pendant quej’écrivais sur le bâtiment de Sa Majesté, je n’avais pas fait mondevoir de sentinelle.&|160;»
–&|160;Eh bien, vous voyez&|160;! remarquaavec satisfaction le caporal, que ces sortes de cochonneries nerestent jamais impunies&|160;! À cette époque, vous étiez déjà bonpour la potence. Si j’avais été à la place du tribunal, c’est passix semaines que je vous aurais collées, mais plutôt sixans&|160;!
–&|160;Allons, allons, mon cher, ne vousfaites pas plus méchant que vous ne l’êtes, fit l’aspirant. Songezplutôt à ce qui vous attend, avant de vouloir condamner les autres.Nous venons d’avoir la visite de l’officier de service qui vous apromis de vous faire passer au rapport. Vous feriez bien de vous ypréparer, en méditant pieusement sur le peu de solidité desgrandeurs d’un caporal. Pensez à ce que vous êtes dans l’univers,où l’astre le plus proche de notre train de transport militaire est275 fois plus loin que le soleil. Même si vous étiez un astre fixe,vous seriez encore si peu de chose, que l’on ne pourrait pas vousvoir, même avec les meilleurs instruments astronomiques. Iln’existe pas d’expression assez puissante pour exprimer le peu deplace que nous tenons dans le monde. Songez, caporal, que la courbeque vous pourriez former en marchant pendant six mois serait uneellipse tellement insignifiante que son axe parallèle ne pourraitmême pas être mesuré.
–&|160;Dans ce cas, remarqua Chvéïk, notrecaporal va devenir fier qu’on soit incapable de mesurer soninsignifiance. Si les émotions qui l’attendent au rapport lerendent un peu malade, je lui conseille de ne pas s’en faire poursi peu, car nous sommes maintenant en guerre et il n’y a que leshommes valides qui vont sur le front.
Si même on vous mettait en taule, mon caporal,continua Chvéïk avec son sourire le plus aimable, il ne faut pasperdre la raison pour cela. Inutile de raconter à tout le monde ceque vous pensez. J’ai connu un marchand de charbon, un certainFrantisek Chkvor, lequel, au début de la guerre, était en prisonavec moi à la Préfecture de Prague. Il était inculpé de hautetrahison. Plus tard, je crois même qu’on l’a pendu parce qu’ilavait été compromis dans une sorte de complot. Donc, lorsqu’onl’interrogeait et qu’on lui demandait s’il n’avait pasd’observations à faire, il répondait&|160;:
–&|160;Les choses sont arrivées ainsi, parcequ’elles ne pouvaient pas arriver différemment, si elles avaientété différentes, elles ne seraient pas arrivées ainsi.
Pour cette déclaration, il a eu deux jours decachot, sans manger ni boire. Puis on l’a ramené àl’interrogatoire, où il n’a cessé de répéter&|160;: Les choses sontarrivées ainsi, parce qu’elles ne pouvaient arriver différemment,etc.
Il devait répéter cela même en se rendant à lapotence.
–&|160;Oh&|160;! on en zigouille pas mal cestemps-ci, dit un homme de l’escorte. On nous lisait, il y aquelques jours, une ordonnance au sujet d’un réserviste du nom deKudrna, qu’on a zigouillé à Motol. Lorsque sa femme était venue luifaire ses adieux à la gare, en portant son gosse sur les bras, lecapitaine de son régiment, devenu subitement furieux, a flanqué uncoup de sabre sur la tête de l’enfant. Mais ceux qu’on zigouille leplus, ce sont les gens qui s’occupent de politique. Ainsi, on apassé par les armes un journaliste en Moravie, et notre capitainedit toujours que les autres ne perdent rien pour attendre.
–&|160;Tout a une fin&|160;!
–&|160;Là-dessus, vous avez bien raison,déclara le caporal. On devrait en faire autant à tous lesjournalistes, ils ne font qu’exciter le peuple. Il y a deux ans,lorsque je n’étais que premier soldat, j’avais dans mon escouade unjournaliste qui m’appelait toujours&|160;: «&|160;Épouvantail del’armée&|160;!&|160;» Oui, mais je lui en ai fait baver. Je lui aifait tremper sa liquette de sueur. Et alors, le bougre a changé deton&|160;: «&|160;Pardon, monsieur, qu’il me disait, respectez enmoi l’homme.&|160;» Je lui ai montré mon respect en l’obligeant àse coucher dans la cour de la caserne, après un orage. Je l’aiconduit devant une mare, puis je lui ai ordonné&|160;: Couche-toi,s’pèce de salaud&|160;! Il était aussi mouillé que s’il venait desortir d’une piscine. Et j’exigeai qu’une heure plus tard il seprésente à moi, propre comme un sou neuf. Vos boutons, que je luiai dit, doivent briller comme une glace. Il a passé toute lamatinée à se débarbouiller et à pousser des gueulements, et lelendemain je recommençais la même comédie. Puis je lui aidemandé&|160;: Qu’en pensez-vous&|160;? Qui est le plus fortici&|160;: l’épouvantail de l’armée ou le journaliste&|160;?C’était un vrai type de l’intellectuel…
En disant ces mots, le caporal regardal’aspirant d’un air triomphal, puis poursuivit&|160;:
–&|160;Lui aussi, il avait été exclu del’école des aspirants pour son intelligence, car il avait eu leculot de mettre dans les journaux que l’on maltraitait les soldats.Non, mais, sans blagues&|160;! Cet homme-là n’était même pascapable de démonter son fusil, et il aurait voulu qu’on lui foutela paix. Si je lui disais&|160;: à gauche, il tournait la tête,comme qui dirait exprès, à droite&|160;; et il faisait une gueulede baleine en bas âge. C’est comme pour le maniement du fusil, ilne savait jamais par quel bout le prendre, et il me regardait commeun jeune veau lorsque j’essayais de lui apprendre la façon de faireun bon&|160;: Présentez armes&|160;! Il ne savait même pas surquelle épaule on porte le fusil, et il saluait comme un gorille.Pour le dresser, je lui ai collé un fusil rouillé, afin qu’ilapprenne à le nettoyer. Il a eu beau frotter du matin au soir,dépenser tout son argent en huile et en toile émeri, c’était peineperdue. Plus il s’acharnait, et plus la rouille ressortait. Aurapport, quelques jours après, le fusil passa de mains en mains, ettout le monde en bavait de voir une arme aussi sale. Notrecapitaine lui disait toujours&|160;: Vous ne serez jamais unsoldat, vous bouffez inutilement la soupe du Kaiser, etc., etc. Unjour, on découvrit dans sa valise toute une masse de bouquinsremplis de balivernes sur le désarmement, la paix entre lespeuples, etc. Pour cela, on l’a mis pour quelques semaines enprison et il ne nous embêta plus, jusqu’au jour où, pour sedébarrasser de lui, on l’a chargé de faire des écritures pour qu’ilne puisse pas contaminer les soldats. Voilà comment a fini cethomme intelligent&|160;! Et pourtant, il aurait pu devenirofficier, s’il n’avait pas lu, écrit et dit tant de bêtises sur sondésarmement et sa paix mondiale&|160;!
Le caporal soupira et ajouta d’un airattristé.
–&|160;Il ne savait même pas plierconvenablement sa capote. Il avait fait venir toutes sortes deproduits pour astiquer ses boutons, et, malgré cela, ils étaienttoujours noirs comme le cul d’un cochon. Mais pour raconter desboniments, il s’y connaissait, l’animal&|160;! Au bureau, il nefaisait que philosopher. C’était son dada, car, comme il le disait,il était toujours «&|160;un être humain&|160;». Je me rappellequ’un jour, en le faisant allonger dans une mare, je lui aidit&|160;: En vous écoutant radoter, cela me rappelle que j’ai lu,un jour, que l’homme avait été fait avec de la boue, parconséquent, vous retournez d’où vous êtes sorti, inutile degueuler&|160;!
Le caporal se tut, fort content delui-même.
Il s’attendait à ce que l’aspirant luirépondit, mais ce fut Chvéïk qui prit la parole à saplace&|160;:
–&|160;Pour les mêmes tracasseries, dit-il, etpour de pareilles chicanes, un certain Konitchev, du 35ede ligne, avait lardé son caporal à coups de baïonnette. J’ai lul’histoire dans le Courrier.Le caporal n’avait pas moinsde trente coups de baïonnette dans le ventre, dont douze étaientmortels. Le soldat, son crime accompli, s’assit sur sa victime ets’égorgea lui-même. Je connais un autre cas, qui est arrivé enDalmatie où on a égorgé un caporal, et l’on n’a jamais pu mettre lamain sur le coupable. Je me souviens aussi de l’histoire qui étaitarrivée à un caporal du 75e de ligne&|160;; quis’appelait Roilan…
Chvéïk, à ce moment, fut interrompu par ungémissement que poussa l’aumônier. Le révérend père, très grave ettrès digne, venait de se réveiller. Ce réveil fut accompagné desmêmes incidents qui illustrèrent celui de Gargantua, que le pèreRabelais nous a contés avec des détails amusants.
Le saint homme rota et péta en même temps,puis il se mit à bâiller à se décrocher la mâchoire. Lorsqu’ils’aperçut de l’endroit où il était, il se leva brusquement ets’écria&|160;:
–&|160;Mais, nom de Dieu&|160;! où est-ce queje suis&|160;?
Le caporal lui réponditrespectueusement&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance,monsieur l’aumônier, que vous vous trouvez dans le wagon desdétenus.
L’aumônier demeura muet un instant, pouressayer de voir clair dans cette énigme. Mais ce fut vainementqu’il essaya de se rappeler les événements qui l’avaient conduitsur la banquette où il se trouvait. Tout ce qu’il avait vécu durantla nuit précédente et pendant la matinée s’était complètementeffacé de sa mémoire.
Enfin, s’adressant au caporal qui se tenaittoujours au garde-à-vous devant lui, il lui demanda&|160;:
–&|160;Eh, dites donc, qui est-ce qui vous apermis…
–&|160;Je vous déclare avec obéissance,monsieur l’aumônier…
L’ecclésiastique, sans même l’écouter, se levaet se mit à déambuler dans le wagon. On l’entendit murmurer&|160;:«&|160;Tout cela est incompréhensible.&|160;» Puis il s’assit etdemanda&|160;:
–&|160;Où allons-nous&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance,monsieur l’aumônier, que nous allons à Bruck-Kiralyhida.
–&|160;Pourquoi diable allons-nouslà-bas&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance,monsieur l’aumônier, que tout le 91e régiment de ligneest transféré dans cette garnison.
À peu près complètement dessaoulé, l’aumônierparvint à distinguer l’aspirant des autres soldats et il luidemanda&|160;:
–&|160;Dites donc, vous qui me paraissez êtreun homme intelligent, voulez-vous m’expliquer, et sans détour, sansvous taire sur quoi que ce soit, comment il se fait que je metrouve en votre compagnie&|160;?
–&|160;Très volontiers, répondit l’aspirantd’un ton cordial. Vous vous êtes joint à notre détachement cematin, à la gare de Budeiovitz, et vous paraissiez avoir la tête unpeu lourde.
Le caporal regarda l’aspirant avecindignation.
–&|160;Ensuite, vous êtes monté dans ce wagon,poursuivit ce dernier, vous vous êtes allongé sur la banquette, etmon ami Chvéïk, que voici, a eu la touchante attention de placer sacapote sous votre tête pour qu’elle vous serve d’oreiller. À ladernière station, nous avons eu la visite de l’officier de service,qui vous a inscrit sur son registre. Et, à cause de cela, lecaporal que voilà doit se rendre demain au rapport.
–&|160;Tiens, tiens&|160;! soupira le révérendpère. À la station prochaine, il ne me restera plus qu’à me rendredans le compartiment des officiers d’état-major. Vous ne savez passi le déjeuner a déjà été distribué&|160;?
–&|160;Pas encore, monsieur l’aumônier,répondit le caporal, le déjeuner sera servi à Vienne seulement.
–&|160;Ainsi c’est vous qui m’avez mis votrecapote sous ma tête&|160;? demanda l’aumônier à Chvéïk. Je vousremercie bien.
–&|160;Il n’y a pas de quoi, répondit Chvéïk,je n’ai fait que mon devoir, ce que chaque soldat doit faire enpareille circonstance, c’est-à-dire lorsqu’il voit qu’un de sessupérieurs n’a rien qui puisse lui servir d’oreiller et qu’il estun peu rond. Le soldat doit respecter son supérieur, même sicelui-ci s’en est mis plein la lampe. Les aumôniers, ça me connaît,car j’ai été l’ordonnance, à Prague, de M.&|160;l’aumônier Katz. Cesont des gens très rigolos et très gentils.
L’aumônier, pour se faire pardonner sadébauche de la veille, tendit une cigarette à Chvéïk&|160;:
–&|160;Tiens, et fume ça, lui dit-il. Quant àtoi, ajouta-t-il, en s’adressant au caporal, qui dois aller demainau rapport à cause de moi, n’aie pas peur, j’arrangerai cela. Toi,dit-il en se tournant vers Chvéïk, je te prends à mon service, tuseras mon brasseur, et tu vivras comme un coq en pâte.
Pris d’une véritable frénésie de bonté, ildistribua des promesses à droite et à gauche. Il promit àl’aspirant, de lui offrir une boîte de chocolat, aux soldats del’escorte une bouteille de rhum, et au caporal, de le fairetransférer au service photographique de la 27e divisionde cavalerie&|160;! Bref, il n’oublia personne.
Ensuite, il offrit des cigarettes à tous, endéclarant aux détenus qu’il leur donnait la permission de fumer etque, du reste, il s’arrangerait pour qu’on les libère le plus tôtpossible.
–&|160;Je ne veux pas que vous gardiez de moiun mauvais souvenir, dit-il. Je veux vous prendre sous maprotection. Vous avez l’air très sympathique. Vous appartenez àcette catégorie de gens que Dieu aime. Si même vous avez commisquelques péchés, je vois que vous en supportez allègrement lesconséquences.
–&|160;Pour quelle raison avez-vous été puni,mon fils&|160;? demanda-t-il à Chvéïk.
–&|160;Le bon Dieu m’a foutu une punition parl’intermédiaire du colonel, répondit Chvéïk pieusement, parce quej’avais du retard en rentrant à mon corps.
–&|160;La grâce de Dieu est infinie&|160;!répondit le révérend père d’un ton solennel. Rien n’échappe à satoute-puissance et à sa prévoyance. Et vous, aspirant, qu’avez-vousfait&|160;?
–&|160;Je suis ici, répondit ce dernier, parceque la grâce du Seigneur ayant bien voulu me procurer unrhumatisme, cette bienveillance me rendit orgueilleux. Après avoirpurgé ma peine, je passerai mon temps à éplucher des pommes deterre.
–&|160;Ce que Dieu fait est bien fait&|160;!s’écria l’aumônier, que l’idée de cuisine venait de subitemententhousiasmer. Un homme de talent peut faire une belle carrièredans la cuisine. Je pense même qu’il faudrait réserver à cet emploiles gens les plus intelligents, car ne l’oublions pas, savoir bienpréparer à manger est un véritable art&|160;! Ce que l’on prépare àla cuisine importe peu, mais ce qui compte c’est l’amour aveclequel on fait ce travail&|160;! Prenons, par exemple, unesauce&|160;! Un homme intelligent, s’il prépare une soupe àl’oignon, prend toutes sortes de légumes et les fait cuire dans dubeurre, sur un feu doux, puis il ajoute quelques épices comme dupoivre, du clou de girofle, de la muscade, du gingembre&|160;;tandis que l’homme ordinaire et stupide fait bouillir toutsimplement les oignons dans de la margarine. Je voudrais beaucoupvous voir nous préparer la cuisine pour le mess des officiers. S’ilest des métiers dans lesquels on peut faire une belle carrière touten étant démuni d’intelligence, on n’en saurait dire autant de lacuisine. Hier soir, à Budeiovitz, au vin d’adieu des officiers, onnous a servi des rognons à la sauce madère. Eh&|160;! bien, celuiqui les a préparés a eu tous ses péchés pardonnés d’avance. C’estun chef épatant&|160;! Naturellement c’était un instituteur, deSkoutch&|160;! J’ai déjà mangé des rognons à la sauce madère aumess, du 64e de ligne. C’était tout ce qu’il y avait deplus ordinaire. On y avait même mis de la croûte de pain râpée,comme dans les restaurants. Savez-vous quel était le chef qui avaitcommis un pareil crime&|160;? C’était un garçon de ferme,naturellement&|160;!
L’aumônier fit tout un discours sur la façonde préparer certains plats. Il parla du vieux et du nouveauTestament où il y avait de nombreuses recettes de cuisine quiavaient servi dans l’antiquité pour préparer des banquets auxquelsdonnaient lieu les fêtes religieuses. Puis, tout égayé par cespropos, il demanda à ses auditeurs de lui chanter quelque chose.Chvéïk, avec sa maladresse habituelle, se mit à chanter la romancesuivante&|160;:
La fille est allée au puits.
Voici notre abbé qui la suit
En portant une bouteille de pinard…
Mais l’aumônier ne se fâcha pas.
–&|160;Si nous avions au moins une bouteillede rhum, dit-il en soupirant, nous n’aurions pas besoin d’unebouteille de pinard. En ce qui concerne les filles, poursuivit-ild’un ton jovial, il vaut mieux les tenir à l’écart. Elles sont toutjuste bonnes à nous pousser à la débauche.
Le caporal allongea le bras dans la profondeurde sa capote et en retira une bouteille de rhum.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance,monsieur l’aumônier, dit-il d’une voix étranglée qui trahissait lalutte intérieure qui se livrait en lui pour consentir à cesacrifice, si vous voulez bien ne pas vous fâcher, permettez-moi devous offrir…
–&|160;Diable&|160;! répondit avecenthousiasme le révérend père, il n’y a rien là qui puisse mefâcher&|160;! Permettez-moi de boire à votre santé et à votre bonvoyage à tous&|160;!
–&|160;Mon Dieu&|160;! soupira le caporal envoyant que la moitié du contenu de la bouteille disparaissaitsubitement dans le gosier du révérend père.
–&|160;Tenez, dit l’aumônier en se tournantvers l’aspirant, goûtez-moi ça&|160;! Vous m’en direz desnouvelles&|160;!
Ensuite ce fut le tour de Chvéïk à quil’aumônier ordonna&|160;:
–&|160;Goûtez-moi ça&|160;!
–&|160;À ta santé, mon vieux&|160;! dit Chvéïkd’un ton consolateur, en remettant la bouteille vide au caporal,qui lui lança un regard furieux.
–&|160;Maintenant, je vais encore un peu mereposer, dit l’aumônier, et je vous prie de me réveiller avant quenous arrivions à Vienne. Et vous, continua-t-il en s’adressant àChvéïk, vous irez à la cuisine du mess des officiers et vousm’apporterez mon déjeuner. Vous n’aurez qu’à dire que c’est pourMonsieur l’aumônier principal Latsina, et tâchez d’avoir uneportion double. Si l’on vous donnait du knedni au gratin,n’acceptez pas de croûtons. Puis faites-vous donner une bouteillede pinard et n’oubliez pas non plus une bonne ration de rhum.
Le révérend père Latsina fouilla dans sespoches.
–&|160;Écoutez, caporal. Je n’ai pas demonnaie sur moi, prêtez-moi un florin. Merci. Tenez mon ami,comment vous appelez-vous&|160;?
–&|160;Joseph Chvéïk, pour vous servir monaumônier.
–&|160;Ce florin n’est qu’une avance. Vous enaurez encore un second, soldat Chvéïk, lorsque vous aurezponctuellement exécuté mes ordres. On vous remettra également, pourmoi, des cigarettes et des cigares. S’il y a une distribution dechocolats tâchez d’en obtenir deux parts&|160;; si on vous donnedes conserves n’oubliez pas de dire que j’aime surtout les languesfumées et le foie gras. S’il y avait du fromage de gruyère, exigezque l’on vous coupe ma part dans le milieu et qu’on laisse de côtéla croûte&|160;; vous agirez de même si l’on faisait unedistribution de salami hongrois. Demandez toujours le milieu carc’est la partie la plus juteuse.
L’aumônier s’allongea sur la banquette, setourna sur le ventre et s’endormit comme un bienheureux.
–&|160;Je pense, caporal, dit l’aspirant,lorsque l’aumônier se fut mis à ronfler, que vous êtes satisfait devotre enfant trouvé.
–&|160;C’est un bébé qui a du cran, n’est-cepas caporal&|160;! ajouta Chvéïk. Il tète gentiment labouteille&|160;!
Le caporal luttait depuis un moment contre lessentiments d’indignation qui montaient en lui, mais, tout à coup,l’amertume déborda.
–&|160;Ah&|160;! oui, tu parles d’unsapeur…
–&|160;Il me rappelle, remarqua Chvéïk, avecsa façon d’emprunter de l’argent, un certain Mileitchko, deDeivitz, ce pauvre diable était toujours fauché, à tel point queses créanciers ont fini par le faire coffrer.
–&|160;Avant la guerre, au 75e deligne, raconta un homme de l’escorte, il y avait un capitaine qui abouffé la caisse du régiment, de sorte qu’il a dû abandonner lacarrière, et maintenant, depuis la guerre, il est de nouveau là, ettoujours capitaine&|160;; nous avons eu un sergent qui a volé lesdraps et les étoffes du magasin&|160;; par-dessus le marché, ilavait barboté également une vingtaine de colis, et ce bandit esttout de même revenu au régiment depuis la guerre avec le grade desergent-major&|160;! Mais en Serbie, on a zigouillé un soldat quiavait bouffé sa boîte de singe en une seule fois au lieu de lafaire durer pendant trois jours…
–&|160;Cela n’a rien à voir avec notreaffaire, déclara le caporal d’une voix sévère, mais il est vrai quetaper un pauvre cabot de deux florins c’est tout de même…
–&|160;Tenez, voilà votre florin, dit Chvéïk.Je ne veux pas m’enrichir au détriment des autres. Et lorsqu’il medonnera le second, je vous le rendrai également pour ne pas vousentendre pleurer. Vous devriez être fier que vos supérieurs vousfassent l’honneur de vous demander de l’argent. Mais vous, je vousvois venir, dans le fond vous n’êtes qu’un égoïste. En somme, il nes’agit là que de deux misérables florins. Je me demande ce que vousferez lorsqu’il s’agira d’offrir votre vie, pour sauver celle devotre officier, lorsqu’il sera blessé et que vous aurez la missiond’aller le chercher en face des tranchées ennemies et de lerapporter dans nos lignes.
–&|160;Vous commencez à m’emmerder&|160;! luirépondit le caporal. Vous…
–&|160;Chaque fois qu’il y a une bataille,remarqua un des hommes de l’escorte, il y en a plus d’un qui fontdans leur culotte. Un copain m’a raconté l’autre jour quelorsqu’ils s’élancèrent à l’attaque, il avait rempli trois fois sonfalzar&|160;; la première fois lorsqu’on lui donna l’ordre degrimper hors de la tranchée, la deuxième en arrivant devant lesbarbelés, et la troisième lorsque les Russes firent unecontre-attaque à la baïonnette en hurlant&|160;:«&|160;Hourra&|160;!&|160;» comme des diables. Ils furent refoulésdans leurs tranchées, et là, ils s’aperçurent qu’ils avaient tousle cul sale. Un homme dont la tête avait été fendue en deux par unshrapnel, s’était soulagé, lui aussi, dans son froc, et la moitiéde son crâne qui avait été arrachée se trouvait juste dessus. Il ya un tas de choses terribles&|160;! On ne sait même pascomment…
–&|160;Il arrive, reprit Chvéïk, qu’onrencontre dans les batailles des choses vraiment dégoûtantes,lorsque j’étais encore à Prague, un convalescent, qui venait dePrezemysr, nous racontait à la Belle Vue de Pohojeletz, qu’il avaitparticipé à une attaque à la baïonnette. En face de lui se trouvaitun Russe, un gros bonhomme sous le nez duquel pendait une grossegoutte luisante.
–&|160;C’était un simple poilu ou uncaporal&|160;? demanda l’aspirant.
–&|160;C’était un caporal, répondit gravementChvéïk.
–&|160;Ah&|160;! cela aurait pu arriver àn’importe quel aspirant&|160;! répliqua le caporal en jetant unregard triomphal sur Marek comme s’il voulait dire&|160;:«&|160;Est-ce qu’il t’est arrivé souvent de rencontrer un type quià la répartie aussi prompte que moi&|160;?&|160;»
L’aspirant se tut et s’allongea sur labanquette. Le train approchait de Vienne, Ceux qui ne dormaient pasobservaient par les portières les fortifications et les largeszones de fil de fer barbelé dont la vue seule commençait à lesabattre.
Les hurlements des bergers de KasperskyHora&|160;: «&|160;Wann ich kumm, wann ich wiedakumm…&|160;» diminuaient d’ardeur devant ce spectacle.
–&|160;Tout est bien en ordre, dit Chvéïk enregardant les tranchées. Tout cela est très bien, seulement lesViennois feront bien de prendre quelques précautions s’ils neveulent pas déchirer leurs pantalons. Vienne est une ville trèsimportante, continua-t-il. À eux seuls, les animaux du jardinzoologique sont une merveille. Lorsque j’ai été à Vienne, il y aquelques années, je suis souvent allé rendre visite aux singes, etsi par hasard un membre de la famille impériale se promenait parlà, les flics formaient un barrage et il n’y avait plus moyend’entrer. Un tailleur du 10e arrondissement a été arrêtéde cette façon, car il voulait à tout prix passer à travers lesflics, pour voir les singes.
–&|160;Avez-vous vu le palais impérial&|160;?demanda le caporal.
–&|160;Ah&|160;! ça c’est joli&|160;! réponditChvéïk. Je n’y suis jamais allé, mais un de mes amis l’a vu et ilm’a raconté là-dessus toutes sortes de merveilles. Et ce qui estplus beau encore, c’est la Garde du Bourg. Chaque soldat de lagarde a au moins deux mètres, et lorsqu’ils ont fini leur serviceon leur donne une licence pour tenir un bureau de tabac. Et desprincesses il y en a autant là-dedans que ce que j’ai de cheveuxsur mon crâne.
Le train traversa une gare et l’on putentendre un orchestre qui jouait l’hymne impérial. Tous les soldatspensaient que c’était pour fêter leur arrivée, mais l’orchestreavait dû se tromper de station, car le train ne s’arrêta qu’à lagare suivante. On distribua la soupe au 91e de ligne etune réception solennelle eut lieu en leur honneur.
Mais ces fêtes n’avaient plus autant d’éclatqu’au début de la guerre, lorsqu’on bourrait les soldats defriandises et qu’ils étaient reçus dans chaque gare par des essaimsde jeunes filles, vêtues de robes blanches.
Trois représentants de la croix rouged’Autriche, deux déléguées d’une association patriotique de femmeset de jeunes filles, et des représentants de la municipalité et ducommandement de la place attendaient le 91e régiment surle quai. Tous et toutes paraissaient très fatigués. Des trainstransportant des troupes ou des blessés traversaient nuit et jourla gare de Vienne et lesdits représentants devaient être présentsau passage de chaque convoi. Ces sortes de manifestationsspontanées finissaient par faire bâiller d’ennui les soldats.
Des dames s’approchèrent et distribuèrent danschaque wagon des pains d’épices décorés avec des inscriptions ensucre de ce genre&|160;: Que Dieu punisse l’Angleterre&|160;! –Victoire et vengeance&|160;! – L’Autrichien aime sa patrie, carelle est digne d’être aimée, etc.
On voyait des montagnards de Kaspersky Horaqui dévoraient à pleine bouche les pains d’épices avec une minedésespérée.
L’ordre arriva enfin d’aller chercher la soupepar compagnie, aux cuisines de la gare où se trouvait également lemess des officiers. C’est là que Chvéïk se rendit.
L’aspirant attendait tranquillement dans soncompartiment qu’on le servît, car deux hommes de l’escorte avaientété chargés par le caporal d’aller chercher les portions pour lewagon des détenus.
Chvéïk s’acquitta à merveille de sa mission.Comme il était en train de traverser les voies, il aperçut lelieutenant Lukach qui se promenait le long du quai en attendant sondéjeuner. Sa situation n’était pas brillante, car il avaitprovisoirement à son service l’ordonnance du lieutenant Kirschner,et le gaillard s’occupait uniquement des affaires de son officier,se souciant peu de celles du lieutenant Lukach.
–&|160;À qui portez-vous tout cela&|160;?demanda-t-il à Chvéïk en le voyant déposer à ses pieds une quantitéd’excellentes choses.
Chvéïk, tout ahuri, le regarda un instant avecstupéfaction, mais il se remit aussitôt de son émotion, et sonvisage se mit à rayonner de joie.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que c’est pour vous. Seulement je ne sais pas où estvotre compartiment et j’ai peur que le commandant du train se metteà m’engueuler s’il me voit avec vous. Il paraît que cet officierest un sale type.
Le lieutenant Lukach jeta un regardinterrogateur sur Chvéïk qui continua d’un air candide&|160;:
–&|160;Mais oui, mon lieutenant, c’est un vraicochon&|160;! Lorsqu’il est venu faire l’inspection des détenus jelui ai déclaré immédiatement que onze heures avaient sonné, quej’avais purgé ma peine, et que je devais rejoindre un wagon àbestiaux pour venir vous retrouver, mais il m’a envoyé me promeneren me déclarant que je devais rester avec les prisonniers pouréviter que je vous attire en route des embêtements.Chvéïk prit une figure de martyr pourajouter&|160;: comme si pareille chose m’était jamaisarrivée&|160;! Le lieutenant Lukach soupira.
–&|160;Des embêtements, continua Chvéïk, jen’ai jamais cherché à vous en donner. Si quelques ennuis vousarrivèrent ce fut toujours par accident, par un caprice de Dieu,comme disait le vieux Vanichek de Pelkarimov, lorsqu’il était entrain de purger son 36e emprisonnement. Je n’ai jamaisvoulu vous faire du tort, mon lieutenant, au contraire, j’aitoujours cherché à vous être agréable, et ce n’est vraiment pas dema faute si, durant notre précédent voyage, nous avons eu toutessortes d’ennuis et de misères.
–&|160;Ne vous en faites pas, Chvéïk, réponditLukach d’une voix émue, je vais m’arranger pour que vous restiezavec moi.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je suis trop grand pour pleurer. Mais cela me faittout de même du chagrin quand je me rends compte que vous et moisommes les gens les plus malheureux sur cette terre, bien qu’il n’yait pas de ma faute ni de la vôtre. Toutes ces misères qui nousarrivent, c’est tout de même d’une injustice effroyable, surtoutquand on songe que je suis l’homme le plus soucieux de l’honneur etdu devoir…
–&|160;Tranquillisez-vous, Chvéïk.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que si je ne craignais pas de faire un affront à ladiscipline, je vous dirais que je ne peux jamais avoir l’âmetranquille lorsque je suis seul, et qu’il me suffit de vousentendre pour que vos paroles me consolent.
–&|160;Alors, grimpez dans ce wagon,Chvéïk&|160;!
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je suis déjà sur le marche-pied.
*
**
Dans le camp régnait le profond silence de lanuit. Dans les baraquements il faisait un froid de loup et leshommes grelottaient. En revanche dans le pavillon des officiers onavait tellement chauffé que ces messieurs avaient été obligésd’ouvrir les fenêtres.
On n’entendait que le pas des sentinellesmontant la garde devant certains bâtiments. Là-bas, au bord de laLeitha, brillait la lumière de la fabrique de Conserves Impérialeset Royales. C’est là que les détritus les plus divers setransformaient en conserve. Le vent apportait des odeurs de boyaux,de tripes, et autres ordures de boucherie dans les avenues du campmilitaire pour apprendre aux soldats la façon dont on préparait lesinge.
Au balcon d’un pavillon abandonné, on voyaitles lampions rouges de la maison de tolérance réservée auxofficiers, qui fut même honorée, un jour, de la visite du princeÉtienne à l’époque des grandes manœuvres de 1908. C’est là que seréunissaient chaque soir un grand nombre d’officiers.
L’entrée en était formellement interdite auxsimples soldats. Pour eux on avait installé «&|160;la Maison desRoses&|160;» dont les lampions jetaient devant la porte une lueurverte.
Même pour les choses de ce genre, lesdifférences de classe se faisaient sentir à l’arrière comme aufront, et plus tard, lorsque la monarchie n’eut plus rien d’autre àoffrir à ses héros que des bordels ambulants attachés à chaquebrigade, les fameux «&|160;Pouffs&|160;», il y eut des«&|160;Pouffs&|160;» d’officiers, de sous-officiers et de simplestrouffions.
Bruck, de l’autre côté de la Leitha, commeKiralyhida du côté hongrois, étaient chaque nuit des lieuxd’orgies. Dans les deux villes, dans la hongroise comme dansl’autrichienne, se trouvaient de nombreux cafés avec des orchestrestziganes. Les restaurants rayonnaient de lumière. Les bourgeois etles fonctionnaires y amenaient leurs femmes et leurs filles, et lesdeux villes acquirent rapidement la réputation d’être chacune unvaste bordel.
Dans les baraquements des officiers, Chvéïkattendait le retour de son lieutenant qui était allé au théâtre.Chvéïk se tenait assis sur le lit de son supérieur, cependant qu’enface de lui l’ordonnance du commandant Wenzl était négligemmentallongée sur la table.
Le commandant Wenzl était revenu au régimentaprès avoir brillamment démontré son incapacité totale sur le frontserbe. On racontait qu’il avait fait démolir un ponton au momentmême où la moitié de son bataillon, qui battait en déroute, setrouvait encore de l’autre côté de la rivière Drina. On l’avaitaffecté depuis au commandement de la place et il travaillait avecl’intendance. Dans les milieux d’officiers, des bruits couraient,affirmant que Wenzl était en train de faire fortune.
Les deux chambres – celles du commandant et dulieutenant – s’ouvraient sur le même couloir. Mikoulachek, lebrosseur du commandant, bavardait&|160;:
–&|160;Je m’étonne que cette crapule de Wenzl,disait-il, ne soit pas encore crevé. Je me demande où diable cettefripouille peut passer ses nuits. Il aurait dû me laisser au moinsla clé de sa chambre, afin que je puisse aller boire un coup. Chezlui, ce n’est pas le pinard qui manque.
–&|160;Il ne fait que voler, remarqua Chvéïk,qui était en train de fumer les cigarettes de son lieutenant, carcelui-ci lui avait interdit de fumer la pipe dans sa chambre. Tudois bien savoir où il le prend tout ce pinard.
–&|160;Je vais où il m’envoie, réponditMikoulachek de sa voix flûtée. Il me donne un bon, je vais chercherdu vin pour les malades et je le rapporte ici.
–&|160;Et si un jour il t’envoie cambrioler lacaisse du régiment, tu le feras aussi&|160;? Quand tu es avec moitu gueules toujours contre lui, mais si tu le vois tu tremblescomme une feuille.
Mikoulachek cligna ses petits yeux et réponditd’un air crâneur&|160;:
–&|160;T’en fais pas&|160;! la prochaine fois,je vais lui dire&|160;: Attendez-moi, mon colon, je vaisréfléchir…
–&|160;Jamais tu n’oseras dire cela&|160;!cria Chvéïk, mais il se tut aussitôt, car la porte s’ouvritbrusquement et le lieutenant Lukach pénétra dans la chambre.
Il paraissait de bonne humeur et il portaitson képi complètement de travers sur la tête.
Mikoulachek fut tellement surpris qu’il oubliade sauter de la table et salua tout en restant assis.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que tout est en règle, annonça Chvéïk en prenant uneattitude rigoureusement réglementaire, bien qu’il eût oublié deretirer sa cigarette de sa bouche.
Le lieutenant ne prêta aucune attention à sesparoles et il marcha tout droit sur Mikoulachek qui suivait avecdes yeux effrayés les moindres gestes de l’officier.
–&|160;Je suis le lieutenant Lukach, ditcelui-ci en arrivant un peu chancelant devant la table. Et vous,qui êtes-vous&|160;?
Mikoulachek garda un silence atterré&|160;:Lukach prit une chaise, s’assit en face du tampon et, le regardantdans les yeux, ajouta d’une voix sombre&|160;:
–&|160;Chvéïk, passez-moi mon revolver. Il estdans la malle.
Pendant que Chvéïk fouillait dans la malle,Mikoulachek demeurait silencieux, comme cloué de terreur sur latable, et fixait des yeux effrayés sur le lieutenant.
–&|160;Eh bien, comment vousappelez-vous&|160;? cria à nouveau l’officier.
Mais l’ordonnance garda un silence de mort.Comme il le raconta plus tard, il éprouva, à l’entrée inopinée deLukach, une sorte de paralysie qui l’empêchait de se mouvoir et deparler. Il aurait voulu sauter de sa place et il se sentaitincapable de faire un geste, il aurait voulu répondre et neparvenait pas à ouvrir la bouche, il aurait voulu abaisser sa mainqui saluait mais il s’en sentait incapable.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que le revolver n’est pas chargé, dit Chvéïk.
–&|160;Alors, chargez-le&|160;!
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que nous n’avons pas de cartouches à la maison. Et jepense qu’il serait difficile, même en tirant dessus, de fairebouger cet animal-là. Je me permets de vous faire remarquer, monlieutenant, que cet homme est le tampon du commandant Wenzl. Dèsqu’un officier lui parle, il perd sa langue. Il a le parler trèsdifficile en général. Il n’est qu’un imbécile. Le commandant, quandil sort en ville, le laisse traîner dans les couloirs de labaraque, et le pauvre diable s’en va causer avec des tamponsvoisins. Il a toujours peur, l’animal, bien qu’il n’ait commis riende criminel.
Chvéïk cracha. Le ton sur lequel il parlait deson collègue montrait clairement le mépris qu’il avait pour cettesorte de lâcheté.
–&|160;Permettez-moi, mon lieutenant, d’allerun peu le renifler.
Chveik fit descendre Mikoulachek de la tableet se mit à le flairer.
–&|160;Ça commence à venir, commença-t-il. Cesalaud est en train de tout lâcher. Voulez-vous que je le foutedehors&|160;?
–&|160;Foutez-le dehors, Chvéïk&|160;!
Chvéïk conduisit l’homme dans le couloir,ferma la porte derrière lui, et lui confia&|160;:
–&|160;Je t’ai sauvé la vie, imbécile&|160;!Bien entendu, tu m’apporteras une bouteille de pinard aussitôt queton commandant sera rentré. Sans blague, je t’ai vraiment sauvé lavie. Lorsque mon lieutenant est noir il est terrible et personned’autre que moi ne peut le retenir.
–&|160;Je suis…
–&|160;Tu n’es qu’une lavette, répondit Chvéïkdurement, va devant ta porte et attends ton maître.
–&|160;Enfin, vous voici, Chvéïk&|160;!s’écria le lieutenant dès que son ordonnance fut de retour. Je veuxvous parler. Laissez-moi de côté ce garde à vous idiot,asseyez-vous et fichez-moi la paix avec vos déclarationsd’obéissance. Fermez-là, et faites bien attention&|160;! Savez-vousoù se trouve la rue Soproni-Utsa à Kiralyhida&|160;? Je vous répètede ne pas me raser constamment avec vos&|160;: «&|160;je vousdéclare avec obéissance&|160;». Vous n’en savez rien&|160;? Alorsdites simplement que vous ne savez pas et ça suffit&|160;! Marquezsur un bout de papier&|160;: 16, Soproni-Utsa, 16. Il y a uneboutique de quincaillerie dans cette maison.
»&|160;Savez-vous ce que c’est unequincaillerie&|160;? Mais, nom de Dieu, ne me dites pas toujours«&|160;je vous déclare avec obéissance&|160;». Vous le savez&|160;?Bon&|160;! Ça suffit&|160;! Cette quincaillerie appartient à unMagyar, à un certain Kakonyi. Vous savez ce que c’est qu’unMagyar&|160;? Nom de Dieu&|160;! le savez-vous ou non&|160;? Vousle savez&|160;! Bon&|160;! Il a son appartement au premier étage decette maison. Vous le savez&|160;? Mais, sacré bougre, comment lesavez-vous puisque c’est moi qui vous le dis&|160;! Donc, il habitedans cet appartement. Bon. Ça vous suffit&|160;? Non&|160;? Nom deDieu, je vais vous faire coffrer dès demain. Avez-vous déjà notéque le type en question s’appelle Kakonyi&|160;? Bien. Donc, demainmatin, vers une heure environ, vous vous rendrez à cette maison,vous monterez au premier et vous donnerez cette lettre à MadameKakonyi.
Lukach fouilla dans ses poches et remit àChvéïk un pli.
–&|160;C’est une affaire très importante,Chvéïk, ajouta-t-il. On ne saurait trop prendre de précautions,c’est pour cette raison que je n’ai pas mis d’adresse dessus. Je mefie à vous. J’espère que vous ferez parvenir sans encombre malettre à cette dame. Notez encore que cette dame s’appelle Etelka.Écrivez&|160;: Etelka Kakonyi. J’ajoute que vous devez garder unediscrétion absolue et que vous devez attendre la réponse. C’est dureste écrit dans la lettre que l’on doit vous remettre une réponse.Que voulez-vous dire encore&|160;?
–&|160;Mais si la dame ne veut pas me donnerde réponse&|160;? Qu’est-ce que je dois faire alors&|160;? objectaChvéïk.
–&|160;Mon vieux, si tu ne m’apportes pas laréponse que je veux à tout prix, tu sauras de quel bois se chauffele lieutenant Lukach. Mais, pour l’instant, je veux dormir. Je mesens un peu fatigué. Dieu sait ce que j’ai bu dans la soirée. Jepense que peu de gens seraient capables de résister à un pareilrégime.
Le lieutenant Lukach n’avait pas prévu qu’ilresterait si longtemps en ville. Il avait quitté le camp militairepour aller voir une opérette que l’on jouait au théâtre hongroisavec des vedettes juives, des actrices fort grasses. On lui avaitraconté que le passage le plus amusant de la pièce était le momentoù ces dames lançaient les jambes en avant, très haut. Et on luiavait même confié qu’elles ne portaient pas de culottes. Le publicde la galerie ne jouissait pas, naturellement, de ces attractions,mais les officiers d’artillerie placés au premier rang du parterren’avaient pas oublié d’apporter leur jumelle de campagne.
Ce spectacle avait pourtant laissé lelieutenant Lukach relativement froid, car les jumelles qu’il avaitlouées au théâtre n’étaient point de bonne qualité.
À l’entr’acte son attention avait été attiréepar une dame qui, accompagnée d’un monsieur d’une quarantained’années, se dirigeait vers le vestiaire en déclarant qu’ellevoulait rentrer chez elle immédiatement&|160;; qu’elle en avaitassez de regarder des cochonneries pareilles. Elle disait cela enallemand&|160;; son compagnon lui répondit en magyar&|160;:
–&|160;Mais oui, mon ange, tu as raison, c’estdégoûtant.
–&|160;C’est écœurant, répéta la dame, tandisque le monsieur l’aidait à mettre son manteau.
Elle avait de beaux yeux noirs qui brillaientd’indignation. Elle regarda Lukach bien en face, comme si elle luiparlait et s’écria de nouveau&|160;:
–&|160;C’est dégoûtant, écœurant&|160;!
Et le lieutenant s’était subitement épris dela dame. Suivant les renseignements que lui avait donnésl’ouvreuse, il s’agissait là du ménage Kakonyi, dont le mari tenaitune quincaillerie qui se trouvait au numéro 15, dans laSoproni-Utsa.
–&|160;Et Mme&|160;Etelka habiteavec lui au premier étage, ajouta-t-elle avec des précisionsd’entremetteuse. C’est une Allemande, elle est de Sopron, et sonmari est magyar. Chez nous tous les couples sont panachés.
Le lieutenant prit également son manteau auvestiaire et s’en alla par la ville. Il rencontra, aucafé-restaurant «&|160;Prinz Albrecht&|160;», quelques officiers deson régiment.
Il ne perdit pas son temps à bavarder, mais ilen but d’autant plus, tout en réfléchissant à ce qu’il devaitécrire à cette belle dame aux mœurs si sévères et qui l’attiraitdavantage que toute la ménagerie de singes. C’est ainsi que sescopains appelaient les acteurs du théâtre hongrois.
Tout à son amour, il éprouva le besoin des’isoler et découvrit un petit café «&|160;À la Couronne deSaint-Étienne&|160;», où il se retira dans un salon, non sans avoirauparavant été obligé de chasser de là une Roumaine qui voulait àtout prix se déshabiller devant lui.
Il demanda de quoi écrire, une bouteille decognac, puis après mûres réflexions, il rédigea la lettre suivante,qu’il jugea la mieux réussie qu’il eût écrite dans savie&|160;:
«&|160;Madame,
«&|160;J’assistais hier soir au spectacle quia provoqué de votre part une si juste indignation. Je vous avaisdéjà observée toute la soirée, vous et monsieur votre mari…
–&|160;Mais vas-y carrément, se dit lelieutenant. De quel droit cet homme s’approprie-t-il une femmeaussi charmante&|160;!
Et il continua&|160;:
«&|160;J’ai remarqué que monsieur votre mari asuivi avec le plus grand intérêt le spectacle obscène qui sedéroulait sur la scène, lequel n’a éveillé dans votre esprit que dudégoût, parce que cela n’était point de l’art mais une bassespéculation sur les sentiments les plus bas de l’homme.
–&|160;Cette petite a une gorge épatante,songea-t-il. Et il continua à écrire&|160;:
–&|160;Pardonnez-moi, Madame, cet excès desincérité. J’ai connu dans ma vie un grand nombre de femmes, maisaucune n’a exercé sur moi une aussi forte impression que vous. Jeme suis aperçu, au cours de cette soirée que nous avions, vous etmoi, la même conception de l’art et de la vie. Je suis persuadé,d’autre part, que votre mari est un homme très égoïste qui voustraîne après lui…
–&|160;Non, se dit le lieutenant Lukach, ça neva pas. Il faut que je biffe ces mots&|160;: «&|160;vous traîneaprès lui&|160;». Et il écrivit&|160;:
«&|160;… est un homme très égoïste, quin’obéit qu’à son propre penchant, en vous obligeant à allerassister à des spectacles qui n’intéressent que lui. J’aime,par-dessus tout, la sincérité, et certes, je ne m’aviserai pas deme mêler de vos affaires de ménage. Ce que je voudrais obtenirsurtout de vous, c’est une suite de conversations sur des questionsartistiques.
–&|160;Elle n’osera jamais me suivre dans unhôtel de cette ville, de peur de se compromettre, songea lelieutenant Lukach. Il faudra que je la mène faire une excursion àVienne. Je demanderai une permission de 48 heures.
«&|160;C’est uniquement pour ces raisons queje vous prie, Madame, de vouloir bien m’accorder quelques instantsd’entretien, afin que nous puissions faire connaissance. J’espèreque vous aurez la bonté de ne pas refuser cette grâce à un hommequi doit partir prochainement pour le front, et qui, s’il obtientune entrevue avec vous, gardera, même au milieu des plus duresbatailles, le magnifique souvenir d’une âme qui l’a compris parcequ’elle était près de la sienne. J’attends votre réponse avecimpatience. Soyez assurée, Madame, qu’elle comptera parmi lesinstants les plus heureux de ma vie.&|160;»
Le lieutenant Lukach traça sa signature au basde la page, but son verre de cognac, en redemanda d’autres et, aubout d’une heure, c’est presque en pleurant qu’il relut salettre.
Neuf heures venaient de sonner lorsque Chvéïkréveilla son lieutenant&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que vous avez déjà loupé votre service du matin, et queje dois aller porter votre lettre à Kiralyhida. J’ai déjà essayé devous réveiller à sept heures, puis à sept heures et demie&|160;; àhuit heures, j’ai fait une nouvelle tentative lorsque j’ai entendupartir la compagnie pour le terrain de manœuvres, mais vous nem’avez répondu qu’en vous retournant du côté du mur. Monlieutenant, allô&|160;! allô&|160;!…
Le lieutenant, tout endormi encore, voulait serecoucher, mais, cette fois il n’y parvint pas, car Chvéïk letenait fermement dans ses bras et le secouait comme un prunier.
–&|160;Mon lieutenant, lui hurla-t-il àl’oreille, je vais à Kiralyhida avec votre lettre.
Le lieutenant bâilla et demanda avecétonnement&|160;:
–&|160;Quelle lettre&|160;? Que me racontes-tuavec ton histoire de lettre&|160;? Puis, se souvenant tout à coupdes incidents de la veille, il ajouta vivement&|160;: Ah oui, c’esttrès important&|160;! Je vous recommande une très grandediscrétion, Comprenez-vous&|160;? Filez&|160;!
Dès que Chvéïk eut tourné les talons, lelieutenant s’enveloppa à nouveau dans sa couverture et se rendormitprofondément.
Trouver le n°&|160;16 de la rue Soproni-Utsan’était pas, somme toute, une opération si compliquée. Mais lemalheur voulut que Chvéïk rencontra en chemin, un de ses vieuxcopains, le sapeur Voditchka, affecté à un bataillon du génie deStirit qui appartenait également au camp militaire. Voditchka avaithabité, il y avait quelques années de cela, à Prague, dans lequartier Na Boïchti, qui avait été celui de Chvéïk. Il était doncnaturel que, dans leur joie de se revoir, les deux hommes, pourfêter cet heureux événement, se rendissent à la «&|160;BrebisRouge&|160;», où une amie de Voditchka, la Roujenka, qui étaittchèque également, servait comme fille de salle.
Les aspirants tchèques, heureux de retrouverune de leurs compatriotes, fréquentaient ce cabaret, où ils avaientfait quelques dettes.
Voditchka, depuis son arrivée, jouait le rôled’homme d’affaires. Il surveillait le départ des bataillons demarche et il s’efforçait, pour le compte de la Roujenka, de leurfaire payer leurs dettes avant qu’ils quittent le pays.
–&|160;Où vas-tu de ce pas&|160;? demanda-t-ilà Chvéïk, après que tous deux eurent vidé une bouteille du bonpinard de la «&|160;Brebis Rouge&|160;».
–&|160;C’est un grand secret, répondit Chvéïk,mais puisque tu es un vieux copain, je vais t’expliquer de quoi ils’agit.
Là-dessus, il lui raconta toute l’affaire dansses moindres détails, et Voditchka lui déclara qu’un vieux sapeurcomme lui ne pouvait laisser un de ses meilleurs copains accomplirune mission d’une si haute importance sans l’accompagner.
Ils passèrent leur matinée attablés aucabaret, à se conter de bonnes vieilles histoires des annéespassées et, lorsque midi se mit à sonner, ils se rappelèrent tout àcoup la mission dont ils étaient chargés et ils quittèrent la«&|160;Brebis Rouge&|160;».
Les histoires qu’ils avaient racontées et levin qu’ils avaient bu leur avaient donné une très grande confiance.Les deux amis avaient l’impression qu’il leur serait ridiculementfacile de vaincre toutes les difficultés qu’ils pourraientrencontrer.
Tout en marchant, Voditchka révéla à Chvéïk lahaine irréductible qu’il nourrissait contre les Magyars, et ilconta longuement les rixes quotidiennes qui avaient lieu contre cesennemis héréditaires, comment et où il avait déjà bataillé contreeux, et il expliqua également la façon dont les autoritésmilitaires avaient essayé de mettre fin à ces combats de rues.
–&|160;Un jour, dit-il, nous avons eu la peaud’un Magyar à Pandorf, où nous étions allés, toute l’équipe desapeurs, pour boire un petit picolo qu’on nous avait recommandé.C’est à cet endroit que j’ai empoigné mon homme à la gorge et queje lui ai administré une bonne raclée avec mon ceinturon. Tout cecis’est passé dans l’obscurité car, par prudence, nous avions dès ledébut de la bagarre mis la lampe en miettes à coups de bouteilles.Tout à coup notre client se met à crier&|160;:
–&|160;Eh&|160;! Tondo, c’est moi lePourkrabek du 16e territorial…
–&|160;Tu vois de quelle façon les accidentsarrivent, ajouta-t-il. Il s’en est fallu de peu pour que nousassommions le copain. Mais nous avons pris notre revanche au lac deNejider, où nous étions allés en excursion il y a trois semaines.Il y avait là, dans un village qui se trouve au bord du lac, undétachement de mitrailleurs honveds, et le hasard a voulu que nousallions dans le cabaret où ils se trouvaient. Comme nous étions là,ils se mirent à danser leur tcharda en faisant un tapage de tousles diables. Ensuite, et de plus en plus excités, ils se mirent àgueuler leur chanson «&|160;Uram, uram, birô uram ou lanyok,lanyok faluba&|160;». Nous nous sommes installéstranquillement en face d’eux, mais nous avons eu soin auparavant dedéfaire nos ceinturons et de les placer devant nous, sur la table.Nous nous sommes dit&|160;: attendez un peu, espèces de salauds,nous allons vous en montrer des&|160;: «&|160;Lanyok, lanyok,faluba.&|160;» Et l’un des nôtres, un certain Meistrik, quiavait un dos aussi large que le mont Bila, a décidé d’aller danserpour faucher une poule aux Magyars. Et ces filles étaientdiablement belles. Elles avaient des jambes un peu là, des fessesrondes et de beaux yeux noirs. Lorsque ces salauds de Magyars lesécrasaient contre eux en dansant, on voyait qu’elles avaient unepoitrine ferme comme du marbre et que ça ne leur déplaisait pasd’être serrées ainsi. Donc, notre bon Meistrik se jette au milieudes danseurs et se met en devoir d’enlever la plus bath de cespoules à un honved. Comme celui-ci se mettait à rouspéter, Meistriklui colle aussitôt une de ces gifles dont il a le secret. Et voilàle honved qui se fout la gueule par terres et juste à cemoment nous nous levons aussitôt, nous empoignons les ceinturonsque nous avions attachés à nos poignets pour empêcher la baïonnettede glisser. Nous bondissons dans le tas et je me mets àgueuler&|160;: Pas de quartier&|160;! chacun sa part&|160;! Tuaurais vu si ça bardait&|160;! Nous en avons assommé quelques-unsau moment même où ils essayaient de se sauver par la fenêtre.
Comme nous faisions un chambard terrible, onest allé avertir les autorités. Bon&|160;! Le bourgmestrerapplique, accompagné d’une douzaine de gendarmes, mais nous noussommes mis à les tabasser, eux aussi, nous avons même passé lecabaretier à tabac, car ce cochon s’était mis à nous insulter enallemand. Lorsque nous avons été les maîtres du champ de bataille,nous avons fait la chasse à ceux qui s’étaient sauvés dans levillage. Nous avons découvert un sergent, qui s’était embusqué chezun paysan dans le grenier au foin. C’était sa poule qui l’avaittrahi par jalousie, car il avait dansé avec une autre durantl’après-midi. Elle avait eu tout à coup un béguin fou pour notreMeistrik, et cette rosse l’a même accompagné sur la route deKiralyhida en disant qu’il y avait par là-bas beaucoup d’arbres etque l’on pouvait regarder la feuille à l’envers. C’est ainsiqu’elle a attiré avec elle notre Meistrik dans un tas de foin, maisaprès, comme elle avait le culot de lui réclamer 5 couronnes poursa petite affaire, notre copain lui a flanqué une baffe sur lagueule. Quand il nous a rejoints, juste à l’entrée du camp, il nousa raconté qu’il s’était rudement trompé avec cette poule, car ilcroyait, d’après ce qu’on lui avait dit, que les Magyares étaientpleines de feu, alors que celle-ci s’était simplement couchée dansle foin comme une truie et n’avait cessé de bavarder pendant toutle temps qu’ils restèrent ensemble.
–&|160;Bref, les Magyars sont tous des voyous,affirma Voditchka en achevant de raconter son histoire.
Chvéïk objecta, en haussant lesépaules&|160;:
–&|160;Qu’est-ce que tu veux, il y a desMagyars qui n’y sont pour rien, s’ils sont Magyars.
–&|160;Comment&|160;? s’écria Voditchka avecindignation, ils n’y sont pour rien&|160;? La belle blague&|160;!Ils y sont bien pour quelque chose, cette bande de salauds. Je tesouhaite de faire avec eux la même parade que moi les premiersjours que je suis arrivé au cours d’entraînement. Le premier jour,on nous a conduits comme un troupeau de bestiaux à l’école, et là,un type s’est mis à dessiner toutes sortes d’idioties au tableau età nous expliquer ce que c’est que le ciment armé et un tas defoutaises de ce genre. Et ceux qui ne se rappelaient pas tout cequ’il avait raconté étaient mis en taule.
–&|160;Sacré nom de Dieu&|160;! je me suisdit. Est-ce que c’est pour t’embusquer ou pour t’asseoir sur unebanquette avec un crayon et un cahier que tu t’es sauvé dufront&|160;! La colère me prend, et si j’avais suivi mon idéej’aurais tout démoli dans la baraque. J’ai même pas attendu lasoupe. Je me suis mis en route pour aller à Kiralyhida. J’étaisdans une telle fureur que je ne pensais qu’à trouver un bon petitbistro, pour me saouler, et coller une bonne claque au premier venuet rentrer ensuite, apaisé, à la baraque de la compagnie. Maisl’homme prévoit et Dieu décide. Arrivé au bord de la rivière, jetrouve un petit local, silencieux comme une chapelle. Je medis&|160;: Nom de Dieu, tu vas aller faire du pétardlà-dedans&|160;! J’entre et je trouve deux clients quis’entretenaient en magyar, ce qui n’a fait que me mettre un peuplus en rogne. Mais, tout en buvant, je ne m’étais pas aperçu quecette vache de mastroquet avait encore une salle à côté de celle oùje me trouvais et, dès que je me suis mis à tabasser mes deuxpékins, huit hussards, qui étaient arrivés sans que je les voie, mesont tombés dessus. J’ai pris quelque chose pour mon rhume&|160;!Ils m’ont fait cavaler par les jardins et par les champs, de sorteque je n’ai retrouvé le campement que vers la fin de la matinée et,en arrivant, j’ai dû me rendre aussitôt à la visite médicale. Là jeleur ai raconté que j’étais tombé dans la fosse d’une tuilerie.Pendant une semaine, ils m’ont gardé à l’hôpital enveloppé dans desdraps humides, pour m’éviter, à ce qu’ils disaient, une congestion.Je ne te souhaite pas d’avoir affaire à ces salauds de Magyars. Cene sont pas des hommes, c’est tout simplement une bande devaches&|160;!
–&|160;Mon vieux, répondit Chvéïk, il y a unvieux proverbe qui dit&|160;: Qui pèche par l’épée périra par leglaive. Il ne faut pas que tu t’étonnes si ces clients t’ontflanqué une trempe. Par-dessus le marché, tu les as obligés àabandonner leur pinard sur la table pour te poursuivre dans lesténèbres. À mon avis, ils auraient dû te régler ton compte surplace et te foutre dehors ensuite. Ç’aurait été plus raisonnable.J’ai connu un bistro du nom de Paroubka, à Libné. Un jour, unmarchand ambulant qui vendait de la quincaillerie s’est saoulé chezlui avec du kirsch. Voilà notre bonhomme qui se met à engueuler lebistro en lui disant que son kirsch ne vaut rien, que soneau-de-vie est anémique et que, s’il ne buvait que ça à ses repas,il se sentait capable d’aller au cirque pour y faire l’équilibristeen portant le bistro dans ses bras. Il ajoute encore que notreParoubka n’était qu’un chien pouilleux. Là-dessus, notre bonParoubka l’attrape et lui flanque tout son barda à travers lafigure. Tu aurais vu voler les casseroles… Puis il l’a mis dehors,et l’a chassé devant lui avec une trique jusqu’à la place desInvalides. Mais comme il trouvait que ce n’était pas encore assez,il a continué de le poursuivre jusqu’à la Karnina, puis à traversZijkov. Ensuite, par la Jidovska jusqu’à Malechitz. Arrivé là, il abrisé sa trique sur le dos du Slovaque. Sa colère un peu apaisée,il rentra à Libné. Seulement, il avait oublié dans sa fureur qu’ilavait laissé sa boutique pleine de clients. Or, ces copains firentà ses frais une petite fête pendant son absence, ce que le bistroput constater en arrivant chez lui. Il trouva deux agents devant saporte, assez mûrs eux aussi, car ils avaient été obligés d’entrerdans le café pour y remettre de l’ordre. Tout avait été vidé àl’intérieur pendant l’absence du propriétaire. Ces cochons avaientroulé un tonneau de rhum devant la porte et ils avaient bu tout cequ’il y avait dedans. Sous le comptoir, deux clients ronflaient,complètement noirs. Les policiers ne les avaient pas aperçus et,lorsqu’ils revinrent à eux, ils voulaient payer à tout prix laconsommation qu’ils avaient bue. Ils tendaient deux sous aucabaretier, en soutenant qu’ils n’avaient pas bu davantage. Voilàoù peut conduire la colère&|160;! C’est à peu près pareil à laguerre. Tu te bats contre l’ennemi, tu cours après lui, toujours deplus en plus échauffé, et ensuite tu es tellement fatigué que, s’ilreprend l’offensive, tu n’as plus la force de courir pour tedébiner.
–&|160;T’en fais pas, répondit Voditchka, jeles ai repérées ces fripouilles de hussards, et je n’attends que labonne aubaine qui en amènera un sur mon chemin. Alors, je luirendrai la monnaie de sa pièce. On ne badine pas comme ça avec unsapeur de ma compagnie. Nous ne sommes pas des soldats comme lesautres. Lorsque nous étions près du fort de Przemysl, nous avionsun capitaine, un certain Jetzbacher. C’était un cochon comme il yen a peu&|160;: il nous a tellement emmerdés, qu’un type de notrecompagnie, un certain Bitterlich, un allemand, mais un brave copaintout de même, s’est suicidé à cause de lui. Alors, nous avons juréde le venger, et nous nous sommes dit&|160;: Aussitôt que lesRusses recommenceront de nous tirer dessus, le capitaine Jetzbacheraura de nos nouvelles.
Et nous l’avons fait, comme nous l’avions dit.À peine les Russes nous ont-ils flanqué quelques balles dans leparapet de notre tranchée, que nous avons aussitôt balancé cinqcoups de flingot dans la peau de cette ordure de capitaine. Il fautcroire que le client avait la vie dure, il devait descendre d’unefamille de chats, car nous avons été obligés de lui refiler encoredu rabiot pour l’achever. Mon vieux, il n’a pas eu le temps degueuler. C’est à peine s’il a grogné un peu. Je t’assure que devoir la bouille qu’il faisait, c’était plutôt marrant…
Et Voditchka se mit à rire à belles dents.
–&|160;Ça, c’est du boulot&|160;! ajouta-t-il.Et c’est arrivé plusieurs fois. Un camarade de notre compagnie m’araconté, l’autre jour, que lorsqu’il était encore avecl’infanterie, du côté de Belgrade, il a zigouillé son lieutenantpendant une attaque, parce que celui-ci avait tiré sur deux de sescopains qui étaient à bout de force.
Tout en devisant de la sorte, Chvéïk etVoditchka arrivèrent au n°&|160;16 de la Soproni Utsa.
–&|160;Tu n’as qu’à rester en bas devant laporte, dit Chvéïk. Je n’en ai que pour deux minutes. Je monte aupremier, je remets la lettre et on me donnera la réponseaussitôt.
Mais Voditchka se mit à rouspéter.
–&|160;Comment&|160;? Tu veux que je te laisseseul&|160;? Mais, mon vieux, tu ne connais pas les Magyars&|160;!Non, non&|160;! Il faut que nous prenions nos précautions. Je monteavec toi, et je vais leur coller une baffe&|160;!
–&|160;Écouté Voditchka, lui répondit Chvéïkgravement, ici il n’est pas question d’un Magyar, il s’agit d’unedame. Je t’ai pourtant dit, lorsque nous étions au Cabaret, quej’avais une lettre de mon lieutenant à remettre et que c’étaitconfidentiel. Mon lieutenant a bien insisté sur ce point. C’est uneaffaire, m’a-t-il dit, que personne au monde ne doit savoir. Tu asd’ailleurs entendu toi-même la fille de Roujenka affirmer que leschoses devaient se passer ainsi et que, dans ces sortesd’histoires, il faut être discret. Tu comprends que mon lieutenantserait ennuyé si l’on venait à savoir qu’il échange des billetsd’amour avec une femme mariée. Mon vieux, je t’ai clairementexpliqué qu’il s’agissait d’une mission secrète et confidentielle.Et maintenant tu viendrais me mettre des bâtons dans les roues envoulant monter avec moi chez cette femme&|160;!…
–&|160;Tu ne me connais pas encore, mon petit,répondit Voditchka gravement, je t’avais bien dit que je ne voulaispas te laisser seul, et ma parole en vaut une autre. Parconséquent, que tu veuilles ou non, nous allons monter ensemblechez cette poule. Quand on est deux, c’est toujours plus sûr…
–&|160;Oui, eh bien, mon vieux Voditchka, jevais te dire moi aussi une bonne chose. Tu connais peut-être la rueEnklanova à Prague&|160;? Eh bien, c’est dans cette rue queVobornik avait son atelier de serrurerie. C’était un grand honnêtehomme. Un matin, il était rentré chez lui après avoir fait unelongue tournée dans les bistros de la ville, en amenant un copainavec lui pour lui donner l’hospitalité, eh bien, mon vieux, que tule croies ou non, le Vobornik a été obligé de rester pendant unesemaine au plumard à cause de son copain. Et chaque fois que safemme le pansait, elle n’oubliait pas de lui dire&|160;:«&|160;Vois-tu, Tom, si tu étais rentré seul, ce jour-là, tu enaurais été quitte pour que je t’engueule et je ne t’aurais pasbrisé le manche à balai sur le crâne…&|160;» Et lorsque Vobornik aété guéri et qu’il a pu se remettre à parler, il lui arépondu&|160;: «&|160;T’as raison, ma chérie, la prochaine fois, sije vais m’amuser quelque part je n’inviterai plus personne à venircoucher à la maison…&|160;»
–&|160;C’est ce que je voudrais voir&|160;!s’écria Voditchka, que ce sacré bougre de magyar s’avise de nousfrapper&|160;! S’il s’avise de faire cela, je l’attrape par lagorge et je lui fais dégringoler l’escalier. Avec ces salauds deMagyars, il n’y a que la manière forte qui compte&|160;! Pasd’hésitation et en avant&|160;!
–&|160;Allons, allons, Voditchka, tu n’as pastellement bu. Je me suis enfilé deux demi-setiers de plus et tu asl’air beaucoup plus noir que moi. Réfléchis un peu. Tu sais que jesuis chargé d’une mission discrète et confidentielle et que nous nesommes pas venus ici pour faire du scandale. N’oublie pas qu’ils’agit d’une poule de la haute…
–&|160;Mon vieux, ça m’est égal, je vais luifoutre aussi sa part de baffes&|160;! Tu connais pas encore tonVoditchka. Un jour, que j’étais avec des copains à l’Île-des-Roses,à Zabeihitz, à une fête de bienfaisance, une poule a refusé devenir danser avec moi parce qu’elle disait que j’avais la gueulegonflée. Et c’était vrai, car je m’étais tabassé la veille dans unbal, à Hostitl. Et tu t’imagines que j’ai avalé comme ça cetteinjure d’une petite putain de bourgeoise&|160;? «&|160;Eh bien, envoilà une pour vous aussi, mademoiselle&|160;! que je lui ai dit,en lui administrant une telle baffe que voilà ma gonzesse qui partà la renverse en entraînant la table, les chaises, les bouteilles,et même son père et ses frères qui s’amusaient en sa compagnie.Ceux qui étaient là se sont mis à gueuler, mais penses-tu que j’aieu la frousse&|160;? J’avais quelques copains avec moi qui sejettent à mes côtés, à la rescousse. Nous avons réglé les comptes àcinq familles y compris les gosses. On les entendait hurler à deuxkilomètres à la ronde. Et tous les journaux, le lendemain, ontparlé de cette fête de bienfaisance&|160;! Pour cette raison, commeces gars de Vershovitz qui m’ont aidé, je veux aussi secourir lescamarades, tu peux me raconter ce que tu voudras, je ne tequitterai pas d’une semelle. Non, mais sans blague, tu ne voudraispas me faire l’affront de me laisser tomber maintenant que nousnous sommes revus après tant d’années et dans des circonstances siextraordinaires&|160;! Et puis, tu ne sais pas ce que valent cescochons de Magyars&|160;!
–&|160;Eh bien, mon vieux, lui répondit Chvéïken soupirant, puisque tu y tiens tant que cela, viens avec moi.Mais attention&|160;! surtout pas de scandale&|160;!
–&|160;T’en fais pas, vieux frère, chuchotaVoditchka en montant l’escalier, tu vas voir ce qu’ils vont prendrepour leur rhume. Je vais aplatir ton magyar comme unegalette&|160;!
Et Voditchka se mit à pousser son cri deguerre&|160;: «&|160;À bas ces salauds de Magyars&|160;!&|160;»
*
**
Chvéïk et Voditchka arrivèrent devant la portedu ménage Kakonyi. Avant de presser sur le bouton de la sonnette,Chvéïk fit un dernier appel à la sagesse de son ami&|160;:«&|160;Souviens-toi de ce qu’on t’apprenait à l’école&|160;:Prévoyance est mère de la sagesse&|160;!
–&|160;Je m’en fous, répondit Voditchka, iln’aura même pas le temps d’ouvrir le bec. Je ne suis pas venu icipour parlementer.
Chvéïk sonna et Voditchka déclara touthaut&|160;:
–&|160;Une… deuss… tu vas le voir dégringolerl’escalier&|160;!
Comme il achevait ces mots la porte s’ouvritet une bonne leur demanda en hongrois ce qu’ils désiraient.
–&|160;Nem ludom, fit Voditchka avecmépris, apprends à parler tchèque, ma fille.
–&|160;Verstehen Sie Deutsch&|160;? demandaChvéïk.
–&|160;Ein bissehen, réponditcelle-ci.
–&|160;Ben, alors, dites à madame que jevoudrais lui parler. Dites à madame que j’ai une lettre pour elled’un monsieur.
–&|160;Ça me fait pitié, dit Voditchka enentrant derrière Chvéïk dans le vestibule, de te voir perdre tontemps à discuter avec des grenouilles de ce genre.
Chvéïk fit remarquer&|160;:
–&|160;C’est assez joli chez eux. Vise un peutous les parapluies qui sont dans ce coin, et cette image deJésus-Christ n’est pas si moche que ça.
Comme il achevait ces mots la bonne sortitd’une pièce d’où parvint un bruit de fourchettes, de cuillères, etelle dit à Chvéïk&|160;:
–&|160;Si vous avez quelque chose à remettre àmadame, vous n’avez qu’à me le donner.
–&|160;Eh bien, déclara Chvéïk solennellement,voilà la lettre pour madame. Mais de la discrétion, je suis enmission confidentielle.
Et il lui remit la lettre du lieutenantLukach.
–&|160;Et moi, continua-t-il, dans un allemandpetit nègre, j’attends ici, dans l’antichambre, la réponse.
–&|160;Pourquoi tu ne t’assieds pas&|160;?demanda Voditchka en se laissant tomber dans un fauteuil. Nous nesommes pas des mendiants. Tu crois que nous allons nous abaisserdevant des magyars&|160;! Nom de Dieu, tu vas voir que nous auronsencore des ennuis avec eux&|160;! et où as-tu apprisl’allemand&|160;?
–&|160;Je l’ai appris tout seul, réponditChvéïk.
Les deux amis attendirent quelques instants ensilence puis, tout à coup, un vaste tumulte retentit dans la pièceoù la bonne avait disparu en emportant la lettre. Parmi des éclatsd’une voix d’homme on pouvait entendre des cris et des sanglots defemme. On entendit une soupière et des assiettes qui se brisaienten tombant sur le plancher. Et, dominant ce vacarme, un hurlementd’homme s’éleva&|160;: Bassam az anyad istenit, a kristusmariadat, bassam az apad istenit[4]&|160;!&|160;»
La porte s’ouvrit brusquement à deux battantset un monsieur d’une cinquantaine d’années, avec sa servietteautour du cou, agitant la lettre du lieutenant dans sa main, seprécipita sur Chvéïk et son compagnon comme un fou.
Comme Voditchka était assis tout près de laporte c’est à lui que s’adressa d’abord le personnagefurieux&|160;:
–&|160;Qu’est-ce que cela veut dire&|160;?Quel est le voyou qui a osé apporter cette lettre&|160;?
–&|160;Ne crie pas tant, vieux frère, luirépondit Voditchka en se levant tranquillement. Je te conseille defermer ta gueule si tu ne veux pas dégringoler immédiatementl’escalier.
Ce fut au tour de Chvéïk d’essuyerl’avalanche. Le monsieur bondit sur lui et se mit à lui raconter untas de choses sans intérêt. Il lui expliqua entre autres qu’ilétait justement en train de déjeuner lorsque…
–&|160;Oui, nous avons bien entendu que vousétiez en train de déjeuner, répondit Chvéïk dans son allemandestropié, et il est vrai que ce n’était peut-être pas le moment devous déranger pendant que vous étiez à table.
–&|160;Pas de compliments inutiles&|160;! luicria Voditchka.
Le monsieur, de plus en plus furieux, se mit àgesticuler des mains, des pieds, tandis que sa serviette flottaitautour de son cou. Il déclara qu’il avait d’abord cru qu’ils’agissait d’une lettre des autorités militaires lui demandantd’héberger de la troupe.
–&|160;En effet, lui répondit Chvéïk, ce n’estpas la place qui manque ici, mais il ne s’agit pas de cela.
Le monsieur lui répondit avec fureur qu’ilétait lieutenant de réserve, qu’il ne demanderait pas mieux qued’offrir sa vie pour la patrie si un malencontreux mal aux reins nele retenait chez lui.
–&|160;De mon temps, ajouta-t-il, lesofficiers n’auraient pas commis la goujaterie d’aller porter letrouble dans les foyers des bons citoyens.
Il se proposait de faire porter la lettre aucolonel du régiment, au ministère même et de la faire publier dansles journaux.
–&|160;Monsieur, répondit Chvéïk avec dignité,j’ai écrit moi-même cette lettre. Le nom et la signature sont faux.J’aime votre femme. Je l’ai dans la peau, comme dirait le poèteVrhlitzki.
À ces mots, le monsieur, écarlate de fureur,voulut se jeter sur Chvéïk qui se tenait tranquillement devant lui,calme et digne. Mais le vieux sapeur Voditchka qui ne le perdaitpas de vue, lui donna un croc en jambe, arracha des mains deMonsieur Kakonyi la précieuse lettre et la mit dans sa poche, puisil attrapa le bonhomme par la gorge, ouvrit la porte d’une main etle précipita dans l’escalier.
Tout cela se passa aussi rapidement quelorsqu’on décrit dans les contes populaires l’enlèvement dequelqu’un par le diable.
Il ne resta plus dans l’antichambre que laserviette de Kakonyi. Chvéïk la ramassa, alla frapper à la ported’où était sorti cinq minutes auparavant le maître de céans et,avec un geste très noble, il dit&|160;:
–&|160;Voilà, madame, la serviette de votremari. Je préfère vous la donner parce que nous aurions pu la saliren marchant dessus… mes compliments, madame…
Il fit le salut militaire, tourna sur sestalons, et regagna le vestibule. Dans l’escalier, aucune trace delutte n’était visible. Voditchka avait tenu parole. Ainsi qu’ill’avait déclaré&|160;: tout s’était déroulé le plus correctement dumonde. Seul, devant la porte, gisait un faux-col tout froissé.C’était à cette place, sans doute, que Kakonyi essaya vainement derésister à la poigne de Voditchka.
Mais lorsque les deux amis arrivèrent dans larue, l’incident prit une tournure plus grave. Monsieur Kakonyiavait été transporté dans une maison d’en face où on l’aspergeaitabondamment pour essayer de le faire revenir à lui. Voditchka, aumilieu de la chaussée, soutint une lutte acharnée contre troishussards qui étaient accourus pour défendre leur compatriote. Levieux sapeur combattait comme un lion en faisant un moulinet avecson ceinturon. Rapidement d’autres soldats tchèques passaient parlà se rangèrent à ses côtés. Comme Chvéïk le raconta plus tard, ilne sut même pas comment il se fit qu’il se trouva au beau milieu dela bagarre. N’ayant pas de baïonnette sur lui, il arracha la canned’un passant pour se précipiter au secours de son copain.
La lutte durait depuis un long moment déjà etdemeurait indécise lorsqu’une patrouille survint qui ramassa tousles combattants.
Chvéïk marchait en tête du groupe, tenantfièrement la canne à sa main comme une épée, à côté de Voditchka,cependant que les soldats de la patrouille les escortaient.
Le vieux sapeur garda un silence farouchedurant tout le chemin. Il n’en sortit que pour déclarer à Chvéïkd’un ton mélancolique, au moment où ils franchissaient la porte ducorps de garde de la garnison&|160;:
–&|160;Eh bien, mon vieux, je te l’avais biendit&|160;! On a toujours des embêtements avec ces salauds deMagyars&|160;!
*
**
Le colonel Schroder observait du milieu de sonbureau, avec un plaisir intense, le visage pâle et les yeux cernésdu lieutenant Lukach. Celui-ci, pour dissimuler sa gêne, évitaitsoigneusement de regarder en face le colonel. À le voir, on auraitcru que tout son intérêt était concentré sur de savants dessinsplacardés contre le mur, qui représentaient la disposition duquartier de son régiment, seules décorations du cabinet de sonchef.
Le colonel Schroder avait étalé devant lui,sur son bureau, une quantité de journaux où certains articlesavaient été marqués au crayon rouge. Il les contempla en silencedurant quelques minutes puis, fixant son regard sur Lukach, ildit&|160;:
–&|160;Ainsi, vous n’ignorez pas que votreordonnance se trouve en prison et qu’il sera fort probablementdéféré au conseil de guerre de la division&|160;?
–&|160;Oui, mon colonel.
–&|160;Vous n’ignorez pas également,poursuivit le colonel en détachant chaque syllabe, que cetteaffaire a eu un retentissement énorme. La stupidité de votreordonnance a fortement contribué à agiter l’opinion publique etvotre nom est gravement mêlé à ces incidents. Le général dedivision nous a fait parvenir les documents qui sont devant vous.Voilà quelques journaux qui vous font l’honneur de s’occuper devous, lieutenant. Lisez-moi à haute voix un de ces articles marquésau crayon rouge.
Le lieutenant Lukach prit un des journaux auhasard.
–&|160;C’est le Pester Lloyd&|160;?demanda le colonel.
–&|160;Oui, mon colonel, répondit Lukach et ilse mit à lire&|160;:
«&|160;Pour mener cette guerre jusqu’à lavictoire, la monarchie austro-hongroise a besoin de lacollaboration de tous ses peuples. Si nous voulons sauver notrepatrie, les nations qui la composent ont le devoir de s’entr’aider.Les graves sacrifices de nos vaillants soldats qui marchenttoujours et sans discontinuer en avant, seraient vains si dansl’hinterland, la division commençait à régner, si des élémentssubversifs paraissaient se proposer pour but de détruire l’unité del’État et de ruiner l’autorité de notre monarchie, en dressant lespeuples de notre fédération les uns contre les autres. Nous nepouvons donc considérer sans inquiétude ces groupements d’individusqui, pour des raisons fallacieuses, se proposent de jeter ledésaccord parmi nos peuples et d’affaiblir ainsi le magnifique élanqui pousse notre population tout entière vers nos frontières, afinde rejeter les misérables qui ont osé nous attaquer dans l’espoirde nous dépouiller de nos richesses culturelles et matérielles.Nous avons déjà eu l’occasion de signaler certains événements quiont obligé le conseil de guerre à prendre des mesures énergiquescontre certains individus appartenant à des régiments tchèques, quitrahissent leur pays en répandant parmi la nation tchèque la hainede tout ce qui est magyar.
«&|160;Or, cette nation nous a donné toute unesérie de chefs militaires d’une réputation glorieuse. Qu’il noussuffise de citer le nom du maréchal Radetzki. À côté de ces hérosnous avons de louches individus qui cherchent à jeter le désaccordentre les peuples qui composent notre grande nation. Nous avonscité ici même, les agissements abominables du… de ligne (censuré) àDebretzen. Ces manœuvres ont été flétries à juste titre par leParlement hongrois, et le drapeau du même régiment, au front…(censuré). Quels sont les responsables de ces actes&|160;?…(censuré). Quels sont ceux qui excitent les soldats tchèques(censuré). Nous voyons un exemple éclatant de l’audace aveclaquelle ces éléments étrangers essayent de jeter la désunion parminous dans les incidents qui eurent lieu ces jours derniers àKiralyhida. À quelle nation appartiennent les soldats du campementmilitaire qui ont fait violence à la personne de l’honorablecommerçant Gyula Kakonyi&|160;? Les autorités responsables ont ledevoir pressant de suivre cette affaire avec une attention toutespéciale.
«&|160;Aussi nous espérons que les minoritésresponsables sauront demander des comptes à un certain lieutenantLukach qui a, paraît-il, joué un rôle de premier plan dans lesévénements que nous venons de décrire. Notre correspondant a réuniune masse considérable de documents à ce sujet, documents d’uneportée exceptionnelle, surtout si l’on songe aux jours historiquesque nous vivons.
«&|160;Les lecteurs du Pester Lloydsuivront, nous l’espérons, avec un intérêt tout particulier, lamarche de l’instruction, et nous pouvons les assurer, d’ores etdéjà, que nous ne manquerons pas de les informer avec exactitudesur le développement de cette affaire. Mais, dès maintenant nousposons la question aux autorités&|160;: Quand dénoncera-t-on, d’unefaçon officielle, l’attaque ignoble qui a été perpétrée contre lapopulation magyare de Kiralyhida&|160;? Le parlement de Budapestdoit s’occuper également de cette affaire. Il y a lieu, enfin,d’expliquer aux soldats tchèques qui traversent notre pays pour serendre au front que le royaume de la couronne deSt-Étienne n’est pas entièrement livré à leur merci. Etsi certains éléments de cette nation persistaient dans leurssentiments fratricides, il conviendrait alors de les rappeler ausens des réalités, c’est-à-dire que nous sommes en guerre et que ladiscipline peut être rappelée au moyen des pelotons d’exécution etdes potences. Leur seul devoir, c’est de se soumettre loyalement,sans attendre des mesures de justice.&|160;»
–&|160;Qui est-ce qui a signé cet article,lieutenant&|160;?
–&|160;C’est Béla Barabas, le député, mon,colonel.
–&|160;En somme, il ne s’agit que d’une bêtisede chauvin magyar, mais sachez que ce même article a été publié lemême jour dans le Pesti Hirlap. Maintenant, veuillez melire la traduction de l’article du journal hongrois, le SoproniNaplo.
Le lieutenant Lukach se mit à lire l’article àhaute voix. L’auteur s’était abandonné à une phraséologie de cegenre&|160;:
«&|160;L’exigence de la raison d’État –l’ordre social, dignité et sentiments humains – une fête sanglantede Cannibales, une civilisation mise en péril, etc.,etc.&|160;»
L’article donnait l’impression que les soldatstchèques avaient assailli le rédacteur de l’article, l’avaient jetéà terre et s’étaient amusés à le piétiner longuement avec leurslourdes bottes, tandis que ledit rédacteur, hurlant de douleur,s’empressait de dicter son article à une dactylo présente au momentmême du massacre.
«&|160;On passe sous silence, ajoutait leSoproni Naplo, certains faits très importants. Nous savonstrès bien tous les méfaits que les Tchèques ont déjà commis à notredétriment. Le point essentiel est de savoir quels sont lesresponsables et de frapper les meneurs. L’attention de nosautorités est évidemment, à l’époque que nous vivons, fort absorbéepar d’autres devoirs. Néanmoins, il convient de ne pas fermer lesyeux sur les événements de Kiralyhida. L’article que nous avonspublié hier a été mutilé par la censure. Cependant, notrecorrespondant envoyé sur les lieux nous téléphone que les autoritéslocales s’occupent d’éclaircir cette affaire. Ce qui nous étonneprofondément, c’est que les instigateurs de ce massacre se trouventencore en liberté. Nous songeons surtout, en écrivant ces lignes, àun certain lieutenant qui, d’après nos informations, continue à sepromener librement dans le campement militaire, en portantl’insigne de son régiment. Son nom a déjà été révélé au public dansla journée d’hier par le Pester Lloyd et par le PestiNaplo.
«&|160;Nos lecteurs auront déjà reconnu lefameux chauvin tchèque, Lukach, dont les agissements serontprochainement dénoncés devant le parlement hongrois, par le députéde la circonscription de Kiralyhida.&|160;»
–&|160;De la même façon charmante, dit lecolonel, le journal hebdomadaire, le Kiralyhida, et lapresse de Pozsony vous rendent célèbre. Enfin, vous me comprenez,lieutenant, ces articles sont inspirés par de vieilles rancunes.Peut-être cela vous amusera également de lire l’article duJournal du soir de Komarom, où l’on affirme en touteslettres que vous avez tenté de violer madame Kakonyi dans sa salleà manger, au moment même du déjeuner et en présence de son mari.Vous avez forcé, d’après ce journal, ce malheureux cocu àbâillonner son épouse avec sa serviette de table, afin del’empêcher de hurler. Ceci est le dernier article qui nous estparvenu sur vous, lieutenant.
Le colonel se mit à rire et ajouta&|160;:
–&|160;Les autorités ont trahi leur devoir, lacensure de la presse locale est entièrement aux mains des Magyars,qui font tout ce qu’ils peuvent pour nous embêter. Nos officiers nesont pas assez protégés contre les diffamations de ces fripouillesde rédacteurs, et ce n’est qu’après des démarches énergiques, surl’insistance du conseil de guerre de notre division, que nous avonsréussi en partie à obtenir satisfaction. Le procureur général deBudapest vient d’ordonner l’arrestation des rédacteurs coupables.Je vous assure que le rédacteur en chef du Journal du soir deKomarom aura de nos nouvelles.
D’autre part, j’ai été chargé en ma qualité devotre supérieur de vous soumettre à un interrogatoire. Le conseilde guerre qui m’a donné cet ordre m’a fourni également desdocuments concernant votre affaire, et tout serait déjà réglé àl’amiable, si cet idiot de Chvéïk n’était pas intervenu dansl’histoire. On avait arrêté avec lui un sapeur nommé Voditchka.Après la rixe au poste de garde de la garnison, on a retrouvé dansla poche de sa capote, la lettre que vous aviez envoyée à MadameKakonyi. Or, comme on interrogeait Chvéïk, il a déclaré àl’instruction que ce n’était pas vous qui aviez rédigé la lettre,mais lui-même. Et, lorsqu’on lui a présenté le document, et que lejuge d’instruction l’a pressé de le copier pour comparer les deuxécritures, votre ordonnance s’est emparée de la lettre et l’aavalée. Le secrétariat du régiment a dû mettre à la disposition dujuge d’instruction des rapports rédigés par vous-même pour comparervotre écriture avec celle de Chvéïk. Et voici le résultat de leursrecherches…
Le colonel chercha quelques instants dansl’amoncellement de feuilles qui se trouvaient sur son bureau, puisil tendit au lieutenant Lukach un papier sur lequel celui ci putlire&|160;:
«&|160;Le détenu Chvéïk s’est refusé à écrireles phrases qu’on lui dictait, en déclarant pour sa défense quedepuis la veille, à la suite des émotions subies, il ne savait plusécrire&|160;».
–&|160;Tout ce que Chvéïk ou le sapeurVoditchka pourront dire au conseil de guerre n’a aucune importance,lieutenant. Chvéïk et le sapeur affirment qu’il ne s’agit danstoute cette affaire que d’une sorte de farce, qu’ils furentcontraints eux-mêmes de se défendre parce qu’ils avaient étéattaqués par des civils. L’instruction a du reste établi que votreChvéïk est un drôle de personnage. Voici la façon par exemple dontil a répondu à ses juges, lorsque ceux-ci le pressaient d’avouer.Je lis sur le procès-verbal&|160;:
«&|160;Je me trouve justement dans la mêmesituation que le célèbre prince Palouchka, à cause d’un portrait dela Sainte-Vierge. Lorsqu’on lui a demandé de quelle façon ils’était approprié certains tableaux, il n’a pu que répondre&|160;:«&|160;Voulez-vous me faire cracher le sang&|160;?&|160;»
–&|160;Bien entendu, poursuivit le colonel,j’ai fait des démarches au nom du régiment pour faire paraître dansles journaux une rectification au sujet de ce que ces saligauds ontpublié à notre sujet. Les communiqués seront expédiés ce soir même,et je pense avoir fait tout ce qui était nécessaire pourréhabiliter notre régiment. Écoutez un peu ce que je leurécris&|160;:
«&|160;Le conseil de guerre de la divisionn°X. et le commandant du 91e régiment de ligne déclarentque les articles publiés dans la presse locale sur les soi-disantattaques et outrages aux mœurs commis par des soldats du régimentsusnommé sont de pures calomnies, que les faits qu’ils dénoncentont été inventés de toutes pièces, et que l’instruction militairedéjà ouverte contre les journaux en question saura combattreénergiquement de pareilles manœuvres.&|160;»
–&|160;Le conseil de guerre a tenu à nousfaire part de son opinion, continua le colonel. Il est d’avis qu’ilne s’agit dans toute cette histoire que d’une campagne haineusecontre les troupes qui se rendent d’Autriche en Hongrie. Calculezun peu combien de soldats nous avons déjà envoyés au front, etcomparez-les au nombre des soldats magyars. Je vous le dis,lieutenant, en toute franchise, j’aime cent fois mieux le soldattchèque que ces canailles de Magyars. Je me souviens encore tropbien que, sous Belgrade, ces salopards de Hongrois ont eu le culotde tirer sur notre 2e bataillon de marche. Les nôtres,ne sachant pas que c’étaient les Magyars qui leur tiraient dessus,se mirent à bombarder l’aile droite des Deutschmeister de Viennequi, à leur tour, ouvrirent le feu sur un régiment de Bosnie qui setrouvait près d’eux. Imaginez cette situation&|160;! J’étais justeà ce moment-là à l’état-major de la brigade et nous étions encore àtable. La veille, nous avions eu un dîner assez frugal&|160;: dujambon et de la soupe. Mais ce jour-là le menu était épatant&|160;:Consommé de volaille, un filet de bœuf au rizzoto et des tartes àla crème. La veille au soir, nous avions fait pendre un marchand devins serbe, et nos cuisiniers avaient découvert dans ses caves desvins vieux de trente ans. L’eau nous venait à la bouche en nousmettant à table. Eh bien, à peine avions-nous avalé la soupe que lapétarade commence, et, pour comble de malheur, notre artillerie,ignorant que nos pauvres poilus se massacraient entre eux, se mit àenvoyer des marmites dans nos lignes. Un de ces obus éclate à dixpas de notre état-major. Les Serbes, croyant qu’il s’agissait cheznous d’une rébellion, se mettent à nous attaquer de tous côtés. Legénéral de brigade est appelé au téléphone. Le général de divisionse met à l’engueuler en lui disant qu’il vient de recevoir l’ordrede préparer une attaque sur l’aile gauche de l’ennemi pour 2 h 35,et que, puisque nous sommes en réserve, nous n’avons qu’à cesser lefeu immédiatement, nom de Dieu&|160;! etc.… Mais comment aurait-ilvoulu que nous fassions pour donner l’ordre de cesser le feu dansde pareilles circonstances&|160;? La centrale téléphonique de labrigade nous fait savoir à ce moment-là qu’elle ne peut obteniraucune communication, que la seule qui lui est parvenue est celledu 75e de ligne, qui déclare qu’il vient de recevoirl’ordre de la division de tenir à tout prix. Puis lescommunications sont absolument interrompues, on nous demanded’envoyer un bataillon en hâte pour rétablir les filstéléphoniques. Mais les Serbes ont déjà occupé les hauteursnos 212, 226 et 327. Nous avons essayé également deparler avec le commandant de la division, mais nous n’avons puobtenir la communication. Évidemment, puisque les Serbes avaientrompu nos lignes sur les deux ailes et qu’ils nous avaientencerclés. Finalement, ils sont parvenus à refouler notre brigadedans un triangle et nous sommes tous tombés entre leurs mains. Noshommes de l’infanterie, l’artillerie, le parc à voitures, et mêmel’infirmerie.
J’ai dû cavaler deux jours durant sansdescendre de selle, et l’état-major de la division et de la brigadeont été faits prisonniers. Et tout cela nous est arrivé par lafaute de ces salauds de Magyars, qui s’étaient mis à tirer surnotre 2e bataillon de marche. Bien entendu, ils ont nié,et même nous ont mis en cause.
Le colonel cracha&|160;:
–&|160;Vous avez pu vous rendre compte parvous-même, ajouta-t-il, grâce à votre aventure de Kiralyhida, de labonne foi de ces gens-là&|160;!
Le lieutenant Lukach, fort embarrassé, se mità tousser.
Le colonel se pencha vers lui et lui demanda,confidentiellement&|160;:
–&|160;Dites-moi, lieutenant, votre paroled’officier, combien de fois avez-vous couché avec cette madameKakonyi&|160;?
Le colonel Schroder était de bonne humeur.
–&|160;Non, mon cher, vous ne voudriez tout demême pas me faire croire que vous vous en êtes tenu à cette lettre.Lorsque j’avais votre âge, j’ai suivi un cours de géométrie enHongrie, à Eger et, durant les trois semaines que je suis resté là,j’ai couché avec des Magyares&|160;: une jeune fille, une femmemariée, et bien d’autres encore. Je prenais tout ce qui seprésentait à ma portée. Je me suis si bien amusé qu’en rentrant aurégiment, je n’avais même plus la force de remuer les jambes. Mais,parmi toutes ces femmes, celle d’un avocat m’avait particulièrementvidé. Ah, celle-là, mon cher, je vous assure, me fit voir ce queles Hongroises sont capables de faire&|160;! J’ai cru qu’elleallait me dévorer. Dans sa rage amoureuse, elle allait jusqu’à memordre, et je n’ai pu fermer l’œil de la nuit.
–&|160;Cette histoire de lettre m’amuse,ajouta le colonel, en donnant une tape cordiale sur l’épaule deLukach. Allons, allons, ne dites rien, je vois clair dans toutevotre affaire. Le mari vous surveillait, et cet idiot de Chvéïk…Mais, à vrai dire, lieutenant, votre ordonnance a du cran. Il atout de même bouffé votre lettre. Dans le fond, c’est un bravetype. Ce geste me plaît. Nous tâcherons de le tirer de là. Le plusennuyeux, c’est que vous avez été compromis, lieutenant Lukach, parcette campagne de presse. Vous ne pouvez plus rester ici. Dans lecourant de la semaine, une compagnie de marche partira pour lefront russe. Vous êtes le plus âgé des officiers à la11e compagnie, vous en prendrez le commandement. J’aidéjà tout arrangé à la brigade. Dites au chef de la compagnie qu’ilvous donne un nouveau tampon à la place de Chvéïk. Lukach jeta unregard plein de reconnaissance sur le colonel et celui-cicontinua&|160;:
–&|160;Eh bien, vous voyez que tout est réglépour le mieux. Je vous souhaite bonne chance. Tâchez de me reveniravec de nombreuses décorations, et lorsque nous aurons l’occasionde nous revoir, ne fuyez pas notre compagnie, comme vous le faisiezà Budeiovitz.
Le lieutenant Lukach en sortant du bureau ducolonel ne cessait de se répéter&|160;: «&|160;Commandant decompagnie… nouveau tampon…&|160;»… et le candide visage de Chvéïklui apparut dans toute sa beauté.
Lorsqu’il ordonna au sergent-major Vanek delui chercher une ordonnance, le sergent montra un grandétonnement.
–&|160;J’avais toujours cru, mon lieutenant,que vous étiez très content de votre brave soldat Chvéïk, luidit-il.
*
**
Dans les cellules du conseil de guerre de ladivision, les prisonniers se levaient régulièrement à 7 heures dumatin. Ils rangeaient les paillasses recouvertes de poussière, cardans ces prisons improvisées, il n’y avait pas de bat-flanc. Lesdétenus se trouvaient dans des baraquements en bois et, après avoirrecouvert leurs paillasses de la façon réglementaire, ils allaients’asseoir sur les banquettes appuyées contre le mur. Les uns, quirevenaient du front, s’occupaient à exterminer leurs poux, tandisque les autres se divertissaient en se racontant des histoires.
Chvéïk et son copain, le bon vieux sapeurVoditchka, prirent place au milieu d’autres soldats de diversrégiments sur une banquette qui se trouvait près de la porte.
–&|160;Regarde-moi ce client-là, s’écriaVoditchka, c’est encore un salaud de Magyar&|160;! Écoutez donc lesprières qu’il fait, l’animal, pour obtenir la protection deDieu&|160;! Vous parlez d’un plaisir que j’aurais à lui fendre lagueule d’une oreille à l’autre&|160;!
–&|160;C’est un brave type, lui réponditChvéïk, il est là car il ne veut pas faire la guerre. Il est d’unesecte quelconque et on veut le zigouiller, précisément parce qu’ilne veut zigouiller personne. Il ne fait que se conformer aux ordresde son Dieu. Mais ici, on va lui en foutre du bon Dieu. J’ai connuen Moravie avant la guerre un certain Nemrava, qui se refusait mêmeà porter le flingot. Lorsque le conseil de révision le prit pour leservice armé, il déclara qu’il ne voulait pas être soldat, carc’était contraire à ses principes. On s’est empressé de le coffrer,et au bout de quelque temps, on l’a conduit devant le conseil deguerre pour prêter serment. Et voilà le bonhomme qui se met à direqu’il ne prêtera pas serment, car c’est contre ses principes. Et ilen resta là.
–&|160;C’était un imbécile, réponditVoditchka, il aurait dû prêter serment et se dire qu’il s’enfichait pas mal du serment et de tout ce qui s’ensuit.
–&|160;J’ai prêté serment trois fois, dit unfantassin, et je suis en tôle pour la troisième fois pourdésertion. Et, si les experts médicaux n’avaient pas prouvé quej’ai assommé ma tante il y a quinze ans, par crétinisme, j’auraisété zigouillé peut-être pour la troisième fois. Mais voilà, matante bien-aimée me tire toujours du pétrin. C’est grâce à elle quej’ai évité le poteau et que je m’en retournerai peut-être la peauintacte de la guerre.
–&|160;Et pourquoi diable as-tu assommé tatante&|160;? demanda Chvéïk.
–&|160;Drôle de question, répondit l’homme ensouriant. Pourquoi est-ce qu’on tue les gens&|160;? Pour leurargent parbleu&|160;! La vieille sorcière avait des rentes, et ellevenait de palper un tas de galette lorsque je suis venu, tout enloques et affamé, lui rendre visite. C’était la seule parente quej’avais dans tout l’univers. Je l’ai priée de me venir en aide, enlui disant que j’étais fauché, et cette vipère m’a envoyé promeneren me disant que j’étais assez grand pour boulonner, que j’étais uncostaud, que je n’avais qu’à trouver du travail. Un mot a suivil’autre et, finalement, je lui ai administré une correction&|160;:deux ou trois coups de hache sur la tête et cela l’avait tellementdéfigurée que je ne savais même plus si c’était ma tante. Je mesuis assis à côté d’elle par terre, et je ne cessai de medemander&|160;: Est-ce que c’est ma tante ou non&|160;? Et c’estcomme ça que le lendemain matin, les voisins m’ont découvert, assisprès d’elle. Alors, on m’envoya d’abord à Slupi, dans une maisond’aliénés. Au début de la guerre, on m’a présenté à une commissiond’experts, qui m’ont déclaré guéri. Et, là-dessus, ils m’ont envoyéau régiment pour y faire mon service militaire que j’avaisloupé.
Comme il achevait ces mots, un homme grand etmaigre, à l’aspect misérable, passa devant eux en tenant dans samain un balai.
–&|160;C’est un instituteur de notre dernièrecompagnie de marche, dit un soldat d’un ton mélancolique à unchasseur qui se trouvait près de Chvéïk. Il va balayer la salle.C’est un brave homme, et on l’a coffré parce qu’il avait fait desvers.
–&|160;Eh, dis donc, instituteur, cria lechasseur, veux-tu nous réciter tes vers sur les poux&|160;?
L’homme s’approcha, avec une mine grave,déposa son balai à ses pieds et, après avoir toussé une ou deuxfois, se mit à déclamer&|160;:
Tout est pouilleux chez nous. Ça démange…
Ce n’est qu’un pou énorme qui nous gouverne
Même nos officemars tressaillent dans les granges
Ou dans d’autres quartiers, dans les cavernes
En se grattant. Pour les poux, tout va bien chez nous
Personne ne peut s’en défaire, ni lui, ni moi.
Tenez, voilà une belle demoiselle-pou
Russe qui se rend à la noce avec un pouhongrois&|160;!
Le pauvre instituteur s’assit sur la banquetteet poussa un long soupir&|160;:
–&|160;Voilà, dit-il, c’est tout. Et c’estpour cela qu’on m’amène pour la quatrième fois àl’interrogatoire.
–&|160;Cela ne vaut vraiment pas quatreinterrogatoires, déclara Chvéïk avec conviction. Tout dépend de ceque vous avez désigné par ce vieux pou hongrois. L’allusion auxnoces des poux vous aidera peut-être à vous tirer d’affaire. Celava les embrouiller tellement que vos juges en deviendront dingo.Dites simplement que c’était pas votre intention de faire de lapropagande pour la fraternisation russo-hongroise, car vous n’aimezpas les Hongrois&|160;; c’est l’unique chance de vous sauver. Dureste, dites que vous n’avez voulu insulter personne et que vousavez fait cette petite poésie pour votre propre plaisir.
L’instituteur soupira de nouveau.
–&|160;Oui, dit-il, mais le juge d’instructions’est mis à chercher la petite bête dans mon poème, afin de pouvoirm’accuser du crime de lèse-majesté.
–&|160;Bref, dit Chvéïk, vos affaires ne sontpas brillantes. Mais, du courage, mon vieux, il ne faut jamaisdésespérer, comme disait le tzigane Yanetchek lorsqu’on lui a misen 1879, pour un double assassinat, la corde au cou. Et il avaitraison puisqu’il a été reconduit dans sa prison, étant donné quec’était justement l’anniversaire de Sa Majesté l’Empereur.
En l’honneur de cette fête on renonçaprovisoirement à la pendaison. Le lendemain, on le conduit ànouveau sous la potence, lorsque les fêtes de l’anniversaireétaient passées&|160;; mais il avait de la chance, ce type-là. Il aété gracié trois jours après. Naturellement c’était un peu tardpuisqu’il était mort. Mais tout de même, on a ordonné la révisionde son procès. Et les juges ont établi que c’était un autre tziganequi avait commis l’assassinat. Aussi il a été transporté en grandepompe du cimetière des forçats au cimetière catholique de Pilsenavec toute la cérémonie de la réhabilitation. Malheureusement on aappris, deux jours plus tard, qu’il n’avait jamais été catholique,mais protestant. Alors on l’a retransporté au cimetière protestantlorsque…
–&|160;T’as pas fini de nous embêter&|160;!s’écria le vieux sapeur Voditchka, ou veux-tu que je te colle unebaffe&|160;! Tout de même il a du culot, ce frère&|160;! On a latête pleine de soucis pour le conseil de guerre et hier encore,lorsque nous sommes allés à l’interrogatoire, il se met à meraconter ce que c’est que la rose de Jéricho.
–&|160;Mais c’est pas moi qui ai dit ça,répondit Chvéïk pour sa défense. C’est Meatthei, le valet del’artiste peintre Pamouchka qui l’a raconté à une vieille femme unjour qu’elle lui demandait ce que c’était qu’une rose de Jéricho.Il le lui expliqua de la façon suivante&|160;: tenez, madame,prenez un bon morceau de merde bovine, bien sèche, mettez ça surune assiette, aspergez-la avec de l’eau fraîche et vousverrez&|160;; cela poussera. Vous aurez une rose de Jéricho. C’esttout. Mais ce n’est pas moi qui ai inventé cette idiotie. J’aipensé que je faisais bien de te consoler en allant àl’interrogatoire…
–&|160;Me consoler&|160;? Voditchka crachaavec un air profondément méprisant. La tête me tourne quand jeréfléchis pour savoir comment je dois faire pour me débiner et pouraller régler leur compte à ces salauds de Magyars. Et pendant cetemps-là, cette andouille vient me consoler avec ses histoires demerde de vache&|160;! Mais comment veux-tu que je rende la monnaiede leur pièce à ces voyous de Magyars, si je suis enferméici&|160;? Et par-dessus le marché, le juge d’instruction veutm’obliger à dire que je n’en veux pas aux Magyars. Chienne devie&|160;! Mais attendez&|160;! Aussitôt qu’un de ces gredins metombera sous les mains, je vais l’assommer comme un chien enragé.Je vais leur apprendre à danser la czarda. Je vais leur régler leurcompte. Ne vous en faites pas, vous aurez encore de mesnouvelles&|160;!
–&|160;T’as raison, faut pas s’en faire,l’approuva Chvéïk. Tout reviendra dans l’ordre. L’essentiel, quandon est déféré en justice, c’est de ne jamais dire la vérité. Chaquefois qu’on se laisse entraîner à faire un aveu, on est perdu. Celuiqui ne sait pas mentir aux juges ne sera jamais bon à rien. Lorsquej’ai travaillé à Ostrova en Moravie, j’ai vu un cas pareil. Unouvrier mineur avait rossé son ingénieur. L’avocat qui le défendaitlui avait bien recommandé de nier toujours, et le président dutribunal l’a gentiment prié d’avouer, en lui disant que ça luiserait compté comme circonstance atténuante, mais le bougre a tenubon, répétant qu’il ne pouvait rien avouer puisqu’il n’avait rienfait. Et pour finir, il a été acquitté. Car il avait réussi àproduire un alibi. Et le même jour, à Brno…
–&|160;Jésus-Marie&|160;! s’écria Voditchka,il devient empoisonnant ce vieux frère&|160;! Pourquoi raconte-t-iltout cela&|160;? Hier nous avons vu un type dans son genre chez lejuge d’instruction. Comme le juge-capitaine lui demandait ce qu’ilfaisait dans la vie civile, il lui a répondu&|160;: «&|160;Je faisde la fumée chez Kreuz.&|160;» Et une demi-heure durant, il n’acessé de répéter cela. Au lieu de dire tout simplement qu’ilmaniait le soufflet chez le forgeron Kreuz. Lorsque le capitainelui cria&|160;: «&|160;Pourquoi ne dites-vous pas que vous êtesmanœuvre&|160;? – Il répondit&|160;: Mais comment donc, manœuvrier,c’est le franta Hibsch.
À ce moment, du corridor on entendit des paset le cri d’un garde&|160;: Un nouveau&|160;! Un&|160;!
Chvéïk annonça joyeusement&|160;: Nous allonsavoir un copain de plus. Peut-être qu’il nous apporte quelquesmégots.
La porte s’ouvrit et l’aspirant Marek, lecompagnon de prison de Chvéïk à Budeiovitz, qui avait été affectédepuis à la cuisine d’une compagnie de marche, pénétra dans lacellule.
–&|160;Que le Seigneur soit loué&|160;!s’écria-t-il en entrant.
Et Chvéïk, au nom de tous ses compagnons, luirendit son salut&|160;:
–&|160;Amen&|160;!
Marek regarda Chvéïk avec un air joyeux,déposa la couverture qu’il portait sur les bras, s’assit sur labanquette de la colonie tchèque, déroula les bandes molletières quientouraient ses jambes et en retira des cigarettes qu’ildistribua&|160;; puis, retirant ses brodequins, il releva une deses semelles et en sortit quelques allumettes qui avaient étécoupées en deux avec une précision parfaite. Il alluma unecigarette, donna du feu à ses compagnons, tira quelques bouffées,puis il dit de l’air le plus calme du monde&|160;:
–&|160;Je suis inculpé de rébellion.
–&|160;Ah&|160;! ce n’est rien, réponditChvéïk avec une mine consolatrice, ce n’est que de la blague.
–&|160;Naturellement, répondit l’aspirant,s’imaginent-ils gagner leur guerre avec des procédés pareils&|160;?Si ces idiots aiment tellement leur comédie de justice, grand bienleur fasse&|160;! Mais en tout cas, cela ne changera rien à lasituation.
–&|160;Et comment qu’t’as fait larébellion&|160;? demanda le vieux sapeur en fixant un regard pleinde sympathie sur Marek.
–&|160;Mon cher, j’ai refusé péremptoirementde nettoyer les cabinets de la garde de service. À cause de cetincident sans importance, on m’a conduit devant le colonel quin’est qu’un vieux cochon. Ce sombre idiot s’est mis à m’engueuleren hurlant que je devrais être en taule, que l’on m’avait puni aurapport du régiment, que j’étais un criminel de droit commun etqu’il était profondément étonné de la patience de la terre quicontinuait à me porter, bien que j’eusse infligé au genre humain lapire des hontes. Il me reprochait surtout d’avoir endossél’uniforme de l’armée et d’avoir nourri la folle prétention dedevenir un officier. Je lui ai répondu que la rotation de la terrene saurait être arrêtée par la présence d’un petit aspirant tel quemoi, que les lois de la nature étaient supérieures à la dignitéd’officier, et, pour terminer, je lui ai déclaré que je serais fortheureux de savoir quelle puissance pourrait bien me forcer ànettoyer un cabinet que je n’avais pas sali. J’ajoutai que,pourtant, il m’aurait été facile de le faire, après avoir avalécette odieuse saloperie que l’on prépare à la cuisine du régimentet que l’on décore du nom pompeux de choucroute. J’ai encore ajoutéque les paroles de monsieur le colonel concernant ma présence surterre m’étonnaient fortement, mais que je me sentais absolumentincapable d’occasionner un séisme…
Pendant mon discours, le colonel claquait desdents telle une jument qui aurait mangé de la carotte gelée. À lafin il me hurla&|160;: Alors, voulez-vous aller nettoyer lescabinets, oui ou non&|160;? – Je vous déclare avec obéissance, moncolonel, que c’est non. – Et moi je vous déclare, aspirant, quevous allez les nettoyer sur-le-champ. – J’ai le regret de vousdéclarer avec obéissance, mon colonel, que je n’en ferai rien. –Nom de Dieu&|160;! par le Christ et la Vierge, vous allez menettoyer non pas un, mais cent cabinets, et tout de suite&|160;! –J’ai le regret de vous déclarer avec obéissance, mon colonel, queje ne nettoierai ni un, ni cent cabinets.
Et cela continua longtemps de la sorte. Lecolonel continuant à me demander&|160;: Voulez-vous nettoyer lescabinets&|160;? cependant que je m’obstinais à répondre&|160;: Jene nettoierai rien du tout.
Le colonel marchait le long du bureau comme untaureau furieux. Finalement, il prit la décision de s’asseoir enface de moi pour me dire&|160;: Réfléchissez encore avant qu’ilsoit trop tard. Savez-vous que vous êtes passible du conseil deguerre, et croyez-vous par hasard que vous seriez le premieraspirant que j’aurais supprimé. Sachez que nous avons pendu deuxaspirants de la 10e compagnie, peu de jours après enavoir fait passer un de la 9e par les armes, car ils’était refusé à marcher en prétendant qu’il avait des engeluresaux pieds. Enfin, voulez-vous nettoyer les cabinets oui ounon&|160;? – Je vous déclare avec obéissance, mon colonel, quec’est non&|160;! – Le colonel me fixa un instant dans les yeux,puis il me demanda&|160;: – Ne seriez-vous pas par hasardslavophile&|160;? – Non, mon colonel. – Là-dessus, on m’a reconduiten prison et on m’a fait l’honneur de m’inculper de«&|160;rébellion&|160;».
–&|160;Tu ferais bien, déclara Chvéïk, dedéclarer que tu étais idiot. Lorsque j’étais aux arrêts à lagarnison, nous avions avec nous un très brave homme, trèsintelligent, un professeur à l’École commerciale. Il avait désertéson régiment pendant qu’il était au front et on a voulu lui faireun grand procès, comme exemple. On voulait le condamner à êtrependu. Et pourtant, il a réussi à se débrouiller et à se tirer despattes. Il s’est mis à faire le crétin, et lorsque le major l’aexaminé, il lui a déclaré qu’il n’avait pas déserté, mais quedepuis son enfance il aimait à voyager, qu’il avait toujours eu lanostalgie d’aller quelque part, très loin, qu’une fois il s’étaitretrouvé à Hambourg, une autre fois à Londres, sans pouvoir serendre compte comment cela lui était arrivé.
Il déclara que son père avait été unalcoolique, décédé à l’hôpital avant sa naissance, que sa mèreexerça longtemps le métier de prostituée, et qu’elle buvaitégalement et qu’elle était morte à la maison des aliénés. Ensuite,que sa sœur cadette s’était noyée. L’aînée s’était jetée sous unelocomotive, et son frère avait sauté du haut du pont dans unerivière. Quant à son grand-père, après avoir assassiné sa femme, ils’était aspergé de pétrole pour se brûler vif. Sa deuxièmegrand’mère était allée se balader avec des tziganes et, finalement,elle se donna la mort en prison en avalant le phosphore d’une boîted’allumettes. De plus, un de ses neveux avait été condamné pourpyromanie et s’était suicidé dans la prison de Kartouze, ens’ouvrant les veines à l’aide d’un morceau de verre. Puis, une deses cousines s’était jetée du sixième étage d’une maison à Vienne.Enfin, il ajouta qu’il n’était lui-même qu’un enfant abandonné,qu’il avait reçu une mauvaise éducation et que, par-dessus lemarché, lorsqu’il était un bébé de six mois, il était tombé de latable et s’était cogné gravement la tête. Il a déclaré encore qu’ilavait de temps à autre un mal à la tête formidable et que, dans cesmoments-là, il ne savait plus ce qu’il faisait, que ce devait êtreà un moment pareil qu’il était parti du front et qu’il n’avaitrepris ses sens qu’au moment où la patrouille l’a découvert chezFleck. Ah&|160;! mes bons amis, si vous aviez vu avec quel plaisiron l’a renvoyé de la prison en le libérant même de tout servicemilitaire. Aussi, les cinq poilus qui étaient ses compagnons decellule lui ont demandé sa combine, et tous l’ont inscrite sur unbout de papier. Ils avaient marqué&|160;: père alcoolique&|160;;mère prostituée&|160;; une sœur noyée&|160;; l’autre sœur&|160;:locomotive. Frère, du pont&|160;: grand-père tué sa femme&|160;;grand’mère couchée avec des tziganes, allumettes, etc., etc. Etlorsqu’on s’est mis à interroger l’un d’eux, le major l’ainterrompu au moment où il était au chapitre du grand-père en luidisant&|160;: «&|160;Assez, mon brave&|160;! tu es déjà letroisième de l’espèce aujourd’hui. Permets-moi de continuer à taplace&|160;: ta cousine s’est jetée du 6e étage, tu asété un enfant abandonné et, pour cette raison, on fera bien de tecorriger un peu.&|160;» Là-dessus, il fit reconduire le pauvrediable aux arrêts, on l’a mis au fer et au cachot, et il asubitement oublié son grand-père brûlé, sa mauvaise éducation, etil demanda sur-le-champ à être envoyé au front.
–&|160;On ne croit plus aujourd’hui, soupiral’aspirant, chez nous, au crétinisme héréditaire. On aurait troppeur d’enfermer pour cette raison tous les généraux dans lesmaisons d’aliénés.
Derrière la porte lourdement ferrée, onentendit le cliquetis des clefs du geôlier qui entraaussitôt&|160;:
–&|160;Le soldat Chvéïk et le sapeurVoditchka&|160;?
–&|160;Présents.
–&|160;Au juge d’instruction.
Tous deux se levèrent, et Voditchka dit toutbas à Chvéïk&|160;:
–&|160;Tu parles d’une bande de crapules.Encore un interrogatoire. Pourquoi diable toutes ces chinoiseries,au lieu de nous condamner tout de suite. On ne fait que nous faireperdre notre temps pendant que les Magyars courent dans lesrues…
Tout en marchant vers le bureau du conseil deguerre qui se trouvait dans l’autre baraquement, Voditchka dit àChvéïk&|160;:
–&|160;Si au moins on voyait où ça va aboutir.Ils noircissent un tas de papiers, ils nous emmerdent à la fin. Nonmais, sans blagues&|160;! Ils nous donnent de la soupe immangeable,de la choucroute pourrie, nom de Dieu&|160;! Je m’imaginaisautrement une grande guerre&|160;!
–&|160;Pour moi, répondit Chvéïk, je suiscontent. Il y a quelques années, lorsque j’ai fait mon service,notre sergent, un nommé Soltera, avait l’habitude de répéter que lesoldat doit être toujours conscient de son devoir, et, pour que tune l’oublies pas, en disant cela il te flanquait une baffe. Notrelieutenant, un nommé Kvaisler, lorsqu’il examinait les fusils, nousexpliquait toujours que le soldat doit avoir un cœur dur et fort,car il n’est qu’une bête de somme que l’État nourrit, lui donnantdu jus pour boire et du tabac pour fumer, mais à condition qu’ilsoit entièrement à la merci de messieurs les supérieurs.
Le sapeur Voditchka, qui paraissait plongédans de profondes réflexions, dit à ce moment&|160;:
–&|160;Lorsque tu seras interrogé par le juged’instruction, fais bien attention de ne pas te gourrer. Répètetoujours ce que tu as dit la dernière fois. Tu te rappelles&|160;:Ce sont les Magyars qui nous ont assaillis.
–&|160;N’aie pas peur, Voditchka, déclaraChvéïk, garde bien ton sang-froid et ne t’emballe pas. Qu’est-ceque c’est pour nous que ces pouilleux du conseil de guerre&|160;?Ah&|160;! si tu avais vu comment ils travaillaient autrefois, tuparles d’un système D. Nous avons eu à notre compagnie uninstituteur, et comme nous étions justement consignés, il nousraconta qu’il avait vu au musée de Prague un livre dans lequel onparlait des conseils de guerre sous le règne de Marie-Thérèse. Àcette époque, chaque régiment avait son bourreau qui exécutait lestrouffions l’un après l’autre pour recevoir une indemnité d’un écupar tête, et suivant ce bouquin, le bourreau gagnait certains joursjusqu’à 5 écus. Bien entendu, ajouta Chvéïk d’un ton sérieux, lesrégiments à cette époque avaient de nombreux effectifs et onrecrutait continuellement dans les villages.
–&|160;Et moi quand j’étais en Serbie,répondit Voditchka, on a fait pendre des comitadjis par desvolontaires. On touchait dix cigarettes pour chaque pendaison, sic’était un homme, et cinq cigarettes pour les femmes et lesenfants. Puis, un beau jour, à l’intendance, ils ont trouvé que çarevenait trop cher et on les a fait massacrer à la mitrailleuse.J’ai eu un copain tzigane qui, on ne savait pourquoi au débutdisparaissait chaque nuit. Nous étions à cette époque au bord de laDrina, et une fois, la nuit, lorsqu’il était dehors, nous avons eul’idée de fouiller dans son havresac et nous y avons découvert plusde trois paquets de cent cigarettes. Alors, quand il est rappliquéun matin dans notre hangar, nous lui avons réglé son compte. Ça étévite fait. Nous l’avons renversé, et un type de notre peloton l’aétranglé avec une lanière. Il tenait à la vie, l’animal, il nous adonné du boulot… Deux lui ont pris la tête, deux l’ont attrapé parles pieds et lui ont brisé l’échine, puis nous lui avons attachéson havresac autour du cou et nous l’avons jeté dans la Drina.Personne n’a voulu de ces cigarettes gagnées de la sorte et, lematin, on l’a cherché partout…
–&|160;Fallait dire qu’il avait disparu,répondit Chvéïk. Vous auriez dû raconter qu’il avait depuislongtemps l’intention de s’en aller, qu’à plusieurs reprises ilavait voulu se cavaler.
–&|160;Penses-tu qu’on y a songé, réponditVoditchka, nous avons accompli notre devoir, et pour le reste ons’en foutait. C’était pas rigolo là-bas, chaque jour nous avionsdes disparus. De temps à autre, on voyait flotter dans la Drina uncomitadji, gonflé comme une outre. De voir un pareil spectacle,quelques bleus en avaient attrapé la jaunisse.
–&|160;Fallait leur donner de la quinine, fitobserver Chvéïk.
Comme il achevait ces mots, ils pénétrèrentdans le bâtiment réservé au conseil de guerre. L’escorte lesconduisit immédiatement dans le bureau n°&|160;8 où, derrière unelongue table chargée de gros bouquins, se tenait le capitaine-jugeRuller. Il avait devant lui un volume du Code pénal sur lequel setrouvait un verre de thé. À sa droite, se trouvait un crucifix enimitation d’ivoire. Le Christ, recouvert de poussière, paraissaitregarder avec désespoir le bois de sa croix qui avait été déshonorépar des mégots.
Le capitaine Ruller venait justement de jeterdans ce cendrier d’un nouveau genre un bout de cigarette qui fumaitencore. Puis il essaya de soulever son verre de thé du bouquin surlequel il s’était collé.
Pendant qu’il s’efforçait de mener à biencette opération délicate, il feuilletait un livre qu’il avaitemprunté au Casino des officiers. C’était l’œuvre d’un certain Fr.S. Kraus, sur les «&|160;Observations concernant la moralesexuelle&|160;». Il regardait avec une grande attention les dessinsnaïfs illustrant le livre&|160;; l’un d’eux représentait le sexed’un homme et celui d’une femme qui avaient été relevés sur le murd’un cabinet de la gare du Nord à Berlin&|160;: des légendes riméesles accompagnaient. Il était tellement absorbé par cettecontemplation qu’il ne vit pas les prévenus qui venaient depénétrer dans son bureau. Il ne s’arracha de ses savantes étudesque lorsque Voditchka eut attiré son attention par quelquestoussotements.
–&|160;Qu’est-ce qu’il y a&|160;?demanda-t-il, tout en continuant à feuilleter son bouquin, sanslever la tête.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncapitaine, dit Chvéïk, que mon camarade Voditchka s’estenrhumé.
À ce moment le capitaine-juge releva la têteet fixa Voditchka dans les yeux. Il s’efforçait visiblement de sedonner un air sévère.
–&|160;Enfin, vous voici, espèces de gredins,dit-il en fouillant dans le tas de pièces qui encombraient sonbureau pour y puiser les documents qui concernaient l’affaire desdeux détenus. Je vous ai ordonné de venir à neuf heures et il enest onze déjà. Eh&|160;! là-bas s’écria-t-il en s’adressant àVoditchka, vous appelez ça un garde à vous&|160;? Jusqu’à ce que jevous dise «&|160;repos&|160;», je vous ordonne de garder l’attituderéglementaire.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncapitaine, que mon camarade Voditchka a des rhumatismes, réponditChvéïk.
–&|160;Toi, je te conseille de fermer tagueule jusqu’à ce qu’on t’adresse la parole, lui cria hors de luile capitaine. Tu es venu trois fois à l’interrogatoire, et chaquefois les idioties sortaient de ta bouche comme d’un réservoirinépuisable. Sacré nom de Dieu&|160;! Est-ce que je trouverai votredossier ou non&|160;! C’est tout de même malheureux d’avoir unboulot aussi formidable à cause de deux idiots de votre genre.Ah&|160;! voici, dit-il tout joyeux en retrouvant les pièces quiformaient un paquet volumineux sur lequel était écrite, en belleslettres rouges, l’inscription suivante&|160;: «&|160;Affaire Chvéïket Voditchka&|160;».
–&|160;Vous en avez de l’audace. Ainsi, vousvous imaginiez que, pour quelques malheureux coups échangés dans larue, vous alliez alerter tout le conseil de guerre. Ne fais pascette gueule d’enterrement, Chvéïk, poursuivit-il, on te ferapasser, lorsque tu seras au front, l’habitude de te battre enpleine rue. Sachez que l’instruction concernant votre affaire estterminée par un non-lieu. Mais vous serez tout même présentés aurapport pour y recevoir la punition à laquelle vous avez droit.Puis, vous filerez immédiatement au front avec la compagnie demarche. Mais si, par malheur, j’avais encore à m’occuper de vous,soyez assurés que ça ne se passera pas aussi bien que cettefois-ci. Tenez, voilà votre billet de levée d’écrou, et tâchez dene pas recommencer.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncapitaine, dit Chvéïk, que nous vous remercions de tout cœur pourvos bonnes paroles. Si nous étions de simples pékins, je mepermettrais de vous dire que vous avez un cœur d’or. Et, en mêmetemps, nous vous prions de nous excuser de vous avoir tellementembêté avec nos affaires. Vraiment nous n’avons pas mérité…
–&|160;Allez-vous-en à tous les diables&|160;!s’écria le capitaine. Si le colonel Schroder n’intervenait pas envotre faveur, je crois que cela tournerait mal pour vous&|160;!
Voditchka ne reprit ses sens que dans lecouloir, lorsque l’escorte les conduisit dans le bureau n°&|160;2.Il se dit alors, en se redressant fièrement, qu’il était de nouveauredevenu le vieux sapeur Voditchka. Le soldat qui les accompagnaitétait extrêmement pressé, car il craignait de manquer la soupe demidi.
–&|160;Allons, les gars, grouillez-vous, leurdit-il&|160;; vous vous traînez comme des limaces.
Voditchka lui déclara qu’il ferait bien de lafermer et qu’il pouvait remercier le ciel de l’avoir fait naîtreTchèque plutôt que Magyar, car sans cela il l’aurait déchiqueté enpetits morceaux.
Comme les soldats affectés aux bureaux étaientdéjà sortis pour aller à la soupe, la sentinelle se vit dansl’obligation de reconduire les deux détenus dans leur cellule, cequ’il ne fit pas sans maugréer et vouer aux tourments de l’enfermessieurs les ronds-de-cuir.
–&|160;Les copains vont tout bouffer, dit-ild’un air tragique. Ils vont prendre les bons morceaux, et moi jevais me l’accrocher… Hier encore, j’ai escorté deux types au campmilitaire et, pendant mon absence, un copain m’a bouffé la moitiéde ma boule de pain.
–&|160;Vous ne songez qu’à bouffer ici,grommela Voditchka.
Lorsqu’ils eurent raconté à l’aspirant laconclusion de leur affaire, Marek s’écria&|160;:
–&|160;Alors, nous allons partir. Cela merappelle un roman que j’ai lu dans un journal tchèque quis’occupait de choses touristiques. Cela s’appelait&|160;: BonneChance. Tous les préparatifs de notre voyage sont terminés, lahaute direction de l’armée aura soin de tout. Vous êtes invités àfaire une excursion en Galicie, allez-y, messieurs, d’un cœurjoyeux et confiant. Admirez surtout le pays des tranchées. Il estbeau et très intéressant. Vous vous sentirez là-bas, dans ces payslointains, comme chez vous, dans un patelin ami, presque comme dansvotre patrie. Haut les cœurs, mes amis&|160;! et mettez-vous enroute pour le pèlerinage dans ce pays qui a inspiré au grandHumboldt ces lignes&|160;: «&|160;Je n’ai jamais vu dans le mondeentier un pays aussi imposant que cette stupide Galicie.&|160;» Lesrenseignements précieux que notre armée a recueillis, au cours deses nombreuses retraites effectuées en Galicie, seront probablementlargement utilisés dans les préparatifs de notre nouvelle campagne.Un dernier conseil&|160;: Toujours en avant pour la Russie, ettirez en l’honneur de ce beau voyage toutes vos cartouches enl’air&|160;!
Avant de retourner au bureau du conseil deguerre, l’instituteur, le malchanceux auteur du poème sur les Poux,s’approcha de Chvéïk et de Voditchka, pour leur dire d’un tonconfidentiel&|160;: «&|160;N’oubliez pas surtout, aussitôt que vousarriverez dans le voisinage des Russes, de leur dire&|160;:Zdravtouite rouskie bratia, my bratia, Tchesky, m’y nietaoustriitsi…&|160;»
Lorsqu’ils eurent quitté la prison, Voditchka,pour manifester sa haine irréductible et sa volonté de lutteinflexible contre les Magyars, marcha volontairement sur les piedsdu Hongrois qui avait refusé de faire son service militaire, en luicriant&|160;: «&|160;Tu es toujours au milieu alors&|160;! S’pèced’imbécile&|160;!&|160;».
–&|160;S’il avait osé me répondre, confiait-ilà Chvéïk, s’il avait eu le culot d’ouvrir son bec, je lui auraisfendu la gueule d’une oreille à l’autre. Mais, penses-tu, cedégonfleur, on lui marche sur les pieds, il ne répond même pas. Jet’assure, mon vieux Chvéïk, que je suis très ennuyé de n’avoir pasété condamné. Vraiment, ces gens-là ont l’air de se foutre de nous.Comme nous n’avons pas été punis, notre histoire avec les Magyarsprend l’allure d’une rigolade, et pourtant nous nous sommes battuscomme des lions. C’est ta faute à toi, Chvéïk, si nous filons d’icisans être condamnés. Maintenant que nous sommes graciés, tous lesgens vont croire que nous ne sommes pas même capables de tabasserquelqu’un. Quoi&|160;? Qu’est-ce qu’on va penser de nous. Pourtantnous nous sommes battus en pleine rue, et nous n’y sommes pas allésavec le dos d’une cuiller.
–&|160;Mon cher copain, répondit Chvéïk avecson air candide, je ne comprends pas pourquoi cela te chagrine quele conseil de guerre de la division nous traite comme des gensbien. On ne peut rien nous reprocher. Il est vrai qu’àl’interrogatoire, j’ai tâché de me débrouiller. Mais mentir c’étaitmon devoir, comme le disait toujours l’avocat Bass à ses clients.Lorsque le capitaine-juge m’a demandé pourquoi nous nous étionsintroduits chez M.&|160;Kakonyi, j’ai dit que nous avions voulusimplement faire sa connaissance, et le capitaine ne m’a pasdemandé autre chose. Remarque bien, continua Chvéïk, qu’il ne fautjamais avouer au conseil de guerre. Lorsque j’étais à la garnisonde Prague, un soldat avait avoué dans la chambre qui se trouvait àcôté de la mienne. Or en rentrant, il a été sévèrement rossé, etensuite nous l’avons obligé à aller se rétracter.
–&|160;Naturellement, s’il s’agit d’uneaffaire malhonnête, répondit le brave Voditchka, je nierai jusqu’àla mort. Mais, si on me demande&|160;: Tu t’es battu avec lesMagyars&|160;? – Je ne peux que répondre&|160;: Oui, je me suisbattu. – Vous avez tabassé un Magyar&|160;? – Mais oui, moncapitaine. – Vous avez blessé un Magyar. – Bien sûr, mon capitaine.– Il faut qu’il sache à qui il a à faire. Et veux-tu savoir mafaçon de penser&|160;? Eh bien, le vrai scandale, c’est qu’on nousait accordé un non-lieu. Cela me pousse, à croire qu’il n’a pas étéconvaincu que j’aie tabassé réellement les Magyars. Mais, dis, tuétais pourtant à mes côtés, toi, lorsque j’avais trois de cesgredins sur le dos&|160;? Tu as vu toi-même qu’au bout de quelquesminutes, je les avais aplatis par terre comme des galettes, et queje leur dansais sur le ventre.
Nom de Dieu&|160;! Et après cela, un jugecapitaine vient te dire que ce n’est rien. Comme s’il voulaitinsinuer que je suis incapable de me mêler à une rixe. Mais,attends, aussitôt que je retournerai dans la vie civile, jeviendrai trouver ce voyou et je lui ferai voir si je suis incapablede me tabasser. Je prendrai un billet de chemin de fer pourKiralyhida, et je ferai ici un tapage tel que le monde n’en ajamais vu de pareil. Il faut que tous les pékins se cachent dansles caves, lorsqu’ils apprendront que je suis venu voir ce gredinde juge du conseil de guerre qui a eu l’audace de nousacquitter.
Au bureau, nos personnages furent expédiés enmoins de deux. Un sergent-major, dont la bouche était encoreluisante de graisse, remit à Chvéïk et à Voditchka leurs papiers,avec une mine sévère. Comme il était d’une province polonaise de laGalicie Occidentale, il orna son discours de quelques fleurs derhétorique de son dialecte&|160;: «&|160;Marekvium, glupi,Motmopsie&|160;», etc.
Ensuite ce fut un moment pathétique. Chvéïk etVoditchka durent se séparer, chacun d’eux devant retourner à sonrégiment. Chvéïk dit&|160;:
–&|160;Alors, mon vieux, une fois la guerrefinie, n’oublie pas de venir me voir. Tu me trouveras chaque soir,à partir de six heures, au «&|160;Calice&|160;» de la rue NaBoïchti.
–&|160;Bien sûr que j’y viendrai, lui réponditVoditchka. Est-ce qu’on rigole bien là-dedans&|160;?
–&|160;T’en fais pas, lui promit Chvéïk, on nes’embête pas. Mais si par hasard c’était trop calme, je compte surtoi pour animer la situation.
Ils se séparèrent, mais, au bout de quelquespas, Voditchka se retourna et cria à Chvéïk&|160;:
–&|160;Et n’oublie pas d’arranger d’ici là unebonne petite rigolade.
Et Chvéïk lui répondit&|160;:
–&|160;T’en fais pas, tu peux venir à coupsûr&|160;!
Ils se dirigèrent vers leur campementrespectif. Mais, alors qu’ils étaient déjà à une bonne distance, aucoin même de la deuxième allée des baraques, Voditchka se retournade nouveau et s’écria d’une voix tonnante&|160;:
–&|160;Eh&|160;! dis donc, Chvéïk, quellesorte de bière buvez-vous au «&|160;Calice&|160;»&|160;?
–&|160;C’est de la Velkopopovitz.
–&|160;Je croyais que c’était de laSmikhov&|160;! lui cria Voditchka, après avoir fait encore quelquespas.
–&|160;Il y a aussi des poules, lui confiaChvéïk, en mettant ses deux mains en porte-voix.
–&|160;Bien&|160;! Entendu&|160;! À six heuresdonc, après la guerre&|160;!
–&|160;Écoute, lui cria Chvéïk, viens plutôtvers six heures et demie, parce qu’il est possible que j’arrive enretard.
La voix de Voditchka retentit de plus en plusloin&|160;:
–&|160;Tu ne pourrais pas venir à six heuresjuste, car je n’aime pas beaucoup attendre.
–&|160;Bien, hurla Chvéïk, je tâcherai d’yêtre à six heures juste.
C’est de cette façon touchante que le bravesoldat Chvéïk se sépara de son bon vieux copain, le sapeurVoditchka.
Chapitre 4
LE DÉPART DE KIRALYHIDA POUR SOKAL
Le lieutenant Lukach marchait nerveusementdans le bureau de la 11e compagnie de marche. Ce bureauétait situé dans un coin du baraquement de la compagnie. C’était untrou noir, séparé du couloir par une cloison de planches. Unetable, deux chaises, une couchette en composaientl’ameublement.
Le sergent-major Vanek se trouvait égalementdans ce bureau. Il était en train de dresser la liste des prêts àpayer. C’était également lui qui était chargé de tenir lacomptabilité de la cuisine. Bref, le sergent-major Vanek n’étaitrien de moins que le ministre des finances de la compagnie. Ilpassait ses journées dans le bureau en question et il y couchaitégalement.
Près de la porte se tenait un gros fantassin,pourvu d’une de ces barbes monumentales que les vieux écrivains sesont amusés à décrire dans leurs contes populaires. C’était Baloun,le nouveau tampon du lieutenant Lukach. Dans le civil, il étaitmeunier au village de Krumlova.
–&|160;Je vous remercie pour le nouveaubrosseur que vous m’avez procuré, maugréa le lieutenant Lukach d’unton sarcastique, en s’adressant au sergent-major Vanek. C’est làtout ce que vous avez trouvé de mieux&|160;? Le premier jour que jel’ai envoyé au mess pour chercher mon dîner, ce cochon m’en abouffé la moitié en route.
–&|160;Je l’ai renversé par hasard, balbutiale gros bonhomme.
–&|160;Tu prétends avoir renversé la soupe etla sauce, mais comment t’es-tu arrangé également pour renverser lerôti de bœuf, puisque tu m’en as rapporté un tout petit bout. Etqu’as-tu fait des macaronis&|160;?
–&|160;Je les ai…
–&|160;Allons, pas d’histoire, tu les asmangés.
Le lieutenant Lukach proféra cette dernièrephrase avec un tel accent accusateur, que le géant barbu recula dedeux pas.
–&|160;J’ai demandé aujourd’hui, à la cuisine,ce qu’ils t’avaient donné pour mon dîner. Il y avait du potage auxKnédli, qu’en as-tu fait&|160;? Tu les as péchés un à un dans lacasserole et tu les as mangés. Il y avait également du bœuf grossel aux cornichons. J’aimerais bien savoir ce qu’il est devenu. Ila achevé sa carrière dans ta gamelle, bien entendu. Et sur deuxtranches de rôti, tu ne m’en as apporté que la moitié d’une. Et latarte aux fruits, où l’as-tu renversée&|160;? Dans ton estomac,espèce de cochon, de goinfre, de bête sauvage&|160;! Tu dis quetout ça est tombé au milieu de la route&|160;? Veux-tu me montrerl’endroit exact. Puis tu me racontes ensuite qu’un chien t’a suiviet que, à peine les tartes avaient-elles touché le sol qu’il les aavalées, Nom de Dieu&|160;! Si tu t’amuses à me raconter de tellesidioties je vais te flanquer une gifle qui te fera enfler la tête,elle deviendra aussi grosse que ton ventre insatiable. Et ce cochonose nier encore&|160;! Ne sais-tu pas que le sergent-major Vanekt’a vu au moment même où tu étais en train de bouffer la nourritureque tu étais chargé de m’apporter. C’est lui-même qui est venu medire&|160;: «&|160;Mon lieutenant, ce cochon de Baloun est en trainde dévorer votre dîner. Je viens de regarder par la fenêtre, et jele vois en train de se taper la cloche comme s’il n’avait rienmangé depuis huit jours&|160;». Seulement, écoutez-moi, chef, il nesuffit pas de dénoncer ce goinfre, il faudrait encore m’expliquercomment il se fait que vous l’ayez choisi pour mon ordonnance.N’auriez-vous pas pu trouver un autre homme que celui-ci&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que Baloun m’a paru être le plus honnête homme de lacompagnie. De plus, il est tellement crétin, qu’il ne peut pasapprendre le maniement d’armes. On craint de lui mettre un flingotdans la main, de peur qu’il ne fasse un malheur. Aux dernièresmanœuvres, il a failli brûler les yeux de son voisin, et pourtantles cartouches étaient chargées à blanc. C’est pour cette raisonque j’ai pensé qu’il était tout juste bon à faire un tampon.
–&|160;Et qui s’empressera à chaque repas dedévorer mon dîner, ajouta Lukach amèrement. Dis donc, voleur, as-tutellement faim que ça&|160;! Ta ration ne te suffit-ellepas&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que si quelqu’un a un morceau de croûte de reste, à lacantine, je cours après lui pour le lui demander. Mais tout celan’arrive pas à me rassasier. Qu’est-ce que vous voulez, ce n’estpas moi qui me suis fait. Je me dis toujours&|160;: Avec ça, tu enas assez. – Mais il n’y a rien à faire, j’ai beau manger, à la findu repas j’ai le même appétit qu’au commencement. Mon estomac ne melaisse pas une minute de répit. Il m’arrive de croire que je l’aiassez bourré et qu’il ne m’embêtera plus. Erreur&|160;! Il mesuffit de voir quelqu’un qui mange, ou de sentir l’odeur d’un plat,pour qu’il s’éveille et recommence de nouveau à réclamer sa pâtée.Je voudrais bouffer du fer pour le digérer plus lentement. Monlieutenant, je vous déclare avec obéissance que j’ai déjà demandéune double ration. Je suis allé également chez le major àBudeiovitz, qui m’a gardé à l’infirmerie durant trois jours, et ilne me donnait à becqueter qu’un peu de soupe matin et soir&|160;;«&|160;Tu apprendras, canaille, me disait-il, à avoir faim. Si tureviens me voir, la prochaine fois tu auras de mesnouvelles&|160;». Mon lieutenant, il n’est pas nécessaire que jevois des plats fins. Les mets les plus ordinaires me font monter lasalive à la bouche. Je vous en supplie, mon lieutenant, faitesqu’on me double ma ration. Si l’on n’a plus de viande à la cuisine,au moins que l’on me donne des pommes de terre, des fayots, despâtes, ou ce que bon leur semblera…
–&|160;Cela suffit&|160;! J’ai assez entendutes balivernes&|160;! répondit le lieutenant. Dites-moi, chef,avez-vous jamais rencontré pareille impudence&|160;! Cet oiseau-làme vole mon dîner et il me demande par-dessus le marché de luifaire doubler sa ration. Attends, mon vieux, je vais te fairedigérer. Chef, conduisez cet homme au caporal Wiederhofer, pourqu’on le mette au poteau bien ligoté, près de la cuisine, pendantdeux heures, au moment où l’on distribuera le goulach. Vous lelaisserez là jusqu’à ce que toutes les rations aient étédistribuées, et vous direz au chef de cuisine qu’il peut disposerde celle de Baloun.
–&|160;À vos ordres, mon lieutenant. Baloun,allons, oust&|160;!
Comme le géant se préparait à sortir, lelieutenant lui dit&|160;:
–&|160;Je te ferai passer ton appétit. Et laprochaine fois que tu mangeras mon dîner, je t’enverrai devant leconseil de guerre.
Un instant plus tard, Vanek pénétra dans lebureau en annonçant que Baloun était déjà solidement attaché aupoteau.
Le lieutenant lui répondit&|160;:
–&|160;Vous me connaissez, Vanek, et voussavez que je n’aime guère ce genre de spectacle, mais il m’estimpossible de faire autrement. Comment voulez-vous que jefasse&|160;? Vous connaissez le proverbe qui dit&|160;: Le chiengrogne lorsqu’on lui retire son os. Je ne veux pas avoir chez moide voleur. Et du reste, j’espère que le sévère châtiment infligé àBaloun servira d’exemple aux autres hommes de la compagnie. Nospoilus sont devenus intraitables depuis qu’ils ont appris qu’ilsallaient partir prochainement pour le front.
Le lieutenant en disant ces mots paraissaittrès abattu. Il continua tristement&|160;:
–&|160;Avant-hier, aux manœuvres de nuit, nousavons eu comme adversaires les élèves de l’École des aspirants. Lapremière escouade, envoyée en éclaireurs, marchait encore assezconvenablement, car c’était moi-même qui la conduisais&|160;; maisla seconde, chargée de protéger notre flanc gauche et de surveillerla sucrerie, s’est comportée comme une bande de touristes quirentrent d’une excursion. Ils ont tellement chanté et ils ont faitun tel tapage que cela s’entendait du bureau du colonel. Latroisième escouade, chargée de reconnaître la forêt, nous précédaitde dix minutes. Ces hommes marchaient avec leurs pipes et leurscigarettes allumées, de sorte que l’on voyait une quantité depoints brillants dans la nuit. Mais la plus extraordinaire detoutes, c’était sans doute la quatrième, qui formaitl’arrière-garde. Elle s’est présentée brusquement en face de nousde telle façon que nous avons cru avoir affaire aux adversaires etque nous nous sommes retirés devant elle. Et voilà&|160;! Ce sontde tels types qui composent notre 11e compagnie demarche dont j’assume le commandement. Que diable voulez-vous qu’ilsdeviennent lorsqu’il s’agira de batailles véritables&|160;!
Le lieutenant Lukach, machinalement, croisases mains en soupirant.
Vanek s’empressa de le tranquilliser.
–&|160;Ne vous en faites pas, mon lieutenant,pas la peine de vous casser la tête pour si peu. J’ai déjàaccompagné au front trois compagnies de marche. Les Russes nous lesont écrasées les unes après les autres. Nous avons dû retourner àl’arrière pour former de nouvelles compagnies, et aucune d’ellesn’était plus brillante que la vôtre, mon lieutenant. Mais la pireque j’aie vue, celle qui s’est dégonflée de la façon la pluslamentable, c’était la deuxième. Elle s’est rendue avec armes etbagages, avec tous ses sous-officiers et même ses officiers, àl’armée russe. Quant à moi, c’est par le plus grand des hasardsqu’on ne m’a pas ramassé. À ce moment-là, j’étais allé àl’intendance pour y chercher de la gnole et du pinard.
Et vous ne savez pas encore, mon lieutenant,qu’à cette même manœuvre de nuit dont vous me parlez, l’École desaspirants, qui avait pour tâche d’envelopper notre compagnie, s’estégarée jusqu’au lac de Néjider&|160;! Elle a marché toute la nuit,et ses éclaireurs ne se sont arrêtés que devant les marécages. Etpourtant ces hommes étaient sous la direction du capitaineSagner&|160;! Ils auraient sans doute poursuivi leur route jusqu’àSopron si, à l’aube, le soleil ne s’était levé. Vous n’ignorez pas,mon lieutenant, poursuivit Vanek, visiblement amusé par cesincidents, que le capitaine Sagner sera désigné pour commandernotre bataillon de marche. On avait d’abord songé à vous, monlieutenant, car vous êtes sans nul doute l’officier le plusqualifié pour cette tâche, mais, comme me l’a dit l’adjudantHegner, l’ordre est venu de la division et on ne peut pas allercontre.
Le lieutenant détourna son regard et allumaune cigarette. Il n’ignorait rien de tout cela et il étaitconvaincu qu’on avait commis une injustice à son égard. C’était ladeuxième fois que le capitaine Sagner le supplantait dansl’avancement, mais la discipline lui interdisait de dire ce qu’ilpensait à ce sujet.
–&|160;L’adjudant Hegner, poursuivit le chefd’un ton confidentiel, nous a raconté l’autre jour que le capitaineSagner, dans l’espoir d’obtenir quelque décoration, avait faitmassacrer ses compagnies l’une après l’autre, par les mitrailleusesserbes, bien qu’il fût évident que l’infanterie était incapable defaire quoi que ce soit, étant donné que les positions de l’ennemiétaient solidement retranchées. Quatre-vingts hommes seulementdemeurèrent de notre régiment. Le capitaine Sagner récolta mêmedans l’aventure une blessure à la main. De plus, à l’hôpital, ilfut atteint de dysenterie. Dès qu’il fut sur pied, il revint àBudeiovitz et hier, il a déclaré au mess des officiers, qu’il étaittrès heureux de retourner au front et qu’il ferait crever plutôttout le bataillon que de revenir de là-bas sans une distinctionhonorifique. Il râle d’autant plus que lors de cette fameuseattaque contre les Serbes, il a été sérieusement engueulé. Et cettefois, il se propose de se rattraper. Peu lui importe que lebataillon crève, pourvu qu’il soit nommé lieutenant-colonel&|160;!L’adjudant nous a raconté aussi, l’autre jour, que vous n’êtes pasen très bons termes avec le capitaine et qu’il s’empressera sansdoute de flanquer votre onzième compagnie dans le secteur où çabardera le plus.
Le chef ajouta en soupirant&|160;:
–&|160;Je suis d’avis que dans une guerre dugenre de celle ci, où il y a un front d’une pareille étendue et unequantité considérable de combattants, on arriverait à un meilleurrésultat plutôt par de savantes manœuvres que par des attaquesdésespérées. J’en ai vu un exemple à la 10e compagnie demarche, dans le défilé de Dukla. Tout allait pour le mieux, nousavions reçu l’ordre de cesser le feu, et nous nous tenions bienpeinards en attendant que les Russes avancent. Nous étionsadmirablement placés pour les cerner, lorsque nos voisins degauche, les «&|160;Mouches de fer&|160;», ont eu une telle frousseen voyant les Russes avancer qu’ils se mirent à tirer avant qu’onleur en donne l’ordre. Et, par leur faute, nous avons été obligésde battre en retraite. 120 hommes seulement sont revenus, lesautres s’étaient égarés chez les Russes. Si, à ce moment-là, unheureux hasard n’avait pas voulu que je me rende à la brigade pourfaire viser ma comptabilité, j’étais bon, moi aussi, comme laromaine. Ah&|160;! c’est terrible, mon lieutenant, de voirça&|160;! Les Russes se sont emparés des meilleures positions, etle capitaine Sagner…
–&|160;Fichez-moi la paix avec votre capitaineSagner, s’écria avec impatience le lieutenant Lukach. Je sais toutcela depuis longtemps. Quant à vous, ne vous imaginez pas que lorsdu prochain engagement vous irez chercher du rhum ou du pinard, oufaire viser votre comptabilité. On m’a déjà dit que vous buviezcomme une éponge, et il suffit en effet de regarder votre nez rougecomme une lanterne, pour se rendre compte qu’on ne vous a pascalomnié.
–&|160;Ça, c’est un souvenir des Carpathes,mon lieutenant, répondit le chef. Nos tranchées étaient creuséesdans la neige, et pas moyen de faire du feu&|160;; sans le rhum,nous serions tous morts, gelés. Je me suis débrouillé pour fournirde la gnole à mes hommes et, de cette façon, j’en ai sauvé desquantités. Seulement, un jour nous avons reçu l’ordre de ne pasenvoyer en patrouille les hommes qui avaient le nez rouge.
–&|160;Tout ça, ce sont des boniments,répondit le lieutenant. Et, d’ailleurs, l’hiver est finimaintenant.
–&|160;La gnole fait du bien dans n’importequelle saison, observa le chef. C’est elle qui maintient le moralde nos troupes. Pour un litre de vin ou pour un quart de rhum, leshommes se battraient comme des lions. Quel est encore cet idiot quifrappe à la porte&|160;? Il ne sait donc pas lire. J’ai pourtantécrit en toutes lettres&|160;: Entrez sans frapper&|160;!
Le lieutenant vit tout à coup la porte quis’ouvrait avec lenteur et, tout doucement, le brave soldat Chvéïkpassa sa tête dans l’entrebâillement, en faisant le salutréglementaire.
Ce salut rehaussait son expression candide etheureuse. Le lieutenant Lukach, affolé, tourna de grands yeux dansla direction du brave soldat Chvéïk, cependant que celui-ci leregardait avec tendresse.
C’est sans doute de ce même regard attendri etconfiant que l’enfant prodigue contempla son père, en train defaire rôtir un mouton en l’honneur de son retour.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je suis de nouveau à votre service, lui annonçaChvéïk d’une voix joyeuse.
Le lieutenant sursauta d’horreur sur sachaise. Depuis le moment où le colonel Schroder lui avait annoncéque Chvéïk était de nouveau affecté à la compagnie, il essayait dese préparer à ce retour avec courage. Cependant, comme les joursavaient passé sans qu’il vînt, Lukach avait peu à peu reprisconfiance.
–&|160;Pourvu, mon Dieu, qu’il ne reviennepas&|160;! songeait-il chaque matin à son réveil.
Et voici que, tout à coup, l’entrée sisympathique de Chvéïk avait réduit à néant tous ses espoirs.
Le brave soldat Chvéïk se tourna ensuite versle chef, et lui remit, avec un sourire amical, les papiers qu’ilretira des profondeurs de sa capote.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monadjudant, que je dois vous remettre ces papiers qu’on m’a donnés aubureau du régiment. Ils concernent mes prêts et ma nourriture…
Chvéïk se réhabituait très rapidement à ladouce atmosphère de la onzième compagnie. À le voir et àl’entendre, on eût cru qu’il avait toujours été un des meilleurscamarades de Vanek. Celui-ci crut bon de tenir Chvéïk à distancerespectueuse, en lui répondant avec sécheresse&|160;:
–&|160;Mettez ça sur mon bureau.
–&|160;Je vous prierai maintenant, dit lelieutenant Lukach au chef, de me laisser seul un instant avecChvéïk.
Vanek se retira alors et colla son oreillecontre la porte pour écouter ce qui allait se dire dans le bureau.Cependant, durant les premières minutes de son attente, il en futpour ses frais d’espionnage, car Lukach et Chvéïk gardèrent unsilence de mort. Ils se contentaient de se contempler l’un etl’autre. Lukach dardait son regard sur Chvéïk, comme s’il avaitvoulu l’hypnotiser, pareil à un coq qui fixe une poule avant de luisauter sur le dos. Chvéïk fixait sur son lieutenant un regardcandide et bon, qui paraissait vouloir dire&|160;: nous sommes unisencore une fois, mon amour de lieutenant, et rien ne pourra plusnous séparer.
Mais en voyant que Lukach gardait le silence,l’expression du regard de Chvéïk devint encore plus tendre. Touteson attitude exprimait clairement&|160;: Mais vas-y donc, monbien-aimé, parle, dis ce que tu as sur le cœur.
Le lieutenant Lukach se décida à rompre cesilence.
–&|160;Je suis charmé de vous revoir, dit-ild’un air railleur, vous êtes bien gentil d’être venu…
Mais à ce moment-là, il ne put se contenir ettoute la colère amassée en lui, durant les jours précédents, fitexplosion. Il donna un terrible coup de poing sur la table, avecune telle violence que l’encrier sauta en l’air et macula la listedes prêts.
En même temps Lukach s’était levé d’un bondet, se plaçant devant Chvéïk, il lui hurla dans la figure, toutsecoué de rage&|160;:
–&|160;Animal&|160;!
Puis il se mit à marcher avec fureur dans sonbureau.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, dit Chvéïk, lorsqu’il vit que Lukach ne cessait pas dese promener et de jeter à droite et à gauche, rageusement, lesboules de papier qu’il roulait dans ses mains nerveuses, que j’aibien remis la lettre, sans faute, ainsi que vous me l’aviezrecommandé. J’ai même vu madame Kakonyi, et je vous assure quec’est une bien jolie personne. Il est vrai que quand je l’ai vue,elle avait un peu pleuré…
À ce moment-là, Lukach se jeta brusquement surla couchette de Vanek, en hurlant&|160;:
–&|160;Quand donc en aurai-je fini avec vous,Chvéïk&|160;?
Mais celui-ci continua, comme s’il n’avaitrien entendu&|160;:
–&|160;Cette histoire de lettre, évidemment, aentraîné quelques petites histoires. Et il se hâta d’ajouter&|160;:Mais j’ai tout pris sur ma conscience. Comme on ne voulait pascroire que j’avais eu de la correspondance avec madame Kakonyi,j’ai avalé votre lettre à l’interrogatoire pour la fairedisparaître. Puis, je suis tombé, par un hasard que je ne peux pasm’expliquer, au milieu d’une petite bagarre. Je me suis débrouillé,là-dedans aussi, le plus gentiment du monde, et le conseil deguerre lui-même m’a reconnu innocent, puisque l’instructionconcernant mon affaire s’est terminée par un non-lieu. Je n’ai étéau bureau du régiment que pendant quelques minutes. Monsieur lecolonel m’a engueulé un tout petit peu, pour la forme, puis il m’aordonné de me présenter de nouveau chez vous, comme ordonnance, etil m’a dit de vous dire qu’il vous invite à venir immédiatementdans son bureau, pour une affaire de la compagnie de marche. Il y aplus d’une demi-heure de cela, car le colonel ignorait sans douteque l’on allait me traîner encore dans les bureaux de lacomptabilité, où j’ai dû attendre. Vous savez, mon lieutenant, toutest tellement confus et désordonné chez eux, qu’il y aurait de quoidevenir dingo…
Lorsque Lukach apprit qu’il était attendu parle colonel depuis plus d’une demi-heure, il dit à Chvéïk ens’habillant en hâte&|160;:
–&|160;Nom de Dieu&|160;! vous m’avez flanquéencore dans de beaux draps&|160;!
Il dit cela d’un ton si désespéré que Chvéïkcrut bon de le consoler, en lui criant&|160;:
–&|160;Ne vous en faites pas, mon lieutenant,le colonel vous attendra&|160;; il n’a pas autre chose à faire…
Dès que Lukach se fut éloigné, l’adjudant-chefVanek pénétra dans le bureau.
Chvéïk s’était assis sur une chaise et s’étaitmis à tisonner le poêle, tout en jetant dans le foyer des pelletéesde charbon. Le bureau ne tarda pas à être envahi par la fumée.Chvéïk, sans accorder la moindre attention à Vanek, continua às’amuser à ce petit jeu, pendant que l’adjudant le regardait,scandalisé. Finalement, le chef perdit patience et, repoussant d’uncoup de pied la porte du poêle, il intima à Chvéïk l’ordre deficher le camp.
–&|160;Mon adjudant, répondit Chvéïk avecdignité, j’ai l’honneur de vous faire savoir que je ne peux pasexécuter vos ordres, car je suis affecté ici par ordre supérieur.Je suis ordonnance à la onzième compagnie, ajouta-t-il fièrement.Le colonel Schroder, lui-même, m’a désigné pour être l’ordonnancedu lieutenant Lukach. J’ai toujours été son tampon, mais, par monintelligence héréditaire, j’ai attiré sur moi l’attention de messupérieurs. Nous nous connaissons bien, le lieutenant Lukach etmoi. Que faisiez-vous, mon adjudant, dans la vie civile&|160;?
Le ton familier de Chvéïk surprit à tel pointl’adjudant, que celui-ci répondit avec simplicité, comme s’il avaitété un subordonné de l’ordonnance&|160;:
–&|160;Je suis le droguiste Vanek, deKralup.
–&|160;J’ai fait, moi aussi, un petit boutd’apprentissage chez un droguiste, dit Chvéïk, chez un certainKokochka au Perchtine. C’était un drôle de type. Il m’arrivad’allumer par erreur, dans sa cave, un tonneau d’essence, et toutela boutique s’est mise à flamber. Alors, il m’a balancé, et leSyndicat de la droguerie aussi. Pour cette raison, à cause d’unidiot de tonneau d’essence, je n’ai pas pu terminer monapprentissage. Est-ce que vous fabriquez, vous aussi, des droguespour les vaches&|160;?
Vanek répondit non de la tête.
–&|160;Chez nous, on en fabrique avec desimages bénies, car notre chef Kokochka était un homme très pieux,et il avait lu quelque part que saint Pérégrine avait guéri desvaches. Donc, il a fait imprimer quelque part, à Smikhov, despetites images qui représentaient saint Pérégrine, puis il les afait bénir au couvent de Memaus pour la somme de deux centscouronnes. Et ensuite il en a enveloppé les paquets de droguesdestinées aux bestiaux. Il suffisait de verser cela, après l’avoirfait dissoudre auparavant dans un peu d’eau chaude, dans lamangeoire de la bête malade, et de réciter une prière à saintPérégrine, rédigée par M.&|160;Tauchen, notre commis. Mais il fautque je vous raconte l’histoire de cette prière&|160;: Notre vieuxKokochka appela un soir M.&|160;Tauchen et lui ordonna de rédiger,avant le lendemain matin dix heures, c’est-à-dire avant la venue dupatron, une belle petite prière rimée, afin qu’elle soit prêteavant midi pour qu’on puisse la donner à l’imprimeur, car ilprétendait que les vaches attendaient impatiemment leur prière. Illui avait donné à choisir, ou il ferait la prière en vers et ilaurait pour cela deux couronnes en plus de sa semaine, ou ilrefuserait de faire la prière et il serait foutu à la porte.Monsieur Tauchen veilla toute la nuit, mais bien qu’il mît soncerveau à la torture l’inspiration ne venait pas. Le lendemainquand il ouvrit la boutique il avait les yeux cernés et les cheveuxen broussaille, il avait même oublié comment s’appelait le saintdes vaches&|160;; alors Ferdinand, notre garçon de course, vint àsa rescousse. Il était très calé dans les affaires de laboutique.
Il fauchait les pigeons au grenier, il nous aappris aussi comment il fallait s’y prendre pour ouvrir la caissedu patron et un tas de choses très utiles dans le commerce. Donccelui-là s’est efforcé de tirer M.&|160;Tauchen de l’embarras.«&|160;Laissez-moi faire et ne vous en faites pas&|160;» qu’il luidit. M.&|160;Tauchen qui était très content qu’on le tire de cettetriste situation envoya aussitôt chercher de la bière pour lui. Etavant même qu’on ait apporté le demi, notre Ferdinand avait déjàterminé son poème qu’il nous a lu&|160;:
Je viens du haut du ciel,
Mon remède est comme du miel.
Veaux et vaches, je vous le dis,
Par moi se guérissent des maladies.
Les potions de Kokochka
Chassent les maux
N’en doutez pas.
Puis, après avoir avalé son premier demi, ils’est remis au travail et il a achevé son poème en cinq sec. Il aajouté&|160;:
C’est le grand et bon saint Pérégrine
Qui se disait que ça le chagrine
De voir les vaches si sympathiques
Souffrant de maux et de coliques.
Achetez donc les poudres du saint homme
Cela ne coûte que deux couronnes.
Bon saint, ayez pitié des bestiaux
Priez pour nous et pour nos agneaux.
Lorsque M.&|160;Kokochka est arrivé, Tauchenl’a suivi dans son cabinet et, en sortant, il nous a montré deuxpièces de deux couronnes que le patron lui avait données au lieud’une, ainsi qu’il avait été convenu. Tauchen voulait partager lebénéfice avec Ferdinand, mais notre Ferdinand, à la vue del’argent, a été pris d’un accès d’orgueil. Il a répondu qu’ondevait lui donner tout ou qu’il n’accepterait rien. Alors,M.&|160;Tauchen glissa les deux pièces dans sa poche et ne donnarien du tout. Puis il m’a appelé dans le fond de la boutique et ilm’a collé une baffe, en me déclarant que j’en aurais encore unecentaine si j’osais dire, à qui que ce soit, que ce n’était pas luiqui avait composé les prières. «&|160;Si M.&|160;Kokochka te faittémoigner, qu’il m’a dit, tu n’auras qu’à dire que Ferdinand n’estqu’un menteur.&|160;»
Puis il m’a demandé de prêter serment, ce quej’ai fait devant un tonneau de vinaigre. Mais notre Ferdinand, quila trouvait mauvaise, s’est mis à se venger sur les drogues auxvaches. Comme nous préparions les remèdes pour les bestiaux augrenier, Ferdinand ramassait toutes les crottes de souris qu’iltrouvait et il les y mêlait. Puis il a ramassé le crottin deschevaux dans la rue, il l’a fait sécher et l’a broyé dans unmortier et il l’a mélangé dans la drogue recommandée par saintPérégrine. Mais cela ne lui a pas suffi. Il a pissé dedans, etautre chose aussi, et avec tout cela il a fabriqué une sorte depâte.
À ce moment le téléphone se mit à sonner. Lechef prit le récepteur et le raccrocha un instant après enjurant&|160;: On m’appelle d’urgence au régiment. Tout desuite&|160;! grogna-t-il. Je n’aime pas cette hâte suspecte.
Chvéïk demeura seul. Une minute après ledépart du chef le téléphone se mit à sonner de nouveau. Chvéïk seprécipita vers l’appareil.
«&|160;Vanek&|160;? il vient de partir àl’instant… Au bureau du régiment. Qui est-ce qui me parle&|160;?Ici&|160;! c’est l’ordonnance de la 11e compagnie. Etqui est-ce qui me parle&|160;? L’ordonnance de la12e&|160;? bravo&|160;! salut, cher confrère&|160;? Monnom&|160;? Chvéïk. Et toi, comment tu t’appelles&|160;?Braun&|160;! très bien. Tu ne serais pas par hasard un parent duchapelier de la rue Boberjny, à Karlina&|160;? Non, tu ne leconnais pas&|160;? Moi non plus. Il m’est arrivé de passer entramway devant sa boutique et c’est pour cette raison que je merappelle de son enseigne. Quoi de nouveau&|160;? Je n’en sais rien.Quand est-ce que nous partons&|160;? Je n’ai entendu parler d’aucundépart. Où diable devons-nous partir encore&|160;?
–&|160;Mais au front, espèced’abruti&|160;?
–&|160;Je n’en ai point entendu parler.
–&|160;Alors, mon vieux, tu es une drôled’ordonnance. Tu ne sais même pas si ton sous-lieutenant…
–&|160;Chez nous, il n’y a pas plus desous-lieutenant que de…
–&|160;C’est du pareil au même. Alors, tu nesais pas si ton lieutenant a été appelé chez le colonel&|160;?
–&|160;Si, il y est allé tout à l’heure…
–&|160;Eh bien, voici, notre commandant estaussi chez le colonel&|160;; je viens de parler à son ordonnance.Tous ces va-et-vient ne me disent rien qui vaille. Tu ne sais pasnon plus si on prépare quelque chose à la fanfare durégiment&|160;? Non&|160;? Fais donc pas l’idiot&|160;! Votre chefa déjà reçu son avis de départ&|160;? Combien d’hommes avez-vous àla compagnie&|160;?
–&|160;Je n’en sais rien.
–&|160;Et, espèce d’imbécile, tu as peur queje te bouffe ton nez&|160;?
Chvéïk entendit, à ce moment-là, soninterlocuteur dire à quelqu’un qui se trouvait à côté de lui&|160;:«&|160;Tiens, écoute, toi aussi. Ils ont un drôle de type commeordonnance à la 11e.
Puis la conversation se poursuivitainsi&|160;:
–&|160;Allo&|160;! tu dors&|160;? maisréponds-moi donc&|160;! Donc, tu ne sais encore rien&|160;? Sansblague&|160;? Le chef ne vous a-t-il pas dit que vous deviez allerchercher des conserves aux magasins&|160;? Que tu es nouille, monvieux frère&|160;! Quoi&|160;? cela ne te regarde pas&|160;?
On entendit des rires à l’extrémité dufil.
–&|160;Non&|160;? Mais tu es dingo&|160;!Enfin, si tu apprends quelque chose à ce sujet, téléphone tout desuite à la 12e. Entendu&|160;? Un mot encore&|160;!…D’où est-ce que tu viens&|160;?
–&|160;De Prague.
–&|160;Alors, mon gars, tu devrais être plusdébrouillard. Et dis donc&|160;: quand est-ce que ton chef est alléchez le colon&|160;?
–&|160;On vient de l’appeler.
–&|160;Ah&|160;! tu vois, ils sont en train decomploter quelque chose. Et toi tu n’en sais rien. Tu es là commeune nouille.
–&|160;Je suis sorti de taule il y a à peineune heure pour venir au Conseil de guerre.
–&|160;Ah&|160;! si c’est comme ça… çachange&|160;! Plus tu m’en diras&|160;! Je viendrai tout à l’heurete voir. Salut&|160;!
Chvéïk était en train d’allumer sa pipelorsque le téléphone recommença à sonner.
–&|160;Que le diable vous emporte avec votretéléphone&|160;! s’écria Chvéïk. Si vous croyez que je vais passermon temps à bavarder.
Mais le téléphone continua à retentir avec unetelle insistance que Chvéïk perdit patience et décrocha à nouveaule récepteur.
–&|160;Qui est là&|160;? Ici&|160;? Chvéïk,ordonnance de la 11e compagnie.
–&|160;Qu’est-ce que vous fichez là&|160;?répondit une voix que Chvéïk reconnut comme étant celle de sonlieutenant. Où est Vanek&|160;? Appelez-moi tout de suite Vanek autéléphone.
Chvéïk, tout ému d’entendre la voix de sonlieutenant, répondit&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant…
–&|160;Écoutez, Chvéïk, je n’ai pas de temps àperdre avec vous. Les communications téléphoniques, surtoutlorsqu’elles sont militaires, doivent être brèves et claires, aussije vous dispense de vos préambules, de vos&|160;: je vous déclareavec obéissance, etc., je vous demande simplement, soldat Chvéïk,si vous pouvez dire à Vanek de venir immédiatement autéléphone&|160;?
–&|160;Je ne l’ai pas à portée de ma main, monlieutenant. Je vous déclare avec obéissance qu’il vient d’aller aubureau du régiment, il n’y a même pas un quart d’heure.
–&|160;Chvéïk, Chvéïk, quand apprendrez-vous àvous exprimer brièvement&|160;! Attendez que je rentre et vousaurez de mes nouvelles&|160;! Maintenant, écoutez bien ce que jevais vous dire. Vous m’entendez bien, n’est-ce pas&|160;? Je neveux pas avoir avec vous une de ces fameuses explications dont vousavez le secret, je ne veux pas que vous me racontiez que vousn’avez pas compris ce que je vous avais dit parce que ma voix étaitbrouillée ou d’autres histoires de ce genre. Aussitôt que vousaurez raccroché l’appareil…
Là, Chvéïk n’entendit plus rien. Le téléphonesonna de nouveau. Chvéïk s’empara de la manivelle et se mit àtourner à toute vitesse. Lorsqu’il approcha son oreille durécepteur ce fut pour recevoir une bordée d’injures&|160;: idiot,voyou, fripouille, pourquoi interrompez-vous notreconversation&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que vous m’avez dit de raccrocher…
–&|160;Dans une heure, je suis de retour. Jevous réglerai votre compte&|160;! En attendant, vous allez mechercher immédiatement un sergent de la compagnie, le sergentFuchs, dites-lui qu’il prenne dix hommes avec lui et qu’il sedépêche d’aller chercher des conserves au magasin du régiment.Avez-vous compris&|160;? Répétez ce que vous devez faire&|160;?
–&|160;Aller chercher avec dix hommes de lacompagnie des conserves au magasin.
–&|160;Enfin&|160;! pour la première fois,vous avez un peu de mémoire&|160;! Je vais téléphoner à Vanek pourqu’il aille également contrôler les comptes. S’il venait tout desuite à la compagnie dites-lui qu’il n’a qu’à courir au magasin. Etmaintenant vous pouvez raccrocher.
Chvéïk s’empressa de sortir et de se mettre àla recherche du sergent. Il trouva un groupe de sous-officiersrassemblés à la cuisine où ils étaient en train de manger. En faced’eux se trouvait le pauvre Baloun. Ils l’avaient solidementattaché à un poteau, mais pas aussi cruellement cependant que ladiscipline l’aurait prescrit. Un des cuisiniers lui avait placédans la bouche un os auquel adhérait encore un peu de viande, et lepauvre diable faisait des efforts comiques pour ne pas le laisseréchapper.
–&|160;Lequel d’entre vous est le sergentFuchs&|160;? demanda Chvéïk.
Le sergent ne daigna même pas répondrelorsqu’il vit que c’était un simple soldat qui était à sarecherche.
–&|160;Je demande, s’écria Chvéïk, qui estparmi vous le sergent Fuchs&|160;?
Fuchs se leva.
–&|160;D’abord, lui dit-il, on ne ditpas&|160;: lequel d’entre vous est le sergent Fuchs&|160;? Maisbien&|160;: je vous déclare avec obéissance, messieurs lessous-officiers, que je voudrais parler à monsieur le sergent Fuchs…Si dans ma section quelqu’un s’avisait de ne pas dire&|160;: jevous déclare avec obéissance, je lui balancerais immédiatement unede ces raclées dont il garderait le souvenir.
–&|160;Ne vous emballez pas, sergent, réponditChvéïk, mais ramassez en vitesse dix hommes et filez avec eux aupas de course au magasin du régiment. C’est pour aller chercher lesinge.
Le sergent Fuchs, suffoqué par cet ordre donnéd’une voix impérative, ne put que répondre&|160;:
–&|160;Quoi&|160;?
–&|160;Il n’y a pas de quoi, répondit Chvéïk.Je suis ordonnance à la compagnie de marche et je viens de recevoircet ordre de la part du lieutenant Lukach. Il m’a dit&|160;:trouvez un sergent et dix hommes et ordonnez-leur de se rendre aupas de course au magasin. Si vous ne voulez pas obéir, c’est bien,je m’en retourne au téléphone. Le lieutenant vous a désigné pourcette mission et vous devez la remplir. Inutile de me bassinerdavantage. Une conversation téléphonique, comme disait lelieutenant Lukach, doit être brève et exacte. Si l’on ordonne ausergent Fuchs d’aller chercher du singe il n’a qu’à se grouiller.Une communication téléphonique, ce n’est pas comme une causerie oùl’on invite les copains à dîner. En temps de guerre, chaque minutede retard est un crime. Si le sergent Fuchs ne veut pas segrouiller, vous n’avez qu’à me le dire, et je vais lui régler soncompte, m’a dit mon lieutenant. Mais oui, mon vieux, vous neconnaissez pas encore mon lieutenant.
Ayant achevé sa harangue, Chvéïk promena unregard triomphal sur le groupe des sous-officiers, visiblementahuris par cette énergique intervention.
Fuchs grogna quelques parolesincompréhensibles et s’éloigna à toute vitesse. Chvéïk luicria&|160;:
–&|160;Alors, je peux téléphoner au lieutenantque tout est en ordre&|160;?
–&|160;Je vais immédiatement au magasin avecles dix hommes, répondit Fuchs en disparaissant sous le portaild’une baraque.
Chvéïk quitta sans un mot le groupe dessous-officiers qui le regardèrent s’éloigner d’un airconsterné.
–&|160;Je crois que ça va barder, remarqua lepetit caporal Blasek. Il ne nous reste plus qu’à boucler nosmalles.
Lorsque Chvéïk fut de retour au bureau de la11e compagnie, il fit une deuxième tentative pourallumer sa pipe, mais il n’en eut pas le temps. Le téléphoneretentit et la voix du lieutenant Lukach se fit entendre au bout dufil&|160;:
–&|160;Nom de Dieu&|160;! où diableétiez-vous, Chvéïk&|160;? C’est la troisième fois que je sonne etvous n’étiez pas au téléphone.
–&|160;Je viens de transmettre vos ordres auxsous-officiers, mon lieutenant.
–&|160;Est-ce qu’ils sont déjàpartis&|160;?
–&|160;Mais bien sûr qu’ils sont partis. Maisje ne sais pas s’ils sont déjà arrivés. Voulez-vous que j’aillevoir&|160;?
–&|160;Avez-vous trouvé le sergentFuchs&|160;?
–&|160;Mais oui, mon lieutenant. Et toutd’abord il s’est mis à m’engueuler&|160;: «&|160;Quoi, qu’il medit…&|160;» Mais après que je lui ai expliqué que les conversationstéléphoniques doivent être brèves…
–&|160;Pas de bavardages, Chvéïk. Vanek n’estpas encore de retour&|160;?
–&|160;Non, mon lieutenant.
–&|160;Nom de Dieu, ne gueulez pas si fortdans le téléphone. Vous ne savez pas où diable peut se trouver cesacré Vanek&|160;?
–&|160;Non, je ne sais pas où ce sacré Vanekpeut se trouver…
–&|160;Je pense qu’il est à la cantine. Allezvoir immédiatement à la cantine, et si vous le trouvez, dites-luiqu’il doit se rendre immédiatement au magasin. Ah&|160;! encore unechose&|160;: dites au caporal Blasek qu’il doit immédiatementrelâcher Baloun et me l’envoyer. Bien, maintenant,raccrochez&|160;!
Chvéïk se trouva alors en face d’une tâcheassez compliquée. Lorsqu’il eût trouvé le caporal Blasek et qu’illui eût transmis l’ordre du lieutenant, le caporal grogna d’un airmécontent&|160;:
–&|160;Ah&|160;! les cochons ont déjà lafrousse&|160;! Ils foirent dans leur culotte…
Chvéïk assista à la délivrance de Baloun etfit quelques mètres avec lui.
Le géant considérait Chvéïk comme son sauveuret il lui promit de partager avec lui les colis qu’il recevrait deson patelin.
–&|160;Chez nous, on va tuer les cochons,dit-il avec mélancolie. Aimes-tu le boudin au lard ou sanslard&|160;? Dis-le moi carrément, car je vais écrire ce soir même àla maison. Mon cochon pèse environ 15o kilogs, il a une gueule debouledogue, cette race est la meilleure. Si tu voyais comme il estgras, mon vieux&|160;! Il en aura du lard&|160;! Lorsque j’étaisencore à la maison, c’était moi-même qui préparais les saucisses etj’en bouffais à m’en faire péter la peau du ventre. Notre cochon del’année dernière pesait 160 kilogs, c’était une bêtemagnifique.
Il serra avec enthousiasme la main de Chvéïken ajoutant&|160;:
–&|160;Je l’ai nourri moi-même avec despatates, et c’était un véritable plaisir que de voir la rapiditéavec laquelle il grossissait. J’ai mis les jambons dans du sel,puis j’en ai fait rôtir un beau morceau. Le rôti de cochon avec dela choucroute, il n’y a rien de meilleur, et si en le bouffant tupeux boire de la bonne bière, ah&|160;? mon vieux…
Et il ajouta avec mélancolie&|160;:
–&|160;On était si heureux autrefois, etmaintenant avec cette saloperie de guerre…
Le géant barbu soupira, plein de tristesse, etse dirigea vers le bureau du régiment, cependant que Chvéïkcontinuait son chemin en marchant sous la double rangée de vieuxtilleuls qui conduisait à la cantine.
Le sergent-major Vanek, comme le lieutenantLukach l’avait prévu, se trouvait en face, à la cantine, et ilétait en train de raconter à un adjudant, au moment où Chvéïkpénétra, les bénéfices qu’il réalisait avant la guerre en vendantde la couleur.
Son interlocuteur était complètement noir. Lemême matin il avait reçu la visite d’un gros fermier, dont le filsfaisait son service militaire sous les ordres de l’adjudant. Pourcette raison, le fermier lui avait graissé la patte et lui avaitpayé à boire et à manger en ville.
Il regardait devant lui avec des yeux vagues,sans comprendre ce que son interlocuteur lui disait. Ces histoiresde couleurs le laissaient complètement indifférent. Il était plongédans ses réflexions et il se mit à balbutier tout à coup quelquesmots où il était question d’un chemin de fer qui passait parTrebone et Telkhrimov.
Lorsque Chvéïk franchit le seuil de la porte,Vanek était en train d’expliquer à l’adjudant de quelle façon onfabriquait un pot de couleur. Et l’adjudant lui répondit&|160;:
–&|160;Naturellement, il est mort sur lechemin du retour. Et voilà tout ce qu’on a de lui… ces quelqueslettres…
Lorsqu’il aperçut Chvéïk, il le confondit avecun personnage qu’il détestait, et il se mit à le bombarder dejurons sonores.
Mais le brave soldat Chvéïk, sans accorder lamoindre importance à ses paroles, se dirigea directement sur Vaneket lui déclara&|160;:
–&|160;Sergent, vous devez filer à toutevitesse au magasin. Le sergent Fuchs vous y attend avec dixtrouffions pour la corvée de singe. Le lieutenant Lukach a déjàtéléphoné plusieurs fois à ce sujet.
Vanek éclata d’un large rire.
–&|160;Croyez-vous que je suis dingo,s’écria-t-il, je me ridiculiserais pour le restant de mes jours, sije vous écoutais. Mon cher ami, nous avons du temps devant nous.Rien ne presse. Lorsque le lieutenant Lukach aura préparé le départpour le front d’autant de compagnies que moi, alors il sauracomment s’y prendre. On m’a déjà ordonné, au bureau du colonel, deme préparer pour le départ de demain et d’aller au pas de coursepréparer les victuailles. Eh bien, savez-vous ce que j’aifait&|160;? Je me suis rendu tranquillement à la cantine pour boireun quart de rouge. Je trouve qu’on est beaucoup mieux iciqu’ailleurs. Le singe ne se sauvera pas des boîtes dans lesquellesil est enfermé, et le magasin restera également à sa place. Jeconnais beaucoup mieux le magasin que le lieutenant Lukach peut leconnaître, et je sais aussi toutes les balivernes qu’on débite auxconférences d’officiers chez le vieux. C’est une lubie du colonelque le magasin soit plein de conserves. Or, dans son magasin à lui,il n’en a jamais eu en réserve. Il s’en est procuré à la dernièreminute. Ils peuvent dire ce qu’ils voudront à la conférence ducolonel, nous autres, on s’en fiche. Pas une compagnie de marchen’a reçu du singe pour sa route.
Puis se tournant vers l’adjudant ilajouta&|160;:
–&|160;Pas vrai, mon vieuxparapluie&|160;?
Mais celui-ci s’était déjà endormi, et ildevait être en train de rêver, car il répondit&|160;:
–&|160;Et, tout en marchant… il tenait à lamain un vieux parapluie…
–&|160;Vous feriez mieux, dit Vanek à Chvéïk,de laisser tomber tout cela. On nous dit aujourd’hui que lerégiment doit partir demain, mais n’en croyez rien. Commentvoulez-vous partir s’il n’y a pas de wagons disponibles&|160;? Or,on a téléphoné à la gare en ma présence&|160;; ils n’ont pas unseul wagon pour nous. Cela s’est déjà produit, il n’y a pas trèslongtemps, nous avons dû attendre à la gare deux jours durant, etc’est seulement après trois jours d’attente qu’on a eu pitié denous et que l’on nous a envoyé un train pour nous emmener. Mais, àce moment-là, personne ne savait où nous devions aller. Le colonellui-même n’en savait rien. Nous avons ainsi traversé toute laHongrie sans savoir si nous devions aller sur le front russe ou surle front serbe. À chaque station que nous traversions, nosofficiers téléphonaient à l’état-major de la division. Mais partoutnous restions en carafe. Finalement, pour se débarrasser de nous,on nous a flanqués au défilé de Dukla, où les Russes nous onttellement aplatis qu’il ne nous resta pas autre chose à faire quede rentrer à l’intérieur pour nous reformer de nouveau. Donc, pasd’alerte inutile. Demain il fera jour. Et surtout, ne nousemballons pas. Donnez-moi une autre chopine, commanda-t-il aucantinier. Le pinard est particulièrement excellent ces temps-ci,poursuivit Vanek, sans apporter la moindre attention à ce quel’adjudant racontait dans son rêve&|160;:
–&|160;Croyez-moi, monsieur, disait celui-ci,je n’ai pas encore eu grand’chose dans ma vie… Votre questionm’étonne fort…
–&|160;À quoi bon se faire de la bile à causede ce départ, poursuivit Vanek&|160;; lorsque la première compagniede marelle a fiché le camp, tout a été prêt en deux heures. Vousferiez beaucoup mieux de vous asseoir à côté de moi.
Un combat terrible se disputa l’âme deChveik.
–&|160;Je ne peux pas, répondit le bravesoldat Chvéïk, ayant vaincu après un effort surhumain la tentation.Il faut que je rentre immédiatement au bureau de la compagnie, caron pourrait me demander au téléphone…
–&|160;Allons donc, mon ami, ne vous en faitespas. Ce n’est pas la peine de se fatiguer les méninges pour leservice. Je ne connais rien de plus ennuyeux qu’une ordonnance quiveut faire du zèle.
Mais Chvéïk était déjà sur le seuil de laporte et se dirigeait à toute vitesse au bureau de sacompagnie.
Vanek resta donc seul, car on ne peut vraimentpas dire que l’adjudant était en état de tenir compagnie à qui quece soit. De plus en plus éloigné du monde réel, il continuait àdébiter des choses incompréhensibles, en caressant de ses doigtstremblants la bouteille qui se trouvait devant lui.
–&|160;J’ai souvent traversé ce village,disait-il, moitié en tchèque et moitié en allemand, sans me soucierde son existence. J’ai passé mes examens en six mois et j’ai mêmepréparé mon doctorat. Hélas&|160;! si je ne suis plus qu’une ruine,c’est par votre faute, Louise&|160;! Est-il vrai qu’ils vont êtrepubliés en peau de chagrin… Mais il y a toujours quelqu’un, ici,qui ne s’en souvient pas…
Le sergent-major, sans s’occuper de ce quedisait son compagnon, tambourinait une marche sur la table. Tout àcoup la porte s’ouvrit et Jurayda, le chef de la cuisine du mess,entra et s’affaissa sur une chaise.
–&|160;Nous avons reçu l’ordre, balbutia-t-il,d’aller chercher du cognac pour le voyage et comme nous n’avionspas de bonbonnes vides, nous avons été obligés de vider celles quicontenaient du rhum. Vous imaginez sans peine ce qui est arrivé…Nos aides-cuisiniers ont complètement perdu la tête, j’ai moi-mêmemal calculé les portions&|160;; lorsque le colonel est arrivé nousn’avions plus rien à lui offrir. C’est une sale blague.
–&|160;C’est une délicieuse aventure, déclaraVanek, qui, lorsqu’il était en état d’ébriété, aimait lesexpressions choisies.
Le cuisinier Jurayda se mit à bavarder, ilraconta qu’il était éditeur d’une revue occultiste et de livres quise proposaient de dévoiler les «&|160;mystères de la vie et de lamort&|160;». Pendant la guerre il s’était embusqué à la cuisine dumess et il lui était souvent arrivé de faire brûler le rôtitellement il était plongé avec passion dans la lecture de saSuter Pragua Paramita (La Sagesse Révélée).
Le colonel Schroder le considérait comme untype très original, il était même très fier de l’avoir sous sesordres, «&|160;car, disait-il, quel régiment peut se vanter deposséder un chef cuisinier occultiste&|160;». Et ce chefconnaissait son métier. Certains de ses plats avaient été si goûtésdes officiers que lorsque le lieutenant Dusek fut blessé à labataille de Komarovo il réclamait toujours Jurayda.
–&|160;Oui, poursuivit le chef de cuisine, quiavait de la peine à demeurer sur sa chaise et dont l’haleinesentait le rhum à dix pas, lorsque notre colonel en arrivant aumess s’est aperçu qu’il ne restait plus pour lui que des pommessautées, il a failli se trouver mal&|160;; il est tombé, comme ondit chez nous, dans l’état des Gaki. Savez-vous ce que c’est que leGaki&|160;? C’est le nom qu’on donne aux âmes affamées. Je lui aidit&|160;: avez-vous, mon colonel, assez de force pour supporterles cruautés du sort qui vous a privé ce soir de votre noix deveau&|160;? Dans le Karma il est écrit que vous mangerez ce soirune délicieuse omelette truffée.
Chers amis, ajouta le chef cuisinier, enfaisant un brusque mouvement qui fit dégringoler tout ce qui setrouvait sur la table, n’oubliez pas que les phénomènes desfigures, les apparitions sont sans substance. La Figure est leSans-Substance et le Sans-Substance est la Figure. L’état deSans-Substance n’est pas différent de la Figure et la Figure n’estpas différente de l’état de Sans-Substance…
Après ces quelques éclaircissements, le chefoccultiste se plongea dans un profond silence. La tête dans lesmains, il se mit à regarder fixement la table inondée de vin.L’adjudant, lui, continuait à délirer&|160;:«&|160;Le blé a disparu des champs et danscette situation il a obtenu une invitation pour elle, mais laPentecôte se fêtera au printemps…&|160;»
Cependant Vanek continuait à tambouriner surla table. De temps à autre il vidait son verre et il se rappelaitqu’un sergent et onze hommes l’attendaient au magasin. En songeantà cela il se mit à rire de bon cœur en faisant de la main un gesterésigné. Lorsqu’il rentra fort tard à la compagnie, il trouvaChvéïk au téléphone.
–&|160;La Figure est la Sans-Substance, et laSans-Substance est la Figure… cria-t-il avec désespoir, puis il sejeta tout habillé sur sa couchette et s’endormit.
Chvéïk, sans accorder la moindre attention àses paroles, garda fidèlement le récepteur en mains. Il y avaitdeux heures de cela, le lieutenant Lukach lui avait téléphoné etcomme il avait oublié de lui dire de raccrocher l’appareil, Chvéïkpour rien au monde ne l’eût quitté. Il entendait les conversationsqui avaient lieu sur les diverses lignes. Le train des équipagesengueulait les artilleurs, les sapeurs faisaient des réclamationstapageuses à la poste, et les gens du polygone se disputaient avecles mitrailleurs.
Cependant, la réunion chez le colonel Schrodertraînait en longueur. Le colonel expliquait la nouvelle théorie duservice au front et il soulignait surtout le rôle des obusiers detranchées. Il parla longtemps et confusément de la disposition dufront. Il expliqua la ligne qu’il traçait et qui allait du nord ausud, il insista sur l’importance d’une bonne liaison entre lestroupes, sur celle des gaz asphyxiants et de la défense contrel’aviation ennemie. Ensuite il discourut encore sur la situationintérieure de l’armée, et commença par analyser les relations desofficiers et des soldats, ainsi que des sous-officiers. Puis il ditce qu’il pensait des hommes qui passent avec armes et bagages àl’ennemi.
Durant ce temps, la majorité des officiers quil’écoutaient se mirent à maugréer entre leurs dents en se demandantsi ce vieux chameau allait bientôt finir de discourir. Mais levieux continuait à bavarder sur les nouvelles tâches des bataillonsde marche, sur les zeppelins, etc.
En écoutant cette avalanche de phrasesincohérentes, le lieutenant Lukach se souvint que Chvéïk avait étéabsent de la solennité de prêter serment, car, au moment où elleeut lieu, il était encore en prison. En songeant à cela,brusquement, il fut secoué par un rire nerveux qui se répanditaussitôt dans l’assistance. Le colonel, ahuri, s’embrouilla encoredavantage dans son discours qu’il clôtura enfin par cesparoles&|160;: Messieurs, ce que je dis n’est pourtant pas sirigolo&|160;!
Là-dessus, tout le monde se rendit au mess,car le colonel venait d’être appelé au téléphone par labrigade.
Chvéïk dormait du sommeil du juste à côté dutéléphone lorsque la sonnerie retentit&|160;:
–&|160;Allo, ici bureau du colonel.
–&|160;Allo, répondit-il, ici 11ecompagnie.
–&|160;Dépêchons-nous, cria une voix, prendsdu papier et un crayon et écris ce que je vais te dicter&|160;:
«&|160;11e compagnie demarche…&|160;» Là-dessus suivirent des phrases complètementconfuses, car les téléphonistes de la 12e et10e compagnie s’étant mis à se raconter des histoires,Chvéïk ne comprit pas un traître mot de ce qu’on lui disait.
–&|160;Allo, répète un peu ce que tu viensd’écrire.
–&|160;Quoi donc&|160;?
–&|160;Ce que je viens de te dicter,parbleu.
–&|160;Quoi, quoi, je ne sais pas ce que vousvoulez dire…
–&|160;Mais, espèce d’idiot, es-tusourd&|160;?
–&|160;Je n’ai rien entendu, répondit Chvéïk,tout le monde parle à la fois au téléphone.
–&|160;Comment&|160;! Qu’est-ce que turacontes, espèce d’andouille&|160;? Crois-tu que j’aie du temps àperdre avec toi&|160;? Veux-tu prendre mon message oui ounon&|160;? As-tu un crayon et du papier&|160;? Eh bien, quoi&|160;!Es-tu prêt&|160;? Bon Dieu de bon Dieu, quel abruti tu fais&|160;!Allons-y maintenant&|160;: Le commandant de la IIecompagnie de marche… répète.
–&|160;La IIe compagnie demarche…
–&|160;Commandant de la IIecompagnie, répète&|160;!
–&|160;Commandant de la IIecompagnie…
–&|160;Est invité pour demain matin…
–&|160;Est invité pour demain matin…
–&|160;À une conférence chez le colonel.Signature. Sais-tu ce que c’est qu’une signature, animal&|160;?Répète&|160;!
–&|160;À 9 heures à une conférence chez lecolonel. Signature. Sais-tu ce que c’est qu’une signature,animal&|160;?
–&|160;Signé colonel Schroder,idiot&|160;!
–&|160;Signé colonel Schroder,idiot&|160;!
–&|160;Quelle andouille&|160;!Qui est-ce qui prend ce message&|160;?
–&|160;Moi-même.
–&|160;Qui ça, moi-même&|160;?
–&|160;Chvéïk.
–&|160;Quoi de nouveau chez vous,Chvéïk&|160;?
–&|160;Rien, tout est comme hier.
–&|160;Est-il vrai que vous avez quelqu’un aupoteau&|160;?
–&|160;Ce n’était rien, c’était simplement letampon du lieutenant Lukack, il avait bouffé le dîner dulieutenant. Tu ne sais pas quand est-ce qu’on partira&|160;?
–&|160;Mon vieux, le colon lui-même n’en saitrien.
Chvéïk raccrocha le récepteur puis se mit àsecouer le chef pour le réveiller. Allongé sur le dos, Vanek se mità lancer les pieds dans toutes les directions. Mais Chvéïk vinttout de même à bout de sa tâche, et le chef tout ahuri, en sefrottant les yeux, lui demanda ce qu’il y avait de nouveau.
–&|160;Oh, pas grand’chose, répondit Chvéïk,je voudrais seulement vous demander un conseil. Je viens derecevoir un message ordonnant au lieutenant Lukach de se présenterdemain à 9 heures, chez le colonel. Mais je ne sais plus quoifaire. Faut-il aller le mettre au courant immédiatement ou faut-ilque j’y aille demain matin&|160;? J’ai longtemps hésité pour vousréveiller, surtout parce que vous ronfliez terriblement, mais à lafin je me suis dit&|160;: il faut tout de même lui demanderconseil…
–&|160;Pour l’amour de Dieu, laissez-moidormir, répondit Vanek.
Là-dessus il se retourna et se rendormit commeun bienheureux. Chvéïk revint au téléphone, s’assit, et recommençaà somnoler. Mais la sonnerie le réveilla de nouveau.
–&|160;Allo, la IIe&|160;?
–&|160;Oui, la IIe. Qui valà&|160;?
–&|160;La 13e. Allo&|160;! Quelleheure qu’il est chez vous&|160;?
–&|160;Notre pendule ne marche pas.
–&|160;Eh bien, mon vieux, chez nous, c’est dupareil au même, tu ne sais pas quand est-ce qu’on partira&|160;?As-tu parlé avec le régiment&|160;?
–&|160;Qui, mais ils ne savent rien, cesandouilles-là.
–&|160;Eh, dites-donc, mademoiselle,voulez-vous être polie&|160;! Nous avons envoyé des gens au magasinet on ne leur a rien donné.
–&|160;Les nôtres aussi sont retournés lesmains vides.
–&|160;C’était sans doute une fausse alerte.Où crois-tu que nous irions&|160;?
–&|160;En Russie.
–&|160;Je ne crois pas, nous irons plutôt enSerbie. Nous le saurons en arrivant à Budapest. Si notre traintourne à droite c’est la Serbie qui nous attend, s’il tourne àgauche c’est la Russie.
–&|160;On dit que les prêts sont augmentés. Tusais jouer au bésigue. Bon&|160;! Alors, viens nous voir demain.Chez nous, on joue chaque soir. Combien vous êtes autéléphone&|160;? Tu es tout seul&|160;? Oh, alors, laisse touttomber et va te coucher.
Chvéïk suivit ce conseil et, appuyantdoucement sa tête sur ses bras repliés, il s’endormit. Comme ilavait oublié de raccrocher le récepteur, personne ne pouvait plusdésormais le déranger. Le téléphoniste du régiment, malgré tous sesefforts, ne put parvenir à passer le message indiquant que leshommes qui n’avaient pas été vaccinés contre la typhoïde devaientse présenter le lendemain à la visite.
Le lieutenant Lukach, ce même soir, veilla auclub des officiers en compagnie du major Schanzler. Ce dernierétait assis à cheval sur une chaise et, tout en frappant leplancher avec une queue de billard, il fit les déclarationssuivantes&|160;:
–&|160;C’est un sultan arabe qui, le premier,a reconnu la neutralité des médecins militaires. Cette conventionmême est applicable aux aumôniers, médecins, chirurgiens,pharmaciens et infirmiers, chargés de donner des soins aux maladesdemeurés sur le terrain de l’adversaire, non seulement ils nepeuvent pas être faits prisonniers mais ils peuvent exiger d’êtrereconduits dans leur armée respective&|160;; les blessés et maladesdoivent être échangés entre les parties belligérantes.
Le docteur Schanzler, bien qu’il eût déjàbrisé deux queues de billards, continua à poursuivre ses théoriessur les conventions de Genève. Cependant le lieutenant Lukach,fatigué d’entendre ces histoires qui ne l’intéressaient guère,acheva de boire son café et rentra dans sa chambre, où il trouvaBaloun, le géant barbu, qui était en train de faire rôtir un boutde saucisson sur une lampe à alcool.
–&|160;Je me suis permis, mon lieutenant,balbutia Baloun, je me suis permis…
Lukach le regarda étonné, il comprit que cethomme n’était qu’un grand enfant naïf et il ressentit de la honteen songeant qu’il l’avait fait mettre au poteau à cause de cettefaim toujours inassouvie.
–&|160;Tu n’as qu’à continuer, répondit-il, endécrochant son sabre, demain je te ferai donner une double portionde pain.
Le lieutenant Lukach s’assit ensuite à satable. Il venait de succomber à un accès de sentimentalisme et ilse mit à écrire une lettre à sa tante&|160;:
«&|160;Chère tante,
«&|160;Je viens de recevoir l’ordre de memettre en route avec ma compagnie de marche pour le front. Il estpossible que cette lettre soit la dernière que tu reçoives de mapart. C’est pourquoi il m’est difficile de la terminer en tedisant&|160;: au revoir&|160;; peut-être vaudrait-il mieux, eneffet, que je te dise adieu…
–&|160;Je la terminerai demain, se dit lelieutenant Lukach, et il alla se coucher.
Lorsque Baloun vit que le lieutenant dormait àpoings fermés, il se remit à fouiller dans la chambre dans l’espoirde découvrir quelque nourriture. En ouvrant la valise dulieutenant, il aperçut une plaque de chocolat qu’il dévora enquelques bouchées. Puis il alla doucement voir ce que le lieutenantavait écrit. Il fut tellement ému par ces quelques lignes qu’il seretira aussitôt sur sa paillasse et qu’il se mit à songer à sonfoyer. Il revit son large coutelas de boucher puis ils’endormit.
Le lendemain matin, Chvéïk fut réveillé parl’odeur du café qu’on était en train de préparer sur les fourneauxde la compagnie. Il raccrocha machinalement le récepteur dutéléphone comme s’il terminait une communication et il se mit à sepromener dans le bureau pour se dégourdir les jambes. Sa bonnehumeur éclata dans un chant joyeux. Il s’agissait d’un soldat quis’était déguisé en jeune fille pour mieux approcher sa bien-aimée.Il l’accompagne au moulin où le meunier le fait coucher dans le litde sa fille en sortant de table&|160;:
Donne à manger à cette fille, la meunière
Elle n’a pas bouffé, paraît-il, depuis hier.
… La meunière sert un dîner copieuxau soldat déguisé et voici la fin de l’histoire&|160;:
Les meuniers en sortant du lit
Découvrirent cet avis&|160;:
Mes compliments à Mademoiselle
Elle était, mais n’est plus… pucelle…
Chvéïk chanta la fin du refrain avec une telleverve qu’il réveilla son chef.
–&|160;Quelle heure est-il&|160;? lui demandacelui-ci.
–&|160;On vient de sonner le réveil, chef.
–&|160;Bien, je ne me lèverai qu’après lecafé.
Vanek bâilla et demanda s’il n’avait pas tropbavardé, hier soir, en rentrant.
–&|160;Oh, pas trop, lui répondit Chvéïk, maisvous n’avez dit que des bêtises, vous avez raconté des histoiressur des Figures qui ne sont pas des Figures, tout en étant desFigures. Ensuite vous vous êtes mis à ronfler comme ungendarme.
Chvéïk se tut, fit quelques pas vers la porte,puis se retournant vers le chef, il ajouta&|160;:
–&|160;En vous entendant parler de cesFigures, mon adjudant, je me rappelais un certain Zeatka, unouvrier de l’usine à gaz qui était chargé d’allumer et d’éteindreles réverbères. C’était un homme très éclairé et bien connu cheznous, car il s’occupait beaucoup, lui aussi, de ces histoires defigures. Il en parlait du matin au soir. Finalement, ajouta Chvéïk,Zeatka a mal tourné, il s’est fait inscrire à la confrérie deSainte-Marie, et il était tellement passionné pour assister auxoffices qu’il a laissé brûler pendant trois jours les réverbèressans les éteindre. C’est très dangereux de s’occuper dephilosophie. Cela ne tarde pas à taper sur le cerveau. Je mesouviens aussi d’un commandant du nom de Eleuphr, qui s’était aviséun jour de nous apprendre ce que c’était que l’autoritémilitaire.
«&|160;Écoutez, nous a-t-il dit, et sachez quel’officier est la création la plus parfaite de l’univers. Il amille fois plus d’intelligence à lui seul que vous tous ensemble.Les ordres de l’officier sont sacrés, même si parfois cela vousparaît ennuyeux de les exécuter.&|160;»
Ayant ainsi terminé son discours, il se mit àse promener devant nous et il nous demanda l’un aprèsl’autre&|160;:
–&|160;Que fais-tu lorsque tu rentres enretard à la caserne&|160;?
Nous étions tous très gênés par cette demandeet nous n’avons fait que des réponses très confuses. Les copainsont raconté toutes sortes de boniments, disant qu’ils n’étaientjamais rentrés en retard, ou qu’à cause de ces retards ils ont eumal au cœur, un autre disait qu’il songeait surtout aux jours deconsigne qu’il allait attraper le lendemain. Et tous ceux-là lecommandant les fit mettre de côté, car ils n’avaient pas trouvé«&|160;l’expression juste de leurs pensées&|160;». Aussi, quand montour est arrivé, j’ai répondu&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncommandant, que lorsque je rentre en retard j’ai le sentimentd’avoir mal agi, j’ai des remords qui m’empêchent de dormir. Parcontre si j’arrive à temps ou si j’ai une permission dans ma poche,je rentre heureux, je me sens envahi d’une grande joie…
Tout le monde s’est mis à rigoler autour denous et le commandant s’est mis en colère&|160;:
–&|160;Tu oses encore te foutre de moi, qu’ilm’a dit, et il m’a fait mettre aux fers.
–&|160;C’est comme ça chez nous, réponditVanek en se traînant paresseusement hors du lit. C’est la règlegénérale. Tu as beau répondre ce que tu veux, tu es toujoursmonsieur le bon. C’est la discipline qui fait la force desarmées…
–&|160;C’est bien dit, approuva Chvéïk. Jen’oublierai jamais l’histoire qui est arrivée à un certain Pech.Lorsqu’il arriva à la caserne, le lieutenant de la compagnie, unnommé Meots, le fit aligner avec d’autres bleus pour leur demanderde quel patelin ils étaient.
–&|160;Vous allez apprendre à parlercorrectement, qu’il leur a dit, vos réponses doivent sonner commedes coups de cravaches. Allez-y, Pech&|160;! De quel patelin vousêtes&|160;?
Pech, qui était un homme très cultivé, lui arépondu&|160;?
«&|160;Dolni Bousov n°&|160;267, 1936habitants tchèques, canton de Jitchine, département de Sobotka,ancien domaine Kost, église Sainte-Catherine du XIVesiècle, reconstruite par le comte Vencel Vrasislave Netolitski,école communale, bureau de poste, télégraphe, sucrerie, six foirespar an…&|160;»
Mais à ces mots, le lieutenant Meots s’est ruésur lui et l’a giflé, en hurlant&|160;: en voici une, deux, trois,quatre, cinq et six pour chacune de ces foires.
Alors Pech, bien qu’il ne fût qu’un bleu,s’est inscrit au rapport du bataillon. Le commandant luidemanda&|160;:
–&|160;Eh bien que voulez-vous&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, moncommandant, que chez nous, nous avons six fois la foire…
Mais il n’eut pas le temps d’en diredavantage, car le commandant s’est mis à gueuler et il l’a faitconduire à la maison d’aliénés.
–&|160;Il est bien difficile d’éduquer lessoldats, répondit le chef. Un homme qui n’a pas eu sa part depunitions n’est pas un vrai soldat&|160;; je me souviens d’un garsde la 8e compagnie qui s’appelait Sylvaleisa. Il nesortait jamais de taule. Ah&|160;! c’était un numérocelui-là&|160;! Il ne se gênait pas pour faucher le pognon de sescopains. Mais au front, il a eu une attitude courageuse, il a étéle premier à couper les fils de fer barbelés&|160;; le même jour,il a fait trois prisonniers, et il en a bousillé un en route. Pourcet exploit, on lui a collé immédiatement la grande médailled’argent et on l’a nommé caporal. Si on ne l’avait pas pendu, ilserait sans doute sergent. Mais on a été obligé de le pendre, carune patrouille l’a surpris un jour en train de dépouiller desmacchabées. On a trouvé sur lui un tas de montres etd’alliances.
–&|160;On voit bien, d’après cet exemple,répondit Chvéïk gravement, que la carrière militaire n’est jamaistrès sûre.
Comme il achevait ces mots, le téléphone semit à sonner. Vanek décrocha le récepteur, et on entendit la voixdu lieutenant Lukach qui l’interrogeait au sujet des conserves,tout en lui adressant quelques reproches.
–&|160;Mais, mon lieutenant, il n’y en a pas,s’écria Vanek&|160;; où voulez-vous que je les prenne ces fameusesconserves, puisqu’elles n’existent que dans l’imagination de cesmessieurs de l’Intendance. Il est inutile d’envoyer des hommes aumagasin. J’ai voulu vous téléphoner pendant que j’étais à lacantine. Vous le saviez déjà&|160;? Qui vous l’a dit&|160;? Cetidiot d’occultiste du mess. Je l’arrangerai celui-là&|160;!Voulez-vous savoir comment le chef de cuisine, cet idiotd’occultiste, a nommé la panique des singes&|160;? La terreur del’inexistence… Mais du tout, mon lieutenant. Je sais ce que jedis&|160;! Je suis sobre et j’ai la tête claire, comme… Vous voulezparler à Chvéïk&|160;? Il est là. Chvéïk, on vous demande autéléphone.
Puis il ajouta tout bas&|160;:
–&|160;Si l’on vous demande dans quel état jesuis arrivé, hier soir, dites que mon attitude était trèsconvenable.
Chvéïk s’approcha du téléphone&|160;:
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant…
–&|160;Chvéïk, est-ce vrai cette histoire queme raconte Vanek sur les conserves…
–&|160;C’est vrai, mon lieutenant. Il n’y apas une seule boîte de singe au magasin.
–&|160;Bien. Je vous ordonne de venir chez moichaque matin jusqu’à mon départ pour le camp de Kiralhyda, je veuxvous garder auprès de moi. Qu’avez-vous fait cette nuit&|160;?
–&|160;J’ai gardé le téléphone.
–&|160;Y a-t-il eu quelque chose denouveau&|160;?
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant…
–&|160;Trêve d’idioties, Chvéïk&|160;! Vousa-t-on fait une communication de quelque importance&|160;?
–&|160;Oui, mon lieutenant, mais pour neufheures seulement. J’ai pas voulu vous inquiéter pour si peu, monlieutenant…
–&|160;Sapristi. Voulez-vous me dire ce qu’ily a pour neuf heures&|160;?
–&|160;Un message, mon lieutenant.
–&|160;Je ne vous comprends pas, Chvéïk.
–&|160;Je l’ai inscrit, mon lieutenant. J’aientendu une voix qui me disait au milieu de la nuit&|160;: Prendsce message, répète avec moi… et ainsi de suite.
–&|160;Sacré nom de Dieu&|160;! Si vous ne medites pas rapidement de quoi il s’agit, je vais vous flanquer unede ces gifles…
–&|160;Encore une conférence, mon lieutenant,à neuf heures, chez le colonel. Tout d’abord, j’ai voulu vousréveiller, mais, après réflexion…
–&|160;Comment&|160;? Pour une idiotiepareille vous auriez eu l’audace de me faire sortir du lit&|160;?Encore une réunion&|160;! Que le diable les emporte tous&|160;!Raccrochez et appelez Vanek au téléphone.
Le sergent-major se précipita vers lerécepteur.
–&|160;Sergent-major Vanek, monlieutenant.
–&|160;Vanek, trouvez-moi immédiatement unautre tampon. Ce cochon de Baloun m’a bouffé tout mon chocolatcette nuit. Au poteau&|160;? Non. Il faudrait plutôt le confier àdes infirmiers. C’est un costaud, cet animal. Il ferait très bienpour le transport des blessés. Je vous l’envoie tout de suite.Réglez cette affaire au bureau du régiment et revenez aussitôt à lacompagnie. Croyez-vous que nous partirons bientôt&|160;?
–&|160;C’est pas la peine de nous presser, monlieutenant. Lorsque nous sommes partis avec la 9ecompagnie, on nous a menés pendant quatre jours par le nez, àdroite et à gauche. Il en a été de même avec la 8e. La10e a été une exception. Nous avions reçu l’ordre dudépart pour midi, et le soir nous étions encore sur le quai de lagare.
Depuis qu’il était chef de la 11ecompagnie de marche, le lieutenant Lukach se trouvait dans un étatque l’on désigne en termes philosophiques sous le nom desyncrétisme, c’est-à-dire qu’il s’efforçait d’atténuer les conflitsd’ordre théorique qui pouvaient survenir au moyen de compromissionsde toutes sortes.
–&|160;Vous croyez donc que nous ne partironspas aujourd’hui&|160;? Nous avons ce matin encore une réunion chezle colonel. Ah&|160;! j’allais oublier. Vous ne savez pas encoreque vous avez été désigné comme adjudant de service. On m’a chargéde vous l’annoncer. Vous allez sur-le-champ me dresser une listedes sous-officiers avec la date de leur entrée en service, puiscelle des réserves en vivres&|160;; n’oubliez pas égalementd’inscrire la nationalité des sous-officiers. Mais le plusimportant, et j’insiste là-dessus, c’est de me trouver un nouveautampon. Appelez-moi Chvéïk… Chvéïk, en attendant, vous resterez autéléphone.
–&|160;Je vous déclare avec obéissance, monlieutenant, que je n’ai pas encore bu mon café.
–&|160;Bon&|160;! allez chercher votre café etrevenez au téléphone jusqu’à ce que je vous appelle. Savez-vous ceque c’est qu’une ordonnance&|160;?
–&|160;Oui, mon lieutenant, c’est un soldatqui court toujours comme un fou…
–&|160;Pas d’histoires, Chvéïk, je vousdispense de vos réflexions. Allo… Allo… où êtes-vous&|160;?
–&|160;Présent, mon lieutenant, on vient dem’apporter mon café. Il est gelé.
–&|160;Occupez-vous également, Chvéïk, decette histoire d’ordonnance. Choisissez-moi un type convenable.Bon&|160;! raccrochez maintenant.
Vanek, tout en ajoutant à son café une bonnerasade de rhum, qu’il portait sur lui dans une bouteille qui,jadis, avait contenu de l’encre, jeta un regard sur Chvéïk etdit&|160;:
–&|160;Il gueule trop notre lieutenant. D’icij’ai entendu chacune de ses paroles. Vous avez l’air d’être en bonstermes avec lui.
–&|160;Ne m’en parlez pas, répondit Chvéïk,nous sommes comme mon cul et ma chemise. Nous avons passé de bellesheures ensemble, et de mauvaises également. On avait beau vouloirnous arracher l’un à l’autre, nous finissions toujours par nousretrouver. Il a une telle confiance en moi que j’en suis moi-mêmeétonné. Vous l’avez entendu, de vos propres oreilles, tandis qu’ilvous demande de lui trouver un nouveau tampon, il me charge, moi,soldat de deuxième classe, de me renseigner sur cet homme et de luidonner comme qui dirait une expertise, car, bien entendu, lelieutenant ne se contenterait pas de n’importe quelle canaille.
*
**
C’était avec un réel plaisir que le colonelSchroder réunissait chez lui les officiers du bataillon de marche,car sa principale passion était de bavarder. De plus, il fallait,cette fois, se décider d’urgence sur le cas de l’aspirant Marek,qui avait refusé d’aller nettoyer les cabinets et qui, pour cetteraison, devait être déféré au conseil de guerre, sous l’inculpationde refus d’obéissance.
Le colonel avait reçu un long rapportdéclarant que l’attitude de l’aspirant Marek ne saurait êtreassimilée à un cas de rébellion, puisque les règlements ne peuventobliger les aspirants à nettoyer les cabinets. «&|160;Néanmoins,ajoutait le rapport, il est certain que le nommé Marek a commis unegrave atteinte à la discipline.&|160;» On lui laisserait,ajoutait-on, la possibilité de se racheter par une attitudecourageuse sur le front. L’aspirant Marek devait être rendu à sonrégiment. L’instruction de l’affaire serait suspendue et ne devaitêtre reprise qu’en cas de récidive.
Il y avait également à l’ordre du jourl’histoire du faux aspirant. Cet homme avait fait son apparition aurégiment depuis peu. Il venait d’un hôpital de Zagreb. Il s’étaitdécerné lui-même le grade d’aspirant, et, il avait épinglé sur satunique la grande médaille d’argent du courage. Il racontait à quivoulait l’entendre ses héroïques exploits de guerre. Il disaitappartenir à la 6e compagnie de marche, dont il seprétendait le seul survivant. Après une longue instruction, ondécouvrit en effet qu’un nommé Teveles avait appartenu à la6e compagnie de marche, mais qu’il n’était pas le moinsdu monde aspirant.
Teveles se défendit devant le conseil deguerre en déclarant que la grande médaille d’argent du courage luiayant été promise, il avait pris les devants et en avait acheté unelui-même.
À l’ouverture de la réunion, avant d’aborderces deux ordres du jour, le colonel Schroder exprima son désir deréunir ses officiers dans son bureau aussi souvent que possible.Quant au départ pour le front, il déclara qu’il était proche. Puisil se mit à répéter tout ce qu’il avait dit la veille.
Devant lui, sur son bureau, était étalée unecarte où des drapeaux marquaient la position respective des arméesennemies. Cette fois, les drapeaux avaient été bouleversés et lesfronts déplacés. On voyait même, sous la table, quelques-uns de cesdrapeaux qui avaient été jetés à terre.
La raison de ce désordre était lasuivante&|160;: le chat du colonel s’était, durant la nuit, soulagésur la table et il avait bousculé ensuite, à coups de griffes, lespositions de la glorieuse armée autrichienne.
Pour son malheur, le colonel Schroder avait lavue très faible.
Les officiers du bataillon de marche suivaientavec un intérêt croissant le déplacement de l’index du colonel quis’approchait de plus en plus du tas suspect.
–&|160;C’est à ce point exact, messieurs…dit-il, d’un ton prophétique. Mais en poussant son doigt dans ladirection des Carpathes, il effleura le monticule que-le chat avaitlaissé sur la carte, probablement pour accentuer le relieftopographique de la Galicie.
Le colonel porta son doigt à sonnez&|160;:
–&|160;Je crois que… que… balbutia-t-il enfronçant les sourcils.
–&|160;C’est de la merde de chat, mon colonel,déclara au nom de tous les officiers présents le capitaineSagner.
–&|160;Nom de Dieu&|160;! hurla furieusementle colonel.
Et il se précipita dans le bureau voisin oùretentit bientôt un tapage infernal, accompagné de la menaceterrible de faire lécher par les hommes qui avaient été coupablesde négligence, le monticule qui déshonorait la carte del’État-Major.
Le colonel revint avec une figure écarlate.Son indignation était telle qu’il en oublia de prendre une décisionsur le sort de l’aspirant Marek et du faux aspirant Teveles.
–&|160;Messieurs, dit-il rageusement, soyezsur vos gardes et attendez mes ordres.
*
**
La situation demeurait stationnaire etconfuse. Le régiment partirait-il pour le front ou non&|160;?Chvéïk attendait patiemment des nouvelles au téléphone de la11e compagnie. Et il entendait toutes sortes d’aviscontradictoires, les uns pessimistes, les autres optimistes. Lecaporal Havlik, en entrant en ville, disait avoir rencontré uncheminot qui lui avait appris que les wagons pour le départ étaientdéjà prêts.
Mais Vanek arracha le récepteur des mains deChvéïk pour crier au caporal que les cheminots n’étaient à ses yeuxque de vieilles femmes bavardes, et que lui, Vanek, qui venait àpeine de rentrer du bureau du régiment, ne savait encore rien.
Chvéïk, cependant, s’accrochait avec passion àson poste téléphonique et répondait avec une candeur inébranlable,à tout le monde, qu’il ne savait encore rien de précis sur ledépart.
Lorsque son lieutenant lui demanda&|160;:
–&|160;Quoi de neuf&|160;?
–&|160;Rien de nouveau, mon lieutenant, luirépondit-il.
–&|160;Ah&|160;! quelle nouille&|160;!Raccrochez, Chvéïk&|160;!
Une demi-heure plus tard, un message luiparvint qui avait été adressé à tous les bataillons. Il était ainsirédigé&|160;: Copie du message n°&|160;75.692. Ordre de la brigaden°&|160;172. Prière d’observer l’ordre suivant pour la confectiondes listes de vivres&|160;: 1°&|160;viande, 20conserves, 3°&|160;légumes frais, 4°&|160;légumes secs,5°&|160;riz, 6°&|160;macaroni, 7°&|160;pâtes diverses,8°&|160;pommes de terre – qu’il fallait mettre à la place dun°&|160;4.
Lorsque Chvéïk lut à Vanek cet importantmessage, celui-ci lui déclara qu’il avait l’habitude de les jetersans les lire dans les latrines.
–&|160;C’est un idiot de l’état-major quiimagine de pareilles balivernes, dit-il, et à cause de lui tout lemonde est embêté.
Puis on dicta à Chvéïk un nouveau message,mais à une telle vitesse qu’il n’en demeura plus sur le papier quequelques mots énigmatiques&|160;: «&|160;À la suite… Précisément…permis… ou bien lui-même… par contre… impossible… attrapez…
–&|160;Toutes ces histoires ne sont que desidioties, déclara Vanek, lorsque Chvéïk lui exprima son étonnementen relisant un pareil passage. Ce sont des niaiseries. Il n’y aqu’à le jeter.
–&|160;Je pense, remarqua Chvéïk, que sij’allais dire au lieutenant Lukach que&|160;: «&|160;à la suiteprécisément permis ou bien lui-même par contre impossibleattrapez&|160;», il serait capable de se fâcher. Ils sont parfoistrès sensibles, ces messieurs, continua-t-il. Un jour je metrouvais dans le tramway qui va de Vysotchan à Prague et à Libni.Un monsieur est monté à côté de moi, je l’ai reconnu et je me suisapproché de lui en lui disant que nous nous connaissions et quej’étais moi aussi de Drasov. Mais voilà le monsieur qui se met àm’engueuler en me disant que je ferais bien mieux de lui ficher lapaix, qu’il ne me connaissait pas, etc. Pour dissiper cemalentendu, je me suis efforcé de lui rappeler que, alors quej’étais un enfant en bas âge, j’étais souvent allé le voir encompagnie d’une femme qui s’appelait Antoinette, dont le maris’appelait Procope, qui tenait une laiterie. Mais il n’a tout demême pas voulu me croire, et il a refusé d’avouer que nous nousconnaissions. Je lui ai alors donné quelques nouveaux détails, parexemple, qu’à Drasov il y avait deux Novotny, dont l’un s’appelaitTonda et l’autre Joseph. Et que lui ce devait être sans doute ceJoseph dont on m’avait écrit de Drasov qu’il tabassait sa femme dumatin au soir, car elle lui rendait la vie dure à cause de sonivrognerie. Ah&|160;! si vous aviez vu quel pétard il a fait&|160;!Il a tout cassé autour de lui, il a même brisé la glace qui setrouvait devant le conducteur. Pour finir, on nous a menés tous lesdeux au commissariat et, là, j’ai appris qu’il s’était emballéuniquement pour cette raison qu’il n’avait jamais été le JosephNovotny de Drasov, mais qu’il s’appelait Édouard Doumbrava et qu’ilvenait de Montgomery en Amérique, pour revoir ses parentstchèques…
Le téléphone interrompit cette histoire, etune voix aphone, de la section des mitrailleurs, demanda s’il étaitvrai que l’on devait partir aujourd’hui.
À ce moment-là, l’enseigne Biegler se présentaà la porte du bureau en demandant à parler à Vanek. Les deux hommeseurent une longue conversation. Lorsque Vanek le quitta, il avaitun sourire méprisant.
–&|160;C’est encore un joli numéro, celui-là,remarqua-t-il. Nous pouvons dire que nous avons des types curieux ànotre compagnie&|160;! Il vient d’assister à la réunion chez levieux et, en rentrant, le lieutenant lui a donné l’ordre d’allerpasser les flingots en revue. Cette andouille vient me demandermaintenant s’il doit faire mettre au poteau le soldat Slabek, carcelui-ci, m’a-t-il dit, à nettoyé son fusil avec du pétrole. On mepose des questions aussi idiotes, s’exclama Vanek avec indignation,lorsqu’on sait que nous allons partir pour le front&|160;! Lelieutenant Lukach s’est montré plus chic avec son tampon.
–&|160;Puisqu’il est question de tampon,répondit Chvéïk, vous ne savez pas encore si l’on en a trouvé un deconvenable pour le lieutenant Lukach&|160;?
–&|160;Ne vous en faites pas&|160;» réponditVanek, rien ne presse. Je pense, pour ma part, que le lieutenantpeut très bien s’arranger avec Baloun. Il n’y a pas de quoi gueulercomme un veau parce que votre ordonnance vous bouffe de temps àautre votre portion.
Vanek s’étira sur sa couchette.
–&|160;Chvéïk, racontez-moi une histoire surla vie militaire.
–&|160;Volontiers, répondit celui-ci, àcondition seulement que ce téléphone ne vienne pas nousembêter.
–&|160;Vous n’avez qu’à décrocher lerécepteur, lui conseilla Vanek.
–&|160;Bien, dit Chvéïk en obéissant aussitôt.Je vais vous raconter une histoire qui rappelle un peu notresituation. Seulement, à cette époque, nous n’avions pas encore laguerre. Nous étions aux manœuvres. J’avais un copain du nom deChitz, de Porchitch, un brave homme, très pieux et très froussard.Il s’imaginait que les manœuvres étaient des choses diaboliques etqu’on risquait d’y mourir de soif. Donc, par précaution, la veillede notre départ, il s’en mit plein la lampe et, lorsque nousquittâmes la caserne pour nous rendre à Mnichk, il nousdéclara&|160;: «&|160;Je n’en peux plus, les gars, c’est Dieu seulqui peut me sauver&|160;!&|160;» Puis nous sommes entrés àHorjovitz, et là nous avons eu deux jours de repos, car nous avionscommis une erreur de vitesse. Nous faisons une halte pour perdre letemps gagné, et notre Chitz en profite pour aller se désaltérerdans le village voisin, car, par malheur, il n’y avait pas debistro dans celui où nous nous trouvions.
Sur le chemin du retour, Chitz, qui étaitcomplètement rond, rencontre, au bord de la route, une niche où setrouvait une petite statue de Saint-Jean de Népomuk. Ses sentimentsreligieux remontent à la surface et il s’agenouille dans lapoussière de la route pour prier.
–&|160;Mon pauvre Saint-Jean, se lamente-t-il,quel triste sort que le tien&|160;! Tu es exposé en plein soleil,et tu n’as rien sous la main pour te rafraîchir le gosier&|160;!Laisse-moi venir à ton secours…
Et en disant cela, il porte son bidon à seslèvres et boit une large rasade en déclarant&|160;:
–&|160;Mon vieux Saint-Jean, je t’en ai laisséune bonne gorgée&|160;!
Mais ce n’était pas vrai. Le gourmand avaittout bu, et il s’est aperçu qu’il n’avait rien laissé pour lesaint.
Alors, il a eu peur d’avoir commis unsacrilège et, pour racheter sa faute, Ghitz a retiré Saint-Jean desa niche, l’a dissimulé sous sa capote, et l’a emporté avec luipour lui offrir à boire à la cantine. Et il n’y a rien perdu, caril a gagné, en jouant aux cartes, tout ce qu’il a voulu. Mais iln’a guère été reconnaissant envers le bon saint. Lorsque noussommes repartis, nous avons vu le Saint-Jean de Népomuk, pendu à unpoirier comme un vulgaire épouvantail.
Voilà l’anecdote. Et, de même que Saint-Jean aété accroché à l’arbre, je raccroche aussi le récepteur.
*
**
Au même instant, le lieutenant Lukach était entrain de se casser la tête sur un message chiffré qu’il venait derecevoir du régiment concernant la direction que son bataillondevait suivre pour se rendre en Galicie. On avait joint au messagela clé pour l’interpréter&|160;:
&|160;
7177 1236 2121 35 = Moson
892 775 &|160; 7282 = Gyor
4432 1238 2721 35 = Komarut
475 7979 &|160; &|160; = Budapest
&|160;En parcourant cette liste de chiffres, lelieutenant Lukach poussa un profond soupir&|160;:
–&|160;Que le diable les emporte&|160;!s’écria-t-il.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Babiole
Marie-Catherine d'Aulnoy (1651-1705)


Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’Aulnoy, née à Barneville-la-Bertran vers 16501 ou 16512 et morte à Paris le 13 janvier 1705, est une femme de lettres française.
Femme « d'esprit » et scandaleuse, elle est l'un des auteurs à l'origine du genre écrit du conte merveilleux au sein duquel, à la différence d'auteurs comme Charles Perrault, qui travaillaient dans le sens d'un polissage, elle a insufflé un esprit subversif en usant d'allégories et de satires.
Son travail littéraire est souvent rapproché de celui de Jean de La Fontaine pour sa critique masquée de la cour et de la société française du xviie siècle.

Il y avait un jour une reine qui ne pouvait rien souhaiter, pour être heureuse, que d’avoir des enfants : elle ne parlait d’autre chose, et disait sans cesse que la fée Fanferluche étant venue à sa naissance, et n’ayant pas été satisfaite de la reine sa mère, s’était mise en furie, et ne lui avait souhaité que des chagrins.
Un jour qu’elle s’affligeait toute seule au coin de son feu, elle vit descendre par la cheminée une petite vieille, haute comme la main ; elle était à cheval sur trois brins de jonc ; elle portait sur sa tête une branche d’aubépine, son habit était fait d’ailes de mouches ; deux coques de noix lui servaient de bottes, elle se promenait en l’air, et après avoir fait trois tours dans la chambre, elle s’arrêta devant la reine. « Il y a longtemps, lui dit-elle, que vous murmurez contre moi, que vous m’accusez de vos déplaisirs, et que vous me rendez responsable de tout ce qui vous arrive : vous croyez, madame, que je suis cause de ce que vous n’avez point d’enfants, je viens vous annoncer une infante, mais j’appréhende qu’elle ne vous coûte bien des larmes. — Ha ! noble Fanferluche, s’écria la reine, ne me refusez pas votre pitié et votre secours ; je m’engage de vous rendre tous les services qui seront en mon pouvoir, pourvu que la princesse que vous me promettez, soit ma consolation et non pas ma peine. — Le destin est plus puissant que moi, répliqua la fée ; tout ce que je puis, pour vous marquer mon affection, c’est de vous donner cette épine blanche ; attachez-la sur la tête de votre fille, aussitôt qu’elle sera née, elle la garantira de plusieurs périls. » Elle lui donna l’épine blanche, et disparut comme un éclair.
La reine demeura triste et rêveuse : « Que souhaitai-je disait-elle ; une fille qui me coûtera bien des larmes et bien des soupirs : ne serais-je donc pas plus heureuse de n’en point avoir ? » La présence du roi qu’elle aimait chèrement dissipa une partie de ses déplaisirs ; elle devint grosse, et tout son soin, pendant sa grossesse, était de recommander à ses plus confidentes, qu’aussitôt que la princesse serait née on lui attachât sur la tête cette fleur d’épine, qu’elle conservait dans une boîte d’or couverte de diamants, comme la chose du monde qu’elle estimait davantage.
Enfin la reine donna le jour à la plus belle créature que l’on ait jamais vue : on lui attacha en diligence la fleur d’aubépine sur la tête ; et dans le même instant, ô merveille ! elle devint une petite guenon, sautant, courant et cabriolant dans la chambre, sans que rien y manquât. A cette métamorphose, toutes les dames poussèrent des cris effroyables, et la reine, plus alarmée qu’aucune, pensa mourir de désespoir : elle cria qu’on lui ôtât le bouquet qu’elle avait sur l’oreille : l’on eut mille peines à prendre la guenuche, et on lui eût ôté inutilement ces fatales fleurs ; elle était déjà guenon, guenon confirmée, ne voulant ni téter, ni faire l’enfant, il ne lui fallait que des noix et des marrons.
« Barbare Fanferluche, s’écriait douloureusement la reine, que t’ai-je fait pour me traiter si cruellement ? Que vais-je devenir ! quelle honte pour moi, tous mes sujets croiront que j’ai fait un monstre : quelle sera l’horreur du roi pour un tel enfant ! » Elle pleurait et priait les dames de lui conseiller ce qu’elle pouvait faire dans une occasion si pressante. « Madame, dit la plus ancienne, il faut persuader au roi que la princesse est morte, et renfermer cette guenuche dans une boîte que l’on jettera au fond de la mer ; car ce serait une chose épouvantable, si vous gardiez plus longtemps une bestiole de cette nature. » La reine eut quelque peine à s’y résoudre ; mais comme on lui dit que le roi venait dans sa chambre, elle demeura si confuse et si troublée, que sans délibérer davantage, elle dit à sa dame d’honneur de faire de la guenon tout ce qu’elle voudrait.
On la porta dans un autre appartement ; on l’enferma dans la boîte, et l’on ordonna à un valet de chambre de la reine de la jeter dans la mer ; il partit sur-le-champ. Voilà donc la princesse dans un péril extrême : cet homme ayant trouvé la boîte belle, eut regret de s’en défaire ; il s’assit au bord du rivage, et tira la guenuche de la boîte, bien résolu de la tuer, car il ne savait point que c’était sa souveraine ; mais comme il la tenait, un grand bruit qui le surprit, l’obligea de tourner la tête ; il vit un chariot découvert, traîné par six licornes ; il brillait d’or et de pierreries, plusieurs instruments de guerre le précédaient : une reine, en manteau royal, et couronnée, était assise sur des carreaux de drap d’or, et tenait devant elle son fils âgé de quatre ans.
Le valet de chambre reconnut cette reine, car c’était la sœur de sa maîtresse ; elle l’était venue voir pour se réjouir avec elle ; mais aussitôt qu’elle sut que la petite princesse était morte, elle partit fort triste, pour retourner dans son royaume ; elle rêvait profondément lorsque son fils cria : « je veux la guenon, je veux l’avoir. » La reine ayant regardé, elle aperçut la plus jolie guenon qui ait jamais été. Le valet de chambre cherchait un moyen de s’enfuir ; on l’en empêcha : la reine lui en fit donner une grosse somme, et la trouvant douce et mignonne, elle la nomma Babiole : ainsi, malgré la rigueur de son sort, elle tomba entre les mains de la reine, sa tante.
Quand elle fut arrivée dans ses états, le petit prince la pria de lui donner Babiole pour jouer avec lui : il voulait qu’elle fût habillée comme une princesse : on lui faisait tous les jours des robes neuves, et on lui apprenait à ne marcher que sur les pieds ; il était impossible de trouver une guenon plus belle et de meilleur air : son petit visage était noir comme jais, avec une barbette blanche et des touffes incarnates aux oreilles ; ses menottes n’étaient pas plus grandes que les ailes d’un papillon, et la vivacité de ses yeux marquait tant d’esprit, que l’on n’avait pas lieu de s’étonner de tout ce qu’on lui voyait faire.
Le prince, qui l’aimait beaucoup, la caressait sans cesse ; elle se gardait bien de le mordre, et quand il pleurait, elle pleurait aussi. Il y avait déjà quatre ans qu’elle était chez la reine, lorsqu’elle commença un jour à bégayer comme un enfant qui veut dire quelque chose ; tout le monde s’en étonna, et ce fut bien un autre étonnement, quand elle se mit à parler avec une petite voix douce et claire, si distincte, que l’on n’en perdait pas un mot. Quelle merveille ! Babiole parlante, Babiole raisonnante ! La reine voulut la ravoir pour s’en divertir ; on la mena dans son appartement au grand regret du prince ; il lui en coûta quelques larmes ; et pour le consoler, on lui donna des chiens et des chats, des oiseaux, des écureuils, et même un petit cheval appelé Criquetin, qui dansait la sarabande : mais tout cela ne valait pas un mot de Babiole. Elle était de son côté plus contrainte chez la reine que chez le prince ; il fallait qu’elle répondît comme une sibylle, à cent questions spirituelles et savantes, dont elle ne pouvait quelquefois se bien démêler. Dès qu’il arrivait un ambassadeur ou un étranger, on la faisait paraître avec une robe de velours ou de brocart, en corps et en collerette : si la cour était en deuil, elle traînait une longue mante et des crêpes qui la fatiguaient beaucoup : on ne lui laissait plus la liberté de manger ce qui était de son goût ; le médecin en ordonnait, et cela ne lui plaisait guère, car elle était volontaire comme une guenuche née princesse.
La reine lui donna des maîtres qui exercèrent bien la vivacité de son esprit ; elle excellait à jouer du clavecin : on lui en avait fait un merveilleux dans une huître à l’écaille : il venait des peintres des quatre parties du monde, et particulièrement d’Italie pour la peindre ; sa renommée volait d’un pôle à l’autre, car on n’avait point encore vu une guenon qui parlât.
Le prince, aussi beau que l’on représente l’amour, gracieux et spirituel, n’était pas un prodige moins extraordinaire ; il venait voir Babiole ; il s’amusait quelquefois avec elle ; leurs conversations, de badines et d’enjouées, devenaient quelquefois sérieuses et morales. Babiole avait un cœur, et ce cœur n’avait pas été métamorphosé comme le reste de sa petite personne : elle prit donc de la tendresse pour le prince, et il en prit si fort qu’il en prit trop. L’infortunée Babiole ne savait que faire ; elle passait les nuits sur le haut d’un volet de fenêtres, ou sur le coin d’une cheminée, sans vouloir entrer dans son panier ouaté, plumé, propre et mollet. Sa gouvernante (car elle en avait une) l’entendait souvent soupirer, et se plaindre quelquefois ; sa mélancolie augmenta comme sa raison, et elle ne se voyait jamais dans un miroir, que par dépit elle ne cherchât à le casser ; de sorte qu’on disait ordinairement, le singe est toujours singe, Babiole ne saurait se défaire de la malice naturelle à ceux de sa famille.
Le prince étant devenu grand, il aimait la chasse, le bal, la comédie, les armes, les livres, et pour la guenuche, il n’en était presque plus mention. Les choses allaient bien différemment de son côté ; elle l’aimait mieux à douze ans, qu’elle ne l’avait aimé à six ; elle lui faisait quelquefois des reproches de son oubli, il croyait en être fort justifié, en lui donnant pour toute raison une pomme d’apis, ou des marrons glacés. Enfin, la réputation de Babiole fit du bruit au royaume des Guenons ; le roi Magot eut grande envie de l’épouser, et dans ce dessein il envoya une célèbre ambassade, pour l’obtenir de la reine ; il n’eut pas de peine à faire entendre ses intentions à son premier ministre : mais il en aurait eu d’infinies à les exprimer, sans le secours des perroquets et des pies, vulgairement appelées margots ; celles-ci jasaient beaucoup, et les geais qui suivaient l’équipage, auraient été bien fâchés de caqueter moins qu’elles. Un gros singe appelé Mirlifiche, fut chef de l’ambassade : il fit faire un carrosse de carte, sur lequel on peignit les amours du roi Magot avec Monette Guenuche, fameuse dans l’empire Magotique ; elle mourut impitoyablement sous la griffe d’un chat sauvage, peu accoutumé à ses espiègleries. L’on avait donc représenté les douceurs que Magot et Monette avaient goûtées pendant leur mariage, et le bon naturel avec lequel ce roi l’avait pleurée après son trépas. Six lapins blancs, d’une excellente garenne, traînaient ce carrosse, appelé par honneur carrosse du corps : on voyait ensuite un chariot de paille peinte de plusieurs couleurs, dans lequel étaient les guenons destinées à Babiole ; il fallait voir comme elles étaient parées : il paraissait vraisemblablement qu’elles venaient à la noce. Le reste du cortège était composé de petits épagneuls, de levrons, de chats d’Espagne, de rats de Moscovie, de quelques hérissons, de subtiles belettes, de friands renards ; les uns menaient les chariots, les autres portaient le bagage. Mirlifiche, sur le tout, plus grave qu’un dictateur romain, plus sage qu’un Caton, montait un jeune levraut qui allait mieux l’amble qu’aucun guildain d’Angleterre.
La reine ne savait rien de cette magnifique ambassade, lorsqu’elle parvint jusqu’à son palais. Les éclats de rire du peuple et de ses gardes l’ayant obligée de mettre la tête à la fenêtre, elle vit la plus extraordinaire cavalcade qu’elle eût vue de ses jours. Aussitôt Mirlifiche, suivi d’un nombre considérable de singes, s’avança vers le chariot des guenuches, et donnant la patte à la grosse guenon, appelée Gigogna, il l’en fit descendre, puis lâchant le petit perroquet qui devait lui servir d’interpète, il attendit que ce bel oiseau se fût présenté à la reine, et lui eût demandé audience de sa part. Perroquet s’élevant doucement en l’air, vint sur la fenêtre d’où la reine regardait, et lui dit d’un ton de voix le plus joli du monde : « Madame, monseigneur le comte de Mirlifiche, ambassadeur du célèbre Magot, roi des singes, demande audience à votre majesté, pour l’entretenir d’une affaire très importante.
— Beau perroquet, lui dit la reine en le caressant, commencez par manger une rôtie, et buvez un coup ; après cela, je consens que vous alliez dire au comte Mirlifiche qu’il est le très bienvenu dans mes états, lui et tout ce qui l’accompagne. Si le voyage qu’il a fait depuis Magotie jusqu’ici ne l’a point trop fatigué, il peut tout à l’heure entrer dans la salle d’audience, où je vais l’attendre sur mon trône avec toute ma cour. »
A ces mots, Perroquet baissa deux fois la patte, battit la garde, chanta un petit air en signe de joie ; et reprenant son vol, il se percha sur l’épaule de Mirlifiche, et lui dit à l’oreille la réponse favorable qu’il venait de recevoir. Mirlifiche n’y fut pas insensible ; il fit demander à un des officiers de la reine par Margot, la pie, qui s’était érigée en sous-interprète, s’il voulait bien lui donner une chambre pour se délasser pendant quelques moments. On ouvrit aussitôt un salon, pavé de marbre peint et doré, qui était des plus propres du palais ; il y entra avec une partie de sa suite ; mais comme les singes sont grands fureteurs de leur métier, ils allèrent découvrir un certain coin, dans lequel on avait arrangé maints pots de confiture ; voilà mes gloutons après ; l’un tenait une tasse de cristal pleine d’abricots, l’autre une bouteille de sirop ; celui-ci des pâtés, celui-là des massepains. La gente volatile qui faisait cortège, s’ennuyait de voir un repas où elle n’avait ni chènevis, ni millet ; et un geai, grand causeur de son métier, vola dans la salle d’audience, où s’approchant respectueusement de la reine : « Madame, lui dit-il, je suis trop serviteur de votre majesté, pour être complice bénévole du dégât qui se fait de vos très douces confitures : le comte Mirlifiche en a déjà mangé trois boîtes pour sa part : il croquait la quatrième sans aucun respect de la majesté royale, lorsque le cœur pénétré, je vous en suis venu donner avis. — Je vous remercie, petit geai, mon ami, dit la reine en souriant, mais je vous dispense d’avoir tant de zèle pour mes pots de confitures, je les abandonne en faveur de Babiole que j’aime de tout mon cœur. » Le geai un peu honteux de la levée de bouclier qu’il venait de faire, se retira sans dire mot.
L’on vit entrer quelques moments après l’ambassadeur avec sa suite : il n’était pas tout à fait habillé à la mode, car depuis le retour du fameux Fagotin, qui avait tant brillé dans le monde, il ne leur était venu aucun bon modèle : son chapeau était pointu, avec un bouquet de plumes vertes, un baudrier de papier bleu, couvert de papillotes d’or, de gros canons et une canne. Perroquet qui passait pour un assez bon poète, ayant composé une harangue fort sérieuse, s’avança jusqu’au pied du trône où la reine était assise ; il s’adressa à Babiole, et parla ainsi :
Madame, de vos yeux connaissez la puissance,
Par l’amour dont Magot ressent la violence.
Ces singes et ces chats, ce cortège pompeux,
Ces oiseaux, tout ici vous parle de ses feux,
Lorsque d’un chat sauvage éprouvant la furie,
Monette (c’est le nom d’une guenon chérie)
Madame, je ne peux la comparer qu’à vous,
Lorsqu’elle fut ravie à Magot son époux,
Le roi jura cent fois qu’à ses mânes, fidèle,
Il lui conserverait un amour éternel.
Madame, vos appas ont chassé de son cœur
Le tendre souvenir de sa première ardeur.
Il ne pense qu’à vous : si vous saviez, madame,
Jusques à quel excès il a porté sa flamme,
Sans doute votre cœur, sensible à la pitié,
Pour adoucir ses maux, en prendrait la moitié !
Lui qu’on voyait jadis gros, gras, dispos, allègre,
Maintenant inquiet, tout défait et tout maigre,
Un éternel souci semble le consumer,
Madame, qu’il sent bien ce que c’est que d’aimer !
Les olives, les noix dont il était avide,
Ne lui paraissent plus qu’un ragoût insipide.
Il se meurt : c’est à vous que nous avons recours !
Vous seule, vous pouvez nous conserver ses jours.
Je ne vous dirai point les charmants avantages
Que vous pouvez trouver dans nos heureuses plages.
La figue et le raisin y viennent à foison,
Là, les fruits les plus beaux sont de toute saison.
Perroquet eut à peine fini son discours, que la reine jeta les yeux sur Babiole, qui de son côté se trouvait si interdite, qu’on ne l’a jamais été davantage ; la reine voulut savoir son sentiment avant que de répondre. Elle dit à Perroquet de faire entendre à monsieur l’ambassadeur qu’elle favoriserait les prétentions de son roi, en tout ce qui dépendrait d’elle. L’audience finie, elle se retira, et Babiole la suivit dans son cabinet : « Ma petite guenuche, lui dit-elle, je t’avoue que j’aurai bien du regret de ton éloignement, mais il n’y a pas moyen de refuser le Magot qui te demande en mariage, car je n’ai pas encore oublié que son père mit deux cent mille singes en campagne, pour soutenir une grande guerre contre le mien ; ils mangèrent tant de nos sujets, que nous fûmes obligés de faire une paix assez honteuse. — Cela signifie, madame, répliqua impatiemment Babiole, que vous êtes résolue de me sacrifier à ce vilain monstre, pour éviter sa colère ; mais je supplie au moins votre majesté de m’accorder quelques jours pour prendre ma dernière résolution. — Cela est juste, dit la reine ; néanmoins, si tu veux m’en croire, détermine-toi promptement ; considère les honneurs qu’on te prépare ; la magnificence de l’ambassade, et quelles dames d’honneur on t’envoie ; je suis sûre que jamais Magot n’a fait pour Monette, ce qu’il fait pour toi.— Je ne sais ce qu’il a fait pour Monette, répondit dédaigneusement la petite Babiole, mais je sais bien que je suis peu touchée des sentiments dont il me distingue. »
Elle se leva aussitôt, et faisant la révérence de bonne grâce, elle fut chercher le prince pour lui conter ses douleurs. Dès qu’il la vit, il s’écria : « Hé bien, ma Babiole, quand danserons-nous à ta noce ? — Je l’ignore, seigneur, lui dit-elle tristement ; mais l’état où je me trouve est si déplorable, que je ne suis plus la maîtresse de vous taire mon secret, et quoiqu’il en coûte à ma pudeur, il faut que je vous avoue que vous êtes le seul que je puisse souhaiter pour époux. — Pour époux ! dit le prince, en éclatant de rire ; pour époux, ma guenuche ! je suis charmé de ce que tu me dis ; j’espère cependant que tu m’excuseras, si je n’accepte point le parti ; car enfin, notre taille, notre air et nos manières ne sont pas tout à fait convenables. — J’en demeure d’accord, dit-elle, et surtout nos cœurs ne se ressemblent point ; vous êtes un ingrat, il y a longtemps que je m’en aperçois, et je suis bien extravagante de pouvoir aimer un prince qui le mérite si peu. — Mais, Babiole, dit-il, songe à la peine que j’aurais de te voir perchée sur la pointe d’un sycomore, tenant une branche par le bout de la queue : crois-moi, tournons cette affaire en raillerie pour ton honneur et pour le mien, épouse le roi Magot, et en faveur de la bonne amitié qui est entre nous, envoie-moi le premier Magotin de ta façon. — Vous êtes heureux, seigneur, ajouta Babiole, que je n’ai pas tout à fait l’esprit d’une guenuche ; une autre que moi vous aurait déjà crevé les yeux, mordu le nez, arraché les oreilles ; mais je vous abandonne aux réflexions que vous ferez un jour sur votre indigne procédé. » Elle n’en put dire davantage, sa gouvernante vint la chercher, l’ambassadeur Mirlifiche s’était rendu dans son appartement, avec des présents magnifiques.
Il y avait une toilette de réseau d’araignée, brodée de petits vers luisants, une coque d’œuf renfermait les peignes, un bigarreau servait de pelote, et tout le linge était garni de dentelles de papier : il y avait encore dans une corbeille plusieurs coquilles proprement assorties, les unes pour servir de pendants d’oreilles, les autres de poinçons, et cela brillait comme des diamants : ce qui était bien meilleur, c’était une douzaine de boîtes pleines de confitures avec un petit coffre de verre dans lequel étaient renfermées une noisette et une olive, mais la clé était perdue, et Babiole s’en mit peu en peine.
L’ambassadeur lui fit entendre en grommelant, qui est la langue dont on se sert en Magotie, que son monarque était plus touché de ses charmes qu’il l’eût été de sa vie d’aucune guenon ; qu’il lui faisait bâtir un palais, au plus haut d’un sapin ; qu’il lui envoyait ces présents, et même de bonnes confitures pour lui marquer son attachement : qu’ainsi le roi son maître ne pouvait lui témoigner mieux son amitié : « Mais, ajouta-t-il, la plus forte épreuve de sa tendresse, et à laquelle vous devez être la plus sensible, c’est, madame, au soin qu’il a pris de se faire peindre pour vous avancer le plaisir de le voir. » Aussitôt il déploya le portrait du roi des singes assis sur un gros billot, tenant une pomme qu’il mangeait.
Babiole détourna les yeux pour ne pas regarder plus longtemps une figure si désagréable, et grondant trois ou quatre fois, elle fit entendre à Mirlifiche qu’elle était obligée à son maître de son estime ; mais qu’elle n’avait pas encore déterminé si elle voulait se marier.
Cependant la reine avait résolu de ne se point attirer la colère des singes, et ne croyant pas qu’il fallût beaucoup de cérémonies pour envoyer Babiole où elle voulait qu’elle allât, elle fit préparer tout pour son départ. A ces nouvelles le désespoir s’empara tout à fait de son cœur : les mépris du prince d’un côté ; de l’autre l’indifférence de la reine, et plus que tout cela, un tel époux, lui firent prendre la résolution de s’enfuir : ce n’était pas une chose bien difficile ; depuis qu’elle parlait, on ne l’attachait plus, elle allait, elle venait et rentrait dans sa chambre aussi souvent par la fenêtre que par la porte.
Elle se hâta donc de partir, sautant d’arbre en arbre, de branche en branche jusqu’au bord d’une rivière ; l’excès de son désespoir l’empêcha de comprendre le péril où elle allait se mettre en voulant la passer à la nage, et sans rien examiner, elle se jeta dedans : elle alla aussitôt au fond. Mais comme elle ne perdit point le jugement, elle aperçut une grotte magnifique, toute ornée de coquilles, elle se hâta d’y entrer ; elle y fut reçue par un vénérable vieillard, dont la barbe descendait jusqu’à sa ceinture : il était couché sur des roseaux et des glaïeuls, il avait une couronne de pavots et de lis sauvages ; il s’appuyait contre un rocher, d’où coulaient plusieurs fontaines qui grossissaient la rivière.
« Hé ! qui t’amène ici, petite Babiole ? dit-il, en lui tendant la main. — Seigneur, répondit-elle, je suis une guenuche infortunée, je fuis un singe affreux que l’on veut me donner pour époux. — Je sais plus de tes nouvelles que tu ne penses, ajouta le sage vieillard ; il est vrai que tu abhorres Magot, mais il n’est pas moins vrai que tu aimes un jeune prince, qui n’a pour toi que de l’indifférence. — Ah ! seigneur, s’écria Babiole en soupirant, n’en parlons point, son souvenir augmente toutes mes douleurs. — Il ne sera pas toujours rebelle à l’amour, continua l’hôte des poissons, je sais qu’il est réservé à la plus belle princesse de l’univers. — Malheureuse que je suis ! continua Babiole. Il ne sera donc jamais pour moi ! » Le bonhomme sourit, et lui dit : « Ne t’afflige point, bonne Babiole, le temps est un grand maître, prend seulement garde de ne pas perdre le petit coffre de verre que le Magot t’a envoyé, et que tu as par hasard dans ta poche, je ne t’en puis dire davantage : voici une tortue qui va bon train, assois-toi dessus, elle te conduira où il faut que tu ailles. — Après les obligations dont je vous suis redevable, lui dit-elle, je ne puis me passer de savoir votre nom. — On me nomme, dit-il, Biroqua, père de Biroquie, rivière, comme tu vois, assez grosse et assez fameuse. »
Babiole monta sur sa tortue avec beaucoup de confiance, elles allèrent pendant longtemps sur l’eau, et enfin à un détour qui paraissait long, la tortue gagna le rivage. Il serait difficile de rien trouver de plus galant que la selle à l’anglaise et le reste de son harnais ; il y avait jusqu’à de petits pistolets d’arçon, auxquels deux corps d’écrevisses servaient de fourreaux.
Babiole voyageait avec une entière confiance sur les promesses du sage Biroqua, lorsqu’elle entendit tout d’un coup un assez grand bruit. Hélas ! hélas ! c’était l’ambassadeur Mirlifiche, avec tous ses mirlifichons, qui retournaient en Magotie, tristes et désolés de la fuite de Babiole. Un singe de la troupe était monté à la dînée sur un noyer, pour abattre des noix et nourrir les magotins ; mais il fut à peine au haut de l’arbre, que regardant de tous côtés, il aperçut Babiole sur la pauvre tortue, qui cheminait lentement en pleine campagne. A cette vue il se prit à crier si fort, que les singes assemblés lui demandèrent en leur langage de quoi il était question ; il le dit : on lâcha aussitôt les perroquets, les pies et geais, qui volèrent jusqu’où elle était, et sur leur rapport l’ambassadeur, les guenons et le reste de l’équipage coururent et l’arrêtèrent.
Quel déplaisir pour Babiole ! il serait difficile d’en avoir un plus grand et plus sensible ; on la contraignit de monter dans le carrosse du corps, il fut aussitôt entouré des plus vigilantes guenons, de quelques renards et d’un coq qui se percha sur l’impériale, faisant la sentinelle jour et nuit. Un singe menait la tortue en main, comme un animal rare : ainsi la cavalcade continua son voyage au grand déplaisir de Babiole qui n’avait pour toute compagnie que madame Gigogna, guenon acariâtre et peu complaisante.
Au bout de trois jours, qui s’étaient passés sans aucune aventure, les guides s’étant égarés, ils arrivèrent tous dans une grande et fameuse ville qu’ils ne connaissaient point ; mais ayant aperçu un beau jardin, dont la porte était ouverte, ils s’y arrêtèrent, et firent main-basse partout, comme en pays de conquête. L’un croquait des noix, l’autre gobait des cerises, l’autre dépouillait un prunier ; enfin, il n’y avait si petit singenot qui n’allât à la picorée, et qui ne fît magasin.
Il faut savoir que cette ville était la capitale du royaume où Babiole avait pris naissance ; que la reine, sa mère, y demeurait, et que depuis le malheur qu’elle avait eu de voir métamorphoser sa fille en guenuche, par le bouquet d’aubépine, elle n’avait jamais voulu souffrir dans ses états, ni guenuches, ni sapajou, ni magot, enfin rien qui pût rappeler à son souvenir la fatalité de sa déplorable aventure. On regardait là un singe comme un perturbateur du repos public. De quel étonnement fut donc frappé le peuple, en voyant arriver un carrosse de carte, un chariot de paille peinte, et le reste du plus surprenant équipage qui se soit vu depuis que les contes sont contes, et que les fées sont fées ?
Ces nouvelles volèrent au palais, la reine demeura transie, elle crut que la gente singenote voulait attenter à son autorité. Elle assembla promptement son conseil, elle les fit condamner tous comme criminels de lèse-majesté ; et ne voulant pas perdre l’occasion de faire un exemple assez fameux pour qu’on s’en souvînt à l’avenir, elle envoya ses gardes dans le jardin, avec ordre de prendre tous les singes. Ils jetèrent de grands filets sur les arbres, la chasse fut bientôt faite, et, malgré le respect dû à la qualité d’ambassadeur, ce caractère se trouva fort méprisé en la personne de Mirlifiche, que l’on jeta impitoyablement dans le fond d’une cave sous un grand poinçon vide, où lui et ses camarades furent emprisonnés, avec les dames guenuches et les demoiselles guenuchonnes, qui accompagnaient Babiole.
A son égard elle ressentait une joie secrète de ce nouveau désordre : quand les disgrâces sont à un certain point, l’on n’appréhende plus rien, et la mort même peut être envisagée comme un bien ; c’était la situation où elle se trouvait, le cœur occupé du prince, qui l’avait méprisée, et l’esprit rempli de l’affreuse idée du roi Magot, dont elle était sur le point de devenir la femme. Au reste, il ne faut pas oublier de dire que son habit était si joli et ses manières si peu communes, que ceux qui l’avaient prise s’arrêtèrent à la considérer comme quelque chose de merveilleux ; et lorsqu’elle leur parla, ce fut bien un autre étonnement, ils avaient déjà entendu parler de l’admirable Babiole. La reine qui l’avait trouvée, et qui ne savait point la métamorphose de sa nièce, avait écrit très souvent à sa sœur, qu’elle possédait une guenuche merveilleuse, et qu’elle la priait de la venir voir ; mais la reine affligée passait cet article sans le vouloir lire. Enfin les gardes, ravis d’admiration, portèrent Babiole dans une grande galerie, ils y firent un petit trône ; elle s’y plaça plutôt en souveraine qu’en guenuche prisonnière, et la reine venant à passer, demeura si vivement surprise de sa jolie figure, et du gracieux compliment qu’elle lui fit, que malgré elle, la nature parla en faveur de l’infante.
Elle la prit entre ses bras. La petite créature animée de son côté par des mouvements qu’elle n’avait point encore ressentis, se jeta à son cou, et lui dit des choses si tendres et si engageantes, qu’elle faisait l’admiration de tous ceux qui l’entendaient. « Non, madame, s’écriait-elle, ce n’est point la peur d’une mort prochaine, dont j’apprends que vous menacez l’infortunée race des singes, qui m’effraie et qui m’engage de chercher les moyens de vous plaire et de vous adoucir ; la fin de ma vie n’est pas le plus grand malheur qui puisse m’arriver, et j’ai des sentiments si fort au-dessus de ce que je suis, que je regretterais la moindre démarche pour ma conservation ; c’est donc par rapport à vous seule, madame, que je vous aime, votre couronne me touche bien moins que votre mérite. »
A votre avis, que répondre à une Babiole si complimenteuse et si révérencieuse ? La reine plus muette qu’une carpe, ouvrait deux grands yeux, croyait rêver, et sentait que son cœur était fort ému.
Elle emporta la guenuche dans son cabinet. Lorsqu’elles furent seules, elle lui dit : « Ne diffère pas un moment à me conter tes aventures ; car je sens bien que de toutes les bestioles qui peuplent les ménageries, et que je garde dans mon palais, tu seras celle que j’aimerai davantage : je t’assure même qu’en ta faveur je ferai grâce aux singes qui t’accompagnent. — Ha ! madame, s’écria-t-elle, je ne vous en demande point pour eux : mon malheur m’a fait naître guenuche, et ce même malheur m’a donné un discernement qui me fera souffrir jusqu’à la mort ; car enfin, que puis-je ressentir lorsque je me vois dans mon miroir, petite, laide et noire, ayant des pattes couvertes de poils, avec une queue et des dents toujours prêtes à mordre, et que d’ailleurs je ne manque point d’esprit, que j’ai du goût, de la délicatesse et des sentiments ? — Es-tu capable, dit la reine, d’en avoir de tendresse ? » Babiole soupira sans rien répondre. « Oh ! continua la reine, il faut me dire si tu aimes un singe, un lapin ou un écureuil ; car si tu n’es point trop engagée, j’ai un nain qui serait bien ton fait. » Babiole à cette proposition prit un air dédaigneux, dont la reine s’éclata de rire. « Ne te fâche point, lui dit-elle, et apprends-moi par quel hasard tu parles ? »
« Tout ce que je sais de mes aventures, répliqua Babiole, c’est que la reine, votre sœur, vous eut à peine quittée, après la naissance et la mort de la princesse, votre fille, qu’elle vit en passant sur le bord de la mer, un de vos valets de chambre qui voulait me noyer. Je fus arrachée de ses mains par son ordre ; et par un prodige dont tout le monde fut également surpris, la parole et la raison me vinrent : l’on me donna des maîtres qui m’apprirent plusieurs langues, et à toucher des instruments enfin, madame, je devins sensible à mes disgrâces, et ... Mais, s’écria-t-elle, voyant le visage de la reine pâle et couvert d’une sueur froide : qu’avez-vous, madame ? Je remarque un changement extraordinaire en votre personne. — Je me meurs ! dit la reine d’une voix faible et mal articulée ; je me meurs, ma chère et trop malheureuse fille ! c’est donc aujourd’hui que je te retrouve. » A ces mots, elle s’évanouit. Babiole effrayée, courut appeler du secours, les dames de la reine se hâtèrent de lui donner de l’eau, de la délacer et de la mettre au lit ; Babiole s’y fourra avec elle, l’on n’y prit pas seulement garde, tant elle était petite.
Quand la reine fut revenue de la longue pâmoison où le discours de la princesse l’avait jetée, elle voulut rester seule avec les dames qui savaient le secret de la fatale naissance de sa fille, elle leur raconta ce qui lui était arrivé, dont elles demeurèrent si éperdues, qu’elles ne savaient quel conseil lui donner. Mais elle leur commanda de lui dire ce qu’elles croyaient à propos de faire dans une conjoncture si triste. Les unes dirent qu’il fallait étouffer la guenuche, d’autres la renfermer dans un trou, d’autres encore la voulaient renvoyer à la mer. La reine pleurait et sanglotait. « Elle a tant d’esprit, disait-elle, quel dommage de la voir réduite par un bouquet enchanté, dans ce misérable état ? Mais au fond, continuait-elle, c’est ma fille, c’est mon sang, c’est moi qui lui ai attiré l’indignation de la méchante Fanferluche ; est-il juste qu’elle souffre de la haine que cette fée a pour moi ? — Oui, madame, s’écria sa vieille dame d’honneur, il faut sauver votre gloire ; que penserait-on dans le monde, si vous déclariez qu’une monne est votre infante ? Il n’est point naturel d’avoir de tels enfants, quand on est aussi belle que vous. » La reine perdait patience de l’entendre raisonner ainsi. Elle et les autres n’en soutenaient pas avec moins de vivacité, qu’il fallait exterminer ce petit monstre ; et pour conclusion, elle résolut d’enfermer Babiole dans un château, où elle serait bien nourrie et bien traitée le reste de ses jours.
Lorsqu’elle entendit que la reine voulait la mettre en prison, elle se coula tout doucement par la ruelle du lit, et se jetant de la fenêtre sur un arbre du jardin, elle se sauva jusqu’à la grande forêt, et laissa tout le monde en rumeur de ne la point trouver.
Elle passa la nuit dans le creux d’un chêne, où elle eut le temps de moraliser sur la cruauté de sa destinée : mais ce qui lui faisait plus de peine, c’était la nécessité où on la mettait de quitter la reine ; cependant elle aimait mieux s’exiler volontairement, et demeurer maîtresse de sa liberté, que de la perdre pour jamais.
Dès qu’il fut jour, elle continua son voyage, sans savoir où elle voulait aller, pensant et repensant mille fois à la bizarrerie d’une aventure si extraordinaire. « Quelle différence, s’écriait-elle, de ce que je suis, à ce que je devrais être ! » Les larmes coulaient abondamment des petits yeux de la pauvre Babiole. Aussitôt que le jour parut, elle partit : elle craignait que la reine ne la fît suivre, ou que quelqu’un des singes échappés de la cave ne la menât malgré elle au roi Magot ; elle alla tant et tant, sans suivre ni chemin ni sentier, qu’elle arriva dans un grand désert où il n’y avait ni maison, ni arbre, ni fruits, ni herbe, ni fontaine : elle s’y engagea sans réflexion, et lorsqu’elle commença d’avoir faim, elle connut, mais trop tard, qu’il y avait bien de l’imprudence à voyager dans un tel pays.
Deux jours et deux nuits s’écoulèrent, sans qu’elle pût même attraper un vermisseau, ni un moucheron : la crainte de la mort la prit ; elle était si faible qu’elle s’évanouissait, elle se coucha par terre, et venant à se souvenir de l’olive et de la noisette qui étaient encore dans le petit coffre de verre, elle jugea qu’elle en pourrait faire un léger repas. Toute joyeuse de ce rayon d’espérance, elle prit une pierre, mit le coffre en pièce, et croqua l’olive. Mais elle y eut à peine donné un coup de dent, qu’il en sortit une si grande abondance d’huile parfumée, que tombant sur ses pattes, elles devinrent les plus belles mains du monde ; sa surprise fut extrême, elle prit de cette huile, et s’en frotta tout entière ! merveille ! Elle se rendit sur-le-champ si belle, que rien dans l’univers ne pouvait l’égaler ; elle se sentait de grands yeux, une petite bouche, le nez bien fait, elle mourait d’envie d’avoir un miroir ; enfin elle s’avisa d’en faire un du plus grand morceau de verre de son coffre. O quand elle se vit, quelle joie ! quelle surprise agréable ! Ses habits grandirent comme elle, elle était bien coiffée, ses cheveux faisaient mille boucles, son teint avait la fraîcheur des fleurs du printemps.
Les premiers moments de sa surprise étant passés, la faim se fit ressentir plus pressante, et ses regrets augmentèrent étrangement. « Quoi ! disait-elle, si belle et si jeune, née princesse comme je le suis, il faut que je périsse dans ces tristes lieux. O ! barbare fortune qui m’as conduite ici ; qu’ordonnes-tu de mon sort ? Est-ce pour m’affliger davantage que tu as fait un changement si heureux et si inespéré en moi ? Et toi, vénérable fleuve Biroqua, qui me sauvas la vie si généreusement, me laisseras-tu périr dans cette affreuse solitude ? » L’infante demandait inutilement du secours, tout était sourd à sa voix : la nécessité de manger la tourmentait à tel point, qu’elle prit la noisette et la cassa : mais en jetant la coquille, elle fut bien surprise d’en voir sortir des architectes, des peintres, des maçons, des tapissiers, des sculpteurs, et mille autres sortes d’ouvriers ; les uns dessinent un palais, les autres le bâtissent, d’autres le meublent ; ceux-là peignent les appartements, ceux-ci cultivent les jardins, tout brille d’or et d’azur : l’on sert un repas magnifique ; soixante princesses mieux habillées que des reines, menées par des écuyers, et suivies de leurs pages, lui vinrent faire de grands compliments, et la convièrent au festin qui l’attendait. Aussitôt Babiole, sans se faire prier, s’avança promptement vers le salon ; et là d’un air de reine, elle mangea comme une affamée. A peine fut-elle hors de table, que ses trésoriers firent apporter devant elle quinze mille coffres, grands comme des muids, remplis d’or et de diamants : ils lui demandèrent si elle avait agréable qu’ils payassent les ouvriers qui avaient bâti son palais. Elle dit que cela était juste, à condition qu’ils bâtiraient aussi une ville, qu’ils se marieraient, et resteraient avec elle. Tous y consentirent, la ville fut achevée en trois quarts d’heure, quoiqu’elle fût cinq fois plus grande que Rome. Voilà bien des prodiges sortis d’une petite noisette.
La princesse minutait dans son esprit d’envoyer une célèbre ambassade à la reine sa mère, et de faire faire quelques reproches au jeune prince, son cousin. En attendant qu’elle prît là-dessus les mesures nécessaires, elle se divertissait à voir courre la bague, dont elle donnait toujours le prix, au jeu, à la comédie, à la chasse et à la pêche, car l’on y avait conduit une rivière. Le bruit de sa beauté se répandait par tout l’univers ; il venait à sa cour des rois, des quatre coins du monde, des géants plus hauts que les montagnes, et des pygmées plus petits que des rats.
Il arriva qu’un jour que l’on faisait une grande fête, où plusieurs chevaliers rompaient des lances, ils en vinrent à se fâcher, les uns contre les autres, ils se battirent et se blessèrent. La princesse en colère descendit de son balcon pour reconnaître les coupables : mais lorsqu’on les eut désarmés, que devint-elle quand elle vit le prince, son cousin. S’il n’était pas mort, il s’en fallait si peu, qu’elle en pensa mourir elle-même de surprise et de douleur. Elle le fit porter dans le plus bel appartement du palais, où rien ne manquait de tout ce qui lui était nécessaire pour sa guérison, médecin de Chodrai, chirurgiens, onguents, bouillons, sirops ; l’infante faisait elle-même les bandes et les charpies, ses yeux les arrosaient de larmes, et ces larmes auraient dû servir de baume au malade. Il l’était en effet de plus d’une manière : car sans compter une demi-douzaine de coups d’épée, et autant de coups de lance qui le perçaient de part en part, il était depuis longtemps incognito dans cette cour, et il avait éprouvé le pouvoir des beaux yeux de Babiole, d’une manière à n’en guérir de sa vie. Il est donc aisé de juger à présent d’une partie de ce qu’il ressentit, quand il put lire sur le visage de cette aimable princesse, qu’elle était dans la dernière douleur de l’état où il était réduit. Je ne m’arrêterai point à redire toutes les choses que son cœur lui fournit pour la remercier des bontés qu’elle lui témoignait ; ceux qui l’entendirent furent surpris qu’un homme si malade pût marquer tant de passion et de reconnaissance. L’infante qui en rougit plus d’une fois, le pria de se taire ; mais l’émotion et l’ardeur de ses discours le menèrent si loin, qu’elle le vit tomber tout d’un coup dans une agonie affreuse. Elle s’était armée jusque-là de constance ; enfin, elle la perdit à tel point qu’elle s’arracha les cheveux, qu’elle jeta les hauts cris, et qu’elle donna lieu de croire à tout le monde, que son cœur était de facile accès, puisqu’en si peu de temps, elle avait pris tant de tendresse pour un étranger ; car on ne savait point en Babiolie (c’est le nom qu’elle avait donné à son royaume) que le prince était son cousin, et qu’elle l’aimait dès sa plus grande jeunesse.
C’était en voyageant qu’il s’était arrêté dans cette cour, et comme il n’y connaissait personne pour le présenter à l’infante, il crut que rien ne ferait mieux que de faire devant elle cinq ou six galanteries de héros c’est-à-dire, couper bras et jambes aux chevaliers du tournoi mais il n’en trouva aucun assez complaisant pour le souffrir. Il y eut donc une rude mêlée ; le plus fort battit le plus faible, et ce plus faible, comme je l’ai déjà dit, fut le prince. Babiole désespérée, courait les grands chemins sans carrosse et sans gardes, elle entra ainsi dans un bois, elle tomba évanouie au pied d’un arbre, où la fée Fanferluche qui ne dormait point, et qui ne cherchait que des occasions de mal faire, vint l’enlever dans une nuée plus noire que de l’encre, et qui allait plus vite que le vent. La princesse resta quelque temps sans aucune connaissance : enfin elle revint à elle ; jamais surprise n’a été égale à la sienne, de se retrouver si loin de la terre, et si proche du pôle ; le parquet de nuée n’est pas solide, de sorte qu’en courant de-çà et de-là, il lui semblait marcher sur des plumes, et la nuée s’entrouvrant, elle avait beaucoup de peine de s’empêcher de tomber ; elle ne trouvait personne avec qui se plaindre, car la méchante Fanferluche s’était rendue invisible : elle eut le temps de penser à son cher prince, et à l’état où elle l’avait laissé, et elle s’abandonna aux sentiments les plus douloureux qui puissent occuper une âme. « Quoi ! s’écriait-elle, je suis encore capable de survivre à ce que j’aime, et l’appréhension d’une mort prochaine trouve quelque place dans mon cœur ! Ah ! si le soleil voulait me rôtir, qu’il me rendrait un bon office ; ou si je pouvais me noyer dans l’arc-en-ciel, que je serais contente ! Mais, hélas ! tout le zodiaque est sourd à ma voix, le Sagittaire n’a point de flèches, le Taureau de cornes et le Lion de dents : peut-être que la terre sera plus obligeante, et qu’elle m’offrira la pointe d’un rocher sur lequel je me tuerai. O ! prince, mon cher cousin, que n’êtes-vous ici, pour me voir faire la plus tragique cabriole dont une amante désespérée se puisse aviser. » En achevant ces mots, elle courut au bout de la nuée, et se précipita comme un trait que l’on décoche avec violence.
Tous ceux qui la virent, crurent que c’était la lune qui tombait ; et comme l’on était pour lors en décours, plusieurs peuples qui l’adorent et qui restent du temps sans la revoir, prirent le grand deuil, et se persuadèrent que le soleil, par jalousie, lui avait joué ce mauvais tour.
Quelque envie qu’eût l’infante de mourir, elle n’y réussit pas, elle tomba dans la bouteille de verre où les fées mettaient ordinairement leur ratafia au soleil : mais quelle bouteille ! il n’y a point de tour dans l’univers qui soit si grande ; par bonheur elle était vide, car elle s’y serait noyée comme une mouche.
Six géants la gardaient, ils reconnurent aussitôt l’infante ; c’étaient les mêmes qui demeuraient dans sa cour et qui l’aimaient : la maligne Fanferluche qui ne faisait rien au hasard, les avait transportés là, chacun sur un dragon volant, et ces dragons gardaient la bouteille quand les géants dormaient. Pendant qu’elle y fut, il y eut bien des jours où elle regretta sa peau de guenuche ; elle vivait comme les caméléons, de l’air et de la rosée.
La prison de l’infante n’était sue de personne ; le jeune prince l’ignorait, il n’était pas mort, et demandait sans cesse Babiole. Il s’apercevait assez, par la mélancolie de tous ceux qui le servaient, qu’il y avait un sujet de douleur générale à la cour ; sa discrétion naturelle l’empêcha de chercher à la pénétrer ; mais lorsqu’il fut convalescent, il pressa si fort qu’on lui apprît des nouvelles de la princesse, que l’on n’eut pas le courage de lui celer sa perte. Ceux qui l’avaient vue entrer dans le bois, soutenaient qu’elle y avait été dévorée par les lions ; et d’autres croyaient qu’elle s’était tuée de désespoir ; d’autres encore qu’elle avait perdu l’esprit, et qu’elle allait errante par le monde.
Comme cette dernière opinion était la moins terrible, et qu’elle soutenait un peu l’espérance du prince, il s’y arrêta, et partit sur Criquetin dont j’ai déjà parlé, mais je n’ai pas dit que c’était le fils aîné de Bucéphale, et l’un des meilleurs chevaux qu’on ait vus dans ce siècle-là : il lui mit la bride sur le cou, et le laissa aller à l’aventure ; il appelait l’infante, les échos seuls lui répondaient.
Enfin il arriva au bord d’une grosse rivière. Criquetin avait soif, il y entra pour boire, et le prince, selon la coutume, se mit à crier de toute sa force : « Babiole, belle Babiole, où êtes-vous ? »
Il entendit une voix, dont la douceur semblait réjouir l’onde : cette voix lui dit : « Avance, et tu sauras où elle est. » A ces mots, le prince aussi téméraire qu’amoureux, donne deux coups d’éperons à Criquetin, il nage et trouve un gouffre où l’eau plus rapide se précipitait, il tomba jusqu’au fond, bien persuadé qu’il s’allait noyer.
Il arriva heureusement chez le bonhomme Biroqua, qui célébrait les noces de sa fille avec un fleuve des plus riches et des plus graves de la contrée ; toutes les déités poissonneuses étaient dans sa grotte ; les tritons et les sirènes y faisaient une musique agréable, et la rivière Biroquie, légèrement vêtue, dansait les olivettes avec la Seine, la Tamise, l’Euphrate et le Gange, qui étaient assurément venus de fort loin pour se divertir ensemble. Criquetin, qui savait vivre, s’arrêta fort respectueusement à l’entrée de la grotte, et le prince qui savait encore mieux vivre que son cheval, faisant une profonde révérence, demanda s’il était permis à un mortel comme lui de paraître au milieu d’une si belle troupe.
Biroqua prit la parole, et répliqua d’un air affable qu’il leur faisait honneur et plaisir. « Il y a quelques jours que je vous attends, seigneur, continua-t-il, je suis dans vos intérêts, et ceux de l’infante me sont chers : il faut que vous la retiriez du lieu fatal où la vindicative Fanferluche l’a mise en prison, c’est dans une bouteille. — Ah ! que me dites-vous, s’écria le prince, l’infante est dans une bouteille ? — Oui, dit le sage vieillard, elle y souffre beaucoup : mais je vous avertis, seigneur, qu’il n’est pas aisé de vaincre les géants et les dragons qui la gardent, à moins que vous ne suiviez mes conseils. Il faut laisser ici votre bon cheval, et que vous montiez sur un dauphin ailé que je vous élève depuis longtemps. » Il fit venir le dauphin sellé et bridé, qui faisait si bien des voltes et courbettes, que Criquetin en fut jaloux.
Biroquie et ses compagnes s’empressèrent aussitôt d’armer le prince. Elles lui mirent une brillante cuirasse d’écailles de carpes dorées, on le coiffa de la coquille d’un gros limaçon, qui était ombragée d’une large queue de morue, élevée en forme d’aigrette ; une naïade le ceignit d’une anguille, de laquelle pendait une redoutable épée faite d’une longue arête de poisson ; on lui donna ensuite une large écaille de tortue dont il se fit un bouclier ; et dans cet équipage, il n’y eut si petit goujon qui ne le prît pour le dieu des soles, car il faut dire la vérité, ce jeune prince avait un certain air, qui se rencontre rarement parmi les mortels.
L’espérance de retrouver bientôt la charmante princesse qu’il aimait, lui inspira une joie dont il n’avait pas été capable depuis sa perte ; et la chronique de ce fidèle conte marque qu’il mangea de bon appétit chez Biroqua, et qu’il remercia toute la compagnie en des termes peu communs ; il dit adieu à son Criquetin, puis monta sur le poisson volant qui partit aussitôt. Le prince se trouva, à la fin du jour, si haut, que pour se reposer un peu, il entra dans le royaume de la lune. Les raretés qu’il y découvrit auraient été capables de l’arrêter, s’il avait eu un désir moins pressant de tirer son infante de la bouteille où elle vivait depuis plusieurs mois. L’aurore paraissait à peine lorsqu’il la découvrit environnée des géants et des dragons que la fée, par la vertu de sa petite baguette, avait retenus auprès d’elle ; elle croyait si peu que quelqu’un eût assez de pouvoir pour la délivrer, qu’elle se reposait sur la vigilance de ses terribles gardes pour la faire souffrir.
Cette belle princesse regardait pitoyablement le ciel, et lui adressait ses tristes plaintes, quand elle vit le dauphin volant et le chevalier qui venait la délivrer. Elle n’aurait pas cru cette aventure possible, quoiqu’elle sût, par sa propre expérience, que les choses les plus extraordinaires se rendent familières pour certaines personnes. « Serait-ce bien par la malice de quelques fées, disait-elle, que ce chevalier est transporté dans les airs ? Hélas, que je le plains, s’il faut qu’une bouteille ou une carafe lui serve de prison comme à moi ? »
Pendant qu’elle raisonnait ainsi, les géants qui aperçurent le prince au-dessus de leurs têtes, crurent que c’était un cerf-volant, et s’écrièrent l’un à l’autre : « Attrape, attrape la corde, cela nous divertira » ; mais lorsqu’ils se baissèrent, pour la ramasser, il fondit sur eux, et d’estoc et de taille, il les mit en pièces comme un jeu de cartes que l’on coupe par la moitié, et que l’on jette au vent. Au bruit de ce grand combat, l’infante tourna la tête, elle reconnut son jeune prince. Quelle joie d’être certaine de sa vie ! mais quelles alarmes de la voir dans un péril si évident, au milieu de ces terribles colosses, et des dragons qui s’élançaient sur lui ! Elle poussa des cris affreux, et le danger où il était pensa la faire mourir.
Cependant l’arête enchantée, dont Biroqua avait armé la main du prince, ne portait aucuns coups inutiles ; et le léger dauphin qui s’élevait et qui se baissait fort à propos, lui était aussi d’un secours merveilleux ; de sorte qu’en très peu de temps, la terre fut couverte de ces monstres. L’impatient prince, qui voyait son infante au travers du verre, l’aurait mis en pièces, s’il n’avait pas appréhendé de l’en blesser : il prit le parti de descendre par le goulot de la bouteille. Quand il fut au fond, il se jeta aux pieds de Babiole et lui baisa respectueusement la main. « Seigneur, lui dit-elle, il est juste que pour ménager votre estime, je vous apprenne les raisons que j’ai eues de m’intéresser si tendrement à votre conservation. Sachez que nous sommes proches parents, que je suis fille de la reine votre tante, et la même Babiole que vous trouvâtes sous la figure d’une guenuche au bord de la mer, et qui eut depuis la faiblesse de vous témoigner un attachement que vous méprisâtes. — Ah ! madame, s’écria le prince, dois-je croire un événement si prodigieux ? Vous avez été guenuche ; vous m’avez aimé, je l’ai su, et mon cœur a été capable de refuser le plus grand de tous les biens ! — J’aurais à l’heure qu’il est très mauvaise opinion de votre goût, répliqua l’infante en souriant, si vous aviez pu prendre alors quelque attachement pour moi : mais, seigneur, partons, je suis lasse d’être prisonnière, et je crains mon ennemie ; allons chez la reine ma mère, lui rendre compte de tant de choses extraordinaires qui doivent l’intéresser. — Allons, madame, allons, dit l’amoureux prince, en montant sur le dauphin ailé, et la prenant entre ses bras, allons lui rendre en vous la plus aimable princesse qui soit au monde. »
Le dauphin s’éleva doucement, et prit son vol vers la capitale où la reine passait sa triste vie ; la fuite de Babiole ne lui laissait pas un moment de repos, elle ne pouvait s’empêcher de songer à elle, de se souvenir des jolies choses qu’elle lui avait dites, et elle aurait voulu la revoir, toute guenuche qu’elle était, pour la moitié de son royaume.
Lorsque le prince fut arrivé, il se déguisa en vieillard, et lui fit demander une audience particulière. « Madame, lui dit-il, j’étudie dès ma plus tendre jeunesse l’art de nécromancien ; vous devez juger par là que je n’ignore point la haine que Fanferluche a pour vous, et les terribles effets qui l’ont suivie : mais essuyez vos pleurs, madame, cette Babiole que vous avez vue si laide, est à présent la plus belle princesse de l’univers ; vous l’aurez bientôt auprès de vous, si vous voulez pardonner à la reine votre sœur, la cruelle guerre qu’elle vous a faite, et conclure la paix par le mariage de votre infante avec le prince votre neveu. — Je ne puis me flatter de ce que vous me dites, répliqua la reine en pleurant ; sage vieillard, vous souhaitez d’adoucir mes ennuis, j’ai perdu ma chère fille, je n’ai plus d’époux, ma sœur prétend que mon royaume lui appartient, son fils est aussi injuste qu’elle ; ils me persécutent, je ne prendrai jamais alliance avec eux. — Le destin en ordonne autrement continua-t-il, je suis choisi pour vous l’apprendre ! — Hé ! de quoi me servirait, ajouta la reine, de consentir à ce mariage ? La méchante Fanferluche a trop de pouvoir et de malice, elle s’y opposera toujours. — Ne vous inquiétez pas, madame, répliqua le bonhomme, promettez-moi seulement que vous ne vous opposerez point au mariage que l’on désire. — Je promets tout, s’écria la reine, pourvu que je revoie ma chère fille. »
Le prince sortit, et courut où l’infante l’attendait. Elle demeura surprise de le voir déguisé, et cela l’obligea de lui raconter que depuis quelque temps, les deux reines avaient eu de grands intérêts à démêler, et qu’il y avait beaucoup d’aigreur entre elles, mais qu’enfin il venait de faire consentir sa tante à ce qu’il souhaitait. La princesse fut ravie, elle se rendit au palais ; tous ceux qui la virent passer lui trouvèrent une si parfaite ressemblance avec sa mère, qu’on s’empressa de les suivre, pour savoir qui elle était.
Dès que la reine l’aperçut, son cœur s’agita si fort, qu’il ne fallut point d’autre témoignage de la vérité de cette aventure. La princesse se jeta à ses pieds, la reine la reçut entre ses bras ; et après avoir demeuré longtemps sans parler, essuyant leurs larmes par mille tendres baisers, elles se redirent tout ce qu’on peut imaginer dans une telle occasion : ensuite la reine jetant les yeux sur son neveu, elle lui fit un accueil très favorable, et lui réitéra ce qu’elle avait promis au nécromancien. Elle aurait parlé plus longtemps, mais le bruit qu’on faisait dans la cour du palais, l’ayant obligée de mettre la tête à la fenêtre, elle eut l’agréable surprise de voir arriver la reine sa sœur. Le prince et l’infante qui regardaient aussi, reconnurent auprès d’elle le vénérable Biroqua, et jusqu’au bon Criquetin qui était de la partie ; les uns pour les autres poussèrent de grands cris de joie ; l’on courut se revoir avec des transports qui ne se peuvent exprimer ; le célèbre mariage du prince et de l’infante se conclut sur-le-champ en dépit de la fée Fanferluche, dont le savoir et la malice furent également confondus.
 votre commentaire
votre commentaire
-
La Promesse des Fées
Renée Vivien


Le vent du soir portait des chansons par bouffées,
Et, par lui, je reçus la promesse des Fées…Avec des mots très doux, les elfes m’ont promis
D’être immanquablement mes fidèles amis.Mais n’attachez jamais votre âme à leurs paroles,
Un Elfe est tôt enfui, souffle vif d’ailes folles !..
.
Leur vol tourbillonnait, vague comme un parfum.
Cependant tous semblaient obéir à quelqu’un.La première portait sur son front découvert
Une couronne d’or… Son manteau semblait vert.Et la couronne d’or, brûlant comme la flamme,
Rayonnait au-dessus d’un visage de femme.
Malgré l’étonnement d’un cœur audacieux,
Je ne pus endurer la splendeur de ses yeux…
Car j’entendais un bruit d’étreintes étouffées…
Aussi j’ai voulu fuir l’amour fatal des Fées…Mais, devant ce bonheur mêlé d’un si grand mal,
Ne regrettais-je pas un peu l’amour fatal ! votre commentaire
votre commentaire
-
L’Amitié Féminine
Renée VIVIEN (1877-1909)


Renée Vivien, née Pauline Mary Tarn le 11 juin 1877 à Londres et morte le 18 novembre 1909 à Paris, surnommée « Sapho 1900 », est une poétesse britannique de langue française du courant parnassien de la Belle Époque.
Durée : 4 minutes et 59 secondes
 votre commentaire
votre commentaire
-
La Guerre sainte
René DAUMAL (1908-1944)


René Daumal, né à Boulzicourt, Ardennes le 16 mars 1908 et mort à Paris, le 21 mai 1944, était un poète, critique, essayiste, indianiste, écrivain et dramaturge français.
Durée : 14 minutes et 20 secondes
 votre commentaire
votre commentaire
-





 ACCUEIL
ACCUEIL LE LIVRE D'OR
LE LIVRE D'OR M'ABONNER
M'ABONNER COMMENTAIRES
COMMENTAIRES 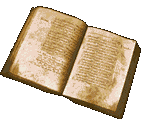
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot